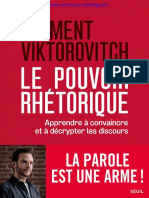Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Livre Blanc Cgem
Livre Blanc Cgem
Transféré par
abdel__amalCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Livre Blanc Cgem
Livre Blanc Cgem
Transféré par
abdel__amalDroits d'auteur :
Formats disponibles
LIVRE BLANC
2.
LIVRE
BLANC
Pour renforcer et consolider
le dynamisme de lconomie marocaine
LIVRE BLANC
2.
2.
Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc
2 0 0 7
2
LIVRE BLANC
Sommaire
2.
2.
Introduction
I. Renforcer la formation du capital humain
13
1 Les limites du dispositif de la formation professionnelle
15
2 Propositions
17
3 Appel une rupture profonde du systme denseignement
23
Un dsquilibre financier structurel mettant en danger le financement de la formation continue
Une sous-utilisation des Contrats Spciaux de Formation (CSF)
Les enjeux dune refonte des CSF
Le scnario pour la refonte des CSF
Une gouvernance bipartite rpartie entre reprsentants des entreprises et reprsentants des salaris
Un dispositif aux missions largies
Des mcanismes de contrles nentravant pas lefficacit du dispositif
Un fonctionnement reposant sur un mcanisme de qualification des oprateurs
Une gestion oprationnelle guide par lobligation de rsultats
Le financement
II. Aider a lmergence de PME comptitives et thiques
25
1 Ncessit damliorer la cohrence et lefficacit
de laide aux PME
27
2 Propositions
28
Recentrer les programmes dappui la PME
Principes gnraux du Plan de Dveloppement pour la PME
Une fiscalit plus souple et plus dynamique pour des PME plus thiques et plus cratrices demploi
Sommaire
LIVRE BLANC
2.
2.
III. Professionnaliser la Justice
1 Constat
33
36
Une diffusion du droit partielle, alatoire et ingale
Des formations inadaptes et peu concrtes des professionnels du droit
Insuffisance du budget de la Justice
Une prminence de la culture contentieuse et un faible dveloppement des modes alternatifs de rglement des conflits
La corruption
2 Propositions
43
Assurer une meilleure diffusion du droit dans un souci de transparence et de prvisibilit de la rgle
Renforcer la formation des professionnels du droit
Doter la Justice de moyens la hauteur des ambitions de modernisation du systme judiciaire
Privilgier les solutions non contentieuses pour le rglement des diffrends
IV. Amliorer la comptitivit de la fiscalit
49
1 Le manque de comptitivit de la fiscalit marocaine
51
2 Propositions
53
LIS marocain, un des taux les plus levs au monde
Impact potentiel dune rduction de lIS de 35% 25%
Modalits pour une baisse significative de lIS
Accompagner la rduction de lIS par une simplification du fardeau administratif
Une fiscalit adapte aux TPE et la lutte contre linformel
Achever rapidement la rforme de la TVA en assurant sa neutralit
pour les oprateurs conomiques
Continuer la baisse des taux dimposition de lIR et encourager lpargne salariale
Accompagner la mise niveau des entreprises, leur restructuration et leur dveloppement
Accompagner le dveloppement des entreprises linternational
Fiscalit des groupes et transactions intragroupe
Consolidation des rapports administration/contribuables
V. Lever les rigidits sur le march de lemploi
63
1 Les limites du Code du travail
65
2 Propositions
67
3 Appel la rouverture du dbat sur le droit du travail
72
Inapplicabilit de certaines dispositions du Code du travail
Le vide lgislatif sur le droit de grve
Les amendements au Code du travail
Les minima de la loi sur le droit de grve
Repenser les grands principes du Code du travail
La promotion progressive des conventions collectives
Annexe
Intervenants dans le dispositif des contrats spciaux
de formation (CSF) actuellement en vigueur
75
76
LIVRE BLANC
Introduction
2.
2.
Lconomie est au cur de la problmatique du dveloppement du Maroc. Par sa capacit crer de la
richesse, lconomie contribue rduire la pauvret; en gnrant de lemploi, elle renforce la cohsion
sociale. Enfin en influant sur les relations internationales, lconomie participe au rayonnement d'un
pays sur la scne mondiale.
La puissance dune nation est ainsi troitement lie la force de son conomie. Mais il ny a ni fatalit
ni miracle : une conomie forte se construit. Le dynamisme dont fait preuve lactivit conomique
marocaine en apporte rsolument la preuve. Dans les secteurs du tourisme, de lhabitat, la mise en
place de plans stratgiques alliant panouissement de linitiative prive et rle moteur de lEtat, a
donn une impulsion sans prcdent ces secteurs, moteurs aujourdhui de la croissance. A une
chelle sectorielle, les plans Azur ou Emergence ont ainsi montr que lactivit conomique a besoin
dune stratgie, de plans dactions et de pilotage.
Fixer les priorits, dfinir les objectifs pour une plus grande efficacit conomique
Il sagit aujourdhui dappliquer les recettes, dj exprimentes au Maroc, lensemble de lconomie
afin de consolider les acquis, de renforcer le dynamisme et de gagner de manire prenne les points
de croissance indispensables lmergence dune conomie marocaine performante et solide, capable
de mettre en place les mcanismes de solidarit essentiels. Comme la performance conomique et
le progrs social vont de pair, davantage defficacit conomique permet de mieux faire face aux dfis
sociaux.
Pour gagner ces points de croissance, il convient de dfinir les objectifs dans le cadre de stratgies
cohrentes et concertes, de fixer les priorits et didentifier les moyens mettre en uvre pour assurer
leur ralisation. Une fois les rles de chacun clairement dfinis, le niveau des rsultats dpendra de la
capacit de lensemble des acteurs, publics et privs, assumer pleinement leur mission.
Parce que lconomie est un jeu complexe dinteractions entre diffrents acteurs, son bon
fonctionnement ncessite au pralable une dfinition claire et lisible des missions et responsabilits
de tout un chacun.
Introduction
LIVRE BLANC
2.
2.
A lEtat de rguler lconomie et aux oprateurs dentreprendre
Ainsi, lEtat, acteur part entire de lconomie, a vu ses missions voluer en fonction de la nature
des modles conomiques retenus pour le dveloppement du pays. Dans une conomie ferme et
protge, lEtat tait administrateur et centralisateur. Dans une conomie ouverte et libralise, lEtat
devient rgulateur et catalyseur. LEtat veille assumer ce rle fondamental et tous ses efforts sont
concentrs sur la ralisation de cette mission.
Aux oprateurs conomiques dchanger et dinvestir, eux donc de crer de la richesse. Cette place
centrale de lentrepreneur et de lentreprise, on la doit au modle conomique retenu par le Maroc. Le
choix fait dans les annes 80 douvrir et de libraliser lconomie a conduit une drglementation
progressive de lensemble des secteurs dactivit et au dsengagement de lEtat des secteurs productifs.
Progressivement, lentreprise marocaine a t amene occuper le devant de la scne conomique.
Aujourdhui, parce que lentreprise renferme en somme lessentiel du potentiel productif de notre
conomie, linstar de toute conomie librale, elle permet de crer et de redistribuer de la richesse.
Principal employeur du pays et principal producteur fiscal, l'entreprise occupe ainsi une place
fondamentale dans la dynamique sociale.
Encourager linitiative prive et reconnatre la russite
Une conomie est dynamique si ses entrepreneurs sont engags, innovants, efficaces et thiques.
Mais le dynamisme ne se dcrte pas. Si changer, investir, incombe en effet au chef dentreprise,
son choix dentreprendre est motiv par la perspective du profit et de la russite. Lengagement du
Maroc sur la voie de lconomie de march implique de ce fait une volution de nos mentalits : il faut
bien comprendre que la recherche de cration de valeur est le moteur de tout oprateur, lincitant
10
augmenter ses changes et ses investissements. Cest l lessence mme du modle libral et il se
doit dtre assum pleinement. Lencouragement de linitiative prive, la reconnaissance de la russite
sont les fondamentaux requis pour soutenir lentreprenariat au sein de notre socit. Instaurer un
climat de dynamisme propice la cration et au dveloppement des entreprises permettra aux plus
talentueux, nationaux et trangers, de crer et dvelopper leur projet ici plutt quailleurs.
Pour autant, il ne saurait y avoir de cration de richesses en dehors de lthique et du respect des
normes de bonne conduite. Seul lentrepreneur thique mrite dtre cout, encourag et respect. En
adoptant sa charte de responsabilit sociale, la CGEM a clairement affich son engagement observer,
dfendre et promouvoir les principes universels de responsabilit sociale et de dveloppement durable.
Il sagit pour nos entreprises de respecter scrupuleusement les normes comportementales bases
sur le droit international public existant en la matire, et plus particulirement dans le domaine social,
environnemental et de la gouvernance dentreprise.
Des propositions concrtes pour ldification dune conomie performante
En conclusion, sil incombe loprateur conomique dentreprendre, les choix qui soffrent lui
sont troitement lis la qualit du march dans lequel il volue et la qualit dexcution de la
partition confie chacune de ses composantes. Lentreprise vit ainsi en interaction constante avec les
institutions conomiques et sociales que sont le march du travail, le systme fiscal, lappareil ducatif
et la justice.
Ce livre blanc na nullement la prtention desquisser un modle conomique. Il a pour vocation de
formuler des propositions concrtes et ralistes pour contribuer ldification de notre conomie, avec
la ferme conviction quelle sera encore plus performante, plus solide et plus solidaire. Cest l lobjectif
de ce livre blanc.
11
LIVRE BLANC
2.
2.
Renforcer
I. la formation
du capital humain
12
13
LIVRE BLANC
Renforcer la formation du capital humain
limites du dispositif de la Formation
1 Les
2.
Professionnelle
au Maroc
2.
A court terme, la principale menace qui pse sur lentreprise et le dynamisme conomique est le
manque de ressources humaines qualifies. Linadquation entre le besoin des entreprises et loffre de
travailleurs qualifis se doit dtre corrige au plus vite.
La formation professionnelle est la fois un levier pour amliorer lemployabilit des entrants sur
le march du travail et un instrument de mise niveau des comptences au sein de lentreprise. Au
Maroc, le dispositif de formation professionnelle a t conu pour rpondre ces deux objectifs. Il
dlivre ainsi deux types de formation : la formation initiale visant rpondre au besoin de qualification
des demandeurs demplois et la formation en cours demploi pour valoriser les comptences et la
comptitivit des salaris. La formation en cours demploi est une des clefs pour rpondre aux nouvelles
exigences dadaptation du capital humain aux volutions du monde du travail.
Aujourd'hui le systme de formation professionnelle ne permet pas de rpondre de manire satisfaisante
au besoin de qualification des entreprises. Lanalyse du dispositif actuel a conduit la CGEM rflchir
et laborer un nouveau mode de gestion des Contrats Spciaux de Formation, principale mesure
existante dans le cadre de la formation en cours d'emploi. Le soutien la comptitivit des entreprises
marocaines et de ses ressources humaines, confrontes une concurrence internationale croissante,
ncessite la mise en place dun dispositif de formation professionnelle souple et efficace.
Mais la refonte du systme de formation professionnelle ne saurait tre envisage elle seule
pour compenser les dfaillances du systme denseignement au Maroc et rsoudre les problmes
dinadquation entre lenseignement et la demande sur le march du travail. La formation professionnelle
est conditionne en amont par le systme denseignement en gnral. Et cet effet, la CGEM appelle
une rforme en profondeur du systme de lEducation Nationale et de la Formation Professionnelle.
Le dispositif public de la Formation Professionnelle repose principalement sur le dcret de 1974 qui
instaure la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) au profit de lOffice de Formation Professionnelle
ainsi que le mcanisme des Contrats Spciaux de Formation (CSF). Cette taxe, collecte par la CNSS
pour le compte de lOFPPT, reprsente 1.6% de la masse salariale brute des entreprises prives et
des Etablissements Publics Caractres Industriel et Commercial (EPIC) et alimente directement le
budget de fonctionnement de lOffice et le systme des CSF.
Suite une modification du dcret de la TFP en 2002, seuls 70% de cette taxe doivent tre consacrs au
financement de la formation publique, encore appele formation initiale, et 30% affects la formation
continue (CSF et GIAC 1).
Paralllement, en 2002, le Gouvernement a fix comme objectif lOffice la formation de 400 000 jeunes,
en doublant ses capacits. Afin de raliser cet objectif, lOFPPT a consenti un effort consquent en matire
de dveloppement du dispositif de formation initiale 2. Cet effort sest traduit par une optimisation trs
forte du dispositif et des ressources pdagogiques consacres la formation initiale 3.
Mais pour atteindre les objectifs fixs par le gouvernement, lOFPPT a t amen recourir un
nombre croissant de vacataires et de prestataires de services, et donc augmenter son budget de
fonctionnement (+ 351 MDH entre 2002 et 2007). Or sur ces cinq dernires annes, lvolution conjugue
de la taxe de formation professionnelle, principale source de financement de lOffice, et de sa masse
salariale remet en cause lquilibre financier du dispositif de formation professionnelle et amne
sinterroger sur la capacit de lOFPPT assurer avec prennit sa mission en matire de formation
en cours demploi.
Les Groupements Interprofessionels d'Appui et de Conseil (GIAC) sont des associations qui peroivent une subvention globale de lOFPPT sur
la base dun plan daction. Leurs missions sont les suivantes : linformation et la sensibilisation la formation en cours demploi ; les tudes et
le conseil pour la dfinition dune stratgie de dveloppement des entreprises ; lingnierie des plans de formation en cours demploi. 9 GIAC
existent actuellement et couvrent les secteurs suivants : Tertiaire, IMME, Textile-Cuir, Technologie, Pches Maritimes, BTP, Htellerie Tourisme,
Agroalimentaire, Transport logistique.
2 Les effectifs en formation ont augment de 150% entre 2003 et 2007 alors mme que le nombre dtablissements est pass de 183 245 (+33%)
et le nombre de places pdagogiques a augment de 45%, passant de 48 500 70 500.
3 Optimisation de la gestion de ses moyens matriels et de ses ressources humaines (apprciation du ratio formateurs/personnel administratif),
gnralisation du systme de roulement et adaptation de la dure des formations qui a conduit la rduction de manire justifie du temps de
formation de 50 75% pour une cinquantaine de filires.
14
15
LIVRE BLANC
Renforcer la formation du capital humain
2.
2.
Un dsquilibre financier structurel mettant en danger le financement
de la formation continue
Entre 2002 et 2007, la taxe de formation professionnelle a augment en moyenne de 3,3% 4 par an,
passant de 760 MDHS 893 MDH.
La part de la TFP affecte au budget de fonctionnement de lOffice a elle augment sur la mme
priode de seulement 30 MDH (pour atteindre 638 MDH en 2007) alors que la masse salariale de
lOFPPT a augment de 351 MDH soit 961 MDH en 2007, reprsentant 153, 7% de la taxe de formation
professionnelle.
La hausse du budget de fonctionnement de lOFPPT traduit laccroissement des ressources de lOffice
vers la Formation initiale.
En ltat actuel des choses, les ressources financires ddies la formation professionnelle empchent
non seulement lOffice de dgager des ressources pour la formation des salaris de lentreprise mais
met en danger la sant financire de lOFPPT.
La CGEM en appelle ainsi un engagement formel de lEtat sur le financement de lOFPPT.
Une sous-utilisation des contrats spciaux de formation
Selon une tude mene par la Fondation Europenne pour la Formation sur le dispositif des Contrats
Spciaux de Formation, prsente en mars 2007, la formation continue via le mcanisme des CSF a eu
un impact trs positif sur les entreprises qui en ont bnfici 5.
Cependant, les rsultats de cette tude, ralise auprs des entreprises ayant bnfici des programmes
de CSF, doivent tre mis en perspective avec le faible nombre dentreprises ayant contract des CSF et
la sous-utilisation des fonds qui leur sont consacrs.
En effet, entre 2003 et 2005, le nombre dentreprises engages dans les programmes de formation
continue est en baisse constante passant de 1 233 1 062. A cela sajoute le faible taux de ralisation
en matire de budget engag. Ainsi sur la priode 2002-2005, 419 millions de dirhams nont pas t
consomms par les entreprises au titre des CSF.
Le manque de visibilit des ressources financires non engages au titre des CSF et le dsquilibre
financier li laccroissement du budget de fonctionnement de lOffice fait craindre que ce budget soit
consomm au titre de la formation initiale.
Compte tenu de limportance de la formation continue pour la comptitivit de lentreprise marocaine,
la CGEM propose la redfinition du dispositif de gestion des CSF afin damliorer son efficacit et de
rpondre rapidement aux besoins des entreprises marocaines en tant quacteurs du dveloppement
conomique du Maroc.
2 Propositions
Les enjeux dune refonte des CSF
Le dispositif actuel, prsent en annexe, est marqu par une trop grande complexit des procdures et par un
grand nombre dintervenants (OFPPT, Dpartement de la Formation Professionnelle, Ministre des Finances,
Trsorerie gnrale, Ministre du Commerce et de lIndustrie, CGEM, UMT - reprsentant des salaris).
Comme instrument de dveloppement, les CSF doivent au contraire reposer sur un dispositif de
gouvernance assurant une bonne gestion des fonds et une souplesse en matire d'excution ne pesant
pas sur les entreprises et capable de sadapter aux volutions de lconomie marocaine.
Le taux moyen est en baisse depuis 2005.
Un chiffre daffaires et une valeur de production sensiblement suprieurs, un accroissement de salaires et/ou une formation pour les salaris
forms, un dveloppement significatif des organismes de formation.
5
16
17
LIVRE BLANC
Renforcer la formation du capital humain
2.
2.
Le nouveau dispositif doit tre volutif en permettant de cibler les secteurs cls de lactivit conomique.
Dune part, il doit permettre un dveloppement cibl des comptences ncessaires lconomie du
Maroc, par domaine d'activit et par secteur conomique. Dautre part, il doit voluer avec les besoins
des entreprises et doit permettre de faire merger de nouveaux mcanismes (le systme actuel est
bas sur des lois ayant plus de trente ans). Enfin, le nouveau dispositif doit permettre de grer au mieux
le budget destin la formation continue.
Lassociation 6 est la forme juridique la plus avantageuse et la plus souple pour cette nouvelle entit
puisquelle permet de possder et dadministrer les subventions publiques , de recevoir laide du
secteur priv et mme les apports et soutiens des parties trangres ou dorganisations internationales.
Elle donne ainsi lopportunit de trouver des complments de financement la formation continue.
En outre, cette future association pourrait obtenir ds sa constitution une reconnaissance dutilit
publique.
Le scnario pour la refonte des CSF
Une gouvernance bipartite rpartie entre reprsentants des entreprises
et reprsentants des salaris
Afin dallger le poids administratif du dispositif et de responsabiliser les acteurs, il est propos de mettre
en place une nouvelle entit juridique, en charge des Contrats Spciaux de Formation et du financement
des GIAC, autonomie de gestion au sein du dispositif actuel.
Dispositif actuel
Dispositif propos par la CGEM
SEFP*
CNSS
Collecte de la TFP
OFPPT
OFPPT
CNSS
Comit de Gestion
30% de la TFP affecte la FCE
C C C S F
C R C S F
TFP
Organismes
de formation
Financement
de la formation continue
Collecte de la TFP
Comit de Gestion
30% de la TFP affecte la FCE
N O U V E L L E
E N T I T
**
***
Financement
des GIAC
Entreprises
bnficiaires
TFP
Organismes
de formation
Financement de la formation en
cours demploi et des GIAC
En limitant la responsabilit de la gouvernance aux partenaires sociaux, ce dispositif permet de
saffranchir des pesanteurs administratives lies la multiplicit des intervenants dans le dispositif
actuel. Il permet galement de responsabiliser les acteurs conomiques, en leur confiant le pilotage
et la gestion du dispositif de la formation continue afin de leur permettre de rpondre au mieux leurs
besoins.
Il est ainsi propos que cette association soit gre par un conseil dadministration, qui dfinira les objectifs
et les orientations annuelles. Ce conseil serait compos de 8 10 membres, 50% de reprsentants des
salaris et 50% reprsentants des entreprises. Le conseil serait prsid par un reprsentant de la CGEM
qui aurait une voix prpondrante.
Un dispositif aux missions largies pour mieux rpondre aux besoins
des entreprises
Cette nouvelle entit garde les mmes objectifs que lorganisation actuelle de gestion des CSF (pilotage du
dispositif des CSF, gouvernance et contrle du dispositif et gestion des paiements aux bnficiaires), mais
ses missions sont largies aux domaines suivants :
Entreprises
bnficiaires
la mise en place et la gestion dun dispositif de qualification (type labellisation), de suivi
et dvaluation des organismes de formation et cabinets de conseil
le suivi des besoins des entreprises en fonction de lmergence de nouveaux secteurs
et des ncessits de reconversion
lorganisation des contrles du dispositif de remboursement de la formation professionnelle
la prospective sur les mcanismes et les mthodes de formation en cours demploi.
* SEFP : Secrtariat d'tat la Formation Professionelle
CCCSF : Comit Central des Contrats Spciaux de Formation
*** CRCSF : Comit Rgional des Contrats Spciaux de Formation
**
18
Dahir n 1-58-376 du 15 novembre 1958 relatif au droit dassociation.
19
LIVRE BLANC
Renforcer la formation du capital humain
2.
2.
Pour cela, il est propos que 4 directions composent la nouvelle association, places sous la
responsabilit dun Directeur gnral nomm par le conseil :
La Direction des CSF assurera le pilotage du dispositif des CSF. Elle est en charge du choix des
orientations stratgiques, des arbitrages, des dcisions organisationnelles, des relations institutionnelles
et des dclinaisons rgionales.
La Direction des Oprateurs (Organismes de formation et Cabinets de conseil) sera responsable de
lattribution dun agrment aux organismes dont les formations sont reconnues et rembourses
guichet ouvert, ainsi que du contrle, du suivi et de lvaluation des oprateurs.
La Direction de lIngnierie et du Conseil reprendra les missions des GIAC (information et
sensibilisation la formation en cours demploi, tudes et conseil pour la dfinition dune stratgie de
dveloppement des entreprises, ingnierie des plans de formation en cours demploi).
La Direction de lEvaluation et de la Prospective ralisera une valuation annuelle du dispositif des
CSF par rapport aux objectifs sectoriels et gographiques. Elle assurera un suivi de linnovation dans le
domaine de la formation continue. Un Observatoire charg de suivre les volutions macro-conomiques
du tissu conomique du Maroc et de recenser les besoins de formation des entreprises et des branches
sera mis en place au sein de cette direction. Enfin, cette direction sera responsable des relations
institutionnelles avec les acteurs du domaine (Union Europenne, Banque Mondiale, autres).
Des mcanismes de contrles nentravant pas lefficacit du dispositif
La nouvelle entit nest pas soumise au contrle financier de lEtat au sens de la loi n69-00 mais
elle reste cependant soumise aux contrles de lInspection Gnrale des Finances et de la Cour des
Comptes. Elle est galement ouverte aux contrles du Ministre de la Formation Professionnelle.
En outre, sous la responsabilit dun Comit daudit, un dispositif de contrle interne est mis en place
permettant de garantir la bonne gestion du dispositif. Ce Comit dfinit les procdures de contrles
mettre en uvre pour garantir le bon fonctionnement du dispositif. Il diligente des contrles en faisant
appel un prestataire externe ou aux quipes de la nouvelle association. Il ralise un bilan annuel des
contrles et le prsente au Conseil dAdministration.
20
Des critres, dfinis par le Comit daudit et valids par le Conseil dAdministration, permettent
de cibler les contrles et den limiter la lourdeur (anciennet du bnficiaire dans le dispositif,
montant des remboursements, nombre de jours de formation rembourss, rptition des formations,
autres).
Un fonctionnement reposant sur un mcanisme de qualification
des oprateurs de la formation professionnelle et un systme de
remboursement guichet ouvert pour les entreprises
Dans la limite des rgles prcises par un nouveau guide de procdures, lensemble des entreprises
accdant au dispositif, cest--dire celles jour dans leurs dclarations auprs de la CNSS, bnficient
dun systme guichet ouvert : les entreprises ont la possibilit dobtenir un financement sans en avoir
fait la demande pralablement.
Le principe du plafonnement du remboursement en fonction du montant de la TFP dclare, actuellement
prvu par le Manuel de procdures en vigueur pour les CSF, est conserv afin de favoriser les PME.
La qualification des organismes de formation et des cabinets de conseil, ralise par la Direction des
Oprateurs, repose sur une valuation de lorganisme de formation son entre dans le dispositif.
Seules les prestations assures par des organismes ayant reu lagrment annuel de la Direction des
Oprateurs de la nouvelle entit pourront faire lobjet dun remboursement.
Un dispositif dvaluation en continu sera mis en place, sur la base dune valuation qualitative annuelle
des actions finances et des organismes de formation, et dune notation annuelle des oprateurs par
les entreprises bnficiaires. Les organismes de formation nationaux devront pralablement avoir reu
lagrment spcifique du Ministre de la Formation Professionnelle.
Le mcanisme de tiers-payant sera tudier. En effet, bien que certains risques importants soient
lis ce mcanisme (dresponsabilisation des entreprises, surfacturation ou surdimensionnement
des formations par les organismes de formation), il est aujourdhui pratiqu avec succs pour les
formations groupes.
21
LIVRE BLANC
Renforcer la formation du capital humain
une rupture profonde de notre systme
3 Appel
2.
denseignement
2.
Une gestion oprationnelle guide par une obligation de rsultats
La gestion oprationnelle des dossiers sera ralise par deux quipes. Dune part, les quipes
actuellement en charge du traitement des demandes daccs au dispositif et de la gestion des CSF
au sein de lOFPPT seront mobilises au sein de la nouvelle organisation par un contrat de service
entre la nouvelle entit et lOFPPT donnant lieu une facturation. Ce contrat favorisera ladhsion des
partenaires sociaux du fait de la mobilisation du personnel OFPPT. Il prsentera galement lavantage
de permettre la nouvelle entit de contrler laction et le fonctionnement des quipes en charge
de la gestion ainsi externalise des CSF, tout en reposant sur une relation client/prestataire, avec
un pilotage du dispositif par les rsultats. Dautre part, la nouvelle entit traitera le processus li au
remboursement des formations et les contrles lis.
Le mcanisme de financement
La nouvelle entit sera finance par une subvention globale verse par lOFPPT, dont le montant sera
au minimum de 30% de la TFP, montant dvolu la formation continue, puis dtermin chaque anne
sur la base dun budget prvisionnel prsent par le Conseil dAdministration de la nouvelle entit. Dans
cette perspective, une modification du dcret n2-73-633 relatif la taxe de formation professionnelle
(articles 7 13 cadre juridique des CSF) est ncessaire.
La nouvelle entit grera en toute autonomie ses dpenses. Les subventions sont attribues par
la nouvelle entit et les versements sont raliss directement par la nouvelle entit. Les frais de
fonctionnement sont financs grce une quote-part de la subvention globale verse par lOFPPT (sur
le modle du financement des GIAC, qui reoivent une subvention et prlvent 10% au titre des frais de
gestion), sur la base dun budget approuv par le Conseil dAdministration.
Ainsi, en confiant aux acteurs conomiques le pilotage, la gestion et la gouvernance du dispositif
de formation continue, le systme gagnera auprs de son public cible, entreprises et salaris,
crdibilit et lgitimit. La simplification des procdures, la clarification du rle des acteurs et la
capacit du nouveau dispositif voluer en crant de nouveaux mcanismes de soutien la formation
professionnelle amliorera sans commune mesure lefficacit dun dispositif dont dpend la comptitivit
des entreprises.
22
A elle seule, la refonte du dispositif de financement de la formation en cours demploi ne permettra
pas de livrer et de gagner la bataille des qualifications. A terme, lEtat ne pourra pas faire lconomie
dune redfinition de lensemble du systme de formation professionnelle dans toutes ses composantes.
Une vritable stratgie long terme doit tre dfinie afin dassurer une meilleure gouvernance du
dispositif de faon tablir une meilleure articulation entre les diffrentes composantes de la formation
(OFPPT, secteur priv de la formation professionnelle, enseignement suprieur), de dfinir clairement
les missions de lensemble des intervenants (Ministre de lEnseignement Suprieur, Secrtariat
d'tat la Formation Professionelle, Ministre de l'Education Nationale, associations professionnelles,
ANAPEC...), de mettre en place des dispositifs de contrle et dvaluation et dtablir une politique de
financement pour lensemble du secteur de la formation professionnelle.
Enfin, si la formation professionnelle permet de lutter contre le chmage des moins qualifis en
cherchant lever leur niveau de qualification, le fait dtre peu qualifi renvoie aux dfaillances de la
formation lmentaire. Elle atteste de la fracture entre le systme dducation nationale et le monde
professionnel.
On ne saurait trop le rpter : il est urgent de prendre des mesures pour aligner loffre de formation
de lenseignement suprieur sur les besoins dun secteur priv en plein essor. On ne peut indfiniment
supporter une situation des plus paradoxales o les entreprises souffrent du manque de travailleurs
qualifis quand des diplms se retrouvent sans emploi la sortie des universits.
Mais lenseignement suprieur ne saurait tre seul sur le banc des accuss. Un systme dducation
forme un tout : sa performance et son efficacit dpendent de la qualit de lensemble des maillons
qui le composent.
Et dans la formation des hommes et des femmes, tout se joue lcole, y compris leur aptitude
participer le jour venu la vie conomique avec leur potentiel de crativit et de prise dinitiatives.
Lcole doit tre adapte au monde daujourdhui et lon se doit de lui donner pour cela tous les moyens
ncessaires. Il est plus quurgent de revoir les outils pdagogiques et le fonds culturel de lenseignement
scolaire. Il ne sagit pas l dun plaidoyer pour une nime rforme mais un appel une rupture en
profondeur de notre systme denseignement.
23
LIVRE BLANC
Renforcer la formation du capital humain
2.
2.
Pour relever ce dfi, secteur public et secteur priv doivent travailler ensemble dans le cadre de
llaboration dun vritable partenariat public. Depuis la fin des annes 80, lEtat a mis en place des
mesures incitatives pour dvelopper loffre de lenseignement priv mais celles-ci se sont rvles
inefficaces et nont pas permis de faire merger une dynamique de complmentarit entre loffre
denseignement public et priv.
Par ailleurs, la mise en place de ce partenariat est dautant plus urgente que leffort fournir en
matire dquipements et dinfrastructures ne pourra tre support terme uniquement par le secteur
public dont les ressources sont limites.
Ainsi, la CGEM appelle le gouvernement placer au rang de ses priorits la dfinition, en concertation
avec le secteur priv et lensemble des intervenants, dune stratgie de dveloppement de loffre
dducation et de formation combinant secteurs public et priv.
24
Aider lmergence
II. de PME comptitives
et thiques
25
LIVRE BLANC
II Aider lmergence de PME comptitives et thiques
damliorer la cohrence et lefficacit
1 Ncessit
. aux PME
de2laide
2.
Conscients de limportance de la PME dans le tissu conomique marocain, les pouvoirs publics
marocains ont mis en place ds 1983 diffrents programmes et initiatives afin dassurer un environnement
juridique, fiscal, social, et administratif favorable cette catgorie dentreprise, dans le but daider
sa mise niveau.
Renforcer et consolider lconomie marocaine, cest avant tout agir sur la Petite et Moyenne Entreprise,
composante centrale et majeure du tissu conomique marocain. Cette spcificit nest pas propre au
Maroc : travers le monde 8, les PME reprsentent plus de 95% des entreprises, 60 70% des emplois,
et les conomies des pays de lOCDE leur doivent une grande partie de leur cration demploi . Mais
si dans les pays les plus riches, la PME est associe linnovation, au dynamisme et ladaptation
facile aux mutations et au dveloppement des marchs, dans les pays conomie en transition comme
le Maroc, la grande majorit des petites et moyennes entreprises sont encore trop marques par des
dfaillances structurelles qui les empchent de profiter de la souplesse et de la force dadaptation
propre ces petites structures.
Les PME marocaines voient en effet leur croissance fortement entrave par une structure financire
fragile et un mode de gestion familialiste9. La sous capitalisation, le manque de transparence
financire, la faiblesse des structures managriales, et la faible internationalisation de cette catgorie
dentreprises handicapent ainsi le dynamisme entrepreneurial, moteur de lactivit conomique.
A ces faiblesses structurelles du tissu conomique, sajoute la prdominance du secteur informel 10.
Sil nexiste pas de donnes chiffres sur la part de lconomie souterraine au Maroc, il est un fait
que nul ne saurait contester : un nombre important dentreprises 11, et particulirement celles de
petite taille (soit la majorit du tissu conomique), nobservent que partiellement la rglementation
tatique et particulirement fiscale. Cette part de lactivit informelle nest pas sans consquence sur
lactivit conomique : elle freine le dveloppement de ces entreprises qui, du fait de leur caractre
illgal, ne peuvent grossir au-del dune certaine taille ; elle cre une concurrence dloyale pour les
entreprises respectueuses des rgles du jeu. Les expriences de par le monde ont dailleurs montr que
limportance relative des PME et de lconomie souterraine a toujours t inversement proportionnelle
au dveloppement conomique.
Renforcer le tissu des PME marocaines, premier rseau dactivit et demploi, ne saurait se faire
en dehors dune dmarche visant rduire le poids de lconomie informelle. La mise en place
dune fiscalit adapte accompagne de mesures incitatives et lisibles visant lever les contraintes
structurelles auxquelles font face les petites et moyennes entreprises contribuera ainsi lmergence
dun rseau de PME solides et comptitives.
Rappel des principales initiatives existantes
S
2001
G 2005
Contrat Programme
Tourisme
INDH
G 2003
1996
Charte
de linvestissement
Fonds Hassan II
2002
Charte de la PME
2004
Contrat
Programme BTP
Rseaux de Diffusion
Technologiques
97% du tissu conomique est compos dentits ayant moins de 10 salaris, daprs les statistiques du dernier recensement conomique tabli
par le Haut Commissariat au Plan (2001-2002).
8 Promouvoir les PME dans loptique du dveloppement, OCDE, 2me confrence de lOCDE des Ministres en charge des PME, Istanbul, (2004).
9 Le secteur priv marocain 1954-2004, rapport du Cinquantenaire.
26
2006
2007
Contrat
Programme NTIC
Contrat Programme
Artisanat
Contrat
Programme Cuir
Rawaj (Commerce
intrieur)
Plan mergence
2002
Contrat
Programme Textile
Contrat programme
Textile
Initiative globale
Initiative sectorielle
Initiative thmatique
10
7
2006
Programmes MOUKAWALATI,
IDMAJ et TAEHIL
2002
Fonds
ISTIMRAR
FOMAN
2000
G 2006
Dans le "Memorendum conomique" de la Banque mondiale publi sur le Maroc, il est not que le secteur informel totalise 45% des emplois
hors agriculture, et reprsente environ 36% du PIB.
Deux enqutes, reprises dans le rapport sur le cinquantenaire (Etude sur le secteur informel au Maroc : 1956-2004) ont t consacres ce
sujet par la direction des statistiques en 1998 et 2000 et montrent que 93% des units de moins de 10 personnes interroges ntaient pas inscrites
sur les registres de la scurit sociale, et 69% dentre elles sacquittaient des impts professionnels (patentes, et impts locaux).
11
27
LIVRE BLANC
II Aider lmergence de PME comptitives et thiques
2.
2.
Mais malgr leffort substantiel des pouvoirs publics, ces programmes dappui ont eu un faible impact
sur le dveloppement des PME. Les indicateurs conomiques sont de ce point de vue sans appel :
depuis le milieu des annes 80 jusqu nos jours, la contribution de la petite et moyenne industrie
dans le dveloppement du secteur manufacturier a trs peu volu. En 20 ans, la part des PME dans la
production industrielle a fluctu entre 35 et 39%, les exportations ont stagn au mme niveau 12 et leur
contribution la valeur ajoute nationale na jamais dpass la barre des 10%.
Principes gnraux du Plan de dveloppement pour la PME 13
Le programme pour la cration et le dveloppement des PME et TPE : en justifiant dune
situation rgulire vis--vis de ladministration, les PME ont accs des mesures de base
(financement de prestations de conseil, allgement de la fiscalit, accs au foncier). Ce
programme est en particulier destin rduire le poids de lconomie informelle et amliorer
la comptitivit des PME.
Ce constat invite rflchir sur la pertinence et lefficacit des programmes de soutien mis en place.
Les mesures dappui ont t penses selon une logique de mise niveau de lentreprise. Mais labsence
de dfinition prcise des objectifs atteindre, la diversit et la complexit des instruments ainsi que la
multiplicit des intervenants ont nui lefficacit de ces mesures.
Le programme pour lappui aux PME fort potentiel de croissance : ce programme est
destin appuyer lmergence de nouveaux acteurs de rfrence dans lconomie marocaine
travers un accompagnement rapproch et un soutien personnalis aux PME et TPE ligibles.
Les PME slectionnes se verront attribuer, au-del des mesures proposes par le programme,
le label PME MAROC. Ce label de qualit permettra la PME daffermir sa crdibilit vis--vis
de ses partenaires (clients, fournisseurs, banques, administration).
2 Propositions
Recentrer les Programmes dappui la PME dans le cadre dun plan de
dveloppement
Un changement dorientation doit tre opr dans les politiques mises en place pour le dveloppement
de la PME. Laction publique doit tre recentre autour dune nouvelle dynamique qui consiste agir
de manire forte et coordonne au plus prs du terrain sur un ensemble de leviers qui concourent la
croissance de nos PME. Selon cette logique, la CGEM a entam une rflexion avec les pouvoirs publics
pour la mise en place de programmes cibls en fonction des diffrents segments de PME.
Il ne sagit pas de proposer une nouvelle srie de mesures pour la PME mais dlaborer une approche
structure qui reprend et optimise les mesures daccompagnement existantes, dans le cadre dun plan
de dveloppement ciblant les diffrentes catgories de petites et moyennes entreprises soutenir et
promouvoir.
Afin dassurer cette initiative un impact massif et durable, il convient de concentrer laction sur
un vivier dentreprises dment slectionnes. Ceci permettra dviter le risque de saupoudrage des
mesures et permettra dobtenir des rsultats visibles plus rapidement, condition indispensable pour
obtenir un effet dentranement. Les PME et TPE les plus innovantes serviront ainsi de locomotives et
de relais pour diffuser la nouvelle dynamique.
Chaque programme doit disposer dun calendrier et dobjectifs chiffrs en terme de PME cibler et doit
tre dot dun budget dtermin, destin financer les actions prcises. Le financement des diffrents
avantages du plan pourra tre assur par le Fonds pour la Promotion de la PME prvu dans le cadre
de la Charte de la PME. A cette fin, il est propos dlaborer un dcret pour la mise en uvre de ce
fond et de lui attribuer un budget annuel pour couvrir les cots des mesures dappui offertes aux PME
et aux TPE.
Afin dassurer une bonne coordination des actions et un suivi des programmes, lANPME, en collaboration
avec la CGEM, pourrait tre charge du suivi oprationnel du plan (production de statistiques, ralisation
daudits) et de llaboration dun rapport annuel sur les rsultats.
Au-del dune logique de mise niveau de lentreprise, ce plan de dveloppement pour la PME sinscrit
dans le cadre dune approche globale de la comptitivit de lconomie marocaine. Sa russite implique
au pralable une rvision de la fiscalit de lentreprise.
12
Etude comparative de la petite et moyenne industrie et de la grande industrie au Maroc, publie en mars 2007 par la Direction des Etudes et
des Prvisions Financires, Ministre des Finances.
28
13
Le Plan de dveloppement de la PME est en cours de finalisation avec les pouvoirs publics.
29
II Aider lmergence de PME comptitives et thiques
LIVRE BLANC
2.
2.
Une fiscalit plus souple et plus dynamique pour des PME plus thiques
et plus cratrices demplois
Ainsi, la CGEM propose dinstaurer un barme pour lIS dmarrant 20% pour la tranche du rsultat
fiscal de moins de 2 millions de dhs.
Cette mesure ne saurait tre apprcie indpendamment de lensemble dans lequel elle sinsre
savoir une rvision gnrale de la fiscalit, comme il le sera dtaill dans le chapitre sur la fiscalit,
et plus particulirement une rduction de lImpt sur les socits dont le seuil maximal doit tre fix
terme 20%.
Si la pression fiscale exerce sur lentreprise marocaine est leve, comme le dmontre ltude sur
la comptitivit de la fiscalit marocaine prsente dans le chapitre suivant, elle lest encore plus
lorsquil sagit des petites et moyennes entreprises aux structures fragiles et marques par une souscapitalisation chronique. Cette charge fiscale nest pas sans consquence : dune part, elle pousse les
entreprises fuir limpt en crant des activits informelles ; dautre part, elle nuit au renforcement
des fonds propres de ces entreprises, et entrave ainsi leur croissance.
Amliorer les capacits dautofinancement
Ce sont les petites et moyennes entreprises qui crent le plus demploi. Mais comme le souligne
ltude du Ministre des Finances 15, ce sont elles aussi qui en dtruisent le plus du fait des contraintes
structurelles auxquelles elles doivent faire face et qui empchent leur prennit. Les PME connaissent
notamment de grandes difficults pour trouver les moyens ncessaires leur dveloppement.
Ladoption dun rgime progressif de lIS adapt la taille de lentreprise permettra doffrir un moyen de
financement supplmentaire permettant lentreprise de rinvestir ses bnfices pour se dvelopper
et crer de lemploi.
Rduire le poids de lconomie informelle
La lutte contre linformel ne saurait se faire par la sanction. Lenvironnement conomique doit susciter
les rflexes pour que sopre naturellement le transfert des activits informelles vers la sphre officielle.
Pour cela, les avantages que procure la lgalit doivent tre suffisamment attractifs et lisibles.
Par sa rigidit et son taux lev, lImpt sur les socits dissuade les entreprises du secteur informel
rallier la sphre officielle 14. Cette charge fiscale leve renchrit pour loprateur conomique le cot
dentre dans lconomie formelle et motive les entreprises rester dans linformel.
Par ailleurs, l'objectif de la mise en place d'une fiscalit adapte la PME est aussi de permettre aux
petites et moyennes entreprises de dtenir des bilans rels et bancables. Ainsi, les financements tant
dcris par les petites entreprises pour leur inaccessibilit deviendront possibles.
La progressivit de lImpt sur les socits par tranche, en rduisant le cot dentre dans lconomie
formelle, permettrait dinciter les entreprises rejoindre la sphre officielle.
La rvision de la fiscalit sur lentreprise propose par la CGEM procde ainsi dune nouvelle manire
denvisager limpt en transformant une taxation peu dynamique en un investissement crateur
demploi.
Le basculement sera favoris par le fait que la non-observation de la rglementation tatique reprsente
un cot pour lentreprise : tenter dchapper au contrle de lEtat oblige en effet les entreprises
demeurer petite en de de leur taille optimale et constamment dvier les ressources pour cacher
leurs activits, ou corrompre pour chapper leurs obligations. Il sagit donc de capter cette part des
ressources par la mise en place dun taux dimposition suffisamment attractif.
14 Les donnes de ltude sur la comptitivit de la fiscalit marocaine, prsente dans le chapitre suivant, montrent que dans les pays dEurope
de lEst o les taux dIS moyen taient les plus levs, lconomie informelle a augment plus rapidement. Les rsultats dtaills de ltude sont
prsents en annexe.
30
15
Etude comparative de la petite et moyenne industrie et de la grande industrie au Maroc, Ministre des Finances.
31
LIVRE BLANC
2.
2.
III.
32
Professionnaliser
la Justice
33
LIVRE BLANC
III Professionnaliser la Justice
2.
2.
La scurit juridique et judiciaire constitue un lment fondamental pour les investisseurs, pour le
dveloppement conomique, l'image et la comptitivit du Maroc et de ses entreprises.
Les autorits marocaines ont entam, durant les quinze dernires annes, une vaste rforme en
matire de droit des affaires dans laquelle sinscrivent les rformes du droit boursier, des marchs
financiers, des droits commerciaux et des socits commerciales, des rgles applicables en matire de
marchs publics, des textes sur la protection des droits de la proprit industrielle et commerciale et
des droits dauteurs, du code des assurances, de la loi sur les tablissements de crdit et organismes
assimils, la cration des tribunaux de commerce, etc.
Par ces textes, le lgislateur a voulu doter le secteur des investissements des garanties ncessaires
leur dveloppement dans des conditions de scurit juridique optimales.
Mais il ne suffit pas de se doter d'un cadre juridique moderne. Encore faut-il s'assurer de l'effectivit
des lois, de la scurit juridique des investissements, de la sanction du non-respect des contrats et
plus encore, de la possibilit concrte et effective d'excuter une dcision de justice.
Lefficacit de la rgle de droit se mesure en pratique l'occasion de sa mise en uvre par lautorit
charge de son application. Pour ce faire, les rformes du cadre des affaires doivent tre accompagnes
de mesures garantissant leur efficacit. Notre conomie a besoin dun systme juridique capable
dappliquer les rglementations de faon efficace, rapide, transparente et claire dans des conditions
rpondant aux standards internationaux.
34
Des progrs ont t raliss dans le cadre de la modernisation et de la moralisation de la justice
marocaine. Les tapes franchies ces dix dernires annes sont palpables (informatisation des services
des greffes, mise en place dun systme on-line pour le suivi des dossiers dfrs devant certains
tribunaux du Royaume, cration de tribunaux de commerce et administratifs, accent mis sur la
formation des juges, contrle, valorisation des rmunrations, renforcement de l'inspection, etc.).
Ces volutions n'ont pourtant pas russi amliorer de manire significative l'image du systme
judiciaire qui continue d'tre jug par les justiciables, en gnral, et par les entrepreneurs, en particulier,
comme peu efficace et vulnrable. Les oprateurs conomiques estiment que le fonctionnement de la
justice au Maroc ne leur offre pas des niveaux de transparence et de scurit suffisants pour leur
permettre de faire valablement valoir leurs droits. Or, sil est un secteur o le zro dfaut est de
mise, cest bien la justice !
Ce livre blanc na ni la prtention ni lambition dapporter une rponse aux maux de la justice marocaine.
De nombreuses tudes ont t menes ce sujet par des organisations nationales et internationales,
et de multiples chantiers sont aujourdhui ouverts. Les pouvoirs publics, en gnral, et le Ministre
de la Justice, en particulier, sappliquent amliorer les performances du systme judiciaire.
Lobjet des recommandations de la CGEM consiste davantage faire ressortir de faon synthtique les
attentes identifies des oprateurs conomiques dont la prise en compte est susceptible dassurer une
meilleure adquation entre loffre de linstitution judiciaire et la demande des entreprises.
35
LIVRE BLANC
III Professionnaliser la Justice
21.Constat
2.
Une diffusion du droit partielle, alatoire et ingale
Grce la publication du bulletin officiel en version lectronique et des outils du type "Artemis",
l'accs aux textes est aujourd'hui quasiment gnralis en langues arabe et franaise.
Des progrs considrables ont t raliss en matire de publication de la jurisprudence par le Ministre
de la Justice, ainsi que par l'Institut Suprieur de la Magistrature, les associations de barreaux et par
certains tribunaux.
La diffusion de la jurisprudence reste toutefois partielle, alatoire et ingale. Malgr l'absence d'effets
contraignants d'une dcision judiciaire, la jurisprudence reste une des principales sources du droit
marocain ; plus particulirement lorsqu'il s'agit de dcisions rendues par la Cour Suprme qui, de fait,
s'imposent aux juridictions d'un rang infrieur.
Etant donne sa diffusion limite, il est difficile de considrer la jurisprudence marocaine comme une
source fiable et effective de droit.
Dans la pratique, les professionnels du droit ont souvent recours aux prcdents de droit gyptien,
syrien ou franais pour tayer un argumentaire de droit marocain et qui font lobjet de recueils beaucoup
plus faciles daccs.
En dehors des quelques dcisions publies par la Cour Suprme de faon slective et de quelques
autres parutions relativement confidentielles, la diffusion de la jurisprudence nest ni systmatique ni
gnralise.
Cette lacune conduit inluctablement lincohrence des dcisions rendues, parfois mme au sein de
juridictions relevant du ressort de la mme Cour dAppel, ce qui nuit la transparence du systme.
Des formations inadaptes et peu concrtes des professionnels du droit
Le rendement de lappareil judiciaire est affect par les dysfonctionnements inhrents l'ensemble
des corps auxiliaires concourant la justice. La formation des professionnels du droit reste insuffisante
pour leur permettre d'assurer les responsabilits auxquelles ils sont destins. Elle doit tre roriente
vers lacquisition de connaissances plus oprationnelles devant permettre de professionnaliser les
praticiens du droit pour les aider apprhender les situations de manire proactive et compatibles
avec les exigences volutives du march.
36
En amont, la formation des tudiants est insuffisante
La formation de l'tudiant en droit s'apparente un "parcours du combattant", o les conditions ne
sont pas en place pour favoriser la "production" de juristes de qualit capables d'accompagner de
manire satisfaisante les besoins en dveloppement du Royaume.
La slection des tudiants en amont
Laccs la facult de droit est libre, en ce sens qu'aucune slection n'est opre, l'inverse d'autres
disciplines. La facult de droit hrite ainsi, souvent, de bacheliers moins qualifis par rapport dautres
filires denseignement suprieur considres comme plus porteuses.
Rendre le droit plus "vivant" pour les tudiants et plus adapt aux exigences du march
L'enseignement du droit est essentiellement thorique. Les tudiants ont du mal s'extraire de leurs
cours, prendre du recul par rapport la lettre du "polycop" pour apprendre l'appliquer de manire
pratique et relle. On demande davantage ltudiant dapprendre que danalyser.
Linteraction entre la facult et le march professionnel est quasi inexistante. Cette relation devrait
pourtant favoriser la compatibilit des programmes avec les besoins du monde conomique dans
lequel le futur praticien sera amen voluer.
Lenseignement des langues
Deux sections, l'une en langue franaise et l'autre en langue arabe, coexistent de manire quasiment
tanche au sein de la facult de droit. La matrise de la langue franaise reste pourtant indispensable
pour un juriste amen travailler sur des dossiers commerciaux, la plupart des actes de la vie des
affaires tant rdigs dans cette langue.
Lenseignement de langues trangres reste marginal l'heure o le Maroc s'inscrit dans une logique
de mondialisation et o la matrise, outre du franais, des langues anglaise ou espagnole nest plus
un luxe.
Les stages obligatoires
Peu de laurats de la facult de droit ont eu l'occasion d'effectuer des stages dans le cadre de leur
parcours universitaire. Un tel passage par l'entreprise, les juridictions, les cabinets d'avocats et autres
lieux d'apprentissage est non seulement obligatoire dans la plupart des pays trangers, mais reste le
seul moyen de confronter l'tudiant la ralit professionnelle, lui permettant dans le mme temps
d'apprhender les attentes du terrain, de jauger ses connaissances et, le cas chant, d'ajuster sa
trajectoire. Sur le terrain, la diffrence de perception entre les tudiants ayant ralis des stages et
ceux qui n'en ont pas eu l'occasion est manifeste.
37
III Professionnaliser la Justice
LIVRE BLANC
2.
2.
Absence de spcialisation
Les matires enseignes aux magistrats sont extrmement varies. La spcialisation des magistrats
reste dans la pratique trs insuffisante. Certes, la polyvalence est ncessaire chez les magistrats, en
ce que la formation d'un praticien de droit commercial serait incomplte sans la matrise des principes
gnraux de droit civil ou de la procdure civile. A l'inverse, quoi sert-il de consacrer beaucoup de
temps la procdure pnale ou aux droits de lhomme pour des magistrats qui sigeront au sein
de tribunaux de commerce ; ou dinvestir autant de temps se familiariser avec les difficults des
entreprises pour un juge se destinant une carrire dans les affaires familiales ?
La complexification des affaires nest plus en pratique conciliable avec une comptence totale des
magistrats dans toutes les matires juridiques. Elle exige en revanche une matrise fine des rgles
auxquelles il doit tre fait appel pour trancher les litiges qui leur sont soumis.
Absence de contrle efficace des connaissances des avocats
Les conditions dexercice et les obligations quotidiennes du stage ne permettent quasiment jamais aux
futurs avocats de combler les lacunes de leur formation universitaire. Par ailleurs, il n'existe pas de
contrle effectif de l'acquisition des comptences professionnelles pendant la dure du stage. Ajoutons
cela l'existence de centaines d'avocats stagiaires sans "bureau fixe", qui exercent en tant livrs
eux-mmes, sans que leur travail soit contrl par un matre de stage.
La formation continue des magistrats
La matire juridique est une construction "mouvante" et volutive (cadence des rformes, mondialisation,
volution de la jurisprudence, etc.). L'enseignement universitaire et la formation de base ne suffisent
pas, en ltat actuel des choses, permettre aux praticiens du droit de rester " la page".
Les efforts dploys par le Ministre de la Justice en matire de formation continue sont importants,
mais les moyens consacrs pour le financement des sessions de formation restent trs insuffisants. Le
nombre des formateurs permanents reste limit par rapport aux besoins.
Les sessions de formation continuent de faire appel des mthodes traditionnelles, privilgiant des
enseignements acadmiques caractre thorique, souvent inadapts.
Insuffisance du budget de la Justice
Le faible budget de la Justice est lorigine de nombreux maux dont elle souffre : le manque de moyens
matriels, linsuffisance des formations, la faiblesse du traitement du personnel judiciaire, ltat de
dlabrement des locaux, les tentations de fonctionnaires sous pays, etc.
L'efficacit de la justice est tributaire de son budget qui reste trs modeste par rapport aux besoins.
L'image de la justice en ptit ncessairement et sa crdibilit en est par consquent affecte. La justice
se trouve implicitement sacrifie dautres priorits et la pression des besoins les plus immdiats se fait
alors sentir au point dexclure toute vision davenir, comme en tmoigne la faiblesse chronique de la part
des investissements dans le budget de la justice.
Les dotations budgtaires qui lui sont affectes ont certes t sensiblement augmentes durant la dernire
dcennie, mais elles restent trs faibles au vu de ltendue des chantiers ncessaires la modernisation
du systme judiciaire marocain.
Des traitements trop faibles
Malgr des efforts importants durant les dernires annes, le traitement des magistrats reste modeste au
regard des enjeux dont ils ont la charge. Le salaire du personnel de juridictions est encore plus faible. De
nombreux auxiliaires de justice peroivent des rmunrations peine suprieures au salaire minimum.
Un tel niveau de rmunration expose forcment le personnel judiciaire aux risques de corruption, plus forte
raison lorsque les sommes en jeu sont importantes. A terme, si les rmunrations du personnel judiciaire ne
sont pas sensiblement revalorises, et pour peu que la pression sur le march des ressources humaines se
poursuive, il sera de plus en plus difficile pour la justice dattirer des comptences de qualit.
Des moyens matriels dsuets
A quelques exceptions prs (la Cour Suprme et quelques cours d'appel), les locaux dans lesquels sont
situs les tribunaux marocains sont dans un tat de dsutude avance qui, il faut le reconnatre, projettent
une image ngative du systme judiciaire l'gard des justiciables. Lexercice de leur mission dans ces
conditions influe galement sur le moral des auxiliaires de justice qui se sentent ainsi dvaloriss.
Une carte judiciaire inefficiente
L'parpillement des tribunaux, en raison notamment de la cration de juridictions spcialises, au vu
notamment de l'accroissement du nombre de dossiers dfrs la justice, nuit de manire significative
au rendement des professionnels du droit. Un mme avocat ou autre auxiliaire de justice effectue
38
39
III Professionnaliser la Justice
LIVRE BLANC
2.
2.
rgulirement, sur une base quotidienne, des trajets de plusieurs heures pour accomplir les diffrentes
dmarches qui lui incombent dans les diffrents tribunaux d'une mme ville, au dtriment de la qualit
du travail de fond qu'il est cens accomplir.
Un tel clatement est contre productif plusieurs gards : il implique le recrutement d'effectifs
supplmentaires alors que le temps et l'nergie des professionnels du droit et de leurs assistants
pourraient tre utiliss de manire plus efficace ; une perte de temps superflue pour les professionnels qui
doivent suivre des procdures pendantes dans diffrents tribunaux de la mme ville ; et un accroissement
inutile du budget de la justice qui pourrait tre utilis de manire rationnelle.
Un nombre de magistrats insuffisant
Le nombre de magistrats a cr durant les dix dernires annes de manire moins importante que
l'augmentation de la population et le dveloppement des dossiers soumis aux tribunaux. Il n'est pas
raliste de penser que les affaires confies la justice puissent tre traites de manire approfondie et
rigoureuse, au regard du temps imparti au traitement de chaque dossier.
Peu d'avocats se sont spcialiss en matire de conseil juridique aux entreprises. La formation
des avocats reste en rgle gnrale celle dun gnraliste qui nest pas suffisamment arm pour
accompagner les besoins de plus en plus pointus et techniques des oprateurs. A lheure actuelle, le
conseil juridique nest pas rglement et est pratiqu de manire ingale par diffrents intervenants,
qui ne sont pas toujours dots du bagage juridique ncessaire. Les barreaux ne communiquent pas
sur le rle que pourraient jouer les avocats dans le domaine de conseil en droit des affaires. Lavocat a
conserv cette image de plaidant et dhomme de prtoire .
Le recours aux Modes Alternatifs de Rglement des Conflits (MARC) ou "Alternative Dispute Resolution"
(ADR) a fait ses preuves dans tous les pays o il a t introduit, rduisant au passage de manire
significative les affaires portes devant les tribunaux en encourageant les parties rsoudre leurs
diffrends avant le recours aux tribunaux.
Une prminence de la culture contentieuse et un faible dveloppement
des modes alternatifs de rglement des conflits
Outre le fait qu'elle a galement vocation soulager les tribunaux, cette mthode permet gnralement
de rduire le dlai des procdures, les cots s'y rapportant, en assurant une confidentialit et une
flexibilit plus importantes que celles offertes par les juridictions traditionnelles.
La grande majorit des litiges au Maroc est rgle de manire contentieuse devant les tribunaux. Il est
rare que les avocats chargs dun dossier privilgient la voie de la ngociation amiable.
Les MARC sont souvent considrs comme des complments utiles d'autres rformes juridiques et
judiciaires.
Les tribunaux sont donc victimes dune judiciarisation excessive des affaires qui entrane une surcharge
corrlative des magistrats et qui se traduit immanquablement par un allongement des dlais judiciaires
de traitement des dossiers.
De mme, nombre de diffrends pourraient tre vits si les relations entre les parties un procs sont
rigoureusement formalises dans le cadre daccords contractuels prpars par des professionnels, de
sorte anticiper en amont des situations dont lissue aurait t encadre dans la convention les liant.
Le recours larbitrage reste modeste, malgr les avantages quil prsente, en raison notamment dun
rgime juridique actuel peu adapt. Les modes alternatifs de rsolution des diffrends restent, quant
eux, peu usits sur le march marocain.
40
Hormis en matire de droit du travail, le recours l'arbitrage et la mdiation reste limit au Maroc ; faute
peut-tre de communication suffisante sur ces modes de rglement des conflits et de soutien administratif
et technique de la part des centres d'arbitrage.
Les deux MARC les plus usits sont la mdiation et l'arbitrage
L'arbitrage est souvent le mode de rglement des diffrends privilgi par les investisseurs et les
partenaires trangers, mais il reste plus adapt des oprations relativement complexes, compte tenu
des cots qui en rsultent. L'arbitrage permet en effet d'avoir recours des arbitres spcialiss pour
traiter, le cas chant, de dossiers caractre technique.
41
III Professionnaliser la Justice
LIVRE BLANC
2 Propositions
2.
2.
Son efficacit est toutefois tributaire du systme judiciaire dont dpend l'excution des sentences
arbitrales qui doivent obligatoirement faire l'objet d'une exequatur pralable.
Assurer une meilleure diffusion du droit dans un souci de transparence
et de prvisibilit de la rgle
La mdiation, quant elle, est susceptible d'avoir un impact beaucoup plus important, en raison
notamment de la population plus large laquelle elle s'adresse et au cot beaucoup plus faible que
celui li l'arbitrage.
Un accs gal de tous les professionnels et justiciables l'information juridique est une garantie
supplmentaire de transparence et de cohrence dans les dcisions de justice.
La mdiation consiste analyser une situation objet d'un conflit et tenter de trouver une solution
amiable qui recueillerait l'adhsion des parties au litige.
Les pouvoirs publics marocains soutiennent le dveloppement des MARC pour les diffrends
commerciaux. Un projet de loi relatif l'arbitrage et la mdiation a t approuv par le conseil du
gouvernement et est actuellement l'tude par la Chambre des Conseillers du Parlement.
La corruption
De nombreuses initiatives sont mises en uvre (augmentation des salaires, missions dinspection,
etc.) dans le but de moraliser la justice, mais en pratique, le fonctionnement de la justice reste dans
une large mesure biais par la corruption. Celle-ci intervient des niveaux varis et peut produire des
rsultats divers : falsification de preuves, disparition dun dossier, retard injustifi dune procdure,
interprtation en faveur dun justiciable, recours la force, dlais dans les excutions, retard dlibr
dun huissier pour une notification, expertise complaisante, ect.
Quels que soient les progrs accomplis rcemment dans ce domaine, les oprateurs conomiques
qui ont eu affaire encore rcemment aux tribunaux se plaignent gnralement de son manque de
transparence. Or, le moindre grain de sable dans la machine judiciaire est susceptible de fausser
le fonctionnement normal et efficient de la justice, tant donn la capacit de nuisance dont dispose
le personnel de ladministration judiciaire des auxiliaires de justice quand leur pouvoir est utilis
mauvais escient.
42
Une diffusion gnralise de la jurisprudence est donc de nature permettre :
- une plus grande harmonie et cohrence dans les dcisions rendues par les diffrents
tribunaux,chambres ou autres juridictions, rduisant les risques de contradiction entre les
dcisions rendues sur la base des mmes textes ; ce n'est parfois qu' l'issue d'un renvoi aprs
cassation que les juridictions du fonds prennent connaissance des dcisions de
la Cour Suprme, ce qui est, bien entendu, source de dysfonctionnements importants dans le
processus judiciaire ;
- un contrle efficient de la part de la hirarchie ;
- dans une certaine mesure, une certaine transparence sur les conditions dans lesquelles la
justice est rendue par les magistrats.
Recommandations :
Il est primordial pour une bonne justice que la diffusion de la jurisprudence soit gnralise
et systmatique
Afin d'tre exploitable, une indexation des dcisions et un rfrencement de manire
thmatique devront tre organiss au lieu d'un simple classement chronologique comme
c'est le cas aujourd'hui
La publication des dcisions de la Cour Suprme devrait tre assure en priorit. Celle des
Cours d'Appel et des juridictions de premire instance pourraient arriver ensuite.
Un accs informatique devrait galement tre possible avec des moteurs de recherche par
mots cls
Des tudiants en droit pourraient tre mis contribution pour la ralisation de ce travail, ce qui
au passage leur permettrait de parfaire leur matrise de l'tat de la jurisprudence au Maroc.
43
LIVRE BLANC
III Professionnaliser la Justice
2.
2.
Renforcer la formation des professionnels du droit
A terme, une spcialisation plus pousse du corps de la magistrature devrait permettre de remdier
l'insuffisance de la formation. Augmenter les domaines de spcialit est la seule manire daccompagner
les volutions de lenvironnement des affaires. Une meilleure formation et une spcialisation plus
pousse devraient terme permettre aux juges de statuer plus rapidement sur des dossiers relevant
de leur expertise ; ce qui impactera positivement sur la dure des procdures judiciaires et remdiera
la lenteur de la justice.
Amliorer la coopration entre lentreprise et les professionnels du droit (stages de formation,
immersions, etc.) et donner accs des outils similaires ceux du monde de lentreprise favoriseraient
une revalorisation des professions judicaires par la restauration de leur image de marque et conduiraient
un changement probable des mentalits.
Lutilisation des technologies de linformation et de la communication augmenterait lefficacit et la
productivit de la justice.
Recommandations :
La rforme de l'institution judiciaire restera sans effet si la facult de droit demeure accessible
tout bachelier sans que des quotas soient fixs. Un systme slectif mme de rehausser le
niveau des tudes universitaires doit tre mis en place
Les dotations des facults de droit en infrastructures et en moyens logistiques doivent tre
renforces
Le cursus universitaire doit tre davantage orient vers la pratique du march des affaires et
vers l'tude des langues
Les tudiants en droit doivent tre mis au contact des professionnels pendant leur cursus
(stages obligatoires, interventions de praticiens au sein des universits, etc.)
Pour plus d'efficacit, la formation thorique des magistrats et des procureurs devrait donc
s'inscrire dans le cadre d'une stricte spcialisation
La formation des magistrats et des auxiliaires de justice doit intgrer lutilisation des
technologies de linformation et de la communication
44
La mise en place effective des centres de formation des avocats, dont linstauration a pourtant
t prvue depuis le 10 septembre 1993, est ncessaire
Un contrle plus troit des comptences des avocats (acadmique, dontologie, aptitude
exercer la profession d'avocat, etc.) est souhaitable
L'effectivit du stage doit galement tre contrle
La cohrence de la formation et une meilleure allocation des ressources doivent tre exiges en priorit.
Les mthodes traditionnelles dencadrement des sessions de formation doivent tre revisites
Renforcer les traditions et le sens de lhonneur des professions judiciaires en les enseignant
lors des formations prparatoires ; encourager lenseignement de lthique et de la dontologie.
Doter la Justice de moyens la hauteur des ambitions de modernisation
du systme judiciaire
La revalorisation des salaires devrait rduire le risque dexposition la corruption et permettre dattirer/
de retenir des comptences de qualit, et de manire plus gnrale, revaloriser les professions judiciaires
dans leur globalit. Le renforcement des effectifs est de nature permettre une spcialisation plus
importante des magistrats, et partant, une plus grande clrit dans le traitement des dossiers.
Par ailleurs, lamlioration des conditions matrielles de travail doit permettre daugmenter lefficacit
du fonctionnement du systme judiciaire. La modernisation de la justice contribuera amliorer son
image et sa crdibilit auprs des justiciables, et plus gnralement des citoyens.
La mise en place de cits judiciaires devrait tre srieusement envisage en vue damliorer la
productivit et d'assurer un fonctionnement plus rationnel du systme judiciaire marocain. A terme,
une telle mesure favoriserait une rduction du budget de la justice.
45
LIVRE BLANC
III Professionnaliser la Justice
2.
2.
Recommandations :
Recommandations :
Le pouvoir judiciaire devrait tre dot dun budget autonome et indpendant du budget de lEtat
Le montant des indemnisations alloues aux juges doit tre revu la hausse
La modernisation des locaux est ncessaire de faon amliorer l'image de la justice.
La rationalisation de la cartographie des tribunaux est indispensable
Les effectifs de la justice doivent tre renforcs
Des services payants susceptibles de permettre aux juridictions de lever des ressources
complmentaires doivent tre cres
Une simplification des procdures devrait tre envisage
Des mesures d'accompagnement pourraient galement tre entreprises pour inciter les
magistrats utiliser les techniques modernes de gestion des dossiers et le recours, dans toute
la mesure du possible, aux modes alternatifs de rglement des diffrends
Un changement de culture doit tre opr pour encourager les magistrats tre proactifs dans
la gestion des procdures.
Privilgier les solutions non contentieuses pour le rglement des diffrends
Renforcer la formation des avocats dans le domaine du conseil et faire voluer la culture des
praticiens par rapport au contentieux
Amliorer la communication institutionnelle des barreaux sur la capacit des avocats
intervenir dans ce domaine
Promouvoir le conseil juridique ds l'universit
Inciter les avocats favoriser les solutions amiables pour vier les litiges sans intrt
Vulgariser ces mthodes auprs des intervenants, entreprises ou spcialistes du droit.
Favoriser la structuration des cabinets davocats et leur spcialisation (rgime juridique et
fiscal moins contraignant que celui actuellement en vigueur).
Dvelopper les MARC, par leur vulgarisation et la cration de centres spcialiss.
Appuyer techniquement la formation de mdiateurs.
Encourager les magistrats, dans certains cas, proposer une partie dans une affaire
contentieuse le recours la mdiation pralablement l'instruction de leur affaire.
Inviter les oprateurs conomiques insrer des clauses de mdiation et/ou d'arbitrage dans
les accords qu'ils passent avec leurs partenaires.
Le recours en amont au conseil juridique par lobtention de conseils fournis de manire prventive
et par la rdaction d'actes juridiques devrait assurer une plus grande scurit juridique pour les
clients. Laccent mis sur une approche conseil plus oriente vers la ngociation de solutions amiables,
permettrait galement de privilgier dans certains cas la rsolution de diffrends de manire extra
judiciaire. Le recours aux MARC permettrait sans aucun doute de soulager les tribunaux qui font face
un accroissement constant des affaires enrles et permettrait ainsi de rduire les besoins budgtaires
se rapportant au secteur de la justice.
46
47
LIVRE BLANC
2.
2.
IV.
48
Amliorer la
comptitivit de la
fiscalit marocaine
49
IV
LIVRE BLANC
Amliorer la comptitivit de la fiscalit marocaine
2.
2.
La comptitivit de lentreprise marocaine ne saurait dpendre uniquement du comportement et de la
qualit de ses gestionnaires. Il revient certes au chef dentreprise dadopter des stratgies commerciales
et des modes de fonctionnement innovants et comptitifs, mais la prennit et la croissance de son
entreprise sont troitement lies son environnement.
La comptitivit de lentreprise ne peut tre apprcie indpendamment de lensemble dans lequel
elle sinsre et dans lequel la fiscalit constitue un pilier majeur. En matire fiscale, la pression qui
pse sur lentreprise marocaine est aujourdhui un handicap majeur pour sa comptitivit. Limpt est
concentr sur une assiette fiscale troite et sur les salaris des entreprises transparentes. Le nombre
dentreprises et de salaris dclars tant infrieur au potentiel rel, la pression fiscale sur cette
population thique est maximale.
Une tude reprise par la Banque Mondiale rvle que le niveau lev de la pression fiscale est jug
comme la troisime contrainte au dveloppement par les socits marocaines. Ce constat est appuy
par lobservation des tendances fiscales dans les pays concurrents du Maroc et les pays conomie
similaire.
Une tude commandite par la CGEM auprs dun cabinet de renom international a conclu, sur la base
de lexamen du comportement des recettes fiscales dans des pays ayant rduit leur taux dIS, quune
rduction de lIS permettrait damliorer la comptitivit du Maroc par rapport ses concurrents
en diminuant la charge fiscale des entreprises. Cette rduction pourrait de ce fait stimuler les
investissements privs et trangers et prsenterait un risque limit sur les recettes fiscales, qui ont de
grandes probabilits daugmenter.
1 Le manque de comptitivit de la fiscalit marocaine
Ltude ralise par le cabinet Monitor Group 17 pour le compte de la CGEM a port sur un Benchmarking
international des rformes de lImpt sur les Socits (IS) afin de donner des indications sur les
bnfices potentiels dune rforme de lIS pour le Maroc et dapporter les lments de rponse sur
limpact potentiel dune rduction de lIS au Maroc, sur la base des rformes adoptes dans le monde
durant les 15 dernires annes.
En effet, avec un taux dimposition sur les socits se situant 35% et 39,6% 16, le Maroc s'loigne
largement de la tendance rgionale euro mditerranenne et de ses concurrents dEurope de lEst
qui sont une moyenne de 25% avec une tendance baissire vers 20%. Cette tendance irrversible
la baisse se justifie par une recherche active du renforcement de l'avantage concurrentiel des
investisseurs privs, et par des efforts pour attirer et fixer des investissements trangers.
LIS marocain, un des taux les plus levs au monde
Au Maroc, la structure des recettes fiscales ne milite pas non plus en faveur de lentreprise et de la
cration de richesse et demploi. Son volution privilgie en effet les impts directs par rapport aux
impts indirects. Il est constat une certaine inefficacit de la taxation indirecte, en particulier de la
TVA, qui fait que le systme fiscal repose sur une taxation leve des entreprises et un impt sur le
revenu des personnes physiques plutt prohibitif.
Les conclusions de ltude sont sans appel : une des variables sur lesquelles le Maroc accuse les plus
grands manques de comptitivit est la fiscalit.
Par ailleurs, et comme voqu dans le prcdent chapitre, la forte rglementation fiscale et son niveau
lev favorisent un secteur conomique informel important et pnalisent la croissance conomique.
La pression fiscale encourage linformel et avec laccroissement continu des dpenses publiques, la
contrainte budgtaire accrot la pression fiscale sur les entreprises organises. Ce cercle non vertueux
milite pour une baisse de la pression fiscale et ladoption dune fiscalit approprie.
16
39,6% pour les tablissements de crdit et les compagnies dassurances et certaines institutions financires publiques (CDG, BAM, ).
50
Sur 76 pays qui ont ralis une rforme fiscale, 52 dentre eux ont fait lobjet dune tude approfondie
et ont t slectionns en fonction de leur similarit structurelle avec le Maroc.
Le Maroc a un des taux dIS les plus levs au monde (35 %), en particulier si on le compare ses
concurrents (moyenne de 27 %). En terme de taux effectif, la diffrence est encore plus notable : avec
un taux effectif de 30 %, le Maroc se trouve plus de 13 points de la moyenne des pays comparables
(taux effectif de 17 %). De plus, tandis quau Maroc le taux standard de limpt sur les socits est rest
constant sur les dix dernires annes, les pays concurrents du Maroc ont tous diminu leur taux, dans
des proportions allant jusqu 60 % du taux initial.
17
L'tude est publie dans son intgralit dans un document joint au Livre Blanc de la CGEM.
51
IV
LIVRE BLANC
Amliorer la comptitivit de la fiscalit marocaine
2.
2.
Impact potentiel dune rduction de lIS de 35% 25%
Une hausse des investissements privs
Dans les 52 pays tudis, les rformes de rduction de lIS ont toutes t motives par la volont
damliorer la comptitivit de ces pays et daugmenter les investissements trangers et privs, afin
notamment damliorer la prosprit de leurs habitants en stimulant lemploi.
Ladoption dun taux dIS comptitif a eu un effet direct sur laccroissement des investissements. Daprs
les rsultats de ltude, les pays ayant un taux dIS de moins de 25 % russissent attirer relativement
plus dinvestissements trangers compars aux pays ayant un taux dIS suprieur 25% :
Les Investissements Directs trangers (IDE) reprsentent, en part du PIB, en moyenne au
moins le double de ceux des pays taux lev. Cette diffrence est encore plus notable en ce qui
concerne le nombre relatif de filiales trangres (entre 5 et 10 fois plus lev)
Ces pays ont connu une croissance des IDE 50 % plus rapide que celle des pays avec un taux
lev.
En conclusion, les pays taux dIS rduit gnrent plus dinvestissements privs, et ceux-ci augmentent
deux fois plus rapidement que dans les pays taux lev.
La lgalisation de lconomie informelle
Une rduction de lIS permet de rduire le cot dentre dans lconomie formelle pour une partie des
entreprises informelles, surtout lorsque cette rduction est accompagne de mesures visant rduire
la complexit administrative de dclaration dimpts ou encore la corruption.
Les rsultats de ltude ont ainsi montr que :
Un risque limit sur les recettes fiscales
Le risque associ une rduction du taux de lIS sur les recettes fiscales est trs limit. En effet, sur
les 52 pays tudis ayant rduit leur taux dIS, 48 dentre eux ont enregistr un accroissement des
recettes fiscales lies lIS. Dans la plupart des cas, les recettes de lIS ont cr plus rapidement que
le PIB. Il existe 4 pays sur les 52 tudis pour lesquels les recettes nont pas augment, mais celles-ci
ont soit stagn (Roumanie : -0.6%, Sri Lanka : -0.2%), soit diminu trs lgrement (Bulgarie : -1%,
Italie : -1.2%).
Il est par ailleurs intressant de constater que la croissance des recettes ne dpend pas du niveau de
rduction du taux de lIS mais du rythme de la rforme. Les pays qui ont augment le plus massivement
leurs recettes sont ceux qui ont procd aux rductions de taux les plus agressives.
En conclusion, une rduction de lIS prsente un risque limit sur les recettes fiscales qui ont, au
contraire, de grandes probabilits daugmenter.
2 Propositions
Modalits pour une baisse significative de lIS
Si la comptitivit nationale est une priorit pour le Maroc, les conclusions de ltude montrent quil
est vital de revoir la baisse de manire significative, et non pas au fil de petites retouches distances
dans le temps, le niveau du taux dimposition des entreprises.
La CGEM propose :
Les pays ayant un fardeau fiscal et administratif lev ont une conomie informelle plus
importante
En Europe de lEst, entre 1999 et 2002, lconomie informelle a augment plus rapidement
dans les pays taux dIS moyen ou lev.
En conclusion, une rduction de lIS accompagne de mesures spcifiques de simplification de la
structure fiscale permettrait dencourager la lgalisation dune partie de lconomie informelle.
52
Pour les socits imposes hauteur de 39,6%, le taux devra tre ramen dans limmdiat 35% (en
2008). Toutefois, ce taux dIS devra voluer pour atteindre moyen terme (horizon 4 ans) 30%.
Pour les entreprises soumises un taux dIS 35%, et pour encourager la PME, il convient dinstaurer
dans limmdiat un barme dIS qui se prsente comme suit:
20% pour la tranche du rsultat fiscal de 0 2 millions de dhs
30% pour le surplus. Ce taux devra tre ramen 25% dans les quatre ans venir.
53
IV
LIVRE BLANC
Amliorer la comptitivit de la fiscalit marocaine
2.
2.
Accompagner la rduction de lIS par une simplification du dispositif
administratif
La rduction de lIS devrait saccompagner de mesures spcifiques de simplification de la structure
fiscale afin daccrotre son efficacit et dencourager la lgalisation dune partie de lconomie
informelle.
Les modalits de paiement de limpt peuvent constituer un exemple damlioration, en permettant un
meilleur quilibre entre les droits et les obligations des contribuables et ceux profitant ou pesant sur
lAdministration. En effet, des paiements dacomptes dimpts alors que la socit est certaine de ne
pas avoir de rsultat pour lexercice suivant se traduisent, dans ce cas, par des paiements sans rapport
avec la future capacit contributive des entreprises. De mme, il est vital de repenser les possibilits
de rcupration des excdents dacomptes verss. Le systme actuel se traduit par des paiements
dimpts alors que le contribuable a des excdents de versements dimpts.
Il convient donc de :
De mme, certaines sanctions sont trop lourdes par rapport aux infractions commises. A titre purement
indicatif, des sanctions pour dfaut de dclaration fixes 15% de limpt thoriquement d pour les
entreprises exonres sont disproportionnes par rapport aux manques gagner par le trsor public.
Des sanctions pour manque dinformations sans incidence sur le montant de limpt d doivent tre
limites des pnalits fixes. La perte de 15% du crdit de TVA pour une dclaration tardive prsentant
un crdit de TVA sans incidence sur le montant de la taxe due devra tre revue.
Un quilibre devra donc tre atteint entre le souci dinciter les contribuables respecter leurs obligations
fiscales et celui de ne pas faire fuir une partie ou la totalit de lactivit de certaines entreprises vers le
secteur informel.
Une fiscalit adapte aux TPE et la lutte contre linformel
Lincitation des pouvoirs publics combattre linformel est une dolance dont les effets dentranement
sur lconomie marocaine ne sont pas dmontrer.
Il convient de sy mobiliser travers :
Prvoir la possibilit pour une socit, sous sa responsabilit, de ne pas payer dacomptes
provisionnels ou de payer un acompte modul en fonction de ses prvisions de rsultats
Permettre aux socits de pouvoir rcuprer le trop vers (excdent dacomptes sur limpt d)
sous forme dimputation sur les paiements exigibles dans le futur jusqu rcupration totale
des excdents verss
Rserver le mme traitement dimputation applicable aux acomptes aux impts retenus la
source qui, en ralit, constituent l aussi des acomptes dIS
Reconnatre la pleine responsabilit de lentreprise en matire de paiement spontan des impts
dont elle est redevable. En effet, le paiement des impts retenus la source sur les paiements
ltranger (redevances, intrts et autres) doit tre la seule initiative de lentreprise concerne.
La responsabilit de la banque intervenant dans le paiement est carter. Ce qui permettra de
mieux dfinir les responsabilits et une meilleure application de la loi fiscale.
Par ailleurs, le dispositif de sanction mis en place ne permet pas dencourager les rgularisations
spontanes par les contribuables de leurs situations. Les mmes sanctions sont applicables pour les
infractions spontanment corriges par les contribuables que pour celles dtectes par lAdministration.
54
Un dispositif fiscal incitatif et appropri : la baisse du taux dIS ou dIR professionnel au profit
des TPE permettant de les inciter sortir de linformel
Un dispositif dencadrement : la reconfiguration des conditions dimposition des forfaitaires
lIR et la hausse du seuil dimposition des dtaillants au titre de la TVA (2 millions de dirhams
actuellement).
Achever rapidement la rforme de la TVA en assurant sa neutralit pour
les oprateurs conomiques
La TVA est aujourdhui une taxe complexe et matire distorsion. La rforme engage en 2005 devra
donc tre rapidement acheve avec une visibilit pour les oprateurs conomiques. Il sagit de mettre
rapidement en place une TVA moderne et conforme aux meilleures pratiques internationales. Lobjectif
ultime tant llimination ou, tout au moins, la rduction progressive des distorsions inhrentes lactuel
systme. Ceci vise lamlioration du rendement de la fiscalit indirecte dans lobjectif dobtenir de
meilleures recettes fiscales mais aussi un allgement de la fiscalit directe.
55
IV
LIVRE BLANC
Amliorer la comptitivit de la fiscalit marocaine
2.
2.
Pour atteindre ces objectifs il est impratif de :
Simplifier cet impt travers, entre autres, la rduction de la grille des taux pour la limiter
dans un premier temps deux taux
viter que la TVA ne se traduise par un cot financier pour les oprateurs conomiques qui ne
sont que de simples intermdiaires (collecte et rcupration)
Revoir le niveau des taux retenir sur la base dtudes approfondies, tenant compte de leur
impact sur la consommation (taux normal et taux rduit). Ce niveau doit reflter un arbitrage
pertinent entre le niveau de la TVA et celui des impts directs
Simplifier les procdures de dclaration et de paiement de la TVA 18.
de main-duvre dans leur secteur, ne peuvent dans leurs premires annes dexistence rmunrer
leurs salaris dans des conditions comparables celles accordes par les firmes tablies.
Le systme actuel mrite donc dtre revu en levant le pourcentage de "labandonment" de 10 25 %
et en tendant le rgime aux participations dans des socits de groupe, et non pas ncessairement la
socit employeuse, ou dans des fonds communs de placements dentreprise.
Par ailleurs, le dveloppement des investissements en gnral, et de la Bourse en particulier, en tant
que moyen de financement des entreprises, passe entre autres par le drainage de lpargne de manire
durable vers ce march.
Continuer la baisse des taux dimposition de lIR et encourager lpargne
salariale
Cette opration peut tre encourage par des mesures fiscales, comme cest le cas dans bien
dautres pays, en mettant en place des Plans dpargne Actions (PEA), bnficiant de mesures fiscales
appropries, qui seraient mme dencourager le grand public procder des placements en actions.
La rvision de lImpt sur le revenu, annonce par le gouvernement depuis la charte de linvestissement
en 1996 19 et entame effectivement en 2007, doit tre poursuivie. En effet, en dpit de cette mesure, il
reste mettre en place une vritable rforme de lIR base sur une meilleure dfinition du revenu net
imposable et une rvision des tranches et des taux dimposition.
Il convient ce titre dtudier la mise en place des mesures fiscales suivantes :
Par ailleurs, dans une phase dinternationalisation de lconomie et pour un personnel hautement
qualifi gnralement trs mobile, lembauche ne se ralise plus dans le cadre national mais dans
un cadre plus global et mondial. La comptitivit fiscale est relle pour des cadres positionns sur
le march international de lemploi. La fiscalit des stock-options en vigueur au Maroc place nos
entreprises en position moyenne par rapport celles implantes ltranger. Elle pourrait inciter les
cadres qui souhaitent lever des plans de stock-options sexpatrier pour bnficier dans dautres
pays dexonration totale de leurs plus-values. Elle nencourage pas non plus les cadres trangers
sexpatrier au Maroc.
Linstauration des stock-options par la loi de finances 2001 peut tre considre comme un premier
signe dencouragement. Nanmoins, dautres mesures devraient suivre ainsi que la mise niveau de
ce mcanisme par rapport aux pratiques internationales.
Il est signaler que le rgime fiscal des stock-options au Maroc na pas prvu un rgime de faveur
linstar de la France, des tats-Unis et de la Grande-Bretagne, qui serait accord aux entreprises
nouvellement cres et aux socits de croissance, les start-up. Ces socits, confrontes une pnurie
18
19
La possibilit pour tout contribuable douvrir un PEA auprs des intermdiaires financiers
habilits
Lexonration des produits et plus-values provenant des placements effectus dans le cadre
du PEA qui ne peut tre employ que dans des placements risque : les actions cotes et les
OPCVM actions
Le maintien des sommes et valeurs dans le plan pendant une priode dindisponibilit ( quatre
annes) pour pouvoir bnficier de cette exonration
Une mesure fiscale incitative en matire dIR consisterait en une dduction du salaire
imposable lIR des sommes verses par les salaris dans les plans dpargne actions. Cette
mesure spcifique aux salaris, similaire au plan dpargne dentreprise, permettrait galement
dallger la charge fiscale de cette catgorie de contribuables, avec bien entendu les plafonds
qui simposent.
Le cot et le temps de gestion de cette taxe seraient, entre autres, lorigine du mauvais classement du Maroc par Doing Business 2007, World Bank.
Le taux marginal annonc tait de 41,5 %.
56
57
IV
LIVRE BLANC
Amliorer la comptitivit de la fiscalit marocaine
2.
2.
Accompagner la mise niveau des entreprises, leur restructuration et
leur dveloppement
La fiscalit doit accompagner et permettre la mise niveau des entreprises. Or actuellement, le
transfert des actifs dans le cadre dune fusion est tax 20 , lchange des actions des socits fusionnes
est galement considr comme crant une plus-value imposable. Le regroupement des participations
dans un holding familial, devant permettre une meilleure prennisation des groupes familiaux, se
traduit, l aussi, par la ncessit de constater des plus-values imposables.
Nombreuses sont en effet les oprations qui, faute de pouvoir se raliser sans frottement fiscal, sont
retardes sinon abandonnes. Cet tat de fait ne permet pas une mise niveau des entreprises, ni une
transmission et une prennisation des groupes. Ces oprations ne traduisant pas un enrichissement
de lentreprise ou de ses actionnaires doivent tre ralises sans frottement fiscal bloquant.
Devant limportance du rapprochement et du regroupement des entreprises marocaines en vue de
rechercher la taille critique, le lgislateur devrait toffer notre systme fiscal marocain par dautres
outils et instruments fiscaux trs familiers aux socits multinationales.
Il serait donc fortement souhaitable que les mesures ci-aprs soient prises trs court terme 21 :
Permettre la ralisation doprations de fusion sur la base des valeurs comptables, sans
constatation de plus-value imposable
Dispenser lchange des actions de la socit absorbe contre celles de la socit absorbante
de toute imposition lors de la fusion. Pour ces nouvelles actions reues en change, la plusvalue imposable sera calcule par rfrence au prix de revient des actions initiales 22 le jour de
leur cession
tendre le rgime fiscal des fusions aux oprations de scission pour que ces oprations puissent
tre ralises galement la valeur comptable sans constatation de plus-value imposable
tendre galement ce rgime aux oprations dapport partiel dactif 23
Prvoir un droit denregistrement fixe aux dites oprations stratgiques de restructuration, en
lieu et place dun droit proportionnel actuellement applicable
Clarifier le rgime fiscal des scissions en matire de droits denregistrement, de TVA, dchange
dactions, etc
Prvoir de manire permanente une disposition permettant aux entreprises individuelles de se
transformer en socit soumise lIS sans incidence fiscale. Cette mesure qui a t instaure
par le pass 24 mrite dtre adopte de manire permanente. Elle permettra aux entreprises
individuelles dadapter leur forme juridique et fiscale en fonction du dveloppement de leurs
activits
Instaurer un droit denregistrement fixe et non pas proportionnel aux oprations daugmentation
de capital. Il est en effet incohrent de continuer appliquer un droit proportionnel prohibitif et
dcrier la sous-capitalisation des entreprises.
Limposition des plus-values sur les actions entre les mains des socits holding se traduit par une
double imposition laquelle il convient de remdier. La richesse cre par lentreprise est dabord
impose chez cette dernire. La plus-value sur la cession des actions formant le capital de cette
entreprise devra bnficier dune exemption fiscale comme cest le cas pour les dividendes. Cette
exemption permet de neutraliser limpact fiscal, indpendamment de la nature juridique des revenus
perus par lactionnaire personne morale. Dailleurs, pour les personnes physiques, tant les plusvalues que les dividendes sont taxs de la mme manire (10 %).
20
Larticle 162 du CGI prvoit, sous certaines conditions, la possibilit de reporter la taxation de la plus-value sur les actifs immobiliss entre les
mains de la socit absorbante.
21 Ces mesures peuvent tre prises de manire transitoire, sinon permanente.
22 la suite dune fusion ou dune scission dfinie par larticle 210-0 A du CGI franais, mme non effectivement place sous le rgime spcial,
lattribution gratuite des titres reprsentatifs de lapport aux membres de la socit apporteuse nest pas considre comme une distribution
de revenus mobiliers et elle est exonre de limpt sur le revenu. Par ailleurs, les plus-values ralises par les associs loccasion de lchange
de titres bnficient dun sursis ou dun report dimposition applicable, quel que soit le rgime fiscal des oprations, que les titres soient dtenus
par des particuliers ou quils figurent lactif dune entreprise.
58
23 Lapport
partiel dactif est lopration par laquelle une socit apporte une autre socit (nouvelle ou prexistante) une partie de ses lments
dactif et reoit, en change, des titres mis par la socit bnficiaire de lapport (en France, un rglement sous une autre forme dans la limite de
10 % de la valeur nominale des titres attribus est toutefois possible : CGI franais, art. 80).
24 Mesure prvue par la loi de finances 1993 et reprise par larticle 12 de la loi de finances 1999/2000.
59
IV
LIVRE BLANC
Amliorer la comptitivit de la fiscalit marocaine
2.
2.
Accompagner le dveloppement des entreprises linternational
La mondialisation et linterdpendance des conomies favorisent et ncessitent une forte mobilit des
capitaux et des investissements. Le Maroc ayant fait le choix dune libralisation de son conomie doit
non seulement prvoir une meilleure structure daccueil aux investisseurs trangers, mais doit aussi
accompagner les entrepreneurs nationaux souhaitant une internationalisation de leurs activits. Une
fiscalit approprie, applicable aux revenus et profits de source trangre raliss par des entits
tablies au Maroc, devra donc tre mise en place. Ceci pourrait faire du Maroc une plate-forme d'accueil
pour les grands groupes mondiaux dsireux d'investir dans les pays de la rgion.
Ainsi, il est propos de prvoir une exemption totale au profit des dividendes de source trangre
perus par des personnes rsidentes au Maroc. Les plus-values sur des titres sociaux dtenus dans
des socits trangres devraient galement bnficier de la mme exemption.
Louverture du Maroc linternational et son corollaire, savoir les relations daffaires avec les socits
trangres, impose au systme fiscal marocain dtre en imbrication avec les systmes fiscaux
trangers afin de mieux apprhender limposition des oprations et revenus internationaux. Dans ce
cadre, les autorits fiscales ont acclr le dveloppement du rseau conventionnel marocain. Cet
effort louable gagnerait tre complt par des mesures dapplication et de vulgarisation. Le contenu
des conventions fiscales internationales signes par le Maroc doit tre appliqu en vitant tout prix
la double imposition.
Fiscalit des groupes et transactions intragroupes
Lextension du pouvoir dapprciation de ladministration fiscale aux transactions ralises entre
entreprises dpendantes tablies au Maroc constitue une mesure lencontre de la fiscalit des
groupes. Elle pourrait tre source de difficults dapplication pratique et vraisemblablement de
contentieux lavenir. En effet, la disposition relative au pouvoir dapprciation par ladministration des
prix de transfert, quon retrouve pratiquement dans les lgislations internes de la plupart des pays, ne
concernait jusqualors que les transactions internationales 25.
25 Il est en effet lgitime que les pouvoirs publics puissent disposer de moyens lgaux pour lutter contre les ventuelles tentations ou pratiques de
groupes internationaux qui pourraient chercher localiser les rsultats de leurs activits dans des pays fiscalit attrayante. Chaque tat devant
soumettre limpt les revenus gnrs par les activits ralises sur son territoire ne pourrait donc le faire sans confrer son administration le
droit dapprcier les prix de transferts pratiqus pour les transactions internationales entre entreprises dpendantes. Le Maroc, linstar dautres
pays, a institu depuis le dbut de la rforme fiscale ce pouvoir dapprciation par ladministration fiscale (ancien article 35 de la loi 24-86, devenu
article 4 du LPF et article 213 du CGI).
60
La raison dtre de ce pouvoir dapprciation ne se justifie pas lorsque les transactions ne concernent
que des entreprises tablies au Maroc, en labsence du risque de transfert de bnfices en dehors
du Maroc. Certes, lon peut bien comprendre que mme en labsence de transferts de bnfices en
dehors du Maroc, certains actes ou pratiques dentreprises tablies au Maroc pourraient aussi affecter
la matire imposable. Ainsi, on pourrait bien tre tent, lintrieur dun groupe, de transfrer les
bnfices dune entreprise une autre lorsque le rgime fiscal de cette dernire est plus avantageux.
Nanmoins, si dans les transactions internationales, tout cart par rapport au prix de pleine concurrence
peut tre lorigine de prjudice pour lun des tats parti de la transaction, ceci nest pas toujours le cas
pour les transactions nationales. Car deux entreprises lies soumises la mme fiscalit nont aucun
intrt fiscal transfrer indirectement les bnfices dune entit une autre en pratiquant des prix
anormaux 26. Elles ne peuvent donc baser les conditions de ralisation de leurs transactions que sur des
considrations conomiques, et non fiscales. Or, la lgislation marocaine ne comporte aucune disposition
express qui vise tenir compte de la ralit conomique des groupes pour justifier certains actes.
Il serait donc temps, la veille de louverture totale de nos frontires, de lancer au moins une rflexion
visant la mise en place dune fiscalit de groupe qui pourrait contribuer au dveloppement des
groupes nationaux dont le rle sur la cration demplois et, partant, sur la croissance conomique du
pays nest pas dmontrer.
Consolidation des rapports administration/contribuables
Les relations administration/contribuables constituent le carrefour dapplication du dispositif fiscal.
Elles se manifestent plusieurs niveaux dont la gestion du dossier fiscal du contribuable en ce qui
concerne les services dassiette, le contrle fiscal des dclarations, les rappels et les rclamations
pour rgulariser sa situation
26
Le pouvoir dapprciation de ladministration fiscale des actes de gestion mettant en relation des entreprises dpendantes nest pas totalement
absent du systme fiscal franais, duquel notre lgislation sest fortement inspire. Mais, la seule diffrence, ce pouvoir ne dcoule pas de la loi
(Code gnral des impts) mais plutt dune jurisprudence qui a t forge au fil des ans et connue sous la thorie de lacte anormal de gestion .
La question demeure donc une question de fait apprcier au cas par cas et ne doit pas faire lobjet dune disposition lgale caractre gnral qui
risque dtre applique tout azimut.
61
IV
LIVRE BLANC
Amliorer la comptitivit de la fiscalit marocaine
2.
2.
Des efforts considrables ont t accomplis dans le cadre de lorganisation des services de
ladministration fiscale avec une proximit et un service adapts chaque type de contribuable. Leffort
dinformatisation devra tre poursuivi afin damliorer les dlais de traitement, tels les remboursements
de TVA, la restitution des excdents dimpts verss. Il est galement souhaitable que le traitement des
rclamations soit amlior.
Le contrle fiscal pour sa part demeure le domaine auquel des amliorations mritent dtre apportes, savoir :
Le dlai du contrle devra tre rationalis en sorientant vers des contrles de plus courte dure
Comme dans tous les systmes fiscaux dclaratifs, la comptabilit du contribuable doit
demeurer le moyen de preuve unique, sauf si la preuve irrfutable du contraire est apporte
La mise en place dune charte du contribuable rsumant ses droits et ses obligations en cas de
contrle est plus que ncessaire, lesquels droits et obligations doivent tre quilibrs, en offrant
par exemple les mmes dlais de rponse aux contribuables qu ladministration
Les instances de recours doivent disposer de moyens la hauteur des responsabilits qui leur
incombent. La Commission nationale de recours fiscale, rattache sur le plan lgal au Premier
Ministre, doit tre dote de ses propres ressources.
V.
Lever les rigidits
sur le march
de lemploi
Les droits des contribuables doivent tre protgs de faon viter larbitraire. Larbitraire et la
dmesure des redressements peuvent constituer une srieuse entrave la confiance dans le systme
fiscal, sans laquelle tout esprit dentreprendre est de facto inhib.
62
63
LIVRE BLANC
Lever les rigidits sur le march de lemploi
2.
2.
A la pression fiscale exerce sur lentreprise marocaine sajoutent les fortes rigidits du march
du travail. Daprs le classement de la Banque Mondiale sur lenvironnement des affaires, les deux
dimensions sur lesquelles le Royaume accuse en effet le plus large retard en matire de comptitivit
sont la fiscalit et le cot de la rglementation sur le march du travail. La mise en place du nouveau
Code du travail a certes introduit plus de souplesse en ajoutant les contrats de travail temporaire et la
sous-traitance des services mais en revanche, les cots de recrutement et de licenciement, lambigut
de certaines dispositions et labsence de rglementation sur le droit de grve nont fait que renforcer
les rigidits prexistantes.
Sil est urgent de prendre les dispositions qui simposent pour clarifier les conditions dexercices
juridiques de lentreprise en matire demploi, terme cest lensemble mme de notre conception du
droit du travail au Maroc quil sagit de revoir.
En effet, la complexit de la lgislation lie la mise en place dun Code du travail gnral entrant
dans les dtails est source dinnombrables contentieux qui, terme, peuvent handicaper la cration
demplois. Lexcs de rgles destines la base protger lemploi conduit freiner les embauches et
concourt mettre lentreprise en inscurit juridique, dcourageant ainsi les employeurs recruter.
En traitant des rgles minimales pour la protection du salari et de lemployeur et en laissant le
contrat individuel ou les conventions collectives fixer les rgles pour les sujets non concerns par le
cadre gnral, le Code du travail gagnerait en cohrence, en lisibilit et serait plus prvisible. En ltat
actuel des choses, la rigidit quil implique joue un rle contre-productif dans le champs de la cration
demploi.
Or lemploi est le dfi majeur relever pour notre pays. Cest l le facteur essentiel pour amliorer
notre croissance et la condition de la poursuite simultane de la cration de richesses et de la cohsion
sociale. La lutte contre le chmage est une obligation incontournable pour rduire la prcarit et
assurer lensemble de nos concitoyens un niveau de vie dcent. La cration demploi est troitement
lie la rglementation du march du travail : si lobjectif est lemploi, une rglementation qui ne tient
compte que du renforcement de la protection de lemploi existant mais qui, par ailleurs, dcourage le
recrutement par les lourdes contraintes que cette protection entrane, accentue la prcarit lchelle
collective.
64
Lentreprise subit la loi du march : ses embauches dpendent uniquement de lactivit conomique.
Introduire plus de flexibilit dans la lgislation sur le droit du travail, cest permettre lajustement
conomique de lentreprise et lui donner la possibilit de supporter les fluctuations de la demande
aussi bien la baisse (une chute provisoire de son activit ne menacera pas son existence et par
consquent ni celle de la totalit de ses emplois), qu la hausse, puisqu'elle n'hsitera pas recruter
pour satisfaire sa croissance.
La flexibilit du march du travail peut contribuer faciliter l'ajustement conomique, rduire le
chmage et amliorer la qualit de vie de nombreux exclus de la vie conomique. Il sagit donc de
dfinir ensemble, partenaires sociaux, gouvernement et employeurs les conditions dexistence dun
march du travail ou flexibilit rime avec scurit des salaris mais aussi avec scurit collective. A
cet effet, la CGEM appelle dans le cadre du dialogue social la rouverture des discussions sur le Code
du travail.
1 Les limites du Code du travail
Inapplicabilit de certaines dispositions du Code du travail
Depuis le 8 juin 2004, les entreprises se sont trouves face une nouvelle lgislation comportant une
multitude dinnovations dont lapplication pour certaines reste difficile voire quasi-impossible.
Le respect dune loi dpend de sa clart, de la facilit de sa mise en uvre et surtout de la prcision
et de la pertinence des mesures quelle stipule. Incontestablement certaines dispositions du Code ne
peuvent tre mises en application, et dautres sont de nature engendrer de lourdes contraintes, pouvant
pnaliser la performance de lentreprise, voire sa comptitivit. De nombreuses dispositions doivent
tre amendes durgence pour permettre une meilleure application de la loi 65-99, les propositions de
la CGEM cet effet sont prsentes ci-dessous.
Toutefois ces mesures doivent tre suivies dune reprise gnrale des ngociations sur le Code du
travail afin de revoir lesprit mme du texte, inadapt aujourdhui aux mutations que connat lconomie
marocaine.
65
LIVRE BLANC
Lever les rigidits sur le march de lemploi
2 Propositions
2.
2.
Le vide lgislatif sur le droit de grve
Les amendements au Code du travail
Le droit de grve a toujours t reconnu dans toutes les constitutions qua connues le Royaume
depuis celle de 1962, qui a consacr ce droit comme un des principaux acquis en matire des liberts
publiques.
Mettre en cohrence les articles traitant des sanctions disciplinaires
En cas datteinte la libert du travail, le salari est suspendu pour une dure de 7 jours, et en cas
de rcidive la suspension porte sur 15 jours avant le licenciement dfinitif (Article 12). Cet article est
en contradiction avec larticle 39 qui considre lentrave la libert de travail, justifie par un PV de
linspecteur du travail, comme faute grave justifiant le renvoi immdiat sans indemnits ni pravis.
La constitution actuelle, celle de 1996, maintient le droit de grve dans son article 14 au mme titre que
le principe de sa rglementation qui doit tre promulgue sous forme d'une loi organique prcisant les
conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
Quarante-cinq ans aprs la premire constitution de 1962 et trois ans aprs lentre en vigueur du Code
du travail, le 8 juin 2004, cette loi organique reste toujours en instance, alors qu'elle est juge vitale
pour l'conomie nationale, voire pour la survie de l'entreprise marocaine.
Compte tenu du contexte conomique national marqu par une rude concurrence l'international et
par la ncessit de promouvoir l'investissement et l'emploi, il devient ncessaire de donner plus de
lisibilit sur les relations sociales travers une lgislation ngocie, rglementant entre autres le droit
de grve pour y prvoir aussi un dlai de pravis destin l'employeur donnant toutes ses chances la
mise en uvre d'une procdure de conciliation ou d'arbitrage, avant le dclenchement de la grve.
En signant l'accord relatif au dialogue social du 30 avril 2003, la CGEM avait comme objectif d'aboutir
la rglementation de toutes les mesures issues de cet accord en vue d'acclrer la mise en uvre des
avances sociales inscrites dans le nouveau Code du travail, et par consquent de favoriser le dialogue
social et dviter le recours prcoce et dsorganis une situation de grve.
Le projet de loi organique, qui a t soumis lors des ngociations en 2003 l'apprciation des diffrentes
parties concernes, constitue une base pour le dialogue et la ngociation. L'objectif n'tant pas de
restreindre le droit de grve mais bien d'viter que la prennit des units de production, et fortiori
l'investissement, ne soient remis en cause par des arrts de travail dont les motifs seraient autres que
des considrations professionnelles ou sociales, ou encore le fait de conflits pouvant tre rgls dun
commun accord dans le cadre des procdures de mdiation et de conciliation.
Les dispositions de larticle 12 doivent ainsi tre sanctionnes au mme niveau que les fautes graves
prvues par larticle 39. Ceci est dautant plus justifi quau regard des dispositions internationales,
notamment de lOIT, latteinte la libert du travail est une faute grave justifiant le renvoi immdiat
sans indemnits ni pravis.
Gradation des sanctions en fonction de la gravit de la faute
Les articles 37 et 38 du code prvoient 4 niveaux de sanctions disciplinaires appliquer graduellement.
Lemployeur ne peut ainsi appliquer une sanction en fonction de la gravit de la faute.
Il est propos que soit reconnu le principe de proportionnalit de la sanction la faute.
Assouplir le recours aux contrats dure dtermine
Les conditions de recours au contrat dure dtermine sont fixes par les articles 16 et 17. Deux ans et
demi aprs lentre en vigueur du code, il sest avr que les recours au CDD ont t trs peu pratiqus
du fait des faibles possibilits laisses lemployeur pour justifier dun recours au CDD. Par ailleurs, dans
le secteur des BTP, les entreprises ont recours au contrat dure dtermin dont lexpiration devrait
en principe attendre la fin du chantier. Le Code du travail ne fixant pas un cadre juridique pour ce type
particulier de contrat, lorsque le chantier excde une anne, les tribunaux ont tendance qualifier ce
contrat en CDI.
Les cas de recours aux CDD doivent tre largis en sappuyant sur les diffrents besoins des entreprises.
Il est en outre propos de reconnatre formellement lexistence dun contrat de chantier part entire
et den dfinir les caractristiques rglementaires.
Certes, le droit de grve est garanti par la constitution du Royaume tout salari qui veut l'exercer. Des
pralables sont ncessaires pour tayer le caractre lgal de la grve. Faute de loi spcifique, le droit
de grve reste dans bien des cas, rgi par la jurisprudence, ce qui ne contribue pas une clart des
droits et obligations de chacune des parties prenantes.
66
67
LIVRE BLANC
Lever les rigidits sur le march de lemploi
2.
2.
Lever les ambiguts sur le cumul des indemnits de licenciement
Daprs larticle 59, en cas de licenciement abusif, le salari bnficie de dommages et intrts et de
pravis prvus dans les articles 41 et 51 ainsi que de lindemnit perte demploi.
Or, il existe une ambigut sur le cumul de ces indemnits de licenciement (licenciement et pravis). Le
Ministre de l'Emploi confirme le non-cumul alors que des juges ont accord le cumul des indemnits.
Il est impossible pour nos entreprises dtre comptitives si elles ne sont pas sur le mme pied dgalit
que leurs concurrents.
Par ailleurs, linterprtation du 4me alina de larticle qui mentionne que la rduction du temps
de travail () nentrane aucune diminution de salaire doit tre prcise. Cette disposition pose un
problme dapplication en ce qui concerne la rduction des heures de travail de 48 heures 44 heures
avec le maintien du salaire pour les salaris pays lheure.
Il est propos de lever lambigut quant aux indemnits payer lors dun licenciement conduisant
actuellement un cumul des indemnits.
Augmenter la rduction des heures de travail en cas de crise conomique
En cas de crise conomique, la dure de travail peut tre rduite dans un seuil maximal de 60 jours,
et la rduction de salaire ne saurait tre infrieure au salaire normal. Cette disposition peut se rvler
insuffisante pour permettre lentreprise daffronter la crise. Le maintien de 50 % du salaire est
injustifi puisque la rduction pourrait tre au-del de 50 % du temps de travail.
Complter la procdure des sances dcoute
En cas de licenciement du salari, son audition par lemployeur est rendue obligatoire par larticle 62.
Cependant dans la pratique, les salaris refusent de rceptionner les convocations lentretien ou
den signer le PV. Mme sil est prvu dans pareil cas de recourir linspecteur du travail, ce dernier
ne convoque jamais les salaris et les employeurs pour les sances daudition. Or les arrts rendus
par la Cour suprme considrent lomission par lemployeur de la sance dcoute comme un vice de
procdure et qualifient la rupture du contrat comme licenciement abusif.
Il est ncessaire de complter la procdure afin de couvrir tous les cas de figures (absence du salari,
refus de signature du PV), de prciser le rle des inspecteurs du travail et de rendre obligatoire leur
action lorsque ncessaire.
Prciser les rgles dannualisation du temps de travail dans le cadre des conventions collectives
Fixe 2 288 heures dans lanne, la dure annuelle de travail peut tre rpartie sur lanne selon
les besoins de lentreprise (article 184). Ce principe de modulation permet ainsi de sadapter aux
fluctuations du march sans recourir aux heures supplmentaires ou au chmage partiel. Mais le
dcret dapplication ne prcise pas les contours de la question de lamnagement du temps de travail
et rend la gestion de lannualisation trop lourde et contraignante mettre en place.
Il est propos de renvoyer la dfinition de rgles oprationnelles pour lannualisation du temps de
travail aux conventions collectives ou aux conventions dentreprise.
Il est propos daugmenter la dure maximale de 60 jours et de prvoir la possibilit de fixer la dure
avec les reprsentants des salaris. En cas de rduction du temps de travail, le paiement doit se faire
sur la base de la dure effective du temps travaill sans minimum.
Elargir leffectif des salaris exigeant un service mdical du travail au sein de lentreprise
Larticle 304 impose quun service mdical soit cr dans les entreprises de plus de 50 salaris.
Compte tenu de la taille des entreprises marocaines, il est propos daugmenter leffectif de 50 100
salaris partir duquel un service indpendant est exig.
Remplacer le contrat de travail du mdecin du travail par un contrat de prestation de service
Le mdecin du travail est li lemployeur ou au chef du service mdical inter-entreprises par un
contrat de travail respectant les rgles de dontologie professionnelle (article 312).
Or certains mdecins du travail exercent en parallle une activit et prfrent, au contrat de travail, un
contrat de collaboration ou de prestation de service.
Il est propos dautoriser galement la conclusion dune convention entre le mdecin du travail et
lemployeur ou le chef du service mdical inter - entreprises.
68
69
LIVRE BLANC
Lever les rigidits sur le march de lemploi
2.
2.
Sanctions disciplinaires lencontre du mdecin du travail sans la ncessaire approbation de
linspecteur du travail
Toute mesure disciplinaire, envisage par lemployeur lencontre du mdecin du travail, doit tre
prononce par dcision approuve par linspecteur du travail aprs avis du mdecin inspecteur du
travail (article 313).
Les mesures disciplinaires lencontre du mdecin du travail sont trs fortement contrles, ce qui ne
parat pas justifi dans tous les cas. Il est propos de supprimer lapprobation pralable par linspecteur
du travail aprs avoir recueilli lavis du mdecin inspecteur du travail exig pour toute sanction lgard
du mdecin du travail.
Elargir les dures des emplois temporaires
Le recours aux socits dintrim est prvu par larticle 500 fixant la dure demplois temporaires.
Celle-ci constitue aujourdhui un obstacle au devenir de ce secteur.
Il est propos daugmenter de 6 9 mois la dure maximale des emplois temporaires (renouvelable
une fois) pour lexcution des travaux pour lesquels il est coutume de ne pas conclure de contrat
dure dtermine en raison de la nature du travail .
Suppression de lobligation de remplacer tout salari mis la retraite
Larticle 528 prvoit que lemployeur doit remplacer tout salari mis la retraite par un autre salari.
Cet article va lencontre du souci actuel de restructuration et de mise niveau de lentreprise
marocaine.
Il est propos de supprimer lobligation de remplacer tout salari mis la retraite.
70
Les minima de la loi sur le droit de grve
Les conflits sociaux se manifestent souvent d'une manire trs dure pour l'entreprise et mettent en
pril son existence et les emplois qu'elle procure. Il est ainsi ncessaire de poursuivre le processus
de rglementation et de finalisation des relations entre employeurs et employs dans un esprit de
comprhension mutuelle, en vue qu'une loi organique sur le droit de grve puisse voir le jour dans le
meilleur dlai.
Au Maroc, le cadre de jurisprudence relatif au droit de grve demeure relativement troit et ce sont
justement les pralables lgitimant le recours la grve qu'il serait judicieux de codifier dans une loi
organique, concerte, quilibre et donnant suffisamment de visibilit aux acteurs conomiques et
sociaux.
S'inscrivant parfaitement dans l'esprit du dialogue social qui a donn naissance l'accord du 30 avril
2003, la loi organique devrait concrtiser les principes fondamentaux des liberts publiques appliques
au monde du travail, travers notamment la dfinition de la grve licite qui doit satisfaire un minimum
de conditions, dont principalement :
tre notifie l'employeur au moins 15 jours l'avance
avoir un objectif professionnel consistant satisfaire des revendications d'ordre purement
professionnel (amlioration des conditions de travail, du salaire, etc.). Ceci exclut la grve perle
qui consiste ralentir volontairement le travail en diminuant les cadences de production, la
grve politique, la grve de solidarit qui ne vise pas soutenir un salari de l'entreprise ou
s'associer des revendications communes un grand nombre de travailleurs, la volont de
dsorganiser lentreprise ou de nuire sa situation conomique
avoir un caractre collectif. Il n'y a pas grve si l'arrt de travail concerne un seul salari sauf
s'il s'associe une grve nationale pour des revendications le concernant galement. La grve
suppose une volont commune de cesser le travail dans un but professionnel dtermin
tre initie par une organisation syndicale reprsentant au moins les deux tiers de l'effectif du
personnel ou, propose par la majorit du personnel via un rfrendum dmocratique
consister en une cessation totale du travail des grvistes, sans rtribution aucune et sans
possibilit pour les grvistes de rclamer un quelconque paiement des jours de grve pour la
reprise du travail
respecter la libert des non-grvistes et de l'employeur
respecter le droit de proprit et viter l'occupation des lieux.
71
LIVRE BLANC
Lever les rigidits sur le march de lemploi
23.Appel la rouverture du dbat sur le droit du travail
2.
Repenser les grands principes du Code du travail
La promotion progressive des conventions collectives
Fruit dune trs longue ngociation, le code du travail marocain a voulu traiter et rglementer lensemble
des relations ayant trait au travail. Cette approche a eu pour inconvnient de rigidifier la rglementation
sans tenir compte des spcifications tant individuelles que sectorielles.
Chaque pays connat des contraintes spcifiques son volution lies son activit, son environnement
aussi bien local quinternational. Dans les pays ayant un cadre lgislatif pour le travail, ce cadre ne
saurait et ne devrait couvrir tous les cas, au risque de crer des contradictions et des effets non
dsirs.
Rdig dans un esprit interventionniste jusquau dtail, le texte ne permet pas une volutivit positive
dans les relations sociales et les ngociations. Il a gnr une rglementation gnrale qui empite sur
les aspects de gestion interne de lentreprise, en marginalisant de fait laspect contractuel.
Le Code du travail aurait un meilleur impact sil traitait des rgles minimales pour la protection de
chacune des parties, en laissant le contrat individuel ou des conventions collectives fixer les rgles
pour les sujets qui ne sont pas concerns par le droit gnral ou qui dpassent les minima.
Les rgles dvolution dans le temps, au titre des gains sociaux selon lanciennet, doivent se baser sur
les minima afin quil ne puisse y avoir cumul entre ces volutions et celles dcides de faon acclre
par lemployeur ou par un contrat particulier.
Aussi, pour parler de lindividualisation du contrat de travail et des conventions collectives, il faut remettre
le dossier global du Code du travail sur la table car le niveau dacquis obtenus par les syndicats dans le
cadre du Code, actuellement en vigueur, rend difficile une ngociation qui ne peut avoir pour rsultat
que lamlioration desdits acquis. Pour cela, il faudrait revoir lesprit de la ngociation pour proposer
un nouveau projet. Afin de pouvoir convaincre les diffrents partenaires de rediscuter, il faudra redfinir
certains principes.
En matire de protection du parcours professionnel, la CGEM reconnat que si lentreprise ne peut
garantir un emploi vie, la solidarit nationale doit assurer chaque salari des protections minimales
par rapport son parcours professionnel. Ainsi, une formation continue, obligatoire et gratuite doit
tre assure chaque salari et porter aussi bien sur la qualification volutive que sur de nouveaux
mtiers afin de mieux apprhender les transitions technologiques ou les changements de parcours ;
un systme dallocation chmage doit tre pens et la couverture mdicale gnralise lensemble
de la population.
72
Les conventions collectives permettent donc dajuster lapplication des lois selon le contexte. Une
convention collective est un accord crit rsultant de la ngociation entre des associations ou syndicats
demployeurs et de salaris. Lesdits syndicats doivent tre reprsentatifs et reconnus au niveau
sectoriel et/ou national.
Pour une activit et un territoire donns, la convention collective encadre et rglemente les contrats
de travail et leur excution. Elle rgit notamment les conditions demploi et de travail des salaris
dans une branche dactivit. Elle complte en les amliorant les dispositions du Code du travail (do
limportance du point de dpart constitu par le code du travail).
Elle adapte galement les dispositions gnrales du Code du travail aux situations particulires dun
secteur ou dune entreprise (amnagement du temps de travail ; harmonisation des salaris ; volution
des salaires ; avantages sociaux ; conditions dembauche et de licenciements).
La convention collective recle plusieurs vertus : elle permet une gestion harmonise des relations du
travail dans une branche donne, en imposant des rgles communes et une quit qui assurent les
conditions dune concurrence loyale dans le secteur.
Au Maroc, la convention collective est rgie par le Dahir formant Code du travail : articles 104 134.
Le texte concerne aussi bien la convention dentreprise que la convention collective sectorielle. Dans le Code
du travail, la convention collective est dfinie comme un contrat collectif rgissant les relations de travail
conclu entre, dune part, les reprsentants dune ou de plusieurs organisations syndicales des salaris les
plus reprsentatives et, dautre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant titre personnel, soit les
reprsentants dune ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs .
73
LIVRE BLANC
2.
2.
A n n exe
74
75
LIVRE BLANC
A n n exe
dans le dispositif des Contrats Spciaux de Formation
2. Intervenants
actuellement en vigueur
Processus
Acteur associ
Supervision et prsidence du dispositif
Secrtariat dEtat la Formation Professionnelle
Participation au pilotage du dispositif
Ministre des Finances et Ministre du
Commerce et de lIndustrie
Reprsentation des entreprises au sein du
dispositif du pilotage
CGEM
Reprsentation des salaris au sein du dispositif
de pilotage
2.
Processus
Acteur associ
Gestion des demandes de remboursement et
tablissement des ordres de virement pour les
entreprises (hors grands tablissements)
Units de gestion des CSF au sein de lOFPPT
Ralisation des paiements
Trsorerie Gnrale
Elaboration des plans de formations groupes
CCCSF
UMT
Mise en oeuvre des plans de formations
groupes
Associations dsignes par le CCCSF
Responsabilit de la conclusion des CSF avec
les entreprises
Comit de Gestion de lOFPPT
Remboursement des actions de formations
groupes
Unit de gestion ddie au Sein de lOFPPT
Responsabilit de lattribution de la quote-part
de TFP affecte la formation continue
Comit de Gestion de lOFPPT
Organisation des contrles
Secrtariat dEtat la Formation professionnelle
Pilotage global du dispositif
CCCSF
Gestion oprationnelle des demandes daccs
au dispositif des CSF et tablissement
des CSF pour les entreprises (hors grands
tablissements)
Units de gestion des CSF au sein de lOFPPT
Gestion des demandes de financement et
ralisation des contrles pour les entreprises
(hors grands tablissements)
Units de gestion des CSF au sein de lOFPPT
76
Gestion des recours prsents par les entreprises CRCSF et CCCSF
Approbation des demandes de CSF manant des Commission des Grands Etablissements
grands tablissements
Ralisation des bilans
OFPPT
77
LIVRE BLANC
2.
2.
78
79
2.
80
Vous aimerez peut-être aussi
- Ethique Du Pret À IntérêtDocument24 pagesEthique Du Pret À IntérêtIssam Hafid100% (1)
- 7tionyele FAYAMADocument14 pages7tionyele FAYAMApriscardgabPas encore d'évaluation
- Philosophie, Un Art de Vivre, LaDocument14 pagesPhilosophie, Un Art de Vivre, LaOhossié Aurèle LaëlPas encore d'évaluation
- Modèles D Évaluation Du COSODocument31 pagesModèles D Évaluation Du COSOThiam100% (1)
- 1 PBDocument21 pages1 PBkemmach toufikPas encore d'évaluation
- Houellebecq, Un Monde de SolitudesDocument16 pagesHouellebecq, Un Monde de SolitudesHerne EditionsPas encore d'évaluation
- Universite Abou Bakr BelkaidDocument14 pagesUniversite Abou Bakr BelkaidYoussef BouzianePas encore d'évaluation
- Fiche Sur UtilitarismeDocument1 pageFiche Sur Utilitarisme5m7hs4dyg9Pas encore d'évaluation
- LeadershipDocument20 pagesLeadershipfrezya6Pas encore d'évaluation
- Citoyenneté Et Éducation À La Citoyenneté: Points de Vue D'enseignants Et D'enseignantes Du Secondaire Au GabonDocument21 pagesCitoyenneté Et Éducation À La Citoyenneté: Points de Vue D'enseignants Et D'enseignantes Du Secondaire Au GabonKouam kamguaingPas encore d'évaluation
- 36 Hydrocarbures Génie GazierDocument42 pages36 Hydrocarbures Génie Gazierabdou100% (1)
- Le Défi de La Solidarité OrganiqueDocument11 pagesLe Défi de La Solidarité OrganiqueRouçadi WafaaPas encore d'évaluation
- 300 Citations Et Proverbes de Confucius en Ordre AlphabétiqueDocument44 pages300 Citations Et Proverbes de Confucius en Ordre Alphabétiquemister vibratoPas encore d'évaluation
- Heidegger Et Nietzsche. Le Problème de La MétaphysiqueDocument53 pagesHeidegger Et Nietzsche. Le Problème de La Métaphysiquevince34100% (1)
- ProtocolemmoireLicenseProfessionnelle MasterDocument12 pagesProtocolemmoireLicenseProfessionnelle MasterDrissa Michael CoulibalyPas encore d'évaluation
- BibliographieDocument59 pagesBibliographieJamesPas encore d'évaluation
- 1 C-5 Kabou Rendue LàDocument13 pages1 C-5 Kabou Rendue LàPapa TraorePas encore d'évaluation
- Table Des MatièresDocument14 pagesTable Des MatièresMendrika RandriamaheninaPas encore d'évaluation
- Rapport D'orientation Methodologique Dao-83429792 GizDocument16 pagesRapport D'orientation Methodologique Dao-83429792 GizydioufPas encore d'évaluation
- Cours STRATEGIE Marketing 2023Document96 pagesCours STRATEGIE Marketing 2023behaeddinesfar99Pas encore d'évaluation
- ارحاب هلال وسام-minDocument279 pagesارحاب هلال وسام-minnabil meghniPas encore d'évaluation
- LOTTIN, Odon. Syndérèse Et Conscience Au XIIe Et XIIIe SièclesDocument146 pagesLOTTIN, Odon. Syndérèse Et Conscience Au XIIe Et XIIIe SièclesmapfsbmPas encore d'évaluation
- 9782021465877Document49 pages9782021465877yvan anehoungPas encore d'évaluation
- Rapport Égalité Des Chances Dans La Promotion de La SantéDocument111 pagesRapport Égalité Des Chances Dans La Promotion de La SantéLowell SmithPas encore d'évaluation