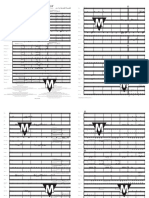Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Weber French 48 PDF
Weber French 48 PDF
Transféré par
VANNI MONTANARITitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Weber French 48 PDF
Weber French 48 PDF
Transféré par
VANNI MONTANARIDroits d'auteur :
Formats disponibles
h a n g e Vi h a n g e Vi
XC e XC e
F- w F- w
PD
PD
er
er
!
!
W
W
O
O
N
N
y
y
bu
bu
to
to
k
k
lic
lic
C
C
w
w
m
m
w w
w
w
o
o
.d o .c .d o .c
c u -tr a c k c u -tr a c k
Ariane, ma sœur, de quel amour blessée
Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée!
[10] Cette question assez importante est trop négligée. Il m'a
passé par les mains un bon nombre d'ouvrages didactiques sur
l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol; jamais
je n'ai pu y trouver des indications assez exactes sur la
prononciation, sans compter que les contradictions n'y manquent
pas.
Il me semble qu'en disant _blèssée_ et _lêssée_, on gâte sensiblement
l'harmonie de ces vers, qui est très belle si l'on prononce _bléssée_
et _léssée_, comme le voulait Michelot et comme paraît le vouloir
aussi M. Legouvé[11]. Puisque nous parlons de la «musique» des vers,
avouons que c'est une singulière musique: à chaque instant on ne sait
s'il faut faire un dièze ou un bémol.
[11] Voir le _Temps_ du 17 avril 1873.
On peut légèrement altérer les voyelles, selon qu'on veut faire
dominer le timbre clair ou le timbre sombre, mais quand cette
altération devient trop sensible, les voyelles se substituent les unes
aux autres. Nous en avons des preuves journalières dans le charabia
des chanteurs aimant à faire la grosse voix. D'autre part, il arrive
que des sopranos à voix blanche et légère altèrent les voyelles en
sens contraire. Mme Cabel en était un des exemples les plus marqués.
Il suffisait de l'avoir entendue dans le _Pardon de Ploërmel_,
commencer ainsi: _Bélla mê chévre chérie_.
Involontairement nous altérons le timbre des voyelles, selon les
sentiments dont nous sommes affectés ou que nous voulons exprimer. Le
timbre sombre convient en général dans les dispositions graves,
sérieuses ou tristes; le timbre clair à la gaîté. En Angleterre, on
appelle l'angine granuleuse «la maladie des prédicateurs», parce
qu'elle provient chez eux de l'abus du timbre sombre.
La différence de timbre des voyelles peut fournir un moyen de trancher
la question de l'hiatus. La règle draconienne, contre laquelle se
révolte Th. de Banville, avec raison, n'existait pas autrefois. Il est
assurément peu logique que deux voyelles puissent se rencontrer au
milieu d'un mot et que les mêmes voyelles ne puissent pas le faire si
l'une se trouve à la fin d'un mot, et l'autre au commencement du mot
suivant, ou qu'elles le puissent dans ce cas, si elles sont séparées
par un _e_ muet qui s'élide. Il y a une grande différence entre des
hiatus tels que les suivants:
Mon fait est venu au contraire...
Je suis ravi, assis entre les dieux...
et ceux-ci:
Chacun s'en va gai et falot...
Auprès de toi, en mille sortes...
Passons aux consonnes. Pour se rendre bien compte de leurs effets, il
n'est pas inutile de considérer la manière dont elles se prononcent;
mais si je parlais de labiales, de labio-dentales, de linguo-dentales,
de palatales, ma démonstration paraîtrait trop scolastique; je me
contenterai donc des grandes divisions, très faciles à saisir. On
appelle muettes les consonnes qui ne peuvent exister sans voyelles.
Par exemple, en prononçant le mot _été_, le _t_ n'existe qu'au moment
où l'on quitte le premier _é_ et au moment où l'on attaque le second
_é_.
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Cours de Langue de La 1ère Année BacDocument2 pagesLes Cours de Langue de La 1ère Année BacJamal Kalkouli55% (11)
- Danzon Juarez - Banda MMDocument10 pagesDanzon Juarez - Banda MMKatherin RamosPas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2024-02-14 À 17.53.44Document1 pageCapture D'écran . 2024-02-14 À 17.53.44kz5zdkvm9fPas encore d'évaluation
- Catalogue Les Super Bons Plans RavateDocument16 pagesCatalogue Les Super Bons Plans RavateRavate974Pas encore d'évaluation
- Les Jours de La Semaine Feuille Dexercices - 6209Document3 pagesLes Jours de La Semaine Feuille Dexercices - 6209Sofia Otarola GamboaPas encore d'évaluation
- Grafcets Ravoux Module 2Document12 pagesGrafcets Ravoux Module 2youri594900% (1)
- Prevert Jacques ParolesDocument32 pagesPrevert Jacques ParolesНаташа ЛујићPas encore d'évaluation
- Lexique - Dans La CuisineDocument5 pagesLexique - Dans La CuisineMarija Stamenković100% (1)
- UntitledhhDocument30 pagesUntitledhhThornblad33Pas encore d'évaluation
- Je Présente Ma Ville: On Peut Voir Ça Dans La Vidéo On Ne Peut Pas Voir Ça Dans La VidéoDocument2 pagesJe Présente Ma Ville: On Peut Voir Ça Dans La Vidéo On Ne Peut Pas Voir Ça Dans La Vidéoluluch86Pas encore d'évaluation
- Test U2voila Ma Journee ViiDocument3 pagesTest U2voila Ma Journee Viidiana panteaPas encore d'évaluation
- 1748 20150716 PDFDocument19 pages1748 20150716 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- UNED - Curso Francés Iniciación - 3 Ed - Séance 3Document27 pagesUNED - Curso Francés Iniciación - 3 Ed - Séance 3carminaPas encore d'évaluation
- Corrige: Les Phrases SuivantesDocument8 pagesCorrige: Les Phrases SuivantesCamilla CorrêaPas encore d'évaluation
- White Box - Aventures OrientalesDocument158 pagesWhite Box - Aventures Orientalesbanaszkiewicz.sophiePas encore d'évaluation
- Le Heros de La Peau de Chagrin Une VictimeDocument6 pagesLe Heros de La Peau de Chagrin Une VictimelynamamryaPas encore d'évaluation
- Le Courant SpectralDocument14 pagesLe Courant Spectraljoaquimcoelhos100% (1)
- Beatles AntologyDocument13 pagesBeatles AntologyAlaina Phillips100% (1)
- MorenaDocument26 pagesMorenajuliPas encore d'évaluation
- Fiche de Travail - La Famille BélierDocument5 pagesFiche de Travail - La Famille BélierCelia BorgesPas encore d'évaluation
- La Seance D EntrainementDocument9 pagesLa Seance D EntrainementEl-Habti ZaidPas encore d'évaluation
- Offre de Service (2) - 1Document9 pagesOffre de Service (2) - 1Mohamed Ghazal Oulad DaoudPas encore d'évaluation
- Alleluia Geraci Organo VociDocument4 pagesAlleluia Geraci Organo VociJosé Faria GarciaPas encore d'évaluation
- 211026CC Formulaire Teranga Premium Bloque VFDocument1 page211026CC Formulaire Teranga Premium Bloque VFdaboPas encore d'évaluation
- FFPSNewsletter Janvier 2022Document12 pagesFFPSNewsletter Janvier 2022Mathieu Micilei BouchetPas encore d'évaluation
- 23 01 11 24hautrotDocument15 pages23 01 11 24hautrotOuedraogoPas encore d'évaluation
- Marinera Caballos BlancoDocument30 pagesMarinera Caballos BlancoRodrigo Hernández100% (5)
- Harry Sparnaay - Scales Studies For SaxophoneDocument584 pagesHarry Sparnaay - Scales Studies For SaxophoneSergio FidemraizerPas encore d'évaluation
- Dragon Age JdR-Aide de JeuDocument75 pagesDragon Age JdR-Aide de JeuhugoPas encore d'évaluation
- INVENTAIREDocument1 pageINVENTAIREjackhuguesPas encore d'évaluation