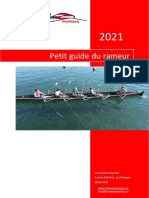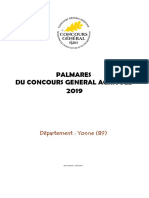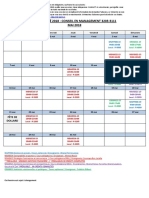Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
nts1 FR
nts1 FR
Transféré par
RaGame Mantella 3DTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
nts1 FR
nts1 FR
Transféré par
RaGame Mantella 3DDroits d'auteur :
Formats disponibles
Syndicat BIL TA GARBI
2 allée des Platanes – BP 28555
64185 BAYONNE Cedex
----------------------------
PROJET D’UNITE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
----------------------------
CHARRITTE-DE-BAS (64)
----------------------------
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE ICPE
----------------------------
PARTIE 2 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
SOMMAIRE
1- AVANT PROPOS 3
2- LOCALISATION 4
3- RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET DU SITE 5
4- CHIFFRES DE L’EXPLOITATION ET NATURE DES DECHETS ADMIS 7
5- CARACTERISTIQUES DU SITE 9
6- EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES DE PREVENTION OU DE
COMPENSATION 18
7- UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET DE LA CONSOMMATION EN EAU27
8- REAMENAGEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 28
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 2/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
1 - AVANT PROPOS
Le projet du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi correspond à la création d’un centre de traitement mécanique et
biologique des ordures ménagères (PTMB) et d’une installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDND) au lieu-dit Larrascacoplaça à Charritte-de-Bas (64). Ces installations permettront de faire face au
besoin local en capacité de traitement des ordures ménagères et en capacité de stockage des encombrants
des ménages et des déchets industriels banals non valorisables provenant des artisans et des industriels
présents sur la zone de chalandise du projet. Ce besoin a été mis en évidence par le Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du département des Pyrénées Atlantiques, approuvé par
arrêté préfectoral du 12/05/2009.
L’aménagement et l’exploitation du PTMB et de l’ISDND, destinés à recevoir des déchets en vue de leur
traitement ou de leur enfouissement, reposeront sur les mesures des textes réglementant ces activités afin
de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de gestion et de traitement des déchets. En tout état de
cause, le centre n’acceptera jamais et en aucun cas, de déchets radioactifs, de déchets toxiques ou tout autre
déchet considéré comme interdit ; un contrôle étant d’ailleurs prévu à cet effet.
Le projet du syndicat Bil Ta Garbi est une installation classée pour la protection de l’environnement
(ICPE), soumise à autorisation et à une réglementation extrêmement stricte, afin de s’assurer de la sécurité
des personnes, des biens et de la protection de l’environnement. Il permettra d’accueillir les déchets des
collectivités locales, des industriels, des commerçants et des artisans, dans de bonnes conditions de sécurité
et de protection de l’environnement, en provenance d’une zone de chalandise préalablement définie.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 3/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
2 - LOCALISATION
Le projet porté par le syndicat Bil Ta Garbi se situera dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sur la
commune de Charritte-de-Bas, plus précisément sur le site de « Larrascacoplaça ».
Les communes situées dans un rayon de 3 km et concernées par l’Enquête Publique sont : Charritte de Bas,
Ainharp, Aroue-Ithorots-Olhaïby, Espès Undurein, Etcharry, Lohitzun-Oyehercq, Nabas, Lichos et
Viodos-Abense de Bas.
SITE
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 4/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
3 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET DU SITE
CHOIX DU PROJET
UN PROJET EN ADEQUATION AVEC LES ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES
Le mode de traitement retenu (tri mécano-biologique après collecte sélective) sur le territoire du syndicat
résulte d’une phase de démarche concertée engagée en 2004 avec l’ensemble des collectivités membres du
syndicat.
Le projet de site de traitement des déchets de Charritte de Bas (PTMB+ISDND) est en parfaite cohérence
avec les orientations données par le Grenelle de l’Environnement et le Plan Départemental d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés du Département des Pyrénées Atlantiques.
En effet les orientations environnementales de ces textes et documents planificateurs privilégient la
prévention de la production de déchets, puis le recyclage des matériaux et la valorisation organique, afin de
diminuer les quantités incinérées et stockées.
L’installation répond pleinement à cet objectif en assurant le recyclage organique de la part fermentescible
des déchets ménagers des adhérents de Bil Ta Garbi sous forme de compost normé.
En outre, le mode de traitement retenu dans le cadre du site de Charritte répond aux exigences de la loi de
programmation du n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Ce texte prévoit, en son article 46 alinéa i, que la méthanisation et le compostage de la fraction
fermentescible des déchets séparés à la source seront encouragés dans un cadre de cohérence nationale et
d’engagements contractuels de tous les acteurs concernés pour assurer notamment la qualité
environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol.
L’installation s’inscrit dans cette démarche. Sa conception permet en effet le traitement d’une fraction
fermentescible issue d’une collecte sélective qui viendrait à être mise en place par tout ou partie des
adhérents de Bil Ta Garbi.
Enfin, le projet du syndicat sur la zone Est du territoire est nécessaire car les autres sites de traitement du
département sont aujourd’hui saturés, et il apporte une solution de traitement locale permettant d’éviter
l’export de déchets ménagers à l’extérieur du département.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 5/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
CHOIX DU SITE
Le choix du site de Larrascacoplaca est issu d’une étude concertée de recherche de site, menée à partir de
juillet 2005. Elle a consisté en une étude comparative aboutissant à une hiérarchisation de 11 sites
présélectionnés, sur la base de critères sociaux et environnementaux établis par une commission de
recherche de site composé d’élus et d’experts locaux.
Le Syndicat Bil Ta Garbi et la Commission de Recherche de site ont donc procédé à une analyse des
qualités et des défauts des sites présélectionnés. A l’issu de cette analyse comparative le site
« Larrascacoplaca » de Charritte-de-Bas a été retenue.
Les avantages du site de Larrascacoplaza ont été décisifs avec notamment son isolement (voisinage réduit
et visibilité très faible), sa morphologie (petit vallon) permettant une bonne insertion paysagère, et la nature
de son sous-sol.
CHOIX DE L’ACCES AU SITE
Six variantes pour la voie d’accès ont été étudiées et comparées entre elles de façon à retenir le meilleur
tracé sur la base de critères environnementaux : occupation humaine, habitats, milieu naturel, faune et flore
topographie.
Cette étude a conduit à retenir le tracé présenté sur la figure suivante car :
il évite le passage à proximité immédiate des habitations,
il permet l’utilisation d’un équipement existant, la création de nouvelles portions de voirie
étant d’une longueur raisonnable,
il évite la traversée du Borlaas par un nouvel ouvrage et ne longe pas directement le cours
d’eau dans sa partie Est, là où des habitats d’espèces sensibles peuvent être présents (loutre,
vison, écrevisse).
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 6/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
4 - CHIFFRES DE L’EXPLOITATION ET NATURE DES DECHETS ADMIS
Emprise parcellaire faisant 52,5 ha
l’objet de la demande
Projet (emprise clôturée) 27,4 ha
Surfaces Emprises techniques 10,6 ha
(PTMB+ISDND) et voiries
Zone de stockage des 3,5 ha
déchets de l’ISDND
Durée de vie de 20 ans
l’exploitation
Durée de vie
du site Durée de la surveillance 30 ans
post-exploitation de la zone minimum
de stockage
Ordures ménagères (OMr) 20 000 Répartition des déchets traités au niveau du PTMB
t/an
Tonnages au
niveau du Déchets verts (potentiel) 2 600 t/an OMR
PTMB DV
Répartition des déchets stockés au niveau de l'ISDND
Déchets industriels et 2 000 t/an
commerciaux banals non
valorisables Encombrants
Tonnages au DIB
Encombrants non 4 000 t/an Résidus non valorisables
niveau de
valorisables
l’ISDND
Résidus non valorisables 10 000t/an
issus du traitement des OMr
au niveau PTMB
Les déchets à caractère fermentescible (OMr) seront traités dans une unité de prétraitement mécanique et
biologique permettant la fabrication de compost. Seuls les résidus non valorisables issus du pré-tri
mécanique seront stockés dans les casiers de l’ISDND. La stabilisation par compostage permet de réduire,
entre autres, la production de biogaz, la pollution organique des eaux d’infiltration et les phénomènes de
tassement dans les massifs de déchets. Il s’agit d’une dégradation contrôlée et accélérée de la part
organique contenue dans les OMr dans un objectif de réduction très rapide du potentiel de nuisances futur
des déchets et la revalorisation de la partie organique en compost.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 7/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
Le projet prévoit les principaux équipements suivants :
Voirie d’accès au site depuis la RD11, à double sens de circulation ;
Installation de Prétraitement Mécano-Biologique des déchets (PTMB) comportant un Bâtiment
process avec un tube de préfermentation, des équipements de criblage et de déferraillage, des
tunnels de fermentation, une aire d’affinage par tri densimétrique, un dispositif de traitement d’air,
une zone de maturation et de stockage du compost, des bassins de rétention étanches ;
Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) comportant des casiers étanches de
stockage des déchets d’une superficie de 3,5 ha représentant un volume total de stockage de
déchets de 360 000 m3, des bassins de rétention étanches, un dispositif de traitement du biogaz, des
installations de traitement des lixiviats, une aire de stockage de terres excavées à réutiliser pour
l’exploitation (couvertures des déchets notamment) ;
Des locaux pour le personnel d’exploitation, un atelier, une aire de lavage, un poste de distribution
de carburants, des voiries internes.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 8/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
5 - CARACTERISTIQUES DU SITE
GEOLOGIE
Le projet de Bil Ta Garbi s’inscrit au sein de la formation des Flysch de Mixe déposée au cours de l’Albien
(Crétacé inférieur), dont la puissance dépasse les 500 m d’épaisseur, et formée par une alternance d’argile
et de grès métamorphisés reconnus sous la forme de schistes à passées gréseuses.
La tectonique du secteur s’apparente à l’anticlinal de
Saint Palais, formé par une succession spatiale des
formations de Flysch de Mixe et des Marnes de Saint
Palais, dont la terminaison est observée au niveau du
site. Ainsi, les couches schisteuses rencontrées sur le
site présentent une direction générale N 120° et un
pendage de 60° vers le Sud qui s’accentue vers le NE
à 75° (zone du PTMB).
La campagne de reconnaissance réalisée au droit du
site a permis de mettre en évidence de façon globale
les formations suivantes de haut en bas :
Terre végétale argilo-limoneuse à beige sur
moins de 1 m d’épaisseur ;
Argile-limoneuse grise bariolée ocre à
rouille, sur une épaisseur de 1 à 4 m ;
Schiste altéré argileux noir sur une
épaisseur variant de 2 à 12 m ;
Schiste sain noir à passées gréseuses à
partir d’une profondeur variant entre 3 m et
12 m par rapport au niveau actuel du sol.
Il s’agit d’un contexte géologique favorable à l’implantation d’une installation de stockage de déchets non
dangereux.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 9/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
HYDROGEOLOGIE
Les formations géologiques (Flysch de Mixe) sont le siège d’écoulements localisés à la faveur de passées
plus perméables (grès notamment) et du réseau de fractures affectant les formations du flysch. Ces
formations contribuent à compartimenter les circulations d’eau en profondeur et ont des caractéristiques
aquifères très médiocres.
Au droit du site, les écoulements souterrains donnent naissance à quatre sources intermittentes sur les
hauteurs du coteau d’Ascounamendia.
Le niveau piézométrique se stabilise à une profondeur comprise entre 2,5 et 3,5 m par rapport au niveau
terrain naturel, soit globalement à l’interface entre les colluvions argileux et les schistes altérés.
Les ressources en eau souterraine dans ces formations géologiques sont diffuses et de faible importance et
ne constituent pas une réserve potentielle d’eau pour la population.
Les eaux souterraines sont naturellement chargées en métaux tels que l’antimoine, l’arsenic, le chrome, le
nickel et le zinc. Une minéralisation naturelle progressive des eaux apparait entre l’amont et l’aval du site.
Dans un rayon de 5 km autour du projet de Bil Ta Garbi, il n’existe aucun captage d’eau souterraine
recensé exploité pour l’alimentation en eau potable, agricole, ou thermale, ni aucune extension de
périmètre de protection.
HYDROLOGIE
Le site de
« Larrascacoplaça »
Rivière Le Saison est implanté dans le
bassin versant du
Saison.
Le cours d’eau
principal du vallon
Ruisseau Le Borlaas
d’implantation des
installations est
dénommé « la
Fontaine de Larrasca Fontaine de
Larrasca ». Ce
ruisseau prend sa
source en bordure du
site coté Sud et est
alimentée par
plusieurs cours d’eau
intermittents depuis
les hauteurs du coteau
d’Ascounamendia.
La Fontaine de Larrasca conflue à environ 2 km à l’est du site avec le ruisseau le Borlaas qui s’écoule du
Sud vers le Nord. Le Borlaas est un affluent rive gauche du Saison, à environ 2,5 km en aval du village de
Charritte de Bas.
D’une longueur de 54 km, le Saison se jette dans le Gave d’Oloron à environ 15 km au Nord/Nord-Ouest
du site, à Autevielle-Saint-Martin-Bideren.
Le réseau hydrographique du Saison, incluant le Borlaas et la Fontaine de Larrasca est inclus dans le site
Natura 2000 « Le Saison ».
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 10/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
Aucun captage d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable n’est recensé dans un rayon de 5 km.
En revanche des prélèvements d’eau pour usage agricole sont recensés sur le Saison.
Les mesures physico-chimiques et biologiques réalisées sur les eaux superficielles, d’amont en aval du site,
ont montré :
- une très bonne qualité physico-chimique des eaux au droit du site (Fontaine de Larrasca) et
en aval (Borlaas et Saison),
- une qualité hydrobiologique moyenne au droit du futur projet (Fontaine de Larrasca), mais
qui augmente vers l’aval,
- l’absence de poissons dans les eaux situées au droit du site, mais leur présence plus en aval
dans le Borlaas et plus encore dans le Saison (présence de truites Fario).
L’objectif de la gestion des rejets du site est de maintenir ces niveaux de qualité, y compris au droit du site.
RISQUES NATURELS
D’après le zonage sismique Français, la commune de
Charritte-de-Bas appartient à l’arrondissement d’Oloron-
Sainte-Marie et au canton de Mauléon-Licharre, qui est
situé en zone de sismicité Ia « Très faible mais non
négligeable ».
Au 2 juin 2009, la commune de Charritte-de-Bas n’est
concernée par aucun plan de prévention des risques
naturels.
Le site n’est pas concerné par le risque d’inondations en
raison de la position géomorphologique du site en amont
du bassin versant du Borlaas.
PAYSAGES
Le projet de site de traitement est situé dans une zone vallonnée, au fond de laquelle coule un chevelu de
petits ruisseaux intermittents. Le secteur d’implantation est à dominante agricole extensive (pâturage), avec
plusieurs petits boisements comprenant des plantations d’eucalyptus et de pins, des champs cultivés et des
zones labourées. Les fermes, dispersées sur le territoire des communes, sont le plus souvent associées à
l’habitat des exploitants agricoles.
Le modelé final de l’installation de stockage contribuera à son intégration dans le relief collinaire
environnant. Les points de vue sur le projet seront très restreints et limités aux abords du site. Ils seront
efficacement compensés par les aménagements prévus (notamment linéaires de haie).
Installation de stockage
Installation de de déchets non
Ferme prétraitement dangereux
Harribelcet mécano
(masquée) biologique
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 11/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
MILIEU NATUREL
Les relevés de terrain, (habitats naturels, flore et faune) ont été menés sur l’emprise foncière envisagée et
au-delà, notamment pour la faune ainsi que dans une zone tampon autour des six différentes voies d’accès
envisagées (100 mètres de part et d’autre). La superficie de l’emprise foncière envisagée est d’une
cinquantaine d’hectares, à l’intérieur desquels le projet d’aménagement d’une superficie de 10 à 12 ha a été
implanté notamment en tenant compte des habitats naturels recensés. La zone de prospection (hors variante
des voies d’accès) est d’environ 83 ha.
Flore et habitats naturels
Les différents groupements végétaux du site
d'étude appartiennent tous à la série
dynamique du chêne pédonculé. Par son
utilisation agricole importante, l'ensemble du
site est surtout occupé par des stades de
substitution de cette chênaie, répartis en un
paysage bocager.
Aucune espèce légalement protégée n’a été observée. Etant donné
l’utilisation agricole actuelle du site, la plupart des milieux naturels sont
dégradés ou transformés et la flore perd une partie de sa richesse.
Photo : bruyère à quatre angles
Au droit du site, un habitat présente un intérêt communautaire. Il s’agit de la Lande ibéro-atlantique
thermophile à Ajonc de Le Gall et Bruyère ciliée. Au niveau de la voie d’accès au site, cinq reliquats
d’habitats d’intérêt communautaire ont été recensés.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 12/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
Faune
Les principaux insectes ayant été observés relèvent des groupes des lépidoptères (papillons) et des
odonates (libellules).
Photo : petite tortue
Plusieurs habitats d’espèces patrimoniales protégées de coléoptères sont présents sur le site (vieux chênes
et vieux saules).
Photo : boisement de chênes en bordure du projet
Les amphibiens observés sont des individus d’Alyte accoucheur, de Grenouille agile et de Grenouille verte
au nord de la zone d’étude, en bordure de la voie d’accès, en rive droite du cours d’eau principal, ainsi que
des pontes de Crapaud commun en rive droite du cours d’eau dans des mares artificielles.
Photo : mares artificielles
en rive droit du ruisseau
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 13/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
Les reptiles observés dans la zone d’étude, essentiellement en rive droite du cours d’eau principal, de
l’autre coté de l’emprise foncière sont le Lézard vivipare et la Couleuvre Esculape. Une Vipère aspic et une
Couleuvre à collier ont été vu dans l’emprise foncière envisagée. La seule espèce qui présente de réels
enjeux de conservation est le Lézard vivipare.
Le secteur présente une avifaune riche, surtout au niveau des boisements et landes situés en dehors de
l’emprise foncière envisagée, et du réseau de haies de la zone d’étude. Parmi les espèces observées sur la
zone d’étude, les espèces suivantes méritent particulièrement d’être soulignées : Grand corbeau, Bondrée
apivore, Loriot, Milan noir, Busard Saint-Martin et Pie-grièche écorcheur.
Photo : Busard St Martin en vol
L’emprise foncière envisagée par le projet et ses alentours immédiats ne présentent pas d’enjeux
particuliers pour les mammifères. Des traces de Renard, de Chevreuil, Sanglier, Blaireau, Taupe, ainsi que
d’un individu de Martre ou de Fouine ont été relevées sur la zone d’étude. Une martre a aussi été vue juste
au dessus de la zone d’étude. Les carnivores aquatiques pourraient présenter un enjeu naturaliste mais
ceux-ci ne peuvent pas trouver d’habitats nécessaires à leur cycle biologique ou de zone d’alimentation au
niveau du site.
Photo : ruisseau en bordure du site
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 14/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
Les installations du projet ont été implantées en fonction de ces habitats de façon à minimiser l’impact sur
le milieu naturel. Le choix du tracé pour la voie d’accès a notamment pris en compte ces critères
naturalistes.
D’un point de vue réglementaire, les surfaces concernées par des destructions d’habitats protégés sont très
faibles au regard des emprises globales de ces habitats sur la zone d’étude. Les seuls habitats d’espèce
susceptibles d’être touchés par les aménagements sont les suivants :
Quelques vieux chênes et vieux saules favorables au Grand Capricorne et à la Rosalie des Alpes,
Des extrémités de haies qui constituent des habitats favorables à des espèces d’oiseaux comme le
Tarier des Prés et la Pie-Grièche Ecorcheur,
Un reliquat d’habitat d’intérêt communautaire (lande thermophile).
Une procédure dérogatoire pour ces habitats est menée en parallèle de la présente enquête publique.
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET HUMAIN
La population de Charritte-de-Bas est en constante régression
depuis 1968. Le nombre d’habitants était de 244 en 2006.
L’habitat est plus particulièrement concentré dans les centres-
bourgs des villages environnant le site. Des hameaux,
constitués le plus souvent d’une ou plusieurs fermes, émaillent
le territoire des communes. L’habitation la plus proche est
située à 500 m du site.
En ce qui concerne l’activité économique locale, elle est
essentiellement agricole, et plus particulièrement liée à
l’élevage.
Plusieurs appellations d’origine sont recensées sur la commune de Charritte-de-bas et
particulièrement l’AOC « Ossau-Iraty » (tomme à pâte légèrement pressée, non cuite,
salée et affinée).
Aucune activité industrielle, artisanale, tertiaire, commerciale ou de loisir n’est recensée
dans un rayon de 1 km autour du site, hormis le quai de transfert des déchets exploité par le syndicat Bil Ta
Garbi en bordure Sud du site (vocation à être démantelé lorsque l’installation de traitement sera mise en
service). Les structures les plus proches (commerces, ERP, etc.) sont localisées dans le centre ville de
Charritte-de-Bas.
Les principaux axes de circulation dans le secteur d’implantation du projet
SITE sont : la RD 11, qui relie Mauléon Licharre au Sud à Bidache au nord-ouest,
et qui traverse le centre-bourg de Charritte de Bas et la RD 23, qui relie
Orthez au nord-est à Charritte ; l’intersection avec la RD 11 se faisant à
300 m environ au Sud-est du centre-bourg de Charritte de Bas, au niveau
d’un rond-point.
Le site sera accessible par la RD 11 de laquelle partira une voie d’accès vers
le site, à partir d’un carrefour aménagé. Le site projet du syndicat Bil Ta
Garbi présente donc une facilité d’accès.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 15/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
Aucun site archéologique n’est recensé au droit ou à proximité immédiate du site.
Aucun monument historique, site classé ou site inscrit n’est recensé sur la commune de Charritte-de-bas et
plus particulièrement au droit du site. Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection
d’alimentation en eau potable et aucune ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain
et Paysager).
BRUIT
Le site forme un cirque ouvert vers le Nord. C’est une zone agricole à vocation de pâturage
essentiellement. La route d’accès à ce vallon se termine en impasse.
L’ambiance sonore de ce site peut être qualifiée de calme, les bruits ressentis étant essentiellement liés aux
bruits de la faune sauvage ou d’élevage, et ponctuellement à des bruits de moteur.
Des mesures de terrain sur 24 h ont été réalisées dans le but d’analyser la situation acoustique initiale dans
l’environnement du site. Cette situation est représentative du niveau de bruit résiduel (point 0) avant
l’implantation des installations.
Ces mesures ont été réalisées au niveau des 4 points
suivants :
point 1 : zone « Ascounamendia » : limite de
propriété Nord-Est, côté PTMB,
point de mesure 2 : lieu-dit « Dascon », au nord-
est du site, côté PTMB : présence d’habitations,
point de mesure 3 : lieu-dit « Landaco », au
nord-ouest du site, côté PTMB : présence
d’habitations,
point de mesure 4 : en direction du lieu-dit
« Harribelcet », au sud-est du site, côté ISDND :
Les niveaux de bruits enregistrés lors de ces mesures sont faibles, avec des perturbations ponctuelles liées à
la faune et à quelques passages d’engins à moteur, et confirment le caractère calme du site. Les niveaux de
bruits résiduels retenus pour caractériser l’état initial du site sont inférieurs à 35 décibels en chaque point.
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le projet est soumis aux
prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les ICPE, qui définit les niveaux sonores maximums en limite de propriété du site et dans les zones à
émergence réglementée (zones d’habitat ou immeubles à occupation sensible).
L’environnement sonore du site étant initialement calme, l’objectif réglementaire appliqué au projet est de
ne pas générer de nuisances sonores dans les zones d’habitations avoisinantes. Ainsi, les niveaux de bruit
globaux ne dépasseront pas 35 décibels au niveau des habitations quand le site sera en fonctionnement.
Une modélisation des bruits générés par l’installation a permis de confirmer que cette exigence sera
respectée.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 16/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
AIR
Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est présente aux alentours du site. Le site est situé dans
une zone à forte vocation agricole et les activités industrielles sont peu nombreuses. Le réseau de
circulation est également très peu dense.
La station de transit des ordures ménagères et assimilés actuellement implantée a proximité du projet, ainsi
que les activités agricoles environnantes peuvent, de manière sporadique, être à l’origine d’une légère
dégradation olfactive de la qualité de l’air, qui n’est toutefois pas de nature à remettre en cause sa qualité
globale.
Une modélisation des rejets atmosphériques des installations du projet a été réalisée dans le cadre de
l’évaluation des effets du projet sur la santé. Elle a permis de montrer que l’impact sur la qualité de l’air
sera faible et respectera les exigences réglementaires concernant les odeurs.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 17/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
6 - EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES DE
PREVENTION OU DE COMPENSATION
EVALUATION DES IMPACTS SUR LES EAUX
Impact
Milieu/Domaine Impact Analyse des impacts, moyens de prévention et Mesure
résiduel
concerné suspecté de protection compensatoire
potentiel
Phase En phase chantier, les mesures suivantes seront
Chantier : prises :
infiltration Stockage des engins, produits, matériels sur des aires
de produits spécifiques / Récupération de tous les produits et
liquides dans matériaux en cours de chantier / Nettoyage régulier
les sols des voiries
Au niveau de l’ISDND :
- Choix d’un site présentant un contexte géologique
favorable
ISDND : - Limitation de la production des lixiviats
Risque - Mise en place d’une double barrière d’étanchéité
d’infiltration active et renforcement de la barrière de sécurité
d’eaux passive
pluviales ou - Contrôle des eaux drainées sous les casiers
de lixiviats - Bassins étanches de collecte des effluents Très faible
- Surveillance de la qualité des eaux souterraines Et ressources
aquifères
Au niveau du PTMB : médiocres
Eaux souterraines
PTMB : - Imperméabilisation des sols (voiries, bâtiments Pas d’aquifère
(risque de /
Risque process) potentiellement
pollution)
d’infiltration - Réseaux séparatifs de collecte des effluents (eaux exploitable
d’effluents pluviales des voiries, jus du PTMB, eaux de l’aire de pour l’eau
liquides lavage) potable
(eaux de - Bassins de stockage étanches des effluents
procédé) - Surveillance de la qualité des eaux souterraines
Au niveau du PTMB (zone atelier) :
Risque - Rétentions étanches pour le stockage des produits
d’infiltration - Réduction des volumes de produits stockés
de produits - Cuve enterrée de 50 m3 double enveloppe / Tests
stockés au périodiques d’étanchéité
niveau de - Système de détection de fuites/ Imperméabilisation
l’atelier, ou du sol au niveau de l’aire de dépotage et de l’aire de
de la station distribution de carburant
de - Stock de sable et matériaux absorbants à proximité
distribution de l’aire de distribution/dépotage
de carburant
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 18/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
Milieu/Domaine Impact Analyse des impacts, moyens de prévention et Impact Mesure
concerné suspecté de protection résiduel compensatoire
potentiel
Risque de - Surfaces imperméabilisés <10% de la surface du
modification bassin versant
du débit du - Bassins de rétention dimensionnés sur la pluie
Très faible
cours d’eau décennale
- Rejet en continu des eaux souterraines drainées sous
les casiers de l’ISDND
Impacts sur la En phase chantier :
qualité des - Mise en place de bassins de décantation
eaux du - Décrotteur pour camions
ruisseau - Interdiction de rejets d’effluents au cours d’eau
En phase exploitation :
- Réseaux de collecte séparatif entre les différents flux
(eaux de voirie, ruissellement sur les parties comblées
de l’ISDND, lixiviats,…)
- Bassins étanches de collecte, de stockage et de
Eaux superficielles
contrôle des effluents
(risque de
- Passage des eaux pluviales de voirie de la zone usine
modification
par un débourbeur- déshuileur avant bassin de
hydraulique et de Faible
rétention,
pollution) Pas de
- Recyclage des effluents dans le procédé de
modification
compostage, consommateur d’eau, y compris lixiviats
de la qualité
épurés de l’ISDND
du cours
- Traitement des lixiviats de l’ISDND avant
d’eau
réutilisation dans le process du PTMB
- Prise en compte par précaution d’un rejet de lixiviats
traités au cours d’eau : seuils de rejets draconiens
calculés en fonction du débit et de la qualité initiale du
ruisseau pour conserver un niveau de qualité très bon
après rejet.
- Contrôles réguliers de la qualité des rejets et du cours
d’eau
- Arrêt des rejets en cas de dérive des paramètres
physico-chimiques
- Analyses de la qualité physico-chimique du ruisseau
en amont et en aval du rejet par un organisme
indépendant
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 19/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
EVALUATION DES IMPACTS SUR L’AIR
Milieu/Domaine Impact Analyse des impacts, moyens de prévention et Impact Mesure
concerné suspecté de protection résiduel compensatoire
potentiel
Phase En phase chantier, les mesures suivantes seront
Chantier : prises :
envols de - arrosage des pistes de chantier lors des périodes
poussières sèches
- lavage systématique des roues des camions en
sortie de site
En phase d’exploitation, les mesures suivantes Faible
seront prises :
Au niveau de l’ISDND :
ISDND : - arrosage au droit des pistes si besoin,
envols de - émission de poussières limitée lors du Bilan
poussières et déchargement des déchets dans l’ISDND en carbone
émanations raison de la nature des déchets (humides) positif au
de biogaz - production de biogaz très faible en raison de la niveau
Air faible quantité de déchets putrescibles régional
(risque de - couvertures régulières des alvéoles de stockage par rapport /
pollution) en cours d’exploitation, à la
- captage et traitement du biogaz (charbon actif + situation
torchère si besoin) actuelle
- contrôles régulier de la qualité des rejets (export
des
Au niveau du PTMB : déchets
PTMB : - émissions de poussières limitées en raison de la vers
envols de nature des déchets stockés (humides) et déchets l’ISDND
poussières et déchargés directement dans le bâtiment mis en de
émanations dépression, du nettoyage régulier des surfaces de Lapouyade
de gaz, roulement en intérieur, de l’arrosage régulier des en
odeurs andains de maturation et des voiries si nécessaire, Gironde)
- bachage des camions de transports des déchets
- traitement de l’air vicié capté dans le bâtiment
process : tour de lavage acide et biofiltre
- contrôles régulier de la qualité des rejets
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 20/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
EVALUATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN
Milieu/Domaine Impact Analyse des impacts, moyens de prévention et Impact Mesure
concerné suspecté de protection résiduel compensatoire
potentiel
Positif
- Installation contribue à la lutte contre la dissémination
Le projet
anthropique des déchets et à la prévention de
participe à
Effets sur les l’environnement
une
activités - Emploi direct de 9 personnes/ Emplois indirects liés à /
véritable
locales l’intervention de prestataires locaux et/ou régionaux
dynamique
(notamment durant la phase travaux, la restauration,
de bassin
etc.)
d’emploi
Gêne sonore
- Les habitations les plus proches du site de traitement
sont situées à plus de 500 m et séparées du site par le
relief,
- En phase chantier, les activités seront limitées à la
période diurne et les engins seront conformes aux
exigences modernes en termes d’émissions sonores.
Des mesures seront réalisées régulièrement,
- En phase exploitation, une modélisation a permis de
vérifier l’absence de gêne sonore potentielle au niveau
Mise en place de
des habitations les plus proches.
haies entre la
voie d’accès au
Gêne visuelle
site et les
Effets sur - Projet conçu pour s’insérer dans le paysage actuel
habitations en
l’habitat (gêne - Aucune habitation ne présente un champ de vision en
bordure
Environnement sonore, direction du vallon d’implantation des installations Faible
(écran visuel et
économique et visuelle, - Zones boisées et collines entourent le site
acoustique)
humain olfactive) -Emissions lumineuses réduites
Mise en place de
- Habitations les plus proches, à plus de 40 m de la voie
haies tout autour
d’accès à créer/élargir
de l’installation
de traitement
Gêne olfactive
- Process et installations conçues pour minimiser la
production d’odeur : fermentation à l’intérieur du
bâtiment avec renouvellement d’air et traitement de
l’air vicié avant rejet
- Une modélisation de la dispersion des odeurs a permis
de vérifier que les habitations les plus proches ne seront
que ponctuellement exposées à de faibles niveaux
d’odeurs, les valeurs réglementaires étant largement
respectées.
Faible
Et
tourisme
Effets sur les vert peu
Haies autour du
activités de - Projet conçu pour s’insérer dans le paysage actuel / présent
projet
loisir Zones boisées et collines entourent le site aux
conservées ou
alentours
replantées
du site
(GR 65 à
2,5 km)
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 21/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
Milieu/Domaine Impact Analyse des impacts, moyens de prévention et Impact Mesure
concerné suspecté de protection résiduel compensatoire
potentiel
- Aucune exploitation forestière dans l’emprise du projet
- Travaux d’aménagement de la voie d’accès faciliteront
Effets sur
l’accès aux parcelles plantées d’eucalyptus si celles-ci Très
l’agriculture et /
viennent à être exploitées faible
la sylviculture
- AOC non affectée
Environnement
économique et
humain
Effets sur le - Aucun monument classé ou inscrit dans un rayon de
patrimoine 500 m autour du site Très
/
historique et - Aucun site archéologique recensé au droit ou à faible
archéologique proximité immédiate du site.
Au niveau de la voie d’accès au site : Très /
- Faible augmentation du trafic sur la RD 11 et la RD 22 faible
lié à l’exploitation du site de traitement
- Absence d’habitation directement situé en bord de
voirie (plus de 40 m)
- Limitation de la vitesse des véhicules / signalisation
Effet sur la
verticale et horizontale/ Pose de miroirs routiers
Sécurité publique sécurité
- Voirie à double sens de circulation,
publique
- Aménagement d’un carrefour « tourne à gauche »
entre la RD 11 et la voie d’accès au site
Au niveau du site de traitement :
- Site entièrement clôturé et fermé par une barrière
télécommandée
Dissémination des déchets : /
- Bâchage des camions,
- Entretien régulier du site et de ses abords,
- Compactage des déchets dans les alvéoles en Très
exploitation, faible
- Mise en place de couvertures sur les alvéoles en
exploitation,
- Dépotage des déchets au niveau du PTMB dans le
bâtiment fermé,
- Mise en place de portes automatiques à
ouverture/fermeture rapide,
- Mise en place, si besoin, d’un dispositif
d’effarouchement des oiseaux.
Effets sur
Gestion des déchets
Hygiène et l’hygiène et la
- L’installation participe à la stratégie départementale de Positif
salubrité salubrité
gestion des déchets,
- Récupération, tri et évacuation des déchets dans les
filières de traitement adaptées,
Captages pour l’alimentation en eau potable
- Aucun captage AEP ni périmètre de protection dans un Nul
rayon de 5 km autour du site,
- Absence de ressources en eau potable au droit du site
Animaux rudophages
- Compactage des déchets qui empêche la création de
galeries par les rongeurs, Moyen
- Réduction de la part fermentescible des déchets dans
l’ISDND par le PTMB,
- Campagnes de dératisation si nécessaire
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 22/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
EVALUATION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LES MILIEUX NATURELS
Milieu/Domaine Impact Analyse des impacts, moyens de prévention et Impact Mesure
concerné suspecté de protection résiduel compensatoire
potentiel
- Choix d’un site éloigné des points visibles extérieurs Restauration des
au site (premières habitations), et écran visuel constitué haies détruites et
par les zones boisées situées entre les habitations et le mise en place de
site haies autour du
Effets sur le
Paysage - Choix de couleurs adaptées au paysage local pour les Faible projet et le long
paysage
constructions de la voie
- Choix d’ouvrages de faible hauteur d’accès à
- Plantation d’arbres de hautes tiges à proximité du bâti, proximité des
- Maintien des haies périphériques habitations
Création et
En phase chantier, les mesures suivantes seront prises : gestion d’habitat
- Formation du personnel des entreprises vis-à-vis des d’intérêt
enjeux naturalistes communataire à
- Protection des habitats naturels par délimitation des l’intérieur du site
Impact par zones à interdire aux engins Faible sur une surface
destruction - Adaptation des périodes de travaux : arasement des d’environ 10 ha
d’habitats haies à la fin de l’été, coupe des vieux arbres en hiver. (60 fois plus que
naturels et la superficie
habitats détruite dans le
d’espèces et En phase d’exploitation, les mesures suivantes seront cadre du projet)
risques de prises :
mortalité par - Maintien de la protection des zones à interdire aux Très
collision engins faible Replantation de
- Suivi écologique à long terme haies avec des
essences locales
(3200 m créés
contre 800 m
détruits)
Milieu Naturel
Faune/Flore
En phase chantier, les principales mesures suivantes
seront prises :
- Stockage des produits sur zones dédiés avec rétention,
- Interdiction de rejets au cours d’eau
- Ouvrages de décantation des eaux de ruissellement
Impacts par
dégradation de En phase d’exploitation, les mesures permettant de ne
la qualité des pas dégrader la qualité du cours d’eau sont notamment Très
eaux et des les suivantes : faible /
habitats - Collectes et traitement des eaux de ruissellement,
aquatiques - Recyclage des eaux de procédé,
- Traitement poussé des lixiviats de l’installation de
stockage des déchets, permettant un rejet n’altérant pas
la qualité physico-chimique du ruisseau (maintien d’une
classe de qualité très bonne),
- Pas de rejet en période d’étiage
- Suivi écologique du cours d’eau
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 23/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
MESURES REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES
L’ensemble des mesures prises par l’exploitant pour limiter, réduire et/ou compenser les effets du
fonctionnement de ses installations sur l’environnement a été précisé dans l’étude d’impact. Parmi les
mesures compensatoires, figurent notamment la restauration des haies détruites durant l’aménagement du
site et la plantation de haies autour du projet et en bordure de la voie d’accès au site, au niveau des
habitations. Ces haies ont une vocation naturaliste, mais aussi d’écran acoustique et visuel pour les
riverains.
Le dossier technique détaille également les aménagements et les équipements techniques qui seront mis en
place sur le site par le syndicat Bil Ta Garbi pour assurer une gestion cohérente et conforme à la
réglementation applicable des ICPE.
Dans la continuité de la démarche exposée précédemment, pour améliorer la connaissance des effets
environnementaux ou sanitaires liés au fonctionnement du site de traitement de Charritte-de-Bas et ainsi
permettre la mise en œuvre de corrections éventuellement nécessaires, le syndicat mixte Bil Ta Garbi
mettra en place un important programme de surveillance de la qualité de l’air, de la qualité des eaux
souterraines et superficielles ainsi qu’un suivi écologique, sur le site, mais également à l’extérieur des
installations.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 24/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE
SOURCE DE DANGER RETENUES
Source de Substances ou Milieu
Nature du danger Voie d’exposition Commentaire
dangers effet impliqués impacté
Composés traces Méthanisation en
(H2S, composés casiers étanches
Biogaz natif
chlorés, BTEX, Drainage des gaz
aldéhydes, …)
Inhalation
CO, SO2, NOx,
Biogaz ISDND
Rejets atmosphériques de composés traces
-
la torchère résiduels,
poussières
Collecte et destruction
Odeurs Stress -
du biogaz
Bassin de stockage des Odeurs : Stress -
Lixiviats lixiviats Traces de
ISDND composés Air -
chimiques
Traces de
Rejet atmosphérique du composés
-
système de filtration chimiques et
Gaz PTMB poussières Inhalation
Traces de
Plate-forme de stockage
composés -
du compost
chimiques
Jus de Traces de
Bassin de stockage des
procédé composés -
jus de compost
PTMB chimiques + odeurs
POPULATION EXPOSEE ET POPULATION SENSIBLE
On dénombre environ 18 habitations dans un rayon de 2,3 km autour du site. La ferme la plus proche sous
les vents dominants est localisée à 500 m du site. Aucun établissement recevant du public n’est recensé
dans un rayon de 1 km.
Aucune activité artisanale, industrielle, commerciale ou de loisir n’est recensée dans un rayon de 1 km.
SELECTION DES VOIES D’EXPOSITION
La source d’exposition retenue est l’inhalation de composés gazeux et particulaires.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 25/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE DES REJETS DE
L’INSTALLATION
Chacune des substances chimiques
retenues comme traceur du risque pour la
santé des populations a fait l’objet d’une Concentrations moyennes annuelles
modélisées pour le NH3
étude de dispersion qui prend en compte en µg/m3
les conditions météorologiques locales sur Point spécifique
3
NH3 (µg/m )
1 4.65E-02
5 années complètes ainsi que les 2
3
2.00E-02
1.24E-02
conditions de relief. Cette étude a permis
4 7.00E-03
5 5.21E-03
6 1.43E-02
de déterminer les concentrations attendues 7
8
9
2.28E-02
6.27E-03
4.74E-03
dans l’environnement du site et notamment 10
11
3.87E-03
6.71E-03
12 1.81E-03
au niveau des habitations riveraines. A titre 13
14
3.13E-03
2.44E-03
15 2.15E-03
d’exemple, la carte des niveaux d’odeur et 16
17
4.41E-03
1.40E-02
18 4.98E-02
la carte des concentrations moyennes
annuelles en ammoniac sont présentées sur
les figures ci-contre.
Concentrations d’odeurs en percentiles 98
horaires modélisées
en uoE/m3
3
Point spécifique Odeurs en P98 (uoE/m )
1 1.71E+00
2 8.62E-01
3 4.02E-01
4 2.35E-01
5 1.27E-01
6 4.58E-01
7 7.70E-01
8 3.13E-01
9 1.68E-01
10 1.13E-01
11 1.39E-01
12 2.71E-02
13 7.88E-02
14 1.08E-01
15 7.61E-02
16 1.76E-01
17 3.34E-01
18 1.17E+00
EVALUATION DU RISQUE POUR LA SANTE DES RIVERAINS
La quantification des risques consiste en la comparaison de valeurs de référence (dose inhalée- effet
provoqué par cette dose) aux doses d’exposition prévues issues de la modélisation de dispersion
atmosphérique pour le projet. Cette comparaison permet de connaître :
l’apparition d’un effet dans une population (Quotient de danger ou QD) dans le cas d’une exposition aux
risques non cancérigènes
la probabilité pour un individu de développer un cancer (Excès de Risque Individuel ou ERI) dans le cas
d’une exposition aux toxiques cancérigènes.
Cette comparaison fait apparaître qu’aucun impact pour la santé des populations environnantes
associé au projet du syndicat Bil Ta Garbi sur le site de Charritte-de-Bas n’est attendu.
D’autre part, l’objectif de qualité de l’air vis-à-vis des odeurs, défini à l’article 26 de l’Arrêté
Ministériel du 22 avril 2008, est respecté.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 26/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
7 - UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET DE LA
CONSOMMATION EN EAU
Dans son projet et dans un souci de développement durable, Bil Ta Garbi a décidé de limiter sa
consommation en eau et en énergie. Les mesures suivantes seront notamment prises :
ENERGIE EAU
Chauffage de l’eau des bureaux par un chauffe-eau solaire avec un appoint par
thermoplongeur électrique en cas d’insuffisance de soleil. Recyclage des effluents
pour les besoins en eau du
Isolation renforcée des locaux.
process
Mise en place d’une VMC double flux avec échangeur rotatif permettant la
récupération de chaleur.
Positionnement stratégique des locaux / Eclairage naturel privilégié. Surveillance des
Equipement des éclairages extérieurs de capteurs photosensibles. consommations d’eau
Choix de matériaux pour la construction selon des critères de mise en œuvre
pratique, modularité, inertie thermique et faible impact environnemental.
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 27/28
Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés de Charritte de Bas (64)
8 - REAMENAGEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE APRES
EXPLOITATION
A la fin de la période d’exploitation, dont la durée est prévue sur 20 ans, soit à l’horizon 2031, le
réaménagement du site comportera :
Concernant la zone usine de pré-traitement mécano-biologique :
Le démantèlement des installations et de la remise en état des sols conformément
aux dispositions des articles R512-74 à R512-76 du code de l’environnement.
L’enlèvement de la clôture.
La remise en œuvre de la couverture de terre végétale décapée lors des travaux de
création du site et stockée sur site durant la période d’exploitation.
La réaffectation des terrains, à un usage de type agricole.
Concernant la zone de l’installation de stockage de déchets :
La mise en œuvre d’une couverture de type imperméable au droit des parties
comblées de la zone de stockage (3,5 ha).
La mise en œuvre et l’entretien de la couverture végétale au droit de la zone de
stockage.
Le maintien des installations de gestion des effluents tant que nécessaire pendant la
période de suivi post-exploitation.
Le réaménagement de l’installation de stockage de déchets prendra en compte plusieurs impératifs :
isolement des déchets vis-à-vis des eaux de pluie par la mise en place d’une couverture définitive,
intégration du site dans son environnement,
devenir à long terme du site compatible avec la présence de déchets,
suivi facilité des éventuels rejets dans l’environnement.
La période de suivi post-exploitation est prévue au minimum sur 30 ans après la fin d’exploitation, jusqu’à
stabilisation du massif de déchets et vérification de l’innocuité du site pour l’environnement. L’exploitant
veillera durant cette période au bon fonctionnement des installations de traitement du biogaz et des lixiviats
ainsi qu’à la sécurité générale du site.
Vue en perspective
de l’intégration de
la zone de stockage
de déchets dans
son environnement
Résumé non technique de l’étude d’impact – Mars 2010 Page 28/28
Vous aimerez peut-être aussi
- Initiation À La Modélisation Et À L'impression 3DDocument26 pagesInitiation À La Modélisation Et À L'impression 3DSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- CleoCE2 AffichesDocument27 pagesCleoCE2 Afficheskitarof100% (1)
- Guérir Par L'ÉnergieDocument21 pagesGuérir Par L'ÉnergieAchraf MouhjarPas encore d'évaluation
- 476550611Document300 pages476550611Tampolla SergePas encore d'évaluation
- Leblanc-Arsene Lupin Gentleman-CambrioleurDocument292 pagesLeblanc-Arsene Lupin Gentleman-CambrioleurSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- Musset-Les Caprices de MarianneDocument37 pagesMusset-Les Caprices de MarianneSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- A Hypochondriac's Song PROOF5b-ADocument11 pagesA Hypochondriac's Song PROOF5b-AMycah WesthoffPas encore d'évaluation
- Gobineau-Les PleiadesDocument453 pagesGobineau-Les PleiadesSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- H AUTEURDocument1 pageH AUTEURSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- Dumas-Le Comte de Moret - Tome I PDFDocument423 pagesDumas-Le Comte de Moret - Tome I PDFSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- MB-P1010132-MBot2 Getting Started Activities FRDocument114 pagesMB-P1010132-MBot2 Getting Started Activities FRSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- PoteauDocument3 pagesPoteauSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- Region Reunion Projet de Plan de Gestion Menagers Des Dechets Solides 2007 PDFDocument25 pagesRegion Reunion Projet de Plan de Gestion Menagers Des Dechets Solides 2007 PDFSylvestre Olanlo100% (1)
- Site Vitrine TIDD PDFDocument5 pagesSite Vitrine TIDD PDFSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- Obs DAE Rapport Final Definitif PDFDocument146 pagesObs DAE Rapport Final Definitif PDFSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- M7-Influence Du Rapport E-C Sur Les PropriétésDocument68 pagesM7-Influence Du Rapport E-C Sur Les PropriétésSylvestre Olanlo100% (2)
- Cours Gestion Des Déchets IFPS 05012020 PDFDocument112 pagesCours Gestion Des Déchets IFPS 05012020 PDFSylvestre Olanlo100% (2)
- Ref Dechets PDFDocument48 pagesRef Dechets PDFSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- M5-Effet Des Agrégats À Base de Déchets Plastiques Sur Les Différentes Propriétés Des Matériaux CompositesDocument183 pagesM5-Effet Des Agrégats À Base de Déchets Plastiques Sur Les Différentes Propriétés Des Matériaux CompositesSylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- Exposé Déchets Loÿe 10 Et 17-10-2013Document70 pagesExposé Déchets Loÿe 10 Et 17-10-2013Sylvestre OlanloPas encore d'évaluation
- Eva GrilleDocument2 pagesEva GrilleImane HanafiPas encore d'évaluation
- NF P 98 252 - PCGDocument17 pagesNF P 98 252 - PCGEl Hadji Moulaye GueyePas encore d'évaluation
- Description Du Processus de Fa - El IDRISSI JAZOULI Khadija - 2216Document30 pagesDescription Du Processus de Fa - El IDRISSI JAZOULI Khadija - 2216MENARA BETPas encore d'évaluation
- Minutes Executivecommitteemay2021 French PDFDocument43 pagesMinutes Executivecommitteemay2021 French PDFPhilippe GossouPas encore d'évaluation
- Fireworks - LDP - 1re Chapitre 11 - Is It A Brave New WorldDocument46 pagesFireworks - LDP - 1re Chapitre 11 - Is It A Brave New WorldplumagathaPas encore d'évaluation
- Avis de Recrutement FBRDocument2 pagesAvis de Recrutement FBRBouba DiambaPas encore d'évaluation
- Fiche Lecture Cuisines Cuisine Et ClassesDocument3 pagesFiche Lecture Cuisines Cuisine Et ClassesGerard BeuretPas encore d'évaluation
- Apprentissage À La PhotographieDocument26 pagesApprentissage À La PhotographieGilles-Axel EsmelPas encore d'évaluation
- Guide Rameur 2021Document32 pagesGuide Rameur 2021Pascale BolazziPas encore d'évaluation
- DR COCHARD-Examen PupillesDocument71 pagesDR COCHARD-Examen Pupillesandreea.aignatoaiePas encore d'évaluation
- You TubeDocument3 pagesYou Tube80cc9667b5Pas encore d'évaluation
- 2018 JCI Plan of Action - FRE PDFDocument4 pages2018 JCI Plan of Action - FRE PDFChristian Trésor KandoPas encore d'évaluation
- CDG CCDocument97 pagesCDG CCAli AmarPas encore d'évaluation
- CV Exemple CompetencesDocument2 pagesCV Exemple CompetencesAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Salon de L'agriculture: Découvrez Les Vins de L'yonne Médaillés D'or Du Concours Général Agricole 2019Document10 pagesSalon de L'agriculture: Découvrez Les Vins de L'yonne Médaillés D'or Du Concours Général Agricole 2019Myriam LebretPas encore d'évaluation
- Gestion Des Matière Récupérer Finissage-ConvertiDocument5 pagesGestion Des Matière Récupérer Finissage-ConvertiSa Lou100% (1)
- Focus CenovnikDocument9 pagesFocus CenovnikНедељко АнђелићPas encore d'évaluation
- Horaire Été 2018Document3 pagesHoraire Été 2018hihouPas encore d'évaluation
- Dossier de Montage EcomurDocument15 pagesDossier de Montage EcomurEco-Logis-InnovationPas encore d'évaluation
- Dossier Technique Pour L Apprentissage Des KuatsuDocument10 pagesDossier Technique Pour L Apprentissage Des KuatsuDanieri Saris FerreiraPas encore d'évaluation
- Thies Phares SVT 2nd Cycle RevuesDocument90 pagesThies Phares SVT 2nd Cycle RevuesMichel NDOURPas encore d'évaluation
- Ed826 PDFDocument60 pagesEd826 PDFjavi_de_garciaPas encore d'évaluation
- Fiches 3asc Parcours Période 6Document69 pagesFiches 3asc Parcours Période 6jamila1989ramocPas encore d'évaluation
- 002-Expansions CorrectionpdfDocument2 pages002-Expansions CorrectionpdfMostafaPas encore d'évaluation
- Poly SIDocument120 pagesPoly SIEssaid AjanaPas encore d'évaluation
- ED 2 de Biologie Cellulaire FMMDocument5 pagesED 2 de Biologie Cellulaire FMMbmnkhalilPas encore d'évaluation