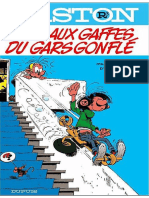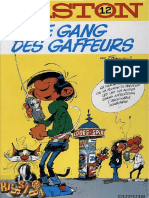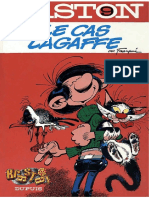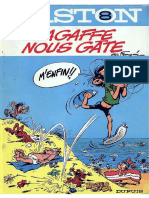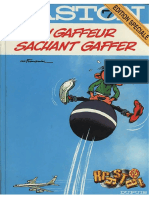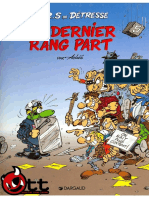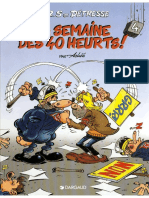Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues06 - Le Bouc +®missaire
06 - Le Bouc +®missaire
Transféré par
anabasethDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous aimerez peut-être aussi
- Sterling, Bruce Schismatrice + (1985) .OCR - French.ebook - AlexandrizDocument539 pagesSterling, Bruce Schismatrice + (1985) .OCR - French.ebook - AlexandrizanabasethPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Ren+® Girard - Laurent LinneuilDocument18 pagesEntretien Avec Ren+® Girard - Laurent LinneuilanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 13 - Lagaffe Mérite Des BaffesDocument47 pagesGaston Lagaffe - Tome 13 - Lagaffe Mérite Des BaffesanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 3 - Gare Aux Gaffes Du Gars GonfléDocument54 pagesGaston Lagaffe - Tome 3 - Gare Aux Gaffes Du Gars GonfléanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 12 - Le Gang Des GaffeursDocument47 pagesGaston Lagaffe - Tome 12 - Le Gang Des GaffeursanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 15 - Gaffe À LagaffeDocument47 pagesGaston Lagaffe - Tome 15 - Gaffe À Lagaffeanabaseth100% (3)
- Gaston Lagaffe - Tome 14 - La Saga Des GaffesDocument47 pagesGaston Lagaffe - Tome 14 - La Saga Des Gaffesanabaseth100% (1)
- Gaston Lagaffe - Tome 9 - Le Cas LagaffeDocument54 pagesGaston Lagaffe - Tome 9 - Le Cas LagaffeanabasethPas encore d'évaluation
- Cours Conception Appl Master 2012 2013 Partie 1Document149 pagesCours Conception Appl Master 2012 2013 Partie 1anabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 8 - Lagaffe Nous GâteDocument60 pagesGaston Lagaffe - Tome 8 - Lagaffe Nous Gâteanabaseth100% (1)
- Gaston Lagaffe - Tome 7 - Un Gaffeur Sachant GafferDocument61 pagesGaston Lagaffe - Tome 7 - Un Gaffeur Sachant GafferanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 11 - Gaffes, Bévues Et BoulettesDocument46 pagesGaston Lagaffe - Tome 11 - Gaffes, Bévues Et BoulettesanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 10 - Le Géant de La GaffeDocument55 pagesGaston Lagaffe - Tome 10 - Le Géant de La GaffeanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 8 - Coups, Coups C'Est Nous !Document50 pagesC.R.S Detresse - Tome 8 - Coups, Coups C'Est Nous !anabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 2 - Gala de Gaffes À GogoDocument61 pagesGaston Lagaffe - Tome 2 - Gala de Gaffes À GogoanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 6 - Des Gaffes Et Des DégâtsDocument61 pagesGaston Lagaffe - Tome 6 - Des Gaffes Et Des DégâtsanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 4 - en Direct de La GaffeDocument46 pagesGaston Lagaffe - Tome 4 - en Direct de La GaffeanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 5 - Le Dernier Rang PartDocument52 pagesC.R.S Detresse - Tome 5 - Le Dernier Rang PartanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 1 - Gaffes Et GadgetsDocument49 pagesGaston Lagaffe - Tome 1 - Gaffes Et GadgetsanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 5 - Le Lourd Passé de LagaffeDocument48 pagesGaston Lagaffe - Tome 5 - Le Lourd Passé de LagaffeanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 6 - La Rossée Du MatinDocument50 pagesC.R.S Detresse - Tome 6 - La Rossée Du MatinanabasethPas encore d'évaluation
- Les Invraisemblabes Aventures D'istérixDocument46 pagesLes Invraisemblabes Aventures D'istérixanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Le Bureau Des Gaffes en GrosDocument54 pagesGaston Lagaffe - Le Bureau Des Gaffes en GrosanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 4 - La Semaine Des 40 Heurts !Document49 pagesC.R.S Detresse - Tome 4 - La Semaine Des 40 Heurts !anabasethPas encore d'évaluation
- Astérix - T02 - La Serpe D'orDocument43 pagesAstérix - T02 - La Serpe D'oranabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome C.R.S Detresse - Tome 10 - Dégelée Sur L'HerbeDocument49 pagesC.R.S Detresse - Tome C.R.S Detresse - Tome 10 - Dégelée Sur L'HerbeanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 3 - Danse Avec Les Coups !Document49 pagesC.R.S Detresse - Tome 3 - Danse Avec Les Coups !anabasethPas encore d'évaluation
- Livre I - Anthropologie FondamentaleDocument103 pagesLivre I - Anthropologie FondamentaleanabasethPas encore d'évaluation
- Livre III - Psychologie InterdividuelleDocument98 pagesLivre III - Psychologie InterdividuelleanabasethPas encore d'évaluation
- Le Sacrifice Au Cœur de La CultureDocument5 pagesLe Sacrifice Au Cœur de La CultureanabasethPas encore d'évaluation
06 - Le Bouc +®missaire
06 - Le Bouc +®missaire
Transféré par
anabaseth0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues161 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format pdf
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues161 pages06 - Le Bouc +®missaire
06 - Le Bouc +®missaire
Transféré par
anabasethDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format pdf
Vous êtes sur la page 1sur 161
GIRARD
LE BOUG
EMISSAIRE
Dans le droit fil de Des choses cachées depuis la_fondation
du monde, René Girard continue sa réflexion sur le
« mécanisme sacrificiel ». Les persécutions, le Mal
sont-ils une fatalité? Les sociétés humaines sont-
elles vouées 4 la violence ? Un commentaire subtil de
Vhistoire et des Evangiles propose les éléments d’une
réponse,
Texte intégral
Couv. Van Eyck. Polahirest de L'Agneau mystique (détail).
|
42/4029/7
Dépét légal Impr. 3770-5 Edit. 1958 - 2/1989
Il
| Code prix LP 12
| 85
Laurent CRESPIN
Le Bouc émissaire
Lentement, méthodiquement, obstinément, I'ccuvre de René Girard se
construit, Livre aprés livre, le penscur élabare et affine son systtme, urga-
hise lédilice théorique & partir duquel se dessine une nouvelle itnage de
homme, et surtout, & partir duquel il devient possible d'imaginer les
Jinéaments d'un ordre du social qui soit épuré de quelques-unes de ses tares
constitutives. Dans ccue perspective Le Bouc émissaire a quasiment valeur
d’achtvement du cycle de fondation du systéme-Girard. II ramasse et
synthétise les analyses développées dans les précédenty owvrages, et s’ouvre
ensuite sur un. programe flamboyant qui, de Sacrate A nos modernes
Goulags, traque la grande constante des sociétés bumaines, le fait de la per
sécution comme principe originaire et structurel de cout ordre social, pour
tenter d’en formuler antidote. Avec au centre de la recherche le persen-
nage du Christ : figure exemplaire, selon Girard, dont la parole, pour qui
sait entendre, fournit les mayens d’échapper enfin & la faralité du Mal.
On s’en souvient, au départ de la démarche if y a cu Critique dans un souter-
rain et Mfensonge romantique ef uéritd romanesque. Deux textes d’investigation li
téraire of dgja s'exprimait "hypothése majeure de la réflexion girardienne,
le « désir mimétique ». Une idée force qui prane que homme n'est jamais
ala source de son propre désic, lequel toujours émane « mimétiquement »
d'un tiers, d’un médiateur constitué A la fois cornme modéle et comme
rival. Le « désir mimétique » ou Pincontournable loi de l'étre, qui nous
pidge et nous enferme dans un triangle infernal ; on ne désire que ce qu'un
autre désire. G'est cette chimie particuligre qui explique la permanente
concurrence entre les hommes et cond compte de l"éternelle violence dont
sont pétris leurs rapports. A lire Girard dans ces deux ouvrayes, nombreux
scraient les grands écrits fittéraires qui vérifient l"hypothése. Comme si,
avant les théoriciens, les romanciers avaient intuitionné la vérité cachée. La
wanité chez Stendhal ? Le snobisme chez Proust? L'idolaurie haineuse chez
Dostoievski? L*héroisme chez Cervantis? Autant de cas différents, ct
cependant tris proches, car chacun se révéle instrnit, gouverné par le phé-
nomine mimélique. Quichotte ne desire que le désir d’ Amadis, comme
Julien celui de Bonaparte ov Swann celui du Prince de Gules... La preuve
du « désir mimétique » par Vimaginaire littérairc.
Mais, pour convaincante qu'elle ait évé, la démonstration manquait encore
dassises. En mati¢re de théorie Pépreuve du zéel est une étape inévitable.
Suivirent alors les deux maitres ouvrages du givardisme : La Violence ef le
Sacré, et surtout Des choses caches deputy la fondation du monde, ‘Textes d'ouver-
ture, Girard prend du champ, élargit ses perspectives, ajuste ses concepts.
L'histoire, les mythes, fe matériau ethnologique, les écrits religieux sont
désormais mubilisés pour explorer les manifestations et les effets du « désir
mimeétique ». Une progression pas & pas qui articule bientét toutes les
pidces du systéme, jusqu’& former un ensemble parfaitement bétonné. Sur
le désir maintenant vient $¢ brancher l’idée de « crise » : quand dans une
(Suite aw verso.)
société Je mimétisme se déchaine, c'est--dire que tous les désirs tendent
vers U'indifférencié, Dun coup la cohésion du groupe vacille, se fissure,
Punité sociale est sur fe point de voler en tclats, s’effondrerait méme, si, a
Vultirne limits, tous les membres du groupe ne s’entendaient paur se priver
ensemble de lcur désir commun, pour se livrer en somme A une eatharsis col-
lective grAce au sacrifice d'une victime émissaire.
‘Tous les éléments de 1’anthropolo; pirardienne sont en place. Freud et
Tévi-Strauss sont renvoyés pour insuffisance interprétative, [J faut relive la
tragédic ardipienne 4 la lumitre des rapports mimétiques, afin de: découvrir
que le vritable crime d*CEdipe n était pas | assaysinat de son ptre, mais sa
tentative pour réduire les différences ct confondre le méme et l'autre dans
une indistinction monstrueuse. LA réside la clé du mythe et aussi Pune des
plus essentielles parnsi les « choses cachées ». En devenant parricide, en
poussani( donc & son point extréme son désir du désir paternel, CRalipe bou-
leversait trop radicalement ley quilibres fondatnentaux de Thébes qui, dés
lors, n’avait d’autre issue pour les rétablir que sa propre mort. Ainsi est la
Joi des sociétés humaines. Elies ne conquitrent leur pérenmiité qu’au prix de
la régulation des viviences réeiproques. Principe du rite sacrificiel des reli-
gions ; Vinstauration dunc « violence fundutrice » qui supplante les autres
violences. La mort d’un seul pour la survie de tous.
Mais René Girard, heureuserment, n'en reste pas & ce constal pessimiste, et
cest cela la grande: nouveauté qui apparalt dans Le Boue émissaire, dernier
tmement done de son cycle. En fait, dit-il en substance, Ju schéraa sacriliciel
ut exception a Ja régle, une
nest pas inéluctable. TH existe une culture ¢
cullurt qui avoue innocence des victimes martyrisées au lien de fermer les
yeux et de faire mine de croire que leur mort était logique, voire Kégitime au
regard des impératits de l'ortre et du bien communs... Notre culture.
Modelée, purtéc par deux Testaments, Girard estime en effet qu'avec le
judGo-christianisme cesse le jeu de capes de l'erdinaire religieux. Tout eo
corpus raconte la vérité de l'histoire at dévoile les mécanismes mortiferes dua
fonctionnement social, En queique sorte il nous enseigne l'alphabet du mal
foul cn nous procurant les moyens dy remécier. « L’heure est venue —~
écrit ainsi Girard — de nous pardonner les uns les autres. Si nous atten=
dons entore, nous n'aurons plus le cemps. » Au terme de analyse ily a ce
que Pon nomme ; la sagesse. Le Bouc émissaire est le livre Pune nouvelle
espérance.
RENE GIRARD
Le Bouc émissaire
GRASSET
Paru dans Le Livre de Poche :
DES CHOSES CACHEES DEPUIS
LA FONDATION DU MONDE.
CRITIQUE DANS UN SOUTERRAIN.
La ROUTE ANTIQUE DES HOMMES PERVERS.
‘Tous droits de traduction, de reproduction et 4’ adaptation
réservés pollt tous pays.
© Editions Grasset & Fasquelle, 1982.
CHAPITRE PREMIER
GUILLAUME DE MACHAUT ET LES JUIFS
Le poéte francais Guillaume de Machaut écrivait au
milieu du xe siécle. Son Jugement du Roy de Navarre
mériterait d'étre mieux connu. La partie principale de
I'ceuvre, certes, n’est qu'un long poeme de style courtois,
conventionnel de style et de sujet. Mais le début a quel-
que chose de saisissant, C'est une suite confuse d’événe-
ments catastrophiques auxquels Guillaume prétend avoir
assisié avant de s’enfermer, finalement, de terreur dans
sa maison pour y attendre ta mort ou la fin de I’indicible
epreuve. Certains événements sont tout 4 fait invraisem- .
blables, d'autres ne le sont qu’a demi. Et pourtant de ce
récit une impression se dégage : il a dd se passer quel-
que chose de réel.
Hy a des signes dans le ciel. Les pierres pleuvent et
assomment les vivants. Des villes entiéres sont détruites
par la foudre. Dans celle of résidait Guillaume — il ne
dit pas laquelle — les hommes meurent en grand nom-
bre. Certaines de ces morts sont dues 4 la méchanceté
des juifs et de leurs complices parmi les chrétiens. Com-
ment ces gens-la s’y prenaient-ils pour causer de vastes
pertes dans la population locale ? Ils empoisonnaient les
riviéres, les sources d’approvisionnement en eau potable.
La justice céleste a mis bon ordre 4 ces méfaits en réve-
5
lant leurs auteurs a la population qui les a tous massa-
crés. Et pourtant les gens n’ont pas cessé de mourir, de
plus en plus nombreux, jusqu’é un certain jour de prin-
temps o& Guillaume entendit de la musique dans la rue
et des hommes et des femmes qui riaient. Tout était fini
et la poésie courtoise pouvait recommencer.
Depuis ses origines aux xvi® et xvu® siécles, la critique
moderne consiste 4 ne pas faire aux textes une confiance
aveugle. Beaucoup de bons esprits, 4 notre époque,
croient faire progresser encore la perspicacité critique
en exigeant une méfiance toujours accrue. A force d’étre
interprétés et réinterprétés par les générations successi-
ves d'historiens, des textes qui paraissaient naguére por-
teurs d'information réelle sont aujourd'hui soupconnés.
Les épistémologues et les philosophes, d’autre part, tra-
versent une crise radicale qui contribue a |’ébrantement
de ce qu'on appelait jadis la science historique. Tous les
intellectuels habitués 4 se nourrir de textes se réfugient
dans des considérations désabusées sur l’impossibilite de
toute interprétation certaine.
Au premier abord, le texte de Guillaume de Machaut
peut passer pour vulnérable au climat actuel de scepti-
cisme en matiére de certitude historique. Aprés quelques
instants de réflexion, pourtant, méme aujourd’hui, tes
lecteurs reperent des événements réels a travers les
inyvraisemblances du récit. Ils ne crojent ni aux signes
dans le ciel ni aux accusations contre les juifs mais ils ne
traitent pas tous les thémes incroyables de la méme
facon; ils ne les mettent pas tous sur le méme plan.
Guillaume n’a rien inventé. C’est un homme crédule,
certes, et il refléte une opinion publique hystérique. Les
innombrables morts dont il fait état n’en sont pas moins
réelles, causées de toute évidence par la fameuse peste
noire qui ravagea le nord de la France en 1349 et 1350.
Le massacre des juifs est également réel, justifié aux yeux
des foules meurtriéres par les rumeurs d’empoisonne-
ment qui circulent un peu partout. C'est la terreur uni-
verselle de la maladie qui donne un poids suffsani 4 ces
rumeurs pour déclencher lesdits massacres.
6
Voici le passage du Jugemen: dee Roy de Navarre qui
traite des juifs :
Aprés ce, vint une merdaille
Fausse, traitre et renoie ;
Ce fu Judée la honnie,
La mauvaise, la desloyal,
Qui bien het et aimme tout mal,
Qui tant donna d’or et d’argent
Et promist a crestienne gent,
Que puis, rivieres et fonteinnes
Qui estoient cleres et seinnes
En plusieurs lieus empoisonnerent,
Dont pluseurs leurs vies finerent ;
Car trestuit cil qui en usoient
Assez soudeinnement moroient.
Doni, certes, par dis fois cent mille
En morurent, qu’a champ, qu'a ville.
Einsois que fust apercené
Ceste mortel deconvenue
Mais cils qui haut siet et louing voit,
Qui tout gouverne et tout pourvoit,
Ceste traison plus celer
Ne volt, enis la fist reveler
Et si generalement savoir
Qu'ils perdirent corps et avoir.
Car tuit Juif furent destruit,
Li uns pendus, li autres cuit,
L'autre noié, l'autre ot copée
La teste de hache ou d’espée.
Et maint crestien ensement
En morurent honteusement*.
Les communautés médiévales redoutaient tellement la
peste que son nom méme les effrayait; elles évitaient
aussi longtemps que possible de le prononcer.et méme
de prendre les mesures qui s'imposaient, au risque
d'aggraver les conséquences des épidémies. Leur impuis-
sance était telle qu’avouer la vérité, ce n’était pas faire
face A la situation mais plutét s'abandonner a ses effets
désagrégateurs, renoncer a tout semblant de vie nermale.
7
La population tout entiére s’associait volontiers 4 ce type
d’aveuglement. Cette volonté désespérée de nier |’évi-
dence favorisait la chasse aux « boucs émissaires? ».
Dans Les Animaux malades de la peste, La Fontaine
suggére admirablement cette répugnance quasi reli-
gieuse A énoncer le terme terrifiant, aA déchainer en
quelque sorte sa puissance maléfique dans la commu-
nauté :
La peste (puisqu’'il faut l'appeler par son nom)...
Le fabuliste nous fait assister au processus de la mau-
vaise foi collective qui consiste 4 identifier dans i’épidé-
mnie un chatiment divin. Le dieu de colére est irrité par
une culpabilité qui n’est pas également partagée par tous.
Pour écarter le fléau,.il faut découvrir le coupable et le
traiter en conséquence ou plutét, comme écrit La Fon-
iaine, le « dévouer » a fa divinité.
Les premiers interrogés, dans la fable, sont des bétes
de proie qui décrivent benoitement leur comportement
de béte de proie, lequel est tout de suite excusé, L’ane
vient en dernier et c'est lui, le moins sanguinaire et, de
ceé fait, le plus faible et le moins protégé, qui se voit, en
fin de compte, désigné.
Dans certaines villes, pensent les historiens, les juifs se
firent massacrer avant l’arrivée de la peste, au seul bruit
de sa présence dans le voisinage. Le récit de Guillaume
pourrait correspondre 4 un phénomeéne de ce genre car
le massacre se produisit bien avant le paroxysme de l'épi-
démie. Mais les nombreuses moris attribuées par ]’auteur
au poison judaique suggérent une autre exptication. Si
ces morts sont réelles — et il n'y a pas de raison de les
tenir pour imaginaires -~ elles pourraient bien étre les
premiéres victimes d'un seul et méme fléau, Mais Guil-
laume ne s’en doute pas, méme rétrospectivement. A ses
yeux les boucs émissaires traditionnels conservent leur
puissance explicatrice pour les premiers stades de lépidé-
ie. Pour les stades ultérieurs, seulement, j’auteur recon-
nait la présence d'un phénoméne proprement pathologi-
8
que. L’étendue du désastre finit par décourager la seule
explication par le complot des empeisonneurs mais Guil-
laume ne réinterpréte pas !a suite entigre des événe-
menis en fonction de leur raison d’étre véritable.
On peut d’ailleurs se demander jusqu’a quel point le
poéte reconnait la présence de la peste car il évite jus-
qu’au bout d’écrire noir sur blanc le mot fatal. Au
moment décisif, il intreduit avec solennité le terme grec
et encore rare, semble-t-il, d’epydimie. Ce mot ne forc-
tfonne pas, visiblement, dans son texte comme il ferait
dans le nétre; ce n’est pas un veritable équivalent du
terme redouté, c’est plutét une espéce de substitut, un
nouveau procédé pour ne pas appeler la peste par son
nom, un nouveau bouc émissaire en somme mais pure-
ment linguistique cette fois. Il n'a jamais été possible,
nous dit Guillaume, de déterminer Ja nature et la cause
de'la maladie dont tant de gens moururent en si peu de
temps :
Ne fusicien n’estoit, ne mire
Qui bien sceiist la cause dire
Dont ce venoit, ne que c’estoit
(Ne nuls remede n'y metoit),
Fors tant que c’estoit maladie
Qu’on appelloit epydimie.
Sur ce point encore, Guillaume préfére s’en remettre &
opinion publique plutét que de penser par lui-méme,
Du mot savant d'epydimie se dégage toujours, au xiv" sié-
cle, un parfum de «scientificité » qui contribue a refou-
ler langoisse, un peu comme ces fumigations odoriferan-
tes qu’on pratiquait longtemps au coin des rues pour
tempérer les effluves pestilentiels. Une maladie bien
nommée parait 4 demi guérie et pour se donner une
{ausse impression de mattrise on rebaptise frequemment
les phénaménes immaitrisables. Ces exorcismes verbaux
n’ont pas cessé de nous séduire dans tous les domaines
ou notre science demeure illusoire ou inefficace, En se
refusant a la nommer c’est la peste elle-méme, en
somme, qu'on « dévoue» a la divinité. Il y a la comme
9
un sacrifice langagier assez innocent, certes, comparé aux
sacrifices humains qui l’accompagnent ou le précédent,
mais toujours analogue dans sa structure essentielle.
Méme rétrospectivement, tous les boucs émissaires
collectifs réels et imaginaires, les juifs et les flagellants,
les pluies de pierre et l'epydimie, continuent a jouer leur
réle si efficacement dans le récit de Guillaume que celui-
ci ne voit jamais l'unité du fléau désigné par nous
comme la « peste noire». L’auteur continue a perce-
voir une multiplicité de désastres plus ou moins indépen-
dants ou reliés les uns aux autres seulement par leur
signification religieuse, un peu comme les dix plaies
d’Egypte.
Tout ce que je viens de dire, ou presque, est évident.
Nous comprenons tous le récit de Guillaume de la méme
fagon et mes lecteurs n’ont pas besoin de moi. Il n'est
pourtant pas inutile d’insister sur cette lecture dont
l'audace et la puissance nous échappent, précisément
parce qu’elle est admise par tous, parce qu’elle n'est pas
controversée. L’unanimité s'est faite autour d’elle il y a
littéralement des siécles et jamais elle ne s’est défaite.
C'est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une réinter-
prétation radicale. Nous rejetons sans hésiter le sens que
lauteur donne a son texte. Nous affirmons qu’il ne sait
pas ce qu’il dit. A plusieurs siécles de distance, nous
autres, modernes, le savons mieux que lui et nous som-
mes capables de rectifier son dire. Nous nous croyons 4
méme de repérer une vérité que |’auteur n’a pas vue et,
par une audace plus grande encore, nous n’hésitons pas a
affirmer que cette vérité, c'est lui qui nous l’apporte, en
dépit de son aveuglement,
Est-ce a dire que cette interprétation ne mérite pas
l'adhésion massive dont etle fait l'objet 2? nous montrons-
nous 4 son égard d'une indulgence excessive ? Pour dis-
créditer un témoignage judiciaire, il suffit de prouver
que, méme sur un seul point, le teémoin manque d’im-
partialité. En régle générale nous traitons les documents
historiques comme des témoignages judiciaires. Or, nous
transgressons cette regle en faveur d'un Guillaume de
10
EE
Machaut qui ne mérite peut-étre pas ce traitement privi-
légié. Nous affirmons la réalité des persécutions mention-
nées dans Le Jugement du Roy de Navarre. Nous préten-
dons tirer du vrai, en somme, d'un texte qui se trompe
prossiérement sur des points essentiels, Si nous avons des
raisons de nous méfier de ce texte, nous devrions peut
étre le tenir pour entigrement suspect et renoncer 4 fon-
der sur lui la moindre certitude, sans excepter le fait brut
de la persécution.
D'ou vient donc Passurance étonnante de notre affir-
mation : des juifs ont été réellement massacrés. Une pre-
miére réponse se présente a |’esprit. Nous ne lisons pas
ce texte isolément. Il existe d’autres textes de la méme
époque; ils traitent des mémes sujets; certains d’entre
eux valent mieux que celui de Guillaume. Leurs auteurs
s'y montrent moins crédules. A cux tous, ils forment un
réseau serré de connaissances historiques au sein duquel
nous replacons le texte de Guillaume. C’est grace a ce
contexte, surtout, que nous réussissons 4 partager le vrai
du fanx dans le passage que jrai cité.
Il est vrai que les persécutions antisémites de la peste
noire constituent un ensemble de faits relativement bien
connu. Il ya la tout un savoir déja constitué et il suscite
en nous une certaine attente. Le texte de Guillaume
repond a cette attente, Cette perspective n'est pas fausse
sur le plan de notre expérience individuelle et du contact
immediat avec le texte, mais du point de we théorique
elie n'est pas satisfaisante.
Le réseau de connaissances historiques existe, certes,
mais les documents qui le composent ne sont jamais
beaucoup plus stirs que !e texte de Guillaume, soit pour
des raisons analogues, soit pour des raisons différentes.
Et nous ne pouvons pas situer Guillaume parfaitement
dans ce contexte puisque nous ne savons pas, je l’ai déja
dit, o& se déroulent les événements qu'il nous rapporte.
C’est peut-étre a Paris, c'est peut-étre a Reims, c’est peut-
étre dans une troisiéme ville. De toute facon le contexte
ne joue pas un réle décisif; méme s'il n’en était pas
informé, le lecteur moderne aboutirait 4 la lecture que
1
j'ai donnée. I] conclurait a la probabilité de victimes
injustement massacrées. It penserait donc que le texte dit
faux, puisque ces victimes sont innocentes, mais il pen-
serait simultanément que le texte dit vrai, puisque les
victimes sont réelles. II finirait toujours par distinguer le
vrai du faux exactement comme nous le distinguons
nous-mémes. Qu’est-ce qui nous donne ce pouvoir ? Ne
convient-il pas de se guider systématiquement sur le prin-
cipe du panier de pommes tout entier bon 4 jeter pour
peu qu'il en contienne une seule de gatée ? Ne doit-on
pas soupconner ici une défaillance du soupcon, un reste
de naiveté dont I’hypercritique contemporaine aurait
déja fait place nette si on lui laissait le champ libre ? Ne
faut-il pas avouer que toute connaissance historique est
incertaine et qu’on ne peut rien tirer d'un texte tel que le
nétre, pas méme la réalité d’une persécution ?
A toutes ces questions il faut répondre par un non
catégorique. Le scepticisme sans nuances ne tient pas
compte de la nature propre du texte. Entre les données
vraisemblables de ce texte et les données invraisembla-
bles il existe un rapport trés particulier. Au départ, cer-
tes, le lecteur ne peut pas dire : ceci est faux, ceci est
vrai. I] ne voit que des thémes plus ou mains incroyables
et croyables. Les morts qui se multiplient sont croyables ;
il pourrait s'agir d'une épidémie. Mais les empoison-
hements ne le sont guére, surtout 4 l’échelle massive
décrite par Guillaume. Le x1v* siécle ne possede pas de
substances capables de produire des effets aussi nocifs.
La haine de l'auteur pour les prétendus coupables est
explicite; elle rend sa thése extrémement suspecte.
On ne peut pas reconnattre ces deux types de données
sans constater, au moins impliciterment, qu’ils réagissent
lun sur l'autre. $'il y a vraiment une épidémie, elle pour-
rait bien enflammer les préjugés qui sommeillent.
Lappétit persécuteur se polarise volontiers sur les mino-
rités religieuses, surtout en temps de crise. Réciproque-
ment, une persécution réelle pourrait bien se justifier par
le type d'accusation dont Guillaume se fait crédulement
l’écho. Un poete tel que lui ne devrait pas étre particu-
12
ligrement sanguinaire. S'il ajoute foi aux histoires qu’il
raconte ¢’est sans doute qu’on y ajoute foi autour de lui.
Le texte suggére donc une opinion publique surexcitée,
préte a accueillir les rumeurs les plus absurdes. Ii sug-
gére, en somme, un état de choses propice aux massacres
dont l’auteur nous affirme qu’ils se sont réellement pro-
duits.
Dans le contexte des représentations invraisemblables,
la vratsemblance des autres se confirme et se transforme
en probabilité. La réciproque est vraie. Dans le contexte
des représentations vraisemblables, l’invraisemblance
des autres ne peut gueére relever d‘une « fonction fabula-
trice » qui s'exercerait gratuitement, pour le plaisir d'in-
venter de la fiction, Nous reconnaissons |'imaginaire,
certes, mais pas n’importe quel imaginaire, ¢’est l’imagi-
naire spécifique des hommes en appétit de violence.
Entre toutes les représentations du texte, par consé-
quent, i] existe une convenance réciproque, une corres-
pondance dont on ne peut rendre compte que par une
seule hypothése. Le texte que nous lisons doit s’enraciner
dans une persécution réelle, rapportée dans !a perspec-
tive des persécuteurs. Cette perspective est forcément
trompeuse en ceci que les persécuteurs sont convaincus
du bien-fondé de leur violence ; ils se prennent pour des
justiciers, il leur faut donc des victimes coupables, mais
cette perspective est partiellement véridique car la certi-
tude d'avoir raison encourage ces mémes persécuteurs 4
ne rien dissimuter de leurs massacres.
Devant un texte du type Guillaume de Machaut, il est
iégitime de suspendre la régle générale selon laquelle
l'ensemble d'un texte ne vaut jamais mieux, sous le rap-
port de "information réelle, que la pire de ses données. Si
le texte décrit des circonstances favorables a la persécu-
tion, s'il nous présente des victimes appartenant au type
que les persécuteurs ont Phabitude de choisir, et si, pour
plus de certitude encore, i] présente ces victimes comme
coupables du type de crimes que les persécuteurs attri-
buent, en régle générale, a leurs victimes, il y a de gran-
des chances pour que la persécution soit réelle. Si le
i3
texte lui-eméme affirme cette réalité, il n’y a pas de rai-
sons de la mettre en doute,
Dés qu'on pressent la perspective des persécuteurs,
Vabsurdité des accusations, loin de compromettre la
valeur d'information d’un texte, renforce sa crédibilité
mais sous le rapport seulement des violences dont i! se
fait lui-méme 1’écho. Si Guillaume avait ajouté des histai-
res d'infanticide rituel 4 son affaire d’empoisonnement,
son compte rendu serait plus invraisemblable encore
mais i} n'en résulterait aucune diminution de certitude
quant 4 la réalité des massacres qu'il nous rapporte. Plus
les accusations sont invraisemblables dans ce genre de
textes, plus elles renforcent la vraisemblance des massa-
cres : elles nous confirment la présence d’un contexte
psychosacial au sein duquel les massacres devaient pres-
que certainement se produire. Inversement, le theme des
massacres, juxtaposé a celui de l’épidémie, fournit le
contexte historique au sein duquel méme un intellectuel
en principe raffiné pourrait prendre au sérieux son his-
toire d’empoisonnement
Les représentations persécutrices nous mentent, indu-
bitablement, mais d'une facon trop caractéristique des
persécuteurs en général et des persécuteurs médiévaux
en particulier pour que le texte ne dise pas vrai sur tous
les points ot i! confirme les conjectures suggérées par la
nature méme de son mensonge. Quand c'est la réalité de
Jeurs persécutions que les persécuteurs probables affir-
ment, ils méritent qu'on leur fasse confiance,
C'est la combinaison de deux types de données qui
engendre la certitude. Si l’on ne rencontrait cette com-
binaison qu‘a de rares exemples cette certitude ne serait
pas complete. Mais la frequence est trop grande pour que
le doute soit possible, Seule la persécution réelle, envi-
sagée dans l'optique des persécuteurs, peut expliquer la
eonjonction réguliére de ces données. Notre interpréta-
tion de tous les textes est statistiquement certaine.
Ce caractére statistique ne signifie pas que la certitude
repose sur la pure et simple accumulation de documents
ious également incertains. Cette certitude est de plus
14
haute qualité. Tout document du type Guillaume de
Machaut a une valeur considérable parce qu’on retrouve
en lui le vraisemblable et l’invraisemblable agencés de
telle fagon que chacun explique et légitime la présence
de Vautre. Si notre certitude a un caractére statistique,
c'est parce que n'importe quel document, envisagé isolé-
ment, pourrait étre I'ceuvre d’un faussaire. Les chances
sont faibles mais elles ne sont pas nuiles au niveau du
document individuel. Au niveau du grand nombre, en
revanche, elles sont nulles.
La solution réaliste que le monde occidental et
moderne a adoptée pour démystifier les « textes de per-
sécution » est la seule possible et elle est certaine parce
qu'elle est parfaite; elle rend parfaitement compte de
toutes les données qui figurent dans ce type de textes. Ce
n'est pas "humanitarisme ou I'idéologie qui nous la dic-
tent, ce sont des raisons intellectuelles décisives. Cette
interprétation n‘a pas usurpé le consensus a peu pres
unanime dont elle fait l'objet. L’histoire n’a pas de résul-
tats plus solides 4 nous offrir. Pour l'historien « des men-
talités », un témoignage en principe digne de foi, c’est-
a-dire le témoignage d’un homme qui ne partage pas les
illusions d’un Guillaume de Machaut, n’aura jamais
autant de valeur que le témoignage indigne des persécu-
teurs, ou de leurs complices, plus fortement parce qu'in-
consciemment révélateurs. Le document décisif est celui
de persécuteurs assez natfs pour ne pas effacer les traces
de leurs crimes, 4 la différence de la plupart des per-
séeuteurs modernes, trop avisés pour laisser derriére
eux des documents qui pourraient étre utilisés contre
eux,
Vappelle nails les persécuteurs encore assez persuadés
de leur bon droit et pas assez méfiants pour maquiller ou
censurer les données caractéristiques de leur persécu-
tion. Celles-ci apparaissent dans leurs textes tantét sous
une forme véridique et directement révélatrice, tantét
sous une forme trompeuse mais indirectement révéla-
trice. Toutes les données sent fortement stéréotypées et
e’est la combinaison des deux types de stéréotypes, les
15
véridiques et Jes trompeurs, qui nous renseigne sur la
nature de ces textes.
Nous sayons tous repérer, aujourd'hui, les stéréotypes
de la persécution. Ii y a 14 un savoir qui s’est banalisé
mais qui n’existait pas ou trés peu au xiv" siécle. Les
persécuteurs naifs ne savent pas ce gt’ils font. Ils ont
trop bonne conscience pour tromper sciemment leurs
lecteurs et ils présentent les choses telles que réellement
ils les voient. Ils ne se doutent pas qu’en rédigeant leurs
comptes rendus ils donnent des armes contre eux-mémes
a la postérité. C’est vrai au xv siécle pour la tristement
fameuse « chasse aux sorciéres », C'est encore vrai de nos
jours pour les régions « arriérées » de notre planéte.
Nous nageons donc en pleine banalite et le lecteur
trouve ennuyeuses, peut-étre, les évidences premiéres
que je lui asséne. Qu’il m’en excuse, mais on verra bien-
16t que ce n’est pas inutile; il suffit, parfois, d'un dépla-
cement minuscule pour rendre insolite, inconcevable
méme, ce qui va sans dire dans le cas de Guillaume de
Machaut.
En parlant comme je le fais, le lecteur peut déja le
constater, je contredis certains principes que de nom:
breux critiques tiennent pour sacro-saints. Jamais, me
dit-on toujours, il ne faut faire violence au texte. Face a
Guillaume de Machaut, le choix est clair : ou bien on fait
violence au texte ou bien on laisse se perpétuer la vio-
lence du texte contre des victimes innocentes. Certains
principes qui paraissent universellement valables de nos
jours parce qu’ils fournissent, semble-t-il, d’excellents
garde-fous contre les exces de certains interprétes peu-
vent entrainer des conséquences néfastes auxquelles
n'ont pas songé ceux qui croient avoir tout prévu en les
ienant pour inviolables. On va partout répétant que le
premier devoir du critique est de respecter la significa:
lion des textes. Peut-on soutenir ce principe jusqu'au
16
bout devant la «littérature» d'un Guillaume de
Machaut ?
Une autre lubie contemporaine fait piétre figure a la
lumiére de Guillaume de Machaut, ou plutét de la lecture
que nous en donnons tous, sans hésiter, et c'est la fagon
désinvolte dont nos critiques littéraires congédient désor-
mais ce qu’ils appellent le «référent». Dans le jargon
linguistique de notre époque, le référent c’est la chose
méme dont un texte entend parler, a savoir ici le massa-
cre des juifs percus comme responsables de |'empoison-
nement des chrétiens. Depuis une vingtaine d’années on
nous repéte que le référent est a peu prés inaccessible.
Peu importe d'ailleurs que nous soyons ou ne soyons pas
capables d'y accéder; le souci naif du référent ne peut
qu'entraver, parait-il, l'étude modernissime de la textua-
lité. Seuls comptent désormais les rapports toujours équi-
voques et glissants du langage avec Iui-méme. Tout n’est
pas toujours a rejeter dans cette perspective mais a
UVappliquer de facon scolaire on risque de voir en Ernest
Hoeppfiner, l’éditeur de Guillaume dans la yénérable
Societé des anciens textes, le seul critique vraiment idéal
de cet écrivain. Son introduction parle de poésie cour-
toise en effet, mais il n'y est jamais question du massacre
des juifs pendant la peste noire.
Le passage de Guillaume, cité plus haut, constitue un
bon exemple de ce que j'ai nommé dans Des choses
cachées depuis la fondation du monde les « textes de per-
sécution? ». J'entends par la les comptes rendus de vio-
lences réelles, souvent collectives, rédigés dans la pers-
pective des persécuteurs, et affectés, par conséquent, de
distorsions caractéristiques. Il faut repérer ces distor
sions pour les rectifier et pour déterminer I'arbitraire de
toutes les violences que le texte de persécution présente
comme bien fondeées,
Il n'est pas nécessaire d’examiner longuement le
compte rendu d'un procés de sorcellerie pour constater
qu’on y retrouve la méme combinaison de données réel-
les et de données imaginaires mais nullement gratuites
que nous avons rencontrée dans le texte de Guillaume de
17
Machaut. Tout est présenté comme vrai mais nous n’en
croyons rien et nous nen croyons pas pour autant que
tout est faux. Nous n’avons aucune peine, pour l’essen-
tie|, a faire le partage du vrai et du faux.
La aussi les chels d’accusation paraissent ridicules
méme si la sorciére les tient pour réels, et méme s'il ya
lieu de penser que ses aveux n’ont pas été obtenus par la
torture. L’accusée peut fort bien se prendre pour une
sorciére véritable. Peut-étre s’est-elle réellement efforcee
de nuire a ses voisins par des procédés magiques. Nous
nen jugeons pas pour autant qu’elle merite la mort. Il
n'y a pas pour nous de procédés magiques efficaces.
Nous admettons sans peine que la victime puisse parta-
ger avec ses bourreaux la méme foi dérisoire en |’effica-
cité de la sorcellerie-mais cette foi ne nous atteimt pas
nous-mémes ; notre scepticisme n’en est pas ébranlé.
Pendant ces proces aucune voix ne s'éléve pour réta-
blir, ou plutét pour établir la vérité. Personne n'est
encore capable de le faire. C’est dire que nous avons
contre nous, contre l’interprétation que nous donnons de
leurs propres textes, non seulement les juges et Jes té-
moins mais les accusées elles-mémes. Cette unanimité ne
nous impressionne pas. Les auteurs de ces documents
étaient la et nous n'y étions pas. Nous ne disposens
daucune information qui ne viene d’eux. Et pourtant, 4
plusieurs siécles de distance, un historien solitaire, ou
méme le premier individu venu se juge habilité 4 casser
la sentence prenoncée contre les sorciéres*.
Cest la méme réinterprétation radicale que dans
I'exemple de Guillaume de Machaut, la méme audace
dans le bouleversement des textes, c’est la méme opéra-
tion intellectuelle et c’est la méme certitude, fondée sur
le méme type de raisons. La présence de données imagi-
naires ne nous améne pas 4 considérer l'ensemble du
texte comme imaginaire. Bien au contraire. Les accusa-
tions incroyables ne diminuent pas mais renforcent la
crédibilité des autres données.
Ici encore nous avons un rapport qui semble paradoxal
mais en réalité ne lest pas entre |'improbabilité et la
18
probabilité des données qui entrent dans la composition
des textes. C'est en fonction de ce rapport, généralement
informulé mais néanmoins présent & notre esprit, que
nous évaluons la quantité et la qualité de l'information
susceptible d’étre extraite de notre texte. Si le document
est de nature légale, les résultats sont d’habitude aussi
positifs ou méme plus positifs encore que dans fe cas de
Guillaume de Machaut. i] est dommage que la plupart
des comptes rendus aient été brilés en méme temps que
les sorciéres elles-mémes. Les accusations sont absurdes
ct la sentence injuste mais les textes sont rédigés avec le
seuci d’exactitude et de clarté qui caractérise, en régle
générale, les documents légaux. Notre confiance est
donc bien placee. Elle ne permet pas de soupgonner que
nous sympathisons secrétement avec les chasseurs de
sorciéres. L'historien qui regarderait toutes les données
dun procés comme également fantaisistes sous prétexte
que certaines dentre elles sont entachées de distorsions
persécutrices ne connaitrait rien a son affaire et ses col-
legues ne le prendraient pas au sérieux. La critique la
plus efficace ne consiste pas 4 assimiler toutes tes don-
nées du texte a la plus invraisemblable sous prétexte
qu'on péchera toujours par défaut et jamais par excés de
méfiance. Une fois de plus le principe de la méfiance
sans limites doit s’effacer devant la régle d’or des textes
de persécution. La mentalité persécutrice suscite un cer-
tain type d’illusion et tes traces de cette illusion confir-
ment plutét qu’elles n'infirment la présence, derriére le
texte qui en fait lui-méme érat, d'un certain type d'éve-
nement, la persécution elie-méme, la mise 4 mort de la
sorcieére. Il n'est donc pas difficile, je le répéte, de démeé-
ler le vrai du faux qui ont Pun et l’autre un caractére
assez fortement stéréotypé.
_ Pour bien comprendre le pourquoi et le comment de
assurance extraordinaire dont nous faisons preuve
devant les textes de persécution, il faut énumerer et dé-
crire les stéréotypes. La non plus, la tache n’est pas dif-
ficile. Il ne s’agit jamais que d’expliciter un savoir que
nous possédons déja mais dont nous ne soupconnons pas
19
la portée car nous ne le dégageons jamais de fagon sys-
tématique. Le saveir en question reste pris dans les exem-
ples concrets auxquels nous lappliquens (et ceux-ci
appartiennent toujours au domaine de Vhistoire, surtout
occidentale, Jamais encore nous n’avons essayé d’appli-
quer ce savoir en dehors de ce domaine, par exemple aux
univers dits « ethnologiques». C'est pour rendre cette
tentative possible que je vais maintenant ébaucher, de
facon sommaire d’ailleurs, une typologie des stéréotypes
de la persécution,
CHAPITRE IL
LES STEREOTYPES DE LA PERSECUTION
Je ne parte ici que de persécutions collectives ou 4 réso-
nances collectives. Par persécutions collectives, j’entends
les violences commises directement par des foules meur-
triéres, comme le massacre des juifs pendant !a peste
noire. Par persécutions 4 résonances coilectives, j'en-
tends les violences du type chasse aux sorciéres, légales
dans leurs formes mais généralement encouragées par
une opinion publique surexcitée. La distinction n'est
d’ailleurs pas essentielle. Les terreurs politiques, celles
de la Révolution francaise notamment, participent fré-
quemment de l'un et l’autre type, Les persécutions qui
nous intéressent se déroulent de préférence dans des
périodes de crise qui entrainent I'affaiblissement des ins-
titutions normales et favorisent la formation de foules,
c'est-a-dire de rassemblements populaires spontanés, sus-
ceptibles de se substituer entitrement 4 des institutions
atfaiblies ou d’exercer sur celles-ci une pression déci-
sive.
Ce ne sont pas toujours les mémes circonstances qui
favorisent ces phénomeénes, Ce sont parfois des causes
externes comme les épidémies ou encore la sécheresse
extréme, ou l’inondation, qui entrainent une situation de
21
famine. Ce sont parfois des causes internes, des troubles
politiques ou des conflits religieux. La détermination des
causes réelles, heureusement, née sé pose pas pour nous.
Quelles que soient, en effet, leurs causes véritables, les
crises qui déclenchent les grandes persécutions collecti-
ves sont toujours vécues plus ou moins de la méme fagon
par ceux qui les subissent. L’impression !a pius vive est
invariablement celle d’une perte radicale du social lui-
méme, la fin des régles et des « différences » qui défi-
nissent les ordres culturels. Les descriptions ici se res-
semblent toutes. Elles peuvent venir des plus grands
écrivains, dans le cas de fa peste notamment, de Thucy-
dide et de Sophocle au texte d’Antonin Artaud, en pas-
sant par Lucréce, Boccace, Shakespeare, De Foe, Thomas
Mann et bien d’autres encore. Elles peuvent venir d’in-
dividus sans prétentions littéraires, et elles ne different
jamais beaucoup. Ce n'est pas surprenant car elles disent
et redisent inlassablement le fait méme de ne phuis diffé-
rer, c'est Vindifférenciation du culture] lui-rméme et tou-
tes les confusions qui en résultent. Voici par exemple ce
qu’écrit le moine portugais Feo de Santa Maria en
1697 :
Dés que s‘allume dans un royaume ou une république ce
feu violent et impétueux, on voit les magistrats abasourdis, les
populations épouvantées, le gouvernement politique désarti-
culé. La justice n'est plus obéie; les métiers s‘arrétent; les
familles perdent leur cohérence, et les rues leur animation.
Tout est réduit A une extréme confusion. Tout est ruine. Car
tout est atteint et renversé par le poids et la grandeur d'une
calamité aussi horrible. Les gens, sans distinction d’état ou de
fortune, sont noyés dans une tristesse mortelle,,, Ceux qui hier
enterraient aujourd’hui sont enterrés... On refuse toute pitié
aux amis, puisque toute pitié est périlleuse...
Toutes les lois de l'amour et de la nature se trouvant noyées
ou oubliées au milieu des horreurs d’une si grande confusion,
les enfants sont soudain séparés des parents, les femmes des
maris, les fréres ou tes amis les uns des autres... Les hommes
perdent leur courage nature! et ne sachant plus quel conseil
suivre, vont comme des aveugles désespérés qui butent 4 cha-
que pas sur leur peur et leurs contradictions.
22
Leffondrement des institutions efface ou télescope les
différences hiérarchiques et fonctionnelles, conférant a
toutes choses un aspect simultanément monotone et
monstrueux. Dans une société qui n'est pas en crise l’im-
pression de différence résulte a la fois de la diversité du
réel et d’un systeme d'échanges qui différe et par consé-
quent dissimule les éléments de réciprocité que forcé-
ment il comporte, sous peine de ne plus constituer un
systeme d'échanges, c'est-a-dire ume culture. Les échan-
ges matrimoniaux, par exemple, ou méme celui des
biens de consommation, ne sont guére visibles en tant
qu’échanges. Quand la société se détraque, par contre,
les échéances se rapprochent, we réciprocité plus rapide
s‘installe non seulement dans les échanges positifs qui ne
subsistent plus que dans la stricte mesure de |’indispen-
sable, sous la forme du troc par exemple, mais dans les
échanges hostiles ou « négatifs » qui tendent 4 se multi-
plier. La réciprocité, qui devient visible en se raccourcis-
sant pour ainsi dire, n’est pas celle des bons mais des
mauvais procédés, la réciprocité des insultes, des coups,
de la vengeance et des symptémes névrotiques. C'est bien
pourquoi les cultures traditionnelles ne veulent pas de
cette réciprocité trop immediate.
Bien qu'elle oppose les hommes les ums aux autres,
cette réciprocité mauvaise uniformise les conduites et
c'est elle qui entraine une prédominance du méme, tou-
jours un peu paradoxale puisque essentiellement conflic-
tuelle et solipsiste. L'expérience d’indifférenciation cor-
respond done a quelque chose de réel sur le pian des
rapports humains mais elle n’en est pas moins mythique.
Les hommes, et c’est ce qui se passe une fois de plus a
notre époque, tendent a la projeter sur I'univers entier et
a Pabsolutiser.
Le texte que je viens de citer fait bien ressortir ce pro-
cessus d'uniformisation par réciprocité : « Ceux qui hier
vnterraient aujourd'hui sont enterrés.., On refuse toute
pitié aux amis, puisque toute pitié est périlleuse... les
enfants sont soudain séparés des parents, les femmes
les maris, les freres ou les amis les uns des autres... »
23
Liidentité des conduites entraine le sentiment d'une con-
fusion et d'une indifférenciation universelles : « Les gens,
sans distinction d’état ou de foriune, sont noyés dans une
tristesse mortelle... Tout est réduit 4 une extréme confu-
sion. »
Lexpérience des grandes crises sociales n'est guére
affeciée par la diversite des causes réelles. Il en résulte
une grande uniformité dans les descriptions qui portent
sur Puniformité méme. Guillaume de Machaut ne fait pas
exception. Il voit dans le repli égoiste de V’individu sur
lui-méme et dans le jeu de représailles qu’il entraine,
c'est-a-dire dans ses conséquences paradoxalement réci-
proques, l’une des causes principales de la peste. On peut
done parler d’un stéréotype de la crise et il faut y voir,
logiquement et chronologiquement, le premier stéréo-
type de la persécution. C’est le culturel qui s’éclipse en
quelque sorte, en s‘indifférenciant. Une fois qu’on a com-
pris cela, on appréhende mieux 1a cohérence du proces-
sus persécuteur et l’espéce de logique qui relie entre eux
tous les stéréotypes dont il se compose.
Devant I’éclipse du cuiturel, les hommes se sentent
impuissants ; ]‘immensité du désastre les déconcerte mais
il ne leur vient pas a esprit de s'intéresser aux causes
naturelles; idee qu’ils pourraient agir sur ces causes
en apprenant a mieux les connattre demeure embryon-
naire.
Puisque la crise est avant tout celle du social, il existe
une forte tendance A l’expliquer par des causes sociales
et surtout morales. Ce soni tes rapports humains apres
tout qui se désagrégent et les sujeis de ces rapports ne
sauraient étre complétement étrangers au phénoméne.
Mais plutét qu’a se blamer eux-mémes, les individus ont
forcément tendance a blamer soit la société dans son
ensemble, ce qui ne les engage a rien, soit d'autres indi-
vidus qui leur paraissent particuliérement nocifs pour
des raisons faciles 4 déceler. Les suspects sont accuses de
crimes d'un type particulier.
Certaines accusations sont tellement caractéristiques
des persécutions collectives qu’a leur seule mention
24
les observaieurs modernes soupconnent qu'il y a de la
violence dans l'air; iis cherehent partout d'autres indi-
ces susceptibles de confirmer leur soupgon, c’est-a-dire
d’autres stéréotypes persécuteurs.
A premiere vue, les chefs d’accusation sont assez
divers, mais il est facile de repérer leur unité. Il y a
d'abord des crimes de violence qui prennent pour objet
les tres qu'il est le pius criminel de violenter, soit dans
Vabsolu, soit relativement a l'individu qui les commet, le
roi, le pére, le symbole de ]'autorité supréme, parfois
aussi dans les sociétés bibliques et modernes, les étres Jes
plus faibles et les plus désarmés, en particulier les jeunes
enfants.
Tl y a ensuite les crimes sexuels, le viol, l’inceste, la
bestialité. Les plus fréguemment invoqués sent toujours
ceux qui transgressent les tabous les plus rigoureux, rela-
tivement a la culture considérée.
Il y a enfin des crimes religieux, comme la profanation
d'hosties. La aussi ce sont les tabous les plus sévéres qui
doivent é@tre transgressés.
Tous ces crimes paraissent fondamentaux. Ils s’atta-
quent aux fondements mémes de |’ordre culturel, aux
differences familiales et hiérarchiques sans lesquelles. il
n'y aurait pas d’ordre social. Dans la sphére de I'action
individuelle, ils correspondent donc aux conséquences
globales d'une e¢pidémie de peste ou de tout désastre
Vous aimerez peut-être aussi
- Sterling, Bruce Schismatrice + (1985) .OCR - French.ebook - AlexandrizDocument539 pagesSterling, Bruce Schismatrice + (1985) .OCR - French.ebook - AlexandrizanabasethPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Ren+® Girard - Laurent LinneuilDocument18 pagesEntretien Avec Ren+® Girard - Laurent LinneuilanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 13 - Lagaffe Mérite Des BaffesDocument47 pagesGaston Lagaffe - Tome 13 - Lagaffe Mérite Des BaffesanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 3 - Gare Aux Gaffes Du Gars GonfléDocument54 pagesGaston Lagaffe - Tome 3 - Gare Aux Gaffes Du Gars GonfléanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 12 - Le Gang Des GaffeursDocument47 pagesGaston Lagaffe - Tome 12 - Le Gang Des GaffeursanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 15 - Gaffe À LagaffeDocument47 pagesGaston Lagaffe - Tome 15 - Gaffe À Lagaffeanabaseth100% (3)
- Gaston Lagaffe - Tome 14 - La Saga Des GaffesDocument47 pagesGaston Lagaffe - Tome 14 - La Saga Des Gaffesanabaseth100% (1)
- Gaston Lagaffe - Tome 9 - Le Cas LagaffeDocument54 pagesGaston Lagaffe - Tome 9 - Le Cas LagaffeanabasethPas encore d'évaluation
- Cours Conception Appl Master 2012 2013 Partie 1Document149 pagesCours Conception Appl Master 2012 2013 Partie 1anabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 8 - Lagaffe Nous GâteDocument60 pagesGaston Lagaffe - Tome 8 - Lagaffe Nous Gâteanabaseth100% (1)
- Gaston Lagaffe - Tome 7 - Un Gaffeur Sachant GafferDocument61 pagesGaston Lagaffe - Tome 7 - Un Gaffeur Sachant GafferanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 11 - Gaffes, Bévues Et BoulettesDocument46 pagesGaston Lagaffe - Tome 11 - Gaffes, Bévues Et BoulettesanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 10 - Le Géant de La GaffeDocument55 pagesGaston Lagaffe - Tome 10 - Le Géant de La GaffeanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 8 - Coups, Coups C'Est Nous !Document50 pagesC.R.S Detresse - Tome 8 - Coups, Coups C'Est Nous !anabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 2 - Gala de Gaffes À GogoDocument61 pagesGaston Lagaffe - Tome 2 - Gala de Gaffes À GogoanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 6 - Des Gaffes Et Des DégâtsDocument61 pagesGaston Lagaffe - Tome 6 - Des Gaffes Et Des DégâtsanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 4 - en Direct de La GaffeDocument46 pagesGaston Lagaffe - Tome 4 - en Direct de La GaffeanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 5 - Le Dernier Rang PartDocument52 pagesC.R.S Detresse - Tome 5 - Le Dernier Rang PartanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 1 - Gaffes Et GadgetsDocument49 pagesGaston Lagaffe - Tome 1 - Gaffes Et GadgetsanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Tome 5 - Le Lourd Passé de LagaffeDocument48 pagesGaston Lagaffe - Tome 5 - Le Lourd Passé de LagaffeanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 6 - La Rossée Du MatinDocument50 pagesC.R.S Detresse - Tome 6 - La Rossée Du MatinanabasethPas encore d'évaluation
- Les Invraisemblabes Aventures D'istérixDocument46 pagesLes Invraisemblabes Aventures D'istérixanabasethPas encore d'évaluation
- Gaston Lagaffe - Le Bureau Des Gaffes en GrosDocument54 pagesGaston Lagaffe - Le Bureau Des Gaffes en GrosanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 4 - La Semaine Des 40 Heurts !Document49 pagesC.R.S Detresse - Tome 4 - La Semaine Des 40 Heurts !anabasethPas encore d'évaluation
- Astérix - T02 - La Serpe D'orDocument43 pagesAstérix - T02 - La Serpe D'oranabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome C.R.S Detresse - Tome 10 - Dégelée Sur L'HerbeDocument49 pagesC.R.S Detresse - Tome C.R.S Detresse - Tome 10 - Dégelée Sur L'HerbeanabasethPas encore d'évaluation
- C.R.S Detresse - Tome 3 - Danse Avec Les Coups !Document49 pagesC.R.S Detresse - Tome 3 - Danse Avec Les Coups !anabasethPas encore d'évaluation
- Livre I - Anthropologie FondamentaleDocument103 pagesLivre I - Anthropologie FondamentaleanabasethPas encore d'évaluation
- Livre III - Psychologie InterdividuelleDocument98 pagesLivre III - Psychologie InterdividuelleanabasethPas encore d'évaluation
- Le Sacrifice Au Cœur de La CultureDocument5 pagesLe Sacrifice Au Cœur de La CultureanabasethPas encore d'évaluation