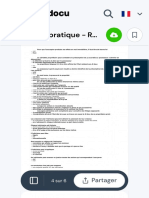Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Remarquessurquelquesparticularitsdudroitadministrtifsngalaisparj M Nzouankeu
Remarquessurquelquesparticularitsdudroitadministrtifsngalaisparj M Nzouankeu
Transféré par
Djily Brickest0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues37 pagesTitre original
remarquessurquelquesparticularitsdudroitadministrtifsngalaisparj.m.nzouankeu
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues37 pagesRemarquessurquelquesparticularitsdudroitadministrtifsngalaisparj M Nzouankeu
Remarquessurquelquesparticularitsdudroitadministrtifsngalaisparj M Nzouankeu
Transféré par
Djily BrickestDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 37
RIPAS n° 9 1 Janvier-mars 1986
REMARCUE> SUR QUELQUES
PARTICULARITES DU DROIT
ADMINISTRATIF SENEGALAIS,
par
Jacques Mariel NZOUANKEU
SOMMATRE
Introduction
I, La recherche du droit applicable a 1'Administration
As> Les principes
B.~ Les contrariétés de 1a jurisprudence
C= Les interprétations
Il. La détermination du champ d'application du droit public
A.= Position du probléme
By~ Principes de base
C.~ Applications
1.= Les actes unilatéreux
2.= Les contrats
J. Les opérations materielles et le responsabilité extr:
contractuelle
III.- L'étendue des pouvoirs du juge
A,= Les domaines dans lesquels le pouvoir d'appréciation du juge
ntest pas susceptible d'une évolution notable
1.= La Limitation du pouvoir d'appréciation du juge par les
textes dont il est destinataire
a) Les régles de procédure
b) Les régles fixant les obligations, les droits et les préro~
gatives des particuliers,
RIPAS 0° 9 2 Janvier-mars 1984
La limitation des pouvoirs du juge par les textes imposant
2 IAdainistration une compétence lige
B.- Le domaine dana lequel le pouvoir d'appréciation du juge est
susceptible d'évolution
2
ANNEXES
Junisprudence
Y.= Cour supréme, 28 mai 1980, Demba Baidy GAYE (pp. 37-38).
2.- Cour suprénie, 8 juin 1980, ee ee doulaye GUEYE (pp. 39-40).
Cour supréme, 27 mai 1981, Léon DIATTA (pp. 41-42)
Cour supréme, 7 juillet 1982, Babacar NIANG (pp, 43-45)
‘Travaux de L'audience solennelle de rentrée des Cours et Tri~
Bunaux
Théme : Le juge ot 1'Administration.
I. Discours d'usage de Mr. Mahmoud Oumar SY, Substitut Géné-
ral prés 1a Cour d'Appel (pp. 46-58).
Discours de Mr+-Abdoulaye Mathurin DIOP, Procureur Général
prés 1s Cour supréne. (pp. 59-63).
3.r Allocution de Me Ogo Kane DIALLO, Batonnier de 1'Ordre des
‘Avocats (pp, 64-66).
Allocution de. Mr, Amadou Louis GUEYE, Premier Président de
1a Cour stipréme (pp. 67-72).
Allocution de Son Excellence Abdou DIOUF, Président de 1a
République du Sénégal (pp. 73-77).
Travaux de 1'audicnce solennelle de rentrée‘des Cours et Tri~
Bunaux (1983-1984) ———
‘Thane: La représentation et la défense de 1’Etat devant le
~~~" Fuge
lye Discours d’usage de Mr, Ahmed Amine DABO, Auditeur 2 la
Cour supréme (rp. 76-90),
2.- Discours de Mr. Abdoulaye Mathurin DIOP, Procureur Général
prs la Cour suprém. (pp. 91-96).
RIPAS n° 9 3 Janvier-mars 1984
3.- Allocution de Maitre Babacar SEYE, Batonnier de 1'Ordre
des Avocats (pp. 97-102).
4,- Allocution-de Mr. Amadou Louis GUEYE, Premier Président de
la Cour supréme (pp. 103-108).
~ Allocution de 8.8, Abdou DIOUF, Président de 1a République
du Sénégal (pp. 109-115).
000
Ltidée que l'on se fait du droit administratif en général se rattache
plus ou moins au droit administratif francais. Le droit administratif est une
invention frangaise, et bien qu'il en existe des copies dans de nombteux pays
Gelgique, Luxembourg, Gréce, Allenagne f€dérale, Etats africains francophones),
nulle part il n'a atteint le degré de technicité et d'efficacité qu'on lui-con~
nait en France. Son originalité tient, entre autres, a l'existence d'un juge
spécialisé, chargé de 1’appliquer ; un juge autonome, ou plutdt un ordre de ‘ju-
ridiction administratif autonome, paralléle 3 l'ordre judiciaire. Au-point
qu'on a souvent 118 l'existence du droit administratif a l'existence d'un juze
spécialisé pour 1'appliquer et soutenu que le droit administratif n'est conce~
vable que dans le syst@me de 1a dualité de juridiction.
Le Sénégal pour sa part ayant opté pour L'unité de juridiction, 1a ques~
tion s'est souvent posée de savoir si, et dans quelle mesure, un droit adminis-
tratif était concevable dans un tel syst®ne. Et au-dela du cas particulier du
Sénégal, c'est l'ensemble des syst8mes administratifs des pays d'Afrique qui
Staient en cause. Le débat théorique suscité naguére par les particularités du
droit administratif sénégalais pourrait bien étre réactivé en raison de 1'évo-
lution jurisprudentielle récente, et aussi des thémes développés lors des au-
ences solennelles de rentrée des Cours et Tribunaux pour les années judicia
res 1982-1983,et 1983-1984, Le théme de 1982-1983, "Le juge et 1'Administra-
tion" enbrasse les rapports du juge avec toute 1’adwinistration, ou en d'autres
termes, avec 1'Administration dans toutes ses manifestations, Le théde de
1983-1984 est plus restreint ; il porte sur "la représentation et la défense
de 1'Etat devant le juge". Conme tel, il ne concerne que 1a situation propre
de 1Etat, au sens contentieux, c'est-a-dire de la principale personne morale
de droit public ; il-exclut notamment les établissements publics, les entre~
prises publigues et les collectivités locales. Toutefois, si les régles de re~
présentation de ces autres personnes morales de droit public ne sont’ pas les
mémes que celles qui s'appliquent 3 L'Etat, on peut, en ce qui concerne leur
défense devant le. juge, leur Stendre les principes applicables a 1'Etat.
Le rapport de'ces-deux thimes avec le syst®me administratif sénégalais
est Evident : le juge se trouve au centre des relations entre 1" Administration
et les particuliers ; en méme temps, il s'agit du juge commun A 1'Administra-
tion et aux-particuliers, Une réflexion s‘impose dés lors, pour déterminer les
particularités d'un tel systéme ; et 1’intérét des thémes précités des audien-
ces solennelles des deux dernitres rentrées judiciaires, c'est de préciser sur
certains points 1s réponse que le systéme sénégalais apporté aux exigences sou-
vent contradictoires qui caractérisent tout. systéme administratif, A‘savoir 1a
RIPAS n° 9 4 Janvier-sars 1984
protection des prérogatives de 1'Administration sans lesquelles elle ne pour-
Fait romplir sa mission et la echerche de 1'équilibre entre L'intGrét giné-
ral et les intéréts particuliers.
Une telle réflexion doit eabrasser les orientations du droit adainistra~
tif dans son ensemble. Jusque-13, en effet, ce sont des aspects particuliers
de ce droit qui ont retenu l'attention de la doctrine. Par_exemple, dans son
Stude bien connue : "Sur la difficile gestation d'un droit administratif séné
galais" (Annales Africaines, 1974, pp. 8-23), le Professeur Alain BOCKEL qui
déclare se limiter 4 des "réflexions nécessairenent partielles" limite volon-
taireient sa réflexion au plein contentieux. Les conclusions auxquelles cet
auteur est parvenu n'ont rien perdu de leur intérSt. On peut simplement prolon-
ger cette réflexion, on L'étendant 2 l'ensemble du contenticux administratif
et en la situant sur un autre plan. Il s'agirait alors, non plus de se deman-
der si un droit administratif satisfaisant peut se développer dans, le aystime
sénégalais de 1'unité de juridiction tel qu'il est congu, ni quelles réfornes
pourraient permettre A ce syst®me d'@tre, pour ainsi dire, plus performant
il s'agirait au contraire de décrire, au sens hénoménologique du terme, le
droit administratif: séaégalais tel qu'il se donne ; de faire apparattre 1a
spécificité de ses principes, tout en admettant conme postulat méthodologique
que_le choix du Sénégal pour le syste de 1'unité de juridiction ainsi que
pour Ta "conception étroite de 1a notion de matiare administrative” (BOCKEL)
senble, sinon irréversible, du moins non susceptible d'étre remis en cause
dans un avenir prévisible. Cette déuarche pourrait Faire aparaitre qua:nombre
ATinsuffisances que l'on considére jusque-1a comme structurolles, en d'autres
termes que l'on impute aux structures ménes du systtme.sénégelais, résultent
au contraire des déviations de certains principes qui, replacés dans leur con
texte socio~politique, ne sont pas, en tant que tels, contestables. Bref, il
stagirait d'apprécier le systéme sénégalais non pas 4 partir, des principes -du
nod8le francais, mais par référence a ses propres crit@res de rationalitd,
Telle est d'ailteurs 1'orientation des travaux précités des deux dernid-
tes audiences solennelles de rentrée des Cours et Tribunaux. Les intervenants
niont songé 8 aucun moment A douter de 1a valeur ou de l'efficacité. du eyst?-
me sGnGgalais ; aucune réforme structurelle n'a été proposée ; tout au plus
certains ont-ils préconisé dés anGnagoments institutionnels ne-renettant pas
en cause les principes fondamentaux du systéme.
Bien plus, un survol rapide de ces travaux est caractéristique des moti-
vations profondes qui sous-tendent le droit administratif sfnégalais. Ainsi,
pour l'année 1982-1983, le discours d’usage de Mr. Mahmoud Ounar SY cur le
Juge et L'administration devait cnporter une tr2s large adhésion de 1' aud
tolre come s"iLrerdlatt au public ce que chacun recseatait sive ou soins
confusénent sans pouvoir 1'expriner. Or pour L'essentiel, ce par quoi son in-
tervention senblait rencontrer une tele audience, c'est le doute qu'il éprou-
vaie quant 3 l'utilité de la sSparation des pouvoirs au Sénégal et surtout
quant & sa portée. I1 en tirdit des conclusions sur 1é plan sociologique ui
Sclairent de maniére saisissante les rapports entre le juge et 1'Adninistra~
tion. Complstant cette ‘approche sociologique, le Bitonnier de 1'0rdre des Avo~
cats ne devait pas s'embarrasser Je formles’: "la théorie de la séparation
des pouvoirs, expose-t-il, est un mythe importé et qui difficilement tente de
s€ Justifier. Positivement, il n'est nulle part inserit dans nos textes...
RIPAS n° 9 5 Janvier-mars 1984
Historiquement elle nous est Strangre...". L'aspect proprenent juridique de
ces-interventions, exposé principalement par le Premier Président dé la Cour
supréme et développé pat L'Avocat Général prés 1a Cour supréme apparait para~
doxalement comme secondaire, par rapport aux problémes socio-politiques posés
par les rapports entre le juge et 1'Administration ; il s‘agit principalenent
de quelques considérations sur les conditions d'intervention du juge ainsi
que sur l'étendue de ses pouvoirs. Mais tout se passe comme si ces pouvoirs
seraient privés de leur légitimité s'ils sortaient du cadre sociologique que
L'on vient d'évoquer. L'allocution de synthtse du Président de 1a République
ne modifie pas fondamentalement ces données : le Chef de 1'Btat préconise une
justice respectée non seulement par les administrés, mais aussi et surtout par
L'Administration elle-méne ; des juges responsables qui prennent conscience
des conséquences des décisions qu'ils rendent. Ce qui est mis en relief, ce
sont done les conséquences pratiques du fonctionnement du syst®me administra~
tif sénggalais.
Le théme développé pour l'année 1983-1984 ne remet pas en cause 1a na~
ture particulitre du droit administratif sénégalais. Tl s'agissait de commen-
ter les textes qui organisent la représentation et la défense de 1’Btat devant
le juge par l’Agent judiciaire de 1'Etat. Les débats portaient sur son statut,
pais aussi et surtout sur les moyens dont il doit disposer pour s'acquitter
de sa mission.
A la lumidre de ces observations, on peut maintenant s'interroger sur les
particularités de 1a réponse du syste sénégalais aux exigences qui caracté~
Fisent tout syst®me administratif dans lequel trois acteurs sont en raoport
IAdainistration, les ‘particuliers, et le juge. I1 faudrait pour cela se pla~
cer sur trois plans, dont chacun privilégie chacun de ces acteurs :
= Dans un syst®me come celui du Sénégal, le probl2me premier est sans
conteste celui du droit applicable 3 1'Administration ; le juge commun appli-
quera-t-il le droit commun & 1'Administration et aux particuliers, ou bien
existe-t-il un droit ‘spécial applicable 1'Administration ? Alors que dans
d'autres systémes, cette question ne présenterait qu'un intérét secondaire,
ici, il s'agit de 1a question centrale, celle-1a méme dont dépend L"existence
du systiae,
= A supposer que lon parvienne @ 1a constatation qu'il existe un droit
spécial applicable 3 1'Administration, il faudra ensuite en déterminer le
champ d'agplication dont dépend 1'équilibre entre 1'intér8t général ‘et les in-
téréts particuliers.
= Enfin et par-dessus tout, il importera de préciser 1a nature ainsi
1e_1'Stendue des pouvoirs du juge commun 4 1'Administration et aux particu
Hers: ee —C“=#E
raient se déterminer selon les principes qui caractérisent un droit prétorien.
x
RIPAS n° 9 6 Janvier-mars 1984
- La recherche du droit applicable @ 1'Administration.
- Le principe.
Ce problane consiste a déterminer 1a nature des régles juridiques appli-
cables a l'Aduinistration. Dans son allocution 3 1'audience solennelle de
rentrée des Cours et Tribunaux nour 1'année judiciaire 1983-1984, le Chef de
1'gtat pose ce probléme de 1a dani@re suivante :
"\ En raison de ses devoirs, 1'Btat ne peut mener ges activités selon
les mémes rgles que l'individu. Et c'est la raison de 2'existence d'un
droit particulier qui lui est propre. Le droit public a deux objectifg. : i1
empdche L'arbitraire toujours possible de la puissance publique, mais il as~
sure aussi & celle-ci les moyens d’exercer les attributions qui lui ont été
configes pat tous.
Si le Sénégal n'a pas retemu la solution de 1a dualité de juridiction,
les magistrats, quelle que soit leur formation d'origine, doivent sans cesse
garder a l'esprit que, sauf exceptions, le droit qui s'applique & 1'Etat n'est
Pas celui qui s'applique aux citoyens.
Ace sujet, je voudrais insister auprés de ceux qui sont en charge de
Is formation et du tecrutement des magistrats, pour que'ces derniers recoivent
tous un enseignement de droit public et méme pour que viennent plus sauvent
prendre rang parmi les nouveaux juges des spécialistes du droit public".
Il résulte de cette déclaration qu'en principe, c'est le droit public
qui s'applique 2 1'Adminigtration et que per exception 1'Administration pourra
Btre soumise, dans certains cas, au droit privé. Si ces principes sont réspec~
tés, le juge devra, dans tous les cas of subsisterait un doute sur le droit
applicable a 1'Administration, présuner que celle-ci a voulu se placer’ sous
Lempire du droit public.
Les contrariétés de 1a jurisprudence.
En fait cependant, 1a pratique jurisprudentielle semble établie en sens
inverse. Tout se passe comme siy en principe, c'est le droit privé qui’consti
tue le droit commun de 1'Administration. I1 apparaftrait alors qu'on ne: peut
déroger & l'application du droit privé 1 1'Administration, que lorsque des
textes particuliers prévoient expreseément 1'anplication du droit public. Par
exemple, le Code des Obligations de 1'Administration (C,0.A.) est présenté
par la doctrine et interprété par la jurisprudence comme une exception a 1'ap-
plication du droit privé comun A l'Adninistration { les conteate de 1’ Adninis~
tration sont en principe sounis au Code des Obligations Civiles et’ Conmercia~
les (C.0.C.C.) ; excentionnellement, certains d'entre eux peuvent déroger sur
certains points au COCC et @tre souzis au COA. Mais on a L'impression que,
dans I’esprit du juge, cette dérogation ne remet pas fondamentalement en cause
le principe de L'application du droit privé 4 1’Administvation i. le contrat,né-
me qualifié administratif, est interprété selon les ragles de droit commun.
On s‘en apercoit a travers un certain nombre d'espSces jurisprudentiel-
les. Tant3t, le juge sounet les contrats de 1'Administration au droit eublic,
et vérifie notamment que la procédure des articles 729 et suivants a &té ob-
servée (Trib. de Dakar, 27 janvier 1979, Ateliers et chantiers maritimes de
Dakar, Grandes Décisions de la Jurisprudence Administrative Sénégalaise,
RIPAS n° 9 7 Janvier-mars 1984
GDJAS - Tome II n° 149 ; Trib, Dakar, 23 février 1980, La Société COMEX-PRO,
GDJAS, IT, n° 166 ; Trib. Dakar, 11 juillet 1981, Institution de Prévoyance
Retraite du Sénégal, GDJAS, II, n° 236). Tantdt au contraire, alors qu'on se
Hoe Sacifestexent en présence d'un contrat adainiecratif. "par nature” au
sens du COA, le juge applique le droit privé commun (Trib. Dakar, 19 janvier
1980, Etablissements TILT-France, GDJAS, II, n° 163 ; Trib. Dakar, [8 juillet
1980, Compagnie Textile de 1’Ouest Africain, GDJAS, II, n° 178 ; Trib. Dakar,
20 juin 1981, Sieur Honoré WENDY <7 I'Agent’ judiciéire’de 1'Etat, le Dive
teur de 1e Direction de 1a Formation pornandnte et Te Directeur de 1'Ecole
Nationale d’Economie Appliquée, (GDJAS, II, n” 225), et on pourrait citer
autres exemples pris en dehors des contrats : application du droit privé
pour les donmages résultant dé 1'effondrement d'un batiment public (Trib.
Dakar, 5 mars 1977, Sieur Mbaye DIOP, GDJAS, II, n° 57), aine‘ que pour le
dommage subi par un agent public participant & i'exécution d' n service pu-
Dlic au sens de l'article 144 du COA (Trib. Dakar, 24 décenb 1977, Sieur
Mane Birane NDIAYE, GDJAS, II, n° 93).
€,- Les interprétations.-
Deux types d'explications neuvent Stre proposées a ce sujet.
1,- La. premi8re explication consiste & imputer cette orientation juris~
rrr ,——C—C—™———U—_L_EE=FS>™—
Palement fornés a la pratique du droit privé appliqueraiont maladroitement le
droit administratif. A cela s'ajouterait le fait qu'ils.ne sont pas: spéciali-
s&s et que les‘litiges de droit privé étant bien plus nombreux que ceux de
droit public; 1a force de 1'habitude entraine, entre autres conséquences, la
tendance toute naturelle A appliquer les mémes principes de raisonnement aux
Personnes privées et aux personnes publiques.
Jette explication n'est pas dénuée de tout fondement et 1a position méme
du Chef de 1'Etat qui.souhaite que tous les magistrats recoivent un enseigne-
ment de droit public et que des spécialistes du droit public si@gent parmi
les nouveaux juges est un aveu implicite, mais incontestable que 1'orienta~
tion intellectuelle des magistrats a pu entrainer, dans de nombreux cas, des
décisions incohérentes et contradictoires.
Mais cela n'explique pas toutes les vicissitudes de 1a jurisprudence.
Par ailleurs, l'importance des exceptions & ce qu'on pourrait considérer come
Ja ragle est telle qu'il faut exclure I'hypothase de 1'inadvertance ‘du jue,
et en rechercher 1"explication dans la spécificité méme du syst®me administra~
tif sGnégalai:
2.~ La seconde explication précisément, consiste 2 situer la pratique
jurieprudentTelle Svoquee far Fapport 2 le logique méne du aystOne administra
tif sénégalai
Pour déterminer- le droit applicable & 1'Administration, on peut retenir
les criterés organico-formels tirés de 1a qualité des parties ou la nature de
Tacte ; on peut aussi retenir les crittres matériels tités de la nature du
litige. Ltune des particularités du droit sénégalais, c'est de n'avoir pas
CTatrement choisi entre les: deux syst®mes et méme de donner 1"impression de
stenfermer dans une contradiction, d'étre paralysé par le conflit entre deux
RIPAS n° 9 a Janvier-mars 1984
rationalités, L'une-matérielle, L'autre organico-fornelle. Pn effet, lorsqu'on
raisonne 3 partir des deux princinaux types de contentieux qui dominent le
droit adninistratif sénégalais, le plein contentieux et le contentieux de
Viannulation, le syst8ne sénégalais se caractérise nar une apparente contra~
diction qui tésulte du conflit de cos deux rationalités : pour le plein con-
tentieux, la détermination du droit applicable se fait selon les critéres ma
tériels ; le critére du droit applicable, c'est la nature du litige. Hn re-
vanche, pour le contentieux de 1’annulation, ce sont les critares organico—
formels qui sont retenus.: c'est la qualité des parties (nme si certains au-
teurs n'admettent pas qu'on puisse parler de parties 4 propos du contentieux
de Iannulation) ou le cas échéant les caractéres organico-formels de l'acte
attaqué qui déterminent le droit applicable.
La coexistence des deux rationalités dans le méne syst®me sonble révon-
dre au double objectif que tend a rSaliser le droit nublic et que le Président
de la République a relevé dans son allocution précitée, a savoir assurer 3
IAdainistration les moyens de son intervention, et orévenir ou sanctionner
son arbitreire.
ment, en ce qui concerne les activités matérielles de 1'Administration, Et
la prérogative essentielle de l'Administration sur ce point, c'est de pouvoir
librement choisir le ‘droit qui sera applicable a l'opération qu'elle décide
d'entreprendre. Le réle! du juge consistera a rechercher si dans le litige dont
il est saisi, 1'Administration a voulu, se placer sous l'empire du droit privé
ou du droit public. En cas de doute, il ne devra pas appliquer' le droit privé,
mais présumer que 1'Administration a voulu se placer ‘sous 1'empire du droit
public, Toutefois, ce n'est pas cette démarche, soume toute classique du juge
administratif, qui constitue l'originalité du syst®me sénégalais. Elle tradui-
rait seulement, si elle recevait une application constante, une bénéfique con~
version de 1a mentalité du juge, qui considérerait désormais que 1"application
du droit public 4 1'Administration constitue la solution de principe. Bt as~
surGnent, une telle attitude contribuerait, dans une large mesure, 3 1'harmo~
nisation de le. jurisprudence,
La spécificité du eystiwe sGnégelais se situesur un autre plan, et
consiste en ce que le mécanisne ainsi institué pour protéger 1'adninistration
ne s'impose pas A elle-méme de manifre absolue. Le juge doit certainenent re~
fuser de suivre un particulier qui voudrait faire appliquer le droit privé %
un litige de.droit public, car alors, ce serait porter atteinte aux prérogati~
ves de l'Administration. Mais en sens inverse, il semble qu'én puisse adnet~
tre que l'Administration peut, au contentieux, renoncer elle-~néne, si elle le
désire, aux r2gles do droit public qui la prot&gent, et-sous L’empire desquel~
Jes elle s'est volontairement place au moment d'agir, sans que le juge puisse
stopposer & une telle renonciation. Dis lors qu'elle estime que le but 4"inté-
rét général qu'elle poursyit n'est pas entravé var L'application du droit pr
vé au litige qui: 1"opoose’aux particuliers, ceux-ci n'auraiant aucun intérét
a s'opposer A ce quelle tenonce aux régles protectrices.de droit public.
On pourrait raporocher cette situction de celle résultant de ia répart
tion des matizres entre 1a loi et le réglement par 1a Constitution : une loi
Portant eur une matitre réservée au réglement n'est pas contraire A la
RIPAS n° 9 9 Janvier-mars 1984
Constitution ds lors que le Gouvernement a volontairement renoncé A s'opposer
au vote d'une telle loi. On pourrait de 1a méne manitre penser que rien ne
s‘oppose & ce que 1'Adninistration renonce elle-méue 1 1' application du droit
public a un litige normalenent soumis au droit public. C'est le sens d'une
jurisprudence assez abondente dans laquelle 1'Etat, assigné sur le fondement
des dispositions du OCC dans un litige qui manifestenent relive du droit
public ne conteste pas le fondement de ca responsabilité et déclare "s'en rap-
porter & justice" (Trib, Dakar, 19 février 1977, E1 Hadj Ounar DIAGNE, CDJAS,
TI, n° 52 : assigné sur le fondement de l'article 118 du COCC par un tiers
blessé par une balle & proxiaité d'un champ de tir militaire, l'Etat francais
déclare "s'en rapporter 2 justice” et le tribunal lui applique le droit privé).
Plus rarement, on rencontre la déaarche inverse : avec: l'accord des partie
et notamment de la défense, le juge applique le droit public 3 un litige ini
tialement concu comme soumis au droit privé (C.A, de Dakar, 9 avril’ 1971, So-
ciété Bernabé c/ Etat, GDJAS, II, n° 30). Clest aussi le sens des décisions
dans Tesquelles Te juge constate, pour appliquer le droit privé @ 1'Administre-
tion, que celle-ci n'a fait aucune observation sur 1a régularité de 1a procé-
dure.
Cette jurisprudence tend a établir que le droit applicable @ 1"Admini
tration n'est pas une question d'ordre public que le juge pourrait soulever de
son propre mouvement. C'est a 1 Stration de dScider si elle eftend béné-
ficier de 1a protection que lui conf8re L'application du droit public. Et
clest 13 précisément le réle central de l'Agent judiciaire de 1'Etat : veiller
a L'application du droit public 3 1'Administration toutes les fois qu'il es~
time qu'il assurerait une meilleure garantie des prérogatives de 1'Btat, ou
alors y renoncer lorsque 1'intérét général 1'exige.
b) Cette marge de manoeuvre disparait, et 1a rationalité organique ri
prend ses droits dés lors qu'il s'agit de prévenir ou de sanctionner 1'arbi
traire de 1'Administration. C'est orincipalenent par le truchenont des actes
unilatéraux qu’un tel arbitraire est souvent rendu possible. Alors que les
activités matérielles ainsi que les contrats de 1'Administration sont norma-
lement sanctionnés par les régles de la responsabilité publique, le privilase
de la décision exécutoire dont dispose 1'Administration n'a pas 4’ équivalent
en droit privé, et ce n'est que tout 4 fait exceptionnellement que les déci-
sions exécutoires peuvent engager 1a responsabilité de 1'Administration. C'est
done dans ce domaine qu'il faut le plus redouter, prévenir et sanctionner
Larbitraire de 1’Administration, par le pouvoir donné au juge d'annuler les
actes adninistratifs.
On s'explique alors que le contenticux de 1'anmulation est organisé selon
les critres orgasico-formels : c'est 1a 2éme section de la Cour supréme qui
est seule compétente pour connattre de ce type de contentieux soumis par ail-
leurs 2 des régles de forne assez sév@res empruntées au droit francais.
Certes; 1'Administration contime de bénéficier de nombreux priviléges
dans le contentieux de L'annulation, notamment en ce qui concerne les régles
de Ltintroduction du recours (délai, signification du recours) 3 1a technique
de Ltexamen du recours (1a présomption de légalité et d'authenticité qui s'at-
tache aux actes administratifs, le ceract?re non suspensif du recours et par
suite exceptionnel du sursis 4 exScution des actes) ; 1a charge de la preuve
qui incombe au requérant ; linterprStation des moyens d'annulation par le
juge (refus d'annuler lorsque les moyens sont inopérants, substitution des
RIPAS n° 9 a
Janvier-aars 1986
motifs lorsqu'il'y a compdtence lise) ; le refus d'adresser des injonctions
a l'Administration, ce qui veut Limiter singulitrement 12 portée des déci~
sions rendues,’ etc.
Toutefois, ces priviltges ne conférent pas @ 1"Administration le pou~
voir de modifier les ragles de droit applicables au contenticux de 1'annula~
tion qui sont pour la plupart des régies d'orére public que le juge souléve
dloffice (nullité de L'assignation, dSchéance, irrecavabilit, incompétence,
contr3le minimum sur les actes vris dans l'exercice du pouvoit discrétionnai~
re, etc...). La rigidité méme des principes applicables 2 ce type de conten-
tieux est une garantie contre l'arbitrairc de 1'Administration.
On peut alors s'expliquer la pratique sénégalaise de l'exception d’ill
galité, On sait que dans ce domaine, c'est le juge de fond'qui est juge des
exceptions. C'est done le tribunal de Ire instance, juge de droit commun du
contenticux administratif, qui est compétent, tant en matiére civile qu’en
matizre répressive pour interpréter et oppréeier 1a Légalité des actes admi-
nistratifs réglenentaires et individuels dont la légalité est contestée par
voie d'exception 3 l'occasion d'un Litige de droit privé. Ce svst®me qui. con~
fre au tribunal de I8re instance le pouvoir d'annulation des actes individuel:
stexplique par le fait que les actes dont 1a Légalité est ‘ainsi contestée sont
intimenent 1iés 2 activité litisieuse, en d'autres termes ne lui sont pas
détachables, en sorte que seul le juge te fond est le mieux placé pour déce
Yer iarbitraire éventuel de 1'Aduinistration.
Le probléme de fond consiste 2 virifier si, A l'occasion de tels re~
cours, le juge interpréte ou apprécic 1s légalité des actes administratife
selon les principes du droit public. La seule espéce significative qu'on peut
invoquer dans ce domaine fait apparaitre un certain nombre de maladresses
dans l'appréciation par le juge du pouvoir réglementaire de L'Adninistration
(Trib. Dakar, 7 avril 1981, Minist@re Public ¢/ Cheikh Anta DIOP, GDJAS, I,
n° 103) : le prévenu est poursuivi pour avoir fait fonetionner son parti, le
Rassemblement National Démocratique sans enregistrement prdalable & une épo-
que o& quatre partis politiques seulement étaient autorisés. La.voursuite eat
fondée sur les textes législatifs qui sanctionnent de peines correctidnnelles
toute porsonne qui fait fonctionner un parti politique sans enregistrement
préalable ; le prévenu soulave L'excention d'illégalité non pas contre lea
textes sur le fondenent desquels il est poursuivi, mais contre le refus d'en-
registrenent de son parti qui lui avait ité opposé par 1'Administration. Le
juge accueille ce moyen et relaxe le prévenu par le motif que ce rofus est
illégal, alors qu'il sert de fondenent aux poursuites engagées contre lui.
or, I'analyse des faits fait apparaitre deux erreurs : d'abord, dans le con-
texte juridique d'alors, ledit refus n'Stait pas illégal ; ensuite ce in'était
pas ledit refus qui servait de fondenent aux poursuites, mais les textes 16~
gislatifs qui interdisaient de faire fonctionner un parti politique sans en
registrement préalable.
Les principes que l'on vient d'énoncer ne seront considérés comme cer~
tains que lorsqu'ils seront confirmés par uné longue pratique jurisprudentiel~
le. Mais d'ores et d6j2, ils permettent de constater que 1a plupart des solu-
tions jurisprudentielles actuolles ne sont contradictoires qu'en apparence,
et qu'elles s'inscrivent dans 1a logique méme du systime sénégalais.
RIPAS n° 9 u Janvier-mars 1984
II.- La détermination du champ d'application du droit public.-
A.- Position du probléme.-
Das lors que 1'on a vosé comme principe que c'est le droit public qui
stapplique a L'Administration, le probl8ne du champ d'application du droit
public consiste a déterminer les actes et activités auxquels s'appliquera le
droit public.
Certains auteurs ne distinguent pas suffisamment le problime du droit
applicable de celui du champ d'application du droit public.
Le premier probléme se borne 8 poser un principe, ‘selon lequel la solu-
tion normale consiste 2 appliquer le droit public a.1'Adninistration, et 3
en tirer les conséquences au plan de l'organisatinn du contenticux. A ce ni-
veau, on ne préjuge méme pas do 1a portée du principe : il se peut qu'en fait,
la plupart des activités administratives sont soumises au droit privé a un
moment déterminé de 1"évolution sociale et que l'application du droit public
apparait alors coume exceptionnelle. Cette situation, cette photographie (2
supposer méme que 1'on puisse 1s projeter sur une longue période) ne remet pas
en cause le principe Iui-méme ; elle traduit seulement les mutations auxquel~
les "Administration est soumise, et qui l'aménent, au moment d'agir, 3 pré-
fGrer le droit privé au droit public ; elle peut, 2 1a limite inciter a re~
Penser le systtne adminidtratif pour I'adapter aux faits Gconomiques et so-
ciaux en décidant que, compte tonu des transformations de 1'Etat moderne,
ctest le droit privé qui sera en principe appliqué a 1'Adninistration. Mais,
logiquenent, une telle adaptation ne s'inpose pas : un principe n'ést pas re~
mis en cause par cela seul que les exceptions @ son anplication sont quant
tativement plus nombreuses que les cas d'application normale.
Le second probléne, celui de 1a détermination du champ d"application est
tout différent, Il ne stagit plus ici de rechercher 1a régle applicable, puis-
qu'on la connait : ctest la ragle de droit public, I1 s'agit encore moins de
Techercher le crit@re de 1a ragle applicable, puisque tel Stait orécisément
Mobjet de Ta recherche du droit applicable..I1 s"agit au contraire, en par-
tant du principe désormais admis que c'est le droit public qui est applica~
ble, de rechercher les actes et activités soumis 3 ce droit. Au lieu de cela,
on constate dans certains raisonnements une confusion dans 1'analyse des deux
problémes : en partant de 1a détermination du champ d'application, on glisse
insensiblement vers la recherche du droit applicable ; par exemple, on se
propose de déterminer les activités soumises au droit public, et en fait, on
recherche la nature des régles avplicables a certaines activités de 1'Adminis-
tration,
B.- Principes de base.~
- Contrairement aux apparences, 1a détermination du ehamp d'applica~
tion au droit public en droit sénégelais, obéit a des principes sensiblement
différents de ceux appliqués en droit francais. Ea droit francais, le princi-
pe majeur de 1a détersination du chan} dvapsitcation du droit public eet le
rincipe de la séparation des pouvoirs consacré par de nombraux textes révo~
Fictonsatres toujours envigiaur (lol des 16226 sod 1790, Constitution de
1971, titre 3, chapitre 5 art, 3, et décret du 16 fruetidor an III), et la
RIPAS n° 9 12 Janvier-mars 1986
confusion, signalée plus haut, entre 1a recherche du droit applicable a 1'Ad-
ministration et la détermination du chanp d'application 4u droit public vient
de ce que les deux opérations se rattachent au méme principe de le séparation
des pouvoirs ; meis elles ne s'y rattachent pas de 1a méme maniare.
Ainsi, le princige de 1a séparation des pouvoirs, envisagé dans ses
rapports avec 1a recherche du droit applicable & 1'Administration signifie
seulement qu'en principe, c'est le droit public qui s'avplique 4 1'Administra-
tion situge au sein du pouvoir exécutif. Ce princine ne vostule ni n'implique
par lui-méme qu'un juge spécialisé aura le monopole de-1'enplication du droit
ublic A 1'Adninistration ; i1 commande seulement que le droit public seul
it appliqué, mais reste indifférent quant 2 la désignation de L'organe qui
I'appliquera, quant au probléme de la compStence juridictionnelle. D'yn autre
cBté, lorsque le méme orincipe interdit aux tribunaux judiciaires de juger
les administrateurs, il ne s'agit que de l'hypoth8se dans laquelle ceux-ci ont
agit en "raison de leurs fonctions” ; dés qu'ils sortent de leurs fongtions,
Ja Constitution de 1’an VIII prévoit que 1a garantie des fonctionnaires qui
sera d'ailleurs supprimée plus tard, ne joue plus et le Conseil 4’Btat peut
autoriser leur poursuite devant les tribunaux judiciaires. Tl en va dé méme
des actes juridiques et matériels de 1'Administration : 1’interdiction d'appli-
quer le droit privé ne joue que si, et dans 1a mesure od 1'Administration a
agi en tant que puissance publique ; dans le cas contraire, lorsqu'il s'agit
par exemple des anciens actes de gestion, les tribunaux appliquent ledroit
privé a 1'Administration, Il est topique A cet égard, de constater que des
pans entiers de 1'Administration sont restés longtemps soumis 3 la compétence
responsabilité: con-
des tribunaux judiciaires : ainsi le contentieux de
tractuelle des départements n'a 6té soustraits aux tribunaux judiciaires que
depuis 1903, avec l'arrét TERRIER ; et le contentieux de 1a responsabilité
contractuelle des communes sounis au droit public deouis seulement 1910,
avec L'arrét THEROND ; aujourd'hui encore, en matiare extra-contractuélle,
on sait entre autres que ce sont toujours les tribunaux judiciaires qui sont
compétents pour juger les communes du fait des dommages causés par les ras-
semblenents et attroupements.
Le principe de la séparation des pouvoirs, envisagé dans ses rapports
avec le problime de 1a détermination du champ d'application du droit public,
signifie seulement que les actes et activités auxquels s'applique le droit
public doivent présenter un caractdre administratif. Ce caract@re doit se dé
terminer de mani@re autonowe par rapport 4 la régle applicable. La augsi, le
principe ne postule ni n'implique un quelconque problame de compétence juri-
dictionnelle, Ce sont les actes et activités de 1'Administration elle-méme
qu'il s'azit de déterminer. [a
Tl semble bien que 1a doctrine francaise @ inutilement compliqué ce pro-
blme en le liant indissolublement 3 celui de 1a compétence du juge administra~
tif. On stexplique alors 1"importance, non justifige, qu'elle accorde aux
cas dans leaqiels les tribunaux judiciaires appliquent. le droit public, alors
que le principe d'une telle compétence ne présente aucun caracttre exception~
nel. On s'explique aussi. 1'effort, rest infructueux, de déterminer le chanp
d'application du droit public par référence 3 1a commétence du juge adminis-
tratif en partant du principe non établi et qui.ne semble méme’ pas avoir été
Srigé en principe général de droit, que le juge administratif a le monopole
de L'application du droit public.
RIPAS n? 9 13 Janvier-mars 1984
2y- Pat rapport au droit francais, le droit sénégalais présente dans ce
domaine deux particularités mejeures : il nTattache pas au principe de la sé
paration des pouvoirs 1a mfme importance que le droit frangais ; les travaux
de 1'audience solennelle de rentrée“des Cours et Tribunaux pour L'année judi-
ciaire 1982-1523 sont méme allés plus loin, comme on 1's indiqué plus haut,
puisque des voix autorisées ont affirmé a cette occasion que le Sénégal ignore
Ja séparation des pouvoirs, doctrine importée qui n'est. inscrite nulle: part
dans les textes (et qui ne semble pas avoir &té érigée par la jurisprudence
en principe général de droit) et cette affirmation d'une portée juridique
capitale n'a pas été démentie, ni néme atténuée par le Chef dé 1'Etat. dans son
allocution de synthése. On ne peut donc pas, pour déterminer le champ d’ appl:
cation du droit public, se référer comme on France au principe de 1d sépara~
tion des pouvoirs. Par ailleurs, le Sénégal, comme 1'on sait, a opté pour
L'unité de juridiction ; il faut donc exclure ici toute comparaison evec le
ete francais ct mém la technique qui consisterait a déterminer le champ
d'application du droit public par référence 3 1a notion de matiare administra-
tive. On doit en effet rappeler que cette notion de matiéré administrative ne
‘GEsigue pas on droit sénépalais I'ensenble du contentieux administratif, aais
seulement la partie de ce contenticux soumise & la procédure des articles 729
et suivants de Cole de Procedure civile- Alte! oa pe parle pas de uatTOre ad
‘ainistrative lorsqu’il s’agit du recours pour excts de pouvoir, ni mfme du re~
cours en interprétation et en appréciation de la légalité. Le seul texte qui
vise et réglemente 1a notion de "natigre administrative”, c'est 1'intitulé du
titre premier, livre III du Gode de Procédure civile (décret n° 64-572 du.30
juillet 1964, 'J.0. 28 septembre 1964) qui s‘applique a la procédure devant les
tribunaux de'l2re instance incompétents, comme l'on sait, pour connsttre des
recours directs en annulation. Or, la détermination du champ d' application du
droit public doit se faire var référence 2 l'ensemble des types d’interven-
tions de 1'Administration et non seulement par rapport a celles qui sont sanc~
tionnées, le cas échéant, par 1a procédure du plein contentieux.
Applications .-
On peut, pour décrire le champ d'application du droit public, adopter
la distinction classique des actes unilatéraux, contrats et opérations maté-
rielle:
l.- Les actes unilatéraux.:
Seuf dérogation expressément prévue par un texte, le droit public
Ligue aux actes uni lateraux réglementaives ct individuels pels Por TEC
Ses ddneubies démenbrements, les collectivités locales, les établissements publics admi-
nistratifs et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé
agissant en tant.qu'autorités administratives. Cela s*expliqué par le fait que
la décision unilatérale qui se définit come la faculté de mettre des droits
ou des obligations 2 la charge d’autrui indépendamment de son consentement
constitue en elle-néme une prérogative exorbitante de droit commun, Certes, 12
doctrine a remarqué 2 juste titre que le phénoméne de l'acte unilatérel est
général dans ce sens qu'il n'est pas propre aux personnes publiques, mais
RIPAS n° 9 4 Janvier-mars 1984
stobserve égalenent dans le milieu familial (testament), dans le secteur privé
(réglenent d'entreprise, réglement intérieur des associations et autres grou-
pements) etc... Mais ces actes unilatéraux qu’on pourrait appeler de droit pri~
vé, ne tirent pas, A vrai dire, leur force juridique de leur caract@re unila~
téral, mais du consentenent de leurs destinataires, En cela, une expression de
DUGUIT conviendrait mieux pour les désigner, des actes plurilatéraux non con
tractuels : le réglement d'association no stimpose aux menbres que tant qu'ils
acceptent cet
jualité de mecbre ; l'association peut seulement suspendre,
‘un menbre qui n'observe pas son réglenent, vais elle ne peut
pas Ie contraindre @ l'observer. Dés_qu'une association est investic par les
Tots ou les réglements de la faculté d'exercer sur ses menbres un pouvoir de
contrainte Lrrésistible, les ates qu'elle prend en cette qualité deviennent
es actes unilatéraux (au seul sens of l'on l'entend ici) auxquels s‘applique
novaalement le droit public,
Les difficultés que l'on rencontre en France sur ce point concernent les
actes unilatéraux édictés par les personnes morales de droit privé, collabe~
rant ou participant & l'exécution d'un service public et sont de deux ordres,
D'une part, on a voulu, une fois encore a tort, lier'le probléme du
champ @application du droit public A celui de 1a compétence du juge adminis~
tratif, et comme les deux problémes ne peuvent pas cofncider parce qu'ils ne
se situent pas sur le uém plan, on a abouti 2 un demi sitcle de discussions
doctrinales sans issue , Le droit sénégalais ignore ce genre de difficultés ;
en affirnant que le éroit public s’applique aux actes unilatéraux, il ne pré-
juge pas de 1a compétence juridictionnelle : le droit public s'appliquere 2 ces
actes, qu'ils fassent l'objet de recours directs en annulation devant 12 2@me
section de 12 Cour supréme, ou que leur légalité soit examinge par une juricic~
tion d'exception tel que le tribunal du travail (car dans cette hypothise-la,
si le juge de l'excts de pouvoir était saisi, il devrait opposer au requérant
Lexception de recours paralléle lorsque l'acte attaqué n'est pas détachable
du contrat de travail) ou enfin par lo tribunal de lére Instance dans 1'une
des hypothésés ot il est amen€ A examiner incidemment ou par voie d'exception,
la légalité des actes unilatéreux conformément au dScret n° 60-390 du 10 nover~
bre 1960 fixant ses compétences : préjudices résultant des différents actec de
L'Aduinistration, dans le cas par exemple, of la responsabilité des personnes
publiques est engagée du fait de 1'illsgalité d'un acte adninistratif (Trib.
Dakar, 24 £6vrier 1979, Siour Iemafla FALL, GDJAS, II, n° 153) ; appréciation
de la légalité, interprétation des actes adwinistratifs, exception d'illégali~
té (Cour supréme, 5 juillet 1961, Waly SARR c/ Commune de Saint-Louis, et Trib.
Dakar, 7 avril 1381, Ministre Piblic 7 Cheikh mrta DIOP, COIAS, T, 0° 7 et
103) ; contentieux des drofts pécunlaires et statutalres des agents publics &
Joceasion desquels le tribunal de l8re Instance interpréte les actes adminis-
tratifs réglenentaires et individuels (Trib. Dakar, 17 mars 1982, Sicurs Boubou
Yoro et Jean Baptiste DIEME, GDJAS, IT, a° 268 ; Trib. Dekar, 17 avril 1982,
Bieurs Towbacar SA00k GE autres, GAUSS; II, n° 269), apprécis leur 1égalits
‘(rrib. Dakar, 15 mai 1977, Alioune SYLLA, GDJAS, IT, n° 31), et méme, les dé~
clare illégaux (Trib, Dakar, 30 d®cenbre 1981, Abdoulaye BOUSSO et autres,
oDgaS, II, n° 253).
RIPAS n° 9 5 Janvier-mars 1984
Diautre part, certaines difficultés du droit frangais sur ce point tien-
nent aux exigences de la politique interventionniste. Par exemple, dans la
c&l&bre affaire du Centre de Lutte contre le Cancer Eugine Marquis de Rennes,
ilest certain quo si le Tribunal des conflits avait conclu finalement pour la
compétence judicisire, c'était pour rapprocher le statut de ce centre avec
celui des organisations privées poursuivant le méme but dans les tate de la
Communauté Economique Européenne ; car sur le strict plan juridique, il est
Evident que 1a “densité des rdgles de droit public applicables" (Ordonneau)
justifiait pleinemnt 1a soumission dudit centre au régime de droit ‘public,
Diautres vicissitudes de la jurisprudence francaise sur 1'application
du droit public aux actes unilatéraux s'expliquent per le souci du Conseil
a'Btat de ne pas se contredire : appelé a statuer au contentieux sur un acte
administratif qui evait recu, peut-Gtre htivement, l'avis favorable de ses
formations administratives, ie Conseil d’Etat ne peut que procéder & un revire~
ment de jurisprudence pour justifier sa position initiale.
Le systéme sénégalais ignore pour l’instant ce genre de difficultés et
par suite les solutions qu'il retient pour 1’application du droit public aux
actes unilatéraux, d@s lors qu'on les situe dans sa propre logique, pareissent
claires et cohérentes.
Les_contrats
Le droit sénégalais se caractérise, sur ce point, par le fait qu'il est
principalesent un droit écrit. Le Code des Obligations de 1'Adninistration,
GOA (loi n° 65-51 du 19 juillet 965, J-0.T965, p..945) document sans Equiva-
Tent en droit-frangais, comporte deux parties : la premi@re est consacrée aux
contrats de l'Administration et doit @tre complétée par de nombreux textes re~
latifs aux mirchés publics, le dernier en date étant le décret n° 823690 du
7 septembre 1982, modifié (J.0. n° 4911 du 25 septenbre 1982, pp. 611-626).
Cette preniare partie du COA codifie les ragles, dont 1a plupart sont inspirées
par la jurisprudence francaise, relatives cux contrats (régime juridique, do-
maines d'application, responsabilité contractuelle, etc...). La seconde partie
est consacrée & “la responsabilité de 1'Administration en dehors des’ contrats";
Sle Codifie les principes de 1 réparation des dormages causés par les actes
juridiques et les opérations matérielles de 1'Administration, Pour 1a détermi-
nation du chaup d'application du droit public, il faut distinguer le domaine
des contrats de 1'Administration et ses activités extra-contractuelles.
En ce qui conceme les contrats, le probléme majeur est de déterminer la
portée de L'application du droit public.
Le COA distingue en effet trois types de contrats : “les contrats de
Ladministration" (article 1), soumis aux régles de droit privé telles qu’elles
Yésultent du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC), “les contrats
de_droit privé conclus par 1'Adwinistration" (article 2) : clest I'hypothése
dans laquelle ies personnes publiques, pour contracter, se placent volontaire~
ment sous L'enpire du droit privé ; et les "contrats administratifs” (arti.
ele 3), “conventions spéciales" conclucs par les personnes morales de droit
public, “en raison des nécessités du service public et du but d'intérét général”,
RIPAS n° 9 16 Janvier-mars 1984
Le problém du champ d'application du droit public aux contrats ne con~
cerne donc,’ proprement. parlor, que les contrats administratifs, et ce problé—
me ee pose du fait que le COA limite ce champ d'application dans son article 4
ainsi congu : "les régles posées par le Code des Obligations Civiles et Com
merciales ne sont applicables aux contrats administratifs qu’en l’absence de
dispositions spéciales". 11 apparaft donc que dans L'esprit du 1égislateur
"alors, les régles du COCC constituaient pour les parties aux contratg admi-
nistratifs, des r2gles supplétives de volonté : en cas de litige, ce sont les
principes énoncés par le contrat contesté, par le COA, et éventuellement par
Jes textes sur les marchés publics qui seront appliqués ; si, et dans la mesu-
re od ces textes ne permettent pas de trancher le litige, le juge pourra alors
se référer au COCC.
La portée de l'application du droit public aux contrats tient compte
de deux considérations : il faudrait d'abord déterminer avec précision'le do-
maine d'application du droit public, c'estzadire 1a notion de contrat adminis~
tratif ; son crit@re, selon l"expression recue par 1a doctrine, I1 faudrait
ensuite, en raison de 1a dualité des régles juridiques applicables aux contrats
adninistratifs, et dans 1hypothése des contrats dont 1a structure est complexe,
déterminer les E16ments du contrat auxquels s'applique le droit public.
a) Le erit@re du contrat administrati
Sur le premier point ~le crit@re du contrat aduinistratif, on le sait,
Je COA 2 codifié les principes de 1a jurisprudence francaise : sont contrats
aduinistratifs, les contrats par détermination de 1a loi (par exemple, les mar
ch&s publics, les offres de concours, les contrats comportant occupation du
domaine public) ainsi que les contrats "par nature", & savoir ceux dont, 1"un
des-co-contractents au moins est une personne publique ou agit pour son compte
et quien outre, soit comportent une participation directe et permanente du
co=contractant de Administration & 1'exécution du service public, soit com
portent des clauses exorbitantes du droit commun.
Le débat théorique tr2s fourni que suscite ce probléme en droit trangais
est presque sans intérét au Sénégal. Certes, il arrive que le juge se prononce
sur le critére du contrat dont il est saisi. Mais c'est dans des hypothéses du
reste rares, dans" lesquelles sa compétence n'était pas évidente, Ainsi,
IASECNA, personne morale de droit public international passe un contrat qui
comporte une option de compétence en faveur du Tribunal de re Instance de
Dekar, statuant en matitre administrative. Ce contrat fait 1’objet d'une scus~
traitance entre deux sociétés privées avec l'agrément et 1a caution de 1'ASECNA.
Devant le juge se pose alors le problime de 1a nature juridique d'un tel con-
trat de sous-traitance ; le Tribunal décide qu'il s'agit d'un contrat de droit
privé per les motifs ci-aprés : "Attendu que le contrat de sous-traitance ne
comporte aucune clause exorbitante du droit commun et doit donc @tre soumis au
droit civil et coumercial, Attondu qu'il s‘agit, en effet, de marchés avec
entente directe entre entrepreneurs et sous-traitants et en ce qui concerne la
société MTA de fournitures de matériel de cuisine sans aucune contrainte adm:
nistrative particuligre" (Trib. Dakar, 25 février 1981, L'Agence pour le Sécuri-
t6 de 1a Navigation a€rienne en Afrique et Madagascar (ASECMA c] to SoctetE
‘BEaagalatec de. Grande Teavaak (SCE). CONS, TE a-TOS} eae Tunal le cas,
RIPAS n° 9 a Janvier-mars 1984
lorsqu'on se trouve non en présence d'un contrat cdministratif, mais d'un con~
trat de travail, ou, & tout le moins d'un litige né des relations de travail
(Trib, Dakar, 3'février 1982, Demoiselle Brigitte El MALEH, GDJAS, II, n° 261).
‘On le voit bien, ia démarche du juge sur ce point présente un caractére
exceptionne] ; le critre du contrat edministratif ne constitue pas dans le
systéme sénégalais un probléme juridique majeur parce que sa portée pratique
est trés limitée: hormis les cas od le juge est tenu d'appliquer le droit pu-
blic et.rien que le droit public, parce que les parties 1'ont expressénent sti-
pulé dans le contrat, 1'existence d'un contrat administratif n'entraine qu'une,
ésompeion d' application du droit public, le juge sowant toujoure, Torsque
Te tortavest pos sufflsammont explicite, recourir au OCC. Cela explique que
dans la pratique, le juge se soucie peu de qualifier le contrat dont il est
saisi, appliquant souvent a l'occasion du méme litige le droit public et le
droit privé et, coume souligné plus haut, appliquant le droit public @ des
contrats de droit privé ; cela explique Gzalenent 1a pratique selon laquelle le
juge se contente de suivre les requérants, sans discuter ia qualification qu'ils
donnent au contrat, notamment lorsque cette qualification n'est pas contestée
par 1'Administration (Trib. de Saint-Louis, 20 février 1971, Georges BERRAZ,
DIAS, TI, n° 29).
Le seul intért que pourrait présenter 1a recherche de ce critere semble
résider dens L'obligation faite au requérant de recourir a 1a procédure des
articles 729 et suivants du Code de Procédure Civile, lorsqu'on se trouve en
présence d'un contrat administratif. Mais on 1'a exposé plus haut en discutant
du probléme du droit applicable : il ne s‘agit pas 18 d'un moyen d'ordre pu-
blic que le juge soulave d'office. Autrement dit, si le juge, de con: propre
nouvenent, ou pour répondre & une irrecevabilité soulevée par 1'Administration,
constate parfois que la procédure administrative a été suivie, il ne le fait
pas systématiquement, et dans bien des cas, 1a responsabilité du fait des con-
trats administratifs est engagée selon les ragles de 1a procédure civile.
b) La portée de L'application du droit public aux éontrate —
Sur le second point ~éléments du contrat auxquels s"applique Te droit
public- il faut distinguer deux problémes.
Le probléme des actes détachables du contrat sur lequel il n'y a pas
de différences najeures avec le droit fraugais. L'article 139 du COA pose con-
me principe que le contrat est soumis au plein contenticux qui rel@ve des tri-
unaux de Iére instance. L'article 140 dispose que les actes détachables du
contrat pourront faire l'objet d'un recours pour exc®s de pouvoir devant la
Cour supréme et Enunére les principatix de ces actes : 1'autorisation de contrac~
ter, la-décision de contracter ou de ne pas contracter, 1'opération 4’ adjudica
tion, L'approbation du contrat, l’acte de conclusion du contrat ou le refus
de conclure.Ces actes sont dits détachables parce qu'ils ne font pas partie
intégrante du contrat lui-néme.
La difficulté sé présente au contraire pour les contrats dont 1a struc~
ture est-complexe, par exemple pour l'acte de concessio:
ce Gn ie salty lvacte de concession comprcid Us couttat proprenent dit et
Je cahier des charges, des clauses et conditions générales qui ont un caractire
RIPAS n° 9 18 Janvier-mars 1984
permanent. Les dispositions du cahier des charges s'int@grent dans les disposi-
tions contractuelles de telle sorte que 1a mdification des unes affecte né-
cessairement les autres.
En droit francais, on @ fini par admettre que les dispositions des ca~
higrs des charges qui ont pour principal objet Lorganisation et lé fonctionne-
ment du service public présentent un caractére réglementaire, en’ sorte que
dans L'acte de concession, coexistent des dispositions réglementaires et con-
tractuelles. L'un des intéréts de cette distinction réside dans le fait que
les clauses réglementaires sont opposables aux tiers 4 la concession, aux usa~
gers du service public concédé ; en contrepartie, ils sont recevables 2 atta~
quer par la voie du recours pour excs de pouvoir les mesures prises par 1'au-
torité concédante en violation des dispositions du cahier des charges. Au to-
tal, en droit francais, 12 concession est sounise a deux régimes juridiques +
le droit public s'applique aux Litiges entre le coneédant et le concessionnai~
re, ainsi qu'aux relations entre 1a personne publique: concédante et 1és usa~
gets du service sublic, tiers a L'acte de concession ; en revanche, les liti-
ges opposant les usagers du service ainsi que les tiers au concessionnaire
sont soumis au droit privé
Dans le COA, il n'existe pas de dispositions particulidres relatives 3
Je concession, hormis la référence de l'article 85 concernant 1a mise ‘sous
séquestre du concessionnaire, En revanche, le contrat, envisagé comme acte
nixte, combinant des dispositions réglenentaires et contractuelles, semble
constituer un procédé normal de 1"intorvention de 1'Administration. Llarticle
I11 du COA dispose en effet : "Le pouvoir de modification unilatérale ne peut
porter que sur les clauses du contrat qui intCressent le fonctionnement du
service public", Ces clauses qui ont un ceractére réglenentaire, constituent
sans aucun doute les clauses excrbitentes du droit commm qui,. au sens:des ar-
ticles 12 8 15 du COA, conf@rent le caracttre administratif. éux contrats.
Ltarticle 15 du CoA donne une liste indicative de telles clauses : 1a rupture
de L'égalité contractuelle au profit de 1'un des contractants ; L'cctroi a
co-contractant de 1'Administration de prérogatives a 1'égerd des tiers’; 1'in-
clusion d'une régle spécifique du régime juridique des contrats administra~
tifs et le but d'intérét général qui a menifestement inspiré la stipulation.
Le probléme de la portée de 1'application du droit public eux contrats
administratifs consiste a déterminer, lorsqu'on se trouve en présence dtun
contrat acte mixte, quels sont les Cléments du contrat auxquels s'appliquera
le droit public. Ce problime ve se serait pas post ai te contrat, ds lora
qu'il est qualifié administratif, était nicessairement et exclusivement soumis
au droit public. On a vu plus haut qu'il n'en est rien ; et par exemple un
contrat de concession de service public qui présente sans aucun doute le carac-
tere de contrat adainistratif sera interprété, orincipglesent sclon les r®gles
du COCC, dans 1a mesure of aucune disposition du COA n'a prévu de ragles par-
ticuliéres 4 ce tyne de contrat (les articles 23 8 37 du COA se bornent a énu-
mérer quatre types de contrats : l'adjudication, l'appel d'offres, le marché
de gré 2 gré et le carché sur factures et nésoires sans visor 1a concession
qui différe des autres contrats par le fait que 1'Administration est libre de
choisir le concessionaire).
Deux types de solutions théoriques peuvent @tre proposées pour résoudre
ce problame.
RIPAS n° 9 19 Janvier-mars 1984
Lune consiste & donner son plein effet & la distinction que fait le
COA entre deux types de contrats administratifs par nature : les contrats
comportant une participation directe at permanente du co-contractant de 1'Ad~
ministration a 1'exécution du service public, et les contrats compottant des
clauses exorbitantes du droit commun. Les contrats qualifiés administratifs
en raison de leur objet seraient soumis principalement au droit public et
accessoirement, en l"absence de dispositions spéciales du COA, aux tégles de
droit privé. En revanche, les contrats qualifiés administratifs par le fait
qu'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun seraient‘soumis
exclusivement au droit public ; ces clauses qui elles sont nécessairement sou-
mises au droit public en raison de leur spécificité imprimeraient 4 l'ensemble
des dispositions du contrat un régime exorbitant du droit commun. Pour cette
catégorie de contrats, les rgles du COCC ne joueraient plus le réle de régles
supplétives de volonté ; en cas d'absence de dispositions spéciales du. COA,
le juge devrait recourir aux principes généraux du droit public, ou les for~
ger. Cette solution serait d'autant plus justifiée que ces clauses ne sont pas
détachables des contrats dans lesquels elles s"insérent.
L'autre solution, moins heureuse A notre sens, consisterait a décider
que le droit public s'applique nécessairenent et exclusivement aux clauses
exorbitantes du droit commun des contrats administratifs, tandis que'les autres
Aispositions du COA resteraient régies par les principes généraux dy COA :
application du droit public, en principe, et accessoirement du droit privé. Le
Principal inconvénient de cette solution, c'est de réduire le chaup.d'applica-
tion du droit public a 1'égard des contrats ; en effet, 1a plupart des litiges
portant non sur les clauses exorbitantes, mais sur les dispositions purement
contractuelles, négociées par les parties, ct 1a solution de ces litiges porte
tout naturellement le juge, en raison de sa formation & étendre aux contrats
aduinistratifs les régles du Cocc.
Tl nlexiste pas de réponse certaine & ce probléme en droit sénégalais.
Dans un arrét du 19 février 1971, la Cour d'Appel de Dakar 1'a abordé, sans
véritablement le trancher (C.A. de Dakar, 19 février 1971, Société Latt®s c/
Société SERAS, GDJAS, II, n° 27).
La Société d’Exploitation des Ressources Animales du Sénégal (SERAS) a
obtenu de 1a Commine de Dakar la concession d'exploitation des Abattoires mu-
nicipaux de la ville de Dakar. Par diverses manoeuvres, elle s'oppoge a ce que
la Société Latt®s acc&de comme par le passé aux Abattoirs afin d'y poursuivre
Lactivieé de commercialisation des cuirs et peaux qu'elle y menait bien avant
IMintervention de 1a concession dont 1a SERAS est titulaire.
La Société Latt8s saisit le tribunal de lére Instance de Dakar pour ob~
tenir Je libre acc8s aux Abattoirs ; ayant 6té déboutée par ce tribunal, elle
rel8ve appel du jugement rendu. La SERAS A son tour forme un appel incident
et invoque comme moyen "L"incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire"
pour connaitre du litige. La Cour d'Appel se trouve donc saisie d'un litige
qui oppose un usager du service public concédé, qui se trouve également étre
tiers & L'acte de concession, au concessionaire.
(Pour justifier son exception d'incompétence, 1a SERAS se fondé sur les
principes de droit frangais : le litige porte sur un service public concédé ;
des "tribunaux de L'ordre judiciaire” sont seuls compétents ; l'usager a le
droit de faire annuler par 1a voie du recours pour excs de pouvoir les mesures
RIPAS n° 9 20 Jenvier-mars 1984
prises par l'autorité concédante en violation des dispositions du cahier des
charges ; puisque la Société Lattés prétend que la Ville de Dakar a commis
une illégalité en donnant & la SERAS une concession trop importante, en lui
conférant “un privilége monopolistique exorbitant du droit commun", il Lui ap-
partient de denander 2 1'autorité concédante de retirer ces mesures, et en cas
de refus, d'attaquer un tel refus par 1a voie du recours pour excts de pouvoir;
il en va ainsi, en raison du principe de la séparation des pouvoirs qui entrai~
ne.la séparation des juridictions judiciaires et administratives ; ainsi, c'est
devant la.Cour supréme que 1a Société Latt&s devrait intenter son recours.
La Cour rejette cette argumentation nar le motif d'une part que "tout le
systime auquel se référe la SERAS, et ci-dessus exposé, n'est nullement une
obligation pour L'usager mécontent, mais une faculté qui lui est ouverte”. En
dfeutres termes, 1'usager n'est pas tenu d'exercer le recours pour exc?s de
pouvoir contre les décisions de l'autorité concédante enfreignant le cahier
des charges ; d'autre part, estime la Cour, ..."en raison des liens de droit
privé entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers,
les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connattre de
L'action formée contre les exploitants desdits services, y compris 1a demande
tendant 8 critiquer le 1égalité d'une décision individuelle™. En d'autres ter-
Sen, TP wy sure pas de qucstion prejadictelie au profit de ia Cour supreme,
lorsque ‘le probléme de la 1éealité d'un acte administratif sera, soulevé devant
les juridictions statuant on matigre civile ou commerciale dans un litige qui
oppose un usager du service public concédé au concessionnaire.
‘Au total, la solution retenue par le Cour d'appel n'éclaire pas le pro-
bl@me du champ d'application du droit public A un contrat dont la structure
est complexe. Elle réaffirme l'inexistence en droit sénégalais des questions
préjudicielles : le juge de fond est juge des exceptions. La Cour d'Appel est
compétente pour interpréter et apprécier 1a 1égalité des dispositions du cahier
des charges de 1a concession, l'occasion d'un litige de droit privé qui oppo-
se l'usager du service public concédé au concessionaire (1'expression "tribu-
naux de l'ordre judiciaire" qui revient fréquenment dans 1'arrét, et qui est
reprise du droit francais désigne les juridictions de fond de droit commun
statuant en matizre civile et commerciale, 4 savoir les tribunaux de premiére
instance et 1a Cour d'Appel. Mais 1a décision ne permet pas de dire si.les
"teibunaux de l'ordre judiciaire" ainsi compétents avpliqueront le droit public
aux dispositions contestées du cahier des charges.
Dans le cas de l'espece, l'article 3 du cahier des charges contesté ne
soulevait pas de grandes difficultés d'interprétation, en sorte que le solu-
tion de 1a Cour ne permet pas de conclure de manitre certaine,, sur ce point.
La Cour décide en effet :
+.e"Attendu qu’a cette thse, 1a Société Lattés oppose l'article 3 du
cahier des charges annexé au contrat de concession, lequel article précise que
le concessionnaire est tenu de donner acts non seulement aux charcutiers,
tripiers titulaires d'une certe professionnelle et patentés ou 4 des personnes
a leur service, mais aussi aux industriels spécialisés.
Attendu que la Société Latts se range parmi ceux-ci, tandis que la SERAS
lui conteste toute spécialisation, au motif qu'elle n'effectue aucun tannage,
se bornant & procéder au lavage et au séchage des peaux.
Attendu, a ce sujet, que la qualification ne vise pas a s'appliquer & une
technique plus ou mins poussée, mais 3 caractériser une activité profession-
nelle déterminge, ce qui est bien le cas de 1a Société Lattés”,
RIPAS n° 9 21 Janvier-mars 1984
3. Les opérations matérielles et le responsabilité extra~
‘contractuelle.-
Le deuxigme partie du COA (articles 141 a 148) est consacrée & la res~
ponsabilité de 1'Adninistration en dehors des contrats. Elle réglenente pri
Cipalenent les modalités de 1a réparation des dommages cousés par les activi
tés matérielles de 1'Administration (on n'aborde pas dans cette étude le pro-
dame de la. responsabilité du fait des lois, des réglenents également faits
et du refus de préter main forte 2 1'exécution d'une décision de justice ré-
glementé par.L'article 142, a et.b du COA).
Cette partie du COA institue trois régimes de responsabilité publique :
4) Le.droit comm de la responsabilité publique concernant les activités
pour lesquelles Ie droit public est normalement appliqué selon la procédure
des articles 729 et suivants du CPC. C'est 1'objet des articles 142, 143, 144
et 145 du COA. A lintérieur de cette catégorie de régles, il n'est pas tou-
jours eisé de déterminer le, fondement de 1a responsabilité ; la responsabilité
sans faute et 1a responsabilité pour faute coexistent et s'interpénétrent de
nanitre complexe, notament en ce qui concerne les articles 143 et 144. Par
axemple, pour l'article 143 (donmages de travaux publics), la responsabilité
de 1'administration est engagée sans faute 3 1'égard des tiers (Trib. Dakar,
ler mars 1969, Sékou BADIO, GDJAS, II, n° 18) et pour faute a 1'égard-des usa-
gers (Trib. Dakar, 26 avril 1980, La Mutuelle Agricole du Sénégal, GDJAS, II,
B°172). Quant A Llarticle 144 (douages causes sux pervonnes berticipant a
Eactivité du service), sa rédaction laisse penser que la responsabilité de
L'Etat ne peut @tre engagée sur son fondement qu'en L'absence de fatite ; dans
Ja pratique cependant, 1a jurisprudence retient aussi bien la responsabilité
sans faute que pour faute (Trib. Dakar, 20 juin 1981, Mamadou Seydou SY, GDJAS,
II, n° 226), sans qu'il y ait lieu de distinguer si 1a victime est collabora~
teur occasionnel de 1'Administration (Trib. Dakar, 22 juillet 1961, Gabriel
MAZARGULL, .GDJAS, II, n° 6, solution implicite). ou agent public (Trib. Dakar,
% décembre 1977, Mame Birame NDIAYE, GDJAS, II, n° 93 ; Trib. Dakar, 27.4@
cembre 1980, Mamadou NDIAYE, GDJAS, II, n° 186).
La particularité du droit administratif dans ce domaine réside.cependant
dans le régime de 1a faute personnelle selon l'article 145. Afin de protéger
1a victime contre L'insolvabilité des agents publics auteurs de dommages, ce
texte prévoit que c'est 1'Administration qui répondra de.la faute personnelle
de son agent, sauf A exercer contre celui-ci une action récursoire. Et c'est
1a que réapparait, & deux niveaux, le probleme du cham 4'application du droit
public.
D'une part, 1a pratique jurisprudentielle tend a sounettre l'article
45. du GOR ge dFOit privé. Loraque I'Administration eat mise en cause pour Te
pondre A 1'8gard deta victine, de la faute personsella détachable de son
agent, c'est le droit privé, et principalement 1'article 137 du COCC sur la
responsabilité du fait des choses et des aninaux que les tribunaux appliquent
A L'Administration. Le droit public ne réapparait que dans le cadre de la res~
Ponsabilité contractuelle, lorsque la faute personnelle détachable se rattache
a l'exécution d'un contrat, administratif. En revanche, dans'le domaine de la
responsabilité extra-contractuelle, le juge epolique le droit privé, das lors
qu'il a Gtabli un lien entre 1a faute personnelle détachable et 1'exercice
RIPAS n° 9 22 Janvier-mars 1984
des fonctions.
Un tel systéme tend A faire disparattre 1a notion de faute personnelle
AStachable du service. D'abord, il n'est pas toujours aisé de 1a distinguer
de la faute de service, et sur ce point, on rencontre des difficultés compara~
bles 2 celles du droit francais (Trib. Dakar, 6 décembre 1980, Dane Niama CISSE,
GDJAS, TI, n° 182 : application de l'article’ 137 du COCC sur 1a responsabilité
du fait des choses et des animaux & propos d'un dommage causé par un cheval de
gendarmerie que son cavalier n'avait pas pu maftriser, alors qu'il y avait liew
de fonder 1a responsabilité soit sur l'article 145, soit sur l'article, 142 du
COA). Ensuite, 1a notion de faute personnelle détachable du service étant dans
la pratique sans portée a 1’égard de la victime, le juge a tendance, pour fa~
voriser celle-ci, 2 rechercher le lien, si tenu soit-il, qui rattache une telle
tute 3 Lexercice des fonctions publiques. Ainsi, le fait pour un agent public
le se livrer a des violences sur un autre agent de son service constitue bien
ume faute détachable du service public ; ... cenendant, cette faute étant in-
tervenue sur le lieu du travail, pendant les heures.de service et 3 propos d'un
fait initial se rattachant & l'exécution du service, elle est intervenue &
Loceasion de L'exercice des fonctions" (Trib. Dakar, 9 novembre 1968, Hector
Jean Pierre, GDJAS, II, n° 17 bis) ; de méme, en cas d'abus de fonctions, “un
Tien de causalité.:. avec 1'exercice des fonctions suffit a rendre le .conmet-
tant.responsable" et ¢e"licn existe ds lore quo le véhicule qui a caudé L'ecci-
dent a été remis au préposé pour i'exécution du service, dans des conditions
of un tiers quelconque n'aurait pu senblablement en obtenir 1a disposition”
(C.S., 8 juin 1968, Abdoulaye GUEYE, GDJAS, II, n° 16).
Brest alse hore de cause que lorsque 1a faute og¢‘conmi-
L" Admini:
se par tine personne qui n'a pas la qualité d'agent public. C'est le sens qu'on
peut donner @ 1'arrét de 1a Cour d'Appel de Dakar du 5 février 1973, uinisttre
ublic et Gorgui NDIAYE c/ Paul FAYE et Ibrahima SY, GDJAS, II, n° 35)": une
personne Strangére au service public se volt confler un v@icule administra
tif ; apr&s avoir accompli 1a mission qui incombait normalement au chayffeur
de 1'Administration, il fait un détour pour déposer chez lui des provigions
qu'il avait achetées, entre en collision avec un autre véhicule et blesse un
tiers. Deux articles du COA sont concernés par cette affaire, d'aprés ta Cour :
Ltarticle 142 sur le fonctionnenent défectueux du service public qui explique
qu'n véhicule administratif ait pu se trouver entre les mains d'un tiers a
L'Administration ; elle décide sur ce point que le dommage qui se rattache &
cet article Echappe a 1a compétence du juge pénal. L'article 147 sur les donma-
ges causés par les vhicules.; la Cour décide que la reaponsabilité de ces don-
mages causés a la partie civile incombe au seul. prévenu et non a l'Etat, qui
niest pas comettant et doit Stre mis hors de cause.
Pour décider ainsi, elle constate que le prévenu, Paul FAYE, n'était pas
chauffeur, n'était pas commis, méce implicitement, par le chef de service pour
utiliser le véhicule ; que par suite, il faut exclure "le lien de prépésition
et de subordination indispensable A la responsabilité du commettant". La Cour
d¥appel refuse donc d’appliquer la jurisprudence Abdoulaye GUEYE de 1a Cour
supréne, et d'acsiniler par cxeuple 1a eituation d& Paul FAVE celle dlum agent
public coupable d’abus de fonctions.
D'autre part, un doute subsiste quant au régime de L’action récursoire.
on peut p quelle sera soumise au droit privé, comme 1'action en indemnité
RIPAS n° 9 2 Jonvier-mars 1924
de L'article 145 du COA ; mais on; penser qnielle.sera soumise
droit public, L'eho2:ce ds jurisprudance sur ce point latese penser que 1!
tion récursoire s'exezce selon les procédures comptables (ordre de recatre ov
de versement) susceptibles 2 leur tour de faire l'objet de tecours, comme on
mati@re fiscale, devant les tribunanx de prenitire irztence.
pebdldnue vont les r+
Ge Cartsihes eatégories de domm~
b) Les régimes perticuliers
gles particuliéres relatives a ic répera
ges j ces régles ne dérogent pas att COA, maie concervent leg seules coaditicns
de tengegement de la responsabilité. le COA prévoit deux régimes particvliezs
Ja responsabilité des menbres de i'enseignonent public (arc, 145) et la recpor
sabilité du fait des dommages causé- par les véhicules adninistratifs (art.
147), Dans les deux cas, la jurisprudence © oxele L'application du droit pu-
blic,
e Is reaporisadi
x um doute str’le droit
~ La r6daction méme de 1" e
applicable aux donmages subis o0 ¢ éléves placés sous 1a ourve!l-
Lance des menbres de 1's, “gnonext putin, brant de lére Instance a
commencé par décider que L'action intentés daus ce domine est soumise au
droit privé (Trib, Dakar, 23 mai i970, Abénurchmans NDOVE, CDJAS, IT, n° 24,
solution implicite), Mais cette soluvicn a'dtsiz pas Avidente parce qu'elle
niétait pas prescrite par lec roe que 12 COA dtant par lui-mime
dérogatoire au droit comm nterpréter comme soumettant au
droit public, en principe 12 responsabilité oxtro~contractuelle-de 1'Adminis—
tration sauf dans celles de ces Jisjcvitions qui y “irogeaient expressé:
en faveur du droit
Ce sont peut~Bere cee coasidérations qui expliquest ter hesitation
la jurisprudence ; dans une affaire anloyze & ceile qui avait donné lieu au
Jugement Abdourahmane NOOYE, io ~squccent seleit le Tribunal de l8re Insteace
selon la procédure administrative (T-!b. Dasar, 28 novenbre 1970, Babacar
GUEYE, GDJAS, IT, iv 25) of Le Tribnnat regoit 1a requéte sans faire d'obe
vation sur 1a procéduze. Sur lo acnent, on pouvait inzeroréter ce jugement
de deux manizres : Ou bien, le
Vous aimerez peut-être aussi
- Belles Citations Football, Proverbes Foot, FootballeurDocument1 pageBelles Citations Football, Proverbes Foot, FootballeurDjily BrickestPas encore d'évaluation
- Finances PUBLIQUES 2017 2018-1 PDFDocument41 pagesFinances PUBLIQUES 2017 2018-1 PDFDjily BrickestPas encore d'évaluation
- QCM & Cas Pratique - Résumé Droit Privé Des Biens - INTRODUCTION QCM Un VTM Agricole Dans Une - StuDocu PDFDocument1 pageQCM & Cas Pratique - Résumé Droit Privé Des Biens - INTRODUCTION QCM Un VTM Agricole Dans Une - StuDocu PDFDjily BrickestPas encore d'évaluation
- Unite 4 DPGDocument8 pagesUnite 4 DPGDjily BrickestPas encore d'évaluation
- Unite 2 PDFDocument9 pagesUnite 2 PDFDjily BrickestPas encore d'évaluation
- Intro PDFDocument7 pagesIntro PDFDjily BrickestPas encore d'évaluation