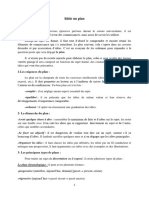Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
III. Géodynamique Interne
III. Géodynamique Interne
Transféré par
satisfying5410 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
11 vues12 pagesTitre original
III.-Géodynamique-interne (1)
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
11 vues12 pagesIII. Géodynamique Interne
III. Géodynamique Interne
Transféré par
satisfying541Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 12
Introduction
La dynamique interne de la terre, ou la géodynamique interne, concerne les mouvements et
les processus qui affectent I’intérieur de la terre. Une des manifestations les plus tangibles de
cette dynamique est le déplacement de plaques rigides (lithosphériques) & la surface de Ia
planéte, plaques qui glissent sur du matériel plastique (asthénosphére). Cette mécanique est
décrite par la théorie de la tectonique des plaques, une théorie unificatrice qui vient expliquer
de grands phénomenes géologiques comme les tremblements de terre, les volcans, la
déformation de la crofite terrestre et la formation des grandes chaines de montagnes.
Chapitre 1 : les tremblements de terre (séismes)
Introduction
Les séismes ou tremblements de terre constituent un phénoméne géologique qui, de tout
temps, a terrorisé les populations qui vivent dans certaines zones du globe. Ils sont les
catastrophes naturelles les plus dangereuses et les plus imprévisibles, ils peuvent dévaster une
région entire et sinistrer des dizaines voire des centaines de milliers de personnes.
2, Comment se produisent les séismes ?
Lorsqu’un matériau rigide est soumis a des contraintes de cisaillement, il va d’abord se
déformer de maniére élastique, puis, lorsqu’il aura atteint sa limite d’élasticité, il va se casser
en dégageant, de fagon instantanée, toute énergie qu’il a accumulée durant la déformation
élastique. C'est ce qui se passe lorsque la lithosphere est soumise 3 des contraintes. Sous
effet des contraintes causées, le plus souvent, par le mouvement des plaques tectoniques, la
lithosphére accumule "énergie. Lorsqu’en certains endroits, la limite d’élasticité est atteinte,
il se produit une ou plusieurs ruptures qui se traduisent par des fuilles. L’énergie brusquement
dégagée le long de ces failles cause des séismes. A noter que les séismes ne se produisent que
dans du matériel rigide. Par conséquent, les séismes se produiront toujours dans la lithosphere
et jamais dans I"asthénosphére qui est plastique.
Lorsqu’un séisme est déclenché, un front d’ondes sismiques se propage dans la croite
terrestre, On nomme foyer (hypocentre) le lieu dans le plan de faille od se produit réellement
le séisme, alors que l’épicentre désigne le point, 2 la surface terrestre, qui est & la verticale du
foyer.
Gi tesinten
AN 5 Doren
Ci
Hap
“Ondes sremiques,
TaTite decrOIAT
3. Les types dondes émises par les séismes : on distingue deux grands types d’ondes
mises par un séisme :
> Les ondes de fond : celles qui se propagent a V'intérieur de la terme et qui
comprennent les ondes $ et P. Les ondes P sont des ondes de compression
assimilables aux ondes sonores, elles se propagent dans tous les états de la matiére,
Les particules se déplacent selon un mouvement avant-arri@re dans la direction de la
propagation de l’onde. Les ondes $, quant a elles, sont des ondes de cisaillement qui
ne se propagent que dans les solides. Les particules oscillent dans un plan vertical, &
angle droit par rapport & la direction de propagation de I’onde.
Les ondes de surface : celles qui se propagent qu’en surface et qui comprennent les
ondes de Love et de Rayleigh. Les ondes de Love ou les ondes L sont des ondes de
cisaillement, comme les ondes S, mais qui oscillent dans un plan horizontal. Elles
impriment au sol un mouvement de vibration latéral. Les ondes de Rayleigh sont
assimilables & une vague, les particules du sol se déplacent selon une ellipse, créant
une veritable vague qui affecte le sol lors des grands tremblements de terre.
Onde P (compression)
Zone
tation compression
Onde L (de Love) (cisaillementy
Onde de Ray!
4, Mesure d’un tremblement de terre:
Nous disposons de deux échelles pour évaluer les tremblements de terre: échelle de Mercalli
et échelle de Richter. Aujourd’hui, nous n'utilisons que celle de Richter, mais les séismes du
passé ne peuvent étre évalués que selon celle de Mercalli.
» Léchelle de Mercalli a été développée en 1902 et modifiée en 1931. Elle indique
Vintensité dun séisme sur une échelle de I & XII. Cette intensité est déterminée par deux
choses: 'ampleur des dégats causés par un séisme et la perception qu‘a eue la population du
éisme. Il s'agit dune Evaluation qui fait appel & une bonne dose de subjectivité. De plus, la
perception de la population et l'ampleur des dégats vont varier en fonetion de la distance &
Vépicentre, On a done avec cette échelle, une échelle variable géographiquement. Mais, &
T'époque, on ne possédait pas les moyens d'établir une échelle objective.
> Liéchelle de Richter a été instaurée en 1935. Elle nous fournit ce quion appelle Ia
magnitude d'un séisme, calculée 2 partir de la quantité d'énergie dégagée au foyer. Elle se
mesure sur une échelle logarithmique ouverte; & ce jour, le plus fort séisme a atteint 9,5 sur
Téchelle de Richter (Chili). Cette fois, il s‘agit d'une valeur qu'on peut qualifier dobjective: il
n'y a qu'une seule valeur pour un séisme donné. Aujourdhui, on utilise un calcul modifié du
calcul originel de Richter, en faisant intervenir la dimension du segment de faille le long
duquel s'est produit le séisme.
Le graphique qui suit met en relation, la magnitude des séismes, sur échelle arithmeétique, et
énergie dégagée au foyer, sur échelle logarithmique; il présente aussi une comparaison entre
quelques séismes les plus connus,
ENERGIE chin, 1980.
(ergs x 10 )
MAGNITUDE A 'ECHELLE RICHTER
Localisation d’un tremblement de terre a la surface de la planéte :
Les ondes P se propagent plus rapidement que les ondes S; c'est cette propriété qui permet de
localiser un séisme. Les ondes sismiques sont enregistrées en plusieurs endroits du globe par
des appareils qu'on nomme sismographes. Il s‘agit d'un appareil capable de "sentir" les
vibrations du sol; ces vibrations sont transmises 2 une aiguille qui les inscrit sur un cylindre
(qui tourne & une vitesse constante, On obtient un enregistrement du type ci-dessous.
onder de
Rayleigh
En un lieu donné, comme les ondes P arrivent en premier, il y aura sur Yenregistrement
sismographique un décalage entre le début d'enregistrement des deux types dondes; ici par
exemple, il y a un retard de 6 minutes des ondes S par rapport aux ondes P.
Les vitesses de propagation des deux types d'ondes dans la crotite terrestre ont été établies et
on posstéde par conséquent des courbes étalonnées, comme celle-ci.
14
onde S
fs Pramiave
2 8 minuter
Temps de"
propagation
(minute) 8
1000 ‘3000 ‘e000
Distance de Iépicentre (iilomatres)
Ce graphique nous dit, par exemple, que pour franchir une distance de 2000 kilometres, onde
P mettra 4,5 minutes, alors que onde S mettra 7,5 minutes pour parcourir la méme distance;
il y a.un décalage de 3 minutes. Pour un séisme donné, il s‘agit de trouver & quelle distance sur
ce graphique correspond le décalage obtenu sur V'enregistrement sismographique; on obtient
alors la distance entre le séisme et le point d'enregistrement, Dans notre exemple, la distance
qui correspond & un décalage de 6 minutes est de 5000 km. Ceci ne nous donne cependant pas
le lieu du séisme & la surface du globe. Pour connaitre ce point, il nous faut au moins trois
cenregistrements. En pratique, on utilise évidemment plus de trois points.
6. Tsunami et raz de marée : catastrophe consécutive & un séisme
Le tsunami (nom tiré du japonais) engendre un phénoméne particulirement destructeur
consécutif 4 un mouvement du fond sous-marin généré par un séisme, une éruption
volcanique ou un glissement de terrain, Il est en quelque sorte soumois parce quill peut
survenir plusieurs heures apres l'événement. Ce schéma illustre la nature d'un tsunami
‘engendré par un soulévement du fond marin causé par un séisme.
A+ Le soulévement du fond marin engendre un gonflement de la masse d'eau, Ce
gonflement donne lieu A une vague qui en surface de Yocéan est & peine perceptible (de
quelques centimétres & moins d'un metre damplitude en général), mais qui sienfle en eau peu
profonde pour atteindre des amplitudes pouvant aller jusqu’a 30 m, La vitesse de propagation
de ces vagues est de 500 4 800 knv/heure en eau profonde (milliers de métres), diminuant 4
quelques dizaines de km/heure en eau peu profonde (moins de 100 m). La périodicité des
vagues est de l'ordre de 15 & 60 minutes. Ainsi, un tsunami initié par un mouvement du fond
marin & la suite d'un séisme qui se sera produit & 1000 km des cOtes viendra frapper ces
derniéres environ 2 heures plus tard, On peut aisément imaginer leffet destructeur de telles
vagues déferlantes sur les cétes habitées et les populations. Le phénoméne de la vague
déferlante qui balaie tout sur son passage est appelée raz de marée,
B- A l'approche de la premiére vague de tsunami, il se produit dabord un retrait de 1a mer (ce
qui est de nature & attirer les curieux!)
C- Vient ensuite la premiére vague.
D- —Celle-ci peut étre suivie d'un second retrait, puis d'une autre vague, et ainsi de suite.
On compte normalement quelques vagues seulement qui en général diminuent
progressivement en amplitude
Le 26 décembre 2004, Vile de Sumatra (Indonésie) a connu un des plus grands séismes jamais
enregistrés (M = 9,0). Ce dernier a engendré un puissant tsunami qui s'est propagé dans tout le
golfe du Bengale et dans 'océan indien, causant une destruction indescriptible.
7. Les tremblements de terre et la tectonique des plaques :
Les séismes n'ont pas une répartition aléatoire & Ia surface de la plantte. Cette répartition
ordonnée vient appuyer la théorie de la tectonique des plaques, particuliérement, en ce qui
concerne lexistence de zones de subduction. On retrouve les séismes surtout aux frontigres
des plaques lithosphériques. De plus, on distingue trois classes de séismes, en fonction de la
profondeur od ils se produisent:
> les séismes superficiels qui se produisent en faible profondeur, soit dans les premigres
dizaines de kilometres, et qui se retrouvent autant aux frontiéres divergentes, c'est & dire le
Tong des dorsales médio-océaniques qu’aux frontitres convergentes au voisinage des fosses
océaniques.
> les séismes intermédiaires qui se produisent entre quelques dizaines et quelques
centaines de kilométres de profondeur et se concentrent uniquement au voisinage des limites
convergentes.
> les séismes profonds qui se produisent a des profondeurs pouvant atteindre les 700
km, soit en pratique la base de l'asthénosphétre, et qui se trouvent exclusivement au voisinage
de limites convergentes.
Toute la céte nord de I’Algérie se situe dans une zone tectonique des plus propices aux
tremblements de terre On se souviendra du grand séisme d’Al Asnam (Chlef), de 1980, qui a
fait 3500 morts. La céte nord de I’Algérie est traversée par une limite de plaques
lithosphériques continentales convergentes : la plaque eurasienne, au nord, chevauche la
plaque africaine au sud. C'est dans cette faille de chevauchement que se déclenchent les
séismes de la région.
8. Tectonique souple et cassante (plis et failles) :
Lorsquielle est soumise & des contraintes, la crotte terrestre se déforme. On peut définir
simplement la contrainte comme étant une force appliquée & une certaine unité de volume.
Tout solide posséde une force qui lui est propre pour résister 2 1a contrainte. Lorsque Ia
contrainte dépasse la résistance du matériel, objet est déformé et il s‘ensuit un changement
dans la forme eV/ou le volume.
Trois paramétres importants doivent étre considérés lorsqu’on applique les concepts de
contrainte-déformation aux matériaux de la crodte terrestre: 1a température, la pression et le
temps. Température et pression augmentent avec la profondeur dans la crofte terrestre et
modifient le comportement des matériaux.
Le temps est aussi un facteur tres important lorsqu’on discute de déformation. Si on étire
brusquement (temps court) un cylindre de pate & modeler, il casse; sion y va plut6t lentement
(Lemps long), il se déforme de fagon plastique. En ce qui concermne la déformation des roches,
le facteur temps, qui se mesure ici en millions d'années, se doit d’8tre considéré. Il est difficile
dimaginer qu'on puisse plier des couches de roches dures, ... 2 moins qu'on y mette le temps
géologique.
Un autre paramétre & ne pas négliger est la composition de la roche, Certaines roches sont
cassantes de nature (comme les calcaires, les grés, les granites), d'autres plutot plastiques
(comme les roches argileuses).
8.1. Les déformations souples, continues ou plis
Elles correspondent & un raccourcissement des terrains dus 2 des mouvements de
rapprochement erées par des forces convergentes : compression.
Biennta Synolinal Antistinal
PLIS DROITS
PLis DEVERSES.
8.2, Les déformations cassantes ou les failles
= Failles inverses lors des mouvements compressif's
= Failles normales : elles correspondent & un étirement, des roches initiales, di a des
mouvements d’écartement crées par des forces divergentes : distension.
FAILLE INVERSE
=
FAILLE DE CHEVAUCHEMENT
Déformation cassante - Régime extensif:
FAILLE NORMALE
FAILLES LISTRIQUES
Déformation cassante - Régime coulissant
FAILLE BE OECROCHEMENT
Chapitre 2 : Les volcans
1, Définition :
Les volcans sont des ouvertures pratiquées dans I’écorce solide du globe, do sortent, de
temps en temps, des jets de substances embrasées, de la fumée, des cendres, des pierres et des
laves. Ces ouvertures ont la forme d’un entonnoir et portent le nom de eratéres. En général,
un volcan est formé de trois parties
—> Un réservoir de magma en profondeur,
> Une ou des cheminges voleaniques qui font communiquer intérieur de la terre avec la
surface,
> Une montagne volcanique, qui est soit un eratére, un déme une coulée de laves ou un
dépét de produits d’explosion.
2. Cratéres de soulévement :
Le premier effet d'un tremblement de terre est de briser avec violence la crofite solide du
globe. D’abord, on voit le terrain se soulever sur une étendue plus au moins considérable, Un
cOne élevé se forme et bientdt, l"explosion se déclarant, il se fait une ouverture en forme
d’entonnoir par laquelle se dégagent les cendres, la fumée, les pierres et les laves.
2.1. La fumée :
Les énormes colonnes de fumée que l'on voit sortir du cratére sont principalement composées
de vapeur d’eau. Mais, comme cette vapeur est, le plus souvent, chargée d’acide carbonique,
poison violent, il est dangereux de s’en approcher
2.2. Les cendres :
Ces cendres d’une finesse extraordinaire sont entrainées dans I’atmosphére et y forment des
nuages assez épais. Il arrive parfois que ces nuages de cendres soient portés sur de grandes
distances.
2.3. Les laves
Les aves jouent le r6le capital dans les phénoménes volcaniques. On donne le nom de laves &
toutes les matidres fondues qui sortent & I’état de courants. Les laves sont, par conséquent, des
matidres pierreuses ou métalliques amenées 2 I’état de fusion par la haute température du
globe. Les voleans ne jettent pas continuellement de la lave, certains sont trop élevés pour
que la lave puisse sortir par le cratére.
Lenteur de refroidissement : la lenteur avec laquelle les laves se refroidissent n'est pas moins
remarquable ; la chaleur se conserve Vintérieur des années entidres, Un baton que l'on
trempa dans un bain de lave 26 ans aprés I’éruption prit feu immédiatement. On peut aussi,
par une fissure, se rendre compte de la chaleur de la lave : on y plongea de argent et du
cuivre qui fondirent instantanément.
2.4, Les gaz qui accompagnent les phénoménes voleaniques :
Une certaine quantité de gaz accompagne les phénoménes volcaniques. Les principaux sont
le gaz acide carbonique, oxygéne et le sulfure d’hydrogéne,
3. Réparti
n des voleans :
Comme les séismes, les volcans ne se répartissent pas de fagon aléatoire a la surface de la
planéte. Plusieurs se situent aux frontiéres de plaques (volcanisme de dorsale et de zone de
subduction), mais aussi a Vintérieur des plaques (volcanisme intra-plaque, comme par
‘exemple le volcanisme de point chaud).
content
> Le volcanisme de dorsale
Nous savons, pour lavoir observé directement grace a Vexploration sous-marine par
submersibles, quil y a des volcans sous-marins tout le long des dorsales, particulitrement
dans le rift central, 1a ott il se forme de la nouvelle lithosphere océanique. La composition de
Ia lave de ces volcans indique qu'on est tout prés de la zone oit se fait la fusion partielle du
‘manteau (voir la section 2.2.2 au sujet de 1a composition des laves et de la fusion partielle)
Sil n'y avait pas de tensions dans cette zone de dorsale, il n'y aurait pas de fractures qui
permettent justement au magma produit par la fusion partielle de s'insinuer dans la lithosphere
et de former des volcans.
> Le volcanisme de zone de subduction
Le volcanisme relié & Venfoncement d'une plaque sous Tautre va former des chainons de
volcans. La fameuse Ceinture de feu autour du Pacifique est 'expression de ce volcanisme de
convergence, mais selon qu'il s‘agisse d'une collision entre deux portions de lithosphére
océanique, ou entre une portion de lithosphére océanique et une portion de lithosphére
continentale, la nature du voleanisme différe. Dans le cas oi il y a convergence entre deux
portions de lithosphere océanique, il y aura formation d'un chainon de volcans qui s'élévent
au-dessus de la surface des océans pour constituer un arc insulaire. Par exemple, toute la
portion de la Ceinture de feu qui se situe dans le Pacifique-Ouest et le Pacifique-Nord est
associge A ce type de collision. Dans le cas de la convergence entre une portion de lithosphere
océanique et une portion de lithosphére continentale, les volcans se trouvent sur la marge du
continent et forment un arc continental. Un bon exemple de cette demitre situation est 1a
Chaine des Cascades (Cascades Range), dans Youest du continent nord américain.
> Le volcanisme de point chaud
Le volcanisme de point chaud est un voleanisme intra-plaque, qu'on retrouve principalement,
mais pas exclusivement, sur la lithosphére océanique. Les chainons volcaniques de points
chauds viennent appuyer la théorie de l'étalement des planchers océaniques. Pour des raisons
que l'on comprend encore mal, il se fait en certains points & la base du manteau supérieur, une
concentration locale de chaleur qui améne une fusion partielle du matériel. C'est ce qu'on
appelle un point chaud.
Point chaud
wotoans volean
le plus vieux le plus jeune
x
—_ a Aa Aa |
[fimoseners CO
ASTHENOSPHERE
Combien y a-t-il de volcans actifs dans le monde ?
Si l'on suit I’activité des voleans dans le monde, il apparait depuis une vingtaine dannées que
le nombre de volcans actifs est en augmentation. Aucune inguiétude ! cela traduit,
simplement, un intérét accru de Ihomme pour les phénoménes volcaniques, avec des
observateurs plus nombreux, des transports plus aisés, et l'information volcanologique qui se
diffuse plus facilement.
Environ 60 volcans sont tous les ans en éruption, Des naturalistes, des savants ont tenté, trés
tat, de dresser un inventaire des volcans actifs dans le monde. Le premier dénombrement fut
réalisé, en 1665, par le jésuite Kircher Athanase, qui dans son ouvrage Mundus Subterraneus
place 36 volcans.
Le grand géographe en compte 407 dans son livre cosmos (1846). Selon les derniers travaux,
1511 volcans sont considérés comme actifs. Cependant, il existe une multitude de volcans
sous-marins actifs encore inconnus.
Vous aimerez peut-être aussi
- VarDocument1 pageVarsatisfying541Pas encore d'évaluation
- Chap 8 MitochondrieDocument8 pagesChap 8 Mitochondriesatisfying541Pas encore d'évaluation
- Mémoire V4Document10 pagesMémoire V4satisfying541Pas encore d'évaluation
- 1er Cours Prise de Notes en FrançaisDocument3 pages1er Cours Prise de Notes en Françaissatisfying541Pas encore d'évaluation
- DiapoDocument95 pagesDiaposatisfying541Pas encore d'évaluation
- PLANCHEPLANDocument3 pagesPLANCHEPLANsatisfying541Pas encore d'évaluation
- Emplois Du Temps S2 2023.2024 2 Enregistre AutomatiquementDocument13 pagesEmplois Du Temps S2 2023.2024 2 Enregistre Automatiquementsatisfying541Pas encore d'évaluation
- Référence BibliographiqueDocument1 pageRéférence Bibliographiquesatisfying541Pas encore d'évaluation
- Compte L1 e LerlingDocument26 pagesCompte L1 e Lerlingsatisfying541Pas encore d'évaluation
- Cours 5 Bâtir Un PlanDocument4 pagesCours 5 Bâtir Un Plansatisfying541Pas encore d'évaluation