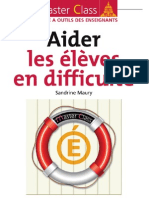Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Connaissance de L Ecrivain
La Connaissance de L Ecrivain
Transféré par
Lilia ZermaneTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Connaissance de L Ecrivain
La Connaissance de L Ecrivain
Transféré par
Lilia ZermaneDroits d'auteur :
Formats disponibles
Jacques Bouveresse, La connaissance de lcrivain. Sur la littrature, la vrit et la vie, Marseille, Agone, 2008.
Le philosophe Jacques Bouveresse, partisan de lcole analytique, est le critique ran!ais le plus rigoureu" du post#odernis#e qui rduit tout $la philosophie, la physique, la littrature, la religion, les loft stories%& ' un rcit, ait de la littrature la reine de la connaissance et a ir#e par ois que chaque te"te renvoie ' un autre te"te, sans r rence au" ralits e"ternes ' la te"tualit. Lauteur re use ces thories u#euses qui voient ( dans la littrature une or#e de connaissance suprieure de la ralit ) et qui entretiennent autour delle ( une at#osph*re de #yst*re indispensa+le ' la prservation de sa valeur et de son autorit particuli*res ). ,l conda#ne ( lide que le te"te littraire est autor rentiel et nous parle essentielle#ent de lui-#.#e ou de la a!on dont le langage est utilis ). ,l critique la ( pho+ie de le"trate"tualit ) qui #et hors circuit le contenu actuel et thique de la littrature, qui renonce ' se"pri#er sur ce que passionne le lecteur / la vie des personnages, leurs dsirs et leurs #otions, les pro+l*#es et les con lits thiques au"quels ils sont con ronts, les e"priences et les aventures #orales dans lesquels ils sont i#pliqus, +re , ( ' ce qui ait de leur e"istence des russites ou, au contraire, des checs plus ou #oins la#enta+les ). La contri+ution essentielle de la littrature ' la r le"ion Lauteur reconna0t que les philosophes concerns par le sens de le"istence $pourquoi vivre1& et la #orale $co##ent vivre1& pourraient avantageuse#ent e"ploiter le #atriau
de choi" quo rent les ro#ans. Mais au-del' de ce qui lui se#+le une vidence, il se de#ande co##ent la littrature peut apporter une connaissance sur l.tre hu#ain di rente de celle que nous ournit la philosophie, ' laquelle 2a2outerais pour #a part les sciences hu#aines. 3e nouvel ouvrage reprend le travail e ectu dans la prparation dun s#inaire donn au 3oll*ge de 4rance au cours de lanne 2005-2006. Bouveresse pose la question de lapport spci ique de la littrature ' notre connaissance, en r lchissant sur les crits thoriques de certains ro#anciers, dont 7roust et 8o+ert Musil $le plus grand crivain du 99e si*cle, selon #oi& et de quelques philosophes conte#porains, dont Jacques 8anci*re et Martha :uss+au# $que 2e ne connais pas&. 3et ouvrage, dont la lecture e"ige +eaucoup dattention et de disponi+ilit, en est un de recherche, de"ploration, de work in progress. Lauteur ne rpond pas ' la question, se contentant trop souvent dcrire ( ce quon ne peut pas dire ) sur le su2et. ;n attendant et esprant quil dter#ine sa position et quil le"pose par crit, 2e prsenterai ici avec t#rit les esquisses de ce que pourrait .tre sa rponse. 3o##ent russit-on ' vivre1 3ontraire#ent ' la philosophie #orale dont lo+2ecti est de"pliquer avec clart et prcision ce que serait une vie +onne et ' quels principes elle devrait .tre assu2ettie, la littrature claircit les ralits ( nig#atiques ou o+scures ) de la vie. ;lle nous apprend essentielle#ent ( lindter#ination et la co#ple"it ) de la vie #orale de chacun. ;lle co#+at ainsi, quoique ce ne soit pas son o+2ecti , la #orale utilitariste do#inante qui
rduit tout ' un calcul rationnel de co<ts-+n ices, #orale qui ne peut rendre co#pte de la vie #.#e dun cono#iste ou dun ho##e da aires. La vrit dun ro#an rside dans son adquation avec la vie, en soulevant indirecte#ent la question de ( la co#pati+ilit entre les e"igences de la vie et celles de la #orale ). La littrature dcrit ce qui peut ( rendre i##orale une action rpute #orale et aire dune action qui se#+le i##orale une chose qui a une relation plus authentique avec la #orale ). La littrature ( e"pri#e pour autrui et rend visi+le pour nous-#.#es notre vraie vie, que nor#ale#ent nous ne pouvons pas o+server et ne voyons pas ). La ( #orale ) de la littrature serait de nous a#ener ' considrer avec sy#pathie la ralit co#ple"e de la vie hu#aine, en sopposant au #oralis#e et ' tout idalis#e #oral. La question ' laquelle le ro#an essaie de rpondre =%> serait peut-.tre #oins Pourquoi vit-on? ou Comment doit-on vivre? que Comment russiton vivre? =%> Le pro+l*#e du ro#an est celui de lho##e individuel
au" prises avec la difficult d!a"iter le monde? autre#ent dit, dy #ener une e"istence ' laquelle il soit possi+le dattri+uer ce quon appelle un sens, ou encore une e"istence capa+le de constituer la ralisation au #oins partielle dun idal, en dpit de tout ce qui peut se#+ler con rer ' la vie hu#aine en gnral un caract*re ' pre#i*re vue insigni iant. La co#ple"it du #essage littraire
@andis que la philosophie ne ait appel qu' notre intelligence, la littrature suscite en nous ( des ractions et des #otions, positives ou ngatives, de nature #orale ), en nous a#enant ' nous identi ier ' certains personnages ou ' nous y opposer. Alors que lessai, co##e celui-ci, e"pri#e des ides, des penses, la littrature enchev.tre #otions et penses, en les incarnant dans des personnages au"quels le lecteur ragira avec sa sensi+ilit et son intelligence. La littrature sadresse gale#ent ' notre i#agination, en #ontrant que les dcisions prises dans la vie quotidienne, dans des circonstances qui si#posent au" personnages et qui in luent sur leurs dsirs et leurs esprances, rel*vent tr*s souvent de li#provisation. ;lle dveloppe li#agination du lecteur, en le #ettant ace ' des situations inconnues et changeantes / Les Auvres littraires ont, en e et, la capacit de nous con ronter ' des possi+ilits qui peuvent sloigner considra+le#ent de celles au"quelles nous so##es ha+itues ou que nous so##es disposs spontan#ent ' considrer? et elles disposent de #oyens spci iques pour nous o+liger ' les prendre en considration et ' r lchir sur elles. La philosophie #orale value gnrale#ent les actes, en les sou#ettant ' des concepts co##e ceu" de +ien et de #al, de vertus et de vices, de droits et de devoirs. ;lle suppose que lindividu agit apr*s dli+ration et quil est capa+le de 2usti ier ses actions, en d#ontrant leur co#pati+ilit avec les principes #orau" au"quels il adh*re. La philosophie #orale, surtout de type Bantien, conda#ne toute a#+iguCt qui en reint la
prcision et la rigueur de ses #a"i#es. La littrature e"plore au contraire co##ent la vie de chacun se plie tr*s di icile#ent au" dictats #orau" / Dne des choses qui sont responsa+les des #auvaises relations que le ro#an en gnral entretient avec le point de vue #oral =%> est 2uste#ent le ait que le pre#ier est par essence spciale#ent attenti ' la a!on dont la contingence, li#prvisi+ilit et la contrEla+ilit du utur, le hasard et la chance sont suscepti+les dintervenir dans la vie #orale. Ainsi, la littrature, #ettant en sc*ne des .tres hu#ains dans leur co#ple"it, interpelle le lecteur dans tout ce quil est / intelligence, i#agination, senti#ents et volont. Dne connaissance pratique Jacques Bouveresse ne re2ette pas les connaissances philosophiques. Ftant philosophe, il ne lui se#+le pas ncessaire de rpter ce qui est une vidence / sans la philosophie #orale, tGtonnant dans lo+scurit co##e des aveugles, notre vie serait dter#ine par les circonstances et nos instincts. ,l reconna0t cependant que la littrature apporte une connaissance pratique qui la distingue des connaissances thoriques ou propositionnelles de la philosophie. Les co#its de dontologie, dont la #ultiplication est directe#ent proportionnelle ' la dilution du politique, ont souvent appel ' des philosophes, co##e Haniel IeinstocB, en
ignorant #alheureuse#ent les ro#anciers dont li#agination #orale est par ois a+sente cheJ les pre#iers / =%> on peut re#arquer quil est s<re#ent, encore au2ourdhui, +eaucoup #oins naturel denvisager de aire entrer un auteur de ro#ans dans un co#it national dthique que dy aire entrer un spcialiste de philosophie #orale, ce qui se#+le signi ier que la qualit la plus ncessaire pour discuter et rsoudre les questions dthique applique nest pas prcis#ent li#agination littraire, et pro+a+le#ent pas non plus, du reste, li#agination #orale.
Bouveresse ad#ire la science qui, telle la physique, nous apporte des connaissances e"actes sur la ralit e"trieure. La littrature nous ournit gale#ent des connaissances, #ais loues et discuta+les, et se d#arque de la science sur deu" points i#portants. Hune part, on ne peut dissocier en littrature le contenu de la or#e, tandis que lo+2ectivit des vrits scienti iques repose sur lindpendance du contenu par rapport ' son e"pression / Ki on utilise co##e paradig#e de ce que peut .tre une vrit o+2ective en gnral le genre de vrit que nous procure la science, on hsitera certaine#ent ' attri+uer ' la littrature la possi+ilit de nous co##uniquer, elle aussi, des vrits o+2ectives. Le propre des vrits de la science se#+le .tre, en e et, de possder le degr le plus lev dindpendance par rapport ' la or#e qui peut .tre choisie pour le"pri#er.
La littrature nous apporte des connaissances non o+2ectives, des vrits transies de su+2ectivit. Hautre part, la science se onde sur le"pri#entation qui peut .tre reproduite, dans des conditions si#ilaires, par tout chercheur. ,l ny a pas de"pri#entation relle en littrature, #ais des ( e"priences de pense ) dont le rsultat est aussi icti que le"prience dcrite. Ki la science peut nous aider ' #ieu" conna0tre le #onde dans lequel nous vivons et si la philosophie peut clairer les choi" qui so rent ' nous, ni lune ni lautre nest su isante pour guider la vie de chacun. 3est pourquoi les connaissances pratiques apportes par la littrature, qui nous claire sur les co#ple"its de la vie, co#pl*tent les vrits scienti iques et le savoir philosophique pour nous per#ettre de rpondre au" questions e"istentielles du pourquoi vivre1 et du co##ent vivre1 7aru dans #ouveau$ Ca!iers du socialisme, no L, 200M, p. 2N5-2N8.
Vous aimerez peut-être aussi
- Dider AdjectifDocument13 pagesDider AdjectifAnonymous MlhE2sa33% (3)
- La Communication Non ViolenteDocument1 pageLa Communication Non Violentenatacha DeerPas encore d'évaluation
- Aider Les Élèves en DifficultéDocument194 pagesAider Les Élèves en Difficultécamli kamlicius100% (2)
- Rapport Tap DefDocument301 pagesRapport Tap DefMarc SatuPas encore d'évaluation
- S1 Ecrits TechniquesDocument785 pagesS1 Ecrits TechniquesJaime Iván Hernández España100% (2)
- 9789953312699 (1)Document19 pages9789953312699 (1)Miha KhPas encore d'évaluation
- Enseigner Le Français Du Tourisme Sem 2 V2Document1 pageEnseigner Le Français Du Tourisme Sem 2 V2DjamilDjimiPas encore d'évaluation
- Fiche de DictéeDocument1 pageFiche de DictéemimiPas encore d'évaluation
- Guide Mes Rituels en Lecture Niveau 6Document168 pagesGuide Mes Rituels en Lecture Niveau 6youssef chadimiPas encore d'évaluation
- Plaquette Petite EnfanceDocument3 pagesPlaquette Petite EnfancebkajjiPas encore d'évaluation
- Heidegger Kierkegaard PinatDocument7 pagesHeidegger Kierkegaard PinatEtienne PinatPas encore d'évaluation
- UFR SEN - EC Libres 2013-2014 - 5eme SemestreDocument4 pagesUFR SEN - EC Libres 2013-2014 - 5eme SemestreUniversité des AntillesPas encore d'évaluation
- Les Enjeux de La Patrimonialisation Entre Discours Et RéalitéDocument16 pagesLes Enjeux de La Patrimonialisation Entre Discours Et RéalitéOuahid AbdouhPas encore d'évaluation
- Aires (5ème)Document3 pagesAires (5ème)MATHS - VIDEOSPas encore d'évaluation
- Global Politics Paper 1 HLSLDocument7 pagesGlobal Politics Paper 1 HLSLNehir TükenmezPas encore d'évaluation
- Calendrier Universitaire UT2J 2022-2023 Adopté en CFVU Et CADocument1 pageCalendrier Universitaire UT2J 2022-2023 Adopté en CFVU Et CAnine oarfishesPas encore d'évaluation