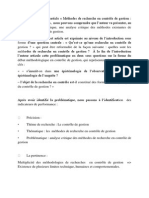Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rapport Jebel Hafeet Melle DIATTA 2012
Rapport Jebel Hafeet Melle DIATTA 2012
Transféré par
Mariemelsiby0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
17 vues10 pagesCeci est le rapport d'une visite de terrain dans l'oasis d'Al Ain aux Emirats Arabes unis effectuée dans le cadre d'un cours de géomorphologie du Professeur Fouache délivré à la licence 1 de géographie de l'Université Paris Sorbonne Abu Dhabi.
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentCeci est le rapport d'une visite de terrain dans l'oasis d'Al Ain aux Emirats Arabes unis effectuée dans le cadre d'un cours de géomorphologie du Professeur Fouache délivré à la licence 1 de géographie de l'Université Paris Sorbonne Abu Dhabi.
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
17 vues10 pagesRapport Jebel Hafeet Melle DIATTA 2012
Rapport Jebel Hafeet Melle DIATTA 2012
Transféré par
MariemelsibyCeci est le rapport d'une visite de terrain dans l'oasis d'Al Ain aux Emirats Arabes unis effectuée dans le cadre d'un cours de géomorphologie du Professeur Fouache délivré à la licence 1 de géographie de l'Université Paris Sorbonne Abu Dhabi.
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
Universit Paris Sorbonne Abu Dhabi
Gographie et amnagement du territoire
Gomorphologie
Licence 1
2012
Auteur : Marime Diank El Siby DIATTA
Professeur Eric FOUACHE
Le J ebel Hafeet, un trsor
dAl Ain
Page | 2
Page | 2
Plan
Introduction
I Le Jebel hafeet, chainon montagneux dAl Ain
A. Naissance de la chaine montagneuse
B. Un relief soumis lrosion
II Le Jebel Hafeet, puits dAl Ain
A. Les falajs : Rle de laquifre dans la cration des oasis
B. Opposition entre loasis dhier et daujourdhui
Conclusion
Page | 3
Page | 3
I ntroduction
Pays de la pninsule arabique, les Emirats arabes unis bordent la rive sud du Golfe arabo-
persique. Cette fdration de 7 mirats est gouverne par Abu Dhabi qui occupe la majeure
partie (80%) du territoire. Le dsert domine le terrain de cet mirat et couvre 70% de sa
superficie. Le relief plat est parsem de dunes de sables impressionnantes, les barkhanes
(dunes en formes de croissant pouvant atteindre des mtres de hauteur). En effet, lEmirat
dAbu Dhabi partage avec le Ymen, lArabie Saoudite et Oman le plus grand erg du monde
le Rouhb al khali .
Figure 1 : Dsert du Rub al Khali
La visite du 12 Mars 2012 nous emmne lest dAbu Dhabi, dans le Quart Vide du pays,
Al Ain, oasis et seconde ville la plus importante de lmirat. Elle occupe le pimont dun
chainon montagneux qui se prolonge au-del de la frontire omanaise, le Jebel Hafeet.
Al Ain
Page | 4
Page | 4
I Le Jebel hafeet, chainon montagneux dAl Ain
Avec ses 8 km de long, le chainon montagneux du Jebel Hafeet stend des Emirats au
Sultanat dOman pays auquel il sert de frontire. Elle est dorientation Nord/Sud avec un
sommet qui culmine 1163 mtres au sud de Al Ain. Le Jebel Hafeet sinscrit dans le
prolongement des montagnes Hajjar du Sultanat dOman et sa formation sest faite sur une
longue priode.
A. Naissance du Jebel Hafeet
Le chainon montagneux du Jebel Haffit est une partie de la chaine montagneuse omanaise du
Jebel Hajjar dont la formation remonte au crtac suite la fermeture de la Tthys. Ne suite
un mouvement de rifting (ouverture) qui fragmente la plaque africaine pour donner
naissance la Mer Rouge, la plaque arabique exerce une remonte vers le nord. Ce
mouvement va entrainer des consquences gologiques importantes. La plaque arabique
ocanique est en subduction avec la plaque Eurasiatique jusqu la fermeture de la Thtys qui
met en contact les deux plaques qui entrent ds lors en collision. Cela provoque un plissement
des croutes continentales donnant ainsi, sur la plaque arabique, naissance aux reliefs et
chaines montagneuses de la rgion dont les montagnes du Zagros en Iran et la chaine
montagneuse omanaise -Jebel Hajjar dont la partie se trouvant aux Emirats constitue le Jebel
Hafeet,
Figure 2 : Plaque arabique
Page | 5
Page | 5
B. Un relief soumis lrosion naturelle
N du plissement vers le haut de la plaque, le Jebel Hafeet est un anticlinale qui a subi une
importante rosion naturelle depuis sa formation. Elle a t victime dune rosion tant
olienne que pluviomtrique. (A titre de rappel, la pninsule na pas t toujours dsertique.)
Figure 3 : Erosion de lanticlinale du Jebel Hafeet
Le processus drosion de lanticlinale a aboutit un creusement dune boutonnire dans la
roche. La combe ainsi cre est borde par une corniche rocheuse, le crt. Elle est en outre
traverse par une valle de faon perpendiculaire, la cluse qui devait sous doute abriter le lit
dun wadi.
Sur le crt, le pendage est dorientation Est-Ouest. Linclinaison de 30 diminue au fur et
mesure que lon sapproche du sommet. Laspect des crts tmoignent dune rosion
diffrentielle. Les couches composes de roches de nature diffrente ne sont pas rods de
faon homogne.
Certaines couches anciennes sont un
stade drosion plus avanc que les
couches les plus rcentes. Les roches
les plus tendres sont plus sensibles
aux alas climatiques.
Image 4 : Crt sous leffet de lrosion diffrentielle
Cette rosion a mis nue les 2 principales roches qui constituent cet anticlinale : le calcaire et
le marne. Elles roches ont des degrs de rsistance diffrente. Do, lrosion sest faite de
faon diffrentielle. Les couches constitues de calcaires srodent un rythme plus lent que
celle contenant plutt du marne.
Page | 6
Page | 6
La prsence de calcaire est rvlatrice dune sdimentation sous-marine. En effet, depuis le
Cambrien, la pninsule arabique t sujette une succession de priodes durant lesquelles
elle tait tantt merge tantt en dessous du niveau de la mer. Entre le Eocne et le Miocne
-immersion dans les eaux tropicales de la Ththys-, il y a eu un dpts de particules minrales
et organiques (squelettes des microorganismes marins) dont la cimentation a donn du
calcaire. La marne est une roche compos de calcaire et de largile. Elle est moins rsistante,
srode donc plus rapidement et peut mme donner du sable. Le calcaire seffrite plutt en
feuillets.
Cette rosion est toujours en progression comme en
tmoignent les boulements de blocs de roches
sdimentaires.
Figure 5 : Blocs de roches bouls
Vu de plus prs, la roche prsente un aspect karstique. Cela est du au fait qu le calcaire
(CaCO3) produit une raction chimique avec leau (H2O) qui libre du gaz carbonique
(CO2). Cest ce gaz emprisonn dans la roche qui provoque des vides dair dans la roche
cimente.
Figure 6 : Karst dans la roche
Le calcaire de couleur gnralement blanche est aussi nettement
visible sur une paroi du sommet. On y trouve mme des calcites -
cristaux forms sous leffet du ruissellement de leau infiltr dans une
roche calcaire- emprisonns dans la roche.
Figure 7 : Cristaux de calcite
Du sommet de la montagne, on voit la valle avec les lits des anciens cours deau le long
duquel subsistent quelques arbustes dans le reg, dsert de cailloux, rsultant de lrosion des
roches. Lrosion est du leffet des amplitudes nycthmrales trs grandes mais aussi du
vent et de la pluviomtrie.
Page | 7
Page | 7
Figure 8 :
Figure 8 : Ancien lits de cours deau
dans la valle o on peut voire
quelques arbustes sans doute aliment
par un coulement hypodermique le
long du wadi assch.
La formation du Jebel Hafeet des intrts gomorphologiques du fait quil tmoigne des
mouvements tectoniques de la plaque arabique mais aussi de la succession de priodes o la
pninsule tait en dessous du niveau des eaux de la Tthys et de priodes o elle tait en
mersion.
C. Amnagement de la combe
Aujourdhui, la combe a t transforme en parc, le Green Mubazarah qui est devenue une
attraction touristique. Le sol pour lessentiel constitu de particules marneuses permet la
vgtation de se dvelopper au sein de la montagne. La cluse traversant la combe qui abritait
un wadi est occupe par une route goudronne.
Figure 9 : Le green Mubazarrah dans la combe du Jebel Hafeet
Le Jebel Hafeet attire de nombreux visiteurs tant nationaux quinternationaux avec ses
sources chaudes. Celles-ci tmoignent du rchauffement des roches souterraines par le
magma. Des piscines ont t amnages pour en faire profiter le public.
.
Page | 8
Page | 8
II Le Jebel Hafeet, puits dAl Ain
La ville dAl Ain dont le nom signifie source est considre loasis dAbu Dhabi. La fertilit
relative de son sol compar aux autres mirats a, en effet, permis le dveloppement dune
vgtation assez abondante dans ce territoire aride. Cependant cela na t rend possible
quavec la mise au point de technique de maitrise de leau car la ressource contenue dans
laquifre nest pas trs accessible. Al Ain possde un important aquifre emprisonn la
chaine montagneux du Jebel Hafeet. Il se serait constitu durant les priodes glaciaires o la
pninsule bnficiaient dun climat tropical humide avec de fortes prcipitations. Inflitres
partir des chaines omanaises, elles ont pendant longtemps offert des ressources en eau
importantes aux habitants de Al Ain.
A. Les falajs : rle de laquifre dans la cration des oasis
Les falajs dAl Ain trouvent leur origine lge de Fer (-3000ans). En effet, des vestiges
datant de lan 1000 AC en tmoignent. On les retrouve dans une large mesure quelques fois
sous diffrents noms avec de lgres diffrences en Iran, au Maroc, Oman
Plus grande oasis de la rgion, loasis dAl Ain est aliment par un vaste systme de falajs. Ce
systme dirrigation permettait aux populations davoir accs leau en distribuant leau
contenue dans laquifre travers un rseau de canaux souterrains qui mergent en surface
sous forme de canaux ciel ouverts.
Explication : Un puits test est
creus afin de vrifier la
disponibilit de la ressource dans
laquifre. Dautres puits seront
ensuite creuss en amont de la
pente certains pour recueillir
leau et dautres serviront
lentretien du systme qui peut
tre boqu par des dbris. Des
canaux souterrains connectent les
diffrents puits.
Figure 10 : Schma dun systme dirrigation en Falajs.
Page | 9
Page | 9
A la surface, des canaux ciel ouvert acheminent leau qui
sera distribue selon un systme de digues qui oriente leau
vers les diffrents champs selon les besoins de chacun.
B. Opposition entre loasis dhier et daujourdhui
La mise au point des falajs ont trs tt permis la cration doasis dans le milieu dsertique.
Lagriculture -essentiellement des palmiers dattes- ne pouvait pas dpendre de la
pluviomtrie saisonnire aussi faible. Les populations qui y vivaient pouvaient ainsi
bnficier deau de faon plus rgulire mais aussi dun climat plus agrable.
De nos jours, les Oasis dAl Ain ne sont plus alimentes par leau contenue dans laquifre.
En effet, laquifre nest pas renouvelable lchelle humaine et les besoins en eau sont
devenus trs importantes avec la forte croissance de la population. De plus, on est pass dune
agriculture extensive une agriculture intensive qui ncessite une forte irrigation. Il a fallu
donc trouver dautres moyens pour irrigus les champs. Cest avec leau de mer dessalinise.
Aujourdhui, il ny plus de populations vivant dans loasis dAl Ain. Elles ont t dplacs et
le village abrit par loasis a t convertit en site touristique.
Figure 11 : Entre de loasis dAl Ain Figure 12 : Chemin dans loasis
Conclusion
La visite du Jebel Hafeet a permis de voir la spcificit gomorphologique de ce chainon
montagneux ainsi que son volution sous leffet de lrosion naturelle quelle a subi depuis sa
formation mais aussi des transformations anthropiques du relief. Cette montagne a en outre
t le point de dpart de la mise en place dune technique de maitrise de leau prcoce qui a
permis des populations davoir accs cette ressource rare dans une rgion aussi aride que
la pninsule arabique. Aujourdhui encore elle continue dtre un site important de la rgion
tant au niveau gomorphologique, touristique et mme archologique avec la dcouvertes des
tombes du Jebel datant de lge de Bronze. Les particularits gologiques et archologiques
des sites de la montagne ont dailleurs valu Al Ain un classement au patrimoine mondial de
lUNESCO.
Page | 10
Page | 10
Sources
Cours de gomorphologie de Mr Fouache
Jebel Hafit , A natural history, SIMON ASPINALL, PETER HELLYER , Emirates
Natural History Group, Abu Dhabi 2004
Environmental atlas of Abu Dhabi Emirate, Environment Agency, 2011
www.ead.ae
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Corps Point Par Point - Gérard Athias - Wawacity - BestDocument211 pagesLe Corps Point Par Point - Gérard Athias - Wawacity - BestDetant Gregory100% (1)
- Mes 40 Premiers JoursDocument16 pagesMes 40 Premiers JoursAurore Imprim PrintPas encore d'évaluation
- Solution Controle Acces ReseauDocument68 pagesSolution Controle Acces Reseaumeone99Pas encore d'évaluation
- Pdd-Rapport Final WB-DMPB 4nt 0591059 000 01 TotaldocDocument344 pagesPdd-Rapport Final WB-DMPB 4nt 0591059 000 01 TotaldocChetan SohalPas encore d'évaluation
- Sirois Lionel MSC 1972Document76 pagesSirois Lionel MSC 1972sihatasnim9Pas encore d'évaluation
- Cours Management I-Chapitre 3Document46 pagesCours Management I-Chapitre 3emmaPas encore d'évaluation
- Sce Nadia BenmansourDocument162 pagesSce Nadia BenmansourIk RamPas encore d'évaluation
- Littérature Pré-Question de RechercheDocument7 pagesLittérature Pré-Question de RechercheAhmed Wheatley MouloudiPas encore d'évaluation
- Amenagement MineDocument25 pagesAmenagement MineLucien KelaluPas encore d'évaluation
- DEVOIRDocument3 pagesDEVOIRnadinePas encore d'évaluation
- TD1 CLC Corrigé Séance3Document10 pagesTD1 CLC Corrigé Séance3abdoufifa18Pas encore d'évaluation
- Notice Climatiseur WHIRLPOOL AMD091Document13 pagesNotice Climatiseur WHIRLPOOL AMD091Hatim BenomarPas encore d'évaluation
- Recommandations de Pratique Clinique (Prothèse, Implant, Ostéo-Synthèse)Document107 pagesRecommandations de Pratique Clinique (Prothèse, Implant, Ostéo-Synthèse)Traumaorthopedist tips and tricksPas encore d'évaluation
- Xfs QuotaDocument16 pagesXfs QuotaChristopheProustPas encore d'évaluation
- Benchmarking de Solution de Core Banking - CopieDocument4 pagesBenchmarking de Solution de Core Banking - Copiejonathan duboisPas encore d'évaluation
- Achraf Rim TP 3Document11 pagesAchraf Rim TP 3mohamed mohPas encore d'évaluation
- Expose Jannat ArtsDocument7 pagesExpose Jannat Artsjannatsultana097Pas encore d'évaluation
- S Physique Chimie Obligatoire 2020 Polynesie Remplacement Sujet OfficielDocument15 pagesS Physique Chimie Obligatoire 2020 Polynesie Remplacement Sujet OfficielShahnas HAMITHPas encore d'évaluation
- Géométrie TopologiqueDocument294 pagesGéométrie TopologiqueAlan Joey JeanPas encore d'évaluation
- Commentaire Linéaire La Scène Du BalDocument4 pagesCommentaire Linéaire La Scène Du BalfkuuykfvuPas encore d'évaluation
- Talkwalker Industrie France Love BrandDocument23 pagesTalkwalker Industrie France Love BrandSegaAlainCoulibalyPas encore d'évaluation
- Razafimamonjy Raymond File Sytem Unix Linux Chapter 5 FRDocument50 pagesRazafimamonjy Raymond File Sytem Unix Linux Chapter 5 FRelmamoun1Pas encore d'évaluation
- Introduction À La GT Et RF-2 PDFDocument21 pagesIntroduction À La GT Et RF-2 PDFSaad GhoummidPas encore d'évaluation
- Lexique TICDocument2 pagesLexique TICJessica LabannePas encore d'évaluation
- EX CorrigéDocument4 pagesEX CorrigésaraPas encore d'évaluation
- La Phobie Sociale FR PublicDocument1 pageLa Phobie Sociale FR PublicED-Daaif M'barkPas encore d'évaluation
- Marché ImmoDocument2 pagesMarché ImmoCapt'n ObviousPas encore d'évaluation
- La TélévisionDocument2 pagesLa TélévisionĐặng Việt ĐứcPas encore d'évaluation
- TD 2 Energie Eolienne Cours CeferDocument5 pagesTD 2 Energie Eolienne Cours CeferTSUMBOU100% (1)
- Atelier 2 Indicateurs de Suivi Et de Pilotage 100 Actuaires VFDocument33 pagesAtelier 2 Indicateurs de Suivi Et de Pilotage 100 Actuaires VFIvan BosseyPas encore d'évaluation