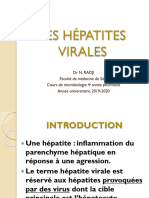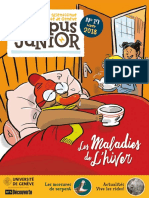Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Chapitre 1v. Stabilité Et Diversification Des Êtres Vivants
Chapitre 1v. Stabilité Et Diversification Des Êtres Vivants
Transféré par
carodream555Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 1v. Stabilité Et Diversification Des Êtres Vivants
Chapitre 1v. Stabilité Et Diversification Des Êtres Vivants
Transféré par
carodream555Droits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 1 : Stabilit et diversification des tres vivants I. Stabilit du caryotype au cours des gnrations successives.
Tous les individus dune mme espce (sauf anomalie) possdent le mme nombre de chromosomes. Les chromosomes peuvent tre classs par paire (mme taille, mme position du centromre et mme coloration). Les 2 chromosomes dune mme paire sont appels chromosomes homologues, ils portent les mmes gnes mais pas ncessairement les mmes allles. Au cours de la reproduction sexue, il y a donc conservation du nombre de chromosomes caractristique de lespce. Comme cette reproduction sexue correspond lunion de 2 cellules reproductrices, il faut quil y ait, un moment au cours de la reproduction une rduction du nombre de chromosomes. A. Des cellules haplodes ou diplodes. Il existe 2 grands types de cellules : - des cellules qui ont 2 exemplaires de chacun de leurs chromosomes : on les qualifie de cellules diplodes. Il sagit de toutes les cellules de lorganisme (cellules somatiques) sauf les gamtes. - des cellules qui nont quun seul exemplaire de chacun de leur chromosome : on les qualifie de cellules haplodes. Il sagit des cellules reproductrices (gamtes) Si on reprsente par n le nombre de chromosomes diffrents dune cellule, on peut crire la formule chromosomique dune cellule : - 2n pour les cellules diplodes - n pour les cellules haplodes Au cours de la reproduction sexue, 2 mcanismes complmentaires se succdent et assurent une stabilit du caryotype de gnration en gnration (en permettant le passage de cellules diplodes des cellules haplodes puis de cellules haplodes des cellules diplodes) : la miose et la fcondation. - La miose produit des cellules haplodes (gamtes) partir dune cellule diplode. - La fcondation rtablit la diplodie en crant une cellule uf qui possde 2 exemplaires de chacun de leurs chromosomes. B. La miose. Avant la miose se produit une interphase au cours de laquelle il y a rplication de l'ADN, la miose touche donc des cellules diplodes aux chromosomes dupliqus (= deux chromatides par chromosome). La miose est un ensemble de 2 divisions successives qui partir dune cellule diplode donne naissance 4 cellules haplodes.
1re division miotique ou division rductionnelle :
Elle se divise en plusieurs phases : prophase I (= prophase de 1re division) - les chromosomes sindividualisent (se condensent) - les chromosomes homologues se rapprochent et s'accolent sur toute leur longueur, on parle dappariement. Cet appariement, trs troit se ralise au niveau des chiasmas qui sont des points d'enchevtrement. - l'enveloppe nuclaire disparat : la division cellulaire occupe alors tout le volume cellulaire. - Le fuseau de division se met en place. 1/9
mtaphase I (= mtaphase de 1re division) Les chromosomes homologues salignent l'quateur du fuseau de division ou plaque quatoriale ; les chromosomes homologues sont fixs sur les fibres du fuseau de division par leurs centromres. anaphase I (= anaphase de 1re division) les 2 chromosomes homologues de chaque paire se sparent (sans division des centromres, au contraire de la mitose) et donc sans sparation des chromatides : chaque chromosome homologue form de 2 chromatides migre alatoirement vers l'un des ples du fuseau. Il y a sgrgation des homologues, les cellules formes nauront plus quun reprsentant de chaque paire de chromosomes homologues : elles seront donc haplodes. tlophase I (= tlophase de 1re division) : gnralement rduite. - les chromosomes ne se dcondensent pas - une enveloppe nuclaire commence se former autour des 2 lots haplodes de chromosomes 2 chromatides (mais cette membrane reste l'tat d'bauche). - le cytoplasme se divise et il se forme deux cellules haplodes. La premire division miotique est qualifie de division rductionnelle car elle conduit la sparation des chromosomes homologues et donc la rduction de la moiti du nombre de chromosomes. Lors de la 1re division de la miose, une cellule mre 2n chromosomes 2 chromatides --> 2 cellules filles n chromosomes 2 chromatides. La 2me division miotique ou division quationnelle. Cette seconde division se droule immdiatement aprs la 1re ,il ny a pas de rplication, les chromosomes tant dj dupliqus. Cette seconde division se droule comme une mitose classique, les 2 chromatides de chaque chromosome se sparent par rupture du centromre. Lors de la 2me division de la miose, les deux cellules-filles n chromosomes 2 chromatides --> 4 cellules n chromosomes 1 chromatide. Bilan :
division division quationnelle rductionnelle 1 cellule 2 cellules 4 cellules 2n chromosomes n chromosomes n chromosomes 1 chromatides 2 chromatides 2 chromatides
M IOS E
La miose permet la formation partir dune cellule diplode aux chromosomes doubles (forms de 2 chromatides) de 4 cellules-filles haplodes aux chromosomes simples (non dupliqus = une chromatide par chromosome). Complter graphique volution quantit dADN en reprsentant lvolution dune paire de chromosomes homologues : Avant la miose, la quantit dADN est double grce la rplication de lADN lors de la phase S de linterphase. La cellule est diplode et ses chromosomes sont doubles : 2 chromatides. 2/9
A la fin de la premire division, les homologues ont t spars dans les 2 cellules filles et donc la quantit dADN est divise par 2. Les 2 cellules formes sont alors haplodes. A la fin de la deuxime division, la quantit dADN par cellule est nouveau divise par 2 de part la sparation des chromatides lors de lanaphase. Au cours de la miose, la quantit dADN et donc divise par 4 tandis que dune cellule diplode on passe 4 cellules haplodes C. La fcondation. La fcondation permet le passage de la phase haplode la phase diplode. Elle correspond la fusion de 2 gamtes haplodes (un gamte mle et dun gamte femelle), conduisant la formation dune cellule uf diplode ou zygote. Chez la plupart des animaux, les spermatozodes s'approchent de lovule, les membranes dun spermatozode fusionnent avec celle de l'ovule, ce qui permet le passage du noyau du spermatozode dans le cytoplasme de l'ovule. Les 2 noyaux, mle et femelle, se rapprochent et fusionnent, cest la caryogamie qui marque la fin de fcondation. La cellule uf obtenue comporte 2 exemplaires de chaque chromosome (qui portent les mmes gnes mais pas les mmes allles), cest une cellule diplode. La fcondation est suivie dune rplication de lADN qui reforme la 2me chromatide de chaque chromosome. La cellule uf pourra alors se diviser par mitoses pour former le ftus. II. Mcanismes de diversification des tres vivants. En 1S, nous avons vu que les mutations (modification rare et alatoire de la squence de nuclotides dun gne) tait source de diversit. Les mutations ne suffisent pas elles seules expliquer la biodiversit que lon peut observer sur Terre. Quels autres mcanismes crent de la diversit ? A. Mcanismes gntiques. 1. Les brassages gntiques lis la reproduction sexue (miose et fcondation). Les 2 chromosomes dune mme paire possdent les mmes gnes mais pas ncessairement les mmes allles, ils sont donc gntiquement diffrents. Pour comprendre la diversit gntique des individus issus de la reproduction sexue, il faut pouvoir tudier la rpartition des chromosomes homologues (donc des allles quils portent) dans les gamtes. Il faut donc connaitre les gnotypes des parents et les gnotypes des descendants. a. Intrt des croisements tests dans ltude des brassages gntiques. Un organisme diplode possde 2 exemplaires de chaque gne. Pour un gne donn, lindividu peut : - possder 2 allles identiques de ce gne : on dit quil est homozygote. Dans ce cas, le phnotype rsulte de lexpression de lunique allle prsent. La simple observation du phnotype permet de connaitre le gnotype. - possder 2 allles diffrents de ce gne : on dit quil est htrozygote. Dans ce cas : le phnotype peut rsulter de lexpression dun seul des 2 allles, lallle dominant. Lautre allle est qualifi de rcessif. Ex : (A//O) lallle A est dominant, cest lui qui sexprime et le phnotype est [A] le phnotype peut rsulter de laction conjointe des 2 allles, on parle alors de codominance. Ex : (A//B) A et B sont codominants, ils sexpriment tous les 2 et le phnotype est [AB] 3/9
Dans le cas dun organisme diplode, un mme phnotype peut donc correspondre diffrents gnotypes. Ex le [A] peut correspondre aux gnotypes (A//A) ou (A//O). Dans le cas dun phnotype dominant, la simple observation du phnotype de lindividu ne permet donc pas toujours de connatre le gnotype. Comment connatre le gnotype dun organisme diplode de phnotype dominant ? Chez les animaux, on ralise des croisements tests ou test-cross qui consistent croiser lindividu de phnotype dominant tester avec un homozygote rcessif (donc dont on connait le gnotype). Si la descendance est homogne, lindividu test est homozygote, si elle est htrogne alors il est htrozygote. Le croisement test permet de connatre le gnotype des gamtes de lindividu que lon teste. Rq : On utilise des espces qui se reproduisent rapidement comme les drosophiles. Chez lhomme, il faut utiliser des arbres gnalogiques et procder par dduction. Rq : Par convention, le gnotype scrit ( ), les 2 allles sont spars par // symbolisant les 2 chromosomes homologues. Le phnotype scrit [ ] b. Un brassage intra-chromosomique. Cf TP 2 : analyse de rsultats de croisements raliss chez la drosophile pour comprendre la transmission de caractres cods par des gnes situs sur le mme chromosome. En prophase de la premire division miotique, des changes de portions de chromatides se produisent entre les 2 chromosomes homologues dune mme paire lorsque ceux-ci sont troitement apparis au niveau des chiasmas. Ces phnomnes appels crossing over (ou enjambement) modifient les associations dallles ports par chacun des chromosomes homologues (les 2 chromatides surs ne portent plus les mmes allles) : on parle de brassage intra chromosomique. Ce brassage intra chromosomique ne concerne que les gnes lis cest--dire les gnes situs sur un mme chromosome. Chez les individus htrozygotes, les crossing over sont lorigine de gamtes recombins. Les crossing over tant des phnomnes rares et alatoires, les gamtes recombins sont moins nombreux que les gamtes parentaux.
c. Un brassage inter-chromosomique. Lors de lanaphase de la premire division miotique, les 2 chromosomes homologues de chaque paire se sparent et migrent chacun vers lun des ples de la cellule. Lanalyse de croisements raliss chez la drosophile (les diffrents gamtes sont produits dans des proportions quiprobables) montre que cette 4/9
sparation est alatoire et indpendante pour chaque paire (il y a autant de chance pour quun chromosome dune paire se retrouve avec lun ou lautre des chromosomes dune autre paire).
Il existe donc de trs nombreuses associations possibles de chromosomes lorigine dune grande diversit de gamtes (2n cest--dire 223 combinaisons chez lhomme (+ de 8 millions !!). On parle de brassage inter chromosomique. Comme ce brassage inter chromosomique sapplique sur des chromosomes dj remanis par le brassage intra chromosomique, la miose permet de crer une diversit quasi infinie de gamtes. d. Un brassage li la fcondation. La fcondation runit au hasard un gamte mle et un gamte femelle. Nimporte quel spz peut sunir avec nimporte quel ovule. Le nombre dassortiments chromosomiques possibles pour le zygote (cellule uf) est lev la puissance de 2. Si on ne tient pas compte du brassage intra chromosomique dans lespce humaine : le nombre de cellules ufs possibles lors dune reproduction sexue entre 2 individus est : 223 x 223 = 246. Si on tient compte du brassage intra chromosomique, le nombre de combinaisons possibles est bien suprieur. Le gnticien Andr Langaney estime que le nombre de cellules ufs potentiellement diffrentes dpasse le nombre estim de particules existant dans lunivers !!! La reproduction sexue est donc lorigine dun paradoxe : elle permet la stabilit de lespce en maintenant de gnrations son caryotype tout en tant lorigine de la variabilit des individus au sein de lespce en brassant les allles. 2. Consquences danomalies au cours de la miose. a. Des anomalies du caryotype. Dans lespce humaine, on connat des caryotypes prsentant des anomalies dans le nombre des chromosomes. Comme par exemple des trisomies (trois exemplaires du mme chromosome) ou des monosomies (chromosome prsent en un seul exemplaire dans une cellule diplode). Lanomalie la plus frquente est la trisomie 21, elle est associe de nombreux signes cliniques qui constituent le syndrome de Down. Ces anomalies graves montrent bien limportance du maintien de lintgrit du caryotype au cours des gnrations. Ces anomalies sont souvent dues une mauvaise sparation des chromosomes au cours de la miose. (les 2 chromosomes homologues peuvent aller dans la mme cellule lors de la 1re division miotique ou les 2 chromatides dun mme chromosome peuvent aller dans le mme gamte lors de la 2me division miotique)
5/9
En effet, une non-disjonction de 2 chromosomes homologues au cours de la miose peut aboutir la formation de gamtes contenant un chromosome surnumraire (21 par exemple) ou au contraire un gamte auquel il manque un chromosome. Aprs la fcondation, on obtiendra la formation dune cellule uf trisomique (possdant 3 chromosomes au lieu de 2) ou monosomique (ne possdant quun seul chromosome au lieu de 2). schma En fait, il existe dautres trisomies qui apparaissent au cours de la reproduction mais elles ne sont pas compatibles avec la vie et provoquent la mort du ftus. La trisomie 21 est compatible avec la vie et elle est donc pour cela plus visible . b. Un enrichissement du gnome. Des appariements incorrects entre chromosomes homologues lors de la prophase I peuvent conduire des crossing over ingaux ou lune des chromatides dun chromosome porte un gne en 2 exemplaires alors que lune des chromatides de son homologue a perdu ce gne.
Si le gamte qui porte les 2 copies est utilis lors de la fcondation, ces 2 copies seront transmises la descendance et pourront voluer indpendamment lune de lautre en accumulant des mutations diffrentes. On peut ainsi obtenir, avec le temps, 2 gnes diffrents qui codent pour des protines diffrentes. Ces 2 gnes prsenteront nanmoins de nombreuses ressemblances et formeront une famille multignique (ensemble de gnes qui ont au moins 20 % de leur squence en commun). Plus le % de ressemblances est important, plus la duplication est rcente. Ces crossing over anormaux sont ainsi lorigine des duplications de gnes et permettent un enrichissement (le nombre de gnes augmente) et une diversification du gnome (apparition de gnes diffrents qui codent pour des protines diffrentes). Ex : les opsines et rhodopsine. Rq : des crossing over peuvent galement se produire entre chromosomes non homologues et permettre la duplication transposition dun gne sur un autre chromosome. 3. Modifications de lexpression des gnes. a. Les gnes du dveloppement. Certains gnes sont impliqus dans la mise en place des plans dorganisation des tres vivants (ex : les gnes homotiques qui dterminent la mise en place des organes selon laxe antro-postrieur). De tels gnes sont des gnes dits architectes car ils permettent la synthse de protines qui contrlent (activent et inhibent) lexpression de nombreux autres gnes. Ainsi, un seul gne peut contrler la mise en place de lil de drosophile qui ncessite pourtant lintervention de plus de 2500 gnes diffrents ! Ces gnes se retrouvent chez tous les animaux et prsentent de fortes homologies de squences qui montrent quils drivent dun mme gne ancestral. b. Modification de lexpression des gnes du dveloppement. 6/9
Les mmes gnes du dveloppement peuvent tre prsents chez diffrentes espces mais le territoire dexpression, lintensit dexpression et la chronologie ou la dure dexpression de ces gnes varient dune espce lautre. Ces modifications dexpression de gnes peuvent conduire des diffrences morphologiques importantes chez des espces pourtant gntiquement trs proches. Ex : modifications du territoire dexpression : - absence de patte chez le serpent - modification de la zone dexpression du gne du dveloppement hox D13 : chez le poisson zbre, il sexprime la base du bourgeon qui formera le membre => formation dune nageoire ; chez les mammifres, ce gne sexprime dabord la base puis vers lavant => formation dune main avec des doigts. Ex : modification de lintensit dexpression dun gne du dveloppement : - lintensit (et la dure) dexpression du gne bmp4 chez lembryon dtermine la taille du bec chez les pinsons des Galapagos Ex : modification de la chronologie ou de la dure dexpression dun gne du dveloppement (= htrochronie) : La dure des diffrentes phases du dveloppement peut tre modifie, certaines phase peuvent se prolonger alors que dautres peuvent ne plus se manifester. Ainsi certaines espces peuvent conserver ltat adulte des caractres juvniles. - ex des canids qui prsentent une grande diversit de morphologie alors quil y a trs peu de diffrences gntiques au sein de ce groupe. Ces modifications rsulteraient de variation de la dure ou de lintensit de certains gnes du dveloppement - ex chez les cervids : persistance de caractres juvniles chez le cerf de crte - ex chez les oursins : le rostre plus long est d une acclration des 2 premires phases du dveloppement. Rq : ce sont les squences dADN qui rgulent lexpression des gnes qui sont modifies. 4. Hybridation suivie de polyplodisation (= association de gnomes) Certaines espces dites polyplodes correspondent lassociation de plusieurs gnomes. Ils se caractrisent par un nombre anormalement lev de chromosomes (3n, 4n, ). Diffrents mcanismes peuvent tre lorigine de cette polyplodie. Par ex, chez les vgtaux, il arrive frquemment, que des individus appartenant des espces diffrentes puissent se reproduire entre eux. Lindividu issu de cette reproduction est un hybride qui est gnralement strile (les chromosomes issus des 2 parents ne sont pas homologues, ils ne peuvent pas sapparier et la miose est impossible). Si un vnement accidentel de doublement des chromosomes suit une hybridation (mitose ou miose anormale), chaque chromosome retrouve un homologue. La miose redevient possible et la fertilit est rtablie. Ainsi, par la combinaison dau moins 2 gnomes existants (ayant pour origine la mme espce ou des espces diffrentes), de nouvelles espces apparaissent. Elles prsentent des combinaisons originales et donc des caractristiques nouvelles propres, de la diversification a donc t gnre. Les vnements de polyplodisation ont t relativement courants dans le monde vgtal (70 % des angiospermes ont eu au moins un pisode de polyplodie au cours de leur histoire volutive) mais existe aussi dans le rgne animal (mme si ils sont beaucoup plus rare). Un exemple: lhistoire des spartines (genre Spartina, Poace) : Jusqu la fin du XIXe sicle une seule espce de Spartine connue en Europe : Spartina maritima (2n = 60) 1829 : premire observation en Angleterre de lespce dAmrique du Nord : Spartina alterniflora (2n = 62) 1870 : un hybride strile (2n = 61) est dcouvert en Angleterre, il est nomm Spartina x townsendii 7/9
1892 : un hybride fertile (2n = 122) est dcouvert, il est nomm Spartina anglica. Lhybride possde en double 30 chromosomes de maritima et 31 chromosomes dalterniflora. Lespce hybride se rpand : niche cologique plus large que les parents. Il est reproductivement isol des espces parentes. 5. Transfert horizontaux de gnes. Un gne peut tre transfr dun individu un autre (sans reproduction), que ce dernier appartienne la mme espce ou non on parle de transferts horizontaux de gnes (par opposition aux transferts verticaux des parents aux descendants) Plusieurs mcanismes permettent de tels transferts : - Intgration par une cellule dun ADN libre dans le milieu - Transfert par voie virale : Lorsquun virus infecte une cellule, il libre sont matriel gntique dans le cytoplasme de cette cellule, ce matriel gntique va alors sintgrer au gnome de la cellule hte qui va le rpliquer et produire des protines et de lARN viral permettant ainsi la production de nouveaux virus. Lors de la production de ces particules virales par la cellule hte, il est possible quun ou plusieurs gnes de cette cellule hte sintgre au gnome du virus. Si un tel virus infecte un autre organisme, il pourra alors transmettre ces gnes ce nouvel organisme. Quelque soit le mcanisme impliqu, lindividu receveur subit une modification de son gnome et son phnotype peut tre modifi. Les transferts de gnes entre espces diffrentes participent donc la diversification du vivant. On estime que 10 % du gnome humain serait dorigine virale (50 % chez le mas) Rq : Ces transferts horizontaux peuvent tre mis en vidence par la lexistence darbres phylogntiques contradictoires raliss partir de molcules diffrentes. Si ces arbres ne sont pas cohrents, il faut admettre quils ne racontent pas la mme histoire volutive (la proximit gntique de certaines espces peut tre due un transfert horizontal de gne(s). B. Mcanismes non gntiques 1. Symbiose. Une symbiose est une association durable et bnfices rciproques entre 2 espces diffrentes. Cette association peut crer de la diversit de diffrentes manires : - en crant des diffrences morphologiques entre les individus : Ex 1 : la symbiose entre les fourmis champignonnistes et les champignons : les fourmis cultivent des champignons dans leur fourmilire et les taillent laide de leurs mandibules. Cette taille favorise le dveloppement des champignons et provoque lapparition de boules riches en sucres et en protines dont les fourmis se nourrissent. Ces boules ne se dveloppent pas lorsque le champignon pousse en absence de fourmi. Ex 2 : symbiose entre le trfle et des bactries du genre Rhizobium. Les bactries bnficient des sucres produits par la plante ce qui favorise leur prolifration et la bactrie fixe lazote atmosphrique qui favorise la croissance de la plante => modification morphologique du vgtal. Ex 3 : Les mycorhizes, associations symbiotiques entre un champignon et les racines dune plante. Le champignon, grce son rseau de myclium transfert leau et les ions minraux la plante et le vgtal 8/9
fournit au champignon les glucides quil a fabriqu par photosynthse => croissance plus importante des 2 partenaires. - en modifiant le mtabolisme des individus (synthse de nouvelles substances) : Ex 1 : le lichen qui correspond une symbiose entre une algue verte et un champignon. Le champignon capte les eaux de pluie et les ions minraux qui sont utiliss par lalgue et lalgue fournit des substances organiques au champignon. Les 2 partenaires participent la synthse dacide lichenique qui donne leur couleur et leur toxicit aux lichens. Cet acide ne pourrait pas tre produit en dehors de lassociation. - en modifiant le comportement des individus : Ex : symbiose entre une anmone de mer et une algue verte. Les anmones de mer vivant en symbiose avec les algues se dplacent vers la lumire. Rq : lhomme vit en association symbiotique avec des bactries qui peuplent notre tube digestif et nous permettent de digrer certains aliments => modification du rgime alimentaire. Idem pour les vaches qui ne peuvent digrer lherbe que grce aux micro-organismes qui peuplent son tube digestif. CCl : Ces associations symbiotiques sont source de diversit en confrant aux organismes de nouveaux caractres (morphologie diffrente, synthse de nouvelles molcules, modification de comportement) sans modifier leur information gntique. 2. Transmission culturelle des comportements. Des comportements peuvent se transmettre de gnration en gnration par apprentissage ou par imitation (donc par voie non gntique). Ex : - Le chant des oiseaux : les pinsons possdent un embryon de chant inn qui va devenir progressivement par imitation et apprentissage un chant structur avec des notes, variations et squences. (le chant est important pour la reproduction car les femelles choisissent les mles en fonction de leur chant. Il est galement important pour linstallation des pinsons sur un territoire, les pinsons sont chasss si leur chant diffre trop de celui des pinsons de la rgion) - utilisation doutil par les chimpanzs => importance pour la slection naturelle - Construction des barrages par les castors : les barrages sont tous btis sur un mme schma de construction (part de linn) mais lemplacement des barrages, le creusement des canaux servant transporter le bois parfois sur des centaines de mtres diffrent selon les populations de castor (apprentissage et imitation) Il existe donc de nombreux mcanismes de diversification des tres vivants qui enrichissent la biodiversit et jouent un rle important dans les mcanismes de lvolution.
9/9
Vous aimerez peut-être aussi
- La Clé de Votre Énergie de Natacha CalestremeDocument231 pagesLa Clé de Votre Énergie de Natacha CalestremeNathalie Louette94% (142)
- TP1. L'atmosphère PrimitiveDocument11 pagesTP1. L'atmosphère Primitivecarodream555Pas encore d'évaluation
- 1cours MACHUEL No1Document6 pages1cours MACHUEL No1carodream555Pas encore d'évaluation
- 3cours Machuel 3Document8 pages3cours Machuel 3carodream555Pas encore d'évaluation
- La LiberteDocument8 pagesLa Libertecarodream555Pas encore d'évaluation
- PrimitivesDocument1 pagePrimitivescarodream555Pas encore d'évaluation
- Dossier Thierry Machuel - Les Oeuvres Au ProgrammeDocument17 pagesDossier Thierry Machuel - Les Oeuvres Au Programmecarodream555Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1. Réaction InflammatoireDocument5 pagesChapitre 1. Réaction Inflammatoirecarodream555Pas encore d'évaluation
- Methode de Diagnostic 10Document55 pagesMethode de Diagnostic 10MACON824100% (1)
- Aplasies Médullaires AcquisesDocument13 pagesAplasies Médullaires AcquisessifessalamPas encore d'évaluation
- Atlas de Poche - MicrobiologieDocument317 pagesAtlas de Poche - Microbiologieapi-2608145094% (18)
- Manuel HCB 2014Document212 pagesManuel HCB 2014azizPas encore d'évaluation
- Microfloredulaitcru RMT juillet2011BDDocument134 pagesMicrofloredulaitcru RMT juillet2011BDCendrey Grace KoutoumaPas encore d'évaluation
- Questions FréquentesDocument19 pagesQuestions Fréquentesparide ulissePas encore d'évaluation
- Copie de Cours de Biosécurité II1Document40 pagesCopie de Cours de Biosécurité II1Med MohamedPas encore d'évaluation
- Mddep Ca Guide Production Eau Potable Vol2 PDFDocument268 pagesMddep Ca Guide Production Eau Potable Vol2 PDFYASSINE EL HAOURIPas encore d'évaluation
- Hépatite Pharmacie DR RadjiDocument72 pagesHépatite Pharmacie DR RadjiJuvet KAMDEMPas encore d'évaluation
- Met - 3Document49 pagesMet - 3مريم البتولPas encore d'évaluation
- Dass-NC Depliant AntibiotiquesDocument2 pagesDass-NC Depliant AntibiotiquesFrançoise Tromeur100% (1)
- Exemple Sujet Examen QCM Virologie 01-2019Document14 pagesExemple Sujet Examen QCM Virologie 01-2019Djakos TRAOREPas encore d'évaluation
- Projet de Fin Etude CompletDocument79 pagesProjet de Fin Etude CompletKhaoula DAMANEPas encore d'évaluation
- Campus Junior 17Document28 pagesCampus Junior 17Leandro Lisowiec SonclairePas encore d'évaluation
- Bio CellDocument23 pagesBio Cellkouki samarPas encore d'évaluation
- Eb 6 2580 2019-2020 25Document4 pagesEb 6 2580 2019-2020 25Mahouzonsou BONOUPas encore d'évaluation
- Vaccins Et SerumsDocument7 pagesVaccins Et SerumsalmnaouarPas encore d'évaluation