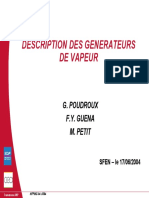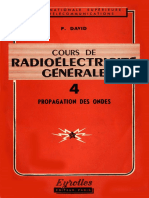Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Categorisation Des Objets Natureles Descola 2004-2005
La Categorisation Des Objets Natureles Descola 2004-2005
Transféré par
llerenasCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Categorisation Des Objets Natureles Descola 2004-2005
La Categorisation Des Objets Natureles Descola 2004-2005
Transféré par
llerenasDroits d'auteur :
Formats disponibles
Anthropologie de la nature
M. Philippe DESCOLA, professeur
Sous lintitul la catgorisation des objets naturels , le cours portait sur les
oprations didentification et de classement des lments de lenvironnement
organique, la faune et la flore au premier chef, envisages de faon comparative,
cest--dire du point de vue des critres que les socits les plus diverses
emploient afin de rpartir plantes et animaux dans des catgories stables. On
sest donc intress pour lessentiel ce que lon appelle traditionnellement les
classifications populaires (folk-taxonomy en anglais), sans sinterdire pour
autant des incursions dans le domaine de la systmatique savante, celle-ci pouvant
tre considre par le comparatiste comme une forme parmi dautres de classifi-
cation populaire dont certains auteurs estiment dailleurs quelle rpond au mme
mcanisme que toute classification ethnobiologique, savoir une propension
inne attribuer aux espces naturelles une essence causale qui rendrait compte
de leur permanence dans le temps (cf. S. Atran, A. Wierzbicka ou S. Pinker). Le
cours a toutefois port principalement sur les classifications ethnobiologiques
des socits sans criture, lesquelles prsentent une bien plus grande diversit
de principes classificatoires combins que ceux exploits par la systmatique
savante, offrant ainsi ltude de la catgorisation une richesse de matriaux
fort stimulante.
Plusieurs raisons conduisaient privilgier la catgorisation des objets naturels
plutt que celle portant sur dautres types dobjet. En premier lieu, aucun autre
domaine, hormis celui des couleurs, na autant retenu lattention des recherches
comparatives, et suscit autant de travaux empiriques, les dbats qui se sont
dvelopps ce propos tant transposables aux problmes que soulve ltude
de la catgorisation en gnral. En second lieu, la catgorisation des objets
naturels semble possder certaines caractristiques propres, notamment le fait
quelle se prsente souvent sous une forme taxinomique, cest--dire avec une
hirarchie dinclusions plusieurs rangs, ce qui est beaucoup plus rarement le
cas dans dautres domaines dobjet, tels les motions ou les artefacts. Il est
possible aussi, bien que cela soit encore controvers, que la perception et la
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:06 Imprimerie CHIRAT
428 PHILIPPE DESCOLA
distribution taxinomique des objets naturels soient actives par un dispositif
cognitif spcifique correspondant ce que les psychologues du dveloppement
appellent une thorie nave, cest--dire un schme dinfrence prsum universel
structurant les attentes de tout individu quant aux caractristiques et au comporte-
ment des organismes. Enfin, et dans la mesure o la plus grande partie de
lhistoire des humains sest droule dans le contexte dune interaction intime et
permanente avec les plantes et les animaux, il nest pas illgitime de penser que
lactivit cognitive a t modele en profondeur par cette exprience. De ce fait,
les objets naturels constituent un domaine de choix pour examiner la validit
des thories concurrentes de la catgorisation, en particulier celles qui privilgient
une classification par similitude dattributs reconnaissance de covariation de
traits , celles qui font primer linfrence causale schmes de la transmission
de caractres identiques par la reproduction ou de la complmentarit des sys-
tmes fonctionnels ncessaires la vie, par exemple ou celles qui mettent
laccent sur la classification prototypique. Lhypothse que lon souhaitait explo-
rer lors du cours tait que ces thories ne sont pas exclusives lune de lautre et
que, pour ce qui est du domaine des objets naturels du moins, des mcanismes
tout fait diffrents de catgorisation et de raisonnement catgoriel sont mis en
uvre en fonction des contextes classificatoires, des niveaux de gnralit viss
et des usages auxquels ces classifications sont destines.
Que recouvre en effet la rubrique de la catgorisation des objets naturels ?
Pour lessentiel trois types de systmes de classification quil importe de distin-
guer, mme sil arrive parfois quon les trouve combins. Le plus commun, a
tout le moins celui sur lequel lethnobiologie a concentr la plus grande part de
son attention au cours des cinquante dernires annes, est la taxinomie hirar-
chique aboutissant des nomenclatures arborescentes de plantes et danimaux
comportant au moins deux rangs. Le deuxime type de systme est celui des
classifications par grandes classes contrastives que lon qualifie gnralement
dutilitaires et quil vaudrait mieux dfinir comme pragmatiques ou motives,
dans la mesure o les critres dinclusion font gnralement rfrence une
proprit qui nest pas intrinsque lobjet class mais qui dpend dune caract-
ristique relle ou imaginaire que lobservateur lui prte en fonction des usages
matriels ou idels auquel il le destine. A ` la diffrence des taxinomies, ces
classifications par classes dattributs ne sont donc pas structurellement hirar-
chiques, mme si la combinaison de plusieurs critres peut aboutir leur
hirarchisation conventionnelle. Si, par exemple, la distinction entre animaux
comestibles et animaux non comestibles peut tre croise avec une distinc-
tion entre animaux terrestres et animaux aquatiques , il nexiste pas, comme
cest le cas dans les classifications taxinomiques, de prsance logique dun
critre sur lautre : un animal class comme comestible peut tre terrestre de
faon subsidiaire ou vice versa. La hirarchisation est ici entirement pragma-
tique. Le troisime type de systme est celui des classifications que lon pourrait
appeler cosmologiques en ce quelles incluent des objets naturels dans des classi-
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:06 Imprimerie CHIRAT
ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE 429
fications plus englobantes o ces objets sont associs des entits relevant
dautres classes ontologiques (pour les Occidentaux modernes, du moins), tels
des orients, des groupes sociaux, des fonctions ou des couleurs. Il sagit dune
sorte dextension du type de classification prcdent qui prend la forme dun
tableau dattributs dans lequel linclusion est gouverne moins par une multiplica-
tion de critres que par un raisonnement analogique du genre A : B :: A : B.
Dans lexemple classique de la classification cosmologique zuni (Cushing, 1896),
les tres et les phnomnes naturels sont classs par orients il y en a sept
en mme temps que les couleurs et une demi-douzaine dautres rubriques : si la
grue est au nord, le blaireau au sud, lours louest, le daim lest, etc., et si,
de faon parallle, le jaune est au nord, le rouge au sud, le bleu louest, le
blanc lest, etc., alors il est loisible de dire que la grue est au blaireau comme
le jaune est au rouge, comme le nord est au sud, etc.
Or, lexception notable de Cl. Lvi-Strauss (La Pense sauvage, 1962),
lanthropologie a eu tendance aborder en ordre dispers ces trois modes de
catgorisation des objets naturels, soit parce quelle ngligeait de les considrer
ensemble, soit parce quelle prenait lun dentre eux comme le paradigme des
deux autres. Les dbats internes lethnobiologie illustrent bien la premire
tendance : ils opposent une perspective intellectualiste et universaliste visant
isoler des universaux dans les classifications ethnobiologiques une perspective,
souvent taxe dutilitariste par la premire, qui sattache dgager les multiples
critres au moyen desquels chaque socit structure ses classifications de la faune
et de la flore. Les avocats de la premire position mettent en avant ce quil y a
de commun tous les hommes dans leur faon de classer les objets naturels et ne
sintressent en consquence quau premier type de catgorisation, la taxinomie
hirarchique, tandis que les dfenseurs de la deuxime position sont concerns
en priorit par la part de crativit que chaque culture introduit dans la perception
et lorganisation de son environnement, et sintressent donc avant tout au
deuxime mode de catgorisation, celui qui met en uvre des critres de type
pragmatique. Mais comme, par-del leurs dsaccords, tous ces auteurs se rcla-
ment dune spcialit disciplinaire, lethnobiologie, qui prsuppose de faon plus
ou moins explicite que lobjet dont elle soccupe, les espces naturelles, est
universellement peru comme un domaine discret, aucun nprouve lenvie de
sortir de ce domaine pour sintresser aux classifications cosmologiques, par
dfinition hybrides sur le plan ontologique. Celles-ci sont donc laisses aux
anthropologues qui sintressent aux dimensions symboliques de la vie sociale,
aux spcialistes du totmisme et des phnomnes religieux. Quant la tendance
rduire les trois modes de catgorisation lun dentre eux seulement, elle est
bien illustre par le clbre essai de Durkheim et Mauss ( De quelques formes
primitives de classification , 1903) dans lequel les auteurs, confronts aux classi-
fications que nous appelons cosmologiques, en infrent non pas tant une diversit
des types de catgorisation que labsence dans la pense dite primitive de catgo-
ries aux contours dfinis, moyen dintroduire la socit et ses divisions internes
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:06 Imprimerie CHIRAT
430 PHILIPPE DESCOLA
comme prototype de toute pense classificatoire. Plutt que de confondre tous
les modes de classification ethnobiologique, ou de les envisager au contraire
comme sils taient tous diffrents en nature, il a donc paru prfrable de traiter
les trois formes de catgorisation des objets naturels comme une sorte de groupe
de transformation, cest--dire comme un systme de variations ordonnes
partir de quelques axes tels le type de savoir concern par un jugement catgoriel,
le type de jugement mis en uvre et le type de mcanisme psychique quil
mobilise.
Reprenant une distinction jadis propose par D. Sperber dans un autre contexte
(Le symbolisme en gnral, 1974), on a commenc par diffrencier les trois
types de catgorisation selon les modes de connaissance quils impliquent : les
taxinomies hirarchiques font appel un savoir smantique, les classifications par
classes contrastives font appel un savoir encyclopdique et les classifications
cosmologiques font appel un savoir symbolique. Le savoir smantique est fini
et porte sur les catgories, cest--dire sur les conditions dinfrence permettant
la subsumption dun objet dans une classe sans faire appel des connaissances
particulires au sujet de cette entit. Tout ce qui est ncessaire pour dire dun
chne quil est un arbre, et dun arbre quil est une plante, cest de connatre
les rapports analytiques dinclusion entre ces trois catgories. Par contraste, le
savoir encyclopdique et le savoir symbolique sont en droit infinis du fait quils
portent sur le monde, le premier de faon directe en spcifiant les connaissances
cumulatives, rvisables, et variables selon les individus, qui se rapportent lobjet
catgoris le chne nest pas la mme chose selon que lon est botaniste,
forestier ou menuisier , le second de faon indirecte, sous la forme de juge-
ments synthtiques au sujet de propositions concernant le savoir encyclopdique,
des noncs qui ne portent ni sur les mots ni sur les choses, donc, mais qui
expriment des croyances formes partir de ce que nous savons des choses
pour dire du chne quil est le roi de la fort, il faut dj en connatre
beaucoup sur le chne.
On a prcis ensuite la manire dont chacun de ces types de savoir est mobi-
lis dans les catgorisations dobjets naturels, en commenant par le savoir
smantique investi dans les taxinomies. Depuis le clbre article de B. Berlin,
D. Breedlove et P. Raven ( General Principles of Classification and Nomencla-
ture in Folk Biology , American Anthropologist 75, 1973), dvelopp ensuite
par Berlin dans une vaste et magistrale synthse (Ethnobiological Classification,
1992), la plupart des spcialistes dethnobiologie saccordent sur le fait que les
taxinomies populaires dobjets naturels possdent partout une structure identique.
Celle-ci sorganise selon une hirarchie inclusive de taxons qui, sous sa forme
la plus complte, comporte six rangs : le plus englobant, le niveau du rgne ,
( plante ou animal ) est rarement nomm et moins encore le niveau
suprieur, que Berlin ne prend pas en compte, et qui ferait rfrence la catgorie
ontologique organisme par contraste avec les objets naturels inorganiques et
les artefacts ; le niveau de la forme de vie dfinit quelques types morpho-
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:06 Imprimerie CHIRAT
ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE 431
logiques hautement distinctifs associs un habitat ou une niche cologique
spcifiques ( arbre , poisson , oiseau , etc.) ; le niveau dit interm-
diaire correspond des subdivisions des formes de vie, parfois non nommes,
qui regroupent un petit nombre de taxons gnriques prsentant de fortes ressem-
blances ( feuillu / conifre ) ; le niveau gnrique peut tre considr
comme le niveau de base, cest--dire celui qui, dans presque toutes les taxino-
mies populaires, compte le plus grand nombre de taxons, la plupart dentre
eux non divisibles (i.e. monotypiques) ; le niveau spcifique constitue une
subdivision de taxons du niveau gnrique ( chne rouvre , chne nain ,
chne vert , etc.) ; le niveau varital , enfin, est le niveau de subdivision
terminal et accueille en gnral des noms de cultivars. Pour la majorit des
spcialistes dethnobiologie, cest ce type de nomenclature taxinomique qui repr-
sente le paradigme de la classification des objets naturels et celui qui, en cons-
quence, retient au premier chef leur attention. On a l une situation un peu
paradoxale puisquil sagit finalement dune architecture assez simple, dont il
peut tre intressant de souligner lventuelle universalit selon Berlin
lhomme ne construit pas des classifications de la faune et de la flore, il les
dchiffre partout dans son environnement de la mme faon , mais dont
ltude nest gure susceptible dclairer les raisons de la diversit culturelle des
modes de catgorisation ethnobiologique l o elle est la plus patente, savoir
dans le registre du savoir encyclopdique.
Et de fait, les dbats contemporains sur les taxinomies ethnobiologiques portent
moins sur leur structure que sur les types de mcanisme psychique que lon
suppose tre la source des jugements dinfrence ou de conformit quelles
mobilisent. En la matire, on peut distinguer grands traits entre deux approches
principales, lune qui met laccent sur la thorie de la prototypicalit dE. Rosch,
cest--dire sur lide que certains membres dun taxon en constituent le proto-
type dans la mesure o ils en seraient perus comme les plus reprsentatifs (cest
la position de Berlin), lautre qui sappuie sur une thorie modulaire de la
cognition inspire de N. Chomski et J. Fodor, et qui postule que, tout comme il
existerait des mcanismes cognitifs spcialiss dans lactivit langagire ou la
reconnaissance des visages, il y aurait des modules spcifiques destins la
reconnaissance et au classement des objets naturels. A ` lintrieur de cette dernire
tendance, il faudrait en outre distinguer entre un point de vue dfendu par
S. Atran selon lequel la smantique des termes despces naturelles est fondamen-
talement diffrente de la smantique des autres domaines dobjet du fait quun
organisme serait toujours conu comme possdant une nature intrinsque rendue
responsable de la permanence de son identit ( la manire de la phusis aristotli-
cienne), et un point de vue alternatif aliment par une branche de la psychologie
du dveloppement (S. Carey, F. Keil) qui repose sur lhypothse que la perception
et la structuration conceptuelle du domaine des objets naturels seraient fondes
sur la constitution ou lactualisation au cours de lontogense dune thorie nave
des proprits des organismes non humains, un point de vue dans lequel se
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:06 Imprimerie CHIRAT
432 PHILIPPE DESCOLA
reconnaissent des auteurs comme D. Sperber ou P. Boyer. Pour intressantes
quelles soient, toutefois, ces thories psychologiques concurrentes ne rendent
pas compte de linclusion hirarchique, pourtant la principale caractristique des
taxinomies ethnobiologiques, ni mme des mcanismes de reconnaissance
luvre dans les rangs suprieurs des classifications du type forme de vie
ou niveau intermdiaire , par exemple dans lesquels la prototypicalit ne
parat gure oprante.
Pour dfinir les proprits des classifications par classes contrastives faisant
appel un savoir encyclopdique, on a utilis lexemple de la classification de
la faune des Montagnais, des Indiens du Qubec parlant une langue de la famille
nord-algonquine (S. Bouchard et J. Mailhot Structure du lexique : les animaux
indiens , Recherches amrindiennes au Qubec 3 (1-2), 1972 et D. Clment,
La Zoologie des Montagnais, 1972). Les trois principaux critres sont ceux qui
portent sur lhabitat opposition entre animal aquatique (nipi.t) et animal ter-
restre (pa.kwa.t) , sur la saison opposition entre animal dt (pupunwe.si.s)
et animal dhiver (ni.panwe.si.s) et sur le mode de locomotion opposition
entre animal dplacement uniforme (marqu par le prfixe -pmpan) et animal
dplacement discontinu (marqu par le prfixe -pmpata). Comme la diffrence
des modes de locomotion ne concerne que les animaux dhiver et que ceux-ci
sont tous des animaux terrestres, la combinaison des trois critres permet dobte-
nir une taxinomie avec une nette inclusion hirarchique trois rangs, de sorte
que la glinotte huppe, par exemple, peut tre subsume sous le taxon animal
dplacement discontinu , lequel peut tre subsum sous le taxon animal
dhiver , lequel peut tre subsum sous le taxon animal terrestre , lequel peut
tre subsum sous le taxon animal indien (innu-awe.hu.h, par contraste avec
les animaux dorigine europenne), lexistence de ce dernier terme faisant dbat
parmi les spcialistes de la zoologie des Montagnais. En ralit, il est hautement
improbable quun informateur montagnais ait une taxinomie de ce type prsente
lesprit lorsquil procde un jugement classificatoire, dautant que rien dans
lethnographie ne permet daffirmer que le critre dhabitat prime sur le critre
de saison, et le critre de saison sur le critre de locomotion. Chacun de ces
critres est utilis dans des contextes dnonciation particuliers de sorte quil est
rare quils puissent tre activs conjointement. Il suffit dailleurs de donner la
prminence au critre du mode de locomotion sur ceux de la saison et de
lhabitat pour constater que les taxons animal dt et animal aquatique
restent dsormais en dehors de linclusion hirarchique, leffet taxinomique tant
ici pour lessentiel le rsultat dun artifice graphique, cest--dire propre aux
cultures lettres, qui conduit privilgier le schma de larborescence ds quil
sagit de reprsenter des enchanements de classements dichotomiques. Il nest
pas impossible pour autant de combiner une structure taxinomique faisant appel
un savoir smantique avec une structure classes contrastives faisant appel
un savoir encyclopdique : le taxon montagnais animal terrestre (du rang
forme de vie ) englobe le taxon ours (de rang gnrique ), lequel
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:06 Imprimerie CHIRAT
ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE 433
englobe deux taxons de rang spcifique , lours noir, un animal dt , et
lours polaire, un animal dhiver . Mais, comme dans le cas prcdent, il est
improbable quune telle combinaison soit active par un informateur loccasion
dun jugement classificatoire. Bref, savoir smantique et savoir encyclopdique
ne sont pas logiquement incompatibles, mais il est rare quils soient simultan-
ment mobiliss dans une opration de classement.
La combinaison entre savoir encyclopdique et savoir symbolique est gale-
ment fort commune puisque le second est issu dune transformation du premier.
Il existe ainsi chez les Montagnais un autre systme de classification des animaux
qui les rpartit dans des domaines (tape.ntamu.n) rgis chacun par un
matre , un esprit qui est dit contrler les espces dont il a la charge, lesquelles
ne peuvent tre chasses sans son assentiment, gnralement obtenu lors des
rves. Certains animaux nont pas de matres (les souris et la classe des petits
oiseaux pine.si.s) et certains matres nont sous leur juridiction quune seule
espce, linstar de ati.hkuna.pe.w, lHomme-Caribou. Toutefois quatre matres
sont la tte de groupes despces prcisment dfinis : missina.kw contrle la
loutre, le castor, le rat musqu, le phoque, le crapaud, la grenouille, la classe
name.s (les poissons), la classe si.si.p (le gibier deau), etc. ; maskw (ours)
contrle lours, la marmotte, la moufette, etc. ; u.huwa.pe.w contrle le porc-
pic, le livre, le corbeau, le harfang des neiges, la chouette pervire, etc. ;
me.me.kwe.si.skwe.w contrle le loup, la martre, le renard, le pcan, le carcajou,
le lynx, lcureuil, le vison, lhermine. Or, les animaux de chaque domaine
rgi par un matre sont caractriss par un ensemble de traits distinctifs organiss
partir des trois critres de lhabitat, de la saison et du mode de locomotion :
missina.kw est le matre des animaux aquatiques (habitat) ; maskw est le matre
des animaux terrestres (habitat) de lt (saison) ; u.huwa.pe.w est le matre
des animaux terrestres (habitat) de lhiver (saison) dplacement discontinu
(locomotion) ; tandis que me.me.kwe.si.skwe.w est le matre des animaux ter-
restres (habitat) de lhiver (saison) dplacement uniforme (locomotion). Savoir
symbolique (sur les matres des animaux) et savoir encyclopdique (sur les attri-
buts des animaux classs selon les trois critres) sont ici mls, les connaissances
zoologiques et thologiques livres par le premier tant mises profit afin de
construire une norme idale des espces comprises dans un domaine . La
distinction entre les trois modes de catgorisation des objets naturels doit donc
tre envisage comme un continuum : pourvu que certaines conditions denqute
soit donnes, il est possible de mettre au jour des taxinomies pures, mais elles
sont combinables en droit avec telle ou telle classification utilitaire faisant
appel un savoir encyclopdique, lequel sert de base aux classifications symbo-
liques qui peuvent par ailleurs se trouver combines des tableaux dattributs
fonds sur un savoir zoologique ou botanique.
On sest ensuite intress non pas au type de savoir auquel les trois modes
de catgorisation se rfrent, mais aux procdures employes dans le jugement
classificatoire. Une certaine confusion rgne ce propos dans les tudes dethno-
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:06 Imprimerie CHIRAT
434 PHILIPPE DESCOLA
science. En effet, beaucoup de psychologues saccordent maintenant penser
que les oprations de catgorisation font appel deux mcanismes distincts, la
classification par attributs et la classification par prototype. La premire tablit
une relation dappartenance une classe par un jugement prdicatif en vertu
duquel les caractres spcifiques reconnus dans un objet quelconque sont la
condition ncessaire et suffisante de lappartenance une classe, tandis que la
seconde invoque une figure exemplaire, le prototype, qui sert de modle focal
la classe, gnralement du fait de son apparence, et forme le support de la
dnomination. Dans le premier cas, on suppose quil existe des primitives sman-
tiques et que la combinaison dun petit nombre dentre elles permet de dfinir
de faon univoque nimporte quel plante ou animal ; dans le second cas, on
suppose quil existe des universaux psychophysiques dans la perception des
espces naturelles de sorte que la nomination ne ferait quentriner la reconnais-
sance dune discontinuit naturelle. Or, les anthropologues qui sintressent aux
classifications ethnobiologiques ont eu tendance dans un premier temps privil-
gier la classification par attributs (dans le cadre de lanalyse dite componen-
tielle ) puis, partir du milieu des annes 1970, ne plus accorder de crdit
qu la classification prototypique (dans le cadre du modle berlinien standard).
Il parat pourtant fort probable que les deux procdures jouent galement un rle
dans la catgorisation des objets naturels, mais dans des types de classification
diffrents et des niveaux diffrents de la hirarchie taxinomique.
Lexamen de lapplication de lanalyse componentielle aux classifications ethno-
biologiques montre son inadquation patente dans ce domaine, raison pour
laquelle ses partisans (notamment F. Lounsbury et W. Goodenough) ont consacr
lessentiel de leurs efforts aux terminologies de parent. Ces dernires ont en effet
pour caractristiques de constituer des nomenclatures matrisables, cest--dire
qui dpassent rarement une trentaine de lexmes, et de pouvoir tre dcomposes
sans peine en primitives smantiques plausibles organisables en fonction du
sexe et du niveau gnrationnel , ce qui permet la constitution de tableaux
paradigmatiques comportant un nombre raisonnable de dimensions contrastives.
La situation est bien diffrente avec les nomenclatures de la faune ou de la flore.
Pour prendre le cas des premires, on sait quelles comportent en moyenne entre
400 et 600 lexmes dans la plupart des socits sans criture, ce qui rend
problmatique la construction dun tableau paradigmatique tel que chaque lexme
serait dfini par une combinaison spcifique de traits. Si lopration est possible
aux niveaux suprieurs des taxinomies, elle devient de plus en plus difficile
mesure que lon descend vers les niveaux infrieurs : un oiseau peut tre
dfini par la possession dun bec et de plumes, un poisson par la possession
de nageoires et dcailles, mais lon imagine la longueur et la complexit des
dfinitions composites ncessaires pour caractriser un taxon de niveau gnrique
ou spcifique, par exemple lune ou lautre de la dizaine despces de fauvettes
reconnues dans la nomenclature populaire franaise. Cest cause de ces diffi-
cults que la tentative danalyser les taxinomies ethnobiologiques au moyen de
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:07 Imprimerie CHIRAT
ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE 435
tableaux de traits contrastifs fut abandonne il y a une trentaine dannes au
profit du modle de la classification prototypique. Mais si celle-ci parat tout
fait vraisemblable au niveau gnrique des taxinomies, il est peu probable quelle
soit employe dans les rangs suprieurs, tels fruit ou oiseau , qui ne sont
pas trs saillants sur le plan perceptif, et cela malgr les tentatives peu convain-
cantes de Rosch pour dceler ce niveau des prototypes artificiels , cest--
dire non dtermins par les proprits intrinsques du monde, ce qui revient
rintroduire de faon paradoxale dans la classification prototypique ce quoi
elle prtendait chapper, savoir le point de vue traditionnel qui envisage les
concepts comme des ralits psychologiques indpendantes des ralits mon-
daines.
` lchelle des taxinomies, de fait, lopposition entre classification prototy-
A
pique et classification par attributs relve dune querelle doctrinale assez vaine.
Car lidentification des discontinuits sappuie, selon les niveaux de la hirarchie,
soit plutt sur la reconnaissance de la prototypicalit (les rgularits morpholo-
giques) soit plutt sur la reconnaissance des complexes dattributs (les rgularits
comportementales et environnementales) chaque fois dans des proportions
variables et sans que lun des mcanismes ne soit jamais compltement limin
au profit de lautre. Si, au niveau gnrique des taxinomies, lidentification est
dclenche par le souvenir gnral de la forme que vient confirmer ou raffiner
le savoir encyclopdique quant certains attributs typiques de lorganisme identi-
fi, aux niveaux suprieurs, en revanche, lidentification se fonde sur quelques
traits distinctifs des taxons, mais qui sont eux-mmes recomposs dans un
ensemble cohrent prsentant bien des caractres dun prototype. Car les attributs
des taxons supragnriques sont rarement indpendants les uns des autres, le fait
quils soient mmorisables sans peine venant de ce quils se prsentent comme
des systmes de corrlats fortement intgrs : les animaux plumes possdent
en gnral des ailes et un bec, et sont capables de voler. De mme, la typicalit
du membre prototypique dun taxon de niveau gnrique vient en partie du fait
quil reprsente le plus haut degr de corrlation et de prdictibilit des attributs
au sein de la catgorie.
Dans les classifications utilitaires faisant appel un savoir encyclopdique,
par contre, ce nest pas la morphologie, base de la prototypicalit, qui sert de
critre discriminant, mais bien des classes contrastives dattributs. On est revenu
au cas de la classification montagnaise de la faune pour en apporter une illustra-
tion. La catgorisation des animaux par la saison sopre partir des noncs
des informateurs questionns au sujet des murs despces particulires du
type le loup il est en t et en hiver ou le castor lhiver il est l en
dessous , tant entendu que cest lhiver qui constitue le critre discriminant
de la rpartition des espces selon les saisons. En effet, les animaux dhiver
sont capables daffronter le froid et supportent aussi lt, tandis que les animaux
dt disparaissent lhiver soit parce quils hibernent soit parce quils migrent.
Il est possible partir de ce principe de construire un tableau paradigmatique
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:07 Imprimerie CHIRAT
436 PHILIPPE DESCOLA
gnral de la faune en utilisant des traits contrastifs trs simples ( hiver + ici
et hiver + pas ici ) qui a le mrite, non seulement de possder une certaine
vraisemblance psychologique, mais aussi de correspondre des ralits perues
et utilises de faon explicite dans la culture locale. Rajouter des traits contrastifs
faisant rfrence aux deux autres dimensions retenues dans la catgorisation de
la faune lhabitat et la locomotion ne prsente pas de difficults non plus
dans la mesure o tous les traits ne sont pas combinables. Les deux catgories
les plus complexes et composites, celle des animaux terrestres + dhiver +
dplacement continu et des animaux terrestres + dhiver + dplacement uni-
forme ne comportent que trois traits chacune et leur pertinence culturelle est
atteste par le fait quelles correspondent chacune au domaine rgi par lun
des matres des animaux. Bref, si le modle cognitif de la classe dattributs est
peu raliste pour ce qui est des niveaux gnriques des taxinomies, il demeure
la meilleure option, non seulement pour les niveaux suprieurs, mais aussi pour
les classifications faisant appel un savoir encyclopdique et un savoir symbo-
lique o le principe de la prototypicalit parat peu probant faute dexemplaires
saillants sur la plan perceptif.
Les dernires leons du cours furent consacres un examen des classifications
taxinomiques travers une analyse critique de certaines propositions de lauteur
qui a sans doute le plus apport dans ce domaine, B. Berlin. On sintressa
dabord aux conjectures de Berlin sur lvolution des taxinomies ethnobiolo-
giques en plusieurs stades : un premier stade o nexisteraient que des taxons
nomms de rang gnrique, suivi par un stade o apparatrait le niveau forme
de vie , puis par deux stades o se mettraient successivement en place le niveau
intermdiaire et les niveaux infragnriques, la dernire tape tant celle de
lmergence du taxon correspondant au rgne . Il sagit, en somme, partir
du noyau primitif de termes gnriques, dun mouvement de diffrenciation vers
le bas et de gnralisation vers le haut, les deux derniers stades, consquences
de la rvolution nolithique , ntant prsents que dans les socits ayant
domestiqu les plantes et les animaux. Or, cette perspective volutionniste, sans
doute lgitime dans le domaine de la phylognie des organismes, pose de nom-
breux problmes lorsquelle est applique lvolution des lexiques, comme
toute production culturelle collective, puisquelle conduit faire des hypothses
sur des successions unidirectionnelles dvnements, en contradiction flagrante
avec ce dont tmoigne lexprience historique. L o lon possde des tmoi-
gnages crits, on sait en effet que le mouvement dvolution terminologique sest
produit dans plusieurs directions : du niveau gnrique vers les niveaux supra-
et infragnriques, sans doute, mais aussi par transformation de termes supragn-
riques en termes gnriques (de frumentum froment , par exemple), et
de termes infragnriques en gnriques. Plusieurs cas bien attests montrent en
outre que des noms de plantes sauvages sont drivs du nom de plantes cultives,
ce qui parat indiquer que bien des plantes peuvent ne pas tre nommes dans
des conomies de chasse-cueillette trs spcialises dans lusage de quelques
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:07 Imprimerie CHIRAT
ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE 437
plantes seulement, lavnement de lagriculture aboutissant paradoxalement une
stratgie plus polyvalente demploi des plantes, et donc une extension du
lexique par drivation du nom des plantes cultives.
Ces considrations amnent traiter avec prudence toute hypothse gnrale
sur le contraste entre les lexiques botaniques des chasseurs-cueilleurs et ceux
des agriculteurs. Sil est vrai quil existe une tendance vers un plus faible nombre
de taxons polytypiques dans les socits de chasseurs-cueilleurs, et donc vers
des taxinomies moins hirarchises et moins inclusives, certains contre-exemples
telles les nomenclatures des Seri du Mexique ou des Pygmes Aka dont le
rapport entre taxons monotypiques et taxons polytypiques correspond celui
rencontr dans les populations dagriculteurs indiquent que cela na rien
duniversel. Il faut enfin garder lesprit que les chasseurs-cueilleurs contempo-
rains ont souvent connu un processus dinvolution qui nen fait pas les meilleurs
tmoins possibles dun hypothtique stade pragricole des nomenclatures ethno-
biologiques. Comme le montre W. Bale dans son analyse comparative des horti-
culteurs Kaapor et de leurs voisins Guaja, ces derniers ayant abandonn
lhorticulture au XVIIIe sicle pour fuir la pression des colons brsiliens, le
problme nest pas tant de conjecturer comment un lexique a pu se dvelopper
et se hirarchiser smantiquement, mais plutt de comprendre comment il a pu
sappauvrir et sa structure se simplifier dans un laps de temps assez bref (Foot-
prints of the Forest, 1994). Tout particulirement dans la zone intertropicale,
sest dveloppe depuis plusieurs milliers dannes une interaction troite entre
horticulteurs et chasseurs-cueilleurs qui interdit de considrer ces deux modes
de subsistance comme htrognes, notamment du fait de la dpendance des
horticulteurs lgard des plantes sauvages et des cueilleurs lgard des friches
de plantes cultives. Tout au plus peut-on dire, dune part quil existe de bonnes
raisons pour que le lexique botanique des agriculteurs soit plus extensif, dautre
part que les mouvements de contraction et dexpansion des lexiques peuvent se
raliser trs rapidement et affecter tous les niveaux de la taxinomie. Il est donc
hasardeux dinfrer partir de situations contemporaines un scnario unilinaire
de lvolution des lexiques ethnobiologiques.
Le dernier problme abord fut celui des catgories latentes, des taxons non
nomms dont Berlin postule lexistence au niveau dit intermdiaire . Sans
mettre en doute leur existence (comme le font R. Ellen ou C. H. Brown), on
peut nanmoins sinterroger sur les mthodes employes par Berlin pour les
mettre en vidence questions directives et usage de lcriture , lesquelles
tranchent sur la recommandation judicieuse que faisait H. Conklin de mener les
enqutes dethnobiologie en situation dinteraction spontane. La formulation
des questions tendant souvent prdterminer les rponses, on risque ainsi de
dcouvrir des catgories latentes l o il ny en a pas, ce qui parat tre le
cas de Berlin dans son enqute chez les Jivaros Aguaruna o il en dcle un
nombre anormalement lev. Notre propre enqute chez les Jivaros Achuar a
aussi permis den identifier, mais sur la base exclusive de commentaires spon-
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:07 Imprimerie CHIRAT
438 PHILIPPE DESCOLA
tans avancs par les informateurs, raison pour laquelle, sans doute, ils taient
bien moins nombreux.
Plus intriguante est la question de savoir pourquoi, en dfinitive, les catgories
latentes existent-elles ? Si les membres dune culture sont capables doprer des
regroupements au moyen de taxons supragnriques nomms, pourquoi npuisent-
ils pas le champ des ressemblances et laissent-ils de ct des regroupements
potentiels quils pourraient tout aussi bien nommer ? Ainsi, dans la classification
ethnozoologique des Jivaros Achuar, il y a vingt-sept taxons supragnriques
nomms du niveau intermdiaire, la majorit correspondant des oiseaux (pn-
chu, rapace ; napi, serpent ; tunkau, silure , etc.). Or, certaines espces
communes caractrises par des traits morphologiques remarquables ne sont pas
pour autant subsumes sous un taxon supragnrique nomm : cest tout particu-
lirement notable pour les cinq espces de Ramphastids (les toucans ) et les
cinq espces de tatous, pour lesquelles il ne semble pas exister non plus de
taxons latents . Si de fortes similitudes dans lapparence ne conduisent pas
des regroupements dans des catgories nommes lencontre dailleurs de ce
que prvoit le principe de prototypicalit , cest probablement qu partir dun
certain degr de proximit morphologique entre espces, lesprit cherche plutt
souligner des diffrences minimes qu mettre laccent sur des ressemblances
ostensibles. De fait, les taxons supragnriques de rang intermdiaire paraissent
avoir une fonction dexclusion plus que dinclusion : ils permettent de nommer
ce qui est mal connu, ce quil nest pas utile de distinguer, ce qui ne prsente
gure dintrt pratique ou symbolique. On doit les considrer comme des co-
nomiseurs de mmoire afin de regrouper des espces sans importance particu-
lire dont il nest pas indispensable de se rappeler les noms, par contraste avec
ce qui se produit dans le cas des espces importantes pour des raisons matrielles
ou idelles, quil vaut mieux alors individualiser plutt que subsumer sous un
taxon englobant.
Ph. D.
SMINAIRE
Tout comme le sminaire de lanne prcdente, celui de cette anne sefforait
daborder la question anthropologique du point de vue des dbats thoriques et
des problmes de mthode quelle suscite. Sous lintitul Sminaire danthropo-
logie gnrale , il sagissait dexaminer les diverses figures que peut prendre
lanthropologie en ce dbut du XXIe sicle et ce qui fonde ses prtentions une
autonomie disciplinaire. Le sminaire a donc t organis autour dune srie
dexposs confis des chercheurs, pas ncessairement anthropologues, qui
taient convis expliciter leur conception de lanthropologie loccasion de la
prsentation de leurs recherches.
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:07 Imprimerie CHIRAT
ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE 439
Programme du sminaire :
Le 9 mars 2005 : prsentation par Philippe Descola, suivie dun expos de
Michael Houseman (EPHE, Ve section) sur Le rituel comme mode dimplica-
tion relationnelle .
Le 16 mars 2005 : expos de Jacques Galinier (CNRS) sur Espace psychique,
espace cognitif dans les socits amrindiennes du Mexique oriental .
Le 23 mars 2005 : expos de Grard Lenclud (CNRS) sur Le Bateau de
Thse. Identit assigne et identits construites .
Le 30 mars 2005 : expos de Pierre Lemonnier (CNRS) sur De ncessaires
redondances ? A ` propos de rites de mort et dinitiation en Nouvelle-Guine .
Le 6 avril 2005 : expos dAlban Bensa (EHESS) sur Une anthropologie de
laction est-elle possible ?
Le 13 avril 2005 : expos de Marc Abls (CNRS) sur Itinraires en anthro-
pologie politique .
Le 20 avril 2005 : expos de Carlo Severi (CNRS et EHESS) sur Limage
rituelle .
Le 11 mai 2005 : expos de Serge Gruzinski (EHESS) sur Mtissages et
mondialisations : les questions de lhistorien et de lanthropologue .
Le 18 mai 2005 : expos de Dan Sperber (CNRS) sur Les raisins sans
ppins : nature et culture .
PUBLICATIONS
Antropologa de la Naturaleza, Lima, Lluvia Editores & Instituto Francs
de Estudios Andinos, 2004, 91 p.
Le sauvage et le domestique , Communication 76, pp. 17-39, 2004.
Mit den Toten leben in F.W. Graf et H. Meier (sous la direction de)
Der Tod im Leben, pp. 235-268, Munich, Piper Verlag, 2004.
On anthropological knowledge , Social Anthropology 13 (1), pp. 65-73,
2005.
AUTRES ACTIVITS
Directeur dtudes lcole des hautes tudes en Sciences sociales.
Directeur du Laboratoire dAnthropologie sociale (UMR 7130 du Collge
de France, du CNRS et de lEHESS).
Prsident de la Socit des Amricanistes, vice-prsident du conseil scienti-
fique de la Fondation Fyssen.
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:07 Imprimerie CHIRAT
440 PHILIPPE DESCOLA
COLLOQUES, ` LTRANGER
ENSEIGNEMENTS ET MISSIONS A
1. Communications des colloques :
Traduction linguistique et traduction culturelle , cole europenne dt
du CNRS Constitution, transmission, circulation des savoirs relatifs au lan-
gage , cole normale suprieure de Lyon, 2-3 septembre 2004.
Linstitution des collectifs , Colloque Atmospheres of Freedom. For
an Ecology of Good Governement , I Dialoghi di San Giorgio, Fondazione
Giorgio Cini, Venise, 15-17 septembre 2004.
Quest-ce quun anthropologue structuraliste ? , Colloque Lvi-Strauss
dans son temps , Institut Catalan dAnthropologie, Barcelone, 30 mai 2005.
Directions de recherche pour une anthropologie de la chasse , Colloque
La chasse : pratiques sociales et symboliques , Maison Ren-Ginouvs, Uni-
versit de Nanterre, le 10 juin 2005.
2. Enseignement :
Universit de Buenos Aires (Centre Franco-Argentin), cycle de 30 heures
denseignement sur le thme pistmologies locales, pistmologie globale ,
premire quinzaine doctobre 2004.
3. Confrences :
Universit de Cordoba (Argentine), Centro de Estudios Avanzados, De
lethnologie lanthropologie , 8-9 octobre 2004.
Universit dOxford, Institute of Social Anthropology, Forms of life ,
le 22/10/04.
Universit de Tbingen, Ludwig- Uhland- Institut fr Empirische Kultur-
wissenschaft et Deutsch- Franzsisches Kulturinstitut, Quel rle pour lanthro-
pologue dans le monde daujourdhui ? , le 17/11/2004.
Cit des sciences et de lindustrie de Paris-La Villette : trois confrences
sur le thme Nature/culture : Les natures du monde (1/12/04), Les frontires
de la socit (8/12/04) et Des mondes trangers (15/12/04).
cole nationale des Beaux-Arts, Les formes du monde , le 27/01/2005.
The Radcliffe-Brown Lecture in Social Anthropology for 2005, Beyond
Nature and Culture , The British Academy, Londres, 31/03/2005, rpte
luniversit de St Andrews (cosse), le 15/04/05.
ACTIVITS DU LABORATOIRE DANTHROPOLOGIE SOCIALE
(2004-2005)
Le Laboratoire dAnthropologie sociale est une unit mixte du Collge de
France, du CNRS et de lEHESS qui compte cinquante-six membres permanents,
dont huit du Collge de France ; il publie deux revues danthropologie gnrale,
LHomme et tudes rurales. Il abrite une bibliothque danthropologie gnrale
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:07 Imprimerie CHIRAT
ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE 441
riche de 20 000 volumes et de 386 priodiques, dont 190 vivants, et un centre
documentaire unique en Europe, les Human Relation Area Files. Une soixantaine
dtudiants y prparent des thses. Les investigations ethnographiques menes
au Laboratoire dAnthropologie sociale concernent lEurope, lAfrique, lAm-
rique du Sud et du Nord, lAustralie et la Mlansie. Les chercheurs poursuivent
individuellement leur activit selon les grands axes de recherche classiques de
lanthropologie sociale ; ils participent aussi collectivement des recherches dans
le cadre dquipes auxquelles sont associs des doctorants et des chercheurs
dautres units. Le Laboratoire compte actuellement huit quipes de recherche
en activit ; faute de place, on nvoquera ici que les activits de lquipe dirige
par le professeur et directement lies la chaire.
Activits scientifiques de lquipe Les raisons de la pratique : invariants, uni-
versaux, diversit (responsable : Ph. Descola).
Membres : S. BRETON, F.M. CASEVITZ, . DSVEAUX, D. KARADIMAS, G. LENCLUD,
C. SEVERI, Ph. SIMAY, W. STOCZKOWSKI, A. SURRALLS, N. VIALLES, M. MOIESSEEFF
(membres du LAS), P. PEREZ, A.C. TAYLOR, M. HOUSEMAN, K. HAMBERGER,
J. BONHOMME (chercheurs associs).
On rappellera que les travaux de lquipe sorganisent autour de la conviction
que lanthropologie a pour mission de mettre en lumire des invariants culturels
en combinant ltude ethnographique intensive de phnomnes circonscrits et
ltude extensive de leurs manifestations en diffrents lieux et diffrentes poques
au moyen de la mthode comparative. Par invariants, on entend ici des schmes
cognitifs et comportementaux oprant une mdiation entre des potentialits bio-
physiques et des systmes de pratique, non des principes universels de type
biologique ou psychologique dont lextrme gnralit ne permet pas de rendre
compte de la diversit des comportements et des reprsentations. Cest la nature
de ces schmes, et leurs rgles de combinaison dans des ensembles sociaux
concrets, qui constituent lobjet des investigations individuelles de chacun des
membres de lquipe. Celle-ci dveloppe en outre des activits collectives dans
le cadre dun sminaire o chacun de ses membres aborde, partir de ses
recherches personnelles, un problme plus gnral li au thme dinvestigation
retenu pour lanne. En 2004-2005, le sminaire de lquipe a t consacr
des questions portant pour lessentiel sur la thorie de la connaissance envisage
dans une perspective comparative et transculturelle. On sest dabord intress
aux rapports entre affectivit, perception et cognition en partant du principe que,
par contraste avec la position habituelle en anthropologie, les motions ne sau-
raient constituer un domaine discret dobjet (susceptible dtre modul de faon
culturelle ), mais quelles doivent au contraire tre apprhendes comme une
dimension de tout acte perceptif. Cest ce quont bien mis en lumire les rsultats
dune enqute mene par A. Surralls sur la terminologie des couleurs chez les
Indiens Candoshi de lAmazonie pruvienne qui indique que les termes dsignant
les couleurs de base sont drivs du vocabulaire des motions et de la proprio-
ception et ne constituent donc pas un domaine smantique autonome. On sest
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:08 Imprimerie CHIRAT
442 PHILIPPE DESCOLA
ensuite pench sur la distinction propose par L. Dumont entre agent empirique
et sujet normatif afin den examiner les consquences quant au statut du sujet
connaissant lorsque, comme la montr S. Breton pour la Mlansie, la personne
est conue comme un foyer de relations et non comme une substance circonscrite
dans un corps ; la connaissance tend alors tre pense la manire dune
relation interne, non comme un rapport entre sujet et objet. Cest vers un autre
problme de la thorie de la connaissance que lon sest ensuite tourn en exami-
nant les usages de la notion de tradition en anthropologie : dconstruisant ceux-
ci avec les outils du philosophe, Ph. Simay a soulign les apories de la position
constructiviste linvention de la tradition et propos une dfinition
pragmatiste du phnomne : cest leffet performatif de la tradition qui importe,
plus que les conditions de sa gense ou sa fonction idologique. Une autre
dimension de la tradition, orale en ce cas, est le rapport quelle entretient avec
les images. A ` partir de cas emprunts aux Lakota, aux Kuna et aux Apache,
C. Severi a montr que lon pouvait mettre au jour un paralllisme de structure
entre des corpus de textes rituels et des sries de pictogrammes, ces derniers
faisant fonction de supports de la mmoire ; loin dtre purement dcoratives ou
symboliques, les images ont ici une fonction cognitive et ne peuvent tre analy-
ses indpendamment des noncs auxquels elles sont associes. On sest enfin
intress la fonction de connaissance du mythe, lequel, comme le dit J.-P.
Vernant, peut aussi servir parler du prsent. Traiter la science-fiction la
manire dune mythologie du monde moderne, ainsi que propose de le faire
M. Moiesseeff, cest donc examiner comment elle prsente de faon condense
certains problmes que se posent les socits postindustrielles, notamment ceux
qui concernent la sexualit et la reproduction.
6463$$ UN26 18-01-2006 14:39:08 Imprimerie CHIRAT
Vous aimerez peut-être aussi
- Une Brève Analyse de La Politique D'efficacité Énergétique Du SénégalDocument23 pagesUne Brève Analyse de La Politique D'efficacité Énergétique Du SénégalsyllacheikhsadiboukaPas encore d'évaluation
- Production D'électricité!: Semaine 1 - Thème 2! Sous-Thème 4!Document11 pagesProduction D'électricité!: Semaine 1 - Thème 2! Sous-Thème 4!Abdourazak AbouPas encore d'évaluation
- Programmes D'Études: Baccalauréat en Biologie - 7705Document16 pagesProgrammes D'Études: Baccalauréat en Biologie - 7705Glenn Ulrich MboussiPas encore d'évaluation
- 2de - Chap 3 - Cours DescartDocument3 pages2de - Chap 3 - Cours Descartmohamed laghribPas encore d'évaluation
- Controle2 Partie 2 2022ههDocument4 pagesControle2 Partie 2 2022ههMouhibi Abdellah100% (1)
- Fabrication BriqueDocument8 pagesFabrication BriqueWalid X ZibitPas encore d'évaluation
- Devoir 1 PermacultureDocument9 pagesDevoir 1 PermacultureIehl Jean Louis100% (1)
- Cours de Combustion 2eme PartieDocument25 pagesCours de Combustion 2eme PartiethdrsvgPas encore d'évaluation
- 06 Les Etats de La MatiereDocument4 pages06 Les Etats de La MatiereHoussemTunisinoPas encore d'évaluation
- EcosystèmeDocument13 pagesEcosystèmeBOUBCHIRPas encore d'évaluation
- Description Des Generateurs de Vapeur: G. Poudroux F.Y. Guena M. PetitDocument174 pagesDescription Des Generateurs de Vapeur: G. Poudroux F.Y. Guena M. PetitAla Eddin Ben SlimenPas encore d'évaluation
- Plaquette Qualitech Lectricit Version FinaleDocument2 pagesPlaquette Qualitech Lectricit Version FinaleQualitechelectricitePas encore d'évaluation
- Décret Exécutif 06-141rejets D'effluentsDocument20 pagesDécret Exécutif 06-141rejets D'effluentsidris baziziPas encore d'évaluation
- Les Eaux UséeDocument5 pagesLes Eaux UséeMustapha BoualamallahPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document2 pagesChapitre 2Chloe MaskatiPas encore d'évaluation
- Cours de RadioÉlectricité Générale T4 Propagation - P. DAVID - (1955)Document227 pagesCours de RadioÉlectricité Générale T4 Propagation - P. DAVID - (1955)JankullPas encore d'évaluation
- Etude Procedes Desinfection FiltrationDocument108 pagesEtude Procedes Desinfection FiltrationMoiPas encore d'évaluation
- Résumé Cours Chimie Verte Et Exercises-CopierDocument20 pagesRésumé Cours Chimie Verte Et Exercises-CopierSoumia Bakhta100% (2)
- Mesure Electrique de La TemperatureDocument162 pagesMesure Electrique de La TemperatureAdelChPas encore d'évaluation
- ThermodynamiqueDocument2 pagesThermodynamiqueAli WardiPas encore d'évaluation
- Cours 4 de L Atome A L Edifice Chimique EleveDocument7 pagesCours 4 de L Atome A L Edifice Chimique EleveAyoub Ben Mlah100% (1)
- IrrigationDocument47 pagesIrrigationMohamed EL manouzi100% (2)
- Second Principe Du ThermodynamiqueDocument15 pagesSecond Principe Du ThermodynamiqueMario SuperPas encore d'évaluation
- Biogaz A Partir de Dechets Biogas WasteDocument4 pagesBiogaz A Partir de Dechets Biogas WastedakPas encore d'évaluation
- Leçon4 Réactions de Quelques Matières Organiques Avec L'air Prof - Elmasaoudy (WWW - Pc1.ma)Document2 pagesLeçon4 Réactions de Quelques Matières Organiques Avec L'air Prof - Elmasaoudy (WWW - Pc1.ma)Agnaou MohamedPas encore d'évaluation
- Ingé - Le Silicium Chimie - BLANQUIERDocument20 pagesIngé - Le Silicium Chimie - BLANQUIERkhaled11250% (2)
- Les Animaux Malades de La PesteDocument12 pagesLes Animaux Malades de La PestenadahammoudPas encore d'évaluation
- LES Moles: 6.02x10 MolDocument1 pageLES Moles: 6.02x10 MolboustakatbPas encore d'évaluation
- Le Diagramme Thermodynamique Du R134aDocument20 pagesLe Diagramme Thermodynamique Du R134amohamed mãjňøönPas encore d'évaluation
- Capteurs Solaire ThermiqueDocument10 pagesCapteurs Solaire Thermiquefg'ergPas encore d'évaluation