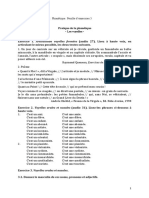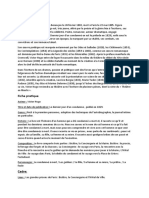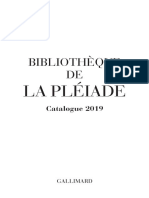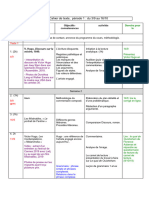Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Developpement de Melancholia
Developpement de Melancholia
Transféré par
Idris Guerrah0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vues2 pagesTitre original
DEVELOPPEMENT DE MELANCHOLIA
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vues2 pagesDeveloppement de Melancholia
Developpement de Melancholia
Transféré par
Idris GuerrahDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
DEVELOPPEMENT DE MELANCHOLIA
Victor Hugo dresse un tableau de la misère à travers le portrait en action
d'enfants allant au travail. Il se met ainsi en chroniqueur qui va enquêter sur les
conditions de travail. L'utilisation de déterminants démonstratifs "ces enfants"
au vers 1 "ces doux êtres" au vers 2 "ces filles" vers 3 inscrit et renforce Hugo
dans une relation de proximité avec ces enfants. Le champ lexical du mouvement
"vont" vers 1 "cheminer" vers 3 "s'en vont" vers 4 montre le souci de réalisme
du chroniqueur qui témoigne.
Le poeme "Melancholia" évolue rapidement avec un registre tragique par les
périphrases "ces doux êtres pensifs", "ces filles de huit ans" qui suscitent la
pitié du lecteur en insistant sur l'innocence et la fragilité de ces enfants. Le
terme "fièvre" sujet du verbe "maigrit" vers 2 devient une allégorie de la maladie
qui s'abat sur les enfants lui donnant un aspect plus fatal. Au 2eme vers l'auteur
joue avec l'homonymie entre "cheminer" et "cheminées" qui suggère que le
mouvement des enfants est entièrement tourné vers l'usinage et la production.
Le choix de "huit ans" n'est pas le fruit du hasard mais correspond a l'â ge
minimum pour travailler en 1856 il n'est cependant pas encore voté en France.
Victor Hugo, indigné par ce seuil tres bas, montre que le droit français incarne ce
destin fatal.
Le champ lexical de l'économie "travailler" "quinze heure" "meules" souligne
l'enfermement des enfants dans les rouages d'une industrie aliénante. Victor
Hugo se situe dans le sillage de la pensée socialiste française qui critique
l'exploitation industrielle des ouvriers et recherche une organisation humaine du
travail, Victor Hugo dénonce ainsi un travail répétitif qui réduit les enfants a
l'état de machine comme le montre le champ lexical de la circularité "de l'aube
au soir" "éternellement" "la meme" "le meme". Par la répétition sans fin des
meme mouvements, les enfants sont implicitement comparés a la figure tragique
de Sisyphe, cette créature mythologique condamnée a monter éternellement au
sommet d'une montagne une pierre qui tombait immanquablement.
A l'époque de la révolution industrielle, l'usine est le symbole du progrès
et de l'émancipation humaine. L'auteur se fait donc polémiste au vers 4
lorsqu'il compare l'usine a une prison "dans la meme prison faire le meme
mouvement". Victor Hugo a ensuite recours a un registre fantastique quand il
compare la machine a une créature mythologique comme le montre le champs
lexical de la monstruosité "dents" "sombre" monstre" "hideux"… La machine
est comparée au Minotaure qui mangeait des enfants. Par analogie, l'usine
devient un labyrinthe dans laquelle l'etre humain perd toute son humanité. Les
antithèses "innocents/bagne; anges/enfer" soulignent l'incompatibilité des
enfants avec la civilisation industrielle. La position "ils travaillent" en rejet au
vers 7 suggère que l'homme est rejeté par l'usine qui le consomme, le consume
puis le rejette comme un produit.
Par le champ lexical du mineral "airain" "fer" "cendre" l'auteur montre la
froideur de l'usine "fer" rimant avec "enfer". Le travail a l'usine est ainsi
marqué par la négation "jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue". Le pronom
impersonnel "on" souligne que cette civilisation industrielle ne laisse pas de
place a l'individu. L'allitération en "j" laisse entendre les sanglots su "je" qui
essaie d'émerger dans ce monde dépersonnalisant. Dans ce monde l'enfant est a
peine né qu'il est déjà un fantôme comme le suggère l'exclamation "ainsi quelle
pâ leur!" et le terme "cendre" qui renvoi a la mort.
Victor Hugo quitte le registre polémique pour se faire l'avocat de la cause
des enfants, l'anaphore en "ils" aux vers 13,14 et 15 met la lumière sur les
enfants, ces derniers s'adressent a dieu "ils semblent dire a dieu" vers 15 ce qui
accentue leur innocence. Leur parole prend d'ailleurs le ton d'une prière
comme le suggère l'incise "Notre père" qui rappelle la prière "Notre Père". C'est
donc une parole qui suscite la pitié du lecteur. Victor Hugo, tel un avocat,
reprend la parole par une invocation "O, servitude infame imposée à l'enfant !"
"Rachitisme !"
Le travail est investi d'une valeur diabolique. Il est présenté comme le diable, la
figure inverse de dieu comme le suggère le chiasme sonore "défait ce qu'a fait
dieu" ou syntaxique "la beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée". Au vers
21 Victor Hugo joue sur le sens du terme "fruit" "c'est la son fruit le plus certain".
Le fruit désigne certes les conséquences d'une action mais fait aussi allusion au
fruit du péché originel. Le travail des enfants est ainsi présenté comme
diabolique et destructeur. Victor Hugo mon le pouvoir néfaste du travail des
enfants a travers les hyperboles qui frappent l'imagination "qui ferait…
d'Apollon un bossu, de Voltaire un cretin. Les antithèses suggèrent que le travail
des enfants crée le chaos et une inversion des valeurs "produit la richesse en
créant la misère". Le parallélisme entre "travail" vers 23 et "progrès" vers 26
donne une dimension ironique a la tirade.
A la fin de l'extrait, l'auteur se fait imprécateur comme l'indique l'anaphore de
l'adjectif "maudit" aux vers 30 et 31.Par le champs lexical du vice "haï" "vice"
"opprobre" "blasphème" il reproche aux hommes de pervertir par le travail
industriel la création de dieu dont l'enfant est l'exemple le plus pur. Victor Hugo
ne veut pas abolir le travail amis veut un travail conforme a la dignité de
l'homme. Le champ lexical du bonheur aux vers 33 et 34 montre que le poète
croit possible cette société du travail et de la dignité "sain" "fécond" "généreux"
"libre" "heureux".
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Petit Chaperon RougeDocument9 pagesLe Petit Chaperon RougePAULA DANIELA DOBRINPas encore d'évaluation
- Blake Et Mortimer - Tome 09 - Le Piège Diabolique (Couleurs Originales) - TextDocument64 pagesBlake Et Mortimer - Tome 09 - Le Piège Diabolique (Couleurs Originales) - Textphil morel100% (1)
- Solibo Magnifique by Chamoiseau PatrickDocument163 pagesSolibo Magnifique by Chamoiseau PatrickmziehliPas encore d'évaluation
- LENFANT NOIR DE CAMARA LAYE Litterature PDFDocument22 pagesLENFANT NOIR DE CAMARA LAYE Litterature PDFEmna Braham100% (3)
- Fiche de Travail-AdjectifDocument3 pagesFiche de Travail-AdjectifMOISILPas encore d'évaluation
- Le CidDocument30 pagesLe CidNestor AmetoviPas encore d'évaluation
- René Bazin, 1853Document9 pagesRené Bazin, 1853Shorena KhaduriPas encore d'évaluation
- فرض محروس رقم 3 في مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى إعدادي الدورة الأولىDocument2 pagesفرض محروس رقم 3 في مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى إعدادي الدورة الأولىIdriss Cher RadPas encore d'évaluation
- La Littérature Française - Théâtre D'absurdeDocument11 pagesLa Littérature Française - Théâtre D'absurdeShargiyaPas encore d'évaluation
- Lectures Cursives Les MétamorphosesDocument3 pagesLectures Cursives Les MétamorphosesTuria TANGIPas encore d'évaluation
- Chapitre 4Document3 pagesChapitre 4mepriseluthesPas encore d'évaluation
- Ashp 6251Document6 pagesAshp 6251Koko Israël EmmanuelPas encore d'évaluation
- Remarques Sur La Traduction de La PoésieDocument12 pagesRemarques Sur La Traduction de La PoésieAlberto Mario Ceballos ArroyoPas encore d'évaluation
- 6 Francais Bac Fiche 5 1Document4 pages6 Francais Bac Fiche 5 1manel hamzaouiPas encore d'évaluation
- Sequence 4 Seances 4 Et 5xDocument3 pagesSequence 4 Seances 4 Et 5xSamaPas encore d'évaluation
- PoesieDocument3 pagesPoesieFort BoyardPas encore d'évaluation
- Raw 26 PDFDocument3 pagesRaw 26 PDFNicoleta IordachescuPas encore d'évaluation
- BiographieDocument7 pagesBiographieDounia FatouchiPas encore d'évaluation
- La Boîte À Merveilles 1BAC - KezakooDocument1 pageLa Boîte À Merveilles 1BAC - KezakooffspockyPas encore d'évaluation
- Proceedingcif2019 6Document7 pagesProceedingcif2019 6Ingom ElisePas encore d'évaluation
- Its Been A Long Long Time Partitura CompletaDocument7 pagesIts Been A Long Long Time Partitura CompletaMiguel RodriguesPas encore d'évaluation
- 00 Pleiade Catalogue 2019Document216 pages00 Pleiade Catalogue 2019Damien ServaisPas encore d'évaluation
- 1STMG3 - Commentaires Des Textes Du Bac Blanc IIIDocument5 pages1STMG3 - Commentaires Des Textes Du Bac Blanc IIInx4cb6xpm5Pas encore d'évaluation
- Evaluation Séquence IiDocument5 pagesEvaluation Séquence Iiamira.gamPas encore d'évaluation
- Cycle de Survie PDFDocument5 pagesCycle de Survie PDFCindy FARRUGIAPas encore d'évaluation
- Nouveau Document Microsoft Office WordDocument2 pagesNouveau Document Microsoft Office WordNajat DahbiPas encore d'évaluation
- Biograpgie Théophile GautierDocument1 pageBiograpgie Théophile GautierJL ClowzayPas encore d'évaluation
- Travail Féminisme Romancières PolicierDocument8 pagesTravail Féminisme Romancières PolicierCatherine StasPas encore d'évaluation
- Cahier de TexteDocument3 pagesCahier de TextebesnardgalymaelPas encore d'évaluation
- 16083-Texte de L'article-14830-1-10-20160818Document17 pages16083-Texte de L'article-14830-1-10-20160818brtyPas encore d'évaluation