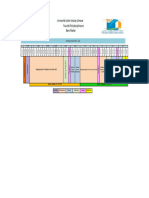Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sociétés - CFS - Copie
Sociétés - CFS - Copie
Transféré par
oussama.michoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Sociétés - CFS - Copie
Sociétés - CFS - Copie
Transféré par
oussama.michoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Genres concernés[modifier | modifier le code]
En Grèce, le sophiste Gorgias y recourait systématiquement. Aristote la codifia ensuite dans
sa Rhétorique, les deux membres d’une phrase devant être antithétiques, quand, dans chacun
des deux membres les contraires sont opposés ou quand le même mot est joint au contraire.
Aristote y voit le fondement de toute argumentation.
Dans l’Antiquité latine, Cicéron, mais aussi Virgile et Horace la déploient sur des pages entières.
Essentiellement une figure rhétorique, employée par les orateurs, l'antithèse devient ensuite à
la Renaissance un procédé récurrent de la poésie amoureuse et lyrique avec les poètes de La
Pléiade et Pétrarque. Les antithèses du feu et de la glace, du soleil et de la pluie, de la chaleur et
du froid, voire du chaud et du gel, du jour et de la nuit, de la lumière et de l’obscurité, du rire et
des pleurs, de la vie et de la mort sont parmi les topos les plus employés.
Le baroque l'utilise afin de révéler la profonde dichotomie qui forme la réalité.
Les moralistes ensuite forment leurs argumentations sur ses ressources rhétoriques afin
d'explorer les concepts métaphysiques comme le "vrai" ou le "faux".
Les dramaturges recourent enfin à l'antithèse, le premier étant William
Shakespeare dans Hamlet et que marque le célèbre monologue du héros éponyme à la scène I
de l’Acte III : « To be or not to be ».
En poésie, elle facilite la confection des périodes. Grâce à la structure binaire et équilibrée de
l’alexandrin en effet (avec la césure à l’hémistiche), l'antithèse poétique accueille son heure de
gloire, notamment chez Pierre Corneille et chez Jean Racine, auteurs dont les tragédies ne
peuvent se passer de la figure pour formuler les dilemmes de la condition humaine. L'antithèse
est alors souvent employée pour dramatiser les tirades et échanges entre actants comme ici
entre le père de Chimène et Rodrigue, le Cid :
Es-tu si las de vivre?
As-tu peur de mourir?
Vous aimerez peut-être aussi
- Sociétés - CFS - CopieDocument1 pageSociétés - CFS - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - CFS - CopieDocument1 pageSociétés - CFS - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - CFS - CopieDocument1 pageSociétés - CFS - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - C - CopieDocument1 pageSociétés - C - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - C - CopieDocument1 pageSociétés - C - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - C - CopieDocument1 pageSociétés - C - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - CFS - CopieDocument1 pageSociétés - CFS - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - C - CopieDocument1 pageSociétés - C - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - C - CopieDocument1 pageSociétés - C - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- SociétésDocument1 pageSociétésoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - CopieDocument1 pageSociétés - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Article 1241Document2 pagesArticle 1241oussama.michoPas encore d'évaluation
- Rare Texts - Copie (5) - CopieDocument1 pageRare Texts - Copie (5) - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Sociétés - CopieDocument1 pageSociétés - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Maha E1Document6 pagesMaha E1oussama.michoPas encore d'évaluation
- Rare Texts - CopieDocument1 pageRare Texts - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Planning Annuel AU 2022 2023 v7Document1 pagePlanning Annuel AU 2022 2023 v7oussama.michoPas encore d'évaluation
- Rare Texts - CopieDocument1 pageRare Texts - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Introductions Aux Sciences Juridiques (Suite)Document8 pagesIntroductions Aux Sciences Juridiques (Suite)oussama.michoPas encore d'évaluation