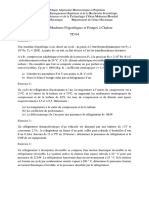Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ed 79
Ed 79
Transféré par
Mohamed KardousTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ed 79
Ed 79
Transféré par
Mohamed KardousDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cette fiche pratique a pour objet de rassem-
bler les principales donnes ergonomiques
applicables la conception et lamnage-
ment de postes de travail en vue de prvenir
les risques et damliorer les conditions de
travail.
Cette fiche est utilisable la fois par les
concepteurs internes de lentreprise (fonc-
tion mthodes, travaux neufs) et externes
(fabricants, cabinets conseil), et par ceux
qui participent ladaptation des situations
de travail aux oprateurs (CHSCT, mdecins
du travail). Les principes dcrits dans ce
document sont applicables dans tous les
secteurs dactivit.
De nombreux textes rglementaires font rf-
rence la notion de poste de travail, notam-
ment dans le cadre des principes gnraux de
prvention dfinis par larticle L. 4121-2 du code
du travail. Les normes dergonomie traitent
galement de ladaptation des postes de tra-
vail lhomme (voir le recueil des normes
Ergonomie de lAFNOR).
Cette fiche pratique ne prtend pas couvrir
lensemble du champ de lergonomie. Dune
part, elle est centre sur le poste de travail
qui nest quun lment dun systme plus
large (atelier, bureau, service). Dautre part,
elle ne traite pas des aspects mthodolo-
giques qui font lobjet dautres publications :
il faut rappeler que la dmarche ergono-
mique repose sur trois lments principaux:
lanalyse du travail rel (par observation des
situations de travail, mesures et entretiens
avec les oprateurs), les connaissances en
ergonomie (sur le fonctionnement de
lhomme au travail) et la participation du
personnel (instances reprsentatives du
ED 79
FICHE PRATIQUE DE SCURIT
Conception et amnagement
des postes de travail
2 Fiche pratique de scurit ED 79
personnel et oprateurs concerns). Lorsque
les caractristiques des oprateurs concer-
ns sont trs spcifiques compte tenu de
leur tat de sant, de leur ge, de leur exp -
rience ces spcificits seront prises en
compte dans cette d marche.
Pour un poste crer, lanalyse pralable
porte sur des situations existantes simi -
laires, pour dfinir ensuite un cahier des
charges du poste en projet. Sil sagit dun
amnagement de poste, cette dmarche est
mise en uvre en partant des problmes
rencontrs par les oprateurs. Il faut noter
que loprateur ne se rduit pas la fonction
production : le poste de travail doit tre
galement adapt tous ceux qui inter -
viennent (installateurs, rgleurs, personnel de
maintenance, dentretien et de nettoyage).
La fiche est structure en sept points qui
regroupent les connaissances principales
prendre en compte lors de la conception des
postes de travail : accs et circulation, com-
munications, contraintes de temps, nuisances
physiques et chimiques, informations, manu-
tentions et efforts, dimensionnement et pos-
tures. Pour chaque thme, les principes
considrer sont illustrs par des exemples
dapplication; les principales erreurs viter
et des rfrences complmentaires sont indi-
ques. Une dernire partie traite de la mise en
uvre de ces sept points aux diffrents
stades dun projet de conception ou damna-
gement des postes de travail.
1. ACCS ET CIRCULATION
Lobjectif est de permettre loprateur dac-
cder et de circuler en toute scurit
son poste de travail, tout en minimisant la
fatigue pour y parvenir.
Cet objectif peut tre atteint partir de la mise
en uvre de principes gnraux suivants :
Lalle de circulation doit tre dimension-
ne en fonction des passages. Exemples :
0,8 m lorsquune seule personne lem-
prunte, 1,20 m lorsque des personnes sy
croisent, 1,50 m lorsque des personnes
passent larrire dautres postes de tra-
vail. Ces valeurs sont majorer pour les
personnes mobilit rduite et en cas
dalles servant lvacuation incendie.
Les zones dvolution de loprateur au
poste sont de 2 m au plus, notamment sil
y a port de charge.
Le sol est antidrapant et dpourvu de
salissures pour viter les chutes par glis-
sade (pour les sols industriels, coefficient
de frottement suprieur 0,30) et pour
faciliter le nettoyage.
Les obstacles provenant dlments fixes :
btis de machines, stockages intermdiaires,
marchandises dpassant de rayonnages, rails
de transfert au sol, caillebotis, mais aussi
dlments mobiles : chariots, bras ou
tabliers de machines doivent tre
pris en compte dans le dimension-
nement de lespace de travail.
Au poste de travail, la place occu-
pe par loprateur lui-mme doit
tre majore de lamplitude des
gestes ncessaires lexcution de
la tche (bras, jambes) et des
dplacements relatifs de son corps
pour reculer, tourner, se baisser
(0,80 m autour de loprateur).
Pour les oprations dentretien sur machines,
les trappes daccs dans les btis doivent
tre suffisamment larges (0,80m) et hautes
(1,00 m genoux, 1,20 m accroupi).
Si laccs en hauteur ne peut tre vit, des
quipements sont alors ncessaires. Il
sagit pour loprateur de pouvoir accder
en hauteur en prfrant lemploi desca-
liers et plates-formes bien dimensionns
aux chelles.
Exemples :
Accs aux postes de travail dans un atelier
(voir figure 1.1).
Accs sans entrave: supports de cbles ali-
mentant des postes informatiques int-
grs dans le mobilier (voir figure 1.2).
Accs en hauteur : plate-forme
plusieurs niveaux pour poste de tra-
vail de diffrentes hauteurs (voir
figure 1.3).
Erreurs viter :
Des cbles et conduits dalimentation sur
le sol.
Des convoyeurs dpourvus de passerelle
pour les traverser.
Des supports ou obstacles dans lespace
de travail moins de 2,20 m de haut.
Bibliographie:
Conception des lieux et des situations de
travail, INRS, ED 950.
La circulation en entreprise, INRS, ED 975.
Norme NF EN 547, parties 1, 2 et 3
(dimensions requises pour les
passages et accs).
Alle dgage
Accs pour une personne (80 cm)
Espace rserv au stockage
Zone dvolution (< 2 m autour de
loprateur)
Fig. 1.1. Accs aux postes de travail
dans un atelier.
Fig. 1.2. Accs sans entrave: intgration
des cbles dans le mobilier.
Plate-forme mobile pour accs en hauteur et pose des outils
Marches
Escalier pour accs la plate-forme suprieure
Fig. 1.3. Accs en hauteur par plate-forme
sur plusieurs niveaux.
ED 79 Fiche pratique de scurit 3
2. COMMUNICATION
Lobjectif principal est dassurer un bon
droulement du travail par une bonne coor-
dination des tches. Un objectif secondaire
est dattnuer les effets ngatifs de la mono-
tonie des tches en permettant aux opra-
teurs concerns de converser.
Les principes mettre en uvre sont les
suivants :
Lister les communications assurer entre
le poste considr et dautres postes de
travail :
communications entre diffrents opra-
teurs contribuant la mme tche (ex. :
le long dune ligne de production),
communications entre oprateurs et
quipes effectuant des tches diffrentes
dans le mme lieu (coactivit), notam-
ment avec des quipes de maintenance,
transmission des informations entre des
oprateurs occupant successivement un
poste de travail (ex. : travail en quipes
successives),
communications en situation dinscu-
rit (ex. : par rapport au public, travail
isol).
Il sagit ensuite de mettre en place des
moyens permettant ces communications :
implantation des postes, dispositifs de
communication distance, supports per-
manents consultables gardant la mmoire
des vnements rcents (supports mat-
riels ou logiciels).
Pour les communications directes entre
les oprateurs, deux points sont consid-
rer : la proximit et le niveau de bruit
ambiant. Ainsi, on estime que pour la com-
prhension de messages simples voix
normale et une distance dun mtre, le
niveau de bruit ambiant ne doit pas
dpasser 70 dB.
Pour les communications directes avec le
public (ex. : guichets), regrouper de prf-
rence plusieurs oprateurs pour faciliter la
constitution dun petit groupe solidaire,
tout en assurant la confidentialit entre
les deux interlocuteurs.
Pour les communications distance, mettre
en place des moyens adapts (tlphones
mobiles, tlphones incluant une fonction
perte de verticalit pour les travailleurs
isols) accompagns de procdures rigou-
reuses.
Des supports (matriels ou logiciels) sont
prvoir lorsque des oprateurs successifs
occupent le poste de travail : registre
dincidents, procdures permettant la
constitution dune mmoire des vne-
ments Cela concerne non seulement les
quipes successives (ex. : travail post),
mais aussi les emplois prcaires (intrim,
CDD) et les liaisons avec les quipes de
maintenance.
Exemples :
Ligne de fabrication implante pour facili-
ter les communications entre lamont et
laval (par exemple: implantation en U,
voir figure 2.1).
Oprateur de maintenance quip dun
moyen portatif de communication dis-
tance (tlphone portable, DATI, voir
figure 2.2).
Cabine insonorise avec fentre permet-
tant une communication visuelle entre
loprateur et les autres travailleurs (ex. :
cabine de banc dessai moteurs, voir
figure 2.3).
Erreurs viter :
Isoler un oprateur dont le travail nces-
site une coordination.
Laisser un travailleur isol sans moyen de
communication distance.
quipes successives sans support de com-
munication crit ou sans recoupement
des horaires.
Surcharge lie des communications trop
nombreuses.
Fig. 2.1. Implantation en U pour faciliter
les communications.
Fig. 2.2. Moyen portatif
de communication
pour travailleur isol.
Vitrages
Possibilit de communication visuelle
Fig. 2.3. Cabine insonorise permettant une communication visuelle entre les oprateurs.
4 Fiche pratique de scurit ED 79
3. CONTRAINTES
DE TEMPS
Lobjectif est de prvenir les risques dacci-
dents, le stress et les troubles musculosque-
lettiques.
Les principes mettre en uvre sont les
suivants :
viter la rptitivit des mmes types de
gestes.
La rptitivit excessive des mmes opra-
tions et surtout des mmes gestes (un
ensemble de gestes est ncessaire lex-
cution dune opration) accrot le risque de
troubles musculosque-
lettiques. Ordre de
grandeur : que le mme
geste ne soit pas rpt
plus de dix fois par
minute. Il est conseill
dorganiser le travail de
manire diminuer
cette rptitivit: lar-
gissement, polyvalence,
enrichissement des tches
pour les lignes de mon-
tage, dissociation entre
le temps de cycle de la machine et le
temps de cycle pour loprateur pour les
postes de conduite de machine (ex. : par
approvisionnement ou vacuation auto-
matique des produits).
Donner de lautonomie dans la gestion du
temps.
Il sagit dviter la dpendance par rapport
au systme (logiciel ragissant rapide-
ment, stocks tampons entre postes suc-
cessifs, appel des clients par loprateur au
lieu de files dattente pour les postes en
contact avec la clientle), de permettre la
prise de pauses, de prfrence au moment
o loprateur en ressent le besoin (pauses
de rcupration au niveau gestuel
< 2 minutes et pauses de dtente de lordre
de 10 minutes o loprateur quitte
momentanment son poste).
Fixer des objectifs de rendement et de
charge de travail non excessifs.
Le temps allou pour effectuer des tches
doit prendre en compte les incidents. Cest
le cas notamment des postes en fin de
ligne qui cumulent les alas des postes
en amont. Leffectif doit tre calcul pour
viter une surcharge de travail lors des
priodes de pointe.
Exemples :
Magasin tampon permettant la fois de
diminuer la rptitivit et daugmenter
lautonomie (ex. : approvisionnement en
planchettes pour la fabrication demballa-
ges en bois, voir figure 3.1).
Tickets pris par les clients et appel des
numros par les oprateurs (voir figure 3.2).
Postes de prparation spars de la ligne
de fabrication (exemple de prparation de
sous-ensembles complets en poste fixe
avant assemblage final en ligne, voir
figure 3.3).
Fig. 3.3. Poste de prparation autonome
par rapport la ligne de fabrication.
Erreurs viter :
Temps de cycle courts pour loprateur.
Dpendance forte entre le poste, les autres
postes amont et aval ou la machine.
Files dattente.
Calcul des temps sans prise en compte des
alas
4. NUISANCES PHYSIQUES
ET CHIMIQUES
Lobjectif est de diminuer les nuisances au
poste de travail pour les rendre compatibles
avec la sant des oprateurs, tout en per-
mettant de raliser le travail sans contrainte.
Les principes mettre en uvre pour attein-
dre cet objectif sont les suivants :
Faire linventaire des nuisances gnres
par le poste lui-mme, mais aussi venant
des autres postes de travail, ou de lenvi-
ronnement.
Il convient didentifier puis de caractriser
les nuisances (en nature et en grandeur)
et les situer par rapport aux valeurs maxi-
males admissibles rglementaires, norma-
tives, ou de confort.
Mettre en uvre les moyens permettant
de rduire les nuisances en utilisant des
produits, matriels et procds non pol-
luants, par exemple : chariot lectrique
silencieux et ne polluant pas lair des
locaux de travail, peintures leau en rem-
placement de peintures aux solvants.
Sassurer que les moyens pris (systmes de
protection collective par exemple) ne
gnent pas et ne perturbent pas le fonc-
tionnement du poste (alimentation, sortie
de pices) ainsi que les oprations de main-
tenance et de dpannage, et amliorent
le confort au travail des oprateurs (en
termes notamment de diminution de la
charge physique et mentale).
Exemples :
Rduire les nuisances mises par le poste
lui-mme : torche aspirante utilise en
soudure (voir figure 4.1).
Fig. 4.1. Torche aspirante conue pour minimiser
la gne lors de son utilisation.
Rduire les nuisances mises par lenviron-
nement : box vitr permettant de sisoler
du bruit et des courants dair tout en gar-
dant un contact direct avec lquipe (voir
figure 4.2).
Ne pas perturber le fonctionnement nor-
mal du poste: vier avec aspiration pri-
phrique des vapeurs nocives permettant
une bonne visibilit par un dispositif int-
gr (voir figure 4.3).
Fig. 3.2. Appel par numros vitant les files dattente.
Sans magasin:
intervention de
lopratrice toutes les
secondes (avant
amnagement)
Avec magasin:
intervention toutes les
minutes ou plus
(aprs amnagement)
Fig. 3.1. Magasin pour lalimentation
de planchettes.
4
4
4
4
4
1
4
0
ED 79 Fiche pratique de scurit 5
Erreurs viter :
Postes polluants ou bruyants (martelage,
peintures, soudures) proximit de
postes qui le sont peu ou pas (montage,
contrle, emballage).
Entres dair frais prs des sources de pol-
lution.
Poste de travail implant entre la source
de nuisance et le dispositif de protection
(capteur, hotte, cran absorbant).
Bibliographie:
valuer et mesurer lexposition profession-
nelle au bruit, INRS, 2009, ED 6035.
Guides pratiques de ventilation n 0 20,
INRS.
5. INFORMATIONS
Lobjectif est de prsenter clairement les
informations visuelles et sonores utiles pour
raliser le travail avec efficacit et en scu-
rit.
Les principes mettre en uvre sont les sui-
vants :
Identifier les informations utiles pour
raliser le travail un poste donn.
Les lister en tenant compte de la fonction
des divers agents concerns (oprateurs
du poste, techniciens de maintenance),
du niveau dapprentissage ou du statut de
ces agents (nouveaux, intrimaires).
Les classer par ordre dimportance en
regard des rsultats de production et de la
scurit.
Disposer les informations utiles dans le
champ visuel en tenant compte des lignes
de vise naturelles propres aux diffrents
types de tches visuelles.
Dans le plan vertical, disposer si possible
les informations dans un angle de 40 en
dessous de la ligne horizontale partant
des yeux (voir figure 5.1).
Dans le plan horizontal, disposer les infor-
mations frquentes (ou importantes)
lintrieur dun angle de 30 devant lop-
rateur, et accessoires lintrieur dun
angle de 140.
Disposer les informations utiles dans
lespace de faon viter les contraintes
posturales, limiter ses dplacements et
permettre une rponse rapide sur les
dispositifs de commande.
Faciliter la perception des informations
utiles : par un clairage adapt (de 300
1 000 lux ou plus suivant la tche), en
agissant sur la dimension des caractres
et en assurant un bon contraste entre lob-
jet percevoir et le fond, en distinguant
clairement les zones de fonctionnement
normal des zones alerte pour les
appareils de signalisation, en recourant, le
cas chant, un doublement du signal
(visuel et sonore) ou une diffusion en
clair de linformation (affichage dun texte
ou de chiffres, message vocal). noter :
lutilit dun retour dinformation rapide
suite une action de loprateur.
Exemples :
Poste daccueil du public : application des
deux premiers principes noncs prc-
demment (voir tableau ci-aprs).
Indicateurs et commandes de machines
sur bras orientable (voir figure 5.2).
Zone dalerte indique en rouge, sur un
cadran (voir figure 5.3).
Fig. 5.3. Zone dalerte sur un cadran.
Erreurs viter :
Manque dinformation (ex. : commande
non identifie sur machine).
Surabondance dinformations.
Indicateurs peu lisibles ou mal positionns
dans lespace.
Interprtation difficile des signaux visuels
ou sonores.
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
Fig. 4.2. Cabine isolant du bruit tout
en maintenant les contacts dans lquipe.
Fig. 4.3. Dispositif intgr daspiration.
aspiration
intgre lvier
25
40
25 Recommand
(informations
frquentes et/ou
importantes)
Acceptable
(informations
accessoires)
Fig. 5.1. Disposition des informations
dans le champ visuel.
Poste
daccueil
du public
Quelles sont
les informations
utiles ?
tre inform
de larrive
du client.
Comment
les prendre
en compte
au poste?
Porte dentre
dans le champ
visuel de lagent
daccueil.
Signal sonore
lentre dune
personne.
Bras orientable
Pupitre de signalisation et de commande
Information directe travers le vitrage
Fig. 5.2. Pupitre sur bras orientable.
6 Fiche pratique de scurit ED 79
Bibliographie:
Norme NF EN 894. Spcifications ergono-
miques pour la conception des dispositifs de
signalisation et des organes du service. Par-
ties 1, 2, 3 et 4.
6. MANUTENTION ET EFFORTS
Lobjectif est de limiter les manutentions
manuelles et les efforts exercer pour viter
les accidents et prvenir les troubles muscu-
losquelettiques.
Les principes mettre en uvre sont les sui-
vants :
Connatre les objets et les produits mani-
puls, les efforts exercs :
pour les objets, produits et outils, prci-
ser leurs dimensions, volume, poids uni-
taire, type de conditionnement et leur
nature,
relever le type et la frquence des manu-
tentions ou manipulations effectues,
dcrire les efforts exercer sur les com-
mandes des machines, sur les outils, sur
les produits.
Faciliter le transfert des produits :
favoriser le transfert des produits laide
de glissires, de bandes transporteuses
ou de tables billes par exemple,
viter les changements de niveau entre
deux plans de travail successifs, entre
deux machines contigus ncessitant
une reprise manuelle,
utiliser des dessertes mobiles pour
dplacer, sans les porter, des produits et
des outils.
Rduire la charge unitaire et le tonnage
journalier :
rduire la charge unitaire en agissant sur
le type de conditionnement, sur les
produits,
valuer et diminuer si ncessaire le ton-
nage journalier manutentionn laide
des abaques (voir figure 6.1) de manire
se situer dans la zone acceptable.
Fournir des aides la manutention:
utiliser des aides la manutention pour
dplacer les charges lourdes, encom-
brantes (par exemple, quilibreurs de
charge pour manipuler des cartons, des
tles, des sacs),
installer des stockages dynamiques qui
autorisent une reprise frontale,
mettre disposition des corbeilles, des
casiers mobiles, permettant de regrou-
per plusieurs objets ou produits dpla-
cer, par exemple pour le courrier, pour
des outils ou pour de petits objets.
Limiter les efforts exercer :
limiter les efforts exercer sur les
commandes, par exemple en utilisant
des relais lectriques pneumatiques ou
hydrauliques plutt que des commandes
mcaniques (force de 3 20 daN suivant
la position des commandes et la fr-
quence),
rduire les efforts par lutilisation doutils
adapts, par exemple, une visseuse
dvisseuse portative plutt quun tour-
nevis, des couteaux bien affils,
mettre en place des aides pour le soul-
vement, par exemple, un ressort de
rappel ou un vrin pour faciliter le mou-
vement dun capot,
choisir des outils dont la conception
vite des angles excessifs, notamment
du poignet.
Exemples :
Desserte mobile servant de caisse outils
et de plan de travail annexe (voir figure
6.2).
Fig. 6.2. Desserte mobile servant de caisse outils
et de plan de travail annexe.
Potence avec pince pneumatique compen-
se (voir figure 6.3).
Erreurs viter :
Les manutentions avec postures contrai-
gnantes, bras tendus, dos courb, torsions
du corps
Les charges unitaires encombrantes ou
difficiles saisir.
Le port de charge sur des distances impor-
tantes.
Bibliographie:
Les troubles musculosquelettiques, INRS,
2005, ED 957.
NF X35-109, Ergonomie Manutention
manuelle de charge pour soulever, dplacer
et pousser/tirer, AFNOR, 2009.
7. DIMENSIONNEMENT
ET POSITIONS DE TRAVAIL
Lobjectif est de permettre de travailler dans
des positions adaptes non dangereuses
pour la sant et confortables. Les principes
mettre en uvre sont les suivants :
Recueillir les donnes de base.
Dcrire les lments du poste de travail qui
vont dterminer les postures : les dimen-
sions et emplacements des commandes, la
taille et la forme des outils, des objets, des
machines utiliser ou atteindre.
Noter les dimensions des plans de travail
prdtermins et des zones de travail.
Relever les points durs prsents dans
lespace de travail : bti de machine, sup-
ports, canalisations, poutre, pilier
Choisir la position principale (debout,
assise ou assis-debout) en fonction des
lments suivants : volume de travail, exi-
gences de force et espace pour les jambes.
Par exemple, si le travail peut tre effectu
dans les zones datteinte des bras, les
objets manipuler lgers et lespace suffi-
sant pour les genoux, la position assise est
indique.
Fig. 6.1. Abaque pour la manutention manuelle
des charges.
Fig. 6.3. quilibreur de charge diminuant leffort.
ED 79 Fiche pratique de scurit 7
Respecter les angles articulaires des diff-
rentes parties des membres et du corps.
Permettre les changements de position et
viter les postures statiques longues. Par
exemple, en alternant les positions assises et
debout (poste assis surlev), en concevant
le poste pour permettre lutilisation dun
appuie-fesses rglable (voir figure 7.1.b).
Exemples :
Zones de confort et datteinte pour un
poste dassemblage (voir figure 7.2).
Erreurs viter :
Les postures contraignantes : dos courb,
bras tendus, bras levs, torsions et flexions
du tronc, du cou.
Les postures immobilisant durablement
une partie du corps.
Les zones de travail triques , cest--
dire ne permettant pas de se mouvoir sans
tre gn ou heurt par des lments fixes
ou mobiles.
Bibliographie:
NF EN ISO 14738, Prescriptions anthropo-
mtriques relatives la conception des
postes de travail sur les machines, AFNOR,
2008.
Prvention des risques lis aux positions de
travail statiques, INRS, 2008, ED 131.
SYNTHSE
Les sept points dcrits prcdemment peuvent
tre utiliss lors des diffrentes phases dun
projet de conception ou damnagement des
postes de travail. Lefficacit sera dautant plus
grande que le projet aura t instruit ds la
dfinition du cahier des charges en concerta-
tion avec les acteurs concerns.
1. Lors de lanalyse des postes
dj existants
La prise en compte de ces sept thmes peut
aider reprer les points forts et faibles de la
situation existante (lorsque le poste cr est
peu diffrent des postes qui fonctionnent
dj dans lentreprise ou dans dautres entre-
prises). Ce constat permettra ensuite de trans-
former le poste de travail en conservant les
points forts et en amliorant les points faibles.
2. Lors de la conception du poste
de travail
Il est ncessaire, au pralable, de situer
le poste dans le processus et comme un
lment parmi dautres de la situation de
travail, de reprer les points durs et in -
contournables (ex. : lments de structure
du btiment), dvaluer les contraintes modi-
fiables allant lencontre de bonnes condi-
tions de travail. On peut ensuite reprendre
les sept points en allant du plus gnral (ex. :
accs, circulation) au plus particulier (ex. :
positions de travail) et en les utilisant pour
trouver la meilleure implantation du poste,
pour choisir les quipements les mieux
adapts et pour agencer lensemble.
Selon les caractristiques du projet, certains
des sept points doivent tre privilgis. Par
exemple, pour la conception dun bureau
daccueil, la communication et les postures
Pour la posture debout, prvoir un dgage-
ment pour les pieds et si possible un plan
de travail rglable. Pour la posture assise,
prvoir un dgagement pour les genoux et
les jambes (voir figures 7.1.a et 7.1.c).
Se situer dans les zones de confort pour
les gestes et positions les plus frquentes
(bras le long du corps et espace de mobi-
lit des avant-bras) et rester dans les zones
datteinte pour les autres (latteinte maxi-
male correspond aux bras tendus, voir
figure 7.1.d).
Exigences de vision
et/ou de prcision leves
Exigences de vision
et/ou de prcision moyennes
Espace pour les pieds
profondeur : 210 minimum
Espace pour
les pieds hauteur :
130 minimum
Exigences de vision
et/ou de prcision peu
importantes (permet la
manutention dobjets lourds)
1 554
1 195
1 075
Hauteur rglable
conseille :
1 050
930
810
a) Position debout
(espace pour les pieds)
(espace pour les jambes)
b) Position assis/debout : hauteur rglable du plan
de travail et espace pour les jambes
570 min.
285
min.
1 330
800
840
15
630
575
370
820
495
540 min.
(espace pour les genoux)
755 min. (espace pour les jambes)
c) Position assise rglable (sige et plan de travail) :
hauteur d'espace pour les jambes
60
415
1 170
480
170 - 290
d) Zone de travail conseille
(mesures fondes sur une surface de sige horizontale)
Fig. 7.1. Dimensionnement du poste de travail
(cotes en millimtres). Population europenne.
Zone de confort Zone datteinte
Fig. 7.2. Zones de confort et datteinte
pour un poste dassemblage.
d) Zone de travail conseille
(mesures fondes sur une surface
de sige horizontale)
Institut national de recherche et de scurit pour la prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles
65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris
Tl. 01 40 44 30 00
www.inrs.fr
e-mail : info@inrs.fr
1
re
dition (1999) rimpression septembre 2013 2 000 ex. ISBN 978-2-7389-1521-4
Fiche pratique de scurit ED 79
doivent davantage tre prises en compte que
les manutentions. Ainsi, la mise en uvre
simultane des deux principes : disposer
des informations utiles dans le champ
visuel (dcrit dans le point 5), et se situer
dans les zones de confort pour les gestes et
positions de travail les plus frquentes
(dcrit dans le point 7) conduit concevoir
une disposition optimale du poste (voir
figure 8).
Cette fiche a t rdige par un groupe de travail
de lInstitution Prvention constitu par tienne
Cam (CRAM de Bretagne), Bernard Durand (CRAM
Centre-Ouest), Michel Valadi (CRAM Midi-
Pyrnes) et Bernard Vandevyver (INRS).
La mise jour a t effectue par Jean-Louis
Pomian (INRS).
Plan de travail face aux visiteurs
cran-clavier
Imprimante
Fig. 8. Disposition optimale dun poste en contact avec la clientle.
Lamnagement doit permettre la fois
loprateur de conserver le contact avec le
client (mme lorsquil utilise son cran et
son imprimante) et dtre en position confor-
table pour chacune de ses tches.
3. Lors de lvaluation
La confrontation entre les options rete -
nues et les sept points doit
permettre dvaluer les dif-
frents projets et, parap -
proximations successives,
de parvenir un projet final
optimal. ce stade, des compro mis
peuvent encore tre trouvs lorsque des
exigences contradictoires apparaissent
dans la mise en uvre des solutions (ex. :
limiter le bruit sans isoler les oprateurs,
concilier les exi gences conomiques
et les prconisations ergonomiques).
Cette valuation sur projets sera
complte, aprs ralisation, par une
validation du rsultat final avec les utili -
sateurs.
Vous aimerez peut-être aussi
- Processus de Collecte (Wizall Money)Document5 pagesProcessus de Collecte (Wizall Money)Shams Al Mareef CisséPas encore d'évaluation
- Bulletin D Inscription SyscoahadaDocument2 pagesBulletin D Inscription SyscoahadaMamadou GueyePas encore d'évaluation
- 731 Em07082012Document19 pages731 Em07082012elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- GRH Chap3 GPECDocument10 pagesGRH Chap3 GPECSimo zroudiPas encore d'évaluation
- Exercices DS MCCDocument22 pagesExercices DS MCCAnas Yassine50% (2)
- Brochure IR2520 25 30 35 45Document2 pagesBrochure IR2520 25 30 35 45birkzoPas encore d'évaluation
- G MonLivredeFrancais4eAP2019 PDFDocument248 pagesG MonLivredeFrancais4eAP2019 PDFTaha ELPas encore d'évaluation
- Production de RizLocalDocument18 pagesProduction de RizLocalsakhoibPas encore d'évaluation
- Application Numérique 13000 EH PDFDocument39 pagesApplication Numérique 13000 EH PDFBadre Ddine Jah-Gon PhénoménalePas encore d'évaluation
- Penalites Retard Ds MPDocument2 pagesPenalites Retard Ds MPprsnnnPas encore d'évaluation
- Exposé APIDocument37 pagesExposé APIbabersonPas encore d'évaluation
- c3 Objets ExcelDocument34 pagesc3 Objets ExcelOssa yamPas encore d'évaluation
- 2015 AmNord Exo1 Sujet SuperHeros 6pts PDFDocument3 pages2015 AmNord Exo1 Sujet SuperHeros 6pts PDFHatouma SemegaPas encore d'évaluation
- MGR BoshaDocument4 pagesMGR BoshaPirlo PoloPas encore d'évaluation
- FR FANOXPC DATA CM PhaseTemperature ST-ST-D D00Document1 pageFR FANOXPC DATA CM PhaseTemperature ST-ST-D D00Alex AngoraPas encore d'évaluation
- Aquapresso FR Low 2Document8 pagesAquapresso FR Low 2haroldPas encore d'évaluation
- Merged 20200621 174501Document6 pagesMerged 20200621 174501Ali FguiriPas encore d'évaluation
- Tarifs WU BureaudePosteDocument2 pagesTarifs WU BureaudePosteedouardsaldoPas encore d'évaluation
- Module 04 Etablissement Des Devis Quantitatifs Et EstimatifsDocument72 pagesModule 04 Etablissement Des Devis Quantitatifs Et EstimatifsTABTI MOHAMED100% (14)
- Controle 1 2017Document3 pagesControle 1 2017Mohamed IyadPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Mesure PneumatiqueDocument10 pagesChapitre 3 - Mesure PneumatiqueSmail LebbalPas encore d'évaluation
- CRADocument2 pagesCRAAmél BenoufellaPas encore d'évaluation
- Présentation Générale Salon REUNIR 2018Document21 pagesPrésentation Générale Salon REUNIR 2018ROUETPas encore d'évaluation
- SPAC - Présentation Agence Sud-Ouest Grands ProjetsDocument21 pagesSPAC - Présentation Agence Sud-Ouest Grands ProjetsGuirecQPas encore d'évaluation
- 222 PPT Final LogistiqueDocument22 pages222 PPT Final LogistiqueChaimae EL MoussaouiPas encore d'évaluation
- Guide Technique Parasismique BelgeDocument121 pagesGuide Technique Parasismique BelgeJalal KePas encore d'évaluation
- Series TD - CombustionDocument3 pagesSeries TD - CombustionAlliche MounirPas encore d'évaluation
- RF 232 DolibarrDocument36 pagesRF 232 DolibarrIssaka OuedraogoPas encore d'évaluation
- Groupes - Équipes - Séances Et Jeux de Données - TP Hydraulique L3 GC Et MécaDocument4 pagesGroupes - Équipes - Séances Et Jeux de Données - TP Hydraulique L3 GC Et MécakheloufimeriemrazanePas encore d'évaluation
- Automates A PileDocument115 pagesAutomates A PileSahbi SkPas encore d'évaluation