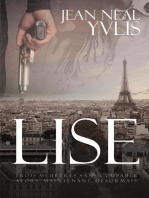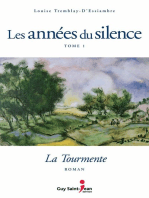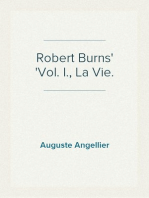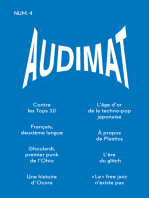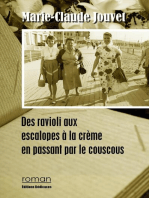Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Svensson2004 Diss Criteres de Figement
Svensson2004 Diss Criteres de Figement
Transféré par
sundongyCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Svensson2004 Diss Criteres de Figement
Svensson2004 Diss Criteres de Figement
Transféré par
sundongyDroits d'auteur :
Formats disponibles
Critres de figement
Critres de figement
Lidentification des expressions figes en franais contemporain
Maria Helena Svensson
Skrifter frn moderna sprk 15
Institutionen fr moderna sprk
Ume Universitet 2004
Institutionen fr moderna sprk
Ume universitet
SE-901 87 Ume
Tfn. +46 90 786 51 38
Fax. +46 90 786 60 23
http://www.mos.umu.se/forskning/publikationer
http://publications.uu.se/umu/theses/
Skrifter frn moderna sprk 15
Ume universitet ISSN 1650-304X
Skriftseriens redaktr: Raoul J. Granqvist
2004 Maria Helena Svensson
Tryckt av: Print & Media 2004:20000320
ISBN 91-7305-722-3
ISSN 1650-304X
Omslag: Tommy Sund
la mmoire de mon grand-pre, Sven Bergman
Quant au mot fige , il peut tonner au premier abord,
mais il est prfrable, me semble-t-il, fossile ou
ptrifie , parce que ceux-ci font penser quelque
chose de mort, tandis que les locutions en question restent
vivantes, bien que dune autre manire qu lorigine. De
plus, fige peint mieux que fixe le changement
quont subi ces locutions.
Pour les locutions, il tait insatiable de renseignements, car, leur
supposant parfois un sens plus prcis quelles nont, il et dsir
savoir ce quon voulait dire exactement par celles quil entendait le
plus souvent employer : la beaut du diable, du sang bleu, une vie
de bton de chaise, le quart dheure de Rabelais, tre le prince des
lgances, donner carte blanche, tre rduit quia, etc., et dans
quels cas dtermins il pouvait son tour les faire figurer dans ses
propos. leur dfaut, il plaait des jeux de mots quil avait appris.
Marcel Proust
Lars Lindberg, 1898
Sommaire
Remerciements..................................................................................................................... 10
Table des abrviations et des symboles............................................................................... 12
1 Introduction....................................................................................................................... 13
2 Analyse des critres.......................................................................................................... 42
3 Conditions ncessaires et suffisantes............................................................................... 139
4 Rapports entre les critres de figement examins............................................................ 146
5 Lexpression fige comme catgorie linguistique............................................................ 179
6 Conclusion........................................................................................................................ 182
Bibliographie....................................................................................................................... 186
Table des matires............................................................................................................... 195
Remerciements
Maintenant quil est temps de remercier tous ceux qui mont aide dune manire ou dune
autre au cours du travail, je me rends compte que le nombre de personnes impliques est
norme. Cela me rend un peu hsitante. Est-ce vraiment moi qui ai crit ce livre?
videmment je prends toute la responsabilit du texte, mais sans vous, le travail aurait t
non seulement plus difficile mais aussi moins amusant.
Ma plus grande gratitude va envers mes directeurs de thse, Ingmarie Mellenius, qui ne
sest jamais dpartie de son enthousiasme quelles quaient t les difficults aborder et Hans
Kronning, qui, quoique loin gographiquement, a toujours lu de prs tout ce que je lui ai
envoy. Merci aussi Karl Johan Danell, linstigateur du projet sur les expressions figes,
phnomne qui ds le dbut a su me passionner.
Je considre mes collgues lUFR des langues modernes dUme comme plus que des
collgues. Vous mavez tous aide non seulement dans la recherche mais dans la vie au sens
le plus large. Vous vous tes occups de moi tant sur un plan professionnel que personnel.
Vous avez pris le temps de lire et de commenter mon travail, vous mavez aid transporter
des meubles et des cadeaux de Nol, vous mavez invite des bals masqus et dautres
ftes. Vous mavez appris apprcier les films les plus tranges et vous avez pris je ne sais
combien de cafs en ma compagnie. Noublions pas non plus toutes les fois o nous avons
simplement djeun ou dn ensemble.
Je remercie ainsi : Florence Sisask, qui corrige mon franais, minvite dner et
memmne des activits culturelles mon rat de sucre , que ferais-je sans toi? Ma chre
Malin Isaksson, merci pour toutes les fois o nous avons rigol ensemble et pour nos sjours
Paris. Barbro Nilsson, tu es une mine de sagesse et je testime beaucoup. Merci dtre l
quand jai besoin de tes conseils. Monika Stridfeldt, tu as souvent t interrompue dans ton
travail par mes questions. Merci davoir pris le temps de mcouter. Anders Steinvall, jai
beaucoup apprci nos discussions linguistiques ainsi que toutes les fois o tu mas sauv la
vie en raison de problmes se rapportant lordinateur. Maria Lindgren, merci davoir eu la
gentillesse de bien vouloir continuer notre amiti malgr notre premire rencontre un peu non-
conventionnelle parmi les ordinateurs Berkeley. Katarina Gregersdotter, les conseils que tu
me donnes sont toujours juste ce quil me faut pour continuer. Si tu savais quel point ta
compagnie contribue mon bien-tre. Berit strm, merci pour les symposiums trs
sympathiques que tu as organiss la campagne. Merci galement de moffrir gnreusement
ta merveilleuse tarte aux fraises lors de nos rencontres cinmatographiques. Mes
remerciements vont encore Carin Agerhll, Marianne Videkull, Oliver Par, Christian
Ferreux, Morgan Lundberg, Van Leavenworth, Stefano Salmaso, Gerd Lilljegren, Ingmar
Shrman, Christina Karlberg et Johan Nordlander pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Parfois, pour ne pas dire le plus souvent, je suis convaincue que ma vie serait plus simple
sans ordinateur, mais javoue men tre beaucoup servi malgr tout. Par consquent je remercie
nos deux Magnus, Nordstrm et Olofsson, ainsi que Jan ( Umdac-Janne ) Petterson et
Andreas Sjberg. Sans votre aide ce livre aurait t crit la main.Enfin, merci tous les
autres qui, dune manire ou dune autre, ont particip la ralisation de ce livre.
Ma gratitude va galement lUFR des langues romanes dUppsala. Merci Kerstin
Jonasson, Stig Bjrkman, Coco Norn, Dan Nosell, Gunilla Ransbo, Helena Pontn, Carina
Andersson et Charlotte Lindgren de mavoir invite votre sminaire de linguistique. Vos
commentaires mont t trs prcieux. Je remercie galement Jrme-Frdric Josserand, qui
a lu et comment le texte dans son intgralit.
En outre, jai t ravie dapprendre que javais une nouvelle collgue dans le domaine
des expressions figes franaises et jai beaucoup apprci notre rencontre. Merci Fanny
Forsberg de lUniversit de Stockholm.
Je suis trs reconnaissante au Service des relations internationales de lUniversit dUme
qui a rendu possible mon sjour lUniversit de Californie Berkeley pendant lanne 1998-
1999. Merci Britt-Marie Nordgren et Sverker Srlin qui taient les responsables de
lchange cette anne-l. Berkeley, les UFR de linguistique et de franais mont accueillie
chaleureusement. Eve Sweetser et Paul Kay ont eu la gentillesse de maider et de commenter
mon travail. Je vous remercie. Susanne Fleischmann a t une grande source dinspiration
pendant mon anne Berkeley. La nouvelle de sa disparition ma beaucoup attriste. Delle et
de Californie je nai que de bons souvenirs.
La fondation J C Kempes Minnes Stipendiefond ma accord une bourse qui ma permis de
poursuivre mes recherches pendant une priode o je navais pas de salaire. Grce au Fonds
Birger Calleman, jai pu entreprendre plusieurs voyages Paris dans le but dy trouver des
publications linguistiques. plusieurs reprises jai pu participer au congrs des romanistes
scandinaves. Pour cela je remercie le Fonds Calleman ainsi que la fondation Knut och Alice
Wallenberg, qui ont aid financer ces voyages.
Le club daikido Bjrkstaden ma fait dcouvrir quon pouvait pratiquer un art martial en
samusant. Merci dtre comme une famille pour moi. Je remercie particulirement Nina
Andersson, Elsabet Einarsdttir, Tommy Sund et Camilla Moberg qui mont soutenue et
encourage de bien des manires.
Merci tous mes parents (jen ai quatre!), qui me reoivent chez eux quand jen ai le plus
besoin. Jenvoie des bisoux ma grand-mre Estrid Bergman qui depuis mon enfance mest
si chre. Finalement un grand merci mes amis Leo Ngaosuvan, Maria stbye, Susanne
Schander, Ti Cooper, et Helne Lindahl. Merci Leo pour ton soutien et ta comprhension.
Merci Maria pour toutes les fois que tu mas loge chez toi Uppsala. Merci Susanne pour de
longs appels tlphoniques. Merci Ti de rester si proche tout en habitant si loin. Merci Helne
de rester une de mes meilleures amies depuis bientt trente ans. Notre amiti vaut plus que tu
ne peux timaginer.
Table des abrviations et des symboles
CDI Cobuild Dictionary of Idioms
CDLITT Dix sicles de culture franaise, CD-ROM
COMP compositionnel
CCT complment circonstanciel de temps
DEI Dictionnaire des expressions idiomatiques
DEL Dictionnaire des expressions et locutions
DLS Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage
DPM Dictionnaire des proverbes sentences et maximes
FO Franska ordboken
LB La libre Belgique
ME Le monde conomique
MO Le monde
MOD modification
MOT motiv
N nom
PART partiellement
POSS adjectif possessif
PR Le Petit Robert
qqch
1
quelque chose
qqn
2
quelquun
SN syntagme nominal
SO Le soir
TLF Le Trsor de la langue franaise
VB verbe
* non acceptable
? acceptabilit douteuse
non attest
non fig
[] (dans les citations) omission
1
Abrviation du Petit Robert.
2
Abrviation du Petit Robert.
1 Introduction
1.1 Gnralits
Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la phrasologie il est vident quil faut tenir
compte de lexistence des suites de mots prfabriques . Or, limportance des expressions
figes est aussi forte pour les linguistes qui tudient dautres domaines que pour les usagers de
la langue, car le phnomne de figement y est omniprsent.
Les termes utiliss pour dcrire ces groupes de mots souvent appels figs, pour des
raisons que nous croyons pouvoir prciser dans cette tude sont nombreux. Parmi ces
termes, on citera titre dexemple locution, idiome, phrase fige, expression toute faite,
fonction lexicale et phrasme
3
. Comme lindique dj cette abondance de termes, le sujet de
ce travail nous ramne une problmatique thoriquement vaste et trs subtile.
La problmatique du figement tant intressante en soi, le phnomne est galement
important sous un autre angle : plusieurs chercheurs signalent le fait que ces groupes de mots
que nous appellerons par la suite expressions figes ne reprsentent nullement un
phnomne marginal de la langue. Ainsi, Danell (1992) estime que le nombre de stock
phrases
4
en franais couvre entre 20 et 30% dun texte donn. Dautres chercheurs ont
examin diffrents types dexpressions, dfinis autrement, et obtiennent en consquence
dautres chiffres. Selon Meluk (1993:83), le nombre dexpressions ( phrasmes
5
dans sa
terminologie) dans la langue franaise slve des dizaines de milliers . Dans un volume
consacr la locution (Martins-Baltar [d.] 1997), G. Gross (1997:202) fait remarquer quil y
a prs de 200 000 noms composs ou dont la combinatoire nest pas libre, prs de 15 000
3
Afin dillustrer explicitement la diversit de la terminologie, nous citons les termes lis la phrasologie et au
figement rencontrs au cours de nos recherches : brachysmie, clich stylistique/rhtorique, dicton, nonc
cod/frquent, expression fige/figure/idiomatique/toute faite, forme convenue, idiome, idiotisme, fonction
lexicale, gallicisme, phrase lexicalise, locution, locution proverbiale, mtaphore, mot compos, phrasme,
phrasologisme, proverbe, signe fractionn, tour et tournure.
Dans la littrature en langue anglaise on trouve galement de nombreux termes : clause, conventional
collocation, colligation, discourse structuring device, formulae idiom, irreversible binomial, phrase, prefab,
quotation et simile.
4
Selon Danell (1992:18), stock phrase se dfinit comme [] both idioms and phrases without metaphor or
strange syntax (including collocations) that I judge as being part of the lexicon [] .
5
La dfinition quil donne du phrasme est : Un phrasme de la langue L est une expression multilexmique
de L qui ne peut pas [] tre produite, partir dune situation donne ou dun sens donn, selon un dictionnaire
de mots de L et partir des rgles gnrales standard de L (Meluk 1993:83). Il est intressant de noter que,
malgr les nombreuses conditions qui doivent tre remplies selon cette dfinition, le nombre de phrasmes est,
selon lui, trs lev.
13
adjectifs et au moins 30 000 verbes figs . Certes, ces chiffres ne sont pas absolus, tant
donn que les expressions vises dans ces citations nont pas t calcules partir de la mme
dfinition, mais ils nous offrent des indices sur limportance de la partie fige de la
langue.
Pourquoi donc toutes ces expressions figes ? Est-ce une faon plus conomique de
sexprimer que demployer un groupe de mots tout fait, au lieu de choisir chaque mot
sparment ? Cest lavis de Hudson (1998:139), qui signale que les locuteurs dune langue
obtiennent un maximum dconomie en rptant les expressions quils ont dj entendues, au
lieu den crer continuellement de nouvelles. Sil est vrai que pour le locuteur il est plus
conomique davoir recours des constructions toutes faites, il est galement possible que
cela permette lauditeur de dcoder plus facilement un message. Dans une certaine mesure,
cette prfabrication dexpressions facilite donc aussi bien la production que la perception des
noncs.
Selon Misri (1987b:7), cest dans lquilibre entre la productivit de la langue et le recours
des noncs prfabriqus que se trouve lconomie. Fabriquer tout le temps de nouveaux
noncs demanderait beaucoup defforts. Toutefois, tre oblig de mmoriser tous les noncs
possibles pour sen servir ensuite selon les besoins, prsenterait autant de difficults. Une
tude sur la manire dont les locuteurs dune langue alternent entre expressions figes et
syntaxe libre serait intressante faire, mais dpasse les limites de cette tude
6
.
Sil y a aujourdhui des travaux de recherche consacrs la phrasologie, noublions pas
quelle est longtemps reste sinon oublie, du moins un peu dans lombre des recherches
domines par lcole gnrativiste. Il est gnralement admis que lapproche gnrativiste
narrive pas rendre compte de la partie fige de la langue
7
. Cela dit, on constate cependant le
mme manque dans dautres approches linguistiques. Les tentatives de dfinition du
phnomne de figement nont pas t sans problmes. Il ny a toujours pas de dfinition claire
et univoque, ce qui pose des problmes dlicats aux chercheurs dans le domaine de la
phrasologie. Le fait linguistique du figement a t obscurci par des dnominations floues et
trs htrognes, de sorte quon est en prsence de strates dfinitionnelles trs souvent
incompatibles , crit par exemple G. Gross (1996:3). Selon Heinz (1993:5), les essais de
classifications des locutions se heurtent maintes difficults, souvent dues la complexit
du phnomne de la locution et limpossibilit de le dcrire dun seul point de vue . Elle
(1993:5) constate galement que quels que soient les critres retenus, il y aura toujours des
locutions qui chapperont une classification .
La prsente tude se propose de remplir certaines des lacunes constates. En soumettant les
critres prsents par dautres chercheurs en phrasologie une analyse approfondie, nous
esprons pouvoir cerner la problmatique dont il est question. Pour ce faire, il sera ncessaire
dexaminer de prs le terme de critre. Une fois les critres proposs dcrits et analyss, leur
validit est dfinie en termes de conditions ncessaires et/ou suffisantes ou dindices. Pour
complter la description des critres, les relations entre eux seront ensuite examines en
dtail. Finalement, si lexpression fige est si souvent considre comme une catgorie
6
Voir Mejri (1997:36-56). Voir aussi Moon (1998:30-31) pour des rfrences quelques tudes dordre
psycholinguistique.
7
Cf. Chafe 1968, Weinreich 1969, Fraser 1970 et Hudson 1998:29.
14
linguistique, la raison en est peut-tre que les critres se laissent grouper en ressemblances de
famille. Cette hypothse sera galement pose dans ce travail.
Nous commencerons par montrer la complexit de la terminologie phrasologique en
dcrivant certaines notions indispensables dans ltude de la phrasologie, telles que
expression fige, catgorie et critre. Nous prsenterons ensuite plusieurs catgories
frquemment mentionnes dans les tudes des expressions figes : idiome, locution,
collocation, proverbe, gallicisme et phrasme. Une section de la partie Terminologie sera
consacre la mtaphore, tantt utilise comme critre, tantt qualifie de catgorie. Nous
parlerons galement de la notion de porte de figement
1.2 Terminologie
La terminologie dans le domaine de la phrasologie est trs complexe. Une consquence de
cela est quelle est employe de manire incohrente par les chercheurs, ce qui nous amne
deux constatations :
1) en raison du manque de cohrence dans lusage des termes, le mme terme peut
donner lieu des interprtations diverses selon lapproche phrasologique adopte
2) certains chercheurs utilisent des termes mal dfinis ou contradictoires dans
leurs propres travaux
Les dfinitions suivantes
8
peuvent servir clarifier notre premire constatation :
[...] une locution prototypique est caractrise [...] par sa non-compositionnalit.
On a beau comprendre tous les mots qui entrent dans tirer le diable par la queue,
cela ne suffit pas pour comprendre ce que cette locution veut dire. (Martin
1997:293)
[...] compositionality that is, the degree to which the phrasal meaning, once
known
[ 9 ]
, can be analyzed in terms of the contribution of the idiom
parts. (Nunberg et al. 1994:498)
La premire chose noter ici, est que selon la premire dfinition, la non-compositionnalit
est mise en vidence par la difficult de comprendre lexpression en question (ici, une
locution). Selon la deuxime dfinition, en revanche, le degr de compositionnalit peut tre
tabli, une fois que le sens de lexpression (lidiome) est dj connu.
Si nous prtendons que certains chercheurs utilisent des termes contradictoires, cela est
probablement d davantage la complexit de la langue qu linconsistance des chercheurs
en ce qui concerne la terminologie. Hudson (1998:64-67) discute les termes anglais
salience , prominence et transparency . Ces termes semploient pour ce qui est
prototypique et clair mais ils sont aussi lis la frquence. Le plus tonnant peut-tre dans sa
thse, est sa conclusion quun emploi mtaphorique peut tre interprt comme lemploi
prototypique de certains mots :
8
Elles sont discutes infra dans 2.3.
9
Cest nous qui soulignons.
15
A further kind of non-salient word meaning is exemplified by way, which can be
used in a concrete sense (path, road) or in an extended metaphorical sense
(fashion, means). Corpus investigation shows [] that the latter metaphorical
sense is much more frequently used in present-day English, and I therefore call
this the salient sense. (Hudson 1998:66)
Il nest donc pas possible dtiqueter les emplois mtaphoriques comme prototypiques ou non
il faut regarder chaque cas sparment, ce qui rend la frquence de tel ou tel sens encore
plus importante. Hudson (1998:66) ajoute propos de sens prototypique, quil est le plus
souvent difficile de dcider quel est le sens considrer comme le plus prototypique dun
mot.
Il est vident que si Hudson se sent oblige de redfinir certains termes chaque fois
quelle veut les appliquer, il est impossible de savoir dans quel sens dautres chercheurs
emploient les mme termes, sils nont pas clairement dclar leur point de vue sur le sujet.
Ainsi, des termes comme premier sens , sens additionnel
10
ou sens prototypique ne
se passent pas dexplications dtailles.
La terminologie est donc abondante et complexe. Pour plus de clart, il convient dabord
de faire une distinction entre catgories et critres, cest--dire entre dune part tous les
diffrents types dexpressions figes et dautre part ce qui les dfinit.
Les critres sont ncessaires pour la classification, do rsultent les catgories, puisque
les critres dfinissent clairement les expressions. Pour mentionner quelques exemples,
idiome, collocation et locution sont des catgories (jusquici pas trs bien dlimites), tandis
que non-compositionnalit, syntaxe marque et blocage grammatical sont des critres.
1.2.1 Expression fige
Une des notions qui posent problme est, justement, celle dexpression fige. Le terme fige
fait peut-tre penser en premier lieu un figement morphosyntaxique, o il nest pas
possible deffectuer de changement sur les parties dont lexpression est constitue. Pour une
expression entirement fige les variations morphosyntaxiques (dclinaisons, conjugaisons et
transformations, entre autres) seraient donc restreintes sinon inexistantes et il ne serait pas
non plus possible deffectuer de commutations des lments lexicaux. Or, on ajoute souvent
au sens de la notion un autre trait fig , savoir un figement dordre mmoriel ou
psychologique. Lexpression en question existerait donc telle quelle dans la mmoire du
locuteur. Autrement dit, le locuteur sait que les mots de lexpression forment une unit. Il
sensuit quil y a plusieurs dfinitions de figement. Les linguistes travaillant dans le cadre de
la phrasologie en ont propos diffrents types, comme lindiquent dj les exemples
suivants :
Expression fige en raison dun blocage grammatical :
Le seul trait de blocage grammatical
11
serait considrer comme dcisif pour lidentification
dexpressions figes. Ainsi, Hudson (1998:9) affirme que sa dfinition dexpression fige
( fixed expression ) est base sur les critres contraintes syntaxiques ( unexpected
10
voqus infra par Mel uk (1.2.2.6).
11
Ce critre implique des restrictions syntaxiques ou des blocages de transformations. Voir infra 2.6.
16
syntactic constraints on the constituent parts
12
) et restrictions collocationnelles
( unexpected collocational restrictions within the expression
13
). Elle appelle ces deux
critres des critres variationels ( variability criteria ) et dit explicitement (1998:9) : The
term fixed expression will be used to refer exclusively to expressions that are fixed according
to variability criteria
14
.
Expression fige en raison dun figement syntaxique ou smantique :
La dfinition dune expression fige dpendrait soit dun figement syntaxique soit dun
figement smantique. G. Gross (1996:154) fait une distinction entre ces deux types de
figement : Une squence est fige du point de vue syntaxique quand elle refuse toutes les
possibilits combinatoires ou transformationnelles [...] Elle est fige smantiquement quand le
sens est opaque ou non compositionnel
15
. Gaatone (1997:165-166) constate limportance de
l arbitraire pour la locution. Il prcise : [...] Arbitraire soit syntaxique, soit smantique,
arbitraire souvent dans la mtaphore sous-jacente la locution, si mtaphore il y a [...]
16
.
Expression fige en raison de sa conventionnalit :
Une expression, flexible ou non au niveau syntaxique, serait fige seulement si le locuteur
sent quil y a une relation entre les mots et lorsque le rsultat en est que les mots sont perus
comme une unit. Cette dfinition peut tre compare celle que donnent Nunberg et al.
(1994:492-493) de la catgorie idiome. Ils numrent les proprits conventionnalit
( conventionality ), inflexibilit ( inflexibility ), figuration ( figuration ), proverbialit
( proverbiality ), informalit ( informality ) et affect ( affect ). Ensuite, ils crivent
(1994:493) : Apart from the property of conventionality, none of these properties applies
obligatorily to all idioms
17
. Ils (1994:292) soulignent limpossibilit de dfinir par un seul
critre les idiomes et constatent que le terme didiome sapplique une catgorie floue,
contenant des exemples prototypiques tels que take care of NP ainsi que dautres, dfinis
seulement par opposition dautres catgories.
Expression fige en raison de sa conventionnalit et de son inflexibilit :
Une expression fige doit tre conue comme une unit chez le locuteur. Elle doit galement
tre inflexible au niveau syntaxique, cest--dire soumise un blocage syntaxique. Notons
que ces traits sappliquent seulement certains types dexpressions figes, dont le plus
comment est probablement lidiome. Narrower uses restrict idiom to a particular kind of
12
Ce critre empche par exemple un changement de nombre ; the other day - *the other days (Hudson 1998:8).
13
Lorsquil y a restriction collocationnelle, deux mots du mme champ smantique ne peuvent pas commuter ;
first of all - *second of all (Hudson 1998:8).
14
Voir aussi infra 1.2.4
15
Toutefois, il nest pas clair pourquoi il fait cette distinction, tant donn quil (1996:12) souligne que ces deux
types de figement vont de pair. Dans son exemple Luc a pris la tangente, lopacit smantique serait corrle
labsence de proprit transformationnelle.
16
Il (1997:166) exemplifie en montrant larbitraire dans les traductions. Une traduction de la locution franaise
baisser les bras donne en hbreu moderne une expression au sens de lever les mains, les bras.
17
Leur dfinition de conventionality est (Nunberg et al. 1994:492) la suivante : Idioms are
conventionalized: their meaning or use cant be predicted, or at least not entirely predicted, on the basis of a
knowledge of the independent conventions that determine the use of their constituents when they appear in
isolation from one another .
17
unit : one that is fixed and semantically opaque or metaphorical, or, traditionally, not the sum
of its parts, for exemple, kick the bucket or spill the beans (Moon 1998:4).
Ainsi, linterprtation du terme fig est tantt lie la syntaxe, tantt la smantique.
Parfois, cest la smantique qui est lobjet dtude principal dans la phrasologie. Un trait
couramment propos
18
est que les mots sont censs ne pas avoir leur sens habituel
lorsquils sont employs dans telle ou telle constellation. Une dfinition qui tend vers cette
direction, mme si un peu diffrente, est celle selon laquelle les mots gardent leur sens, bien
quun sens additionnel , quils nont pas en dehors de lexpression, soit sous-entendu
lorsquils sont employs dans lexpression en question. Encore une fois, les combinaisons
sont nombreuses :
- un ou quelques-uns des mots de lexpression gardent leur sens premier ou
habituel
19
, les autres non
- les mots de lexpression gardent leur sens habituel , mais ont en plus des sens
additionnels
Tout cela indique quil sera ncessaire de trancher clairement entre un emploi littral et un
emploi figuratif des mots.
En abordant la notion dexpression fige, nous sommes ainsi en prsence de plusieurs
domaines linguistiques :
- La syntaxe des expressions figes est cense tre soumise des restrictions plus ou moins
svres.
- La psychologie est pertinente dans la mesure o les locuteurs peroivent les expressions
figes comme des units qui sont mmorises.
- La smantique doit tre invoque lorsquon considre des sens premiers, additionnels ou
figurs
20
.
Pour ce qui est de notre emploi du terme dexpression fige, il est utilis comme un terme
gnrique runissant toutes les diffrentes catgories dcrites ci-dessus. Ainsi, il couvre tous
les groupes de mots aptes tre jugs comme des units par les locuteurs, quel que soit le
terme employ par dautres chercheurs. Cest donc surtout le ct psychologique ou mmoriel
qui a de limportance pour ce terme.
18
Voir infra, surtout les dfinitions didiome (1.2.2.1).
19
Nous avons voqu supra les difficults de savoir comment interprter ces termes.
20
Il est galement probable que la phontique joue un rle important dans de nombreuses expressions figes.
Cependant nous laissons de ct les traits appartenant plutt la langue parle ainsi que les rimes, les
allitrations et autres caractristiques de ce genre, mme sils sont prsents dans la langue crite. Ces traits,
frquents dans certaines expressions, ne sont certainement pas un hasard : cor et cris, prendre ses cliques et
ses claques, purement et simplement, Allons-y Alonzo, laise Blaise etc.. Pour un expos succinct dexpressions
qui comprennent des prnoms avec ou sans rime voir Treps (1994).
18
1.2.2 Catgories
Les catgories sont donc le rsultat dun classement de diffrents types dexpressions. Mais
mme si nous citerons ici des catgories proposes dans la littrature linguistique, le but
principal de cette tude nest pas dtablir une liste des catgories en corrlation avec les
critres quon a proposs pour les dfinir. La raison en est que cela a dj t fait ailleurs.
Hudson (1998, Chapitre 1) et Moon (1998:19-25) citent plusieurs typologies proposes et
Norrick (1985:72-72) propose une feature matrix definition of the proverb and related
genres []
21
. Toutefois, il faut tenir compte des discussions qui ont eu lieu au sujet des
termes les plus frquents tel que idiome, locution, proverbe et collocation. Les limites entre
ces catgories, on le sait, ne sont pas nettes.
Lordre dans lequel les catgories seront prsentes nest pas arbitraire. Si nous laissons le
terme de phrasme pour la fin, cest parce quil nest pas trs courant
22
. En ce qui concerne
gallicisme, le terme est plus rpandu que celui de phrasme, quoiquil concerne un type
dexpressions qui est ncessairement franais. Toujours est-il quil nest pas trs rpandu non
plus
23
. Le proverbe prsente des particularits diffrentes. Ce terme nest nullement rare
24
,
mais la notion de proverbe est dune moindre importance pour nous que les notions idiome,
locution et collocation. Les collocations sont pertinentes pour la phrasologie, mais leur place
ny est pas facilement cerne, tant donn que le terme de collocations recouvre davantage de
ce qui est traditionellement considr comme des expressions figes
25
. Nous en arrivons aux
termes locution et idiome, qui sont les plus importants dans les recherches qui traitent le
figement comme phnomne linguistique. Ce sont les termes les plus frquemment rencontrs
dans la littrature phrasologique. Ils sont assez gnraux pour convenir lanalyse que nous
voulons faire. En outre le terme didiome est celui qui semble venir en premier lesprit chez
les gens lorsquon voque le sujet dexpressions figes
26
.
1.2.2.1 Idiome
Comme dfinition de la notion didiome, Fraser (1970:22) propose : a constituent or series
of constituents for which the semantic interpretation is not a compositional function of the
formatives of which it is composed . Il cite les exemples anglais figure out, make love to,
beat around the bush, by accident, pass the buck et has the cat got your tongue. La dfinition
21
Voir aussi Benson (1985), qui fait une distinction entre idiome et collocation, Nunberg et al. (1994), qui
divisent les idiomes en deux groupes, et le Dictionnaire des expressions et locutions (1983), o Rey fait un
expos de simples tendances de distinctions entre locutions , expressions , noncs frquents ou
cods , tournures et idiotismes .
22
Nous lavons rencontr principalement chez Meluk. Lors dune recherche sur linternet entreprise le 28
octobre 2001, nous avons obtenu, sur AltaVista, 13 occurrences en cherchant sur phrasme . Dans SSCI (Arts
and humanities citation index) il ny avait aucune occurrence du mot.
23
Sur AltaVista le mot gallicisme a compt 57 occurrences. Dans SSCI il ny avait aucune rfrence
gallicisme le 28 octobre 2001.
24
Le terme semble effectivement trs rpandu sur AltaVista (toujours le 28 octobre 2001), on trouve 10901
occurrences du terme, en cherchant sur les pages en franais. Peut-tre est-il plus populaire que les autres
termes. Dans le SSCI, le nombre doccurrences remonte 2 en franais, 139 en anglais.
25
Les statistiques de linternet du 28 octobre 2001 sont : 10299 occurrences sur AltaVista, et pour SSCI, 14 en
franais et 2635 en anglais.
26
Sur AltaVista, le 28 octobre 2001, le terme de locution comptait plus que idiome (2152 occurrences pour
locution, 1742 pour idiome). En revanche, locution ne donnait que 3 occurrences en franais et 10 en anglais
dans SSCI. Une recherche sur idiom (en anglais, donc) a fourni 278 occurrences, tandis que le terme franais
idiome na fourni aucune rfrence.
19
de Fontenelle (1994:43) ressemble celle de Fraser : What characterizes idioms is the fact
that they constitute a single semantic entity, and that their meaning is not tantamount to the
sum of the meanings of the words they are made up of . Il (Fontenelle 1994:43) dit encore :
it is admitted that an idiom is basically a fixed multi-word unit whose meaning cannot be
computed from the meanings of its components .
Selon Nunberg et al. (1994), la catgorie didiome est trs floue. Ils constatent que les
idiomes ont souvent t identifis laide du critre de non-compositionnalit mais ils veulent
aussi prendre en considration les dimensions de conventionnalit ( conventionality ) et de
figuration ( figuration ). En raison de limportance du terme de conventionnalit pour les
idiomes, regardons leur explication de ce terme : idioms are conventionalized; their
meaning or use cant be predicted, or at least not entirely predicted, on the basis of a
knowledge of the independent conventions that determine the use of their constituents when
they appear in isolation from one another (Nunberg et al. 1994:492). La conventionnalit
( conventionality ) serait la seule des proprits du syntagme
27
( properties of the phrase )
qui se rapporte obligatoirement tous les idiomes (Nunberg et al. 1994). Cest donc cette
proprit qui constitue leur dfinition dun idiome. En outre, ils proposent une distinction
entre idiomatically combining expressions (des exemples en seraient take advantage et
pull strings) et idiomatic phrases (avec lexemple emblmatique kick the bucket). Une
idiomatically combining expression est une expression dans laquelle les composants ont
des parties dont on peut identifier les sens idiomatiques
28
. Dans les idiomatic phrases , en
revanche, les interprtations idiomatiques ne peuvent pas tre distribues sur les parties de
lexpression.
Leur division ressemble celle faite par Makkai (1972:25, 57) entre idioms of
encoding et idioms of decoding
29
. Celui-ci (Makkai 1972:24) dit : [] certain
peculiar phrases are only peculiar in so far as they exist at all and not in so far as it is
impossible to deduce their meanings from their components . Il appelle ce type
dexpressions, qui ne posent pas de problmes de comprhension, des idioms of
encoding
30
. Lautre type, un idiom of decoding prsente probablement plus souvent des
difficults de comprhension pour le locuteur qui ne la pas rencontr auparavant. Il cite entre
autres les exemples hot dog, hot potato et to take the bull by the horns.
Dans la prface du Dictionnaire des expressions et locutions (1993, ci-aprs DEL), Rey
voque plusieurs difficults auxquelles on peut se heurter dans le domaine de la phrasologie,
ainsi que plusieurs notions, difficiles sparer de faon absolue les unes des autres. Quant aux
termes didiome et didiotisme, il les vite, le premier tant trop savant et lautre une
forme fcheuse . Selon lui, il faudrait pouvoir comparer lexpression en question une
expression dans une autre langue pour que le terme didiome soit appropri. Dans le cas o il
27
Ici les faux amis phrase (anglais) et phrase (franais) posent problme. Dans larticle, le terme de
phrase est utilis, mais en franais, il est plus adquat de parler dun syntagme.
28
[W]e will use the term idiomatically combining expression [] to refer to idioms whose parts carry
identifiable parts of their idiomatic meanings (Nunberg et al., 1994:496).
29
Reprise par Fillmore et al. (1988).
30
Makkai (1972:24-25) donne comme exemple la prposition employe lorsquon conduit une certaine
vitesse ; en franais on conduit une certaine vitesse, en allemand mit einer gewissen Geschwindigkeit etc.
Avec et mit se traduisent parfois en anglais par with, mais en anglais on dit drive at a certain speed. Voir
aussi infra 2.6.2.
20
est possible de faire une telle comparaison, et lorsque lexpression franaise ne se traduit pas
dans cette autre langue, lexpression est en mme temps un gallicisme. Rey considre donc ce
dernier comme un type didiome.
Le dictionnaire anglais Cobuild Dictionary of Idioms (ci-aprs CDI) dfinit lidiome
( idiom ) comme suit :
An idiom is a special kind of phrase. It is a group of words which have a different
meaning when used together from the one it would have if the meaning of each
word were taken individually. [] Idioms are typically metaphorical : they are
effectively metaphors which have become fixed or fossilized. (CDI 1995:iv)
La dfinition de Benson (1985:66) est peu prs la mme, si lon excepte la mention de la
mtaphore : An idiom is a relatively frozen expression whose meaning does not reflect the
meanings of its component parts .
On aura remarqu que les critres de non-compositionnalit et de conventionnalit ainsi
que de mtaphoricit sont prsents dans les dfinitions de la notion didiome. Reste
maintenant examiner ce qui se cache derrire ces termes. Les notions de non-
compositionnalit ainsi que celles dopacit et de sens figur (quivalant mtaphoricit)
seront examines en dtail dans le Chapitre 2
31
.
Dans la plupart des dfinitions de lidiome, cest le sens dviant qui est le critre le plus
important, mais certaines dfinitions prennent aussi en considration des restrictions
syntaxiques. Ainsi, Fontenelle (1994:43) fait remarquer, que dans un idiome, plusieurs
oprations syntaxiques sont impossibles effectuer, telles que la passivation, la
pronominalisation et linsertion. Selon lui, il nest pas non plus possible de faire subir aux
idiomes lopration syntaxique de clivation. Selon Benson, un idiome est relativement fig
( relatively frozen ). Certains changements, dordre tant lexical que grammatical, sont
pourtant possibles (Benson 1985:66)
32
.
Un autre souci est de sparer lidiome de la collocation. Une diffrence propose est que,
dans une collocation, le sens est infrable partir du sens des mots : the collocations []
are not idioms : their meanings are more or less inferrable from the meanings of their parts,
even though the prepositions in the collocations are not predictable (Benson 1985:62). Nous
allons voir
33
que le consensus est loin de rgner en ce qui concerne la dfinition de la
collocation.
1.2.2.2 Locution
Selon le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage (1994:289, ci-aprs DLS),
une locution est un groupe de mots (nominal, verbal, adverbial) dont la syntaxe particulire
donne ces groupes le caractre dexpression fige et qui correspondent des mots uniques.
Ainsi, faire grce est une locution verbale (ou verbe compos) correspondant gracier [] .
La tentative de dfinition savante que donne Rey (DEL, 1993:VI) de la locution, est la
suivante : une unit fonctionnelle plus longue que le mot graphique, appartenant au code de
31
Infra 2.3.
32
Voir aussi Nunberg et al. (1994:492) sur inflexiblit ( inflexibility ).
33
Infra 1.2.2.3.
21
la langue (devant tre apprise) en tant que forme stable et soumise aux rgles syntactiques de
manire assumer la fonction dintgrant (au sens de Benveniste)
34
. Pour distinguer entre
locution et expression, il se rfre ltymologie : locution aurait le sens de manire de dire
(lat. locutio, de loquor, parler ), tandis quexpression serait une manire dexprimer
quelque chose . Selon Rey (DEL, 1993:VI), lexpression implique une rhtorique et une
stylistique ; elle suppose le plus souvent le recours une figure, mtaphore, mtonymie
etc. .
Une autre solution est celle laquelle arrive Grunig (1997a:17), et qui est la suivante : il
faut admettre que [] la locution na pas de dfinition linguistique. Quelle se dfinit
ailleurs (je pense en particulier aux registres couverts par la psychologie scientifique
contemporaine) et que ses comportements linguistiques paradoxaux sont consquences de ses
proprits ailleurs dfinies
35
.
Martin (1997:292) adopte un tout autre point de vue : [] la locution est un syntagme
fig, situ au-del du mot et en de de la phrase fige . Il explique ensuite ce qui caractrise
une locution prototypique, en commentant les trois proprits les plus typiques : les
restrictions slectionnelles, la non-compositionnalit et la valeur intensionnelle (oppose la
valeur rfrentielle).
Les dfinitions de la locution couvrent une vaste gamme de proprits. DEL voque la
syntaxe particulire . Rey constate quelle est une manire de dire , tandis que Grunig
propose que sa dfinition est autre que linguistique. Martin, finalement, ajoute la non-
compositionnalit et la valeur intensionnelle comme traits pertinents.
1.2.2.3 Collocation
Une dfinition trs gnrale de la notion de collocation est celle qui se contente de la tendance
des mots apparatre ensemble. Ainsi, Gregory (Gregory apud Bcklund 1981:4) crit :
Collocation is the category that attempts to account for the tendency, in a language, of
certain items to occur in close approximation to each other
36
.
Benson (1985:61) propose une catgorisation des collocations o il distingue les
collocations grammaticales des collocations lexicales. Cette division est galement
mentionne par Fontenelle (1994:44). Une collocation grammaticale est une combinaison
courante, compose dun mot lexical (du type VERBE, NOM ou ADJECTIF) et dun mot
grammatical, le plus souvent une prposition. Quelques exemples fournis par Benson
(1985:62) en sont : VERBE + PRPOSITION : accuse of, aim at ; NOM+ PRPOSITION : access to,
anger at et ADJECTIF + PRPOSITION : afraid of, angry about. Il existe videmment des
exemples franais du mme genre : VERBE + PRPOSITION: accuser de ; NOM + PRPOSITION :
accs et ADJECTIF + PRPOSITION : fch de, fch avec. Les collocations lexicales, en
revanche, sont composes de deux mots gaux : they usually consist of two equal
lexical components . Benson (1985) donne galement des exemples de ce type : ADJECTIF +
34
Il explique (DEL, 1993:VI) que lintgrant de Benveniste est une unit apte tre reprise pour tre intgre
dans une unit de niveau suprieur : lment dans le mot, mot dans le syntagme, syntagme dans la phrase
minimale etc. .
35
Son point de vue sera dvelopp dans le Chapitre 2. Voir 2.1.
36
Il mentionne, titre dexemple, la probabilit que le mot beer (bire) apparat proximit de mots tels
que drink (boire), drunk (ivre), glass (verre), ou bottle (bouteille).
22
NOM : confirmed bachelor, pure chance ; NOM + VERBE : alarms go off, blood circulates et
VERBE + NOM : give a lecture, inflict a wound. Des exemples franais en sont : ADJECTIF +
NOM : clibataire endurci ; NOM + VERBE : le sang circule et VERBE + NOM : faire une
confrence. La traduction mot mot dans une autre langue prsente de grands risques.
Cowie parle non seulement de la tendance de certains mots figurer ensemble, mais aussi
de la possibilit (ou non) de remplacer un mot par un autre dans la collocation :
A collocation is by definition a composite unit which permits the substitutability
of items for at least one of its constituent elements (the sense of the other element,
or elements, remaining constant). According to these criteria, run a business and
wages freeze are both collocations, given the assumption of substitutability in both
cases. (Cowie 1981:224)
Les collocations restrictives comprennent, selon la dfinition dAisenstadt (1981:54), des
combinaisons de deux mots ou plus. En outre, au moins un des mots a un usage restreint en ce
qui concerne ses possibilits de commutation : RCs [restrictive collocations] are
combinations of two or more words, [] in which one word at least is restricted in its
commutability not only by its grammatical and semantic valency, but also by usage
37
.
On trouve parmi les dfinitions celles o est mentionne la possibilit que la collocation
soit forme de plus de deux mots. Or, ce trait est souvent oubli, et ce qui est analys ou cit
comme collocation consiste souvent en une paire de mots. Aisenstadt (1981:54) lui-mme se
concentre sur des combinaisons de deux mots : When we investigate the commutability
restrictions in RCs, we find a) RCs with both components restricted in their commutability, b)
RCs with one restricted component and the other one free (cest nous qui soulignons).
On aura not que les dfinitions cites de la notion de collocation sont ranges par ordre de
spcificit. La premire ne parle que de la tendance des mots apparatre ensemble , alors
que la seconde est plus prcise sur la nature de ces mots : soit un mot lexical est combin avec
un mot grammatical, soit il y a une combinaison de deux mots lexicaux. Ensuite, avec la
dfinition de Cowie laccent est mis sur les groupes de mots o un des mots peut tre
substitu un autre. Les collocations restrictives finalement sont celles o les possibilits de
substitution sont les plus limites. Plus on impose de restrictions ce genre dunits de
langue, plus on se rapproche du phnomne de figement.
1.2.2.4 Proverbe
linstar des autres catgories dexpressions figes, les proverbes ne se laissent pas
facilement dfinir
38
. Il semble pourtant quil y ait consensus parmi les chercheurs sur de
nombreuses proprits caractrisant le proverbe. Il est souvent admis dans la catgorie de
lexpression fige. Le proverbe est un cas particulier de phrase fige , crit Conenna
(2000:29). Kleiber (2000:40) voque galement lappartenance la catgorie des expressions
figes : En parlant de dnomination pour le proverbe, il ne faut entendre quune et une seule
chose : le fait quil sagit dune expression idiomatique ou fige [...] .
37
Des exemples de collocations restrictives sont shrug ones shoulders et pay attention (Aisenstadt 1981:54).
En analogie avec ces exemples, on peut constater que dans hausser les paules et prter attention, on ne
remplace pas facilement les mots composants par dautres mots. Voir aussi infra 2.2.6.1 et infra 2.5.1.
38
Voir Shapira 1999:55-56.
23
Selon Norrick (1985:31), le proverbe est, dans les dfinitions traditionnelles, indpendant,
piquant, traditionnel, didactique et fig
39
. Il a en outre des traits potiques tels que la prosodie
et la figuration (1985:46-48). Le trait indpendant est galement mentionn par Shapira
(1999:58), qui dcrit le proverbe comme un nonc smantiquement autonome, transparent,
sens mtaphorique . Elle parle de lautonomie grammaticale, aprs quoi elle procde une
description des composants dont le proverbe est constitu. Elle (1999:61-62) constate que le
sujet dans un proverbe est souvent de valeur gnrique.
Certains proverbes ont une syntaxe marque
40
. Norrick (1985:34) dit, propos des
proverbes anglais, que plusieurs dentre eux se composent de structures qui sont propres au
proverbe. Il dit mme quaucune grammaire normale nengendrerait ces exemples-l
comme des phrases grammaticales compltes. Il cite les exemples Like father, like son
(1985:85) avec la structure like X, like Y (en franais tel X, tel Y
41
) et The more, the
merrier (1985:35) avec la structure the X-er the Y-er (en franais il y a la structure similaire
en plus X, plus Y
42
).
Norrick (1985:2) est galement davis que, linstar dautres units de la langue, les
proverbes doivent tre mmoriss : Like words, idioms and other recurrent linguistic units,
the proverbs of a language must be stored in some kind of inventory . Selon lui (1985:3), les
proverbes sont aussi des idiomes, dans la mesure o ils ont des interprtations non
compositionnelles.
Ce qui distingue les proverbes des idiomes est, selon Benson (1985:66), que le sens des
proverbes peut tre littral (ou presque) et quils font rfrence une sagesse traditionnelle
( folk wisdom ) ou une vrit prtendue gnrale ( alleged general truth ).
Reste maintenant le problme de savoir dune part ce que cachent les termes piquant,
traditionnel, didactique, folk wisdom et alleged general truth, dautre part dans quelle
mesure ils aident sparer les proverbes des autres types dexpressions. Benson ne mentionne
pas la syntaxe ventuellement marque, mais constate que les proverbes sont normalement
des phrases entires, tandis que les idiomes en sont des parties. Un autre trait qui spare les
deux notions est, selon lui, que les proverbes sont plus figs que les idiomes.
On voit donc que les proverbes ont clairement leur place dans les tudes des expressions
figes et quils partagent des proprits avec les autres catgories tudies dans ce travail.
1.2.2.5 Gallicisme
Le gallicisme tant un [i]diotisme propre la langue franaise (par rapport dautres
langues) (Le Petit Robert, ci-aprs PR), ce terme fait rfrence une sous-catgorie des
expressions figes, dont on ne peut faire abstraction en parlant de la phrasologie franaise.
La notion de gallicisme ncessite une comparaison du franais avec dautres langues. Dans la
prface du DEL (1993:V), on attire lattention sur le rapport avec dautres langues. La
difficult de traduire certaines expressions est un trait communment associ aux gallicismes.
39
Dans la dfinition anglaise, il crit (1985:31) : self-contained, pithy, traditional expressions with didactic
content and fixed [...] form .
40
Pour une dfinition du terme marque, voir 2.4 infra.
41
Comme dans Tel matre, tel valet (DEI:matre).
42
Comme dans Plus on est de fous, plus on rit (DEI:fou).
24
Lard (1992:18) prend aussi en considration la difficult pour les gallicismes de trouver
une place dans la grammaire. Il est davis que les grammaires catgorielles engendrent un
rsidu , et cest ce rsidu quil appelle gallicismes. Ceux quil examine de plus prs sont il y
aqui/cestqui, voici/voil, cest toi de jouer et ce que.
PR fait une distinction entre deux types de gallicismes : gallicisme de vocabulaire (ex. la
bonne heure
43
) et gallicisme de construction (ex. sen donner cur joie
44
), sans prciser
pour autant en quoi rside la diffrence entre les deux types.
Cependant, comme lcrit Wilmet (1997:457)
45
, [g]allicisme est une appellation
rejeter parce que trop large [...] . Il nous semble en effet justifi de critiquer un terme qui
narrive qu spcifier ce qui est propre la langue franaise , sans plus de prcisions.
1.2.2.6 Phrasme
Meluk (1993:82-84) se sert du terme de phrasme et en propose quatre types majeurs. Le
premier type est le phrasme pragmatique, qui a une forme et un sens transparents et bien-
forms [sic !], et qui est fig par rapport une situation donne. Il donne lexemple Cest
pour toi !.
Le phrasme complet a un sens qui ninclut le sens daucun de ses constituants . Il cite
lexemple faire le joli cur [avec N] dans le sens se comporter envers une femme N de
faon exagrment galante dans le but de la charmer .
Ensuite, le demi-phrasme a deux constituants. Le sens de lexpression en question inclut
le sens de lun des constituants mais pas de lautre. Un exemple en est donner une confrence,
parce qu il sagit bel et bien dune confrence, mais DONNER na pas son sens premier .
Le quatrime type est le quasi-phrasme. Le sens de ce type de phrasme inclut les sens de
tous ses constituants, mais ici il y a en outre un sens additionnel et imprvisible.
Lexemple propos est donner le sein [ N].
Les limites entre ces quatre types ne sont pas toujours nettes. Comment interprter le fait
que le phrasme pragmatique ait une forme et un sens bien-forms , et quel trait distinctif
les spare des autres phrasmes, tant donn quon accorde seulement aux premiers lpithte
de bien-forms ?
Une autre caractristique, qui pourrait dcrire plus dun type de phrasme est celui dtre
fig par rapport une situation donne . Il est difficile de trouver des expressions
quelconques dans la langue, figes ou non, qui ne dpendent pas de la situation dans laquelle
elles sont nonces. Il est vrai que Meluk explique quil faut dire Cest pour toi dans
certaines situations et Cest toi dans dautres, mais, comme dfinition, fig par rapport
une situation donne est un peu vague.
En ce qui concerne le phrasme complet, comment tre sr quil ninclut le sens daucun
de ses constituants ? Laffirmation selon laquelle un verbe comme faire, avec un sens si
polysmique, serait totalement priv de son sens dans faire le joli cur est peut-tre un peu
trop catgorique.
43
la bonne heure! cest trs bien, cest parfait, tant mieux! (DEL:heure).
44
Sen donner cur joie se donner de qqch avec la joie du cur ou par la joie de cur (DEL:cur).
45
Sa critique du terme se retrouve dans le contexte de focalisation. Il sagit du clivage cest...qui/que, qui serait
un gallicisme.
25
Dans la dfinition du demi-phrasme nos rserves sont, comme dans lexemple prcdent,
en relation avec les diffrents sens possibles des mots polysmiques (il doit tre possible
dtiqueter donner ainsi). Pour pouvoir constater quun mot na pas son sens premier ,
il faut des prcisions sur la dfinition de ce sens premier .
Le mme reproche peut tre formul lgard du dernier type propos par Meluk,
puisque le quasi-phrasme est, au moins thoriquement, polysmique.
Il nous semble que les critres pertinents pour sparer les diffrents types de phrasmes
peuvent tre amliors et prciss.
1.2.3 Entre catgorie et critre la mtaphore
Il nimporte en premier lieu, en ce qui concerne les mtaphores, ni de leur donner une
dfinition, ni de les dcrire, ni mme de catgoriser certaines expressions comme
mtaphoriques, mais dexpliquer leur pertinence pour les expressions figes. Elles sont
souvent mentionnes dans le contexte du figement o elles sont dcrites laide de certains
des critres qui seront discuts et analyss par la suite
46
. Or, cerner la problmatique de la
mtaphore pour servir notre propos nest pas une tche triviale, vu labondance dtudes faites
sur les mtaphores
47
. Quant la relation entre mtaphore et figement, on notera que cette
relation parcourt un continuum qui va de la relation zro (il ny a pas forcment de relation
entre mtaphore et figement) jusqu une relation trs forte (dans certaines dfinitions, les
idiomes ont un statut de mtaphores mortes ). Afin dillustrer le problme que peut poser
la notion de mtaphore dans le cadre de la phrasologie, il faut attirer lattention sur les
diffrents aspects du continuum dont nous venons dindiquer lexistence.
Citons, pour commencer, une dfinition assez gnrale de la mtaphore :
Figure de rhtorique, et PAR EXT. Procd de langage qui consiste employer un
terme concret dans un contexte abstrait par substitution analogique, sans quil y
ait dlment introduisant formellement une comparaison (PR:mtaphore).
Cette dfinition semble tre communment accepte dans la plupart des thories sur les
mtaphores. Deignan (1999b:24), par exemple, considre lemploi dun mot comme
mtaphorique, lorsquil a une rfrence abstraite et en mme temps une relation smantique
un autre emploi du mot, avec une rfrence concrte
48
.
Dans la thorie de la pertinence de Sperber et Wilson (1995:231-237), les mtaphores ne
reprsentent pas un phnomne extraordinaire dans la langue. Selon eux, les mtaphores
(ainsi que dautres tropes comme lhyperbole, la mtonymie et la synecdoque) ne demandent
pas de connaissances linguistiques particulires, ni plus de capacit interprtative que dautres
noncs.
46
Pour le lecteur qui souhaite une approche diffrente de la ntre, nous renvoyons d'autres auteurs qui traitent
les mtaphores, par exemple Ricur (1975), Lakoff et Johnson (1980) et Henry (1983).
47
Voir par exemple Gibbs (1999:29) pour des rfrences aux diffrentes thories de la mtaphore, en
psychologie et dans dautres domaines.
48
Deignan (1999b:24) : I consider uses of a word to be metaphorical where they have abstract reference and
are related semantically to another use of the word, which has concrete reference .
26
Cela va lencontre des thories qui ont leur origine dans la rhtorique classique
49
et qui
sont probablement les plus connues. Dans la rhtorique classique, le point de dpart est que
les mtaphores prsentent une particularit linguistique quil faut dterminer. On dit souvent
que cest dans la smantique que lon retrouve cette particularit, qui peut tre considre
comme une malformation lexicale . Il sensuit que les noncs mtaphoriques sont, un
certain niveau, forcment faux
50
mtaphoriques et les noncs non mtaphoriques, Moeschler et Reboul (1994:407-408)
fournissent ce quon peut appeler une prdication inapproprie comme celle de Achille est
un lion , lorsque Achille dsigne un tre humain.
Un autre point de vue est celui du philosophe Davidson (1984:245-264). Mme sil admet
quil y a une diffrence entre noncs mtaphoriques et noncs non mtaphoriques, la
diffrence nest pas, selon lui, de nature smantique. Ainsi, il dfend lhypothse que les
mtaphores nont quune signification et que cette signification est littrale. Pour lui, cest la
distinction entre le sens des mots et leur utilisation qui est pertinente
51
.
Les dfinitions et les thories sur les mtaphores que nous venons dexposer nont rien
voir avec le figement. Ce nest quen abordant les hypothses qui vont suivre que nous
pouvons rapprocher la problmatique des mtaphores celle du figement. La premire de ces
hypothses consiste supposer que les mtaphores et les idiomes peuvent avoir certains traits
en commun. Ainsi, certains chercheurs vont jusqu dclarer que les idiomes sont une espce
de mtaphore
52
. Dans le dictionnaire Cobuild (1995:iv), on lit : they [les idiomes] are
effectively metaphors which have become fixed or fossilized . Selon Gibbs (1994:267), la
plupart des chercheurs partagent cet avis. ce propos le terme mtaphore morte ( dead
metaphor ) peut servir : [] most scholars assume that idiomatic language may once have
been metaphorical but has lost its metaphoricity over time and now exists in the mental
lexicon as a set of stock formulas or as dead metaphors . Cependant, la prudence simpose,
encore une fois, quant la terminologie. Comme le signale Deignan (1999a:182),
linterprtation du terme mtaphore morte peut prendre des directions diverses. Il peut sagir
dune mtaphore tel point tablie dans la langue quon la considre dans la langue
contemporaine comme ayant un sens littral. Les exemples le pied de la montagne, le pied de
la table ou le pied de larbre ne sont probablement plus vus comme mtaphoriques pour la
plupart des locuteurs franais. Un autre sens du terme de mtaphore morte est que lorigine
dune telle mtaphore est oublie et que dans la langue courante on ne voit pas quel tait le
rapport entre la mtaphore ou lexpression mtaphorique et ce quelle reprsente aujourdhui.
On peut ainsi parler de dmotivation tymologique, comme le fait Martin (1997:299). On lui
emprunte les exemples porter le chapeau
53
et sonner les cloches qqn
54
.
49
Voir par exemple Moeschler et Reboul (1994:407).
50
Cf. Moon (1998:193) : All metaphors, all metaphorical FEIs [fixed expressions and idioms] are at some
level untrue .
51
I depend on the distinction between what words mean and what they are used to do. I think metaphor
belongs exclusively to the domain of use (Davidson 1984:247).
52
Supra 1.2.2.1.
53
Porter le chapeau tre rendu responsable (DEI:chapeau).
54
Sonner les cloches qqn lui adresser de vifs reproches (DEI:cloche).
27
.Pour exemplifier la diffrence entre les noncs
Chez Moon (1998:22), le terme de non compositionnel
55
, dcrivant le trait que les idiomes
partagent avec les mtaphores, est introduit comme suit : Strings classified as metaphors are
non-compositional because of their semantics : they include pure idioms . Le rapprochement
quelle fait entre les mtaphores et les idiomes est explicit lorsquelle (1998:23) constate que
limpossibilit de dcoder une mtaphore fait delle un idiome : [] opaque metaphors,
pure idioms, are those where compositional decoding and interpretation of the image are
practically or completely impossible without knowledge of the historical origins of the
expression .
Aprs ces dernires citations, il semble logique dappeler la mtaphore une catgorie
dexpressions figes ( linstar de lidiome). Or, la diffrence des autres catgories ici
prsentes
56
, la mtaphore est tantt prsente comme un type dexpression (catgorie), tantt
comme une caractristique qui peut faire partie dun critre de figement. Moon (1998:178)
appelle les trois notions dambigut, de polysmie et de mtaphore des caractristiques des
expressions figes anglaises, mme si elles ne sont que des caractristiques de surface. Elle
les oppose la non-compositionnalit, qui est, selon elle, une notion cl des expressions
figes
57
.
Il ressort des dfinitions cites que certaines thories sur les mtaphores peuvent
effectivement avoir une importance pour la phrasologie, mais nous nous contentons dans la
prsente tude de ces quelques remarques sur les termes ainsi que de renvois des recherches
antrieures. Une analyse approfondie de cette problmatique mnerait trop loin.
1.2.4 Critres
Les catgories cites jusquici (idiome, locution, proverbe etc.) sont celles qui sont le plus
souvent mentionnes lorsquon voque le phnomne de figement. On les retrouve souvent
classes comme des types dexpressions figes. Est-il possible de trouver une dfinition de
lexpression fige comme catgorie ?
Hudson (1998:33) signale, au sujet des expressions figes anglaises, que les critres
typologiques donnent souvent comme rsultat des taxinomies incluant des catgories non
discrtes et incompltes
58
. G. Gross est davis que pour dcrire la notion de figement, il faut
quitter le niveau trop gnral qui dcrit le phnomne tel quel et se limiter des catgories
prcises :
Nous examinons les proprits communes qui caractrisent ce phnomne, que
lon doit considrer comme un des plus importants dans les langues. Cependant,
nous ne voulons pas rduire pour autant le figement aux considrations gnrales
que nous proposons ici. Cest dans le cadre des diffrentes catgories que peut se
faire lanalyse avec la prcision voulue. (G. Gross 1996:9)
Mais mme si lon dcide de limiter lanalyse une seule catgorie dexpression fige, on
peut rencontrer les mmes obstacles dfinitoires. Nunberg et al. (1994) se consacrent aux
55
Pour la notion de non-compositionnalit, voir infra 2.3.
56
Supra 1.2.2.1-1.2.2.6.
57
Voir Moon (1998:8).
58
Hudson (1998:33) : [...] typology criteria generally result in taxonomies with non-discrete, non-
comprehensive categories, which is an undesirable state of affairs [...] .
28
idiomes. Selon eux, les problmes demeurent pour toute dfinition et la catgorie didiome est
floue
59
.
Laffirmation de Schapira (1999:9), quil y a des critres distinctifs, qui se vrifient pour
toutes les expressions figes , va lencontre de ce que pensent la plupart des linguistes. Elle
ajoute pourtant qu il en existe dautres [critres], moins rigoureux, qui sappliquent ou non
selon le degr de figement plus ou moins lev de la squence . Cette citation voque lide
quil y aurait des degrs de figement
60
. Le figement, dit-elle (1999:10) est un phnomne
scalaire, ses produits pouvant prsenter une rigidit plus ou moins intense .
Ni les catgories ni les critres ne fonctionnent automatiquement comme des outils
efficaces pour dcrire ou analyser le phnomne de figement. En parlant des critres
dinstitutionnalisation ( institutionalization ) et de rapparition ( recurrence ), Moon est
du mme avis :
Fixedness is complex. Institutionalization or recurrence of a fully frozen string
does not necessarily indicate status as an FEI [Fixed Expression or Idiom]. [...]
many of the realizations of the frameworks are highly frequent but few can be
considered holistic units [...]. (Moon 1998:7)
Il sera ncessaire de dcrire les termes impliqus dans le domaine de la phrasologie. Notre
tude met lemphase sur les critres utiliss pour dcrire les expressions figes. Cela dit, il
faut avouer que critre de figement nest pas un terme univoque. Tantt il semble dcrire ce
qui est typique pour certains types dexpressions figes, tantt il est utilis pour vraiment
trancher entre les syntagmes figs et les syntagmes non figs. Nous allons examiner plus en
dtail la notion de critre, en essayant de rpondre la question suivante : quest-ce qui est
cern par un critre de figement ?
Ce qui est typique pour toutes les expressions figes ?
Ce qui est typique pour certaines ?
Des traits qui sparent les expressions figes de la syntaxe libre ?
Des traits qui sont pertinents pour les expressions figes, mais qui sont aussi
valables pour la syntaxe libre ?
Le terme de critre nest pas le seul employ par les phrasologues dans leurs descriptions des
expressions figes. Ainsi, on parle aussi de proprits et de traits distinctifs , ainsi que
de paramtres , de causes et mme de symptmes . Une question qui se pose est si
ces termes sont employs les uns lexclusion des autres ou si les chercheurs ne font pas de
distinction claire entre les notions quils dcrivent. Si les notions derrire les termes analyss
natteignent pas le statut de critres distinctifs, doit-on les appeler des proprits ?
Dans les dfinitions cites sous catgories, il y a des critres souvent appliqus dans les
recherches phrasologiques, tels que la non-compositionnalit, la conventionnalit, la
59
Nunberg et al. (1994:492) : Attempts to provide categorical, single-criterion definitions of idioms are always
to some degree misleading and after the fact. In actual linguistic discourse and lexicographical practice, idiom
is applied to a fuzzy category defined on the one hand by ostention of prototypical examples [...] and on the other
by implicit opposition to related categories [...] .
60
Voir aussi G.Gross 1999:16-17.
29
mtaphoricit, la mmorisation, linflexibilit syntaxique et la syntaxe marque (exprims ci-
dessus par ces termes ou par dautres, mais qui couvrent peu prs les mmes phnomnes,
entirement ou partiellement). Dautres critres sont les rsidus de langue ancienne (notion
parfois impliquant une syntaxe ou des traits lexicaux marqus), le caractre non officiel, la
valeur intensionnelle ou la non-actualisation dun rfrent, les restrictions slectionnelles et
la non-possibilit de traduire dans une autre langue. Il faut prciser ici que cette numration
nest videmment pas exhaustive.
Essayons maintenant de prciser quelles sont les notions qui semblent avoir le statut de
critres, en les sparant, si possible, des proprits ou des autres notions discutes.
Dans la thse Perspectives on fixedness, Hudson (1998) arrive problmatiser le
phnomne de figement ( fixedness ) et introduire des aspects que dautres chercheurs
oublient ou laissent de ct. En ce qui concerne les critres utiliss, elle en cite quatre qui sont
rcurrents dans les ouvrages traitant des expressions figes en anglais (Hudson 1998:8-9) :
1. contraintes syntaxiques inattendues ( unexpected syntactic constraints on the
constituent parts )
2. restrictions collocationnelles inattendues ( unexpected collocational
restrictions within the expression )
3. syntaxe anomale ou usage anomal ( anomalous syntax or usage )
sens figuratif ( figurative meaning )
Hudson appelle les deux premiers critres dans cette liste des critres variationnels
( variability criteria ). Ce sont ces critres-l quelle garde pour sa dfinition du figement
( fixedness ). Elle constate que le critre de sens figuratif a souvent t mis en rapport avec
les critres variationnels, alors quelle fait une distinction claire entre ces deux aspects de la
langue :
It has been widely assumed that this fourth criterion (figurative meaning)
correlates with the first and second [...]. Put in these terms the criteria sometimes
conflict, so that an expression such as (to) sow wild oats would be considered
fixed according to the figurative meaning criterion (4) yet not according to the
variability criteria (1-2). In other words, the meanings of the parts do not add up
to the meaning of the whole although the expression does permit considerable
variation [...]
[...] I make a clear distinction between the variability criteria on the one hand, and
the figurative meaning criterion on the other. The term fixed expression will be
used to refer exclusively to expressions that are fixed according to variability
criteria. (Hudson 1998:9)
Cependant, elle avoue que pour elle les critres variationnels ne sont que des symptmes de
figement. En ce qui concerne le sens figuratif, celui-ci a plus dimportance pour les aspects
conceptuels quelle appellera des forces figeantes ( fixing forces ).
Dans son chapitre intitul La notion de figement , G. Gross (1996:9) annonce quil a
lintention dexaminer les proprits communes qui caractrisent ce phnomne . Les
diffrentes proprits dont il parle dans ce chapitre et qui en intitulent les parties sont :
30
1. La polylexicalit
2. Lopacit smantique
3. Le blocage des proprits transformationnelles
4. La non-actualisation des lments : la notion de locution
5. La porte du figement
6. Le degr de figement
7. Le blocage des paradigmes synonymiques
8. La non-insertion
9. Le dfigement
10. Ltymologie
11. Les locutions sont-elles rductibles des catgories ?
Lensemble de ces proprits offre tout un ventail daspects divers du phnomne de
figement. Elles sont plutt des notions pertinentes et utiles que des critres. Aussi ne prtend-
il pas quelles soient toutes des critres distinctifs. Certaines sont plutt des phnomnes
scalaires ou des notions plus ou moins importantes pour le figement. Nous ne commenterons
pas toutes ces proprits ici, mais constatons que toutes ne sappliquent pas, au mme degr,
toutes les catgories figes.
La polylexicalit , une squence de plusieurs mots, est, selon G. Gross (1996:9), une
condition ncessaire pour quon puisse parler de figement . Les mots en question doivent
aussi avoir une existence autonome .
Il ne dit pas explicitement que lopacit smantique est une condition ncessaire pour le
figement. Pourtant, il (1996:11) appelle les suites opaques smantiquement figes aprs
avoir dj stipul (1996:8) que lopacit smantique va de pair avec le figement syntaxique :
[...] le figement smantique et le figement syntaxique sont deux aspects dun mme
phnomne quil convient de ne pas sparer de faon artificielle . On voit que les opinions de
Hudson et celles de G. Gross sont opposes sur ce point.
Lorsquil se consacre la catgorie plus spcifique des noms composs , il parle, non
pas de critres, mais de paramtres qui permettent de montrer le figement dans les groupes
nominaux
61
(1996:31). Deux de ses paramtres sont dcrits sous les rubriques absence de
libre actualisation des lments composants et un nom compos est une non-prdication .
Lactualisation est une dtermination qui peut tre un article ou encore un modificateur
adjectival. Pour montrer la diffrence entre les groupes nominaux libres et les noms
composs, G. Gross (1996:32) fournit les exemples un fait vident et un fait divers. Le
premier exemple serait un groupe nominal ordinaire , avec un substantif-tte, actualis
dune part par larticle un, dautre part par ladjectif vident. Un fait divers est un nom
compos. Dans ce cas, larticle un nest pas une actualisation cense dterminer le seul mot
fait, mais tout le nom compos fait divers. Divers nest pas une dtermination, ce mot faisant
partie du nom compos. Pour ce qui est du deuxime paramtre, il explique, avec les mmes
exemples, quun fait vident est une prdication, puisquon a la possibilit dexpliciter cette
prdication avec une paraphrase : Nous avons constat un fait qui est vident. Ce procd ne
marche pas pour les noms composs : *Nous avons constat un fait qui est divers.
61
Cest nous qui soulignons.
31
Shapira (1999:8-9) utilise le terme de critre, mais aussi de trait distinctif et de proprit.
Parmi les critres, elle identifie la possibilit ou limpossibilit de changer formellement de
quelque manire que ce soit le groupe donn comme le trait distinctif le plus
important entre la squence libre et la forme fige . Elle ne semble pas faire de distinction
entre les notions critre, trait distinctif et proprit. Il est vrai que les critres en soi ne
constituent pas son sujet principal et elle fait rfrence louvrage de G. Gross. Cependant
elle appelle les oprations impossibles effectuer dans les squences figes des critres
distinctifs , quelle juge valables pour toutes les expressions figes :
1. limpossibilit de changer lordre des mots dans la squence fige ;
2. limpossibilit de remplacer lun ou lautre des mots du groupe, ft-ce par un synonyme ;
3. le segment fig nadmet pas la translation morphologique
62
;
4. la suspension de la variation en nombre des composantes, mme pour les cas o le
changement naffecterait pas le sens de la locution ;
5. le segment fig nadmet pas la manipulation transformationnelle ;
6. le segment fig ne permet pas lextraction dun de ses composants pour :
la relativisation
la topicalisation
la voix passive
la mise en vedette au moyen de la corrlation cest...que.
(Shapira 1999:8-9)
On aura loccasion plus tard de revenir sur les autres critres quelle cite, dans les discussions
plus spcifiques.
Moon (1998:8-9) emploie le terme de critre ( criterion ). La non-compositionnalit est
un critre, dont la forme archtypale est la non-compositionnalit smantique. Outre ce
critre, elle en mentionne trois autres : lorthographe ( linstar de G. Gross, elle considre les
FEIs
63
comme des suites de deux mots ou plus), lintgrit syntaxique ( FEIs typically form
syntactic or grammatical units in their own right ) et finalement lintonation, un critre
phonologique.
En parlant de la locution, Glich et Krafft (1997:243) signalent que les deux traits
didiomaticit et de stabilit sont souvent utiliss comme critres de prfabrication, terme
quils emploient l o dautres chercheurs utiliseraient volontiers celui de figement
64
.
Martin (1997:292-293) utilise le terme de proprits, et numre celles quil considre
comme les plus essentielles pour les locutions : les restrictions slectionnelles, la non-
compositionnalit et la valeur intensionnelle.
Nunberg et al. (1994:492-493) emploient le mme terme, celui de proprit ( properties
of the phrase ). Les proprits mentionnes dans leur article sont conventionnalit,
inflexibilit, figuration, proverbialit, registre informel et affect. Ces proprits ne sont pas
62
La translation morphologique implique quune catgorie grammaticale peut tre transforme en une autre, par
exemple: verbe -> nom ; payer -> le paiement.
63
Fixed Expressions and Idioms.
64
Glich et Krafft (1997:243) : La qualit essentielle des locutions / idiotismes / expressions phrasologiques,
cest dtre prfabriques ou prformes [sic !].
32
toutes des critres distinctifs, puisquon stipule que seule la proprit de conventionnalit
sapplique obligatoirement tous les idiomes.
Sans numrer tous les critres dont parle Misri (1987b) il en numre une trentaine il
est possible de constater que cest le terme de critre quil emploie lorsquil va prsenter
lidentification et la classification des figements.
Il est intressant de noter lapparition que fait parfois lintuition dans les contextes
phrasologiques. Parfois elle est mentionne explicitement, soit comme critre, soit comme
outil ou mthode de travail. Ainsi, Misri (1987a:75) commente limpression du dj vu
de Bally (1963:70) et lappelle un critre intuitif . Selon Misri (1987a:76), il sagit mme
du critre prfr de Bally : [] on peut dire que Bally prfre finalement lintuition tous
les critres [] . Dans un sens, Misri utilise lui-mme lintuition comme outil de travail. Son
procd de travail a t de constituer dabord un corpus dexpressions. Ces expressions ont
ensuite servi de point de dpart sa discussion thorique des critres. Il dit aussi
explicitement :
Tout francophone peut dire intuitivement laquelle des deux squences suivantes :
1) Les carottes sont cuites [pour lquipe de]
2) Les nouilles sont cuites
est une expression toute faite et laquelle ne lest pas.
(Misri 1987b:7)
Il faut admettre quil nest pas le seul travailler de cette manire. Dans une analyse de la
distribution des idiomes et de ce quil appelle stock phrases , Danell (1992:20) identifie les
stock phrases laide de lintuition
65
. De mme, on peut citer Achard et Fiala :
Lintuition de locutionnalit peut sexprimer sous forme de jugements : un
locuteur, dans la majorit des cas, est (thoriquement) capable, sans mme
pouvoir formuler ses critres, de dcider quun groupe de mots est plutt un nom
compos, une locution, une expression figure, un groupe plus ou moins fig etc.
[...] Tout sujet parlant possde par rapport sa langue, cette intuition
locutionnelle, variable videmment dun sujet lautre, et que lactivit
lexicographique vise homogniser et construire en norme. (Achard et Fiala
1996:281)
Notre impression est que les linguistes utilisent souvent lintuition comme mthode (quils en
soient conscients ou pas) et que cela est la raison pour laquelle on classe souvent certains
syntagmes comme figs, quand bien mme les critres prsents ci-dessus ne pourraient pas
tre appliqus.
Pour conclure, on constate que les critres proposs portent des dnominations diverses :
Hudson appelle les contraintes syntaxiques inattendues et les restrictions collocationnelles
inattendues des critres variationnels. Shapira numre six critres qui seraient des critres
distinctifs . Moon parle des quatre critres de non-compositionnalit, dorthographe,
dintgrit syntaxique et dintonation. Misri analyse une trentaine de critres et Bally,
finalement, voque lintuition comme critre.
65
[...] all the phrases that I intuitively judge as being stock phrases (Cest nous qui soulignons).
33
Lorsque G. Gross veut dcrire ce qui se cache derrire la notion de figement, il examine les
onze proprits numrs ci-dessus. Martin aussi bien que Nunberg et al. parlent galement
de proprits.
Glich et Krafft, finalement, utilisent les deux termes de traits et de critres lorsquils
voquent lidiomaticit et la stabilit.
Le choix dutiliser lune ou lautre des tiquettes critres, proprits ou traits ne semble
pas tre bas sur des qualits inhrentes aux notions derrire les termes examins. Ce que lun
appelle un critre, lautre lappelle une proprit. Que lon pense par exemple la non-
compositionnalit, qui est un critre chez Moon, mais une proprit chez Martin. Ce que G.
Gross nomme blocage des paradigmes synonymiques couvre probablement ce que Hudson
appelle des restrictions collocationnelles inattendues et Shapira limpossibilit de remplacer
lun ou lautre des mots. G. Gross appelle cela proprit, tandis que Hudson et Shapira
emploient le terme de critre. Nous navons pas trouv de manire systmatique de sparer
les notions de critres, proprits et traits les unes des autres, puisque nous avons
limpression quon accorde le mme statut aux caractristiques dcrites par ces termes.
1.2.5 Porte du figement
Dans de nombreuses expressions, lendroit o sarrte le figement est vident, dans dautres,
les limites prtent discussion. Afin dillustrer la problmatique de la porte du figement,
regardons lexemple du mot gr, qui est surtout utilis dans les expressions figes.
1.2.5.1 Expressions continues
En ce qui concerne la porte, il est clair que dans au gr de
66
, tous les mots font partie de
lexpression. Aucun mot nest remplaable par une variante et il ny a pas non plus de mot
dont on puisse se passer.
Dans lexpression + POSS
67
+ gr, il nest pas non plus possible dexclure un des mots,
mais la diffrence de lexemple prcdent, lexpression admet une certaine variation ;
ladjectif possessif (POSS) ne reste pas toujours le mme. Ainsi, les variantes son gr et
leur gr sont attestes dans le corpus. Puisque les mots et gr sont ceux qui restent toujours
les mmes, il est logique de dire que toute lexpression ( POSS gr) doit tre incluse dans la
porte du figement, mais que __ gr constitue le noyau
68
de lexpression.
Une autre expression qui contient le mot gr, et qui a une structure similaire celle que
nous venons de voir est de POSS gr. Dans notre corpus
69
, nous avons relev les variantes son
et notre comme adjectif possessif. Dans cette expression, il y a aussi la possibilit dinsrer un
des deux adjectifs qualificatifs plein et propre. Lexpression a la structure suivante, o on
peut choisir entre les mots plein et propre : de POSS plein / propre gr. Or, le fait est
quaucune des attestations dans le corpus ne se passe de ladjectif qualificatif. Les exemples
utiliss sont de notre plein gr, de son propre gr, de son plein gr et de plein gr.
Lexpression semble donc inclure ou bien ladjectif possessif ou bien ladjectif qualificatif
66
Au gr de selon le got, la volont de (PR:gr).
67
Adjectif possessif.
68
Notre utilisation du terme de porte de figement diffre de celle de G. Gross (1996:38). Notons aussi que nous
nemployons le terme de noyau ni comme lui, ni comme Martinet (1970).
69
Voir 1.4 infra.
34
plein, ou bien les deux, mais pas ladjectif qualificatif propre sans adjectif possessif. Cela
veut dire que la prsence de ladjectif possessif nest pas indispensable et que nous sommes
en fait en prsence de deux expressions, avec les structures suivantes :
p
p
{
oss
g
}
POSS
de oss plein r de POSS propre gr
plein
{
*propre
}
Notons que le choix de ladjectif qualificatif est trs restreint, et cest la raison pour laquelle
nous les citons explicitement. Le noyau de cette expression est de _ gr, mais la porte du
figement stend sur toute la structure de {POSS/plein} gr et de POSS propre gr,
respectivement.
La porte du figement peut tre plus ou moins difficile tablir. Nous allons maintenant
examiner quelques expressions qui se prtent des discussions plus labores. Commenons
par (travail) de longue haleine
70
. Pourquoi un mot entre parenthses ? Dans le PR,
lexpression est cite comme un complment du substantif travail ; travail de longue haleine.
Dans Franska Ordboken [Le dictionnaire franais] (ci-aprs FO), lexpression de longue
haleine est traduite en sudois, sans faire rfrence un substantif particulier. Dans le DEI,
lexpression est galement cite indpendamment, sans prcision sur le nom quelle peut
qualifier. Le corpus nous renseigne sur quelques combinaisons possibles. Ainsi, lexpression
se manifeste avec les substantifs suivants :
entreprise de longue haleine
exercice de longue haleine
manifestation de longue haleine
objectif de longue haleine
uvre de longue haleine
opration de longue haleine
tche de longue haleine
travail de longue haleine
Puisque, en principe, nimporte quel substantif, tant quil rentre dans le contexte, peut tre
utilis, nous proposerons que le noyau de cette expression soit de longue haleine et la porte N
de longue haleine. Cependant, le mot travail semble tre plus frquent dans cette expression
que les autres noms cits dans la liste ci-dessus. Lexpression travail de longue haleine est
cite dans le PR. Des expressions particulirement frquentes doivent avoir une grande
importance pour les lexicologues. Comment choisir quelles expressions inclure dans un
dictionnaire ? Nous proposons dappeler les mots frquemment employs (mais non
obligatoires) dans une expression particulire des expansions
71
.
70
De longue haleine qui demande des efforts prolongs (DEI:haleine).
71
Martinet (1970:128) dfinit lexpansion comme tout lment ajout un nonc qui ne modifie pas les
rapports mutuels et la fonction des lments prexistants . Mme si pour lui ce terme est employ dans
plusieurs contextes qui ne nous concernent pas, nous constatons que rien dans sa dfinition nempche dutiliser
le terme comme nous le faisons ici.
35
Lexpression mettre qqn hors de POSS gonds
72
est prsente dans les dictionnaires avec des
variantes en ce qui concerne le verbe. Ainsi, le PR utilise les verbes jeter et mettre qqn hors
de ses gonds. Dans le DEL et le Trsor de la langue franaise (ci-aprs TLF), ce sont les
verbes tre et sortir qui sont utiliss. Le TLF fournit galement les variantes faire sortir et
mettre qqn hors de ses gonds. Dans le corpus, le seul exemple est faire sortir qqn de ses
gonds. partir des exemples cits, les conclusions possibles sont nombreuses. Premirement,
les verbes tre et sortir ne se combinent pas avec qqn. Dans lexpression se cachent en fait
deux variantes:
1) VB qqn hors de POSS gonds [VB: mettre, jeter, faire sortir]
2) VB hors de POSS gonds [VB: tre, sortir]
Les verbes possibles dans la premire variante sont mettre, jeter et faire sortir, tandis qutre
ou sortir doivent tre utiliss dans la deuxime. Le noyau des deux expressions est hors de __
gonds
73
. Puisquil nest pas possible de se passer du verbe, il est inclus dans la porte de
lexpression. La porte stend ainsi sur toute lexpression, comme dans les exemples donns
ci-dessus.
Dans lexemple faire faux bond ( qqn)
74
, le verbe faire simpose. Le TLF, Le
Dictionnaire des expressions idiomatiques (ci-aprs DEI) et le PR citent tous faire faux bond
qqn
75
. Le PR (bond) montre aussi quon peut employer lexpression sans indiquer qui le
faux bond a t fait : Lentrepreneur qui devait rparer le pavillon inhabitable avait fait faux
bond, cause des grves. Il arrive que lexpression se trouve sans verbe. Dans notre corpus,
les exemples attests se passent de lobjet indirect qqn et un des exemples se trouve
galement sans verbe :
Le premier faux bond est survenu courant aot. Les tensions dans le golfe
Persique et lclatement de la grve dans la moiti des mines dor sud-africaines
nont pas mme fait frmir les cours du mtal jaune Londres. (ME 87 27:1)
Le noyau de lexpression est faux bond, et la porte inclut le verbe ainsi que lobjet indirect.
Lorsque le verbe est prsent dans le contexte, cest le verbe faire qui est de rigueur.
Revenons au mot gr, cette fois dans lexpression savoir gr ( qqn)
76
. La forme dans le PR
est savoir gr qqn. On y cite les exemples Il faut en savoir gr lauteur et Nous vous
saurions gr de nous rpondre rapidement. Dans le DEI, on lit savoir gr qqn de qqch et
dans FO, savoir [bon] gr qqn de qqch. Le TLF cite les variantes savoir gr, savoir bon gr,
savoir un gr infini qqn (de qqch). La question qui se pose est donc o sarrte la porte de
lexpression et sil y a un noyau qui reste toujours le mme. Dans les exemples cits des
dictionnaires, savoir gr qqn fait toujours partie de lexpression, parfois suivie par de qqch.
72
Mettre qn hors de ses gonds LOC.FIG. jeter, mettre qqn hors de ses gonds, hors de lui-mme, sous leffet de
la colre (PR:gond).
73
Peut-tre mme que le noyau ne comprend que de __ gonds, puisque hors nest pas obligatoire en combinaison
avec le verbe faire sortir.
74
Faire faux bond qqn ne pas faire ce quil attendait (DEI:bond).
75
Dans le TLF faux bond scrit avec un trait dunion : faux-bond.
76
Savoir gr qqn MOD. SAVOIR GR qqn : avoir de la reconnaissance pour qqn. (PR:gr).
36
Le fait est que dans les exemples cits, lobjet indirect de qqch est toujours prsent, dans les
dictionnaires aussi bien que dans le corpus. Voici quelques exemples tirs du corpus :
[...] baissez dun cran la viscosit de votre huile ; votre batterie vous en saura
gr [...]. (LB860216)
[...] pour que les uns et les autres ne sachent pas gr au gouvernement de vouloir
en hter la cration. [...] (MO 4 dcembre 1954)
[...] lopinion lui sait gr davoir rejet [...] une note de Washington. (MO 29
dcembre 1984)
dont beaucoup de citoyens algriens rtifs sa frule lui ont su ou lui sauront
gr.
(MO 28 dcembre 1978)
La porte de lexpression est savoir gr qqn de qqch, avec le noyau gr __ de __. Les
possibilits dinsrer bon ou infini sont facultatives.
Dans le cas de for intrieur
77
, il y a les variations for intrieur (FO, TLF), le for intrieur
(PR emploie ltiquette littraire), en mon (son etc.) for intrieur (PR) et dans son for
intrieur (PR, DEL, FO). Le noyau est for intrieur, et la porte en/dans POSS for intrieur.
Cette hypothse est confirme par notre corpus, qui contient les formes en son for intrieur et
dans leur for intrieur.
Le problme de porte pour avoir maille partir
78
est de savoir sil faut ou non inclure un
objet indirect comme avec qqn ou avec qqch. Le PR et le TLF citent tous les deux les deux
variantes avoir maille partir avec qqn, avec qqch. Le DEI et FO citent la forme avec qqn.
Dans le corpus il y a un objet indirect prsent dans les exemples :
avoir maille partir avec les autorits brsiliennes
avoir maille partir avec ses allis
avoir maille partir avec Tito
avoir maille partir avec ceux-ci
La porte de lexpression est avoir maille partir avec qqn/qqch, avec le noyau ___ maille
partir avec ___.
Il importe de noter que la porte peut avoir une importance non ngligeable sur le sens.
Pour illustrer cela nous nous inspirons de ltude de Molander (1999) sur les expressions
figes comportant le mot coup. Molander (1999:38) cite le sens opaque de lexpression sur le
coup, qui est instantanment
79
. Lexpression sur le coup de, en revanche, nest pas
simplement la mme expression suivie dune prposition. Sur le coup de doit tre suivi dune
77
For intrieur COUR. en, dans mon (son etc.) for intrieur : dans la conscience, au fond de soi-mme
(PR:for).
78
Avoir maille partir MOD. AVOIR MAILLE PARTIR avec qqn, avec qqch. : avoir un diffrend [...] avec qqn,
une difficult avec qqch. (PR:maille).
79
Elle se sert du dictionnaire Larousse.
37
indication horaire et veut dire vers [chiffre] heures. Citons titre dexemple les attestations
suivantes du corpus :
Atteint la tempe, M. Bureau a t tu sur le coup. (LB860929)
A Louvain, ce sera une course pour A.T.V. qui sera propose en premier lieu sur
le coup de 12h 15. (SO880402)
1.2.5.2 Expressions discontinues
Les expressions figes de longue haleine, faire faux bond qqn et au gr de sont continues ;
les mots dans lexpression sont contigus et il ny a pas de trou remplir entre eux. Ceci nest
pas toujours le cas. Les mots dans une expression fige peuvent apparatre lun proximit de
lautre, mais avec des mots qui ne font pas partie de lexpression, insrs entre eux. Dans les
expressions N prs et dun N lautre, ce sont les mots autour du nom qui sont toujours
prsents (avec une variation de genre de larticle indfini). Le nom peut varier aussi bien dans
N prs que dans dun N lautre, et na donc pas de forme exacte dans cette expression.
ce propos on peut noter que le choix de N peut varier et aller de trs restreint jusqu
pratiquement libre. Plus tard nous allons examiner le blocage lexical de ces expressions
80
.
Pour linstant il nous suffit de dire quelles sont discontinues, mais pas pour autant moins
figes que les autres expressions examines dans cette section.
Les collocations forment un groupe trs htrogne qui peut parfois tre inclus dans le
groupe des expressions figes. Il est normal quil soit souvent possible dinsrer dautres mots
dans une collocation.
1.2.5.3 Synthse
Rsumons brivement les dfinitions des notions suivantes :
Le noyau de lexpression est constitu par les mots qui sont toujours prsents, normalement
sous la mme forme
81
.
La porte de lexpression reprsente lexpression dans sa forme la plus complte, avec
toutes les parties qui peuvent tre prsentes. Tout ce qui nest pas noyau peut avoir des
variantes et certains mots ne sont pas obligatoirement prsents.
Les expansions sont des mots courants dans lexpression en question, mais qui sont non-
obligatoires
82
.
Une reprsentation systmatise des expressions discutes dans cette section donne le tableau
suivant :
80
Voir 2.5.1.2 infra.
81
Dans une tude plus exhaustive, consacre uniquement la porte, il importerait de distinguer entre les mots
sans flexion et les mots flexionnels. Ici, nous nentrons pas dans ces dtails.
82
Il y a donc une diffrence entre les expansions qui sont courantes et les insertions qui peuvent tre nimporte
lesquelles. Voir 2.6 infra.
38
porte de lexpression noyau expansions
au gr de au gr de
POSS gr __ gr
de POSS gr de__ gr de POSS propre gr
de POSS/ plein gr de __ gr
N de longue haleine de longue haleine uvre de longue haleine
travail de longue haleine
mettre/jeter/faire sortir qqn hors de
POSS gonds
hors de ___ gonds
tre/sortir hors de POSS gonds hors de __ gonds
faire faux bond qqn faux bond
savoir gr qqn de qqch savoir gr __ de__ savoir bon gr qqn
savoir un gr infini qqn
en / dans POSS for intrieur for intrieur
avoir maille partir avec qqn/qqch avoir maille partir
avec
sur le coup sur le coup
sur le coup de CCT. sur le coup de
N prs __ prs
dun N lautre dun __ lautre
Tableau 1. La porte, le noyau et les expansions des expressions figes.
1.3 Dlimitation du sujet
Malgr le caractre gnral du phnomne de figement, il faut fixer des limites au sujet de
ltude. Dans le prsent travail, cest le franais moderne qui sera la cible de la recherche. Ce
nest donc pas ltymologie ou laspect historique en gnral qui nous intressent en premier
lieu, mme si ces aspects ne sont pas sans importance pour un critre comme la syntaxe
marque, pour en mentionner un exemple. Si nous citons parfois des exemples dun corpus
littraire de textes datant de 888 1899
83
, cest pour fournir des exemples particulirement
rvlateurs et pour montrer comment des traits de lancienne langue sont rests jusqu nos
jours. Les exemples du corpus littraire ne sont pourtant pas indispensables.
Si nous vitons les procds appartenant plutt la langue parle, cest pour dlimiter le
sujet de cette tude. Il est certes pertinent pour la phrasologie de prendre en considration la
situation de lnonciation
84
.
En outre, il faut fixer les limites de la forme des expressions tudies. Ainsi, il ny aura pas
danalyse de mots individuels le figement au niveau morphologique naura pas de place
dans ce travail. Les expressions examines contiennent deux mots ou plus
85
.
83
CDLITT.
84
ce propos, les termes noncs lis ( bound utterances , Fnagy 1982, 1997), phrasme (Meluk 1993)
ainsi que les termes anglais routine formulas ( situation formulas , stylistic formulas , ceremonial
formulas , gambits et euphemisms , Yorio 1980) et conversational routines (Coulmas 1981, Aijmer
1996) mritent leur place dans la recherche consacre au figement. Or, fixant les limites du prsent travail, nous
sommes oblige de laisser certains aspects, si intressants soient-ils, de ct.
85
Mme si la dfinition dun mot mrite toute une discussion, nous nous contentons ici dutiliser les mots en
tant quunits graphiques, cest--dire, orthographiquement spars dun blanc. Les mots contenant un trait
dunion seront donc compts comme un seul mot, mme si cela peut paratre arbitraire, dautant plus que
lorthographe nest pas toujours uniforme.
39
Les expressions analyses seront tout de mme de caractre et de longueur varis : les plus
courtes (en comptant le nombre de mots) sont composes de deux mots seulement et dautres
de phrases entires. On pourra donc sattendre rencontrer des expressions de diffrentes
fonctions syntaxiques : syntagmes nominaux, verbaux, adverbiaux et dautres. Notre but est
dexaminer tous les types dexpressions qui se prtent au figement, sans les diviser ds le
dbut de la recherche en catgories.
1.4 Corpus
Pour ltude empirique, les exemples sont tirs dun corpus informatis des journaux Le
Monde (MO), Le Monde conomique (ME), La libre Belgique (LB) et Le Soir (SO), dont les
deux derniers sont belges, les autres franais. La composition du corpus est prsente dans le
tableau ci-dessous. Le logiciel utilis pour extraire les exemples est WordCruncher.
Nom du journal Nombre de
mots
Nombre de
numros
Dates
La libre Belgique 1 033295 17 fvrier 1986-novembre
1987
Le Monde 556192 14 1945-1988
Le Monde
conomique
994528 5 1983-1988
Le Soir 1 118891 12 avril 1988
Tableau 2. Le corpus informatis de journaux.
On pourrait objecter que ltude de journaux ne nous renseigne pas sur tous les aspects de la
langue. Cela dit, il est nanmoins possible dillustrer nos thories avec des exemples tirs de
journaux. Lalternative serait de construire nous-mme des exemples, mais nous considrons
les exemples authentiques comme plus intressants pour notre tude. Cela est dautant plus
important que nous sommes persuade que le contexte a une trs grande importance dans
toute analyse linguistique. Nous concluons aussi, avec Deignan (1999a:197), quun corpus
journalistique contient des textes dont les lecteurs reprsentent une grande partie des locuteurs
dune langue.
1.5 But, mthode et disposition
En raison de la difficult voque de dfinir lexpression fige, nous avons voulu formuler le
but de notre recherche autrement. Pour viter daborder la problmatique avec des ides
prconues, nous nous carterons des classements pralables des diffrentes catgories
dexpressions figes. Nous commencerons la discussion par une analyse des critres, ce qui
nous permettra de cerner non seulement la catgorie quon nomme expression fige, mais
galement tout le phnomne de figement linguistique. Nous nous proposons ainsi de mettre
lpreuve les critres communment proposs pour identifier les expressions figes.
Il semble invitable de tomber dans des raisonnements circulaires lors dune tude du
phnomne de figement. Il est impossible de recommencer, pour ainsi dire, zro en ce qui
concerne nos connaissances linguistiques. Le fait est que nous sommes influence par
limpression de pouvoir identifier par nous-mme de nombreuses expressions figes. Nous
avons galement vu bon nombre de critres proposs, ainsi que des explications sur leur
40
fonctionnement, ce qui peut avoir une influence sur la recherche. Souvent, au lieu dtablir
des listes dexpressions figes partir des critres, on explique les critres partir des
expressions figes alors dj considres comme telles.
La mthode suivie ici prend comme point de dpart un raisonnement thorique autour des
termes ncessaires pour lanalyse. La mthode choisie consiste ainsi en lanalyse
systmatique des critres, de leur fonctionnement et de leur validit lorsquil sagit
didentifier les expressions figes. En comparant les critres choisis nous essaierons de
dcider sils se recouvrent ou sils sont indpendants les uns des autres.
Vu que les expressions lexicalises sont, telles que nous les dfinissons, un type
dexpressions figes, il est vident que les dictionnaires constituent un outil important de
notre travail. Nous nous servirons principalement des dictionnaires unilingues Dictionnaire
des expressions idiomatiques (DEI), Le Petit Robert (PR), Le Trsor de la langue franaise
(TLF) et du dictionnaire bilingue Franska Ordboken (FO).
Les exemples authentiques avec contexte, accessibles dans le corpus informatis, serviront
surtout illustrer les hypothses que nous mettrons.
Le Chapitre 2 est le plus important, tant par le nombre de pages que par lanalyse, qui
constitue la base des chapitres qui suivent. Il contient lexamen des critres qui marquent le
point de dpart de notre recherche. Dans le Chapitre 3, ces critres seront soumis un examen
de leur statut dans le modle classique de classification. Selon ce modle, les conditions
ncessaires et suffisantes sont les facteurs dfinitoires qui permettent dinclure ou non un
membre dans la catgorie examine. Dans le Chapitre 4, les critres analyss seront mis en
rapport les uns avec les autres, dans le but dexaminer sils se recouvrent partiellement ou
entirement, ou sils sont juxtaposs. Ce procd nous permettra de discuter, dans le Chapitre
5, du concept de ressemblance de famille, modle de classification qui pourra expliquer
comment on peut considrer les expressions figes comme une catgorie linguistique, quoique
htrogne en apparence. Finalement, nous rsumerons dans le Chapitre 6 les conclusions
tires dans ltude.
41
2 Analyse des critres
Nous nous proposons de jeter une nouvelle lumire sur le figement, avec comme point de
dpart une analyse des critres proposs et de leur application aux expressions dites figes.
Si nous avons choisi daborder le figement partir des critres et non pas en analysant les
catgories dj proposes, cest que, dune part, plusieurs chercheurs ont dj entrepris des
descriptions de catgories et de typologies de figement et que, dautre part, les chercheurs
semblent daccord sur le fait que certaines expressions figes appartiennent clairement
diffrentes catgories, quoique plusieurs de ces expressions soient souvent identifies par les
mmes critres. Il nous semble quon se laisse parfois diriger par des ides prconues sur
lappartenance des expressions figes telle ou telle catgorie et que, ce faisant, on nglige
les critres.
Les critres suivants seront ainsi discuts et analyss en dtail :
mmorisation le rle de la mmorisation pour les expressions figes
contexte unique le rle des mots utiliss uniquement dans les expressions figes
non-compositionnalit la contribution au sens de lexpression par chaque mot qui y figure
syntaxe marque limportance des constructions syntaxiques rares
blocage lexical limpossibilit deffectuer des commutations
blocage grammatical limpossibilit de faire des changements syntaxiques
En examinant ces critres, nous aurons loccasion de revenir sur la plupart des critres et
proprits mentionns dans le Chapitre 1, bien que la terminologie diffre dun chercheur
lautre. En raison de la terminologie abondante et diverse, il est difficile de se retrouver dans
la phrasologie. Pour remdier cet aspect, nous prsenterons ici un choix de termes
frquemment employs par dautres auteurs, arrangs en fonction de la dnomination sous
laquelle le phnomne dcrit par le terme est analys dans ce travail
86
:
86
Les noms inclus dans cette liste sont premirement ceux des chercheurs dont le sujet de recherche a t les
expressions figes ou le figement, tels que Gross, Hudson, Moon et Shapira. Dautres chercheurs dans la liste ont
particip avec des articles dans des anthologies sur les locutions, par exemple Martin ainsi que Glich et Krafft.
Nous y avons aussi plac les termes de Nunberg et al. en raison de leur article, souvent cit, sur lidiome. La liste
nest pas exhaustive.
42
Dnomination : Termes employs par dautres chercheurs : Nom :
tymologie G.Gross (1996:21) mmorisation
(voir 2.1) prfabriqus,
squences prformes
Glich, Krafft
(1997:243, 244)
archasmes,
dficiences lexicales
Glich, Krafft
(1997:243, 244)
contexte unique
(voir 2.2)
lments archaques de nature lexicale Schapira
(1999:10)
opacit smantique G.Gross (1996:10)
dficiences lexicales et smantiques Glich, Krafft
(1997:243)
figurative meaning Hudson (1998:9)
restrictions slectionnelles,
non-compositionnalit,
valeur intensionnelle, valeur non rfrentielle
Martin (1997:292-
293)
non-compositionality Moon (1998:8)
conventionality,
figuration
Nunberg et al.
(1994:492)
non-compositionnalit
(voir 2.3)
squence dite opaque Shapira (1999:11)
non-actualisation des lments G.Gross (1996:13)
dficiences syntaxiques,
anomalies
Glich, Krafft
(1997:243, 266)
anomalous syntax or usage Hudson (1998:8-9)
syntaxe marque
(voir 2.4)
lments archaques de nature morphologique,
lments archaques de nature syntaxique,
constructions elliptiques
Schapira (1999:10,
11)
degr de figement,
blocage des paradigmes synonymiques,
dfigement
G. Gross (1996:16,
17,
19)
unexpected collocational restrictions,
unexpected syntactic constraints
Hudson (1998:8)
restrictions slectionnelles Martin (1997:292-
293)
blocage lexical
(voir 2.5)
limpossibilit de remplacer lun ou lautre des
mots du groupe,
lments archaques de nature syntaxique (ordre
des mots)
Shapira (1999:9
43
Dnomination : Termes employs par dautres chercheurs : Nom :
blocage des proprits transformationnelles,
non-insertion,
absence de libre actualisation des lments
composants
G. Gross (1996:12,
18,
32)
impossibilit de changer lordre des mots dans la
squence fige,
la suspension de la variation en nombre des
composantes,
le segment fig nadmet pas la manipulation
transformationnelle,
le segment fig ne permet pas lextraction dun des
composants pour la relativisation, la
topicalisation, la voix passive ou la mise en
vedette au moyen de la corrlation cest...que
Shapira (1999:9)
unexpected syntactic constraints Hudson (1998:8)
restrictions de variations ou de transformations Glich, Krafft
(1997:243)
fixedness,
variation
Moon (1998:120-
150)
blocage grammatical
(voir 2.6)
inflexibility Nunberg et al.
(1994:492)
Ce qui nous intresse, cest lidentification des expressions figes. Il nous semble surtout
ncessaire de dcider si les critres proposs par les linguistes sont pertinents pour
diagnostiquer laptitude du locuteur reconnatre certaines suites de mots comme des
expressions figes. Nous tenons prciser que les mmes principes doivent sappliquer quel
que soit le locuteur. Un enfant ne reconnat pas les mmes expressions (ni la mme quantit
dexpressions) quun locuteur plus instruit : un apprenant de franais ne reconnat pas les
mmes expressions quun linguiste franais etc. Nous croyons quil ny aura pas, en principe,
deux locuteurs ayant exactement les mmes connaissances en ce qui concerne la grammaire,
le vocabulaire ou la connaissance des expressions figes. Toutefois les diffrences indiques
ne sont pas considres comme des obstacles notre recherche, puisquici, ce sont les
principes derrire le phnomne de figement qui sont importants.
44
2.1 Mmorisation
Il y a consensus entre chercheurs sur le fait que des expressions telles que avoir les yeux plus
grands que le ventre
87
ou vendre la mche
88
sont des idiomes. De nombreux chercheurs sont
aussi daccord sur le fait que certains idiomes sont plus figs que dautres, certains sont plus
opaques que dautres, certains sont plus compositionnels que dautres et certains plus
lexicaliss que dautres. Nanmoins, il ne semble pas y avoir de doute sur leur qualit
didiomes
89
. Mais quel est le trait partag par les idiomes qui rendent les chercheurs inclins
les regrouper dans la mme catgorie ? Nest-il pas plausible quils partagent tout simplement
le trait dtre mmoriss par les locuteurs ?
Grunig voque (1997:225), en parlant de locutions
90
, lide quelles ne sont pas dfinir
comme un phnomne fondement essentiellement linguistique mais comme un phnomne
fondement psycholinguistique, et plus exactement mmoriel . On aura remarqu les
raisonnements circulaires dont souffre pratiquement toute recherche en phrasologie : bien
quil ny ait pas de dfinition communment accepte du figement, personne ne semble
hsiter lorsquil sagit de dresser des listes de diffrents types dexpressions figes. Voil
pourquoi il nous semble quil serait fructueux dexaminer le statut mmoriel que Grunig veut
attribuer aux locutions :
Nimporte quelle phrase ou syntagme peut acqurir le statut de titre, ou de phrase
historique, ou de rituel peu de choses prs mme de proverbe, condition
davoir un statut social solidaire dune inscription mmorielle [] ou davoir
connu un taux de rptition ou notorit dans une circulation langagire qui les ait
transforms en inscriptions mmorielles. (Grunig 1997:235)
Elle (1997:226) dit aussi que ce quoi elle attache le plus dimportance dans la dfinition de
la locution, est le figement, ou limmobilit, quelle associe donc linscription mmorielle.
Ainsi conue, la mmorisation, non seulement sinscrit parmi les critres, mais ajoute un
aspect trs important au figement dans la mesure o elle est pertinente pour toute expression
fige, quon les nomme idiomes, locutions ou autrement. Un problme dont souffre lanalyse
du critre de mmorisation est celui den prouver lexistence, ce qui nest gure possible sans
recourir des tests psychologiques. Mais sil est vrai que les locuteurs y compris les
linguistes bien sr ont des reprsentations mentales de toutes ces suites figes, cela signifie
87
Avoir les yeux plus grands que le ventre avoir plus dapptit apparent que rel ; tre incapable de manger
autant quon le dsirait (DEL:il).
88
Vendre la mche trahir un secret ; dvoiler un dessein qui devait tre tenu cach (PR:mche).
89
Cf. par exemple Gibbs (1994:278), qui ne contredit pas dautres chercheurs en ce qui concerne les idiomes en
question, mais qui prtend (au contraire dautres chercheurs) quils sont analysables ou dcomposables;
Contrary to the traditional view that idioms are noncompositional, many idiomatic phrases appear to be
decomposable or analysable, with the meanings of their parts contributing independently to their overall
figurative meaning [...] Idioms like pop the question, spill the beans and lay down the law are decomposable,
because each component obviously contributes to the overall figurative interpretation .
90
Sa dfinition de la locution, dans larticle en question, est trs gnrale et concide avec notre dfinition de
lexpression fige (voir 1.2.1 supra). Elle affirme (1997:225) que [c]ela couvre [] un champ vaste : du mot
compos au proverbe en passant par Je vous ai compris, Rodrigue as-tu du cur, Les mmoires dune jeune fille
range, A louest rien de nouveau, Soliman le magnifique et Un conomiste distingu .
45
que la catgorie conceptuelle expression fige existe, avec ou sans dfinition scientifique ou
formelle.
Il est vrai que bon nombre dexpriences ont t faites sur la seule catgorie didiome et
que ce qui intresse surtout les psycholinguistes est la comprhension des idiomes et, plus
prcisment, comment on arrive accder au sens que le locuteur a voulu transmettre.
Toutefois, on trouve parmi ces linguistes ceux qui ont propos que les idiomes soient en effet
stocks dans notre mmoire. ce propos, on sest souvent rfr aux trois modles
suivants
91
:
1) le modle de la liste mentale didiomes, propos par Bobrow et Bell en 1973,
2) le modle de la reprsentation lexicale de Swinney et Cutler, qui date de 1979,
3) le modle daccs direct, qui se concentre surtout sur linterprtation des
idiomes. (Gibbs, 1980)
Les deux premiers modles postulent que les idiomes sont reprsents en mmoire dans des
listes didiomes. La diffrence rside dans la manire daccder la liste en question. Bobrow
et Bell estiment quil y a deux moyens spars de comprendres des phrases un processus
pour interprter une suite littrale, et un autre pour les expressions idiomatiques. Lorsquune
interprtation littrale choue, cest la liste didiomes qui permet un interlocuteur dobtenir
le sens voulu.
Selon Swinney et Cutler il y aurait galement une liste didiomes, mais ceux-ci seraient
reprsents en mmoire de la mme manire que les mots. Un moyen spcial pour les
interprter ne serait pas ncessaire et les deux sens des mots impliqus littral et idiomatique
seraient dans ce cas prsents en mme temps.
Selon Gibbs finalement, les expressions ambigus sont interprtes premirement comme
idiomatiques. Mais mme sil constate que linterprtation idiomatique prcde
linterprtation littrale, il en arrive la conclusion que cela est surtout vrai pour des idiomes
trs courants ou familiers. Il est remarquer que cest la conventionnalit dune phrase qui
dcide de la difficult de comprhension. Dans certains cas, un usage littral est plus
conventionnel, tandis que dans dautres cest lusage idiomatique qui est le plus courant, voire
conventionnel, ce qui a videmment une influence sur linterprtation
92
. Quant aux critiques
qui ont t souleves contre ces modles, on notera que ce nest pas lhypothse que les
idiomes (dans ces cas-l) seraient mmoriss qui est mise en doute, mais plutt les procds
dinterprtation ou daccs.
Dans ce contexte, larticle intitul Meaning and memory par Bolinger (1976-1977)
mrite dtre mentionn. Bolinger ne sintresse pas aux procds de comprhension,
dinterprtation ou daccs, mais parle plutt des capacits psychologiques et de la relation
entre la mmoire et lengendrement des units de langue. Le degr dinteraction entre la
mmoire et la production est complexe et varie dun cas lautre. ce propos il conclut quil
y a, en fait, deux espces de langue : dun ct la langue automatique , de lautre la langue
91
Ces modles nont pas t sans critiques. Cacciari et Tabossi (1988) ont eu des rsultats qui vont lencontre
des deux premiers modles. Ils critiquent aussi, en partie, le modle daccs direct. Ce modle ne semble pas
valable lorsquon lapplique sur des idiomes moins familiers. Cf. larticle intitul Against the Lexical
Representation of Idioms de Burt (1992). Voir aussi Denhire et Verstigel (1996).
92
ce propos, voir aussi 2.5.2 infra.
46
propositionnelle . Il y a, selon lui (1976-77:13), a side that files things and a side that
puts them together . Pourtant il met en valeur le rle jou par la mmoire : [...] speakers do
at least as much remembering as they do putting together (1976-77:2); [...] memory is not
to be denied its effect (1976-77:8).
Le fait dtre mmoris est une proprit partage par toutes les expressions figes. Nous
avons vu que la conclusion laquelle est arrive Grunig, est que, lorsquon essaie de dfinir
la locution
93
, la linguistique toute seule ne suffit pas. ce sujet on peut galement citer
Hudson (1998:161), qui cherche des facteurs partags justement par toutes les expressions
figes : [...] it is only in a conceptual perspective that it is possible to suggest underlying
factors common to all fixed expressions .
Tournons vers le ct ludique de la langue. Grunig (1997:236) constate, lorsquelle
numre les proprits partages par toutes les formules figes, quelles donnent toutes lieu
des jeux de reconnaissance , comme par exemple la Roue de la Fortune
94
. Cela est une
consquence du fait qu [u]ne partie suffit pour lidentification du tout (Grunig 1997:237).
Misri (1987b:8-14) est arriv la mme conclusion et en profite dans une petite recherche
o il utilise la langue des schtroumpfs, issue des bandes dessines de Peyo. Il sagit de
remplacer les mots construits avec schtroumpf par dautres mots. Il a prsent ses
informateurs les phrases suivantes, sans autre contexte :
1. On va schtroumpfer au pont sur la rivire Schtroumpf, aujourdhui !
2. Schtroumpfer ! Toujours schtroumpfer ! ! Jen ai plein le schtroumpf, moi !
3. Je vais me schtroumpfer dans un coin et piquer un petit schtroumpf !
4. ...espce de tire-au-schtroumpf !
5. Quon ne me schtroumpf sous aucun prtexte !
6. Je ne vous cacherai pas le danger que vous schtroumpferez !
7. Schtroumpfons la courte schtroumpf !
8. Cest schtroumpf !
9. Il nous faut la [mouche] Bzz schtroumpf que schtroumpf !
10. Schtroumpf-qui-peut !
(Misri 1987b:9-10)
Les informateurs remplacent les constructions schtroumpfs avec les mmes mots dans la
plupart des phrases : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 (parfois avec une variante) :
2. Jen ai plein le dos/cul, moi !
3. [...] et piquer un petit somme/roupillon !
4. ... espce de tire-au-flanc/-cul !
5. Quon ne me drange sous aucun prtexte !
6. [Je ne vous cacherai pas] le danger que vous courrez !
7. Tirons la courte paille !
9. [Il nous faut la Bzz ] cote que cote !
10. Sauve-qui-peut !
(Misri 1987b:11)
93
On se rappelle que son utilisation du terme couvre plusieurs types dexpressions figes.
94
La Roue de la Fortune est une mission tlvise. Il sagit dun jeu o le but est de retrouver des phrases
connues laide des lettres de lalphabet. Lquivalent amricain sappelle Wheel of Fortune.
47
Misri tire la conclusion que cette unanimit montre que les phrases en question (ou, au moins
des parties de ces phrases) sont mmorises. Les seules phrases que les sujets nont pas
russies complter sont la phrase numro 1 (On va schtroumpfer au pont sur la rivire
Schtroumpf aujourdhui), les premires parties des phrases 2 et 3 (Schtroumpfer ! Toujours
schtroumpfer ! ! et Je vais me schtroumpfer dans un coin) et la phrase 8 (Cest schtroumpf !).
Dans une deuxime partie du test, les informateurs ont pu voir les images de la bande
dessine, ce qui a rendu le remplacement plus facile. On arrive en effet cerner le mot
cherch avec laide visuel que donnent les images
95
. Cest, selon Misri, le manque de contexte
qui rend difficile le remplacement dans 1, 2 et 8. En ce qui concerne la phrase numro 3,
celle-ci donne lieu plusieurs variantes
96
, mme avec le contexte visuel. Puisque ces quatre
exemples ne sont pas mmoriss hors situation (Misri 1987b:14), ils ne constituent pas des
figements.
Convenons pour un instant mme si ce nest que pour tester une hypothse que toutes
les expressions figes sont mmorises. Si cela saffirme, une implication inverse savre-t-
elle aussi logique ? Autrement dit, toutes les suites de mots mmorises, sont-elles des
expressions figes ? Cest la conclusion laquelle arrive Grunig (1997:225) : Une locution
serait un syntagme complexe inscrit durablement en mmoire et, inversement, tout syntagme
complexe ainsi mmoriellement inscrit serait une locution . Que dire des exemples comme
les suivants, qui font partie de lexprience faite par Misri :
5. Quon ne me schtroumpf sous aucun prtexte !
6. Je ne vous cacherai pas le danger que vous schtroumpferez !
Tous les sujets qui ont particip lexercice ont propos quon remplace le verbe
schtroumpfer par le verbe dranger dans la phrase 5 et par courir dans la phrase 6.
Selon la logique, Quon ne me drange sous aucun prtexte ! et Je ne vous cacherai pas le
danger que vous courrez ! (ou, au moins des parties ou variantes de ces phrases, telles que ne
pas dranger sous aucun prtexte ou courir un danger) serait donc des expressions figes.
Les phrases 5 et 6 constituent des exemples difficiles ranger dans lun ou lautre domaine
appartiennent-elles la phrasologie ou la langue librement engendre ? Voil justement
quon se rapproche des zones floues qui constituent une partie de la langue quon aurait (peut-
tre ?) du mal catgoriser. Nous tenons pour peu probable que les chercheurs phrasologues
classeraient 5 et 6 comme des expressions figes. Cependant, on peut certainement dire quil y
a des restrictions en ce qui concerne la commutation des mots les choix des informateurs
donnent croire quon ne remplace pas librement les mots par dautres. Il y a clairement des
liens entre les mots dans les rseaux psychologiques des informateurs. Ces liens jouent
vraisemblablement un grand rle dans le choix de mots que doivent faire tous les locuteurs
pour sexprimer. Ce genre de phrases, qui se retrouvent quelque part entre la langue librement
engendre et les expressions figes, seront discutes nouveau, puisquelles ont aussi des
95
Dans la premire ainsi que dans la deuxime phrase il sagit du verbe travailler et dans la phrase 8, le contexte
donne croire que cest le mot rat quon cherche.
96
Pour schtroumpfer, les informateurs ont propos se mettre, se cacher, se coucher et sallonger. Mme si Misri
(1997b:13) opte pour se cacher, il avoue que dautres verbes seraient possibles.
48
rapports avec les critres de blocage lexical et de blocage grammatical
97
. Limportance des
collocations est galement considrable dans ce contexte
98
.
Il semble logique de conclure que toutes les expressions figes seraient mmorises ou, si
lon veut, stockes, par les interlocuteurs. Il serait tentant de conclure que ce critre serait le
seul qui permette didentifier toutes les expressions figes, telles que nous les avons dfinies.
Or, le critre de mmorisation pose un problme : comme le signale le petit test de Misri, on
arrive aussi identifier des exemples qui ne sont normalement pas classs comme des
expressions figes. Voil pourquoi nous allons aborder, plus tard, la problmatique de la
catgorisation. Nous nous proposons de rexaminer les critres dans les modles de
catgorisation des conditions ncessaires et suffisantes et des ressemblances de famille
99
.
97
Voir infra 2.5.1.1 et 2.6.
98
Voir supra 1.2.2.3.
99
Voir les chapitres 3 et 5.
49
2.2 Contexte unique
Les mots fur et lurette apparaissent uniquement dans les expressions au fur et mesure
100
et
belle lurette
101
. Ce genre de mots ont un usage trs restreint, tant donn quils ne sont utiliss
que dans les expressions figes. Cest donc toujours dans le mme contexte quils
apparaissent. La notion de contexte est ici prise dans un sens troit ; cest toujours dans les
mmes constructions quun francophone utilise ces mots. Grce la particularit de ce genre
de mots, nous pouvons identifier un certain type dexpressions figes.
Dautres termes peuvent tre employs pour dcrire ce genre dexpressions. Sous
ltiquette d archasmes , par exemple, sont souvent regroupes des constructions
syntaxiques aussi bien que des particularits lexicales dites archaques. Ces particularits ne
se conforment pas aux paradigmes courants de la langue. Glich et Krafft (1997:244) disent,
propos des expressions de pied en cap
102
et au fur et mesure, quelles correspondent des
rgles grammaticales ou lexicales propres au franais dpoques antrieures . Schapira
(1999:10) appelle les mots qui entrent dans ce genre dexpressions des lments archaques
de nature lexicale . Elle exemplifie ce phnomne avec chercher noise
103
, de pied en cap et
rester coi
104
. Chez Misri, nous retrouvons un mot contexte unique (hocher dans hocher la
tte) sous le critre de neutralisation des oppositions lexicales (1987b:119). Comme
Schapira, il mentionne aussi des archasmes, et prsente entre autre fleurette dans conter
fleurette
105
, ores dans dores et dj
106
et frir dans sans coup frir
107
(1997b:156-157). Les
squences de ce type sont galement tudies par Martin (1997:294-295), qui les prsente
sous la rubrique Limitation de ltendue combinatoire
108
.
Vu que ces mots sont toujours employs dans le mme contexte, le locuteur ne peut mme
pas imaginer un autre contexte dans lequel ce mot pourrait tre employ, mais reconnat tout
de suite lexpression laquelle ils appartiennent. En franais moderne, les mots dont il est
question doivent tre pratiquement dnus dun sens indpendant, mme sil est possible de
retracer leur sens originel. En dautres termes, ce genre de mots nexiste plus ltat
indpendant en franais moderne (Schapira 1999:10).
Il nous a sembl intressant de faire une tude systmatique de ce genre dexpressions,
sans mettre lemphase sur la syntaxe archaque dont elles font ventuellement preuve. Aux
exemples cits ci-dessus sajoutent entre autre les mots instar, leu et sauvette, qui ne sont
employs que dans les expressions
linstar de
109
la queue leu leu
110
100
Au fur et mesure en mme temps et proportionnellement ou successivement (PR:fur).
101
Belle lurette LOC. FAM. IL Y A BELLE LURETTE : il y a bien longtemps (PR:lurette).
102
De pied en cap des pieds la tte (PR:cap).
103
Chercher noise chercher noise quelquun. Chercher se quereller avec lui (DEI:noise).
104
Rester coi demeurer, tre, rester coi demeurer, tre.. muet dtonnement (DEL:coi).
105
Conter fleurette MOD.LOC. conter fleurette une femme, la courtiser (PR:fleurette).
106
Dores et dj MOD. DORES ET DJ [] : ds maintenant, ds aujourdhui (PR:or).
107
Sans coup frir LOC. SANS COUP FRIR : [] MOD. sans rencontrer la moindre rsistance, sans difficult
(PR:frir).
108
Voir 2.2.6 infra pour dautres dfinitions pertinentes ce sujet.
109
linstar de la manire de (DEI:instar).
50
la sauvette
111
.
Ces mots ont tous eu une existence autonome, mais dans la langue moderne on ne les utilise
pas hors ces expressions. Dans les textes journalistiques du corpus, aucun de ces mots nest
utilis dans dautres combinaisons que dans celles que nous venons de mentionner :
Sur le front central, les troupes irakiennes, qui avaient ds les premiers jours,
occup sans coup frir le poste frontalier de Qasr--Chirine et la localit de
Mehran, nont pu progresser au-del de ces positions. (MO 25 fvrier 1984)
Et puis, au fur et mesure, il faut slalomer entre les obstacles, contourner les
cbles lectriques enchevtrs, jusqu ce que, au dtour dun virage, on
dcouvre la zone ravage par la catastrophe. (SO880412)
Des milliers de personnes, ds le milieu de la matine, des Willey-Barracks la
banlieue de Stuttgart, staient mises en marche la queue leu leu, suivant des
ballons-phares, orange pour ceux qui gagnaient le Sud, bleu pour ceux qui
remontaient au Nord. (MO 25 octobre 1983)
De nombreuses socits belges ont dores et dj inscrit un ou plusieurs de leurs
reprsentants cette session, mais il reste encore quelques places... (LB860214)
En revanche, le mot ores est employ de faon indpendante dans le corpus diachronique de
textes littraires, surtout dans les textes du XVI
e
sicle ou dans les textes encore plus anciens,
sans que lexpression dores et dj
112
soit atteste une seule fois :
Je fus jadis Hercule, or Pasquin je me nomme,
Pasquin fable du peuple, et qui fait toutefois
Le mme office encor que jai fait autrefois,
Vu quores par mes vers tant de monstres jassome
(CDLITT ; Du Bellay, Les regrets. Sonnet 108. XVI
e
sicle.)
Dans le corpus littraire il y a deux occurrences de frir, dont une figure librement, cest--
dire en dehors de lexpression sans coup frir :
Et, le voulant Panurge davantage interroger, Triboulet tira son pe de bois et
len voulut frir.
(CDLITT ; Rabelais, Le tiers livre. Chapitre XLV-XLVI. XVI
e
sicle.)
Les autres exemples cits ci-dessus ne sont jamais employs librement dans nos corpus.
110
la queue leu leu LOC. ADV. [] LA QUEUE LEU LEU : lun derrire lautre (comme taient censs
marcher les loups) (PR:queue).
111
la sauvette FIG. la sauvette: la hte, avec une prcipitation suspecte (PR:sauvette).
112
Selon le Dictionnaire historique de la langue franaise (1992), cette expression nest atteste quen 1615 et
probablement annonce au cours du XIV
e
sicle par dores a ja.
51
2.2.1 Thme unique
premire vue, les expressions contexte unique semblent former un groupe assez
homogne, facile identifier. Mais, il faut tenir compte du fait quil est en fait possible de
distinguer au moins deux types dexpressions contexte unique. Seulement certains des mots
dont il sagit sont vraiment employs dans un contexte unique, en ce sens que le thme
113
du
mot en question n'existe que dans une expression unique. Considrons les exemples suivants :
les mots queux, fur et (en partie) Saint-Glinglin respectivement dans les constructions matre
queux
114
, au fur et mesure et la Saint-Glinglin
115
ne s'emploient pas ailleurs dans la langue
franaise. Dans ces cas, il ny a pas non plus de formes productives de ces mots en franais
moderne.
2.2.2 Forme unique
Pour certains mots contexte unique, il y a pourtant un lment de productivit. Mme si la
forme en question se combine avec un seul groupe de mots, on reconnat le thme ailleurs.
Ceci est le cas pour jectable qui, dans le PR nest cit quen combinaison avec sige (sige
jectable
116
). videmment, le thme ject- (-ject-) fait partie du verbe jecter et des noms
jecteur et jection
117
. De mme on peut, avec le thme improv- (im-prov-) former entre
autres les mots improvisation et improviser, mais dans nos sources, la forme improviste nest
atteste que dans limproviste
118
. Dautres exemples de formes uniques avec une racine ou
un thme productif sont entre autres jeun ( jeun
119
) et sauvette ( la sauvette).
2.2.3 Liste dexemples contexte unique
Nous avons voulu examiner systmatiquement les mots contexte unique et tablir un corpus
dexemples dexpressions contexte unique en franais moderne. Pour avoir un corpus
pertinent et assez grand, nous avons dabord parcouru le dictionnaire bilingue franais-
sudois, FO. Les mots expliqus uniquement par une citation dune expression ont t
retenus. Il sagit de mots qui, tout seuls, ne semblent pas avoir dquivalent en sudois.
Ensuite les expressions ainsi dcouvertes ont t recherches dans le dictionnaire unilingue le
TLF. Ce procd quelque peu rduit le nombre dexpressions gardes pour la liste.
On pourrait objecter quil y a des exemples dans le TLF dans lesquels les mots cits en
dehors des expressions recherches sont assez vieux (certains datent du XIX
e
sicle) ou
restreints un usage littraire, et quen faisant cette analyse on perd des exemples qui sont, en
113
Thme est ici employ dans le sens de Togeby (1965:92) : Le thme se divise en racine + drivatif [],
plusieurs couches de drivatifs tant possibles . Derrire cette dfinition, se cache une ralit assez complexe,
que nous navons pas la possibilit dexaminer dans ce travail. laide des exemples, les termes thme unique et
forme unique seront faciles comprendre, sans quon ait besoin dentrer dans trop de dtails.
114
Matre queux cuisinier (PR:queux).
115
la Saint-Glinglin jamais (PR:Saint-Glinglin [ la]).
116
Sige jectable qui peut tre ject hors dun appareil volant avec son occupant en cas de perdition; FIG.
situation prcaire (PR:jectable).
117
La forme jectable se retrouve dans dautres combinaisons dans dautres source. titre dexemples les
syntagmes banc jectable, baquet jectable et capsule jectable ont t relevs sur linternet le 29 juin 2004.
Cela confirme donc que les formes uniques sont plus productives que les thmes uniques. Ainsi, un autre
matriel aurait eu pour rsultat une autre liste.
118
limproviste dune manire imprvue, inattendue, au moment o on sy attend le moins (PR:improviste
[ l]).
119
jeun sans avoir rien mang, lestomac vide (PR:jeun []).
52
franais moderne, restreints aux expressions cites. Il est possible quun dictionnaire bilingue,
si restreint soit-il, reflte un usage plus moderne de la langue, mme sil nest pas exhaustif
sur tous les points.
tant donn que le dictionnaire bilingue nest pas trs grand
120
, et prenant en considration
notre mthode de travail, nous ne prtendons pas que la liste tablie soit exhaustive. En
revanche, elle montre la diversit de ces expressions, dont certaines sont assez frquentes, et
dautres moins courantes. Avec un corpus assez important, nous esprons pouvoir veiller un
intrt pour le phnomne en soi. Finalement les mots contexte unique ont t recherchs
dans notre corpus de journaux. Cette dernire partie de lanalyse rvlera si la liste semble
bien fonde pour nos fins.
Ainsi, la mthode de travail pour tablir la liste ci-dessous a t :
1. de retenir les expressions dont un des mots nest pas expliqu dans FO mais uniquement
cit titre dlment constitutif dune expression fige,
2. de vrifier que les mots ainsi retenus tombent sous une des catgories a.-b. ci-dessous dans
le TLF ;
a. le mot est dot dun sens mais son emploi indpendant, en dehors de lexpression fige en
question, est soit tiquet vieux ou vieilli soit rare ;
b. le mot est dot dun sens indpendant, mais le TLF dclare explicitement que lemploi en
dehors dun (ou plusieurs) syntagme(-s) cit(-s) est rare.
Pour les commentaires de la liste, voir infra 2.2.3.1.
Mot contexte
unique
Expression contexte unique Expressions dans le corpus
(nombre doccurrences en totale)
A
-
B
barguigner sans barguigner
121
(1) voir commentaire
C
-
D
-
E
jectable sige jectable (0)
emble demble
122
(88)
F
frir sans coup frir (5)
fortiori a fortiori
123
(15)
120
Il contient approximativement 38 000 mots et syntagmes dans la section franais-sudois.
121
Sans barguigner sans hsiter (PR:barguigner).
122
Demble du premier coup, au premier effet fait pour obtenir le rsultat en question (PR:emble [d]).
123
A fortiori en concluant de la vrit dune proposition la vrit dune autre pour laquelle la raison
invoque sapplique encore mieux (PR:a fortiori). Il y a variation entre deux formes dorthographe : a fortiori et
fortiori.
53
Mot contexte
unique
Expression contexte unique Expressions dans le corpus
(nombre doccurrences en totale)
franquette la bonne franquette
124
(0)
fur au fur et mesure (41)
G
go tout de go
125
(2)
H
hre pauvre hre
126
(1)
huis huis clos
127
(20) voir commentaire
I
improviste limproviste (5)
instar linstar de (48)
insu linsu de
128
(9) voir commentaire
J
jeun jeun (0)
K
-
L
leu la queue leu leu (3)
lige homme lige
129
(2)
lurette belle lurette (17)
M
maille avoir maille partir avec qqn/qqch (4)
martel martel en tte
130
(0)
mgarde par mgarde
131
(3)
mi-chemin mi-chemin
132
(16)
mi-corps mi-corps
133
(0)
mi-cte mi-cte
134
(1)
mi-course mi-course (2) voir commentaire
mi-figue mi-figue, mi-raisin
135
(6)
mi-hauteur mi-hauteur (0)
mi-jambe(s) mi-jambe(s)
136
(0)
mi-voix mi-voix
137
(9)
124
la bonne franquette sans faon, sans crmonie (PR:franquette [ la bonne]).
125
Tout de go directement, sans prambule (PR:go [tout de]).
126
Pauvre hre personne misrable (DEI:hre).
127
Huis clos toutes portes fermes (PR:huis).
128
linsu de sans que la chose soit sue de (qqn) [...], Sans (en) avoir conscience (PR:insu [ linsu de]).
129
Homme lige LOC.MOD. HOMME LIGE de (une personne, une organisation) : personne entirement dvoue
(PR:lige).
130
Martel en tte SE METTRE MARTEL EN TTE : se faire du souci (PR:martel).
131
Par mgarde sans prendre garde, sans faire exprs (PR:mgard).
132
mi-chemin au milieu ou vers le milieu du chemin, du trajet (PR:mi-chemin []).
133
mi-corps au milieu du corps, jusquau niveau de la taille (PR:mi-corps []).
134
mi-cte au milieu, la moiti de la pente dune cte (PR:mi-cte []).
135
Mi-fique, mi-raisin LOC.ADJ. [...] MI-FIGUE, MI-RAISIN : qui prsente une ambigut, par un mlange de
satisfaction et de mcontentement, ou de srieux et de plaisant (PR:figue).
136
mi-jambe au niveau du milieu de la jambe (PR:mi-jambe []).
137
mi-voix dune voix faible, ni haut ni bas (PR:mi-voix []).
54
Mot contexte
unique
Expression contexte unique Expressions dans le corpus
(nombre doccurrences en totale)
N
nec nec plus ultra
138
(1)
nitouche sainte nitouche
139
(0)
non-retour point de non-retour
140
(3)
O
objecteur objecteur de conscience
141
(5)
ores dores et dj (101)
P
patronnesse dame patronnesse
142
(0)
perpte perpte
143
(0)
posteriori posteriori
144
(7)
priori priori
145
(40)
prou peu ou prou
146
(10)
Q
quant quant
147
(862)
148
queux matre queux (0)
R
reculons reculons
149
(4)
redresse la redresse
150
(0)
repris repris de justice
151
(3) voir homonymes
152
revient prix de revient
153
(21) voir homonymes
S
Saint-Glinglin la Saint-Glinglin (0)
sauvette la sauvette (5)
138
Nec plus ultra degr le plus haut (DEI:nec).
139
Sainte nitouche personne qui affecte linnocence (PR:sainte nitouche).
140
Point de non-retour point au del duquel un aronef ne peut plus revenir son lieu de dpart faute de
carburant. FIG. moment o il nest plus possible de revenir en arrire (dans une srie ordonne dactes, de
dcisions) (PR:non-retour).
141
Objecteur de conscience celui qui, en temps de paix ou de guerre, refuse daccomplir ses obligations
militaires, en allguant que ses convictions lui enjoignent le respect absolu de la vie humaine (PR:objecteur).
142
Dame patronnesse qui se consacre des uvres de bienfaisance (souvent iron.) (PR:patronnesse).
143
perpte perptuit, pour toujours (PR:perpte []).
144
Avec les deux formes dorthographe a posteriori et posteriori.
145
priori COUR. au premier abord, avant toute exprience (PR:A priori).
146
Peu ou prou LITTR. plus ou moins (PR:prou [peu ou]).
147
Quant pour ce qui est de, relativement (telle personne, chose ou question sur laquelle se fixe un
moment lattention (PR:quant ).
148
Dans le cas de quant, il y a seulement 8 occurrences sur 870 qui ne se manifestent pas dans la combinaison
quant . Les exemples dviants sont dus des erreurs (linterrogation quand crit avec un t la fin, manque
daccent sur la lettre a) et un nom propre (Mary Quant).
149
reculons en reculant, en allant en arrire (PR:reculons []).
150
la redresse POP. quon ne peut duper ; qui, parmi les malfaiteurs, se fait respecter par la violence
(PR:redresse [ la]).
151
Repris de justice individu qui a t lobjet dune ou de plusieurs condamnations pour infraction la loi
pnale (PR:repris de justice).
152
Pour tous les homonymes, voir infra 2.2.3.2.
153
Prix de revient somme des cots dachats, de production et de distribution du bien ou du service propos
la vente (PR:prix).
55
Mot contexte
unique
Expression contexte unique Expressions dans le corpus
(nombre doccurrences en totale)
Seltz eau de Seltz
154
(0)
somme bte de somme
155
(1) voir homonymes
Stentor voix de Stentor
156
(1)
T
tantinet un tantinet
157
(4)
tapinois en tapinois
158
(0)
ttons ttons
159
(1) voir homonymes
tire-daile tire-daile
160
(1)
tire-larigot tire-larigot
161
(0)
tournemain en un tournemain
162
(2)
trmire rose trmire
163
(0)
tue-tte tue-tte
164
(2)
U
us us et coutumes
165
(3)
V
vau-leau vau-leau
166
(4)
vergogne sans vergogne
167
(5)
vrac en vrac
168
(11) voir commentaire
2.2.3.1 Commentaire de la liste
barguigner
En tout, il y a deux attestations de barguigner, dont une o barguigner nest pas prcd par
sans :
La preuve? Divis sur tant de problmes, le C.E.P. na pas barguign pour
reconduire la formule en vue des prochaines saisons, tout en lamnageant et en
ltendant. (SO880412)
Il est vrai que le corpus prsente peu dexemples de ce mot, mais lexemple donne croire
que barguigner est plutt un mot de polarisation ngative
169
quun mot contexte unique.
154
Eau de Seltz eau gazifie artificiellement au moyen dun appareil spcial (PR:eau).
155
Bte de somme bte de charge qui porte les fardeaux (PR:somme).
156
Voix de Stentor voix forte, retentissante (PR:stentor).
157
Un tantinet LOC.ADV. Un petit peu, lgrement (PR:tantinet).
158
En tapinois en se cachant, la drobe, avec dissimulation (PR:tapinois [en]).
159
ttons en ttonnant [...]. FIG. Au hasard, sans mthode (PR:ttons []).
160
tire-daile avec des coups dailes, des battements rapides et ininterrompus (PR:tire-daile []).
161
tire-larigot beaucoup, en quantit (PR:tire-larigot []).
162
En un tournemain LITTR. en un instant (PR:tournemain [en un]).
163
Rose trmire varit de guimauve trs haute tige, bisannuelle, trs dcorative (PR:trmire).
164
tue-tte dune voix si forte quon casse la tte, quon tourdit (PR:tue-tte []).
165
Us et coutumes MOD. et DIDACT. LOC. [...] Les US ET COUTUMES [...] : les habitudes, les usages
traditionnels (PR:us).
166
vau-leau au fil de leau, du courant. FIG. Aller, sen aller vau-leau : se perdre, se dsorganiser,
pricliter (PR:vau-leau []).
167
Sans vergogne MOD. LOC. SANS VERGOGNE : sans pudeur, sans scrupule (PR:vergogne).
168
En vrac ple-mle, sans tre arrim et sans emballage. [...] En dsordre. [...] Au poids (oppos en
paquet) (PR:vrac [en]).
169
Voir infra 2.2.6.4.
56
huis
Huis est employ tout seul dans une occurrence. Le contexte est particulier ; on est chez les
schtroumpfs :
Stant introduits, non par lhuis mais par la croise, dans la demeure du Pre
Temps pour y qurir un nouveau sablier pour le Grand Schtroumpf, les trois
Schtroumpfs se retrouvrent enferms dans une horloge dont les aiguilles
tournaient lenvers. (SO880413)
Cet exemple nest pas compt parmi le nombre doccurrences dans notre liste.
insu
Le mot contexte unique insu se trouve dans une expression, linsu de (qnn), qui varie
facilement, puisquelle se combine avec les adjectifs possessifs. Les formes suivantes sont
reprsentes dans notre corpus : leur insu, mon insu, son insu. En tout (avec les variantes
cites), il y a 9 attestations.
mi-course
Sur quatre occurrences en tout de mi-course, une seule est directement prcde par . Les
autres reprsentations sont prcdes de larticle dfini, dont deux dune autre prposition :
la mi-course (ME 85 10:1), de la mi-course (SO880405) et vers la mi-course (SO880405).
Dans la liste nous avons inclus les deux occurrences qui contiennent la prposition .
vrac
En vrac est attest en tout 11 fois, mais il y a aussi deux exemples o vrac est prcd par
larticle dfini.
Si lon admet que la production espagnole naugmentera pas considrablement et
que les circuits commerciaux, pour le vrac blanc surtout sont dj tablis, la
concurrence sexercera sur des appellations aux contours mal dfinis [...]. (ME
85 7:1)
Ladhsion donnera aux productions viticoles espagnoles un accs plus large
ces marchs, dabord pour le vrac (avec peut-tre le danger dune rsurgence de
la pratique des coupages en Europe), puis pour les vins dappellation en
bouteilles. (ME 85 7:1)
Ces exemples fournissent deux fois le syntagme pour le vrac. Les exemples du corpus
suggrent que vrac serait plutt un mot contextes limits. Cependant, ce sont les
dictionnaires qui sont dcisifs dans la mthode employe pour tablir la liste, et vrac est ainsi
gard dans la liste de mots contexte unique.
2.2.3.2 Homonymes
Parmi les mots qui tombent sous le critre de contexte unique, il faut tenir compte des
homonymes. Un exemple en est maille, dans avoir maille partir avec quelquun. Le fait que
57
maille, avec le sens de boucle ou anneau, soit attest en dehors du contexte cit nest pas
pertinent, puisquil sagit de deux lexmes avec des origines diffrentes, et que les deux
formes soient identiques est une concidence. Un exemple de la forme qui nous intresse
170
est :
Le gouvernement a aussi maille partir avec ses allis des syndicats, qui lui
reprochent de ne pas tre suffisamment dynamique dans la lutte contre le
chmage et de freiner les crdits au commerce. (ME 84 24:1)
Un autre exemple dun mot contexte unique avec des homonymes est somme
171
, dans
lexpression bte de somme :
Cest un village du peuple ancien quil convient donc de purifier de ses
souillures imprialistes , capitalistes , coloniales et fodales . Cest
un peuple infrieur, nous tions tout juste des btes de somme, nous dit notre
interlocuteur. (MO 7 septembre 1977)
Le phnomne dhomonymie rend parfois difficile la vrification du nombre doccurrences
dans le corpus. Le mot repris, qui fait partie de lexpression repris de justice, est galement le
participe pass au masculin du verbe reprendre
172
. Nous avons calcul le nombre
doccurrences de toute la combinaison. En ce qui concerne le reste des occurrences de repris,
nous ne sommes pas entirement sre quelles soient toutes des participes.
La mme chose vaut pour revient (232 occurrences), qui, videmment, en dehors de prix
de revient, est une forme courante du verbe revenir (prsent de lindicatif de la 3
e
personne au
singulier).
Ttons dans ttons est galement homonyme de la 2
e
personne au pluriel (le prsent de
lindicatif ou limpratif) du verbe tter, mais cela ne pose pas de grands problmes, vu que
cette forme nest pas trs frquente.
2.2.4 Contextes limits
Dautres mots que les mots contexte unique ont un usage restreint, mais ils se retrouvent
dans plus dune expression ou mme en dehors de ces expressions, ce qui reste pourtant trs
rare. Toutefois, ils font preuve dune syntaxe et une smantique qui ne sont pas du tout libres
et napparaissent le plus souvent que dans un nombre limit dexpressions. Voil pourquoi il
faut aussi mentionner des mots comme escient et gr. Ces mots semploient dans un nombre
limit dexpressions, telles que bon escient
173
, mauvais escient, au gr de et son gr.
170
En tout, il y en a quatre dans notre corpus.
171
Il y a trois homonymes somme, chacune avec son origine : somme
1
(quantit), dorigine latine summa,
somme
2
(bte de somme), du latin sagma et somme
3
, (action de dormir), du latin somnus.
172
La forme repris tant trs frquente dans le corpus (246 occurrences), il est difficile de constater si, part la
fonction de participe, elle est uniquement employe dans repris de justice. Pour ce faire, il aurait fallu parcourir
tous les exemples, ce que nous avons choisi de ne pas faire, tant donn que cela nest pas le problme central de
notre tude. Nanmoins, nous signalons cette difficult laquelle il faut penser si lon veut obtenir des chiffres
exacts.
173
bon escient MOD. LOC. BON ESCIENT [...] : avec discernement, raison (PR:escient).
58
Ainsi, escient est attest dix fois dans le corpus, dont huit dans bon escient
174
. Gr peut
servir dexemple dun mot employ plus librement, mais la plupart des occurrences se
retrouvent dans les cinq expressions les plus courantes : au gr de, son gr, en savoir gr
qqn de qqch, bon gr mal gr et contre son gr
175
. Dautres exemples de mots contextes
limits sont metteur et guise :
Mot contextes limits Nombre d'occurrences
dans le corpus
Nombre d'occurrences dans les
expressions les plus courantes
metteur 61 59 (metteur en scne)
gr 71 49 (au gr de, son gr, en savoir
gr qqn de qqch, bon gr mal gr,
contre son gr)
guise 46 34 (en guise de)
Tableau 3. Exemples de quelques mots contextes limits.
On voit donc que gr apparat dans plus dune expression. En voil la rpartition des nombres
doccurrence de chaque expression :
Expression Nombre doccurrences dans le corpus
au gr de
son gr
en savoir gr qqn de qqch
bon gr mal gr
contre son gr
18
11
8
8
4
Tableau 4. Les expressions contextes limits contenant le mot gr.
2.2.5 Liste dexemples contextes limits
Nous avons galement entrepris une recherche systmatique des mots contextes limits. Nos
sources pour cette recherche ainsi que la mthode employe sont les mmes que celles de la
section prcdente
176
. La diffrence consiste en lemploi des mots cits par les dictionnaires.
Dans la liste de mots contextes limits seront inclus :
1. les mots cits par les dictionnaires dans une ou plusieurs expressions et qui ont aussi un
sens indpendant, mais qui ne sont que rarement employs en dehors des expressions cites,
selon les dictionnaires ou dans les exemples du corpus. Par exemple :
Nique a le sens dent denfant (TLF). Ce sens nest ni attest dans le corpus ni
enregistr dans les dictionnaires le PR ou FO. En revanche la suite faire la nique (
qqn/ qqch)
177
est cite dans tous les trois dictionnaires consults et atteste cinq fois
dans le corpus.
174
Les deux autres occurrences sont aussi en relation avec la dichotomie bon - mauvais : meilleur escient et
mauvais escient.
175
Pour les autres contextes dans lesquels gr est employ, voir la liste complte infra 2.2.5.
176
FO, le TLF et le corpus de journaux.
177
Faire la nique qqn lui faire un signe de mpris, de bravade (PR:nique).
59
2. les mots que le TLF dclare clairement comme faisant partie dexpressions, constructions,
locutions ou syntagmes. Par exemple :
Pour acabit, le TLF signale quen dehors des constructions figes, la vitalit de ce mot
est trs faible.
Selon le TLF, be ne semploie que dans les expressions bouche be et gueule be.
La liste comprend tous les exemples de mots contextes limits relevs dans les dictionnaires
ainsi que le nombre doccurrences des expressions dans lesquels ils figurent dans le corpus.
Pour les commentaires de la liste, voir infra 2.2.5.1.
Mot contextes
limits
Expressions contextes limits
(selon le TLF)
Expressions dans le corpus
(nombre doccurrences en totale)
A
acabit
178
de (dun) bon acabit
dun meilleur (pire) acabit
de POSS
179
acabit
de cet acabit
de (du) mme acabit
dun autre acabit
de tous (les) acabits ; de tout acabit de tout acabit (1)
aloi de bon aloi, de mauvais aloi
180
dexcellent aloi
de bon aloi (4) voir commentaire
B
be bouche be
181
gueule be
bouche be (2)
berlue avoir la berlue
182
se faire des berlues
ne pas se faire de berlue
C
clopinettes des clopinettes
183
cropinettes les cropinettes
D
damer
184
damer un pion
damer le pion qqn damer le pion qqn (1)
178
Acabit 1. VX manire dtre (dans des loc. : de quel acabit ; de bon acabit) 2. LOC. MOD. (souvent pj.) de cet
acabit ; de, du mme acabit : de cette, de mme nature (PR:acabit).
179
Pour simplifier la prsentation, labrviation POSS sera employ partout o les adjectifs possessifs peuvent
tre utiliss.
180
De bon, de mauvaise aloi de bonne, de mauvaise qualit, qui mrite, ne mrite pas lestime (PR:aloi).
181
Bouche be la bouche ouverte dadmiration, dtonnement, de stupeur (PR:be).
182
Avoir la berlue avoir des visions. [...]FIG. Se faire des illusions (PR:berlue).
183
Clopinettes des clopinettes fam. Rien. Des clopinettes! pop. Non ! (DEI:clopinettes).
184
Damer (DAMES, CHECS) transformer (un pion) en dame [...] LOC. FIG. damer le pion qqn, lemporter sur
lui, le surpasser, rpondre victorieusement ses attaques (PR:damer).
60
Mot contextes
limits
Expressions contextes limits
(selon le TLF)
Expressions dans le corpus
(nombre doccurrences en totale)
E
entrefaites sur ces entrefaites
185
sur les entrefaites
sur cette entrefaite
dans ces entrefaites
sur ces entrefaites (3)
escient POSS escient
bon escient bon escient (8)
meilleur escient (1)
mauvais escient (1)
F
fam, -e bien/mieux fam
mal fam
186
mal fam (1)
for for extrieur
for ecclsiastique
for intrieur for intrieur (3)
G
gamm, -e croix gamme
187
croix gamme (4)
gr
188
POSS gr
au gr de
de bon gr
de POSS (plein) gr
contre POSS gr
de POSS propre gr
bon gr mal gr
de gr ou de force
savoir (bon) gr
un gr infini qqn
POSS gr (8)
au gr de (23)
de bon gr (2)
de POSS plein gr (4)
contre POSS gr (4)
de POSS propre gr (4)
bon gr mal gr (9)
de gr ou de force (2)
savoir gr /de (7)
guise
189
POSS guise
en guise de
POSS guise (5)
en guise de (41)
I
instigation linstigation de qqn
190
linstigation de (3)
intenter
191
intenter une accusation
intenter une action (en justice)
intenter un procs (/contre qqn)
intenter une demande
intenter une action (2)
intenter un procs (10)
185
Sur ces entrefaites ce moment (PR:entrefaite).
186
Mal fame se dit dun lieu qui a mauvaise rputation, est frquent par des gens du milieu, des malfaiteurs
(PR:fam).
187
Croix gamme dont les branches sont coudes en forme de gamma majuscule (PR:gamme).
188
Gr DE GR OU DE FORCE : que cela plaise ou non [...]. LOC.ADV. BON GR MAL GR : en se rsignant,
malgr soi, que cela plaise ou non. (PR:gr)
189
Guise MOD. MA, TA, SA... GUISE : selon le got, la volont propr [...]. EN GUISE DE : en manire de,
comme (PR:guise).
190
Instigation COUR. LINSTIGATION DE. agir linstigation de qqn, sur ses conseils ou en subissant son
influence (PR:instigation).
191
Intenter DR. entreprendre contre qqn (une action en justice).
61
Mot contextes
limits
Expressions contextes limits
(selon le TLF)
Expressions dans le corpus
(nombre doccurrences en totale)
J
javel eau de javel
192
(eau javelise 1)
jouvence fontaine de Jouvence
193
eau, lixir de jouvence
huile de jouvence
bain, cure de jouvence
L
(belle) lurette
194
il y a belle lurette (que)
voici belle lurette (que)
depuis belle lurette
il y a belle lurette (7)
voici dj belle lurette (2)
depuis belle lurette (8)
M
main-forte prter main-forte
195
prter main-forte (6)
metteur, -euse metteur en SUBST. ;
metteur en ondes, en uvre,
en scne, en carte(s), en main
metteur au point (de + SUBST.)
metteur en scne (42)
metteur en scne-chorographe (1)
metteur en scne-scnographe (1)
N
nique faire la nique ( qqn/ qqch) faire la nique (5)
noise chercher (des) noise(s) qqn
chercheur de noise
O
ouvrable jour ouvrable
196
jour ouvrable (8)
P
pendable
197
cas pendable
tour pendable
cas pendable (1)
tour pendable (1)
Q
qui(-)vive sur le qui-vive
198
se tenir/vivre sur le qui-vive
sur le qui-vive (3)
R
raccroc
199
de raccroc
par raccroc
de raccroc (1)
rancart
200
jeter au rancart
mettre au rancart
voir commentaire
mettre au rancart (1)
192
Eau de javel mlange en solution aqueuse dhypochlorite et de chlorure de sodium ou de potassium, utilis
comme dtersif, dcolorant et antiseptique (PR:javel [eau de]). Le mot javel ne figure pas dans le corpus, mais
la forme javelise en combinaison avec eau est atteste une fois.
193
Fontaine de jouvence fontaine fabuleuse dont les eaux avaient la proprit de rajeunir. FIG. Source de
jeunesse, de rajeunissement. Eau, bain de jouvence (PR:jouvence).
194
Belle lurette LOC. FAM. IL Y A BELLE LURETTE : il y a bien longtemps (PR:lurette).
195
Prter main-forte aider (DEI:main-forte).
196
Ouvrable se dit des jours de la semaine qui ne sont pas des jours fris (PR:ouvrable).
197
Pendable MOD.LOC. jouer un tour pendable qqn, un mchant tour (PR:pendable).
198
Sur le qui-vive sur ses gardes et comme dans lattente dune attaque (PR:qui-vive).
199
Raccroc LOC. [...] PAR RACCROC : sans plan et par le fait dun heureux hasard. [...] DE RACCROC : qui ne
dpend que du hasard (PR:raccroc).
200
Rancart LOC.FAM. mettre au rancart : jeter, se dbarasser, se dfaire (dune chose inutile ou use)
(PR:rancart).
62
Mot contextes
limits
Expressions contextes limits
(selon le TLF)
Expressions dans le corpus
(nombre doccurrences en totale)
rase-mottes
201
en rase-mottes
faire du/un rase-mottes
en rase-mottes (1)
faire du rase-mottes (1)
rebours
202
rebours (de)
au rebours de
rebours (7)
rcin vin rsin
203
rtorsion mesure, -s de rtorsion
204
acte, -s de rtorsion
mesures de rtorsion (9)
rogatoire
205
formule rogatoire
commission rogatoire commission rogatoire (3)
S
seing (acte sous) seing priv
206
acte sous seing priv (1)
T
talion
207
loi du talion
V
va-tout jouer POSS va-tout
208
risquer POSS va-tout
jouer POSS va-tout (5)
risquer POSS va-tout (1)
2.2.5.1 Commentaire de la liste
aloi
Il y a un exemple o aloi est employ en dehors des expressions cites :
De toute vidence, lmission de Bernard Bouthier lemporte de loin, la fois par
le fini du produit et par laloi de linspiration, sur le confrre belge. (LB861002)
rancart
Dans le corpus il y a une construction elliptique o le verbe peut tre interprt comme sous-
entendu :
Pour entendre parler srieusement Athnes des affaires de ltat, il fallait
passer le seuil, gnralement surveill, de techniciens ou de politiciens au
rancart . (MO 25 juillet 1974)
Nous avons indiqu que les mots contexte unique sont en fait de deux types : certains sont
des thmes uniques, dautres ne sont uniques que par la forme. Cela est vrai aussi pour les
mots contextes limits. Les relations quont les mots contexte unique et contextes limits
avec les thmes et formes uniques sont illustres par le tableau 5 :
201
Rase-mottes vol en rase-mottes, trs prs du sol, faire du rase-mottes, un rase mottes, un tel vol (PR:rase-
mottes).
202
Rebours LOC.PRP. [...] REBOURS DE ; AU REBOURS DE : contrairement (PR:rebours).
203
Vin rsin contenant de la rsine de pin (PR:rsin).
204
Mesure(s) de rtorsion rponse analogue un mauvais procd ; vengeance (PR:rtorsion).
205
Rogatoire DR. relatif une demande. Formule rogatoire. SPCIALT. Commission rogatoire
(PR:rogatoire).
206
Seing priv signature dun acte non reu par un notaire (PR:seing).
207
Talion ANC. DR. chtiment qui consiste infliger au coupable le traitement mme quil a fait subir sa
victime. La loi du talion : linstitution de telles peines (PR:talion).
208
Jouer son va-tout risquer le tout pour le tout, prendre les derniers moyens (PR:va-tout).
63
Mot contexte unique Mot contextes limits
Thme unique berlue
noise
aloi
escient
Forme unique jectable
sauvette
encombre
ouvrable
Tableau 5. Relations entre mots contexte unique et contextes limits, thmes et formes uniques.
Les mots contextes limits qui sont des thmes uniques ne sont employs que dans les
expressions cites. Les mots contextes limits qui sont des formes uniques en revanche, font
partie dautres mots. Les morphmes encombre- et ouvr- des exemples encombre (sans
encombre) et ouvrable (jour ouvrable) du tableau 5 font partie dautres mots, tels que
encombrer et ouvrir.
2.2.6 Dautres termes avec une dfinition similaire
Il existe dautres termes pour dcrire le phnomne de mots (ou de parties de mots) qui
napparaissent pas librement en dehors de certains groupes de mots (ou lexmes).
2.2.6.1 Collocations restrictives
Les expressions contexte unique et celles contextes limits font penser aux collocations
restrictives dont nous avons parl brivement dans le Chapitre 1
209
. Les mots dans une
collocation restrictive ne sont pas sujets aux commutations habituellement ralisables dans
des combinaisons de deux mots ou plus. ce propos, Riegel et al. disent :
[] ladverbe grivement ne modifie naturellement que le participe bless ;
ladjectif accorte nest effectivement utilis quau fminin pour caractriser
quelques substantifs comme servante, serveuse, soubrette, etc. Ces affinits
slectives (parfois appeles collocations) sexpliquent par le sens trs spcifique
dvolu ces termes par lusage standard (grivement bless soppose gravement
malade) ou par leur appartenance un registre de langue bien dtermin
(ladjectif accorte est tiquet vieux et littraire par les dictionnaires). (Riegel et
al. 1994:123)
Ces linguistes (1994:359) numrent galement des adjectifs qui forment souvent des noms
composs avec un nombre limit de noms : (nez) aquilin, (pied) bot, fat, dispos, (feu)
grgeois, (marais) salant, (hareng) saur, (bouche) be, (porte) cochre, (ignorance) crasse,
(pierre) philosophale, (uvre) pie, (jument) poulinire, (fivre) scarlatine, (rose) trmire.
Nous constatons que les mots cits par Riegel et al. sont rares dans notre corpus de
journaux. On retrouve pourtant quelques-uns de ces noms composs
210
. Deux occurrences de
be (bouche be) sont attestes dans La libre Belgique. En voici une :
LAllemand Sloothaak reste bouche be : il a remport, tard jeudi soir, la
deuxime preuve internationale. (LB871128)
209
1.2.2.3 supra. Voir aussi Bcklund (1970 et 1981) sur restrictive collocations et frozen collocations .
210
Dans le corpus de textes littraires, il y a des attestations des noms composs nez aquilin, pied bot, uvre pie
et jument poulinire.
64
On retrouve une occurrence de pierre philosophale dans Le Soir :
Certes, Leiris nattend plus de la posie quelle soit une pierre philosophale ,
un facteur de transmutation radicale du monde. (SO880414)
En ce qui concerne la combinaison pied dispos, il ny a aucun exemple attest dans le corpus
journalistique, ni dans les textes littraires
211
. Dans les dictionnaires la seule construction cite
qui contient le mot dispos est frais et dispos
212
. On pourrait mettre en question lutilit
dinclure dans une grammaire franaise moderne une combinaison qui soit tellement peu
courante.
Cette question se pose galement pour le nom fat, autre mot rare dans nos sources. La
collocation cite par Riegel et al. est pied fat. Dans les dictionnaires, fat nest jamais cit dans
une expression particulire. La mme chose vaut pour le corpus de journaux, o il nest attest
quune fois
213
:
Monsieur Maze, je ne suis pas, comme vous, un grand fat, ni un grand beau.
(SO880413).
Commentons brivement les deux autres exemples de lusage standard, mentionns par Riegel
et al. Le rapport entre ladverbe grivement et le participe bless se rvle plus clairement
dans le corpus. Dans 36 sur 40 attestations de grivement, ladverbe se combine avec une
forme du verbe blesser. Nous constatons que dans les quatre autre exemples, grivement se
trouve ct des formes des verbes brler et atteindre, qui peuvent aussi tre classs comme
dsignant des blessures.
La relation collocationelle entre gravement et malade nest pas aussi saillante. Les 94
exemples du mot gravement, ne se combinent avec malade que dans 6 cas. Or, 37 des
adjectifs peuvent tre classs comme des hyponymes de malade, tels que bless, handicap,
touch, affaibli et tourment :
Les dgts ne sont pas importants, mais trois personnes ont t gravement
intoxiques par de loxyde de carbone. (LB871127)
la diffrence de grivement, gravement renforce souvent des verbes
214
. Dans 11 de nos 94
exemples, ces verbes sont aussi associs aux maladies ou aux blessures, comme dans
lexemple suivant :
211
Le fait est que le mot dispos ne figure que dans les textes littraires, o il est employ librement, sans se
combiner avec un mot particulier.
212
Lors dune recherche sur www.google.fr le 17 juin 2003 il savre quil y a cinq occurrences de pied dispos
(dont 3 se rfrent au mme exemple) et quelles se retrouvent toutes dans des chansons ou des pomes du 16
e
et
du 17
e
sicle.
213
Le mot fat ne se combine avec pied ni dans nos sources (dictionnaires et corpus), ni sur linternet (Google).
214
Cest seulement dans deux exemples que grivement se combine avec un verbe au prsent (blessent) et un
grondif (blessant) respectivement. Dans tous les autres cas, ladverbe se combine avec un participe pass, donc
employ comme adjectif.
65
Enclave, sous-quipe, sa partie nord frquemment frappe par la scheresse,
elle souffre gravement, aussi de la dsorganisation de la corruption de son
administration. (ME83 11:1)
Mais gravement se combine aussi avec des mots non associs la maladie. En voici deux
exemples :
Naturellement la perte de comptitivit europenne ne peut que les aider
redresser une balance commerciale gravement dficitaire. (LB860214)
Ils ont gravement sous-estim la force et la popularit du rgime de Castro
(MO 22 avril 1961)
Il nous semble que les exemples cits ainsi que dautres exemples de collocations restrictives
sont pertinents lorsquon parle dexpressions contexte unique ou contextes limits.
Toutefois, il est intressant de noter que plusieurs des exemples fournis par une grammaire
moderne sont rares et parfois mme contestables.
2.2.6.2 Hapax legomena
Le terme hapax legomena est employ par van der Wouden :
On the scale of restricted distribution, one of the endpoints will be occupied by
so-called hapax legomena [] or cran morphs, lexical items that occur in one
collocation or idiom word only, such as cran (as in cranberry, which is the source
of the term), spick (as in spick and span), etc. (van der Wouden 1997:46)
On voit quil cite le terme cran morphs , terme sans doute plus connu pour dsigner ce
phnomne que celui de hapax legomena. Lemploi de van der Wouden du terme hapax
legomena nest pas le plus courant. Le plus souvent, un hapax ou un hapax legomena
est un mot (ou une forme) dont on peut relever une seule occurrence dans un corpus dfini.
Cest la dfinition trs spcifique de van der Wouden qui rend le terme pertinent dans cette
section.
2.2.6.3 Cranberry collocations
Nombreux sont les chercheurs qui commentent le terme cranberry collocations dans des
ouvrages de linguistique anglais. Citons titre dexemple Moon :
While most lexemes in the general lexicon never occur in FEIs [fixed expressions
or idioms], a few never occur outside FEIs. Many of these are rare fossil words, or
have been borrowed from other languages or varieties, and they include :
amok run amok
cahoots in cahoots with someone
dint by dint of something
dudgeon in high dudgeon
fettle in fine/good fettle
fro to and fro (Moon 1998:78)
66
Nous notons quil ne semble pas y avoir de terme franais bien tabli pour ce genre de mots.
2.2.6.4 Polarisation
Un autre phnomne qui se manifeste dans la langue, et dont la ressemblance au critre de
contextes limits est frappante est la polarisation, positive ou ngative. Certains chercheurs se
concentrent sur la polarisation ngative
215
. Celle-l se dtermine par des mots ou expressions
qui semploient uniquement dans des contextes ngatifs, comme grand-chose, lever le petit
doigt
216
, y aller de main morte
217
et ne pas souffler mot. En voil des exemples du corpus :
Au dbut des annes 60, il ne restait apparemment rien, ou plus grand-chose, de
la grande esprance. (MO 21 octobre 1976)
Il ne lve mme pas le petit doigt pour dfendre linstitution parlementaire quand
elle est traite plus mal que ne le prvoie la Constitution. (MO 6 avril 1974)
Le docteur Hasan Zaza, professeur de langue arabe et hbraque lUniversit
arabe de Beyrouth, traitant du Rle des associations secrtes dans lopinion
publique mondiale , ny tait pas all de main morte : (LB860929)
cause du dcalage horaire, on ignorait toujours, jeudi midi, lattitude
officielle des tats-Unis. Leur missaire Genve, Robert Peck, na pas souffl
mot en arrivant et en quittant le Palais des Nations. (SO880407)
Il est improbable de retrouver ces phrases laffirmatif :
*Au dbut des annes 60, il restait apparemment grand-chose, de la grande
esprance.
* Il lve mme le petit doigt pour dfendre linstitution parlementaire...
* Le docteur Hasan Zaza y tait all de main morte
* Robert Peck a souffl mot en arrivant...
La ralit est plus complexe que ne le laisse croire ces quelques exemples. On peut, linstar
de Fauconnier, voir la polarisation syntaxique, o les lments apparaissent en prsence dune
ngation, comme un cas spcial dun phnomne plus gnral, la polarisation smantique. Il y
a dans ce cas des syntagmes polariss par rapport au contexte, sans quil y ait formellement de
ngation prsente dans la phrase. Un exemple, fourni par Fauconnier (1980:83) en est les
superlatifs quantifiants , comme dans Il nadmet pas la critique la plus insignifiante,
phrase dans laquelle le syntagme nominal la critique la plus insignifiante prend le sens
aucune critique . Or, dans un autre exemple, la plus insignifiante fonctionne avec son
sens propre, comme prdicat de la critique : Je nai pas tenu compte de la critique la plus
insignifiante (Fauconnier 1980:84). Cet exemple nous loigne du critre de contexte unique et
215
Voir par exemple Gaatone 1971 sur les satellites de la ngation , Muller 1991 sur la polarit ngative et
Achard et Fiala (1997).
216
Lever le petit doigt - ne pas lever, ne pas remuer le petit doigt : ne pas faire le moindre effort (PR:doigt).
217
Y aller de main morte LOC. ne pas y aller de main morte : frapper rudement ; attaquer avec violence
(PR:main).
67
une analyse de ce genre de polarisation serait plus approprie dans les parties qui traitent de la
non-compositionnalit ou du blocage lexical. Toutefois, il est maintenant clair quil y a deux
sortes de polarisation ngative :
1) il y a des lments qui ne semploient pas sans quil y ait formellement une
ngation dans le contexte
2) il y a des lments qui semploient dans des contextes ngatifs aussi bien que
dans des contextes affirmatifs, la diffrence rsidant dans linterprtation.
Ce qui est le plus clairement lie au critre de contextes limits est videmment le premier
type. Revenons donc aux exemples cits plus haut.
Grand-chose est un bon exemple dun mot polaris ngativement, mais lexemple suivant
est meilleur pour nos fins, puisquil contient plus de deux mots. Il sagit de lever le petit doigt,
ou plutt VB le petit doigt, en croire les attestations dans le corpus, qui comprennent aussi
les verbes bouger et mettre
218
. Tous ces mots pris un un semploient videmment dans
nimporte quel contexte, affirmatif aussi bien que ngatif. Mais la combinaison VB le petit
doigt est un exemple que les linguistes classent souvent comme polaris ngativement
219
,
comme dans les exemples suivants :
En second lieu, malgr leurs dclarations charitables, les tats arabes nont pas
boug le petit doigt pour permettre aux rfugis de stablir chez eux. (MO 21
avril 1951)
Sbastien est heureux. Affectivement et matriellement. Et ce, sans avoir ou
presque bouger le petit doigt. (SO880411)
Dans ces exemples on remarque la prsence de mots ngatifs ; dans le premier il y a une
ngation et dans le deuxime il y a sans, avec un sens ngatif inhrent. Or, des six attestations
de lexpression dans notre corpus, deux se trouvent dans des contextes sans ngation :
Depuis la nuit passe, cependant, qui avait vu lmeute montrer le poing Alger,
lorsque larme avait rejoint les civils insurgs, et lever le petit doigt sur les
Champs-lyses lheure mme o lAssemble nationale accordait linvestiture
au seizime prsident du conseil du rgime [...] (MO 11 novembre 1970)
Il enregistre des ractions contre lui ds quil bouge le petit doigt. (SO880415)
On voit la difficult quil peut y avoir classer catgoriquement des expressions comme
polarises ngativement ou pas. Lemploi dans des phrases affirmatives dans les exemples
cits, est-il marqu ou ironique, ou est-il encore considrer comme une espce de polarit
smantique ? Il y a, il nous semble, des ressemblances entre le dernier exemple que nous
avons cit et les superlatifs quantifiants de Fauconnier : Il nadmet pas la critique la plus
insignifiante.
218
Il y a aussi le verbe remuer, propos par PR.
219
Voir par exemple Fauconnier 1980:195.
68
Il y a galement des expressions polarises positivement, et qui se trouvent donc dans des
contextes affirmatifs
220
. Cela peut tre exemplifi avec les expressions suivantes, fournies par
Misri (1987b:140) :
Cest la fin des haricots
221
*Ce nest pas la fin des haricots
On aurait entendu une mouche voler
222
*On naurait pas entendu une mouche voler
Les bras men tombent
223
*Les bras ne men tombent pas
Les mots ou expressions qui figurent dans des contextes ngatifs ou positifs ne concernent pas
les mots ou expressions contextes limits, mais sont pertinents pour ltude de la
polarisation. Nous les laissons de ct dans notre tude.
2.2.7 Rsum
Nous avons stipul quun type particulier dexpressions figes sidentifie par la particularit
quun des mots dont est constitue lexpression en question nest employ nulle part ailleurs.
Ainsi, on identifie facilement les expressions au fur et mesure, belle lurette et dores et dj
comme des expressions figes, puisque les mots fur, lurette ou ores ne sont retrouvables que
dans ces expressions. Nous avons appel ce genre de mots des mots contexte unique.
Le prsence dun mot contexte unique dans un syntagme est un critre suffisant pour
dire que ce syntagme est une expression fige
224
.
Il sest avr que les mots contexte unique sont en fait de deux types. Suivant la
dfinition de Togeby (1965:92), nous appelons ceux dont la racine, avec drivatifs ventuels,
nest pas productive, des thmes uniques. Des exemples en sont queux et fur qui ne sont ni
productifs ni attests dans aucune autre forme. Ils se retrouvent uniquement dans matre
queux et au fur et mesure. En revanche, les expressions sige jectable et limproviste
contiennent des lments productifs : on retrouve ject- dans jecter, jecteur et jection, en
dehors du syntagme cit. La forme jectable, par contre, nest employe dans nos sources
quen combinaison avec sige. Nous appelons ces mots contexte unique des formes uniques.
Lorsquil sagit didentifier les expressions figes laide dun mot non productif, il est
intressant de noter quil y a aussi des mots qui semploient dans plus dune expression mais
qui ont quand mme un usage restreint. Ainsi, nous avons appel les mots tels que escient ou
gr des mots contextes limits. Ces mots se retrouvent dans les expressions bon escient et
au gr de, mais aussi dans mauvais escient et dans son gr par exemple. Notre analyse
montre que mme si le mot gr peut semployer indpendamment, le plus souvent, il fait
partie dune expression fige.
220
Le terme de discourse prosody (Stubbs 2001:65-66), employ pour certains mots qui se combinent soit
avec des mots pjorativement connots, soit avec des mots mliorativement connots, est galement pertinent
dans ce contexte.
221
Cest la fin des haricots, la fin de tout (PR:haricot).
222
On aurait entendu une mouche voler LOC. on aurait entendu une mouche voler : le plus profond silence
rgnait (PR:mouche).
223
Les bras men tombent : Je suis stupfait (PR:bras).
224
Voir 3.2 infra.
69
laide des dictionnaires et du corpus informatis, nous avons pu tablir un corpus
dexemples dexpressions contexte unique et contextes limits, employes en franais
moderne.
Finalement, les termes collocations restrictives , hapax legomena , cranberry
collocations et polarisation , qui ont des dfinitions pertinentes pour les expressions
contexte unique, ont t comments brivement.
70
2.3 Non-compositionnalit
225
De nombreux chercheurs mentionnent le critre de non-compositionnalit comme contribuant
au figement ou comme typique dun idiome, dune locution ou dautres catgories
dexpressions figes
226
. Michiels (1977:184), se formule comme suit : Most of the
definitions of idiom to be found in the literature hinge on the semantic notion of
compositionality .
Il nous semble que ce critre mrite une analyse approfondie. Nous tudions les difficults
lies aux diffrentes interprtations de ce critre et proposons de trancher plus distinctement
entre certains termes et de dcrire ainsi plus clairement le phnomne de compositionnalit.
Dans ce chapitre nous montreront que les quatre dichotomies suivantes jouent toutes leur
rle dans la description des diffrents aspects de la non-compositionnalit.
motivation non-motivation
sens propre sens figur
transparence opacit
analysabilit inanalysabilit
Les notions utiles pour la prsentation seront expliques au fur et mesure de leur ncessit
pour lanalyse.
Nous commencerons par une brve prsentation du critre de non-compositionnalit, dans
laquelle les notions de non-compositionnalit partielle et totale seront introduites. La
premire dichotomie tre analyse sera la motivation et sa contrepartie. Nous explorerons
ensuite la dichotomie sens propre sens figur. Avant de continuer la description des
dichotomies, on notera le besoin de distinguer entre le contenu lexical et la forme
grammaticale. Aprs un examen de lopacit et de la transparence, nous traiterons la
dichotomie analysabilit inanalysabilit. Finalement, les termes datomiste et dholiste
seront prsents.
2.3.1 La non-compositionnalit et ses caractristiques
La notion de non-compositionnalit est souvent prsente dans les dfinitions de diffrents
types dexpressions figes, telles que les locutions ou les idiomes. Ce qui nous intresse
particulirement dans les citations suivantes est lemploi du terme (non-) compositionnalit :
1. Une construction donne est dite compositionnelle quand on peut dduire son
sens de celui de ses lments composants relis par une relation syntaxique
spcifique. (G. Gross 1996:154)
2. une locution prototypique est caractrise [...] par sa non-compositionnalit.
On a beau comprendre tous les mots qui entrent dans tirer le diable par la queue,
cela ne suffit pas pour comprendre ce que cette locution veut dire. (Martin
1997:293)
225
Dans ce chapitre nous avons labor les ides voques dans Svensson (1998).
226
Voir par exemple Bally (1963:74), Gross (1988:58,60) et Gosselin (1996:161) qui discutent le phnomne de
compositionnalit, quoique pas toujours sous le terme de compositionnalit. Cf. aussi Katz (1973), Newmeyer
(1974) et Fontenelle (1994).
71
3. [...] compositionality that is, the degree to which the phrasal meaning, once
known, can be analyzed in terms of the contribution of the idiom parts. (Nunberg
et al. 1994:498)
Il y a des diffrences subtiles entre ces dfinitions et elles sont assez difficiles interprter.
Dans certains cas, on se concentre sur la comprhension de lexpression, comme dans la
premire et dans la deuxime citation. La comprhension est souvent discute en terme de
transparence. Dans la troisime dfinition, on est cens dj connatre le sens de lexpression
pour pouvoir analyser dans quelle mesure les mots contribuent au sens. Ici on se rapproche de
lanalysabilit, qui concerne les contributions possibles des diffrentes parties de
lexpression. Il est clair que le terme de compositionnalit nassume pas la mme fonction
dans les trois citations. Voil pourquoi nous traiterons sparment les quatre dichotomies
motivation non-motivation, sens figur sens propre, opacit transparence et
analysabilit inanalysabilit. Nous estimons quil est possible de faire une distinction entre
ces dichotomies et quune expression au sens figur nest pas forcment non-motive et vice
versa. Il importe de noter la possibilit de distinguer nettement entre ces quatre dichotomies,
qui seront dcrites en dtail par la suite. Nous montrerons que tous les termes dans ces
dichotomies sont pertinents pour dcrire la compositionnalit dune expression fige. Puisque
la dfinition varie dun chercheur lautre, nous sommes davis que le terme de non-
compositionnalit est trop flou et quon devrait prciser si cest la non-motivation, lopacit,
le sens figur ou linanalysabilit qui est le trait le plus important.
Lassociation couramment propose entre les expressions figes et la non-
compositionnalit nest pas absolue. La compositionnalit est un phnomne continu plutt
que discret. On peut ainsi parler de degr de compositionnalit . Martin (1997:297)
prsente lenrichissement smantique comme un des mcanismes qui dterminent la non-
compositionnalit. La non-compositionnalit est prsente dans la langue dans sa totalit, mais
plus une squence de mots senrichit smantiquement, plus on se rapproche de la
locutionalit , crit-il (1997:298). Ce que signifie cet enrichissement smantique, cest
qu une squence de mots peut signifier plus que laddition de ses parties. (Martin
1997:297). Comme le montre bien quelques exemples de Martin, lenrichissement smantique
peut tre plus ou moins tendu :
Un mdecin de campagne est un mdecin qui exerce la campagne ; cest surtout
un gnraliste qui ne craint pas de mettre la main louvrage. Une maison de
campagne est une rsidence secondaire. Un demandeur demploi est quelquun
qui est la recherche dun emploi. Cest quelquun aussi, dans lorganisation
sociale du moment, qui bnficie dun certain nombre de droits, plus ou moins
strictement conditionns. Attendre un bb, cest pour une femme, un peu plus
que lattendre : cest le former en soi, mme si cest la nature qui le fait. (Martin
1997:297-298)
Selon Martin (1997:298), il y a dans la diversit des formes de lenrichissement une source
importante de non-compositionnalit et consquemment un facteur indniable de
locutionalit . La non-compositionnalit est, comme nous lavons dj constat, prsente
comme un facteur important dans une des catgories dexpressions figes, savoir celle de la
72
locution. ce propos, Langacker a fait peu prs la mme remarque : most composite
expressions have a conventional meaning more specific than their compositional value
(Langacker 1987:455)
227
.
La non-compositionnalit peut tre partielle ou totale. Selon Langacker (1987:449), la
compositionnalit totale fait plutt lexception que la rgle
228
. Les termes partielle et totale
peuvent aider prciser la nature de la compositionnalit des expressions.
2.3.2 Motivation vs non-motivation
On aura not, dans la dfinition de Nunberg et al., limportance quils accordent au problme
de savoir dans quelle mesure les mots contribuent au sens dune expression. Le terme de
motivation sera utilis pour parler de ce phnomne. Pour pouvoir dcider si un mot est
motiv dans telle ou telle expression, il faut dabord connatre le sens de lexpression. On voit
que ce procd est plus proche de la mthode propose par Nunberg et al. que des mthodes
de G. Gross et de Martin. Une fois le sens connu, on dcide quel est le degr de motivation
des mots dans lexpression, et jusqu quel point ils contribuent au sens de lexpression. Si
tous les mots contribuent au sens de lexpression, nous dirons quelle est compositionnelle.
Il convient ici dexpliquer les diverses possibilits dinterprter le mot motiv. Lorsque
nous disons quun mot dans une expression est motiv, cela nest pas prendre dans le sens
saussurien le plus rpandu. Le mot ou le signe tel quel, de mme que le rapport entre le
signifiant et le signifi, sont des phnomnes arbitraires. Le verbe marcher et le nom uf
auraient pu tre constitus dautres suites de lettres. Autrement dit, ils auraient pu avoir
dautres reprsentations phontiques et graphiques, ainsi que dautres signifis. Mais, une fois
tabli dans la langue, le mot acquiert, par lintermdiaire des locuteurs de la langue, un (ou
plusieurs) sens et un (ou plusieurs) usage(s), motiv(s) par rapport aux autres mots dune
expression ou dun syntagme. Cela ne veut pas dire quils soient motivs par rapport la
ralit en dehors de la langue. Ce qui est compris dans un mot a toujours un lment
darbitraire
229
. Cependant, Saussure a lui-mme parl de la limitation de larbitraire
(1916:182). Ainsi, notre emploi du terme motiv correspond plutt ce que Saussure appelle
relativement motiv . Dans le Cours de linguistique gnrale (1916:104) on lit : par
rapport lide quil reprsente, le signifiant apparat comme librement choisi . Mais, par
rapport la communaut linguistique qui lemploie [] il est impos , puisque le signifiant
choisi par la langue ne pourrait pas tre remplac par un autre. On lit galement : lesprit
russit introduire un principe dordre et de rgularit dans certains parties de la masse de
signes, et cest l le rle du relativement motiv (Saussure 1916:182).
On remarquera donc que dans les exemples qui vont suivre, nous employons motiv dans
le sens motiv par rapport au contexte linguistique devenu conventionnel et nous ne
prtendons pas que le signe aurait perdu son caractre arbitraire, tel quil est dfini par
Saussure.
227
Voir son exemple trs spcifique de patriotic pole-climber (Langacker 1987:454).
228
Linguistic phenomena lend themselves more easily to a claim of partial rather than full compositionality
(Langacker 1987:449).
229
Les exceptions sont connues les onomatopes sont communment acceptes comme plutt motives, mme
dans un sens saussurien. Certains linguistes sont davis que le nombre dexceptions excdent les quelques
onomatopes dans la langue. Pour des rfrences ce sujet, voir par exemple Hinton et al. (1994) et Abelin
(1999).
73
Il nous semble que lutilisation de la motivation est prfrable aux autres notions
examines dans ce chapitre, lorsquil sagit de dfinir la non-compositionnalit. Soit les autres
dichotomies sont difficiles utiliser, soit leur importance dans la dfinition est moins
saillante. La dichotomie transparence opacit, par exemple, est difficile appliquer
230
. La
dichotomie sens figur sens propre na pas de rapport direct avec la non-compositionnalit.
En ce qui concerne la notion danalysabilit, elle ressemble celle de motivation, mais on
peut faire une distinction entre ces deux termes
231
. Le terme de motivation sera ainsi utilis
dans la description dautres notions explores dans cette section.
Dans certaines expressions figes, un ou quelques-uns des mots seulement sont faciles
motiver. On peut ainsi voquer le besoin de parler de non-motivation partielle. Dans ce cas, la
motivation de certains mots peut tre difficile entrevoir ou bien tre dpendante de certains
autres mots dans lexpression, tandis que la prsence dautres mots sexplique facilement par
la motivation.
2.3.3 Sens propre vs sens figur
La notion de sens figur apparat souvent dans le contexte des expressions figes. Il nest pas
rare quelle soit considre comme peu prs synonyme dopaque, pithte qui dcrit souvent
des syntagmes dits non-compositionnels. Vu cette confusion, nous tenons toujours sparer
toutes ces notions les unes des autres.
Pour des raisons heuristiques, il peut tre utile de faire une distinction entre les niveaux de
syntaxe, de lexique, de smantique et de pragmatique, mme si une telle division est un peu
arbitraire. Une sparation de ces niveaux peut aider rendre plus claires les caractristiques
qui concernent les dichotomies qui seront analyses par la suite
232
.
Au niveau smantique on peut identifier certaines expressions qui ne peuvent tre
employes que figurativement, linterprtation littrale tant trop absurde ou improbable. Les
raisons pour cela peuvent tre des contradictions inhrentes ou des sujets et/ou objets
abstraits. Ces malformations smantiques sont, soit dues aux restrictions de slections, soit le
rsultat de la violation des rgles de sous-catgorisation. Ainsi, on reconnat, mme sans
contexte, les exemples qui ne sont normalement pas employs littralement. Si, toutefois,
certaines interprtations sont peu probables, on arrive voir une diffrence entre des
interprtations impossibles (dans le monde tel que nous le connaissons) et celles qui seraient
possibles dans des contextes trs spcifiques. On peut montrer cela avec une srie dexemples.
Nous prendrons comme point de dpart des exemples dans lesquels il est vident quaucun
mot na son sens propre. Nous verrons quil existe galement des expressions possibles mais
peu probables, et dautres allant jusqu lambigu. En effet, dans nos derniers exemples les
230
Il faut avouer quil est impossible dliminer entirement un lment darbitraire, mme si on laisse la
dfinition de la compositionnalit se baser sur la motivation. Cependant, il nous semble que ce choix est moins
arbitraire quune dfinition base sur la comprhension.
La compositionnalit varie avec le temps, lorsque lorigine dune expression tombe dans loubli et que la
motivation devient de plus en plus difficile entrevoir.
231
Langacker distingue entre la compositionnalit et lanalysabilit. Voir 2.3.6 infra, o nous reviendrons ce
sujet.
232
Le niveau syntaxique est utile pour parler de linanalysabilit et de lanalysabilit et sera donc discut plus
tard (voir 2.3.6). En ce qui concerne le niveau lexical, nous y reviendrons dans la partie qui traite de lopacit et
de la transparence (voir 2.3.5).
74
mots peuvent facilement avoir un sens propre aussi bien quun sens figur, et puisquil faut un
contexte pour en dcider, le niveau pragmatique savrera donc ncessaire.
La montagne qui a accouch dune souris
233
est, videmment, difficilement interprtable
au pied de la lettre. Nos connaissances du monde nous renseignent sur limpossibilit du sujet
montagne daccoucher dune souris et lexpression dcrit une ralit non seulement
contradictoire, mais en outre totalement impossible. Le corpus fournit une dmonstration de
ce fait :
Quand un vnement est trop attendu limage du visage new look de la
Formule 1, le risque est grand de voir la montagne accoucher dune souris.
(SO880402)
Un autre exemple est lexpression mettre quelquun hors de ses gonds
234
, dans laquelle le
gond nest pas cens reprsenter, littralement, une pice de fer, indispensable pour ouvrir ou
fermer une porte :
La possibilit dlections lgislatives anticipes ne va sans doute pas permettre
M.Gandhi dadopter une autre ligne de conduite qui risque de faire sortir les
Hindous de leurs gonds. (SO880402)
Un autre facteur qui peut tre significatif pour linterprtation dune phrase ou dun syntagme
est labsence dun rfrent spcifique
235
. supposer que le diable nexiste pas dans le monde
rel, il sera difficile de le tirer par la queue et nous sommes plus inclins interprter
lexemple suivant comme employ figurativement :
La reliure dart ne semble pas connatre la crise, alors que certains relieurs
traditionnels doivent, pour linstant, tirer le diable par la queue
236
. (LB860211)
Les anaphores peuvent galement manquer de rfrent spcifique dans certaines expressions,
telles que la bailler belle
237
, en voir de toutes les couleurs
238
, en dire des vertes et des pas
mres
239
et a la fout mal
240
.
La plupart des expressions suivantes sont probablement connues et normalement
interprtes comme figures, mais nous notons la possibilit, pour celui qui veut jouer avec la
langue, de crer des contextes dans lesquels on pourrait les employer avec un sens propre :
faire une tte de six pieds de long
241
233
Cest la montagne qui accouche dune souris se dit par raillerie des rsultats dcevants, drisoires dune
entreprise, dun ambitieux projet (PR:montagne).
234
Mettre quelquun hors de ses gonds - LOC.FIG. jeter, mettre qqn hors de ses gonds, hors de lui-mme, sous
leffet de la colre (PR:gond).
235
Cf. Martin (1997:293). Voir aussi Anward et Linell (1976:99) sur les syntagmes lexicaliss en sudois.
236
Tirer le diable par la queue avoir peine vivre avec de maigres ressources (PR:queue).
237
La bailler belle faire accroire quelque chose dextraordinaire (DEI:bailler).
238
En voir de toutes les couleurs subir toutes sortes dennuis, daffronts (DEI:couleur).
239
En dire des vertes et des pas mres tenir des propos grossiers (DEI:vert).
240
a la fout mal cela fait mauvais effet (DEL:mal).
241
Faire une tte de six pieds de long - tre triste, maussade (PR:tte).
75
donner sa langue au chat
242
couper un cheveu/les cheveux en quatre
243
avoir dautres chats fouetter
244
ce propos, Heinz (1993:33) crit : Mme dans les cas o le syntagme en question pourrait
galement dcrire un phnomne de la ralit extralinguistique, par ex. jeter le bb avec
leau du bain, mettre tous ses ufs dans le mme panier, linterprtation avec le sens propre
aurait quelque chose dartificiel, de dviant [...] .
Finalement, nous citerons des exemples o les mots peuvent avoir un sens propre ou un
sens figur, selon le contexte. Avec ces exemples, on arrive au quatrime niveau, le niveau
pragmatique :
baisser les bras
245
prendre une veste
246
prendre une culotte
247
cracher dans la soupe
248
jeter une pierre dans le jardin de qqn
249
Citons deux exemples du corpus o les expressions cracher dans la soupe et baisser les bras
sont au sens figur. Le sens figur est mme soulign par lemploi des guillemets dans le
premier exemple :
Nous avons surtout eu limpression dassister un dialogue de sourds entre des
invits refusant daller au fond de leurs penses parce quencore trop attachs au
milieu quon leur demandait de juger. Seul un invit aigri par son manque de
russite osa cracher dans la soupe . (SO880413)
Ne sachant plus que faire ou craignant daggraver encore la situation, les
autorits baissent les bras. (ME 88 10 :1)
Dans le corpus informatis, il ny a pas dattestation au sens propre des expressions que nous
venons dnumrer. Cependant, lextrait suivant dune page daccueil sur Linternet montre
quil est tout fait normal dinterprter prendre une veste au sens propre dans le bon
contexte :
Catherine avait froid. Moi aussi. Je suis retourne mon htel me changer et,
comme je suis une fille attentionne, jai pris une veste pour elle.
(< http://ccorsini.online.fr/repetition/itw_corsini_beart3.htm > Le 30 juin 2003)
242
Donner sa langue au chat - savouer incapable de trouver une solution (PR:chat).
243
Couper les cheveux en quatre subtiliser lexcs (PR:cheveux).
244
Avoir dautres chats fouetter dautres affaires en tte, plus importantes (PR:chat).
245
Baisser les bras (mtaph. de la boxe) : abandonner la lutte, renoncer agir (PR:baisser).
246
Prendre (ramasser, remporter) une veste - subir un chec (DEL:veste).
247
Attraper, prendre une culotte - faire une perte importante au jeu (DEL:culotte).
248
Cracher dans la soupe - affecter de mpriser ce dont on tire avantage, critiquer ce qui procure des moyens
dexistence (PR:soupe).
249
Jeter une pierre, des pierres dans le jardin de qqn - lattaquer indirectement (PR:jardin).
76
Dans la citation suivante, G. Gross dfinit la notion de compositionnalit en faisant
implicitement allusion aux dichotomies de sens propre sens figur, transparent opaque et
compositionnel non compositionnel, ce qui peut tre difficile voir sans bien rflchir sur la
terminologie. Pour rendre cela plus clair, nous avons explicit notre interprtation entre
crochets
250
:
[...] dans les langues, il existe un grand nombre de suites quun tranger ne peut
pas interprter littralement [ce que nous appelons donc sens figur], mme sil
connat le sens habituel de tous les mots qui les composent. Il en est ainsi de la
phrase suivante :
La moutarde lui monte au nez
Le sens ordinaire [sens propre] des mots de cette phrase ne permet pas de
conclure [le sens est donc opaque] que la phrase dans son ensemble signifie que
lon parle dune personne qui se fche. Nous dirons que cette phrase na pas de
lecture compositionnelle [elle est non compositionnelle]. (G. Gross 1996:11)
La phrase La moutarde lui monte au nez est donc non compositionnelle et opaque et elle a
un sens figur. Cette conclusion nest pas fausse. Cependant, cela ne veut pas forcment dire
que toutes les phrases au sens figur sont opaques aussi bien que non compositionnelles. G.
Gross semble utiliser les termes opacit et non-compositionnalit comme quivalents. Dans le
glossaire la fin de son livre un renvoi au terme d opaque figure sous le terme de
compositionnalit .
propos de sens figur ( figurative meaning ), Hudson crit :
Most definitions of fixed expressions also include a condition to the effect that
there is a semantic mis-match between the parts and the whole : a red herring, a
hot potato, to kick ass, not much cop, at the end of the day. This mis-match is
most commonly perceived as a result of the fact that the meaning of red and the
meaning of herring do not add up to the meaning of red herring [...]. It has been
widely assumed that this forth criterion (figurative meaning) correlates with the
[...] variability critieria [...]. (Hudson 1998:9)
linstar de Hudson, nous sommes davis quune distinction entre le sens figur et les
critres variationels
251
peut tre fonctionnelle.
Nous montrerons par la suite quune expression sens figur nest pas forcment une
expression non motive. Il est clair quon peut faire une distinction entre ces notions.
Au niveau pragmatique, on dcide tout dabord, laide du contexte si une expression (ou
une autre suite de mots) est employe au sens propre ou au sens figur. Les cas qui sont
clairement employs au sens propre sont toujours motivs
252
.
250
Dans cette citation de G.Gross, cest nous qui soulignons toutes les parties en caractres gras.
251
Nous rappelons que les critres variationels de Hudson sont les contraintes syntaxiques ( unexpected
syntactic constraints on the constituent parts ) et les restrictions collocationnelles ( unexpected collocational
restrictions within the expression ). Voir 1.2.1 supra.
252
Voir lexemple ils ont une chambre, 2.3.3.1 infra, dans son contexte.
77
Emploi au sens propre Emploi motiv
Figure 1 : Les expressions au sens propre sont compositionnelles.
Les expressions syntaxiquement et smantiquement bien formes pouvant tre employes au
sens figur aussi bien quau sens propre
253
, il est parfois problmatique de dcider entre les
deux possibilits
254
.
Emploi motiv
Emploi au sens figur
Emploi non motiv
Figure 2 : Les expressions au sens figur peuvent tre motives ou non.
Notre analyse est rsume dans la figure 3
255
.
NON MOTIV
SENS FIGUR
SENS PROPRE
MOTIV
Figure 3 : Les relations entre les sens propre et figur et la motivation.
Nous montrerons laide de quelques exemples la diversit des interprtations possibles en ce
qui concerne le sens propre ou figur et la motivation.
Dans lexpression marcher sur des ufs
256
, on exprime une activit qui est, sinon trs
courante, au moins possible effectuer, mme littralement. Or, avec un sujet abstrait comme
la bourse, il est clair que lexpression nest pas prendre au pied de la lettre.
253
Voir lexemple les carottes sont cuites, 2.3.3.3 infra, dans son contexte.
254
Ce fait est reconnu par de nombreux linguistes et philosophes. Voir par exemple Gibbs 1994 et Searle 1978.
255
Nous tenons remercier Sven Bjrkman, qui nous a incit combiner les notions en cette figure.
256
Marcher sur des ufs en touchant le sol avec prcaution, et SPCIALT dun air mal assur ; FIG. agir avec
circonspection (PR:uf).
78
En avril, ne te dcouvre pas dun fil , assure le dicton. La Bourse suivit cet avis
judicieux. Elle marcha mme sur des ufs cause des nouveaux remous crs
sur le front des monnaies par les reprsailles amricaines sur les puces
japonaises. (ME 87 10:1)
Un locuteur francophone reconnat trs probablement cette expression comme figure, mme
avec un sujet anim et parfaitement capable de marcher, dans le sens le plus concret, sur des
ufs.
Notons que pour le locuteur la ralit est quand mme trs complexe, et que les contextes
peuvent varier. Lexpression en question peut ainsi aboutir plusieurs interprtations, avec
des combinaisons diverses de sens figur ou propre et de motivation. Dans le cas o les mots
auraient leur sens propre (scnario pourtant peu probable), on pourrait donner la
reprsentation schmatique suivante du syntagme marcher sur des ufs
257
:
SYNTAGME...
AU SENS PROPRE
MOTIV
MO
(sens propre)
marcher
(sens propre)
sur
TIV MOTIV MOTIV
Figure 4 : La motivation de marcher sur des ufs au sens propre.
Les mots dans la figure 4 sont employs dans leurs sens propres. Ainsi on peut dire que
chaque mot est motiv dans lexpression. Dans la figure, on voit galement lequel des deux
termes de la dichotomie en question sapplique lexpression discute.
Il y a cependant une autre possibilit, probablement plus courante, dinterprter
lexpression marcher sur des ufs : en touchant le sol avec prcaution . Ce sens est le
premier donn par PR. Dans ce cas, les ufs ne sont pas littralement prsents dans le
contexte, mais, des ufs est toujours un nom motiv dans le contexte, en raison de
lassociation avec la fragilit
258
. Puisque marcher est ici employ au sens propre tandis que
des ufs est au sens figur, la prposition sur devient plus difficile interprter. Nous lavons
pourtant marque comme motive dans lexpression, puisquelle a sa place dans lexpression,
prise dans son ensemble, quelle soit employe au sens propre ou non.
257
Chaque mot du syntagme examin est plac dans une case, dans laquelle il y a une indication concernant la
nature du sens qui peut tre propre ou figur. Suivant le contexte, les mots peuvent ensuite tre motivs ou non.
Cela est indiqu en bas des flches dans la grande case. En dehors de la case sont indiques les interprtations
pertinentes des dichotomies examines pour le syntagme ou pour lexpression en question.
258
Lassociation avec la fragilit, qui rend le nomdes ufs motiv, est explicite dans un cercle dans la figure.
79
(sens propre)
des ufs
EXPRESSION...
marcher sur
(sens propre) ( ? (sens figur)
AU SENS PROPRE (PARTIEL)
avec prcaution
fragile
MOTIVE MOTIV MOTIV MOTIV
)
des ufs
Figure 5 : Lexpression marcher sur des ufs au sens en touchant le sol avec prcaution en termes de sens
propre et motivation.
Le dernier sens fournit par le PR, de la mme squence de mots, est agir avec
circonspection. Cela est linterprtation la plus probable pour lextrait suivant du corpus, o
lexpression sapplique facilement, quand bien mme le pape resterait assis :
Chaque fois quil sest rendu dans des pays prpondrance non chrtienne
(Turquie, Japon, Thalande), le Pape a d marcher sur des ufs. En Inde, o
se manifeste un certain complexe de lhindouisme li sa faiblesse
structurelle, la mission tait plus dlicate encore. (LB860210)
EXPRESSION... marcher sur des
(sens figur) (sens figur) (sens figur)
fragile
ON MOTIV MOTIV MOTIV
?) ( ?)
ufs
AU SENS FIGUR
avec prcaution
PARTIELLEMENT
MOTIVE
N
Figure 6 : Lexpression marcher surdes ufs au sens agir avec circonspection en termes de motivation et
sens figur.
Dans cet exemple la motivation du verbe marcher est moins saillante. Ce qui est exprim est
plus une attitude quune action, et le verbe ne contribue plus autant au contexte. En revanche,
les ufs contribuent toujours au sens du comportement avec prcaution, par lintermdiaire
du trait fragile. Aprs la perte de la motivation du verbe, il est difficile de voir la raison
dtre de la prposition sur. Cest toujours en fonction des autres mots dans le syntagme que
80
(agir
la prposition a sa place. Le verbe non motiv dans cette expression rend donc difficile la
motivation de la prposition. En somme, lexpression nest plus motive dans sa totalit. Or,
tant donn que des ufs contribuent toujours au sens, elle nest cependant pas non motive
non plus. Cette conclusion suggre que la langue ne se laisse pas facilement organiser dans
une structure bipartite comme la dichotomie motivation non-motivation. Elle confirme
lutilit de parler de motivation partielle et il semble logique de considrer cette expression
comme partiellement motive.
Nous avons dit quun syntagme au sens figur peut tre motiv ou non. Nous allons
maintenant tudier quelques exemples qui sont au sens propre et motiv, au sens figur et
motiv et un exemple qui est au sens figur et non motiv. Quelques expressions figes
contenant des noms de couleurs seront aussi examines ce propos.
2.3.3.1 Sens propre et motiv
Tout dabord, nous tudierons une suite au sens propre qui est donc, en mme temps,
motive :
A lhtel Reichshof, pour un shilling par jour, ils ont une chambre, trois repas et
quinze cigarettes, et dans la salle manger un orchestre allemand, aux heures de
repas, alterne musique de jazz et valses viennoises. (MO 9 septembre 1947)
Ici nous concluons, laide du contexte, que ces quatre mots, chacun au sens propre,
contribuent au sens du tout. Cela peut tre illustr par la figure 7.
SEQUENCE...
ils
(sens propre)
ont
(sens propre)
une
(sens propre)
chambre
(sens propre)
AU SENS PROPRE
MOTIVE
MOTIV MOTIV MOTIV MOTIV
Figure 7 : La motivation de ils ont une chambre (sens propre), dans lexemple tir du corpus.
2.3.3.2 Sens figur et motiv
Examinons maintenant un exemple qui a un sens figur et qui reste motiv. Mme sans
contexte, il est facile de conclure que lexpression avoir les yeux plus grands que le ventre
peut difficilement tre employe littralement sil sagit dun tre humain. Si nous acceptons
que ce syntagme veut dire, approximativement, quune personne a pris trop manger, non pas
parce quelle a trs faim, mais parce que la nourriture a lair trs bonne ou parce que notre
gourmand veut goter toutes les diffrentes varits prsentes, comment dcider si cette
expression est motive ou non ? Les syntagmes nominaux (ici des noms avec leurs
dterminants) sont examins dans leur totalit et cest surtout les mots lexicaux qui sont
intressants. Tous les sens possibles du verbe avoir ne sont pas pris en compte. Lanalyse est
81
ainsi simplifie. Comme les yeux sont les organes avec lesquels on voit, il nest pas difficile
de comprendre pourquoi ils sont prsents dans ce contexte. Le ventre est, videmment, une
partie du corps lie la nourriture (mais aussi des phnomnes comme grossesse ou
corpulence, etc.). Ainsi, les interprtations mtonymiques des yeux, se rfrant la vue, et du
ventre, se rfrant, dans ce cas, la faim, sont motives. Les syntagmes nominaux sont donc
motivs dans cette expression. Plus grand que est le comparatif de grand, tout simplement
une forme de ladjectif parfaitement facile comprendre et motiver. Si on accepte cette
analyse, tous les mots de lexpression sont motivs dans le contexte et elle est motive mme
si elle a un sens figur.
EXPRESSION...
avoi les yeux pl
AU SENS
( ? (sens figur) (sens propre) (sens figur)
PARTIELLEMENT
FIGUR
la vue la faim
MOTIVE
MOTIV MOTIV MOTIV MOTIV
Figure 8 : La motivation de lexpression avoir les yeux plus grands que le ventre au sens prendre trop
manger.
2.3.3.3 Sens figur et non motiv
Lexpression fige les carottes sont cuites
259
est au sens figur et non motiv. Cette suite de
mots peut tre comprise littralement. Il faut donc avoir recours au contexte pour dcider si
elle est employe figurativement ou non :
Ces mots de Kasparov en quittant lestrade de lhtel Leningrad aprs sa victoire
dans la 22e partie traduisent, en effet, un sentiment gnral. Cette fois-ci, les
carottes semblent cuites. Encore quil faille se garder dtre trop catgorique : ce
championnat du monde nous a dj rserv tellement de surprises... (LB861005)
On comprend quil sagit du championnat du monde dchecs, non pas de gastronomie, ce qui
fait quil est clair que lon ne parle pas de vraies carottes. Ici cest le sens tout est fini qui est
en jeu. Parmi les connotations et associations avec les carottes et avec cuites, il ny a pas de
motivation apparente pour que ces mots soient utiliss pour exprimer que tout est perdu, ce
qui fait que lexpression est non motive
260
.
259
Les carottes sont cuites tout est fini, perdu (PR:carotte).
260
Nous ne prtendons pas quune expression quelconque, considre aujourdhui comme non compositionnelle
na jamais t compositionnelle. Cest toujours dans une perspective synchronique que la motivation de mots
constituant une expression est perdue, si lorigine est oublie. En principe, nous partageons lavis de Martin
(1997:300) qui crit : Historiquement, la non-compositionnalit nexiste pas [] Il est vrai que certaines
locutions restent obscures [] [m]ais cest d une connaissance insuffisante et non labsence effective de
motivation . La seule exception que nous pouvons imaginer serait quune expression invente dans le but dtre
r
)
us grands que le ventre
82
EXPRESSION...
les carottes
(sens figur)
sont
AU SENS FIGUR
NON MOTIVE NON MOTIV NON
Figure 9 : La motivation de lexpression les carottes sont cuites au sens tout est fini.
Pour une interprtation non motive de lexpression les carottes sont cuites, cest le contenu
lexical qui est pris en compte. Pour ce qui est de la forme grammaticale, elle est plus
facilement motive. Nous reparlerons de cet exemple dans la section sur le contenu lexical et
la forme grammaticale
261
.
2.3.3.4 La motivation des noms des couleurs
Pour illustrer avec encore un exemple comment on peut sparer les notions de figur et de non
motiv, nous allons nous servir des noms de couleurs. premire vue, on est peut-tre tent
de croire que les noms de couleurs ne peuvent pas semployer pour dcrire des objets
abstraits. Mais lemploi des couleurs peut en fait tre de deux types, lis justement la
distinction que nous tenons faire. Dans le premier type demploi, le nom de la couleur est
motiv dans son emploi synchronique, tandis que dans lautre, le choix de couleur nous parat
compltement arbitraire (si le choix a une fois t logique, lorigine est maintenant oublie).
Les expressions avec un nom abstrait, dans lesquelles le nom-tte a comme pithte une
couleur, ne peuvent pas semployer dans un sens concret et littral. Des exemples en sont nuit
blanche et peur bleue. Lexpression est non motive si le locuteur ne voit pas le rapport entre
la couleur et ce quelle dcrit. Si, en revanche, la couleur a aussi un sens additionnel,
communment accept, compris par la plupart des locuteurs et mme reprable dans dautres
expressions, elle peut effectivement tre motive sans pour autant dcrire la couleur dun
objet concret.
Ainsi, ce nest pas un hasard si dans plusieurs langues blanc est associ linnocence
ou la puret, noir au pessimisme ou vert la jeunesse
262
. Dans les expressions figes blanc
comme neige
263
et une oie blanche
264
, la couleur blanche fait penser linnocence. Avoir des
ides noires
265
, voir les choses en noir
266
, le march noir
267
et colre noire
268
sont des
obscure reste ensuite dans la langue et ne soit motive ni dans une perspective synchronique, ni mme ds
lorigine (des exemples en seraient des messages cods en temps de guerre ou des plaisanteries etc.).
261
Voir 2.3.4 infra.
262
En anglais les termes de couleurs white, black et green sont employs entre autre dans des expressions figes
comme white wedding mariage blanc, black market march noir, et green fingers les doigts
verts.
263
Blanc comme neige innocent (DEI:neige).
264
Une oie blanche une jeune fille trs innocente, niaise (PR:oie).
265
Avoir des ides noires tre sujet la mlancolie (DEI:noir).
266
Voir les choses en noir nen voir que le ct fcheux (DEI:noir).
267
March noir vente clandestine au prix fort (DEI:march).
268
Colre noire violente colre (DEI:colre).
MOTIV
cuites
(sens figur)
83
syntagmes dans lesquelles lemploi du terme noir tonne peu. Peut-tre la couleur noire
fait-elle partie dun champ smantique li la rage et la colre, et dun autre li la
dpression ou aux choses ngatives en gnral
269
. Dans avoir les doigts verts ou avoir la main
verte
270
, la motivation du terme vert est claire, en raison de la couleur des plantes.
Comme la motivation derrire le choix de couleur nest pas vidente dans les expressions
nuit blanche
271
, peur bleue
272
et rire jaune
273
, nous les classons comme non motives.
2.3.4 Contenu lexical et forme grammaticale
Lexpression les carottes sont cuites est non motive. Or, il convient de distinguer le contenu
lexical de la forme grammaticale dun mot. Linterprtation non motive de lexpression en
question nest valable que si lon considre le contenu lexical des mots individuels. Le rapport
entre le sens figur tout est fini, et le substantif carottes nest pas clair, pas plus que celui
entre ce sens et le verbe cuire. Il nous semble que le mme sens aurait pu tre exprim aussi
bien par dautres substantifs que par les carottes et que dautres verbes auraient pu tre
utiliss, si cela avait t la convention :
les carottes sont cuites
les pommes de terre - " -
les pois - " -
le mas est cuit
les carottes sont cuites
- " - manges
- " - achetes
Il faut avouer quil y a un rapport logique entre le substantif sujet et le verbe, vu quon peut
trs bien faire cuire des carottes. Mis en rapport avec le substantif sujet, le verbe nest pas
compltement arbitraire (et vice versa). En raison des relations entre les mots, le choix de
lensemble des mots nest pas compltement immotiv. Mais une fois le substantif sujet
tabli, dautres verbes aussi logiques que cuire aurait donc pu occuper la place du verbe dans
lexpression. Il suffit de constater que tant que lon sen tient au mme champ smantique et
respecte les rgles de sous-catgorisation, les mots pourraient tre choisis diffremment.
La forme grammaticale du verbe peut tre considre comme motive. La forme du verbe
dans les carottes sont cuites, implique que laction est termine. Pour dire tout est fini, il
nous semble que la forme du verbe, qui exprime une action termine, est motive. Il serait
moins logique demployer, la place de sont cuites, une forme progressive comme sont en
train de cuire ou mme un autre temps du verbe comme le futur ou le prsent pour exprimer
cet tat dsespr
274
.
269
Voir Ohtsuki (2000) pour une tude compare de symboles de couleurs dans plusieurs langues. Cf. aussi
Steinvall (2002), chapitre 6 et 7.
270
Avoir les doigts verts, la main verte tre habile cultiver les plantes (PR:vert).
271
Nuit blanche nuit sans sommeil (DEI:blanc).
272
Avoir une peur bleue avoir trs peur (DEI:peur).
273
Rire, sourire jaune rire, sourire contrecur (DEI:jaune).
274
Dautres possibilits, comme lalternative de mettre un adjectif la place du verbe, seraient aussi moins
naturelles pour cette expression ; les expressions les carottes sont jolies ou les carottes sont vertes ne rendent pas
84
Il semble que dans les exemples analyss, les verbes portent plus de sens que dautres mots
lexicaux, tels que les noms et les adjectifs. Nous pensons l aux significations ventuellement
inhrentes au verbe, comme des indications sur la nature de laction. Est-elle volontaire ou
force, rptitive ou termine, irrversible ou itrative, excute de manire active ou non ?
Nous voquons ainsi la possibilit que les verbes soient plus connots que les noms et les
adjectifs.
Dans les formes des verbes rside la possibilit dexprimer les aspects perfectifs et
imperfectifs dune action, aussi bien que le temps. Ces distinctions sont trs significatives,
voire plus significatives que linformation fournie par les formes du nom. Cela porte croire
quen gnral, il est plus intressant de connatre les dtails dune action que les qualits dun
objet qui peuvent tre exprimes par les formes du substantif.
Notons en mme temps que dans la structure argumentale, cest le prdicat qui dcide du
nombre darguments quil peut prendre. Cest ainsi le verbe qui dcide des rles des autres
composants dans la phrase. Ou, comme le formule Gaatone (1998b:193) : Le prdicat ne
dpend de rien, mais tout dpend de lui. et [d]e mme [...] les rgles dordre des mots ne
peuvent se formuler qu partir dun lment choisi comme point zro, de mme les rgles de
structure de phrase doivent se formuler par rapport un point de rfrence qui est prcisment
ce quon appelle le prdicat . Mme sil affirme aussi qu il semble trs largement admis
que le verbe prdique par essence (1998b:194), ce point de vue nest pas incontest.
Rousseau (1998:503) conclut que le rle de prdicat peut tre jou par dautres lments que
le verbe. Nous nentrerons pas ici dans les dtails de la prdication, mais concluons avec
Gaatone (1998b:193) que Tesnire (1966:103) considre le nud verbal comme le centre de
la phrase dans la plupart des langues europennes. Cela peut avoir des consquences sur
linteraction entre la motivation et la structure grammaticale des expressions figes. Ainsi, ce
nest pas un hasard si le verbe cuire se combine avec des lgumes et pas avec des objet qui
ne se laissent pas cuire (des meubles, des livres, des btiments etc.).
2.3.5 Transparence vs opacit
laide des mots qui nont pas de thme
275
productif, on peut identifier un type dexpressions
figes dont les mots nont pas forcment un sens connu en franais moderne. Le niveau
lexical introduit auparavant est pertinent dans ce contexte
276
. Dans un dictionnaire bilingue
franais-sudois les mots fur et instar sont cits dans les expressions au fur et mesure et
linstar de. Ils ne sont pas dots dun sens individuel, courant en franais moderne. Ici, il est
logique dattirer lattention sur la dichotomie transparence/opacit. Notre hypothse est
quelle se distingue des autres dichotomies souvent mentionnes propos du terme de
compositionnalit. Cependant, le fait quon puisse faire une distinction entre les dichotomies
nest pas souvent pris en compte.
Dans bon nombre de dfinitions de la compositionnalit la comprhension joue un rle
important. Dans ces dfinitions, la transparence va de pair avec la compositionnalit et les
le mme sentiment dimpossibilit de changer ce qui est dj arriv. Avec un participe comme cuites, il est plus
vident que laction est irrversible et quil est trop tard pour changer ltat des choses.
275
Nous rappelons que le thme est, dans la terminologie de Togeby (1965:92), RACINE + DRIVATIFS. Voir
supra 2.2.1 pour la dfinition.
276
Voir 2.3.3 supra.
85
expressions non compositionnelles sont opaques. Regardons nouveau quelques exemples de
G. Gross, dont le premier a t discut dans le contexte de sens figur :
[...] dans les langues, il existe un grand nombre de suites quun tranger ne peut
pas interprter littralement, mme sil connat le sens habituel de tous les mots
qui les composent. Il en est ainsi de la phrase suivante :
La moutarde lui monte au nez
Le sens ordinaire des mots de cette phrase ne permet pas de conclure que la
phrase dans son ensemble signifie que lon parle dune personne qui se fche.
Nous dirons que cette phrase na pas de lecture compositionnelle. Mais le plus
souvent, une suite donne peut avoir deux lectures possibles : lune est
transparente et lautre opaque. Cela sapplique une phrase comme :
Les carottes sont cuites
qui signifie que les lgumes en question sont prts tre mangs (sens
compositionnel) ou que la situation est dsespre (sens opaque). (G. Gross
1996:11)
On voit que dans cette dfinition, opaque soppose compositionnel. Mais peut-tre les
termes dopacit et de non-compositionnalit reprsentent-ils des phnomnes diffrents.
Nous tenons faire une distinction entre les deux. Le fait est que le terme de
compositionnalit est difficile interprter justement en raison du grand nombre possible
dinterprtations. Une solution serait de choisir la motivation comme dfinitoire de la
compositionnalit (ce qui est dj une ralit dans certains dfinitions). Il nous semble que la
motivation est une notion assez claire pour quon puisse dcider, dans la plupart des cas, si un
mot est motiv ou non dans une expression. La transparence est lie la comprhension.
videmment, si les mots dune expression fige sont tous motivs, cela facilite la
comprhension. Cependant, une analyse de diffrentes combinaisons possibles de motivation
et de transparence sera effectue en vue dexpliquer plus clairement les diffrences qui
peuvent se cacher derrire ces notions. La dichotomie sens propre/sens figur sera galement
reprise.
2.3.5.1 Sens propre, motiv et transparent
Nous avons postul quun emploi sens propre est toujours motiv. Reprenons lexemple ils
ont une chambre. Cet ensemble de mots ne pose pas de problme de comprhension. Il est
donc galement transparent.
86
SQUENCE...
ils
(sens propre)
ont une chambre
(sens propre) (sens propre) (sens propre)
AU SENS PROPRE
TRANSPARENTE
MOTIVE
Figure 10 : La motivation et la transparence de ils ont une chambre sens propre dans lextrait du corpus.
2.3.5.2 Sens figur, motiv et transparent
Revenons lexemple sens figur avoir les yeux plus grand que le ventre. La motivation de
chaque mot est facile voir, ce qui nous permet de conclure que le syntagme en question est
motiv tout en ayant un sens figur.
EXPRESSION...
AU SENS FIGUR
TRANSPARENTE
MOTIVE MOTIV
Figure 11 : La motivation et la transparence de lexpression avoir les yeux plus grands que le ventre au sens
de prendre trop manger.
Lexpression nest pas difficile comprendre, puisque la prsence des mtonymies est
logique
277
, ce qui fait quelle est galement transparente pour le locuteur commun. Nous nous
en tenons lhypothse que les deux notions de motivation et de transparence ne sont pas
synonymes quoiquil y ait une relation entre elles qui nest pas due au hasard. Si la motivation
des mots est claire, lexpression est certainement plus facile comprendre. Pourtant, nous
allons voir que la distinction entre la transparence et la motivation peut tre justifie.
2.3.5.3 Sens figur, motiv et opaque
Examinons quelques cas plus complexes. Y a-t-il des expressions figes opaques sens figur
dans lesquelles les mots sont motivs ? Il est difficile den trouver des exemples, mais les
expressions franaises ventre terre et plat ventre ainsi que lexpression anglais a shot in
the arm seront analyses :
87
277
Voir figure 8 supra.
MOTIV MOTIV MOTIV MOTIV
MOTIV MOTIV MOTIV
(sens figur)
le ventre
(sens figur)
plus grands que
(sens figur)
les yeux
(sens figur)
avoir
Selon PR, courir ventre terre, veut dire courir trs vite et, par extension, on dit aussi
arriver ou aller ventre terre. Dans un contexte donn, lexpression est facile comprendre :
Il parat que si lon veut neutraliser sa belle-mre de toute urgence, il faut
appeler S.O.S.-Voyance. Un charmant jeune homme vient vous dpanner ventre
terre. Ah! lamour a tout esprer des voyantes. (SO880411)
Or, le ventre nest pas, proprement parler, pos par terre. Ce fait peut rendre difficile la
comprhension aussi bien que lutilisation de cette expression. Le rfrent du mot ventre
est prsent dans le contexte et ventre garde ainsi son sens propre, mme si lexpression
dans sa totalit est employe au sens figur. Il faudrait en fait tre assez explicite pour que
lexpression soit transparente ; courir si vite quon a limpression que le ventre est en
parallle avec la terre donne peu prs une ide correcte et faciliterait la comprhension. La
prposition , ayant une signification trs gnrale, est peut-tre le mot quon peut donc
qualifier comme tant opaque.
Ainsi, la motivation de la prposition est la plus difficile dfendre. Cependant,
lexpression est au moins partiellement motive, puisque les mots lexicaux sont motivs dans
lexpression en question.
EXPRESSION...
AU SENS (PARTIELLEMENT)
PROPRE
OPAQUE
PARTIELLEMENT
MOTIVE
MOTIV NON MOTIV (?) MOTIV
ventre
(sens propre)
(sens figur)
terre
(sens propre)
Figure 12 : La motivation et la transparence de lexpression ventre terre .
Au cas o un locuteur ne connatrait pas le sens de lexpression ventre terre, il pourrait le
confondre avec lexpression plat ventre :
Cinquante hommes sont runis sur la place du village. Ils refusent de dnoncer les
coupables. Bien : Je fais alors avancer une AM [automitrailleuse] et je fais
coucher les cinquante hommes plat ventre devant l'engin blind. Je dtruis [...]
(MO 18 octobre 1974)
Dans le contexte cit, il nest pas probable quun locuteur confonde lexpression avec ventre
terre. Mais sans contexte, il est possible quun locuteur qui ne connat pas les deux
expressions les confonde. Le contexte fournit beaucoup dinformation, ce dont on a peut-tre
besoin pour les comprendre.
Un autre exemple du mme type est lexpression anglaise a shot in the arm, dans laquelle
le shot dont il est question nest pas un coup de feu reu dans le bras, mais une piqre, qui
est cense injecter de lnergie et de lencouragement. Les locuteurs anglophones pour qui
88
cette signification nest pas saillante, peuvent donc trouver lexpression opaque, mme si les
mots dont elle est constitue sont motivs
278
.
2.3.5.4 Sens figur, non motiv et transparent
Le syntagme saw logs (scier des troncs), comment par Nunberg et al. (1994:497) peut
avoir le sens de ronfler. Dans ce cas, il est question dun sens figur des mots, puisque
aucun tronc nest en fait sci. Lexpression en question nest pas difficile comprendre,
puisque limage sonore du bruit qui se produit lorsquon scie un tronc ressemble au bruit de
ronflement. Mais il est vident qu part lvocation dun son, cette expression na rien voir
avec lactivit de ronfler ou de dormir, et les mots ne contribuent pas individuellement au sens
de ronfler. Elle peut donc tre considre comme non motive
279
.
EXPRESSION...
AU SENS FIGUR
TRANSPARENTE
NON MOTIVE
NON M
Figure 13. La motivation et la transparence de lexpression saw logs au sens figur.
2.3.5.5 Sens figur, non motiv et opaque
On a vu que lexemple les carottes sont (ou semblent) cuites peut tre employ au sens figur.
Dans ce cas, les mots ne sont pas motivs et on peut difficilement dire que lexpression est
transparente. Il faut avoir appris que lensemble de ces mots peut vouloir dire tout est fini
pour comprendre cette combinaison de mots. Elle est donc non motive et opaque.
278
Cf. Moon (1998:22-23), sur semi-transparent metaphors : Semi-transparent metaphors require some
specialist knowledge in order to be decoded successfully. Not all speakers of a language may understand the
reference or be able to make the required analogy. Ex. grasp the nettle, on an even keel, the pecking order, throw
in the towel, under ones belt .
279
Or, si on regarde lexpression dans sa totalit, dans un perspectif holiste, elle peut passer pour
compositionnelle. Cf. 2.3.7 infra.
OTIV NON MOTIV (?)
saw
(sens figur)
ogs
(sens figur)
89
l
EXPRESSION...
AU SENS FIGUR
OPAQUE
NON MOTIVE
NON
Figure 14. La motivation et la transparence de lexpression les carottes sont cuites au sens figur.
La mme chose vaut pour les syntagmes une omelette norvgienne
280
, qui est le nom dun
dessert glace et non dune omelette, une douche cossaise, qui nest ni forcment une
douche, ni mme un objet ou un phnomne cossais
281
et pour un gros bonnet
282
qui est
souvent un mtonyme plutt que quelque chose quon met sur la tte.
2.3.5.6 Comparaisons
Certaines comparaisons peuvent servir illustrer le critre de non-compositionnalit ainsi que
la dichotomie opacit-transparence. Quelques expressions qui renforcent un adjectif
qualificatif par une comparaison seront examines par la suite.
Dans les comparaisons heureux comme un poisson dans leau, clair comme de leau de
roche et sale comme un pourceau, on exprime ds le premier mot ce qui est le plus important
dans le contexte, savoir ladjectif qualificatif (heureux, clair et sale). Les comparaisons sont
faciles comprendre et associer avec respectivement un poisson dans leau, de leau de
roche et un pourceau. On assigne aux expressions les sens trs heureux, trs clair et trs
sale et elles sont par consquent transparentes. Par analogie, on peut interprter les exemples
fort comme un Turc, sol comme un Polonais, et bte comme ses pieds comme signifiant trs
fort, trs sol et trs bte, mme si le choix de la comparaison est moins vident
283
.
On peut donc dire que les trois premiers exemples (heureux comme un poisson dans leau,
clair comme de leau de roche et sale comme un pourceau) sont motivs. Dans un sens, les
trois derniers (fort comme un Turc, sol comme un Polonais, et bte comme ses pieds) le sont
peut-tre aussi, (ou ltaient une fois ?), mais ce qui vient lesprit lorsquon essaie dassocier
un Turc, un Polonais et des pieds des traits typiques (ou prototypiques), nest pas forcment,
en premier lieu, li la force, livresse ou la stupidit.
Il est intressant de noter un exemple qui va pour ainsi dire dans un sens contraire : haut
comme trois pommes ne veut pas dire trs haut, mais tout petit.
280
ventuellement on peut voir ladjectif norvgienne comme motiv, tant donn quil peut faire froid en
Norvge.
281
Voir 2.5.2 infra.
282
Un gros bonnet une personne influente (DEI:bonnet).
283
Toutes les expressions cites dans cette section sont conventionnalises et se retrouvent normalement dans les
dictionnaires.
MOTIV NON MOTIV
les carottes
(sens figur)
cuites
(sens figur)
90
sont
Des constructions qui ressemblent celles cites sont celles qui comportent un verbe
renforc de la mme manire : jurer comme un charretier et pleurer comme une Madeleine
signifient, respectivement, jurer beaucoup et pleurer beaucoup. Passer comme une lettre
la poste veut dire passer facilement, sans incident.
Il y a dautres constructions dont les locuteurs peuvent se servir pour insister sur une
qualit. Citons titre dexemple chaud cuire du pain, fou lier, fivre de cheval, patience
dange, apptit dogre et voix de Stentor
284
, construites avec une prposition. Elles expriment
un tat ou une qualit extrme et sont facilement interprtes comme trs chaud, trs fou,
beaucoup de fivre, beaucoup de patience, grand apptit. Voix de Stentor est
vraisemblablement lexpression la moins transparente dans ce groupe. ventuellement, le
locuteur fait un parallle avec dautres expressions cites, et conclut, mme si Stentor lui
est inconnu, quavoir une voix de Stentor veut dire avoir une voix forte. Mais on pourrait
aussi faire lerreur de donner lexpression le sens contraire : avoir une voix faible
285
.
2.3.6 Analysabilit vs inanalysabilit
Nous arrivons la dernire dichotomie lie la non-compositionnalit, lanalysabilit et
linanalysabilit. Lanalysabilit dune expression concerne la possibilit de voir quelles
peuvent tre les contributions de tel ou tel mot. Selon Langacker, lanalysabilit est sparable
de la compositionnalit. Voil ses dfinitions danalysabilit : the extent to which speakers
are cognizant of the presence and the semantic contribution of component symbolic
elements (Langacker 1999:127) et de compositionnalit : Compositionality, on the other
hand, pertains to the regularity of compositional relationships, i.e. the degree to which the
value of the whole is predictable from the values of its parts (Langacker 1987:448). Il dit
explicitement quil faut sparer les deux notions : Compositionality [...] is to be
distinguished from analyzability, which pertains instead to the extent to which speakers are
cognizant [...] of the contribution that individual component structures make to the composite
whole (Langacker 1987:457)
286
.
Pour quune expression ou quun syntagme soit analysable, il faut donc que le locuteur soit
conscient de la contribution de chaque partie au sens total. La perte de compositionnalit
contribue une perte progressive danalysabilit, crit Langacker (1987:464). Or, cette
relation nest ni automatique, ni absolue.
On reconnat maintenant que plusieurs types dexpressions figes (les idiomes par
exemple) sont en fait analysables, mme si traditionnellement lhypothse a t que les
lments composants des expressions figes nont pas de sens individuel. Ainsi, Gibbs fait
remarquer (1994:278) que de nombreux syntagmes idiomatiques sont analysables (ou
dcomposables les deux termes sont utiliss) et que les sens des composants contribuent
indpendamment au sens figuratif global du syntagme en question. Il constate aussi que cela
va lencontre du point de vue traditionnel, ce qui est galement confirm par Langacker :
The working assumption in transformational grammar was that elements [...] have no
284
Voix de stentor voix forte, retentissante (PR:stentor).
285
Cf. la discussion sur diffrents types de comparaisons de Henry (1983:88).
286
Ici la pertinence des termes atomiste et holiste est voqu. Le terme de compositionnalit holiste semble
couvrir ce que Langacker dcrit sous le terme de compositionality . En revanche, le terme de analyzability
est proche de ce que nous appelerons compositionnalit atomiste. Voir 2.3.7 infra.
91
independent semantic value and only occur as part of fixed sequences [...] (Langacker
1999:344). Il continue en affirmant que cette hypothse na pas t confirme empiriquement
et quil la considre comme fausse. Il est davis quune expression fige est presque toujours
capable de garder un degr danalysabilit (1987:461).
Comme le constatent Gibbs et al. (1989:578), il ny a pas de mthode bien dfinie pour
dcider de lanalysabilit dun idiome. Cependant ils proposent que les champs
smantiques
287
peuvent servir de moyen danalyse. Plus les lments composants dun idiome
partagent les champs smantiques de leurs rfrences idiomatiques, plus lidiome est
analysable.
Gibbs (1994:278) donne des exemples dexpressions quil juge dcomposables : Idioms
like pop the question, spill the beans and lay down the law
[288]
are decomposable, because
each component obviously contributes to the overall figurative interpretation .
Nous aimerions commenter les deux derniers exemples. Spill the beans (littralement
renverser les haricots) veut dire rvler un secret. Selon Gibbs chaque mot contribue dune
faon indpendante linterprtation figurative de lexpression considre dans sa totalit.
ventuellement on peut dire que le mot spill (renverser) contribue au sens de lexpression,
lorsquon le met en relation avec le sens figur, mais nous ne partageons pas lavis que le mot
beans (avec larticle dfini) contribue dune faon indpendante au sens figur de
lexpression. Il ne nous semble ni que les connotations du mot the beans sassocient aux
secrets, ni que les haricots et les secrets appartiennent au mme champ smantique. Force
est de constater que ce nest quen combinaison avec spill que les locuteurs associent the
beans un secret.
EXPRESSION...
t
AU SENS FIGUR
OPAQUE ( ?
?
)
INANALYSABLE
PARTIELLEMENT MOTIVE
(action involontaire)
faire en sorte que
quelque chose sorte
OTIV NON M M OTIV
spill he beans
Figure 15 : La motivation, la transparence et lanalysabilit de lexpression spill the beans au sens figur.
Le deuxime exemple, lay down the law, est peu prs lquivalent de faire la loi. Parfois, il
faut se mfier des vidences apparentes lorsquon parle de sa propre langue. Pour un locuteur
natif de langlais, il est clair que lay down veut dire poser et que le sens figur est peu prs
imposer. Mais comment les mots lay et down contribuent-ils chacun indpendamment au
sens figur de lexpression ? Mme si on accepte de traiter lay down comme unit lexicale,
287
Nous nentrons pas dans les dtails de la thorie des champs smantiques, qui est trs complexe. Voir Ullman
(1967) et Miller et Johnson-Laird (1976).
288
Pop the question veut dire faire une demande en mariage. To spill the beans vendre la mche, to lay
down the law faire la loi (CFCD).
92
nous ne trouvons pas aussi vident que Gibbs que cette unit contribue indpendamment au
sens.
EXPRESSION...
th
AU SENS FIGUR
OPAQUE
PARTIELLEMENT MOTIVE
poser en bas ? la loi, les rgles,
principes quil faut
appliquer dans une
situation donne
NON MOTIV MOTIV
lay down
e
law
Figure 16 : La compositionnalit de lexpression lay down the law .
Il nous semble que lay down aurait pu avoir une interprtation exactement contraire celle
que propose Gibbs. Lay down aurait pu aussi bien vouloir dire poser que mettre de ct ou
mme cacher, si cela avait t la convention au lieu de lusage actuel. Notons quen sudois,
lgga ner (lay down) peut vouloir dire fermer ou sabstenir, selon le contexte. Lgga ner
fabriken
289
, veut dire fermer lusine et lgga ner sin rst
290
, sabstenir de voter.
videmment il y a beaucoup de cas limites qui se laissent difficilement classer comme
analysables ou non. Toutefois, il est souhaitable de pouvoir dcrire comment les mots en
question contribuent au sens pour pouvoir classer une expression comme dcomposable.
Il est vrai que les mots peuvent contribuer, comme le constate Gibbs, soit avec leur sens
propre soit avec leur sens figur : All that matters for an idiom to be viewed as
decomposable is for its parts to have meanings, either literal or figurative, that contribute
independently to the phrases overall figurative interpretation (Gibbs 1994:278). Mais que la
contribution dun mot soit au sens propre ou au sens figur, il faut pouvoir expliciter comment
ce mot contribue au sens.
Une manire plus nette de dfinir la notion danalysabilit serait de postuler que cest la
structure syntaxique dune phrase ou dun syntagme qui en dcide. Dans les dfinitions que
nous venons de citer
291
on parle de la contribution que fait chaque composant individuel au
sens du tout. Ainsi, il suffit de voir quelle partie contribue avec quoi, pour dire quune
expression est analysable. Dans les exemples de Gibbs, on peut effectivement voir des
correspondances entre les verbes et entre les substantifs de la manire reprsente dans la
figure 17.
289
Traduit mot mot en anglais : lay down the factory (poser bas/en bas lusine).
290
Littralement, en anglais : lay down ones voice (poser bas/en bas sa voix).
291
Langacker 1987, Gibbs et al. 1989 et Gibbs 1994.
93
pop question spill beans
ask marriage proposal reveal secret
Figure 17 : Les correspondances entre les mots dans les expressions pop the question et spill the beans
et leurs interprtations.
Il y a une assez grande diffrence entre ces deux exemples. Dans pop the question, on arrive
voir un lien smantique entre les mots composants pop et ask ainsi quentre le mot question et
le syntagme marriage proposal, puisque une demande en mariage est une question. Dans le
deuxime exemple, spill the beans, en revanche, le lien smantique est seulement prsent
entre spill et reveal. En ce qui concerne beans et secret, seule la structure de la phrase
contribue lanalysabilit. Or, ce que disent Gibbs et al. (1989) donne croire quils veulent
en fait prendre en considration la smantique aussi bien que la syntaxe, puisquils proposent
une analyse mettant en exergue les champs smantiques, auquel cas, notre avis, le deuxime
exemple ne tient plus. Avec une dfinition de lanalysabilit, telle que nous la proposons, les
deux expressions seraient analysables, mais cest seulement dans pop the question que tous
les mots contribuent smantiquement au sens du tout.
Revenons un instant sur le terme gnrique compositionnalit. Pour en donner une
dfinition prliminaire, on peut dire que la compositionnalit est lie la contribution des
mots au sens du tout. Les exemples de Gibbs montrent quil faut prendre en considration la
structure syntaxique aussi bien que la smantique pour pouvoir dire quelque chose sur la
compositionnalit dune expression. Cependant, le plus souvent, nous avons voulu viter le
terme de compositionnalit, puisquil est justement mal dfini. Nous avons vu que pour
certains chercheurs, le trait dfinitoire de la compositionnalit est la transparence. Chez
dautres il sagit de la motivation des mots tandis que chez dautres encore cest le sens figur
qui est le trait le plus significatif. Il convient donc de choisir un terme plus prcis que celui de
compositionnalit, ou du moins den donner une dfinition plus exacte.
Regardons maintenant lexemple avoir dautres chats fouetter. Nous dirons que cette
expression est transparente bien que tous les mots ne contribuent pas au sens.
EXPRESSION...
AU SENS FIGUR
TRANSPARENTE
PARTIELLEMENT
MOTIVE
ANALYSABLE
avoir dautres chats fouetter
MOTIV MOTIV NON-MOT. NON-MOT. NON-MOT.
Figure 18a : La motivation, la transparence et lanalysabilit de lexpression avoir dautres chats fouetter
au sens figur.
94
Mme sans chats et sans la moindre intention de fouetter quoi que ce soit, un locuteur franais
est probablement capable dinterprter cette expression. Les mots dautres gardent leur sens et
constituent mme le centre de ce syntagme, parce que cest grce ces mots quon arrive
linterprter, ce qui est indiqu en caractres gras dans la figure. Par contre, il est difficile de
voir comment chats et fouetter pourraient contribuer au sens. la limite, on pourrait dire que
la structure mme de cette phrase aide linterprtation
292
. Elle est analysable puisquon voit
bien quelle partie contribue avec quoi.
Figure 18b : Lanalysabilit de lexpression avoir dautres chats fouetter .
part la structure syntaxique, la structure phonologique joue un rle important dans cette
expression vu que les mots chats et choses ainsi que fouetter et faire respectivement,
commencent par le mme phonme :
Malheureusement, elle a souvent dautres chats plus prioritaires fouetter que
les braconniers et nest pas toujours disponible pour aller passer des soires dans
les bois. (SO880409)
Faute de disposer dun interlocuteur politique Jean-Luc Dehaene a dautres
chats fouetter. (SO880414)
La distinction entre le contenu lexical et la forme grammaticale peut avoir des consquences
sur linterprtation dun syntagme vu que lun dentre eux peut avoir plus dimportance pour
la motivation. En ce qui concerne lexpression avoir dautres chats fouetter, on peut ajouter
que la structure phonologique, contribue galement la motivation des mots composants.
Un dernier exemple qui peut servir illustrer la notion dinanalysabilit est mordre la
poussire
293
. Cest lexpression dans son ensemble qui signifie tomber ou tre vaincu. Le
verbe mordre na pas tout seul ce sens. La poussire ne fournit pas non plus le sens de
mourir . Cest expression est inanalysable, mme sil y a peut-tre une logique derrire
lexpression dans sa totalit.
292
Nous tenons remercier Paul Kay qui nous a signal le fait que choses et faire sont des hypronymes de
chats et fouetter et que cela peut influencer linterprtation du locuteur.
293
Mordre la poussire tomber de tout son long (dans un combat) ; essuyer un chec, une dure dfaite
(PR:mordre) et Mordre la poussire tre vaincu (DEI:poussire).
avoir dautres Chats Fouetter
(avoir) dautres hoses aire C F
95
2.3.7 Les perspectives atomiste et holiste
Linterprtation dune expression dpend de la perspective atomiste ou holiste dans laquelle
on lenvisage. Pour que lexpression en question soit compositionnelle dans une perspective
atomiste, les mots individuels doivent contribuer indpendamment au sens de lexpression.
ce propos, Gosselin dit :
On regroupe sous le concept dapproche compositionnelle atomiste de la
signification lensemble des analyses qui considrent que la signification globale
dun nonc rsulte directement de la mise en commun des significations
individuelles des lments qui le composent. (Gosselin 1996:161)
Une suite interprte comme compositionnelle dans une perspective atomiste est
automatiquement compositionnelle dans une perspective holiste. Cette conclusion est valable
aussi bien pour les sens propres que pour les sens figurs. Citons ce propos la phrase ils ont
une chambre et lexpression figure avoir les yeux plus grands que le ventre. Dans leurs
contextes respectifs, ces suites de mots peuvent avoir des interprtations compositionnelles
294
.
Si nous avons donc pu constater que chaque mot contribue au sens du tout (perspective
atomiste), les mots pris ensemble (perspective holiste) donnent alors le mme rsultat.
Les suites qui, en revanche, sont non-compositionnelles dans une perspective atomiste
peuvent tre soit compositionnelles, soit non-compositionnelles dans une perspective holiste.
Lexemple saw logs (Nunberg et al. 1994:497), illustre pourquoi il est important de
prendre en considration ces deux cts de la compositionnalit.
EXPRESSION...
saw
(sens figur)
logs
(sens figur)
NON COMPOSITIONNELLE
(PERSPECTIVE ATOMISTE) NON MOTIV OTIV NON M
Figure 19a : La compositionnalit de lexpression saw logs dans le sens de ronfler (perspective atomiste).
Ce que nous voulons rendre explicite avec les figures 19a et 19b, cest le fait que les mots ne
contribuent pas indpendamment au sens ronfler, quils voquent ensemble, un son peru
comme une sorte de mtonymie auditive qui rend motivs les mots dans lexpression
considre comme une unit. Dans une perspective holiste elle est donc compositionnelle.
96
294
Voir 2.3.3 supra.
EXPRESSION...
(sens figur)
ronflement
COMPOSITIONNELLE
(PERSPECTIVE HOLISTE)
Figure 19b : La compositionnalit de lexpression saw logs (perspective holiste).
Ici, la perspective dans laquelle on interprte lexpression a des consquences pour
linterprtation et donc sur le phnomne de compositionnalit
295
.
Dans lexpression les carottes sont cuites, finalement, il ny a aucun mot qui contribue au
sens tout est fini. Dans une perspective atomiste, lexpression est non compositionnelle.
Grouper les mots ensemble dans lexpression les carottes sont cuites ne change pas la
possibilit dentrevoir quel mot contribue avec quoi. Cette expression est non
compositionnelle dans une perspective atomiste aussi bien que dans une perspective holiste.
2.3.8 Rsum
La notion de non-compositionnalit est souvent voque comme une caractristique
dexpressions figes (notamment didiomes, de locutions ou dautres constructions dites
figes). Il est possible de distinguer pas moins de quatre dichotomies, toutes pertinentes dans
ce contexte. Elles ont t dfinies dans cette section sous les noms de :
motivation non-motivation
sens propre sens figur
transparence opacit
analysabilit inanalysabilit
La motivation dun syntagme ne se laisse dcider quaprs quon connat le sens du syntagme
en question. Une fois le sens connu, le locuteur peut juger si les mots composants contribuent
au sens dune faon logique. Si cela est le cas, les mots sont motivs. Dans la phrase Les
carottes sont cuites, les mots composants peuvent tre motivs ou non, selon le contexte. Lors
de la prparation du dner, ces mots sont tous motivs, tandis que dans un contexte sans
295
la limite, on peut dire que saw est motiv, puisque laction de scier produit normalement un bruit. Dans
lexpression sudoise dra timmerstockar (littralement : tirer des troncs), lquivalent de saw logs , on
voit encore moins le rapport entre les verbes (tirer et ronfler). Lexemple sudois montre donc mieux
comment on peut sparer les perspectives atomiste et holiste.
MOTIV
saw logs
[son]
97
nourriture, o la mme phrase a la signification tout est perdu, la motivation des mots
composants nexiste plus et lexpression est dans ce cas non-motive.
Lorsque les mots composants dun syntagme passent par une mtonymie, le sens du
syntagme est figur. Si on entend dire dune personne quelle a les yeux plus grands que le
ventre, linterprtation la plus probable est au sens figur, ce qui revient dire que cette
personne prend trop manger en regardant les plats qui lui sont prsents. Pour que ce
syntagme ait un sens propre, il faudrait se retrouver dans un monde fictif ou devant une
personne trs difforme.
Une expression transparente est une expression dont on comprend le sens. Une expression
difficile (voire impossible) comprendre est opaque. Il semble raisonnable quun locuteur qui
entend pour la premire fois laffirmation il est heureux comme un poisson dans leau
nprouve pas de grandes difficults linterprter, tandis que lexpression il est haut comme
trois pommes peut poser des problmes de comprhension. Dans ce cas, haut comme trois
pommes serait plus opaque que heureux comme un poisson dans leau.
Dans notre dfinition, lanalysabilit repose surtout sur la structure dune phrase ou dun
syntagme. Il suffit de trouver la correspondance entre les mots composants et leurs
quivalents dans une interprtation de la phrase pour la classer comme analysable. Il nest pas
ncessaire de voir la motivation derrire chaque mot dun syntagme pour pouvoir dterminer
les contributions respectives de telle ou telle partie. Avec une telle dfinition, lexpression
avoir dautres chats fouetter se laisse analyser : le nom chat correspond choses et le
verbe fouetter faire. En revanche, une expression comme mordre la poussire est
inanalysable. Il ny a pas de mot qui corresponde tomber plus que les autres.
Ayant remarqu que de nombreux linguistes traitent les termes de ces dichotomies soit
comme interchangeables soit comme dfinitoires de la non-compositionnalit, nous avons
voulu les dcrire en dtail. Il sest alors avr non seulement quils diffrent les uns des
autres, mais aussi que les rles quils jouent pour la compositionnalit ne sont pas les mmes.
La non-motivation nous semble tre le critre le plus facile dfinir et utiliser. Sans
connatre le sens dune expression, il est impossible de dire quoi que ce soit de ces
caractristiques. Nous avons ainsi stipul que la non-motivation est le critre que nous
prfrons pour dfinir la non-compositionnalit.
Les expressions au sens figur peuvent tre motives ou non. Elle peuvent galement tre
transparentes ou opaques aussi bien quanalysables ou non. moins que lon ninsiste sur une
relation entre le sens figur et la non-compositionnalit, la dichotomie figur propre semble
tre celle qui a le rapport le plus faible avec la notion de compositionnalit.
Le problme le plus important en ce qui concerne la dichotomie opacit transparence est
quelle est plus difficile appliquer que les autres. Il semble raisonnable de supposer quune
expression motive est plus transparente quune expression non motive. Force est donc de
constater que la transparence est dpendante de la motivation. Tant que la dichotomie opacit
transparence est dfinie en termes assez floux, on doit donc utiliser le terme de motivation,
qui apporte plus de prcision.
En ce qui concerne lanalysabilit, finalement, nous avons constat que les expressions
analysables aussi bien que les expressions inanalysables peuvent tre motives. Ces deux
types dexpressions peuvent galement tre transparentes ou non.
98
Le principe sur lequel se basent la plupart des dfinitions est quun syntagme ou une
phrase qui se laisse dcrire par le terme ngatif dune (ou plusieurs) des dichotomies (non-
motiv, sens figur, opaque, inanalysable) est une expression fige. Ces notions
ngatives sont censes dcrire ce qui scarte de la norme, ce qui dvie de la langue
librement produite sans expressions prfabriques. Cependant, les expressions figes ne se
laissent dcrire obligatoirement par aucun de ces termes. On aura aussi remarqu quune
expression fige peut tre caractrise par le terme ngatif dune des dichotomies et en
mme temps par les termes positifs des autres dichotomies. videmment, aucune
expression fige ne peut tre dfinie simultanment par le terme positif et le terme ngatif de
la mme dichotomie. Lillustration suivante aide y voir plus clair :
Non-motiv Sens figur Opaque Inanalysable
Motiv avoir les yeux plus
grands que le ventre
avoir dautres chats
fouetter
ventre terre
haut comme trois
pommes
mordre la poussire
Sens propre ventre terre
Transparent avoir dautres chats
fouetter
sol comme un
Polonais
avoir les yeux plus
grands que le ventre
avoir dautres chats
fouetter
mordre la poussire
Analysable vendre la mche avoir dautres chats
fouetter
vendre la mche
lexception des termes dcrits jusquici, dautres notions se sont avres utiles lors dune
analyse de ces dichotomies. Pour pouvoir les dcrire en dtail il faut en effet reconnatre que
la compositionnalit dune expression peut tre partielle ou totale.
Il est galement ncessaire de faire une distinction entre le contenu lexical et la forme
grammaticale dun syntagme. Avec une telle distinction, on peut voir une motivation dans
une expression comme les carottes sont cuites en ce qui concerne la forme grammaticale du
verbe.
Finalement, on peut examiner les expressions figes dans une perspective atomiste ou
holiste. Le choix de perspective a des consquences sur linterprtation de lexpression en
question. La perspective atomiste dune expression est prise en compte lorsquon regarde
sparment chaque mot de lexpression, afin de dterminer leur contribution au sens. Une
expression examine dans une perspective holiste est considre dans sa totalit. Nous
traiterons la non-compositionnalit et son statut de critre de figement dans le chapitre 3.
99
2.4 Syntaxe marque
Nous traiterons par la suite des cas o la syntaxe scarte des formes les plus courantes. Nous
avons choisi de rassembler ces dviances sous le terme de syntaxe marque
296
.
La syntaxe marque est souvent associe aux expressions figes
297
. Or, cest une erreur
courante, nous semble-t-il, de rduire les expressions figes des constructions qui ne sont
pas conformes aux rgles syntaxiques. Il savre en effet que peu de rgles sont effectivement
violes et certaines constructions dites figes ou archaques sont en fait productives en
franais moderne. Nous allons prsenter les traits de la langue qui peuvent tre taxs de
fautes de syntaxe pour examiner ensuite sil y a effectivement un rapport entre la syntaxe
marque et le figement.
Pour reprer les anomalies syntaxiques, nous prenons comme point de dpart ce qui est
cens tre normal du point de vue syntaxique. Riegel et al. (1994:108) constatent, dans leur
Grammaire mthodique du franais, quil y a de nombreuses formes syntaxiques qui
correspondent lide que nous nous faisons dune phrase franaise . Ils constatent dautre
part que les squences suivantes, toutes reconnues comme des phrases, nont rien en commun
qui permette de dfinir directement les rgularits valant pour toute phrase :
(1) Je pense, donc je suis.
(2) Mon collgue, Klaus Willmann, de lUniversit de Kiel (dit pour prsenter
quelquun)
(3) Pourriez-vous me passer le sel, sil vous plat ?
(4) Un peu trop cuit, ton rosbif.
(5) Et ta sur ?
(6) Votre manteau (dit en prsentant quelquun son manteau)
(7) coutez la chanson lente dun batelier / Qui raconte avoir vu sous la lune sept
femmes / Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu leurs pieds (Apollinaire)
(8) Une petite clef tomba sur le trottoir. (Gide)
(Riegel et al. 1994:108)
tant donn cette diversit, il savre utile, comme le constatent Riegel et al. (1994:109), de
se doter dune structure canonique , ou, phrase de base , qui doit tre suffisamment
simple, facilement accessible lanalyse et nanmoins susceptible de servir de modle pour
lanalyse des autres structures de phrase . La phrase de base est cense tre assertive,
simple [] et neutre [...] . Ceci implique quelle nest ni ngative, ni emphatique, ni
passive, ni exclamative . La forme quils proposent est la suivante :
(CC) Sujet (CC) Verbe Complment(s)/Attribut (CC)
296
Dans le DLS (marqu) on lit :
On dit dune unit linguistique quelle est marque lorsquelle possde une particularit [...]
syntaxique [...] qui loppose aux autres units de mme nature de la mme langue. Cette unit
marque est alors le cas marqu dune opposition binaire o le terme oppos, priv de cette
particularit, est appel non-marqu.
297
Certains des exemples cits dans cette section seraient appels chez Moon (1998) illformed collocations ,
chez Botelho da Silva et Cutler (1993) syntactically ill-formed idioms et chez Fillmore et al. (1988)
extragrammatical idioms .
100
o (CC) reprsente le complment circonstanciel, facultatif et mobile .
La phrase (8), Une petite clef tomba sur le trottoir, est considre comme lexemple-type
de la phrase de base et classe comme une forme prototypique . propos de cette forme
prototypique, ils crivent :
La phrase canonique est gnralement assimile la phrase assertive simple, ce
qui revient considrer cette dernire comme la forme prototypique de la classe
de toutes les phrases. On peut aussi considrer que la phrase canonique est une
entit purement thorique dont la phrase assertive simple se trouve tre la
ralisation la plus immdiate et sans doute la plus frquente (Riegel et al.
1994:109).
La phrase canonique est un point de dpart pour pouvoir dfinir dautres phrases au moyen de
diverses modifications. Bien quil soit difficile, voire impossible, de trancher entre les phrases
qui seraient conformes ces modifications et celles qui seraient anomales , la syntaxe
marque est parfois considre comme un critre de figement. La difficult que prsente ce
critre est parfois reflte par une certaine confusion chez les chercheurs en ce qui concerne
sa relation ventuelle avec les expressions figes. M. Gross dit :
Nous montrerons quelles [les expressions figes] ne sont exceptionnelles ni par
leur syntaxe, ni par rapport au lexique. (M. Gross 1984:142)
[] les mots constituant les expressions figes sont assembls de faon
syntaxiquement correcte. (M. Gross 1984 :163)
[] la syntaxe des formes figes ne diffre pas de la syntaxe des formes libres
[]. (M. Gross 1984:172)
En revanche, Moon (1998:14) crit : FEIs [fixed expressions and idioms] are regarded as
exceptions to syntactic rules or as unique realizations of rules
298
. . Daprs G. Gross
(1996:22) [i]l reste, dans toutes les langues, des blocs erratiques, des lments ou
constructions qui remontent un tat de langue antrieur. Ces lments ont gard leur syntaxe
dorigine et apparaissent de ce fait comme extrieurs au systme actuel . Il fournit lexemple
chercher noise, que nous avons choisi de classer comme tant une expression contexte
unique plutt que comme un bloc erratique . Shapira (1999:10) appelle ce type
dexpressions figes des lments archaques de nature lexicale.
Il faut maintenant examiner, dune part, si les phrases prototypiques ne peuvent pas tre
figes, et, dautre part, si les phrases scartant du modle prototypique sont des expressions
figes. La premire question examiner, est de savoir si les phrases canoniques ou
prototypiques ne sont jamais figes. La phrase Le chien effrayait les enfants, considre
comme canonique, nest pas une expression fige. Dautres phrases non figes de construction
identique se laissent facilement trouver.
Une autre phrase, de construction identique, est Il mord la poussire :
298
Voir aussi Hudson (1998:8), qui cite, parmi des critres rcurrents des expressions figes anglaises,
Anomalous syntax or usage .
101
Aprs quatre ans seulement passs la Chambre, le dput dAustin croit stre
assez dmen pour briguer le sige snatorial libr par la mort, le 9 avril 1941,
du snateur Sheppard. Il mord la poussire. Il lui faudra attendre 1948 pour quil
dcroche son premier mandat snatorial. (MO 24 janvier 1973)
Les dictionnaires confirment que mordre la poussire est une expression fige. Il y a
effectivement des expressions figes, construites comme cette phrase-type. Nous pouvons
sans difficults citer plusieurs exemples, ayant la structure canonique :
Expressions figes : Squences non figes :
mettre les pieds dans le plat
299
lire la lettre dans le fauteuil
mordre la poussire boire le lait
les carottes sont cuites la pomme est pluche
La notion de productivit est oppos celle de syntaxe marque. Ainsi, les constructions
syntaxe marque ne seraient pas aussi productives que les constructions structure canonique.
La structure canonique , qui est considre comme normale et non marque, est lexemple-
type de la construction productive. Plus on sloigne de la structure canonique, plus on a
limpression que la syntaxe est marque. Plusieurs chercheurs ont soutenu que les expressions
figes sont des constructions non-productives : par dfinition, les expressions figes
napparaissent que dans un nombre restreint de formes syntaxiques , crit par exemple M.
Gross (1984:172). Il existe effectivement des expressions figes ayant une structure non-
productive, mais elles sont peu nombreuses. Citons titre dexemple Curat (1999:179), qui
conclut, propos de certaines expressions construction archaque, quelles ne sont plus
productives en franais moderne : [...] on ne peut plus construire des phrases sujet nus [du
type pierre qui roule namasse pas mousse ou ventre affam na point doreille] qui sous une
forme ou une autre sont fort anciennes, sinon en parodie archasante de proverbes, adages,
aphorismes et dictons anciens [...]. . Comme exemple de parodie archasante il cite Bire
qui mousse na plus de got
300
.
Les seuls exemples de syntaxe marque qui semblent tre en relation systmatique avec les
expressions figes sont labsence de dterminant et ladjectif employ comme adverbe. Il y a
quelques expressions figes avec une syntaxe marque qui diffrent des deux cas que nous
examinons
301
et qui ne se laissent pas organiser dans des catgories selon leur structure. Elles
ne font cependant pas partie de notre analyse systmatique de la syntaxe marque.
Il y a en outre des expressions figes qui ne sont pas concernes par nos deux cas de
syntaxe marque. Les expressions figes au doigt et lil
302
et entre la poire et le
fromage
303
ne manquent pas de dterminant. Le proverbe qui va lentement va srement et
299
Mettre les pieds dans le plat aborder une question dlicate avec une franchise brutale ; commettre une
gaffe (PR:pied).
300
Nous dirons que cet exemple est un dfigement. Voir 2.5.4 infra.
301
Cf. par exemple au jour le jour, bon gr mal gr, cote que cote, dores et dj et lchapper belle.
302
Au doigt et lil avec prcision (DEI:doigt).
303
Entre la poire et le fromage la fin du repas, quand on sexprime plus librement (DEI:poire).
102
lexpression y aller franchement sont deux exemples dexpressions figes o les adverbes
nont pas la forme dun adjectif.
2.4.1 Absence de dterminant
Lexemple baisser pavillon servira de point de dpart une discussion sur les carts ventuels
de la syntaxe normale. Dans PR, sous pavillon, on lit : loc. Baisser pavillon devant qqn :
savouer battu . Le critre de syntaxe marque peut-il tre utile pour reprer le caractre fig
de cette expression ? La syntaxe qui serait marque dans ce syntagme est le manque darticle.
Si un syntagme nominal sans article est rare ou mme fautif en franais, la syntaxe marque
peut effectivement servir de critre. Certes, il est normal de mettre un article devant le
substantif. On ne dit pas *lire livre, mais lire un livre, non plus *louer voiture mais louer une
voiture. De nombreux auteurs ont effectivement propos labsence darticle comme un trait
contribuant au figement. Ruwet affirme (Ruwet apud Picabia, 1983:157), propos des
expressions idiomatiques syntaxiques , quelles sont marginales dun point de vue
syntaxique et caractrises en gnral par une proprit syntaxique : labsence darticle devant
le N . Il numre les exemples rendre justice, prter assistance et avoir faim et continue en
crivant quil est clair que le dterminant zro devient de fait un critre dfinitoire des
expressions figes . Il en tire la conclusion que larticle est obligatoire en franais. Selon
Picabia (1983:57) il y a une corrlation couramment admise entre larticle zro et les
expressions figes. ce propos, Le Goffic (1993:23-24) dit : Certains noms communs se
trouvent employs seuls (avec dterminant zro) dans certaines structures plus ou moins
figes ou conserves par archasme [...] . Il cite les exemples: je viendrai avec plaisir (prp.
+ nom sans dterminant), prenez garde, noblesse oblige et bon chien chasse de race.
Gougenheim (1938:133) mentionne les locutions verbales et les locutions figes parmi
les divers types de constructions qui nont pas de dterminatif. Dans la Grammaire
mthodique du franais (Riegel et al. 1994:166) on lit : [b]eaucoup dexpressions
idiomatiques et proverbiales apparaissent comme des hritages de lancien franais, qui
marquait rgulirement par labsence de dterminant la rfrence virtuelle ou gnrique . Les
exemples cits sont : faire flche de tout bois
304
, remuer ciel et terre
305
, chemin faisant
306
, par
monts et par vaux
307
, pierre qui roule namasse pas mousse
308
et comparaison nest pas
raison
309
. Quant leurs exemples, on notera quils nomment explicitement les types
expressions idiomatiques et proverbiales et les appellent des hritages de lancien
franais .
Dans un passage de M. Gross sur les phrases entirement figes et [les] proverbes ,
larticle est, encore une fois, prsent comme un trait obligatoire devant les noms :
304
Faire flche de tout bois utiliser tous les moyens disponibles, mme sils ne sont pas adapts (PR:flche).
305
Remuer ciel et terre faire appel tous les moyens (pour obtenir qqch.) (PR:remuer).
306
Chemin faisant pendant le trajet (PR:chemin).
307
Par monts et par vaux LOC. par monts et par vaux : travers tout le pays ; FIG. de tous cts, partout
(PR:mont).
308
Pierre qui roule namasse pas mousse on ne peut senrichir en menant une vie agite (DEI:pierre).
309
Comparaison nest pas raison PROV. comparaison nest pas raison : une comparaison nest pas un
argument, ne prouve rien. (PR:comparaison).
103
Certains exemples de proverbes ont une structure syntaxique dviante ; dans
Pierre qui roule namasse pas mousse il ny a de dterminant sur aucun des deux
noms; or en rgle gnrale, les noms comportent un article, surtout en
position sujet [Cest nous qui soulignons]. Mais de nombreux proverbes sont bien
forms syntaxiquement, on ne peut donc pas les distinguer sur cette base (M.
Gross 1984:151).
Ainsi, labsence de dterminant est pertinente et mme, selon certains chercheurs, dfinitoire
des expressions idiomatiques, des locutions (verbales et/ou figes) ou des proverbes.
Mais mme si de nombreux syntagmes qui se retrouvent sans dterminant sont des
expressions figes, comme voir rouge, chercher noise et livrer bataille, il faudra admettre une
certaine productivit de ce genre de constructions
310
. On aurait tort de conclure quune
certaine construction serait toujours fautive ou anomale. Anscombre crit :
[...] dune part, les proprits syntaxiques invoques pour justifier lappellation
idiome , ne sont pas stables dans le corps des locutions verbales [...]. Dautre
part, ces locutions verbales article zro montrent une grande productivit, tant
lcrit qu loral. (Anscombre 1984:8)
Picabia (1983:157) constate que les termes didiomatique et de fig sont quivalents dans les
sources quelle a consultes
311
. Ensuite, elle crit : Si lamalgame entre idiomatique et fig
disparat, alors on pourra parler de constructions idiomatiques productives, comme cest le cas
des phrases en il y a X .
G. Gross rappelle lexistence dautres constructions qui nont pas de dterminant, sans
quil sagisse dexpressions figes :
Or labsence de dterminant devant un complment correspond des ralits
linguistiques trs diffrentes. Il peut sagir de rptitions dans le discours (Il a
perdu femme et enfants dans cet accident), de contraintes syntaxiques lies
certaines ngations (Il na ni courage ni raison) [...]. (G. Gross 1996:72)
propos de lancienne langue , Anscombre (1984:7) remarque qu un article zro de
lancien franais peut correspondre un article franais contemporain ou linverse . Labsence
darticle nest donc pas toujours interprter comme des rsidus de lancienne langue .
Dj en 1974, Bernard (1974:6) fait peu prs la mme remarque : [...] on na pas
attendre grand secours des explications dordre historique qui interprtent labsence darticle
comme le rsidu dun tat de langue antrieur, o lopposition article/ avait une autre
pertinence que maintenant .
Curat (1999:177-194) relve plusieurs cas dabsence de dterminant, dont un seulement
semble concerner les expressions figes, savoir celui quil appelle archasmes .
Notre question reste entire : le caractre fig dpend-t-il dune syntaxe aberrante ou non ?
Quoi que le rapport entre labsence de dterminant et le figement ne semble pas absolu, le
nombre dexpressions qui portent ce trait nest pas ngligeable. Bjrkman (1978) a examin la
310
Voir Picabia 1983 et 1986, Anscombre 1984 et 1986 sur article zro et Togeby 1982, pp. 75-77, sur avoir +
objet et faire + objet.
311
Il sagit de Ruwet 1982, dAnscombre 1982 et de M.Gross 1982.
104
coalescence verbo-nominale en franais
312
. La statistique tant une partie importante de
son travail, il a tabli une liste des locutions les plus frquentes en synchronie
313
. Parmi les 50
locutions les plus courantes, ce sont les deux verbes avoir et faire qui fournissent le plus
grand nombre doccurrences. Ainsi trouve-t-on, parmi ces exemples, 21 types de coalescences
avec avoir et 15 avec faire. 14 types sont des coalescences avec dautres verbes (rendre,
prendre, tenir, demander, donner et mettre). Avoir besoin est la coalescence verbo-nominale
la plus courante, avec 961 occurrences. Bjrkman (1978:25) constate que le nombre de verbes
formant ce type de locutions (il les appelle des verbes locutionnels ) est assez petit, et peut-
tre mme en train de baisser. Ainsi, dans les exemples quil a parcourus, 85% des exemples
sont forms avec une quinzaine de verbes, dont les plus courants sont justement faire et
avoir
314
.
Dans Norstedts Franska Idiombok [Le dictionnaire franais didiomes de Norstedts], qui
date de 1991, plusieurs des expressions cites sont des constructions coalescentes, et dans de
nombreux cas le verbe est soit faire soit avoir. Il y a galement des combinaisons avec dautre
verbes, o le syntagme nominal reste toujours sans dterminant : plier bagage
315
, fermer
boutique
316
, porter chance, perdre contenance
317
, dclarer forfait
318
, ne pas souffler mot,
baisser pavillon, menacer ruine
319
, refaire surface
320
, montrer patte blanche
321
, donner carte
blanche
322
, payer rubis sur longle
323
, prendre fait et cause
324
, rebrousser chemin
325
, mener
grand train
326
et tre bonne poire
327
. On remarque que dans les deux derniers exemples, il y a
une pithte devant le substantif. Dans les expressions la nuit porte conseil et ncessit fait
loi, ainsi que dans les phrases entires comme cest partie remise, il y a anguille sous roche et
qui ne dit mot consent, les sujets sont prsents dans lexpression cite.
312
Bjrkman utilise la mme dfinition du terme coalescence que Damourette et Pichon: une adjacence
dans laquelle il y a union intime entre le rgime et son rgent avec touffement de la valence du rgime et fusion
smimatique entre le rgime et le rgent (Damourette et Pichon apud Bjrkman 1978:8). Lorsquil sagit
dexemples lexicaliss qui ne demandent pas le terme exact de coalescence , Bjrkman se sert du terme
locution .
313
Voir Bjrkman (1978:12-14) pour les dtails sur les statistiques.
314
Les autres verbes formant des coalescences, parmi les 115 types les plus courants sont rendre, prendre, tenir,
demander, donner, mettre, prter, savoir, tenir, rebrousser, reprendre, trouver, tirer, lcher, porter et perdre.
315
Plier bagage LOC. [...] sen aller, partir (PR:bagage).
316
Fermer boutique - fermer, plier boutique : cesser de faire qqch., renoncer (PR:boutique).
317
Perdre contenance tre subitement dconcert, confus; se dmonter, se troubler (PR:contenance).
318
Dclarer forfait LOC. COUR. [...] annoncer quon ne prendra pas part une preuve. FIG. ne pas participer
la comptition, abandonner, se retirer (PR:forfait).
319
Menacer ruine risquer de tomber en ruine (PR:ruine).
320
Refaire surface LOC. FIG. [...] rapparatre aprs une priode dabsence (PR:surface).
321
Montrer patte blanche montrer un signe de reconnaissance convenu, dire le mot de passe ncessaire pour
entrer quelque part (PR:patte).
322
Donner carte blanche - MOD. LOC. donner, laisser carte blanche (qqn) : laisser (qqn) libre de toute
initiative dans laction ou le choix (PR:carte).
323
Payer rubis sur longle payer comptant, jusquau dernier sou et sance tenante (PR:rubis).
324
Prendre fait et cause - prendre fait et cause pour qqn, prendre son parti, le dfendre, le soutenir (PR:cause).
325
Rebrousser chemin - sen retourner en sens oppos au cours dun trajet (PR:rebrousser).
326
Mener grand train vivre dans un luxe ostentoire (PR:train).
327
Bonne poire - se dit dune personne facile duper (DEI:poire).
105
2.4.2 Adjectif employ comme adverbe
Comme le signalent Riegel et al. (1994:382), il y a des adjectifs qui, aprs un verbe,
semploient comme des adverbes. Cela est une particularit possible classer comme relevant
dune syntaxe marque. Cependant, ils dclarent que ce schma [est] trs productif en
franais moderne (Riegel et al. 1994:382). Si les adjectifs employs comme adverbes
appartiennent un schma productif, on ne devrait pas les utiliser uniquement dans les
expressions figes. Pourtant, les expressions suivantes sont cites sous ltiquette plus ou
moins figes : cuisiner gras, manger gras, manger sal, manger lger, manger chaud,
manger froid, voir double, voir trouble, voir clair, voir rouge (fig.), crire serr, crire large,
crire grand, crire petit, tirer (trop) court, tirer (trop) long, tailler large, tailler trop court et
tailler un peu juste (Riegel et al. 1994:382). Le sens des expressions contenant un adjectif
employ comme adverbe est souvent transparent, mme si ladjectif dans ces expressions na
pas toujours la mme fonction. Dans voir clair, par exemple, clair a peu prs le sens de
clairement et fonctionne comme un adverbe de manire. Dans les expressions cuisiner gras,
manger gras, manger sal et manger lger, lemploi de ladjectif est logique, vu quil ne
dcrit pas la manire de manger ou cuisiner mais plutt la qualit de ce qui est mang ou
prpar. Les expressions crire serr et crire large peuvent dcrire la manire et le rsultat
de laction en mme temps (si on crit dune manire serre, lcriture va tre serre). Le cas
de voir rouge est un peu spcial puisque lexpression a un sens figur.
Noailly (1999:148) constate que ladverbe peut tre trait comme un adjectif, mais quil est
plus courant demployer ladjectif comme adverbe. Selon elle, cet emploi de ladjectif est
considr comme marginal par les grammaires, qui citent toujours les mmes exemples, tels
que fort aimable, travailler dur et creuser profond. Noailly (1999:148) trouve ces exemples
rebattus et anciens . Or, elle affirme quun adjectif peut tre utilis pour modifier le verbe
et essaie dexpliquer cette utilisation. Les raisons demployer un adjectif peuvent tre, soit que
ladverbe en ment nexiste pas, soit quil existe mais na pas le sens de ladjectif
correspondant
328
. Dans le chapitre 4, nous examinerons de plus prs des adjectifs employs
comme adverbe ainsi que les raisons pour lesquelles ladverbe correspondant ladjectif nest
pas employ
329
.
2.4.3 Une chelle syntaxique
Une chelle syntaxique sera maintenant prsente pour montrer que les expressions figes y
sont reprsentes tout au long. Dun ct, nous plaons des exemples avec une syntaxe non
marque (on pourrait aussi dire frquente , productive ou encore normale ), avec
une structure grammaticale qui ne choque pas. De lautre ct il y aura des expressions dont la
syntaxe est marque. Plus on est pouss vers la droite de lchelle, moins la syntaxe est
productive ou usuelle. Entre les deux extrmes seront placs des exemples moins clairs.
328
Voir Noailly (1999:148-150).
329
Voir 4.4.1.2 infra.
106
Syntaxe non marque Syntaxe rare/peu productif Syntaxe marque
mordre la poussire il y a maldonne
330
baisser pavillon
il a perdu femme et enfants... plier bagage
il na ni courage ni raison sarrter net
Figure 20 : Lchelle syntaxique.
Nous voyons que les difficults quil faut aborder pour pouvoir dterminer si un exemple suit
les rgles normales de syntaxe ou non sont considrables.
Notre hypothse est que plus une construction est rare, plus on a tendance linterprter
comme fige
331
. Cela expliquerait la difficult de dcider si certains exemples sont figs ou
non. Une phrase ou construction qui nest pas typiquement fige mais qui ne se range pas
parmi les phrases canoniques non plus, est peut-tre en voie de lexicalisation.
Parmi les exemples rares (ou peu productifs) nous avons plac le type que G. Gross
(1996:72) appelle rptition dans le discours : Il a perdu femme et enfants dans cet
accident. Une rptition dans le discours est un type de construction o il serait possible
de citer les noms sans article, sans que cela soit bizarre ou incorrect. Or, une phrase similaire
comme Il a perdu cheval et vaches dans lincendie (notre exemple), serait-elle galement
accepte telle quelle, sans dterminants ? Si elle semble tre peu idiomatique pour un locuteur
franais, comment se fait-il que le mme problme ne se pose pas pour femme et enfants ?
Cela est peut-tre justement parce que la formule femme et enfants est en train de devenir
une unit fige. La construction se trouve entre la mmorisation et la gnration dun
syntagme libre.
En ce qui concerne les exemples il a ni courage ni raison , galement propos par Gross,
et il y a maldonne (ou mme il y a N , par Picabia), ils sont probablement assez
productifs. On pourrait affiner lhirarchie de lchelle, mais elle donne dans son tat actuel
une ide de la problmatique que nous voulons dcrire.
2.4.4 Rsum
La relation souvent voque entre une syntaxe peu productive ou mme aberrante et les
expressions figes nest pas absolue. Les traits marqus les plus rcurrents, en ce qui concerne
la syntaxe, sont labsence de dterminant et ladjectif employ comme adverbe. La difficult
de dcider si une syntaxe marque souffre dune anomalie ou si elle est en train de devenir
une construction productive dans la langue a t voque.
Mme si lutilit du critre syntaxe marque peut tre mise en question, il nous semble que
les constructions rares (ou peu productives) indiquent souvent quil sagit dune expression
fige. Le critre de syntaxe marque est donc efficace pour identifier un bon nombre
dexpressions figes, mme si la relation entre la syntaxe marque et le figement nest pas
absolue. En mme temps, le critre de syntaxe marque est loin dtre exhaustif, puisque de
330
Pour la construction il y a N, voir Picabia (1983).
331
Cela nexclut pas le fait quil existe des expressions dune syntaxe non marque, mais qui sont interprtes
comme figes par dautres raisons.
107
nombreuses expressions figes se laissent placer dans la structure canonique. Nous avons
propos lutilisation dune chelle syntaxique, pour rendre compte de la tendance suivante :
plus une structure syntaxique est rare, plus on a tendance interprter une expression
construite sur cette structure comme fige.
108
2.5 Blocage lexical
Lorsquil y a blocage lexical dans une expression, il y est impossible de remplacer un mot
lexical par un autre. Cette impossibilit existe mme quand un remplacement devrait tre
possible selon les rgles grammaticales. Il faut aussi tre conscient du fait que la formule il
est impossible de remplacer le mot X dans lexpression Y se laisse interprter de plusieurs
manires. Il importe de clarifier et de voir quelle interprtation est pertinente dans le cas
actuel. Nous pouvons formuler au moins trois interprtations possibles :
- la nouvelle suite de mots devient carrment incomprhensible lorsquun mot
lexical est remplac par un autre
- la nouvelle suite de mots nest pas conventionellement employe, mais
comprhensible
- la nouvelle suite de mots a un autre sens que lexpression dorigine, par exemple
si une expression au sens figur prend un sens propre (cela vaut donc galement
lorsquil sagit de synonymes ou dun autre mot dun mme paradigme)
Le critre de blocage lexical, trait implicitement ou explicitement par plusieurs
chercheurs
332
, semble tre important dans le domaine de la phrasologie. Notre objectif est
dtudier plus en dtail les diffrents risques que courent les expressions figes de devenir
impossibles lors dun remplacement dun mot lexical par un autre. Le phnomne de
blocage lexical est un problme facile reconnatre mais difficile dcrire, puisquil sagit de
conventions dusage dune langue. Ainsi, Nunberg et al. constatent propos du groupe
nominal center divider :
Of course a phrase like center divider applies in a perfectly literal way to its
reference, but it is used to the exclusion of other phrases that might do as well if
there were no convention involved, such as middle separator [...] (Nunberg et al.
1994:495)
Ils mentionnent aussi des syntagmes tels que industrial revolution, passing lane et gain the
advantage, qui sont transparents mais qui bloquent dautres syntagmes qui auraient pu tre
utiliss, sil ny avait pas eu de convention empchant leurs usages
333
.
Les difficults de savoir quelle est la manire conventionnelle dexprimer telle ou telle
notion font penser au termes encodage et dcodage
334
. Un idiom of encoding ne pose pas de
grands problmes de comprhension, tandis quil faut avoir appris le sens dun idiom of
decoding pour le comprendre ; son sens nest pas aussi facile dduire partir du contexte.
ce propos, la situation des apprenants de langues trangres est digne dintrt. Leurs
difficults ventuelles de comprhension sont parfois commentes dans la phrasologie
335
, et
souvent lorsquon voque la difficult des expressions sens figur. Cependant, en ce qui
332
Cf. par exemple Makkai 1972, Hussein 1990, Lorentzen 1994, Nunberg et al. 1994, Abeill 1995, Danell
1995, Gosselin 1996, Hudson 1998 et Videkull 1999.
333
Cf. aussi McIntosh (1961:325) : there are lexical factors [], which [] tend to rule out of actual use a
large number of sentences (and smaller units) even though these seem to conform to all the rules of
grammatical pattern .
334
Voir 1.2.2.1 supra.
335
Voir par exemple DEL [prface] 1993, Hausmann 1997 et Glich et Krafft 1997.
109
concerne les expressions au sens figur, elles ne prsentent pas forcment de difficults plus
grandes que dautres expressions. Il est probablement assez facile pour un apprenant de
souponner quil ne faut pas interprter une expression comme avoir les yeux plus grands que
le ventre au sens propre. En revanche, les difficults produire des phrases ou des expressions
correctes peuvent savrer importantes. Savoir quune combinaison parfaitement transparente
et comprhensible peut tre bloque par un autre syntagme qui correspond la manire
conventionelle dexprimer tel ou tel phnomne nest pas vident.
Il semble que la langue librement engendre soit normalement considre comme le cas
normal , et que les expressions figes sont considres comme lexception la rgle.
Dans le cas normal , les mots seront choisis selon le contexte mais pas imposs par la
langue et donc remplaables par dautres mots. Cependant, la convention va souvent jusqu
empcher les locuteurs de gnrer des constructions normales . Les blocages lexicaux
peuvent poser des problmes importants pour les apprenants dune langue trangre, quils
appartiennent la langue figure ou non.
2.5.1 Commutations
Nous commenterons quelques cas de blocages lexicaux, o certaines commutations sont
proscrites, conformment lusage. Nous avons choisi de prsenter les commutations en nous
basant sur les relations synonymiques et sur dautres relations paradigmatiques qui rvlent
des blocages lexicaux dans la langue.
2.5.1.1 Synonymes
Deux mots (ou plus) avec le mme sens et appartenant la mme catgorie grammaticale
336
deux synonymes devraient tre interchangeables dans une phrase ou dans un syntagme. Or,
la synonymie est une notion pineuse, et certains chercheurs refusent la notion mme de
synonymie. Misri (1987b:163) emploie le terme de parasynonymes : [] il est trs
difficile, voire impossible, de trouver de vritables synonymes, identiques en tous points.
Cest pourquoi, nous utilisons le terme de parasynonymes [] . La typologie des relations
synonymiques de Martin (1976:114) est pertinent dans ce contexte. Il distingue dune part la
synonymie absolue et la synonymie relative et dautre part la synonymie totale et la synonymie
partielle. Mme si la synonymie absolue nexiste pas en pratique, il dfinit une synonymie
absolue thorique. Ainsi, Martin (1976:114) propose : [] que a et b sont, dans un
environnement donn, des synonymes absolus sils ont le mme sens dnotatif [] et sils ont
[la] mme valeur connotative . Ensuite il dit de la synonymie relative quelle est due [...]
lidentit de la formule smique assortie dune diffrence de connotation (policier, flic ; livre,
bouquin) et la quasi-identit de la formule smique, tant entendu que cest l une
notion sur laquelle il y aurait lieu de revenir (fatigu, puis) (Martin 1976:114). Il dfinit
synonymie totale et synonymie partielle comme suit :
On dira que a et b sont des synonymes totaux si pour toute phrase p de la forme
XaY, XbY est une phrase q bien forme, paraphrase de p. Ainsi livre et bouquin
sont commutables dans tout environnement : ce sont des synonymes totaux. Au
336
Il faut galement prendre en considration des aspects tels que les conditions de vrit, le style et les
connotations, entre autres.
110
contraire ter et enlever ne sont pas interchangeables dans nimporte quel
contexte (Pierre est un bon commerant : il a fini par enlever laffaire ; Pierre a
enlev Marie la nuit du 4 aot) ; ce sont des synonymes partiels. (Martin
1976:115)
Nous pensons quil est pertinent pour la phrasologie dtudier des synonymes et les
possibilits ou impossibilits de les remplacer par dautres mots. Ce phnomne est parfois
tudi sous le terme de concurrence.
Le terme de concurrence mrite une attention particulire. Plusieurs tudes de
concurrence ont t effectues, dont un nombre non ngligeable par des linguistes
scandinaves
337
. Dans ces tudes, sont examines les possibilits de remplacer un mot ou une
construction par un autre. Ainsi, les emplois de deux variantes ou plus sont compars. Or, il
faut expliciter comment est utilis le terme de concurrence, discussion commence dj dans
les annes 50. Andersson (1957) mne une discussion sur le terme de concurrence dans
son compte rendu de Bostrm (1957). Andersson est davis que Bostrm se sert du terme de
concurrence l o il serait plus appropri de parler dopposition et quil devrait soit donner
une dfinition plus claire du terme, soit le changer. Bostrm dfend sa position comme suit :
Le terme concurrence exige quelques commentaires. Sil fallait lemployer
strictement, il ne serait utilisable que lorsque toute diffrence smantique nette
entre deux constructions serait absente. Si nous nous occupons ici galement des
cas qui diffrent dun point de vue smantique, cest cause de limpossibilit de
tracer une limite nette entre ceux-ci et ceux qui ne sopposent pas du point de vue
du sens. (Bostrm 1957:80)
Andersson soutient que Bostrm examine des oppositions qui diffrent smantiquement, ce
qui rend lusage du terme concurrence inappropri.
Dans les annes 70, Bjrkman (1978) et Lemhagen (1979) font rfrence la discussion
mene par Andersson (1957). Bjrkman (1978:61) ne critique pas aussi fortement
quAndersson ni la dcision de traiter des constructions qui diffrent dans leur sens, ni
lutilisation du terme concurrence, mais il commente le terme tel quel : Mme sil tait
possible de prouver lexistence de deux formes diffrentes pour un contenu identique, ces
formes ne seraient pas ncessairement en concurrence, terme qui semble indiquer une sorte
de vie organique inhrente la langue .
Si, dans ce travail, nous employons plutt le terme de commutation dans notre analyse des
possibilits de remplacement dun mot par un autre, cest pour viter dutiliser un vocabulaire
non seulement charg dinterprtations diverses, mais aussi impliquant ventuellement
que les mots auraient leur propre capacit de se faire concurrence, sans ncessiter
lintermdiaire dun locuteur. Toutefois, le terme de concurrence est employ par de
nombreux linguistes et nous lutilisons en faisant rfrence leurs travaux.
Ainsi Danell soutient, dans son tude du phnomne de concurrence (Danell 1995:115),
que les expressions figes sont essentielles pour la description de beaucoup de
337
Voir par exemple : Brant (1944), Westrin (1973), Persson (1974), Lemhagen (1979), Olsson (1986), Danell
(1995) et Videkull (1999).
111
concurrences . Il est par consquent plausible que les concurrences sont leur tour
importantes pour la description des expressions figes. Danell signale les blocages suivants :
Groupe fig Groupe bloqu
jour fri/ouvrable *journe frie/ouvrable
tous les ans *toutes les annes
toute la journe *tout le jour
Danell (1995:115)
Il commente ainsi le premier exemple : Les expressions jour fri/ouvrable semblent
bloquer *journe frie/ouvrable. Mais jour libre na pas ce pouvoir, puisque journe libre
reste permis (Danell 1995:115).
Dans le but dexpliquer lemploi des deux termes franais an et anne aux tudiants
norvgiens, qui sont obligs de choisir lun dentre eux pour traduire le mot r, Halmy
338
(1979) examine la distribution des deux mots, souvent dcrits comme des synonymes. Elle
mentionne que le problme se pose galement dans dautres langues germaniques. Ainsi,
Danell (1995:20) sest inspir de larticle de Halmy, et mne plus loin la discussion. Son
point de dpart est la rgle principale laquelle est arrive Halmy, savoir que dans la
majorit des cas, on pourrait conseiller aux tudiants norvgiens
339
demployer an aprs un
numral cardinal et anne partout ailleurs. Danell dcide deffectuer une tude empirique,
partir des exemples relevs dans un corpus informatis. Il (1995:24) conclut, en ce qui
concerne lemploi de la forme au pluriel, ans, que sur les 1355 occurrences de ans, il ny en
a que 9 qui manifestent une structure autre que chiffre + ans . Cela confirme la rgle
propose par Halmy. Danell constate que les occurrences qui font exception la construction
CHIFFRE + ans sont des expressions figes. Il sagit dexpressions comme au cours des ans, au
fil des ans et tous les ans, linstar de Danell, nous constatons que les exemples dans notre
corpus confirment cette dcouverte. En tout, il y a une seule occurrence avec toutes les
annes
340
et six avec tous les ans, dont voil trois exemples :
Mais les loisirs nen sont pas oublis pour autant : elle va rgulirement se
reposer la cte et passe tous les ans, un mois de vacances en France avec sa
mre, ses sures et leurs enfants. (LB871124)
Tous les ans, Lucas, qui compte aujourdhui cinq mille habitants sagrandit de
moiti. (ME 88 8:1)
Tous les ans, avec un dcalage de cinq ans, lInstitut national de statistique
publie un volume (1) contenant les relevs de la statistique criminelle du pays.
(LB860930)
338
Dans larticle de Halmy (1979), son nom de famille est crit avec . Pourtant, conventionnellement
Halmy est la forme utilise pour ce nom de famille.
339
Les tudiants sudois peuvent profiter du mme conseil.
340
Dans cette attestation, toutes les annes est suivi dune pithte. Vu que nous avons dans une large mesure
utilis le mme corpus que Danell, il nest pas tonnant que lexemple cit par lui soit le mme que celui que
nous avons pu lire dans notre matriel : Cologne accueille toutes les annes paires, lautomne, la Photokina
(LB860929).
112
Le syntagme tous les ans ne semble pas adhrer la rgle cite par Halmy et Danell. Non
seulement lexemple fait exception la rgle stipulant que ans est normalement prcd dun
numral cardinal, mais il est en outre impossible de remplacer ans par anne
341
(sauf si le mot
anne est suivi dune pithte). Il y a donc un blocage lexical qui opre dans ce cas.
Chez Gosselin, nous trouvons cette liste de blocages dans des expressions temporelles
342
:
Groupe fig Groupe bloqu
en dbut de (la) matine *en dbut de/du matin
en fin de (la) soire *en fin de/du soir
au milieu de (la) journe *au milieu de/du jour
au cours de (l)anne *au cours de/du an
Gosselin (1996:155)
Est-ce un hasard que le vocabulaire temporel semble souvent prsenter des cas de figement ?
part les blocages cits ci-dessus, Videkull et Lindgren (1989) prsentent de nombreuses
formes quils appellent phrases figes
343
, o seule lune des variantes jour/journe,
matin/matine et soir/soire est permise. Ainsi, la forme journe semble tre exclue des
expressions suivantes :
ce jour, ce jour-l, jour aprs jour, de jour comme de nuit, par jour, voir le
jour, lautre jour, chaque jour, le mme jour, se faire jour, au jour le jour, mettre
au jour, tous les jours, un de ces jours, ces derniers jours, en ces jours, ces
prochains jours, de nos jours, nos jours, les mauvais jours
(Videkull et Lindgren 1989:8)
Seule une des variantes matin/matine et soir/soire est possible dans les syntagmes suivants :
une grasse matine, en grasse matine, la grasse matine, en dbut de matine,
en fin de matine, en tout dbut de matine, ds le dbut de la matine, 9h 30
du matin, vers 2 heures du matin, ds 5 heures du matin, aux environs de 9h le
matin, les repas du matin et du soir, en fin de soire, dans le courant de la soire
(Videkull/Lindgren 1989:19-20)
G. Gross fournit des exemples de blocage des paradigmes synonymiques, entre autres :
Groupe fig Groupe bloqu
casser sa pipe *casser sa bouffarde
signer son arrt de mort *signer sa condamnation mort
manger son bl en herbe *manger (du, son) froment en herbe
341
Voir aussi 2.5.1.1 infra.
342
On peut objecter que plusieurs des paires mentionnes ne sont pas toujours considrer comme synonymes.
Or, le fait quelles prsentent un blocage lexical parat clairement lorsquon compare deux langues diffrentes. Il
y a dans certaines langues un seul terme qui couvre les deux termes franais. Dans les dictionnaires bilingues FO
(sudois-franais), ainsi que dans Collins French College Dictionary (anglais-franais), pour ne prendre que
deux exemples, les mots morgon et morning sont traduits par matin et matine . Il faut donc connatre
ce genre de blocages pour pouvoir utiliser ces noms correctement. Voir aussi 2.5.3 infra.
343
Il ne sagit pas de phrases entires : nous dirions plutt syntagmes figs.
113
Groupe fig Groupe bloqu
bout de force * fin de force
aller comme un gant *aller comme une moufle
(G. Gross 1996:17-18)
Les blocages lexicaux peuvent concerner des groupes de mots synonymes, pas seulement des
mots uniques. Hudson attire lattention sur le mme genre de blocages pour les expressions
temporelles en anglais
344
:
Groupe fig Groupe bloqu
a century ago *last century
a decade ago *last decade
last night *a night ago
yesterday *last day, *a day ago
an hour ago *last hour
a minute ago *last minute
a second ago *last second
Hudson (1998:7)
Videkull signale des blocages o apporter simpose et ne peut pas tre remplac par amener :
Groupe fig Groupe bloqu
apporter une pierre ldifice * amener une pierre ldifice
apporter une aide * amener une aide
apporter une rponse * amener une rponse
Videkull (1999:34)
2.5.1.2 Autres relations paradigmatiques
Les exemples que nous avons vus jusquici concernent donc la possiblit de remplacer un mot
par un synonyme. Mais le phnomne de blocage lexical peut aussi se prsenter dans dautres
relations paradigmatiques, o lon sattend ce quil soit possible de remplacer un mot soit
par un synonyme, soit par un autre mot de la mme catgorie grammaticale.
Certaines expressions figes acceptent des commutations. Les restrictions sur ces
commutations varient. Aucune commutation nest accepte dans les expressions figes avec
les restrictions les plus svres. Dans dautres, il suffit que la catgorie grammaticale reste la
mme pour quun mot puisse tre remplac par un autre.
2.5.1.2.1 Commutations libres
Lorsque les commutations sont libres, le mot remplaable/remplac ne fait pas partie de
lexpression. Dans lexemple, dun(-e) N lautre, il ne semble pas y avoir dautre restriction
que la catgorie grammaticale
345
:
344
Tous les groupes bloqus ne sont pas forcment impossibles utiliser. Cependant les groupes figs et les
groupes bloqus qui rsultent des remplacements cits ne sont pas synonymes et il faut savoir quand employer
quelle expression. Voir 2.5.2 infra pour une discussion de changements de sens.
345
Les autres noms dans lexpression dun(e) N lautre, relevs dans le corpus, sont (au masculin) : bout,
bunker, chapiteau, cinma, coin, engin explosif, tage, exercice, gouvernement, immeuble, intrim, jour, march,
114
dune anne lautre
dune branche lautre
dun an lautre
dun appareil lautre
Les expressions figes commutations libres peuvent tre discontinues
346
. Cela vaut pour
lexpression dun(e) N lautre puisque, le N nen fait pas partie, mais se trouve
obligatoirement insr entre dun et lautre
347
.
2.5.1.2.2 Commutations dans le mme champ smantique
Une expression qui admet quon varie un des mots qui en fait partie est SN prs, dont le SN
est remplac par dautres mots. Voil des exemples relevs dans le corpus :
cela prs
ceci prs
peu de choses prs
quelques exceptions prs
quelques variantes prs
dix suffrages prs
Dans la plupart des exemples de notre corpus, ce qui est reprsent par le syntagme nominal
SN prs dsigne une faible quantit de ce que dnote le noyau du SN
348
. Les variantes releves
sont :
1 ou 2 % prs, ceci prs, cela prs, cette diffrence prs, de notables
exceptions prs, de rares exceptions prs, des degrs prs, deux diffrences
prs, deux doigt prs, deux exceptions prs, deux genoux prs, deux
lettres prs, deux siges prs, dix suffrages prs, peu de chose prs,
quelques dtails prs, quelques exceptions prs, quelques points prs,
quelques variantes prs, quelques voix prs, un ou deux pour cent prs, un
paradoxe prs, un petit mtier prs et une voix prs.
Selon PR, (qqch) prs indique lcart, la diffrence qui spare le rsultat dune mesure de
la valeur relle de la grandeur mesure [...] (avec lide que la diffrence en plus ou en moins
est sans consquence) .
Certains groupes ayant la forme SN prs sont trs frquents, comme par exemple peu
prs, qui se traduit par un seul mot en sudois : ungefr.
mdecin, mdium, ministere, modle, moment, parti, pays, poste de travail, quartier, revendeur, soleil, stade,
tank et (au fminin) nergie, entreprise, extrmit, firme, forme, gnration, hrone, le, langue, ligne, uvre,
page, personne, phase, phrase, pice, rgion et tragdie.
346
Voir 1.2.5.2 supra.
347
Larticle indfini dpend du genre du N.
348
Le seul contre-exemple, dans lequel le syntagme nominal exprime plutt le contraire dune faible quantit est
beaucoup prs (avec de grandes diffrences, PR:prs), attest une fois.
115
mentionns, dautres ont un syntagme nominal qui comprend un nom prcd dun article
dfini ( la virgule prs). Les attestations que nous avons pu relever sont, outre la virgule
prs, la minute prs et la dsinence
prs.
Dans le syntagme en plein SN, le SN est commutable, mais le syntagme nominal semble
souvent tre constitu soit dun nom locatif (en plein centre), soit dun nom temporel (en
plein jour) soit dun nom dont la smantique implique une intensit ou un tat exceptionnel,
qui voque de forts sentiments (en pleine crise)
349
. Dans les exemples relevs dans notre
corpus, le SN appartient un des trois champs smantiques :
complments de lieu (surtout des villes)
en pleine ville, en plein Paris, en plein cur de [+ endroit], en pleine centre, en
pleine centre ville, en pleine centre de Louvain, en pleine centre dAnvers, en
pleine centre de la ville europenne, en plein Atlantique
complments de temps
en plein jour, en plein t, en plein hiver
expressions plus abstraites (connotes dune certaine intensit)
en pleine campagne lectorale, en plein conte de fe, en pleine controverse, en
pleine crise, en pleine effervescence, en plein essor, en pleine gloire, en plein
sommeil, en pleine vigueur
Le SN est donc variable, mais pas sans restriction. Le SN ne peut pas tre constitu par un nom
concret dans cette expression, ce quil parat (*en plein plancher, *en plein lit, *en pleine
table, *en pleine voiture).
Ce que Hudson appelle unexpected collocational restrictions within the expression est
un phnomne galement pertinent pour le critre de blocage lexical :
first of all *second of all
above board *below board
disaster area *catastrophe area
how do you do *how do they do
(Hudson 1998:8).
On voit parmi ses exemples diffrentes espces de blocage : synonymes (disaster
catastrophe), paradigmes (you they) et mots du mme champ smantique (first second,
above below).
Elle cite aussi des exemples dans lesquels les mmes mots peuvent tre remplacs sans
problmes : first in line second in line, above standard below standard, major disaster
major catastrophe, how do you do it? how do they do it?.
349
Comme dautres adjectifs, plein sadapte au genre du substantif qui le suit.
116
Le syntagme sn prs comporte des expressions de deux types. part les exemples dj
2.5.1.2.3 Commutations hyponymiques
Dans les phrases libres, un remplacement dun mot par un hyponyme ou un cohyponyme
change linformation donne (ou la prcision de linformation), mais la phrase reste possible,
grammaticalement correcte et interprtable. Ainsi, les phrases suivantes sont
grammaticalement correctes. Que linformation donne soit correcte ou non dpend dautre
chose que de la phrase en soi :
Jai un animal domestique.
Jai un chat.
Jai un chien.
Jai un caniche.
Jai un teckel.
Plus il y a de restrictions sur les commutations possibles dans un syntagme, plus on se
rapproche du figement. Les collocations restrictives constituent des cas qui se trouvent mi-
chemin entre les phrases libres et les expressions figes
350
. Nous avons vu, par exemple, que
gravement se combine avec dautres mots que malade dans notre corpus
351
, bien que cela soit
contest dans Riegel et al. (1994) :
gravement handicap
dficitaire
brl
prjudici
intoxiqu
bless
Les six variantes ne dcrivent pas forcment un tat de maladie, mais reprsentent toutefois
un manque ou un tat qui peut tre interprt comme peu souhaitable. Le mot dficitaire ne
dcrit pas un corps affect, mais bien un manque ou quelque chose de ngatif
352
. Les
collocations qui contiennent le mot gravement sont partiellement bloques, puisque les
commutations possibles sont limites.
Lemploi de mots contextes limits est encore plus restreint. La signification du mot be
est peu prs grand ouvert. Pourtant, dautres noms reprsentant des objets qui se laissent
ouvrir ne se combinent pas avec be, qui ne semble semployer quavec bouche ou gueule :
*porte be, *fentre be, *armoire be. Dans ces cas, il faut utiliser les mots ouvert ou bant.
2.5.1.2.4 Variantes sans commutation
Un exemple qui semble constituer un cas particulier est lexpression bon N
1
mal N
1
. Dans
cette expression, les seuls noms possibles sont an et gr. Ils ne semblent pas partager de
caractristique smantique et ne font donc pas partie du mme paradigme. Or, on ne peut pas
dire quil sagit dune commutation, comme dans lexpression dun N lautre, o il ne
semble pas y avoir de restrictions sur le syntagme nominal. En fait, il sagit de deux
350
Voir 1.2.2.3 et 2.2.6.1 supra.
351
Cf. 2.2.6.1 supra. Notons aussi quil existe des exemples ou gravement modifie un verbe : entraver
gravement, affecter gravement et mettre gravement en pril.
352
Grivement se combine galement avec brls et atteints dans le corpus (voir supra 2.2.6.1).
117
expressions figes qui nacceptent pas dautres variantes. Elles sont donc entirement
bloques
353
.
2.5.2 Sens figur et sens propre
Les restrictions sont particulirement saillantes dans les expressions sens figur. Les phrases
permettant dexemplifier les commutations hyponymiques et co-hyponymiques sont
grammaticalement correctes et interprtables, mais un simple ajout du syntagme dans la
gorge rend la plupart de ces phrases tranges :
Jai un animal domestique. *Jai un animal domestique dans la gorge.
Jai un chat. Jai un chat dans la gorge.
Jai un chien. *Jai un chien dans la gorge.
Jai un caniche. *Jai un caniche dans la gorge.
Jai un teckel. *Jai un teckel dans la gorge.
une exception prs, elles sont difficiles interprter aprs un tel changement. La deuxime
phrase se distingue des autres, videmment parce quavoir un chat dans la gorge
354
est une
expression fige, qui a un sens figur, tabli et connu par de nombreux locuteurs. Le mot chat
ne se laisse pas remplacer facilement par dautres mots. Nombreux sont ceux qui ont
comment cette diffrence entre les expressions figes sens figur et les phrases libres
355
.
Abeill crit par exemple :
Substitution of a synonym for an idiomatic part does not preserve the idiomatic
meaning of the expression. For example, in the French idiom manger ses mots to
mumble (lit. to eat ones words), one cannot replace mots with paroles without
losing the idiomatic meaning : # manger ses paroles
[356]
. (Abeill 1995:15-16)
Nous avons constat que les expressions sens figur ont un comportement particulier. Mais
le critre de blocage lexical est-il pertinent uniquement pour les expressions sens figur ?
Abeill soutient quon ne peut pas remplacer un mot par un autre sans perdre le sens
idiomatique. Est-ce que, dans les expressions de ce type, le mot nest pas remplaable du
tout ? Ou bien, change-t-on le sens en le remplaant ? Selon Abeill, lexpression nest plus
idiomatique aprs le remplacement. Ceci tant vrai, il faut aussi reconnatre que le sens nen
est pas non plus littral, puisquon ne peut pas littralement manger ses paroles . Il est vrai
que la formule manger ses paroles ne semploie pas, mais nous allons voir que le critre
de blocage lexical a galement des consquences pour les phrases ou syntagmes au sens
propre.
353
Voir aussi infra 4.2.2.
354
Avoir un chat dans la gorge tre enrou (PR:chat).
355
Voir par exemple Denhire et Verstigel (1996), qui rend compte dexpriences faites sur linterprtabilit de
variantes didiomes. Cf. aussi Gibbs (1980:282-283).
356
Abeill emploie le symbole # pour indiquer quil nest pas possible demployer le syntagme avec
linterprtation idiomatique dsire.
118
Il y a des exemples de commutations, o deux variantes (ou plus) existent, mais changent
de sens selon le contexte. Considrons les exemples douche cossaise
357
et omelette
norvgienne
358
, proposs par G. Gross (1988:66). Il nous semble vident que dans la mesure
o on parle de nationalit ou de rgion gographique, les variantes suivantes restent
permises :
norvgienne de Norvge nordique
cossaise de lcosse du Royaume Uni
Les restrictions imposes sur omelette norvgienne, sont, videmment, dues au sens trs
spcifique (et opaque pour le locuteur qui ne connat pas le dessert en question) qui merge
lorsque ces deux mots sont juxtaposs. Si lon parlait vraiment dune omelette, faite en
Norvge, la formule omelette de Norvge , semploierait trs bien.
Notons que le blocage va dans les deux directions. Si lobjet dont on parle est un dessert,
glac lintrieur, la suite omelette norvgienne est la seule quil est permis demployer. En
revanche elle reste, justement cause de ce sens trs spcifique, prohibe pour les autres
emplois du mot omelette.
Groupe fig lorsque lomelette est
un dessert
Groupes bloqus lorsque lomelette est
un dessert
omelette norvgienne * omelette de Norvge
* omelette nordique
* omelette cossaise
* omelette franaise
Groupes possibles lorsque lomelette
est une omelette au sens propre
Groupe bloqu lorsque lomelette
est une omelette au sens propre
omelette de Norvge * omelette norvgienne
omelette nordique
omelette cossaise
omelette franaise
Ayant constat que les syntagmes au sens propre peuvent tre concerns par un blocage
lexical, il faut avouer que la raison en est quils sont, dans les cas examins dans cette section,
bloqus par une expression fige. Cependant, noublions pas que les suites de mots sens
propre peuvent bloquer une autre combinaison quil devrait tre possible dutiliser selon les
rgles combinatoires. Un syntagme transparent et motiv peut en bloquer un autre, rien que
par convention.
357
Douche cossaise alternativement chaude et froide ; FIG. parole, vnement trs dsagrable qui suit
immdiatement une parole, un vnement trs agrable (PR:douche).
358
Omelette norvgienne dessert compos de glace, de meringue et de gnoise, chaud lextrieur et glac
dedans (PR:omelette).
119
2.5.3 Traductions
Dans un article sur lapprentissage des collocations anglaises par des apprenants jordaniens,
dont la langue maternelle est larabe, Hussein (1990:123) signale, avec presque les mmes
mots que Wilson (1972:127-128), que unfortunately joining words which are semantically
compatible does not always produce an acceptable co-occurrence . Les idiomes constituent
un problme pour les tudiants, parce quils doivent tre appris en bloc : The attempt to
construct them by joining semantically compatible items is invariably doomed to failure
(Hussein 1990:127). Entre autre, il cite les erreurs suivantes :
quicksand *moving sand
wear make up *put make up
black eye *red eye
cold blood *hot blood
benefit of the doubt *merit of the doubt
blind date *blind meeting
(Hussein 1990:126-127)
Les mots anglais many et sudois mnga peuvent prsenter des problmes de traduction en
franais. Normalement, many / mnga peut tre exprim par beaucoup de en franais.
Cependant, Danell (1993:88) signale limpossibilit de dire *il est rest beaucoup dannes et
propose que cette faon de sexprimer est bloque par dautres constructions telles que de
nombreuses annes ou de longues annes. Lorentzen (1994:355) constate galement quil faut
prendre certains blocages en considration lorsquil sagit demployer bien des ou beaucoup
de : si, dans la grande majorit des cas, on pourrait facilement changer beaucoup de contre
bien des et vice versa, il existe des contextes o lusage sest fig (Lorentzen 1994:359).
Certaines suites de mots ne posent pas de problmes de comprhension. En revanche, ces
mmes suites de mots ne sont pas toujours faciles traduire. La traduction mot mot dune
langue une autre ne rsulte pas toujours en une formule correcte, si transparente et
acceptable quelle paraisse. Les difficults de production sont plus considrables lorsquil y a
un blocage lexical auquel il faut prter attention. titre dillustration, nous ferons ici une
comparaison entre le franais, langlais et le sudois de quelques groupes de mots qui nous
semblent transparents au niveau de la comprhension :
Franais Anglais Sudois
le chanon manquant the missing link den felande lnken
le chanon manquant le chanon qui fait erreur
fausse alerte false alarm falskt alarm
fausse alarme fausse alarme
clibataire endurci confirmed bachelor inbiten ungkarl
clibataire confirm clibataire invtr
couper lapptit take away a persons appetite frstra aptiten
enlever lapptit de qqn dtruire lapptit
120
En franais on dit avoir le cur sur la main
359
, tandis quen sudois il y a une expression
similaire handen p hjrtat
360
(litteralement la main sur le cur, et non linverse !). Une
traduction littrale de lexpression avoir le cur gros
361
donne en sudois peu prs ha stort
hjrta, ce qui veut dire tre gnreux.
Les mots qui ne se traduisent pas constituent une autre difficult dans les traductions. Cette
difficult peut tre exemplifie par les mots sudois samma (le/la mme) ou anglais
the same (le/la mme). Le problme qui se pose est que ce mot se traduit parfois, mais
pas toujours. La prsence de mme ne gne nullement dans les exemples suivants, qui sont du
type PRPOSITION + ARTICLE + mme + NOM :
On en arrive ce paradoxe que deux Juifs conscients de leur judit ne peuvent
plus manger ensemble la mme table, parce que lun accepte de se soumettre
une discipline alimentaire prescrite par la loi et lautre ne lui reconnat plus
aucun sens. (SO880402)
Nous sommes confronts au mme dfi queux, exporter pour nous dvelopper
[...]. (SO880401)
En sudois la mme table est exprim par vid samma bord, en anglais at the same table. On
dit samma utmaning / the same challenge pour le mme dfi. Or, les syntagmes sudois p
samma gng et anglais at the same time, construits en analogie avec les exemples prcdents,
sexpriment en franais soit par la fois, soit par en mme temps. La diffrence entre ces
expressions est que temps se combine avec mme , tandis que la possibilit de dire *
la mme fois, semble exclue, ce qui est probablement d un figement et donc un blocage
lexical, qui permet uniquement la fois. Dans notre corpus, il ny a pas dexemple o mme
se trouve ct de fois. En revanche, il y a 466 occurrences du syntagme la fois :
[] car les cranciers nen exigent point tous la fois le remboursement [...]
(ME 87 48:1)
[...] puisquil fallait la fois lutter contre linflation, rduire le chmage et
conserver des devises au pays. (SO880401)
Ces tentatives naboutirent pas, car les deux centrales se heurtaient la fois sur
des questions de mthode et sur leur orientation politique, pendant que les conflits
de personnes achevaient denvenimer les rapports. (MO 12 fvrier 1955)
2.5.4 Dfigement un phnomne inverse du blocage ?
Le terme de dfigement commence stablir dans les tudes phrasologiques
362
. Sullet-
Nylander introduit le terme dans le contexte des jeux de mots :
[] lun de ces procds consiste redonner vigueur des locutions, des mots
composs, des proverbes, voire dautres titres duvres. Nous appellerons ces
359
Avoir le cur sur la main tre gnreux (DEI:cur).
360
Handen p hjrtat la main sur la conscience (FO:hjrta).
361
Avoir le cur gros prouver du chagrin (DEI:cur).
362
Voir G. Gross (1996:19-21), Rastier (1997) et Sullet-Nylander (1998:204-235).
121
locutions et autres noncs formant une unit des figements, et les jeux de mots
bass sur ces figements, des dfigements. (Sullet-Nylander 1998:204)
G. Gross (1996:20) caractrise galement le dfigement comme un jeu : [] le figement
peut tre mis en vidence grce leffet provoqu par le jeu du dfigement, qui consiste
briser le carcan qui caractrise les suites figes. Le dfigement consiste ouvrir des
paradigmes l o, par dfinition, il ny en a pas .
Pour nous, le dfigement est un procd qui se base sur le critre de blocage lexical tant
donn que cest le fait mme que le locuteur connat dj lexpression dorigine (et quelle est
normalement bloque), qui rend le jeu de mots russi. Autrement dit, sil ny avait pas dj
une expression modifier, on ne pourrait pas y faire allusion
363
.
Dautres chercheurs commentent galement le procd de dfigement, bien que ce terme
ne soit pas employ
364
. Dans ltude de Heinz (1997:213) sur les -peu-prs (APP), le
terme dAPP peut faire rfrence aux dfigements, mais aussi dautres dformations dune
locution de base , comme elle les appelle. Ainsi, si ce que nous appelons dfigement est un
procd dont le rsultat est un dtournement dune locution de base, leffet recherch est
pourtant conscient chez le locuteur. LAPP, en revanche, est soit un jeu de mots, soit le
rsultat dun lapsus (Heinz 1997:220).
Sullet-Nylander (1998:210) divise les figements en deux groupes : figements
linguistiques et figements culturels . Elle classe les locutions et les mots composs ainsi
que les proverbes comme des figements linguistiques . Ils sont exemplifis par les
exemples (1-5) ci-dessous. Les exemples (6-11) sont, selon elle, des figements culturels ,
puisquils font rfrence des titres duvres tels que des pices de thtre, des missions
tlvises ou des chansons. Ici, elle place aussi des phrases entires mmorises, telles que
des paroles de chansons ou de prires, pour en mentionner quelques exemples. Regardons,
titre dexemple les dfigements suivants, qui se trouvent dans des titres de presse :
Figements linguistiques Dfigements
(1) prendre dassaut Serge prend Dassault (30 oct 1986)
(2) avoir lme en peine Lme en Penn (1-2 nov 1986)
(3) avoir du vague lme De la vague lme (12 nov 1986)
(4) perdre ses facults (mentales) Monory perd ses facults (25 nov 1986)
(5) Mieux vaut tard que jamais Mieux vaut Tardieu que jamais (29 avril 1986)
363
Cela correspond peu prs ce qui est exprime par G. Gross (1996:20).
364
Cf. Misri (1987b:17, 413-421). Voir aussi Grunig (1997b:236) : Tous ont en commun quils donnent lieu
des dtournements ludiques. [...] Si le dcalage ludique se fait [...] cest bien que les syntagmes dtourns sont
disponibles en mmoire .
122
Figements culturels Dfigements
(6) En attendant Godot En attendant Godart (24 mai 1986)
(7) Cris et chuchotements Crins et chuchotements (5 oct 1986)
(8) Ltre et le nant Ltre et le non (25 nov 1986)
(9) Au thtre ce soir
(titre dune mission tlvise des annes
1970-1980)
Haut thtre ce soir (19 janvier 1987)
(10) Nous nirons plus au bois, les
lauriers sont coups
(phrase de chanson enfantine)
Nous nirons plus aux dunes, les bunkers
sont rass (20 juin 1986)
(11) Notre pre qui tes aux cieux
(prire)
Notre pape qui tes Lyon (5 oct 1986)
(Du journal Libration
365
, daprs Sullet-Nylander 1998:209-210)
Mme si la langue permet de ne pas toujours suivre strictement les rgles, elle naccorde pas
une libert totale. Pour des jeux de mots, il y a galement des normes. Pourtant, ces normes ne
sont pas clairement formules. Si on sloigne trop de ces normes ou de ces codes, que lon
partage avec ses interlocuteurs, le dfigement ne sera pas russi. Les interlocuteurs ne vont
pas comprendre le message entendu. Soit le dfigement passe inaperu, soit il sera mal
compris et pris pour une faute ou une incohrence.
Pour quun dfigement soit russi, il faut donc que lexpression dorigine soit voque,
mme si ce nest que par association. Cette association peut se faire par lintermdiaire dune
ressemblance phonique ou rhytmique, comme dans les exemples 1-9 ci-dessus. Or, avec une
locution de base suffisamment connue, une ressemblance phonique nest pas ncessaire. Selon
la convention, cest dans la choucroute, dans la semoule ou dans le yaourt que lon pdale, si
on a certaines difficults
366
. Or, nous avons relev un cas de dfigement, dans lequel lauteur
de larticle fait rfrence la nationalit des joueurs de foot :
Les Milanais de Scifo ont pdal dans les spaghettis avec un cur admirable.
(LB871127)
G. Gross (1996:20) constate, linstar de Sullet-Nylander, que les proverbes sont des sources
possibles de dfigement. Il cite lexemple Aide-toi, lAgha Khan taidera
367
, qui est un
dfigement de Aide-toi, Dieu taidera
368
. Il y a des dfigements de la mme origine dans le
corpus :
A la limite, on pourrait prtendre que lEtat leur dit : Aide-toi car bientt
personne ne taidera. . (MO avril 1986)
365
Selon Sullet-Nylander (1998:204), le journal Libration pratique beaucoup le procd de dfigement dans ses
titres.
366
Pdaler dans la choucroute (dans la semoule, dans le yaourt) faire des efforts dsordonns et vains, se
dpenser en pure perte (DEL:pdaler).
367
Il dit lavoir emprunt Fr. Cabasino (La Sapienza, Rome).
368
Ce proverbe date de 1456. On retrouve galement la variante Aide-toi, le Ciel taidera , qui provient de La
Fontaine, Fables, VI (DPM:aider soi-mme).
123
Mais Peugeot fait aussi appel ses salaris : aide-toi et lentreprise taidera.
(ME 87 33:1)
Il nest pas rare, on la vu, que lon emploie des dfigements dans les titres. Dans les titres des
deux livres Des mots et merveilles de Gagnire (1994) et Mots et Merveilles de Kibdi Varga
et Bertho (1995), on voit nettement la ressemblance avec lexpression promettre monts et
merveilles
369
.
Par leur caractre unique, les expressions contenant des mots contexte unique ou limit,
doivent se prter merveille ce genre de jeu de mots. Ainsi, DEL (for) donne lexemple
dans ma Ford intrieur, ce qui est un cas de paronymie
370
, form sur la ressemblance dans
mon for intrieur.
2.5.5 Rsum
Il est, dans bien des cas, impossible de remplacer un mot par un autre, l o cela devrait tre
possible, tant selon la smantique que selon les rgles syntaxiques et grammaticales. Il est
important de noter que, dans ce contexte, la formule il est impossible de remplacer le mot X
dans lexpression Y , na pas seulement une interprtation. Elle peut en effet avoir au moins
trois significations : soit la nouvelle expression devient incomprhensible lors dun
remplacement, soit le sens change, soit lexpression nest ni incomprhensible ni na chang
de sens, mais nest pas conventionnellement employe dans la nouvelle forme. Nous
constatons donc quune expression, si correcte et comprhensible quelle soit, peut tre
bloque par une expression conventionnelle.
Le terme de commutation est employ pour parler du remplacement dun mot par un autre.
Les commutations des synonymes ont t les premires tre examines. Le blocage de
synonymes dans les expressions temporelles semble tre courant. Parmi les exemples
dexpressions synonymes soumis un blocage lexical, il y a entre autres jour fri et jour
ouvrable, qui bloquent les suites *journe frie et *journe ouvrable; il y a en dbut de (la)
matine qui bloquent *en dbut de/du matin ; jour aprs jour qui bloque *journe aprs
journe et la grasse matine qui bloque *le gros matin. Cependant le blocage lexical nest pas
prsent uniquement dans des expressions temporelles. Dautres exemples sont apporter une
pierre ldifice et apporter une aide, expressions dans lesquelles le verbe apporter nest pas
remplaable par amener, bien que les sens de ces deux verbes soient proches les uns des
autres dans certains contextes.
Dans les cas o un mot ou un syntagme se laisse remplacer par nimporte quel autre mot, le
mot commut est libre et ne fait pas partie de lexpression en question. Certaines expressions
acceptent des commutations mais avec des restrictions sur le mot remplac. Les restrictions
peuvent tre plus ou moins svres. Les restrictions dans les expressions dont nous avons
examin le blocage lexical imposent par exemple aux syntagmes remplaants de dsigner une
faible quantit ( N prs) ou de faire partie dun certain champ smantique (en plein/-e N).
369
Promettre monts et merveilles promettre des avantages considrables, des choses merveilleuses
(DEL:mont).
370
Les paronymes sont des mots qui prsentent des ressemblances phoniques, sans que la ressemblance doive
pour autant tre totale Cf. Heinz (1997:218).
124
Dans certaines expressions il ne semble pas quil y ait de restrictions, par exemple dans dun
SN lautre, o lon trouve des syntagmes nominaux de caractres trs divers.
Ensuite, notre attention a t attire sur les effets du blocage lexical sur le sens figur et le
sens propre dune suite de mots. Nous avons montr que le phnomne de blocage lexical
concerne les expressions figes aussi bien que les syntagmes libres. Ainsi, il y a des
expressions sens propre qui bloquent dautres expressions sens propre, des expressions
sens figur qui bloquent des expressions sens propre et des expressions sens propre qui
bloque des expressions sens figur.
Limportance du critre de blocage lexical est particulirement vidente lors des
traductions. Nous avons explicit linfluence du blocage lexical sur la traduction mot mot ou
sur les mots qui ne se traduisent pas.
Finalement, nous avons stipul que le dfigement peut tre considr comme un procd
dont lexistence dpend du phnomne de blocage lexical. Le dfigement est le choix
conscient quun locuteur fait de modifier une expression fige de faon ce quun
interlocuteur reconnaisse la ressemblance lexpression dorigine. Il sutilise entre autres
dans les slogans publicitaires, comme dans tout feu tout femme (dfigement de [tre] tout feu
tout flamme
371
) par France Paul Boutique (Grunig 1990:118), ou mettez-vous Martell en tte
(se mettre martel en tte) par Martell
372
.
371
tre tout feu, tout flamme manifester une grande ardeur (DEI:feu).
372
Marque de cognac.
125
2.6 Blocage grammatical
Le blocage grammatical dun syntagme est constitu par limpossibilit de modifier le genre,
le nombre ou le temps des mots constituants dune expression ainsi que par limpossibilit
deffectuer des tranformations telles que la relativisation, la passivation, la pronominalisation
ou la permutation.
Cependant, la langue ne se laisse gure dcrire par une division strictement bipartite entre
les expressions qui ne sont pas concernes par le blocage grammatical (flexibles) et les
expressions concernes par ce blocage (donc inflexibles). Tout comme la syntaxe marque, le
blocage grammatical peut tre reprsent sur une chelle.
Nous examinerons ici le rapport entre le blocage grammatical et le figement. Nous avons
dit que notre emploi du terme dexpression fige repose sur le trait mmoriel et que ce terme
runit toutes les expressions reconnues comme des units conventionnellement utilises
373
.
Quune expression fige soit vraiment fige au niveau syntaxique et donc bloque
grammaticalement, nest pas prsuppos. Il se peut quune expression fige ne soit pas
concerne par un blocage grammatical ou restreinte au niveau smantique. Le degr de
figement est dans ce cas zro dans le sens de G. Gross (1996:16-17)
374
. Une telle expression
serait, selon nous fige (parce quelle est mmorise) tout en tant flexible.
2.6.1 Blocage morphologique
Lorsque les possiblits de changer le genre, le nombre et le temps des mots individuels dans
un syntagme sont limites, il importe de rflchir sur lorigine de ces restrictions.
videmment, ce sont les restrictions imposes par la langue plutt que par la situation dcrite
qui nous intressent. Dans ce qui suit, nous prsenterons une discussion sur le blocage
morphologique, partir dexemples concrets en commenant par les restrictions de genre.
Les mots concerns par le genre sont de plusieurs types. Il y a les noms, les adjectifs, les
pronoms et certaines formes de verbes (les participes). Ils se combinent normalement partir
de rgles bien prcises et les restrictions ventuelles sont imposes par le vocabulaire. Ainsi la
plupart des noms sont soit masculin soit fminin
375
et les locuteurs ne changent pas le genre
de ces noms selon leur propre volont. En ce qui concerne les adjectifs qualificatifs, les
restrictions sont dune autre nature. Ce nest pas ladjectif en soi qui est fminin ou masculin,
mais il saccorde avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Or, parmi les exemples
contexte unique
376
retenus, on trouve des adjectifs employs uniquement en combinaison avec
un substantif prcis. Les exemples suivants dexpressions contexte unique, avec un adjectif
qui ne sutilise pas librement, ont t comments auparavant
377
. Ces formes sont attestes
uniquement comme des formes fminines :
373
Voir 1.2.1 supra.
374
Cf. aussi Misri (1987b:211-218).
375
Il existe des lexmes deux formes, cf. par exemple ouvrier/ouvrire et directeur/directrice. En revanche, les
mots comme un voile, une voile, un tour, une tour etc., avec deux formes qui se ressemblent, ne reprsentent pas
une flexion en genre mais des lexmes spars.
376
Voir 2.2 supra.
377
Cf. aussi les exemples d affinits slectives de Riegel et al. (1994:123), 2.2.6.1 supra.
126
be (bouche be, gueule be) *b
gamme (croix gamme) *gamm
trmire (rose trmire) *trmier
Lorsque nous disons que les formes sont seulement attestes au fminin, il faut prciser
quune telle conclusion est lie la convention de la langue franaise. Il nous semble que dans
la mesure o on comprend le sens des adjectifs de ce genre, il serait possible de les utiliser
mme ailleurs. Or, selon la convention, ils ne sont pas employs en dehors des syntagmes
cits. Mais, par le procd de dfigement
378
, rien nempche les locuteurs de se servir de ces
mots, pourvu que leur message reste comprhensible.
Le deuxime cas de blocage morphologique concerne le nombre. Dans les expressions
suivantes, il nous semble que le pluriel nest normalement pas utilis :
Singulier Pluriel
tirer le diable par la queue * tirer les diables par les queues
lchapper belle * les chapper belle
(avoir) une peur bleue * des peurs bleues
fort comme un Turc * fort comme des/les Turcs
entre la poire et le fromage * entre les poires et les fromages
prendre une veste * prendre des vestes
jeter une pierre dans le jardin de qqn * jeter des pierres dans le jardin de qqn
vendre la mche * vendre les mches
faire la loi * faire les lois
bon chat bon rat
379
* bons chats bons rats
pre avare, fils prodigue
380
* pres avares, fils prodigues
Le blocage du nombre est galement rgl par la convention dusage. Dans la plupart des
exemples cits, lexpression est aussi logique au pluriel quau singulier. Ces changements
nexistent pas loral, puisque lopposition entre le singulier et le pluriel nest exprime que
par crit. Ainsi, les emplois suivants du pluriel ne se remarqueraient que dans la langue crite,
mais ne sont normalement pas utiliss :
avoir maille partir avec qqn ? avoir mailles partir avec qqn
donner sa langue au chat ? donner sa langue aux chats
tel pre, tel fils
381
? tels pres, tels fils
378
Voir 2.5.4 supra.
379
bon chat bon rat la dfense, la rplique vaut, vaudra lattaque (PR:chat).
380
pre avare, fils prodigue les fils ont souvent une attitude inverse de celle de leurs parents
(DEI:prodigue).
381
Tel pre, tel fils les fils ressemblent souvent leur pre (DEI:pre).
127
Les blocages morphologiques suivants sont des cas o cest le pluriel qui simpose :
Pluriel Singulier
les carottes sont cuites * la carotte est cuite
marcher sur des ufs * marcher sur un uf
avoir dautres chats fouetter * avoir un autre chat fouetter
payer en chats et en rats
382
* payer en chat et en rat
vos risques et prils
383
* votre risque et pril
baisser les bras * baisser le bras
avoir les yeux plus grands que le ventre * avoir lil plus grand que le ventre
mettre les pieds dans le plat * mettre le pied dans le plat
Si un locuteur veut changer une forme dans le but de jouer avec la langue (comme une espce
de dfigement grammatical ), il nous semble peu efficace de changer le nombre. La
raction la plus probable dun tel changement est soit quun interlocuteur ne le remarque pas,
soit quil ne ragit pas devant ce petit dtail.
On na pas limpression de changer le sens des expressions figes que nous avons vues
jusqu maintenant en changeant le nombre. Or, il y a des cas o un changement de nombre
change le sens de lexpression. Hudson (1998:8) note que lon ne sattend pas voir le
syntagme anglais the other day au pluriel. Ainsi *the other days serait un syntagme qui nest
pas utilis. Il nous semble que le syntagme cit semploie, mais que la deuxime forme nest
pas interprte comme le pluriel du premier. Il sagit plutt dun syntagme indpendant qui a
sa place dans un autre paradigme. En regardant le syntagme correspondant en franais, on
remarque que la situation est la mme : les autres jours est un syntagme utilis, mais il ne
sagit pas de la forme plurielle de lautre jour
384
. La forme au singulier semploie pour oprer
une localisation temporelle qui concerne un pass pas trs lointain :
La rgle est de ne jamais dpasser seize heures de travail et de vol sans prendre
de repos. Mais avec Dien-Bien-Phu ce nest plus possible. Lautre jour jai fait
vingt-six heures (MO 9-10 mai 1954)
Mais des gens qui sen fichent, ce sont ceux qui ont laiss, lautre jour,
Zaventhem, des millions de grenouilles assoiffes dans cent cinquante caisses.
(SO880409)
En revanche, les attestations au pluriel sont surtout utilises pour mettre certains jours en
rapport avec dautres, dj mentionns dans le contexte. Les exemples parlent tous
dhoraires :
Cette expo-car sera accessible le lundi 18 avril de 13 16h30, les autres jours de
10 12 et de 13 16h30. (SO880414)
382
Payer en chats et en rats payer en mauvais effets (DEI:chat).
383
Faire qqch ses risques et prils en acceptant den subir toutes les consquences (PR:pril).
384
Cela se montre dautant plus clairement lors dune traduction en sudois, o les syntagmes ne comportent pas
les mmes mots au singulier et au pluriel. Lautre jour se traduit par hrom dagen, les autres jours par vriga
dagar.
128
Tandis que le Cercle des Beaux-Arts de Verviers prsente jusquau 9 octobre
Adolf Christmann, le dimanche de 11 12h30 et de 16 18h30, et tous les autres
jours, sauf le lundi. (LB860930)
Il nous semble que les restrictions du temps dans les expressions figes sont moins
rigoureuses. Regardons les syntagmes suivants dans lesquels il y a un verbe et donc, en
principe, une possibilit dutiliser diffrentes formes temporelles :
lchapper belle
avoir maille partir avec qqn
vendre la mche
marcher sur des ufs
avoir dautres chats fouetter
avoir du pain sur la planche
385
baisser les bras
Il serait logique de supposer que le temps du verbe se conforme au contexte et quon peut
donc rencontrer plusieurs formes temporelles. En effet, les expressions numres sont
attestes des temps diffrents dans le corpus
386
. La plupart des occurrences sont au temps
prsent (10 occurrences).
Le gouvernement a aussi maille partir avec ses allis des syndicats qui lui
reprochent de ne pas tre suffisamment dynamique dans la lutte contre le
chmage [...]. (ME 84 24:1)
Soames fait aussitt rapport Londres, mais Wilson [] vend la mche aux
Allemands, puis aux autres dirigeants de la Communaut [] (MO avril 1986)
Il y a galement des attestations au pass compos, au pass simple, limparfait, au futur
simple, au futur proche et au plus-que-parfait :
Nous ne pouvons nous empcher de penser Trissotin qui la chapp belle en
dormant et vient raconter sa frayeur aux femmes savantes [...] (LB860210)
De plus, les visits, aprs un premier quart dheure convenable, baissrent les
bras en chur aprs le second but lonin. (LB861005)
[...] River Plate lchappait belle, mais se trouve maintenant dans une situation
idale pour se rendre lUnion 4200. (LB871124)
Martens VI, VII ou VIII auront dautres chats fouetter. (LB861003)
Il va avoir du pain sur la planche(SO880405)
Bruges lavait son tour chapp belle! (SO880407)
385
Avoir du pain sur la planche avoir beaucoup de travail en perspective (DEI:pain).
386
Voir aussi Mejri (1997:39), qui affirme que les squences base verbale connaissent [...] les variations
morphosyntaxiques propres aux verbes [...] .
129
Il y a pourtant des cas o des restrictions de temps simposent. Ces cas concernent des
expressions trs inflexibles, dans lesquelles on ne peut remplacer pratiquement aucun mot,
souvent pas mme le sujet
387
. Dans des phrases entires comme celles qui suivent, il nous
semble que les variations temporelles sont moins courantes et que ces phrases sont surtout
connues aux formes que voici :
prsent de lindicatif
Pierre qui roule namasse pas mousse.
Lhabit ne fait pas le moine.
Mieux vaut tard que jamais.
Lapptit vient en mangeant.
Loccasion fait le larron.
Lunion fait la force
Les petits ruisseaux font les grandes rivires
prsent du subjonctif
Honni soit qui mal y pense
Il nest de bonne compagnie qui ne se quitte
Vaille que vaille
futur
Qui vivra verra.
Aide-toi, le Ciel taidera.
Thoriquement, des changements de temps restent possibles. On peut imaginer la possibilit
de sexprimer au pass, auquel cas le temps changerait :
lpoque
? lhabit ne faisait pas le moine
? lapptit venait en mangeant
? loccasion faisait le larron
? lunion faisait la force
? les petits ruisseaux faisaient les grandes rivires
Pourtant, les attestations des expressions que nous avons pu retenir du corpus sont toutes au
prsent de lindicatif, au prsent du subjonctif ou au futur
388
:
La voiture dont nous disposions tait quipe du tout nouveau kit RS qui lui donne
un look particulirement agressif mais, hlas, lhabit ne fait pas le moine et il
vaut mieux ignorer les provocations des petites GTI qui encombrent les routes.
(LB860930)
387
Un autre type dexpressions avec des restrictions de temps sont les locutions motionnelles (Heinz
1993:40), qui semploient le plus souvent la premire personne du singulier . Citons titre dexemple Jen
mettrais ma main au feu, Je ne mange pas de ce pain-l et Jen ai par-dessus la tte.
388
En revanche, tous les proverbes que nous avons examins ici, sauf les petites ruisseaux font les grand rivires
sont attests limparfait sur linternet www.google.fr, le 21 juillet 2003.
130
Un demi-sicle plus tard, le P.S., ralisant enfin le slogan de 1968
Limagination au pouvoir a invent les pelles. Mieux vaut tard que jamais.
(LB860213)
Certains se rsignent en attendant dun air flasque leur bus qui nen finit plus
darriver, certains trpignent et manifestent leur exaspration par de violents
soupirs, certains enfin, sassocient, selon le vieux principe que lunion fait la
force. (LB871128)
Loccasion, cest bien connu, fait le larron. (SO880413)
Qui vivra verra et que le meilleur gagne (SO880406)
Le prsident et son quipe semblaient, en ce qui concerne leur politique lgard
du tiers-monde, tre guid [sic !] par ladage en loccurrence un peu court,
aide-toi, le ciel taidera . (ME 85 10:1)
Les expressions figes semblent effectivement inflexibles au niveau morphologique,
diffrents degr. Les temps verbaux sont plus faciles modifier que le genre ou le nombre.
2.6.2 Blocage syntaxique
Un rapport intime entre les expressions figes et le blocage syntaxique a t voqu par de
nombreux chercheurs
389
. Grunig (1997b:235) dit par exemple, dune certaine mtaphore (jeter
largent par les fentres
390
) quelle est mmorise comme telle. Elle a circul comme telle
et [l]a formule doit tre reproduite comme elle est inscrite, tant du point de vue de sa forme
que de son sens . Cela vaudrait, selon elle, pour toutes les formules mmorises. Ainsi, ces
formules, avec ce statut, nexistent quainsi, exactement ainsi (Grunig, 1997b:235).
Nous ne partageons pas lavis rigoureux de Grunig, mais croyons possible de modifier
syntaxiquement certaines expressions, tant quon les reconnat aprs ce changement.
Lexistence de telle ou telle flexion dpend de la structure de lexpression en question. Nous
examinerons dans quelle mesure le blocage syntaxique joue un rle pour les expressions
figes. Les oprations syntaxiques telles que la pronominalisation, la passivation et la
relativation ont t regroupes sous la rubrique transformations.
2.6.2.1 Transformations
Bien des chercheurs ont mis en rapport les idiomes ou dautres expressions figes avec les
possibilits restreintes deffectuer des transformations syntaxiques : Lindication du degr
de figement se reflte dans les possibilits transformationnelles , crit par exemple G. Gross
(1996:78). Plusieurs cas de transformations ont t jugs incorrects, entre autres les
transformations suivantes de la phrase franaise Luc a pris la tangente
391
:
* La tangente a t prise par Luc (passivation)
* Luc la prise (pronominalisation)
389
Voir par exemple Fraser (1970), Misri (1987b), Fontenelle (1994), Nunberg et al. (1994) et Fontenelle
(1994).
390
Jeter largent par les fentres dpenser sans compter (DEI:argent).
391
Prendre la tangente partir sans se faire remarquer (DEI:tangente).
131
* Cest la tangente que Luc a prise (extraction)
* La tangente que Luc a prise (relativation)
(G. Gross 1996:12-13)
Dautres exemples jugs comme incorrects sont :
Couper un cheveu en quatre
* Un cheveu a t coup en quatre (passivation)
Donner sa langue au chat
* Sa langue a t donne au chat (passivation)
Faire des chteaux en Espagne
392
* Des chteaux ont t faits en Espagne (passivation)
Faire mouche
393
* La mouche que tu as faite (relativation)
Perdre pied
394
* Le pied que jai perdu (relativation)
(Misri 1987b:226-233)
Cependant, il y a deux choses remarquer : dune part, on constate que les exemples cits
comme incorrects aprs une transformation sont souvent crs par les chercheurs. Il est
vident quil est impossible de reprer des exemples authentiques dans un corpus quelconque
dexemples non attests. En dautres termes, il est impossible de trouver des preuves
ngatives de lemploi de telle ou telle forme. Ceci est comment par Fauconnier (1994:xxvi),
qui est critique envers lemploi trop rpandu des astrisques, conventionnellement utiliss en
linguistique pour indiquer des formes inacceptables. Fauconnier (1994:xxvii) en conclut que
le jugement des informateurs pris de faon isole ne donne pas les renseignements ncessaires
sur la forme et le sens. Selon Fauconnier, ce quon obtient est plutt la capacit de
linformateur en question de construire un contexte minimal.
Dautre part, les changements transformationnels mentionns jusquici ne concernent pas
uniquement les expressions figes. La passivation, par exemple, est galement proscrite dans
dautres cas.
2.6.2.1.1 Passivation
Limpossibilit de mettre une forme au passif peut dpendre du verbe. Voil des exemples des
verbes concerner, qui peut tre mis au passif, et regarder, qui ne le peut pas
395
:
Cette affaire nous concerne tous
Nous sommes tous concerns par cette affaire
Cette affaire nous regarde tous
* Nous sommes tous regards par cette affaire
(G. Gross 1996:12)
392
Faire, btir des chteaux en Espagne former des projets illusoires (DEI:chteau).
393
Faire mouche atteindre son but (DEI:mouche).
394
Perdre pied tre dpass par la situation (DEI:perdre).
395
Voir aussi G. Gross (1989:318-324).
132
Gaatone (1998a) cite plusieurs cas de verbes impassivables dans son livre sur le passif en
franais. Il reprend lexemple du verbe regarder de G. Gross (1989:219;1996:12), cette fois
dans le sens tre tourn vers. Le verbe est toujours impassivable :
Cette maison regarde la mer.
* La mer est regarde par cette maison.
(Gaatone 1998a:101)
Regardons aussi les verbes permettre et autoriser qui diffrent au niveau de la passivation :
Maman a autoris Maya aller jouer dehors.
Maya a t autorise par maman aller jouer dehors.
Maman a permis Maya daller jouer dehors.
* Maya a t permise par maman daller jouer dehors.
(Gaatone 1998a:71)
Plusieurs verbes sont donc impassivables, entre autres les verbes intrinsquement
impersonnels
396
:
Il (me) faut largent tout de suite.
* Largent (m)est fallu tout de suite.
* Il (m)a t fallu largent tout de suite.
Il a fait un temps affreux.
* Un temps affreux a t fait.
* Il a t fait un temps affreux.
(Gaatone 1998a:85)
Revenons brivement sur lexemple Luc a pris la tangente. La raison pour laquelle la phrase
*La tangente a t prise par Luc serait impossible est que [l] opacit smantique est
corrle une absence de proprits transformationnelles (G.Gross 1996:12). Gaatone
(1998a:114-115) commente le lien souvent propose entre limpassivabilit et le sens figur
dun verbe
397
. Il constate que lopposition agentif/statif est souvent plus importante pour le
rapport entre le verbe et la passivabilit et postule que le sens figur dun verbe nentrane
pas ncessairement son impassivabilit
398
. Ainsi, le lien suppos entre le blocage syntaxique
de passivation et les expressions figes est peut-tre moins important quon ne le croit.
2.6.2.1.2 Permutations de syntagmes coordonns
Le blocage syntaxique concerne aussi les syntagmes coordonns. Mme si tous les mots dune
expression sont gards, et que le sens reste parfaitement transparent, la convention empche
396
Ce sont des verbes qui sens gal, nexistent qu la troisime personne du singulier, avec pour sujet, le
pronom il ou ce/a non anaphoriques, ou linfinitif [...] (Gaatone 1998:85).
397
Cf. aussi Chapitre 6 de Gaatone (1998), qui traite les locutions verbales.
398
Voir aussi Langacker (1987:474-475) pour une discussion de la passivabilit et sa relation avec lanalysabilit
des units lexicales.
133
les permutations. Lexpression sain et sauf bloque lemploi de *sauf et sain de mme que
tort et travers
399
bloque * travers et tort.
Les exemples suivants illustrent l'impossiblit de faire des permutations
400
:
Entre la poire et le fromage *Entre le fromage et la poire
Sr et certain *Certain et sr
Sain et sauf *Sauf et sain
Purement et simplement *Simplement et purement
A tort ou raison
401
*A raison ou tort
A tort et travers *A travers et tort
A cor et cris
402
*A cris et cor
A vos risques et prils *A vos prils et risques
Clair et net *Net et clair
Pur et simple *Simple et pur
(Misri 1987b:105-106, 287)
Selon Hagge (1985), cest la loi du second lourd qui dcide de lordre des mots. Le
deuxime lment dans de telles expressions serait donc celui qui est le plus lourd :
[] les langues favorisent, dans les binmes de ce type, le rejet en seconde
position du terme plus lourd, cest--dire de celui qui a le plus grand nombre de
syllabes, ou les consonnes ou voyelles les plus longues ou les plus postrieures,
ou les consonnes spectre acoustique prsentant les plus fortes concentrations
dans les basses frquences. La loi du second lourd lemporte le plus souvent sur la
prise en compte du locuteur humain comme repre par rapport auquel sont
apprcis les distances spatiales ou temporelles, ou comme centre ordonnateur
dune chelle de valeurs, cest--dire, plus gnralement comme rfrence de
toute dixis ou dsignation de lunivers autour dego comme foyer. [...] Ainsi, le
franais se trouve pouvoir dire, sans violation de dixis, ici et l, tt ou tard, plus
ou moins, o le dernier terme suit la loi du second lourd. (Hagge 1985:244-245)
Admettons que ce soit la loi du second lourd qui entre en jeu ici. Cela expliquerait peut-
tre lorigine des expressions cites. Toujours est-il quelles sont figes en ce sens quelles
sont conues comme units. Mme sil est possible que cette loi rgisse (ou ait rgi) lordre
des mots, nous tenons pour improbable que le locuteur prenne en compte (mme
inconsciemment) ces rgles aujourdhui alors que ces expressions sont l, toutes faites, prtes
tre rutilises. En outre, il est possible de choisir entre les syllabes les plus longues, les
voyelles les plus longues ou postrieures, les consonnes de basses frquences qui sont
pertinentes pour le rejet en seconde position, et finalement la deixis. Dans le cas de ici et l, la
rgle du plus grand nombre de syllabes cde la place la deixis et sa relation avec le
locuteur. Pour des binmes tels que prendre ses cliques et ses claques, combien de locuteurs
rptent cette expression quils ont probablement entendue de nombreuses fois et combien
399
tort et travers de faon inconsidre (DEI:tort).
400
Hudson (1988:8) donne lexemple anglais trials and tribulation *tribulations and trials, et le compare avec
sorrow and pain pain and sorrow, suite dans laquelle les deux variantes dordre des mots sont permises.
401
tort ou raison avec ou sans droit (DEI:tort).
402
cor et cris bruyamment (DEI:cor).
134
prennent vraiment en compte quil y a une diffrence de position pour les voyelles lors de la
prononciation ? Il nous semble que ces hypothses ne sexcluent pas mutuellement, mais que
la loi du second lourd fournit peut-tre une explication de lorigine du figement plutt que
des rgles suivies par les locuteurs.
2.6.2.1.3 Insertions
propos de blocage syntaxique on peut galement mentionner limpossibilit de faire des
insertions dans les suites figes. Cependant, ce phnomne est considrer cas par cas. Il
semble que le caractre de lexpression soit dcisif. G. Gross (1996:18) soutient que [d]ans
les squences figes, linsertion dlments nouveaux est trs rduite , mais avoue que [i]l
est souvent possible, juste aprs le terme qui porte la flexion, dajouter dans les suites figes
certains adverbes ou incises . Il cite les exemples : il tourne vraiment de lil
403
et il prend
toujours les vessies pour des lanternes
404
(G. Gross 1996:19). Il est vrai que dans ce quil
appelle un figement total, cette possibilit nexiste pas. Dans les adjectifs composs cran et
la mode, il ny a pas de place pour une incise.
Un exemple attest dans notre corpus serait donc jug impossible par certains
linguistes :
Malheureusement, elle a souvent dautres chats plus prioritaires fouetter que
les braconniers et nest pas toujours disponible pour aller passer des soires dans
les bois. (SO880409)
Ladverbe souvent est probablement plus facile accepter que linsertion plus prioritaires qui
se rapporte justement au mot chats, qui dans ce sens ne devrait pas pouvoir avoir dpithte
qualifiant.
Dans un autre exemple, un adverbe est insr aprs le verbe dans lexpression prendre la
tangente :
Il est permis de croire, en effet, que des garons comme De Groote, Janssen et
Swinnen prendront sous peu la tangente pour terminer une carrire bien remplie
dans un club moins exigeant. (SO880412)
Cet exemple illustre le fait que les insertions sont assez facilement acceptes dans ces cas-l.
Il confirme donc la constatation de G. Gross.
Misri parle du mme phnomne en termes d impossibilit des expansions partielles . Il
soutient que dans les exemples suivants, le figement est dtruit dans la forme marque dune
astrisque et lexpression fige devient non fige :
Mettre des btons dans les roues
405
* Mettre de grands btons dans les roues du train
Retourner sa veste
406
403
Tourner de lil VX mourir; MOD. svanouir (PR:il).
404
Prendre des vessies pour des lanternes commettre une grossire mprise (PR:lanterne) ou se tromper
compltement (DEI:lanterne).
405
Mettre des btons dans les roues susciter des difficults (DEI:bton).
406
Retourner sa veste changer dopinion (DEI:veste).
135
* Retourner sa veste grise et son pantalon bleu
Un temps de chien
407
* Un temps de chien qui aboie
Entre la poire et le fromage
* Entre la grande poire et le fromage blanc
Leau va la rivire
408
* Leau qui coule va la grande rivire
(Misri 1987b:79-80)
Certaines incises seraient peut-tre possibles. Il nous semble que mettre de grand btons
dans les roues serait une expansion possible. Cependant, il faut dire quil nest pas trs
probable que les formulations exactes proposes par Misri soient utilises. Il reconnat
pourtant que certaines expansions sont admises (Misri 1987b:80-83)
409
.
Il y a un type dinsertion de caractre mtalinguistique. La fonction de ce type dinsertion
est de nous renseigner sur le fait que lexpression existe dj et quelle est en quelque sorte
considre comme cite. Ce genre dinsertions est facilement accept :
Loccasion, cest bien connu, fait le larron. (SO880413)
2.6.2.1.4 Effacements
ventuellement, il est moins accept deffacer des parties qui sont normalement prsentes
dans les suites figes que den ajouter. Que dire de linterprtabilit dune suite comme a
cote les yeux la place de a cote les yeux de la tte ?
ce propos, Misri donne des exemples d irrductibilit des expansions . Dans les
exemples 1-5, le figement est annihil, tandis que dans les exemples 6-8 lexpression fige
cite est tranforme en une toute autre expression aprs le changement :
(1) Ne pas y aller de main morte
410
* Ne pas y aller de main
* Ne pas y aller
* Y aller
(2) Le plus vieux mtier du monde
411
* Le vieux mtier du monde
* Le mtier du monde
* Le mtier
(3) Ce nest pas la mer boire
412
* Ce nest pas la mer
* Cest la mer
(4) Se donner corps et me
413
* Se donner corps
* Se donner
(5) Demain on rase gratis
414
* On rase gratis
(6) Ne pas avoir froid aux yeux
415
Avoir froid
407
Un temps de chien mauvais temps (DEI:chien).
408
Leau va la rivire les richesses vont naturellement ceux qui en possdent en abondance (DEL:eau).
409
Il mentionne des variantes comme dans Grand comme un mouchoir de poche et des expansions de type
intensif ou diminutif comme dans en trs bonne voie ou avoir un petit creux lestomac.
410
Ne pas y aller de main morte faire preuve de rudesse (DEI:main).
411
Le plus vieux mtier du monde la prostitution (DEI:mtier).
412
Ce nest pas la mer boire cest une chose facile (DEI:mer).
413
Se donner corps et me qqch sy consacrer totalement (DEI:me).
414
Demain on rase gratis se dit dune promesse qui ne sera pas tenue (DEI:gratis).
415
Ne pas avoir froid aux yeux tre audacieux (DEI:il).
136
(7) tort et travers tort
(8) Avoir une faim de loup
416
Avoir faim
(Misri 1987b:83-88)
Il est vident que dans les cas o on obtient une suite agrammaticale, lon ne peut, ni dans un
figement, ni dans la syntaxe libre, enlever des lments dun syntagme ou dune phrase. Il
faudrait donc surtout examiner des cas qui peuvent tre interprts et voir pourquoi ils ne
semploient pas. Il nous semble en effet beaucoup plus intressant dexaminer pourquoi une
suite comme *On rase gratis ne semploie pas que dexaminer une phrase comme *Le vieux
mtier du monde, qui nest gure interprtable. Lexemple (8) ressemble aux comparaisons du
type fort comme un Turc, sol comme un Polonais et bte comme ses pieds. Dans ces cas, les
effacements ne sont pas impossibles. La mme chose vaut pour une expression comme obir
qn au doigt et lil qui nempche pas la construction obir qn. Pourtant, se donner est
acceptable sans la partie corps et me
417
.
2.6.3 Rsum
Le blocage grammatical concerne aussi bien la morphologie que la syntaxe. Il rend compte de
limpossibilit de varier les flexions dun mot ainsi que de limpossibilit de faire des
transformations. Or, une expression fige, telle que nous lavons dfinie, nest pas forcment
concerne par le blocage grammatical. Ainsi, nous avons voulu examiner le rapport entre le
blocage grammatical et le figement.
Lanalyse a commenc par une tude du genre des mots constituants dune expression
fige. Un blocage de genre nest pas souvent un trait pertinent dans la dfinition dune
expression fige. Cependant, il existe des adjectifs qui ne semploient que dans des
expressions figes. Dans le cas o il sagit de mots contexte unique, seule une forme de
ladjectif est utilise (comme dans rose trmire).
Un blocage du nombre semble rpandue dans les expressions figes. Il sest avr, dans un
chantillon dexpressions, que seule une des formes (singulier ou pluriel) est employe. En
mettant au pluriel certains mots qui sont normalement utiliss au singulier on commet une des
deux fautes suivantes : soit on emploie une expression qui nest pas communment accepte
(*tirer les diables par les queues), soit le sens de lexpression change (lautre jour les
autres jours).
Les formes temporelles ne sont pas souvent restreintes dans les expressions figes. Une
exception semble tre les phrases entires figes (Lhabit ne fait pas le moine), qui se prtent
moins facilement aux changements temporels.
Comme il ny a pas de manire systmatique dexaminer les changement syntaxiques, ils
sont plus difficiles analyser. On a souvent comment limpossiblit de faire des
transformations dans les expressions figes. Cependant, les restrictions dpendent souvent
dautres choses que du caractre de lexpression. Pour la passivation, par exemple, le verbe
agentif ou statif est plus important que le sens figur. En outre, plusieurs transformations
peuvent avoir comme rsultat des constructions lourdes, que ce soit une expression fige ou
un syntagme libre qui fasse lobjet de la transformation.
416
Une faim de loup une faim vorace (PR:loup).
417
Voir par exemple le PR (donner).
137
Les insertions ne sont pas impossibles dans les expressions figes, mais certaines
restrictions simposent. Les insertions mtalinguistiques et les adverbes sont celles qui sont le
plus facilement acceptes (Loccasion, cest bien connu, fait le larron, Elle a souvent
dautres chats fouetter). Les effacements, en revanche, peuvent provoquer la transformation
dune expression fige en une autre ou la rendre incorrecte.
138
3 Conditions ncessaires et suffisantes
Une question qui se pose est de savoir si les critres tudis sont des conditions ncessaires et
suffisantes (CNS) qui permettent didentifier univoquement toutes les expressions figes.
Cette question sera examine dans le prsent chapitre.
3.1 Mmorisation
Selon notre hypothse, il est ncessaire quune expression fige soit mmorise. Nous avons
postul que lexpression fige est une catgorie cognitive
418
, qui existe dans la mmoire des
locuteurs dune langue. Cela explique pourquoi de nombreux linguistes
419
voquent
l intuition en parlant de figement. Le critre de mmorisation explique galement le fait
que dautres critres, dfinitions opposes, arrivent identifier les mmes expressions
figes
420
. Lidentification des expressions figes tant souvent un procd circulaire, il arrive
quon travaille partir dun corpus dexemples, suite quoi on se prononce sur les critres. Il
serait sans doute plus scientifique dtablir dabord des critres pour ensuite, en les
appliquant, identifier les expressions figes.
Aprs avoir postul la ncessit du critre de mmorisation, il faut dcider sil est
galement suffisant pour identifier les expressions figes. Autrement dit si un groupe de
mots est mmoris, les mots dans ce groupe forment-ils du coup une expression fige ? Notre
rponse cette question est non. Que lon pense aux exemples voqus par Misri (1987b:8-
14) dans sa mini-enqute sur la langue des schtroumpfs
421
. Dans ses dix exemples, il y a chez
les informateurs un consensus sur la possibilit de remplir les blancs, mme pour les suites
quon ne classe pas volontiers comme des expressions figes. Les exemples Quon ne me
schtroumpf sous aucun prtexte ! et Je ne vous cacherai pas le danger que vous
schtroumpferez ! ne se trouvent pas dans les dictionnaires dexpressions figes. Les
chercheurs ne les classeraient certainement pas non plus comme des expressions figes. Ils
appartiennent plutt aux collocations trs frquentes qui se retrouvent dans une zone
intermdiaire entre les expressions figes et les phrases libres. Ainsi, la mmorisation identifie
418
Voir 2.1 supra.
419
Voir la fin de 1.2.4 supra.
420
Pour certains linguistes la non-analysabilit est un critre dfinitoire des expressions figes, tandis que
dautres les considrent comme analysables. Voir 2.3.6 supra.
421
Voir 2.1 supra.
139
des expressions figes aussi bien que dautres suites de mots et elle nest par consquent pas
un critre suffisant pour dfinir les expressions figes
422
.
3.2 Contexte unique
Le contexte unique nest pas un critre ncessaire pour identifier les expressions figes,
puisque ce critre narrive identifier quun type particulier dexpressions figes. Il est
suffisant sil y a un mot contexte unique dans un syntagme, le syntagme est forcment une
expression fige.
3.3 Non-compositionnalit
En ce qui concerne la non-compositionnalit, le statut des CNS sera examin pour chacun des
3.3.1 Non-motivation
La non-motivation consiste en limpossibilit de voir la motivation derrire les mots
constituants une expression. Une expression qui ne comprend que quelques motivs, nest que
partiellement motive.
Il y a des expressions dites figes dans lesquelles les mots sont motivs (quoique le plus
souvent la motivation nest que partielle). Nous avons montr
423
que les mots dans lexemple
avoir les yeux plus grands que le ventre peuvent tre motivs, si le sens en est avoir faim
424
.
On trouve dautres exemples dans lesquels on voit la motivation derrire les mots. Dans ne
pas bouger plus quune bche
425
, il est certainement motiv dutiliser un mot comme
bche , qui dcrit un objet immobile. On voit trs bien comment les mots constituant
montrer les griffes
426
contribuent au sens. Dans dautres exemples la motivation est difficile
voir (que dire par exemple des mots constituant les expressions faire long feu
427
ou tourner
court
428
?). Cependant, nous avons constat que la non-motivation nest pas une condition
ncessaire pour que les mots forment une unit qui soit une expression fige.
En revanche, la non-motivation doit tre une condition suffisante pour quune expression
soit fige. Il est en effet impossible de simaginer des groupes de mots non motivs qui ne
soient pas considrs comme figs.
3.3.2 Sens figur
En ce qui concerne le sens figur, nous avons vu que cette proprit est souvent mentionne
comme un critre
429
(ou un indice) du figement. Or, le
sens figur
nest une condition ni
422
La haute frquence de certaines collocations pourrait ventuellement motiver leur appartenance la catgorie
des expressions figes. Nous avons choisi domettre un examen de la frquence et de son influence sur la
tendance appeler des suites courantes expressions figes.
423
Voir 2.3.3.2 supra.
424
Un sens plus gnral de cette expression est avoir des dsirs plus importants que ses possibilits
(DEI:ventre). Mme sans les mtonymies aussi directes que celles du sens tre incapable de manger autant
quon le dsirait, les mots peuvent tre considrs comme motivs.
425
Ne pas bouger plus quune bche rester immobile (DEI:bche).
426
Montrer les griffes - avoir une attitude hostile (DEI:griffes).
427
Faire long feu manquer son but (DEI:feu).
428
Tourner court se terminer brutalement (DEI:court).
429
Voir par exemple Hudson (1998:8-9).
140
notions de non-motivation, de sens figur, dopacit et dinanalysabilit.
ncessaire ni suffisante pour quil y ait figement. Il y a des expressions figes dans lesquelles
les mots ont leur sens propre. videmment le terme sens propre est problmatique, mais
les expressions du type moi, cest moi, cest moi de ainsi que clair et net, sain et sauf et
sr et certain peuvent tre considres comme tant figes aussi bien que comme ayant un
sens non figur. La mme chose vaut pour tt ou tard. Toutefois, il y a des expressions figes
au sens figur, par exemple couvrir quelquun de boue
430
ou mettre le doigt sur la plaie
431
.
Certaines expressions peuvent tre au sens figur ou au sens propre, selon le contexte. Citons
titre dexemples le nez en lair
432
, ouvrir la bouche
433
et prendre une veste.
On peut utiliser une langue image sans pour autant se servir dexpressions figes. Que
lon pense aux potes crant des images qui ne sont pas forcment employes ailleurs. On voit
dans le pome Obsession de Baudelaire, lemploi dune langue image mais qui ne
contient pas pour autant dexpressions figes mmorises
434
:
Grands bois, vous meffrayez comme des cathdrales ;
Vous hurlez comme lorgue ; et dans nos curs maudits,
Chambres dternel deuil o vibrent de vieux rles,
Rpondent les chos de vos De profundis.
(Baudelaire 1964:96)
Dans la langue quotidienne il nest pas rare que lon utilise une langue image sans quil y ait
de figement. Lexemple suivant, o il sagit de sport automobile, montre un usage figur du
mot gibier qui ne fait pas partie dune expression fige :
Adversaire rsolu du pire. Question de temprament. De temprament de
champion. Une gchette facile, oui, mais uniquement lorsque le gibier est
dimportance. Le reste ne lintresse que mdiocrement. Eric Geboers, lhomme
du nord (du pays) sest mis lafft dun gros gibier. (SO880401)
Vu que de nombreux chercheurs lui donnent un statut de critre dcisif et quil semble tre un
trait pertinent des expressions figes, nous proposons de lappeler indice de figement.
3.3.3 Opacit
Une expression opaque est impossible comprendre pour un locuteur qui ne connat pas le
sens particulier de lexpression, tel quil est dfini par lusage et la convention. tant donn
que la variation entre les locuteurs en ce qui concerne la connaissance dexpressions peut tre
trs grande, lopacit est une des conditions les plus difficiles dcrire. Or, on peut estimer
que certaines expressions sont plus opaques que dautres.
Lopacit, telle que nous lavons dfinie, nest pas une condition ncessaire pour quune
expression soit fige, puisquil y a des expressions (plus ou moins) transparentes, qui sont
430
Couvrir quelquun de boue le dshonorer (DEI:boue).
431
Mettre le doigt sur la plaie indiquer clairement la cause dun mal (DEI:plaie).
432
Le nez en lair sans faire attention (DEI:nez).
433
Ouvrir la bouche commencer parler (DEI:bouche).
434
Il est vrai que des pomes ou titres de livres etc. peuvent accueillir le statut dexpressions figes, dans la
mesure o ils forment des expressions mmorises et connues par les locuteurs dune langue. Sullet-Nylander
(1998:210) appelle ce genre dexpressions des figements culturels . Voir 2.5.4 supra.
141
considres comme figes. Ainsi, nous supposons que des expressions telles que montrer les
griffes et couvrir quelquun de boue sont transparentes pour de nombreux locuteurs qui ne les
ont pas rencontres avant, tandis que les expressions dorer la pilule quelquun
435
, casser sa
pipe
436
, tre noir
437
et tre gris
438
sont plus difficiles interprter.
Une expression qui, sans contexte, resterait opaque pour les francophones qui ne lont pas
entendue avant doit, nous semble-t-il, tre une expression fige, dont lusage est devenu
conventionnel. Dans ces conditions, lopacit est une condition suffisante pour quune
expression soit une expression fige. Or, vu les difficults de dcider de ce critre, il est
difficilement appliquable.
3.3.4 Inanalysabilit
Une expression est analysable si on arrive dterminer la contribution de telle ou telle partie
dans la suite de mots quelle constitue. Linanalysabilit nest pas une condition ncessaire
dans une dfinition des expressions figes puisquil y a des expressions figes qui sont
analysables. Que lon pense aux expressions comme la montagne qui accouche dune souris
ou ventre terre. Mis en rapport avec une bte comme la souris, un mot comme montagne
reprsente quelque chose de grand. On comprend ainsi, lintermdiaire dune interprtation
plus gnrale, que montagne peut faire allusion un grand projet, ou un projet
ambitieux. Si, en plus, cette grande montagne accouche , il est normal que lon sattende
une progniture plus grande quune souris. Linterprtation qqch de grand engendre qqch
de petit rend comprhensible que cette petite souris reprsente quelque chose de dcevant,
vu que sa taille ne correspond pas au rsultat voulu ou attendu.
EXPRESSION SENS
FIGURE
l qui
INTERPRTATION GNRALE
q
INTERPRTATION
CONVENTIONNELLE
(un projet am
Figure 21 : Lanalysabilit de lexpression fige la montagne qui accouche dune souris .
La signification des diffrentes parties est galement claire dans une expression comme ventre
terre. En fait, la prposition est la seule partie avoir un sens assez gnral pour pouvoir
poser problme. Lanalysabilit de lexpression en question nest pas problmatique.
435
Dorer la pilule quelquun le mystifier (DEI:pilule).
436
Casser sa pipe mourir (DEI:pipe).
437
tre noir tre ivre (DEI:noir).
438
tre gris - tre moiti ivre (DEI:gris).
a montagne accouche d une souris
qch de grand qui engendre qqch de petit
bitieux qui donne un rsultat dcevant)
142
Figure 22 : Lanalysabilit de lexpression ventre terre .
Force est de constater que les suites inanalysables doivent constituer des expressions figes.
Linanalysabilit est donc une condition suffisante.
3.4 Syntaxe marque
Ayant observ lexistence des expressions figes avec une syntaxe parfaitement normale
439
,
nous concluons quune syntaxe marque nest pas une condition ncessaire pour quune
expression soit fige. Des expressions telles que mordre la poussire ou couvrir quelquun de
boue ne diffrent pas syntaxiquement de suites engendres librement.
Les limites entre une syntaxe normale et une syntaxe marque tant difficiles tablir,
lemploi dune chelle syntaxique est pertinent pour illustrer les rapports entre la syntaxe
marque et les expressions figes. Bien quon puisse, dans certains cas, utiliser une syntaxe
qui sloigne des normes
440
, sans quil soit forcment question dun figement, nous dirons que
la syntaxe marque est souvent pertinente pour le figement. Une syntaxe marque nest ainsi
ni une condition suffisante ni une condition ncessaire pour identifier une expression fige.
Pourtant, elle est souvent un indice de figement.
3.5 Blocage lexical
Dans une expression concerne par un blocage lexical, il est impossible de remplacer un mot
par un autre, mme l o, selon les rgles grammaticales, cela devrait tre possible.
Le blocage lexical est forcment quelque chose qui concerne toutes les expressions figes.
Il est ncessaire pour quune suite de mots soit une expression fige. Certaines expressions
ont des variantes lexicales, comme dans blanc comme SN, o le SN peut tre un cachet
daspirine, un linge ou neige, mais, part ces variantes, lexpression nest connue sous
aucune autre forme.
Le dfigement consiste changer une expression fige de faon ce quon soit conscient
du changement et reconnaisse lexpression dorigine. Le procd de dfigement confirme
plutt que contredit lexistence et la pertinence du blocage lexical.
Si, pour une expression donne, il ny a aucune commutation accepte (sauf celles qui
dpendent du contexte uniquement), elle doit tre fige. Il suffit quil y ait blocage lexical,
pour quil y ait figement. Le critre de blocage lexical est ainsi une condition tant ncessaire
que suffisante.
143
439
Voir 2.4 supra.
440
Voir 2.4.3 supra, et les ides de G.Gross (1996:2).
ventre terre
(avec ?) le ventre en position le sol/la terre
parallle avec
3.6 Blocage grammatical
Le blocage grammatical est constitu par limpossibilit de modifier les mots dun syntagme.
Ainsi, les changements de genre, de nombre ou de temps sont impossibles dans un syntagme
soumis au blocage grammatical. Il est galement impossible deffectuer des tranformations
(relativisation, passivation ou pronominalisation) ou de changer lordre des mots dans le
syntagme en question.
Il y a une certaine flexibilit dans de nombreuses expressions figes. linstar du critre
de syntaxe marque, le critre de blocage grammatical est plutt une question de degr. Ainsi,
on peut constater avec Fraser (1970:39) quil est possible dtablir une hirarchie et de diviser
les expressions figes en catgories selon leur flexibilit. Or, le rapport entre figement et
blocage grammatical ne semble pas tre aussi intime que le rapport entre figement et syntaxe
marque. Il peut y avoir dautres raisons que le figement (dans le sens cognitif que nous
attribuons au terme) qui restreignent les possibilits de modifier une suite de mots
441
. Un
manque de flexibilit dans une suite de mots nindique pas automatiquement que nous ayons
affaire une expression fige.
Le blocage grammatical nest ni une condition ncessaire, ni une condition suffisante pour
le figement, tel que nous lavons dfini. Cependant, on constate un manque de flexibilit dans
de nombreuses expressions figes
442
. Nous proposons de parler du blocage grammatical en
termes dindice de figement.
3.7 Rsum
Les conditions ncessaires et suffisantes sont difficiles tablir pour certains des critres (le
critre dopacit, par exemple), tandis que dautres se laissent facilement dcrire en termes de
conditions ncessaires et/ou suffisantes (comme le critre de contexte unique). En ce qui
concerne les critres de syntaxe marque et de blocage grammatical, ils sont souvent des
indices de figement, mme sil ny a pas de rapport absolu entre ces proprits et le figement.
Hudson (1998:8-9) classe les contraintes syntaxiques inattendues parmi les critres de
variation, qui ne sont que des symptmes de figement.
Nous pouvons rsumer notre analyse de la manire suivante :
Critre Condition ncessaire Condition suffisante Indice
mmorisation + -
contexte unique - +
non-compositionnalit :
non-motivation
- +
sens figur
- - indice
opacit - +
inanalysabilit - +
syntaxe marque - - indice
blocage lexical + +
blocage grammatical - - indice
Tableau 6. Rsum schmatique des CNS des critres examins.
441
Limpossibilit de mettre une forme au passif peut, par exemple, dpendre du verbe.Voir 2.6.2.1.1 supra.
442
La plupart des expressions figes sont inflexibles au niveau morphologique. Voir 2.6.1 supra.
144
Il ny a que le critre de blocage lexical qui soit aussi bien ncessaire que suffisant pour
dfinir les expressions figes. Pourtant les critres examins semblent, dune manire ou
dune autre, tous pertinents pour la notion de figement.
Dans le chapitre 5, nous examinerons les possibilits dorganiser les critres dexpressions
figes en ressemblance de famille ainsi que lventuelle pertinence de ce concept.
145
4 Rapports entre les critres de figement examins
Nous nous proposons de faire une analyse gnrale des relations entre les critres analyss
dans les chapitres prcdents. Malgr la simplicit apparente du point de dpart, nous
arriverons la fin, en largissant lanalyse critre par critre, une description plus complexe
et plus proche de la ralit linguistique telle quelle se prsente dans linteraction des
expressions figes et de la syntaxe libre.
Nous dcrirons leurs relations critre par critre, ce qui explique lingalit de longueur des
diffrentes sections de ce chapitre. Afin dillustrer leur interaction, nous proposons une
reprsentation schmatique des critres avec des reprsentations graphiques densembles
dexpressions, forms par lapplication du critre en question
443
.
Lapplication de deux critres peut avoir pour rsultat lidentification des mmes
expressions figes. Dans ce cas, il y a une intersection o les deux ensembles se chevauchent.
Les expressions figes identifiables par seulement un des critres seront inclues dans
lensemble form par lapplication du critre en question mais en dehors de lintersection.
Lorsquil y a identit, les critres examins identifient exactement les mmes expressions et il
ny aura pas dexpression en dehors de lintersection. Quand les expressions identifies par
lapplication dun critre sont galement compltement incluses dans lensemble form par
lapplication dun autre, on identifie un sous-ensemble.
En ce qui concerne le blocage grammatical, nous nous concentrerons dans le prsent
chapitre sur le blocage morphologique (blocage de genre, nombre et temps). Pour les autres
cas de blocage grammatical (transformations, insertions, effacements et permutations), il nous
semble plus difficile de dire quelque chose de dfinitif sur les possibilits ou non deffectuer
des changements dans des comparaisons de ce type. Une difficult particulirement saillante
lors dune analyse du blocage morphologique est que les expressions figes nont pas toutes la
mme structure syntaxique. Une tude comparative entre le blocage grammatical de
diffrentes expressions figes est ainsi difficile entreprendre.
443
Selon le Chapitre 3, toutes les proprits examines nont pas le statut de critre. Cela nest pas indiqu dans
les figures de ce chapitre.
146
4.1 Rapport entre mmorisation et les autres critres
La mmorisation est une condition ncessaire pour quune expression soit classe comme
fige
444
. Ainsi toutes les expressions figes possibles identifier laide dun critre
quelconque sont mmorises. Dans lensemble des expressions classifies comme figes
laide du critre de mmorisation sont galement inclus tous les ensembles dexpressions
identifies comme figes laide dautres critres, comme le montre la figure 23.
Figure 23. Le rapport entre la mmorisation et les autres critres.
4.2 Rapport entre contexte unique et les autre critres
4.2.1 Rapport entre contexte unique et non-compositionnalit
Ayant dj montr lutilit dune distinction entre divers aspects de la non-compositionnalit,
nous tenons toujours compte des quatre notions de non-motivation, de sens figur, dopacit
et dinanalysabilit. Si nous avons choisi de traiter toutes ces notions sous la mme rubrique,
mme aprs avoir constat les diffrences qui existent entre elles, cest parce quil nest pas
rare que dautres chercheurs les considrent comme inhrentes la dfinition de la non-
compositionnalit. Nous examinerons ainsi le rapport entre le contexte unique et chacune des
notions couvertes par les termes non-motivation, sens figur, opacit et inanalysabilit.
4.2.1.1 Rapport entre contexte unique et non-motivation
Un mot employ uniquement dans une expression contexte unique
445
(fur, lurette, us), a-t-il
un sens indpendant (dans une perspective synchronique) et dans quelle mesure contribue-t-il
au sens de lensemble dune expression fige ? Autrement dit, dans quelle mesure le mot est-il
motiv
446
dans lexpression en question ? Nous cherchons donc savoir comment
interagissent les deux critres de contexte unique et de non-motivation.
444
Voir Chapitre 3 supra.
445
Voir supra 2.2 pour une dfinition de contexte unique.
446
Pour notre emploi du terme motiv, voir 2.3.2 supra.
mmorisation
contexte unique
au fur et mesure
non-compositionnalit
les carottes sont cuites
syntaxe marque
baisser pavillon
blocage lexical
jour fri
*journe frie
blocage morphologique
vendre la mche
*vendre les mches
147
Figure 24. Exemples dexpressions identifies par les critres de non-motivation et de contexte
unique.
Les expressions identifies par le critre de contexte unique peuvent tre divises en deux
groupes, celles thmes uniques (au fur et mesure) et celles formes uniques ( la
sauvette).
forme unique
Figure 25. Le contexte unique se divise en deux groupes.
non-motivation
les carottes sont cuites
casser sa pipe
rire jaune
contexte unique
au fur et mesure
belle lurette
us et coutumes
contexte unique
thme unique
au fur et mesure
la sauvette
Le sens dun mot contexte unique thme unique (fur) est normalement difficile dfinir et
ltymologie du mot nest pas connue par le locuteur du franais moderne. Les expressions
thme unique sont donc non motives. Elles se situent ainsi simultanment dans les deux
ensembles forms par lapplication des critres de non-motivation et de contexte unique (
thme unique). Les deux ensembles dexpressions identifies par les critres en question se
superposent.
non-motivation
les carottes sont cuites
contexte unique
thme unique :
au fur et mesure
la Saint-Glinglin
Figure 26. Le rapport entre la non-motivation et le thme unique du contexte unique.
Pour ce qui est des mots dans les expressions figes formes uniques ( ttons, la sauvette),
leurs sens respectifs contribuent au sens du tout dans les expressions dont ils font partie, ce
qui veut dire quils sont motivs. Ainsi, les expressions figes formes uniques ne tombent
pas sous le critre de non-motivation, mais elles sont identifiables laide du critre de
contexte unique. Elles sont incluses dans lensemble cr par le critre de contexte unique,
mais exclues de celui de non-motivation.
148
non-motivation
les carottes sont cuites
contexte unique
thme unique :
au fur et mesure
la Saint-Glinglin
forme unique :
limproviste
la sauvette
Figure 27. Le rapport entre la non-motivation et le contexte unique.
Il ressort de cette analyse que les deux critres de non-motivation et de contexte unique ne se
recouvrent que partiellement.
Quant la non-motivation, on notera que la division en quatre niveaux de description,
cest--dire les niveaux syntaxique, lexicale, smantique et pragmatique, introduite dans le
Chapitre 2
447
, peut toujours servir de point de dpart pour faciliter la prsentation. Il y a un
lien entre le critre de contexte unique et la non-motivation au niveau lexical. Ce lien ressort
plus clairement lorsquil est explicit dans une reprsentation graphique. Il y a identit entre la
non-motivation du niveau lexical et le thme unique (au fur et mesure) du critre de
contexte unique.
Figure 28. Le rapport entre la non-motivation du niveau lexical et le thme unique (identit).
149
447
Voir supra 2.3.3.
non-motivation
niveau lexical
au fur et mesure
la Saint-Glinglin
matre queux
contexte unique
thme unique
au fur et mesure
la Saint-Glinglin
matre queux
non-motivation
niveau lexical
=
contexte unique
thme unique
au fur et mesure
la Saint-Glinglin
matre queux
Ayant examin le critre de contexte unique et sa relation la non-motivation, nous passons
maintenant au critre de contextes limits. Certaines expressions figes identifies par le
critre de contextes limits contiennent des mots motivs. Les mots dans des expressions
comme jouer son va-tout et vin rsin sont motivs dans ces contextes. En revanche, les
expressions il y a belle lurette, des clopinettes et faire la nique qqn contiennent des mots
contextes limits qui ne sont pas motivs, parce quils nont pas de sens connu qui contribue
au sens de lexpression fige dont ils font partie. La relation entre les critres de contextes
limits et de non-motivation peut tre reprsente par des ensembles qui se chevauchent.
Figure 29. Le rapport entre la non-motivation et les contextes limits.
4.2.1.2 Rapport entre contexte unique et sens figur
Parmi les expressions figes que nous avons examines dans le prsent travail, on trouve
celles dont le sens est figur (avoir les yeux plus grands que le ventre, marcher sur des ufs)
et celles qui gardent leur sens propre (sige jectable, tt ou tard). En ce qui concerne les
expressions contexte unique, on retrouve parmi elles des expressions des deux types. Dans
la plupart des cas il est difficile dtablir, sans contexte, quel est le sens actuel de lexpression
employe.
Les deux exemples sige jectable et reculons semploient normalement au sens propre.
Lexpression contexte unique la Saint-Glinglin a un sens figur. Il y a une intersection des
ensembles constitus par les expressions repres par lindice sens figur et ceux constitus
par les expressions identifies par le critre de contexte unique.
Figure 30. Le rapport entre le sens figur et contexte unique.
sens figur
avoir les yeux plus grands que le ventre
marcher sur des ufs
contexte unique
la Saint-Glinglin
sige jectable
reculons
non-motivation
les carottes sont cuites
casser sa pipe
contextes limits
des clopinettes
belle lurette
faire la nique qqn
damer le pion
vin rsin
risquer son va-tout
150
Tout parmi les thmes uniques (au fur et mesure, eau de Seltz) que parmi les formes uniques
( la sauvette, sige jectable) peut-on retrouver des expressions qui semploient au sens
figur ou au sens propre :
Sens normalement utilis:
Sens propre Sens figur
Thme unique eau de Seltz tire-larigot
Forme unique sige jectable mi-figue, mi-raisin
Le rapport entre le contexte unique et le sens figur est arbitraire puisque toutes les
combinaisons sont possibles.
4.2.1.3 Rapport entre contexte unique et opacit
Comme nous venons de le voir dans la figure 28, le rapport entre le thme unique et la non-
motivation au niveau lexical (au fur et mesure) dune expression est tel que les ensembles
des expressions dnotes par ces termes se recouvrent entirement. Si la motivation des mots
des expressions figes thmes uniques est difficile voir, il est galement difficile de
connatre le sens de lexpression. Il y a ainsi galement un rapport trs fort entre lopacit (les
carottes sont cuites, casser sa pipe) et le thme unique (au fur et mesure, avoir maille
partir). Pourtant, les expressions figes identifiables laide du critre de contexte unique
(sige jectable) sont parfois transparentes. Parmi celles-l, la plupart sont des formes
uniques.
opacit
les carottes sont cuites
casser sa pipe
contexte unique
thme unique
au fur et mesure
avoir maille partir
la Saint-Glinglin
forme unique
sige jectable
mi-chemin
reculons
Figure 31. Le rapport entre lopacit et le contexte unique.
Mais comme il ressort de la figure 31, il y a des expressions opaques (les carottes sont cuites,
casser sa pipe) qui ne sont pas des expressions contexte unique. Le rapport entre lopacit et
le contexte unique thme unique nest pas absolu, puisque les deux ensembles forms par
lapplication de ces critres ne concident pas.
151
4.2.1.4 Rapport entre contexte unique et inanalysabilit
La plupart des expressions contexte unique sont analysables. Dans lexpression contexte
unique sans barguigner, il est clair que sans veut toujours dire sans et que le verbe porte un
sens peu prs quivalent hsiter, mme si les deux verbes ne sutilisent pas dans les
mmes contextes. Dans huis clos, on voit galement quelle est la signification de chaque
partie. Le fait que huis dans le sens de porte est vieilli nempche pas que les locuteurs
francophones daujourdhui connaissent ce sens. De nombreuses expressions forme unique
ont la forme syntaxique PRP. + ART. + FORME UNIQUE (+ PRP) ( linstar de, linsu de , la
sauvette) et sont ainsi analysables. Il y a galement des expressions inanalysables (belle
lurette, tout de go) parmi les expressions contexte unique, surtout parmi celles thme
unique, mais il ny a pas de lien systmatique entre le contexte unique et linanalysabilit.
Figure 32. Le rapport entre linanalysabilit et le contexte unique
4.2.2 Rapport entre contexte unique et syntaxe marque
Il semble logique de supposer que les expressions contexte unique suivent leurs propres
rgles de syntaxe, puisquelles sont justement uniques. Cependant, les catgories
grammaticales ou fonctions syntaxiques ne posent la plupart du temps pas de problme et les
rgles sont loin dtre toujours violes. Ainsi, nous avons vu
448
des adjectifs qui se rapportent
un seul substantif : ouvrable (jour ouvrable) et aquilin (nez aquilin), pour en mentionner
deux exemples. Il y a des adjectifs de ce genre du type thme unique (aquilin dans nez
aquilin) ainsi que du type forme unique (ouvrable dans jour ouvrable). Ce quil importe de
noter ici, cest que malgr le caractre trs restrictif de leurs emplois et le fait que la plupart
soient des hapax dans le corpus dpouill, la suite SUBSTANTIF + PITHTE est parfaitement
normale en franais
449
.
Or, parmi les expressions contexte unique sont galement attestes des exceptions aux
rgles syntaxiques. Citons titre dexemple avoir maille partir avec qqn, expression dans
laquelle le mot maille se trouve sans dterminant. Cela est un trait qui peut tre caractris
comme appartenant une syntaxe marque. Dans sans coup frir, lordre des mots nest gure
habituel et il ny a pas de dterminant devant le substantif coup. Dautres exemples
dexpressions contexte unique sont dores et dj et la queue leu leu. Pour ces deux
448
Supra 2.2.
449
Cf. un extrait de Jabberwocky (Lewis Carroll) :
Twas brillig and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe.
Ce pome trs connu est un exemple type du fait quil est, dans une large mesure, possible didentifier les
catgories grammaticales mme lorsque tous les mots ne sont pas connus, tant que les formes des mots sont
toutes conformes des structures connues.
inanalysabilit
les carottes sont cuites
contexte unique
belle lurette
tout de go
sans barguigner
huis clos
152
expressions, la syntaxe est en effet bizarre, mais notre conclusion est pourtant que le rapport
entre le contexte unique et la syntaxe marque nest pas systmatique. En jetant un regard sur
lchelle syntaxique prsente dans le Chapitre 2, nous pouvons constater que les expressions
contexte unique y sont reprsentes tout au long de lchelle.
Syntaxe non marque Syntaxe rare Syntaxe marque
jour ouvrable sans coup frir
450
avoir maille partir
nez aquilin dores et dj
la queue leu leu
Figure 33. Les expressions contexte unique sur lchelle de la syntaxe.
Les expressions contexte unique (dores et dj) dont nous classons la syntaxe comme
marque ou rare ne sont pas nombreuses. part les exemples que nous venons de citer (sans
coup frir, dores et dj, la queue leu leu et avoir maille partir) il ny a, dans la liste que
nous avons tablie, que lexpression tout de go que nous jugerons comme tant marque.
Ce que nous venons de constater est rsum graphiquement dans la figure 34.
Figure 34. Le rapport entre le contexte unique et la syntaxe marque.
Les formes uniques ( la sauvette, jour ouvrable) semblent suivre les rgles syntaxiques plus
souvent que les thmes uniques (dores et dj, la queue leu leu, avoir maille partir)
451
.
Parmi les expressions contexte unique il y a donc des cas de syntaxe non marque aussi
bien que de syntaxe marque. Il importe galement dexaminer si les expressions contextes
limits (bon gr mal gr) suivent dans une plus large mesure que les expressions contexte
unique les rgles syntaxiques. Cest en effet le cas des exemples que nous avons pu relever.
Les mots contextes limits dans les expressions suivantes ont un emploi restreint un
nombre limit dexpressions, mais ne prsentent pas dcart au niveau syntaxique : de
450
Cf. sans rien faire et sans mot dire.
451
Si les expressions figes thmes uniques ont plus souvent une syntaxe marque que dautres expressions
figes, une raison possible en est quelles ont longtemps exist sous la mme forme et quil existe parmi celles-ci
des expressions dont le degr de figement est trs lev.
syntaxe marque/rare
baisser pavillon
faire cavalier seul
plier bagage
lavoir belle
contexte unique
dores et dj
la queue leu leu
avoir maille partir
nez aquilin (thme unique)
la sauvette (forme unique)
jour ouvrable (forme unique)
153
bon/mauvais aloi, sans/ne pas barguigner, jouer/risquer son va-tout, bouche/gueule be et
bon/mauvais/mon escient.
On trouve aussi, parmi les expressions contextes limits, des constructions moins
courantes. Un exemple en est lexpression bon gr mal gr. Il est intressant de noter que
cette construction, avec les adjectifs bon et mal (bon N mal N), nest atteste dans notre corpus
quavec les deux substantifs gr et an
452
.
Si lexpression bon an mal an
453
est reprable laide de la syntaxe marque, elle nest pas
pour autant lattestation dune expression contextes limits (bon gr mal gr). Tout comme
la relation entre le contexte unique et la syntaxe marque, la relation entre le critre de
contextes limits et la syntaxe marque nest pas systmatique. Une reprsentation graphique
montre que les ensembles forms par les expressions identifies par ces deux critres ne se
recouvrent que partiellement.
Figure 35. Le rapport entre les contextes limits et la syntaxe marque.
Nous avons vu que lexemple bon gr mal gr scarte des rgles, et que la construction bon N
mal N nest pas trs productive. Labsence darticle devant le nom peut tre considr comme
leffet dune syntaxe marque
454
. De mme, nous pouvons classer les exemples prter main-
forte et chercher noise comme marques en ce qui concerne la syntaxe. Cependant, linstar
des exemples dexpressions contexte unique, les expressions contextes limits suivent
souvent les rgles syntaxiques et font partie de constructions productives.
La construction de bon N est certes productive. Pourtant, plusieurs types de cette
construction contiennent des mots contextes limits. Citons titre dexemples les
expressions de bon acabit, de bon aloi et de bon gr. Dans notre corpus, les deux dernires
semploient galement avec ladjectif pjoratif mauvais dans de mauvais aloi et de mauvais
gr
455
. Il y a dautres mots dans le corpus qui semploient dans ces constructions, mais les
variantes ne sont pas trs nombreuses. Les exemples attests plus de deux fois dans notre
corpus sont
456
:
452
Il y a dautres constructions avec une syntaxe similaire o apparat ladjectif bon, par exemple bon chic bon
genre (se dit pjorativement dune personne distingue, DEI:chic) et bon chat bon rat.
453
Bon an mal an en faisant la moyenne entre les bonnes et les mauvaises annes (PR:an).
454
Voir 2.4.1 supra.
455
La forme comparative meilleur est employe dans de meilleure qualit. Une forme pjorative est galement
atteste plus de deux fois dans de mauvais got et de mauvais temps.
456
Dautres occurrences, attestes une ou deux fois, sont de bon accueil, de bon cur, de bonne confirmation,
de bon gars, de bon gr, de bon hritage, de bon niveau, de bon sang, de bon ton, de bonne bourgeoisie, de
bonne chaire, de bonne chance, de bonne coute, de bonne encre, de bonne facture, de bonne famille, de bonne
fin, de bonne grce, de bonne humeur, de bonne manire, de bonne pratique, de bonne protection, de bonne
rigolade, de bonne technologie, de bonne tenue et de bonne vie.
syntaxe marque
bon an mal an
bon chic bon genre
contextes limits
bon gr mal gr
cas pendable
154
de bon aloi (4)
de bon augure (4)
de bon got (3)
de bon nombre (6)
[rputation] de bon payeur (3, tous avec rputation)
de bon sens (7)
de bon ton (4)
[relations] de bon voisinage (7, dont 3 avec relations)
et au fminin :
de bonne conduite (3)
de bonne foi (15)
de bonne guerre (3)
de bonne heure (7)
de bonne qualit (9)
de bonne source (5)
de bonne volont (27)
De bon N est, videmment, une construction trs courante en franais moderne et dans
laquelle le N peut tre reprsent en principe par nimporte quel substantif. Mais est-ce un
hasard si plusieurs des variantes numres ci-dessus sont cites dans les dictionnaires et si
plusieurs sont galement des expressions contextes limits ? Aprs consultation du PR, du
DEI et de FO, on constate que parmi les 15 exemples les plus courants dans le corpus (attests
plus de deux fois) il ny en a que trois qui ne sont mentionns dans aucun de ces dictionnaires,
savoir de bon payeur, de bon sens et de bonne conduite. Que les expressions avec des mots
contextes limits apparaissent dans les dictionnaires ntonne gure. Il est galement
comprhensible que lon mentionne des expressions dont le sens est moins transparent
(comme de bonne foi
457
, de bonne guerre
458
et de bonne heure
459
). De bon nombre est cit
uniquement dans le dictionnaire bilingue, peut-tre en raison de la grande diffrence qui
existe entre le franais et le sudois pour exprimer une quantit importante. Ce qui tonne le
plus, vu que cette expression est tout fait transparente, est lapparition de relations de bon
voisinage, cite uniquement dans le dictionnaire bilingue. Cependant, le nombre
doccurrences de cette expression dans notre corpus est assez lev. Elle appartient aux
expressions qui ne se laisse pas facilement ranger dans lune ou lautre des catgories figes
ou libres.
4.2.3 Rapport entre contexte unique et blocage lexical
Le blocage lexical est une condition ncessaire et suffisante pour quune expression soit
considre comme fige
460
. On pourrait ainsi tre tent de lomettre de notre analyse des
rapports entre les critres que nous sommes en train de faire et de dire que la relation entre le
457
De bonne foi par excs de confiance (DEI:foi).
458
De bonne guerre lgitimement (DEI:guerre).
459
De bonne heure tt (DEI:heure).
460
Voir chapitre 3 supra.
155
blocage lexical et les autres critres est toujours la mme : les expressions figes concernes
par tel ou tel critre sont toutes concernes de la mme manire par le critre de blocage
lexical. Or, le critre de blocage lexical est assez complexe, vu que les expressions figes ne
sont pas bloques de la mme manire. Quoi quil en soit, les commutations qui se laissent
faire dans les expressions figes ne sont que rarement libres. Le plus souvent, il sagit de
quelques variantes dune expression fige, si celle-ci contient des mots commutables. part
les variantes, il y a blocage lexical.
Le rapport entre contexte unique (dores et dj, au fur et mesure) et blocage lexical est
forcment trs troit, puisque ni les thmes uniques (au fur et mesure) ni les formes uniques
( la sauvette) ne sont commutables avec dautres mots
461
. Par consquent, les expressions
contexte unique font toutes partie de lensemble des expressions identifies par le critre de
blocage lexical, linverse ntant pas vrai (il y a dautres expressions que celles contexte
unique qui sont bloques).
Figure 36. Le rapport entre le blocage lexical et le contexte unique.
Les expressions identifies par le critre de contexte unique constituent un sous-ensemble de
celles identifies par le blocage lexical, puisquil est question dun blocage total. Aucune
commutation nest possible pour les mots contexte unique. Il existe pourtant une exception :
le procd de dfigement
462
. Plutt que de cacher le caractre fig dune expression, cette
possibilit de jouer avec la langue le met en vidence. Les mots contexte unique se prtent
bien ce jeu, tant donn quon ne fait allusion qu une expression imaginable. Les
dfigements des expressions contexte unique sont srement recherchs pour crer un effet,
et le locuteur qui les emploie est probablement trs conscient de lexpression originale, ce qui
distingue un dfigement dune variante communment utilise de lexpression originale. Nous
avons vu un exemple paronymique dans DEL : dans ma Ford intrieur
463
.
Lemploi des mots contextes limits (bon gr mal gr) nest pas restreint dans la mme
mesure que celui des mots contexte unique (au fur et mesure), et leur relation avec le
blocage lexical ne ressort pas aussi clairement. Dans une expression soumise au blocage
lexical total, aucun mot ne peut tre remplac par un autre. Cela est le cas dans les expressions
contexte unique. Dans les expressions contextes limits la situation est toute autre. Puisque
les mots contextes limits se retrouvent souvent ct de mots grammaticaux, ils se
461
Rappelons que si les mots ne sont pas commutables, cela peut sexpliquer par des raisons diverses : soit
lexpression devient incomprhensible, soit le sens change, soit lexpression reste comprhensible, mais nest
plus une expression fige conventionnelle. Voir 2.5 supra.
462
Voir 2.5.4 supra.
463
Cet exemple est qualifi de plaisanterie par -peu-prs (DEL:for).
blocage lexical
au cours de lanne
*au cours de lan
contexte unique
dores et dj
au fur et mesure
156
remplacent facilement par dautres mots. Considrons par exemple les expressions contextes
limits de bon aloi, bon escient, avoir la berlue et faire du rase-mottes. Il est clair que les
mots aloi, escient, berlue et du rase-mottes peuvent commuter avec dautres mots. Il est
galement possible de garder les mots contextes limits et de changer le reste de
lexpression. Jusquici, les expressions contextes limits ne semblent donc gnralement pas
soumises au blocage lexical, mme si certaines peuvent ltre. Comme nous lavons vu
464
, le
seul mot qui puisse tre remplac par le mot contexte unique gr dans lexpression bon gr
mal gr est an. Certaines expressions contextes limits prsentent donc plus de deux
variantes, tandis que dautres nexistent que dans deux expressions. Ainsi, les expressions de
gr ou de force et savoir gr sont soumises au blocage lexical puisquelle nont pas de
variantes. Lexpression contexte limit belle lurette ne se retrouve que dans trois
combinaisons : il y a/voici et depuis belle lurette. Cependant, la liaison entre le blocage
lexical et le critre de contextes limits nest pas aussi forte que celle entre le blocage lexical
et le critre de contexte unique. Il existe en effet des possibilits de commutations, mme si
les possibilits de substitution sont restreintes.
bl
Figure 37. Le rapport entre le blocage lexical et les contextes limits.
4.2.4 Rapport entre contexte unique et blocage morphologique
Il ressort des analyses du Chapitre 2 que les expressions contexte unique sont inflexibles
un trs haut degr. En consquence, elles sont soumises au blocage grammatical. Ici, nous
nous concentrerons sur le blocage morphologique, vu quil est possible den faire une analyse
systmatique assez complte. Les possibilits ventuelles de changer le genre restent le plus
souvent thoriques, puisque les mots contexte unique se retrouvent justement toujours dans
les mmes contextes, avec le mme donneur daccord. Ainsi, ladjectif trmire ne semploie
quavec rose, et trmier
465
nexiste pas, quoique cette forme ne soit thoriquement pas
464
4.2.2 supra.
465
Nous employons le symbole devant les mots non attests. Dans ces cas, les mots sont tellement restreints
quils manquent pratiquement de sens. Lastrisque * est galement employ devant des constructions non-
attestes, la diffrence tant que ces constructions sont fautives quoique souvent comprhensibles. Pourtant, la
distinction est parfois difficile faire.
ocage lexical
au cours de l anne
*au cours de l an
contextes limits
bon gr mal gr
de gr ou de force
il y a belle lurette
de bon aloi
de mauvais aloi
de bon augure
avoir du berlue
avoir de la chance
ne pas se faire de berlue
faire du rase-mottes
faire du ski
157
irralisable en franais
466
. Cet adjectif, qui correspond tymologiquement une forme de
doutremer , ne semble donc pas avoir le statut dadjectif, sauf en combinaison avec
rose
467
.
Dans la plupart des expressions contexte unique, le blocage morphologique concerne
galement le nombre. Ainsi, les expressions la redresse, la sauvette, tire-daile et tire-
larigot ne semploient pas au pluriel. Ainsi les formes suivantes semblent bannies : *aux
redresses, *aux sauvettes, *aux tire-dailes et *aux tire-larigots. Dautre part, ttons et les
us et coutumes ne sutilisent pas au singulier : * tton, *lus et coutume. De ce point de vue,
les expressions bte de somme et rose trmire sont plus flexibles, tant donn quil est
possible de les employer au pluriel. Cette flexibilit nest pas tonnante, vu quelles se
construisent diffremment.
Dans la mesure o il y a des verbes dans les expressions contexte unique, il nous semble
que les changements de temps ne posent pas de problme. Dans avoir maille partir, le verbe
avoir peut sutiliser au prsent aussi bien quau pass et au futur.
Il est peu tonnant que les mots contextes limits soient un peu plus flexibles que ceux
contexte unique. Parmi nos expressions, il y en a surtout quatre qui sont soumises la flexion
de genre. Puisque be ne se combine quavec bouche ou gueule, ladjectif apparat
uniquement la forme fminine. Fam, dans mal fam, par contre, saccorde avec un
substantif et change donc de genre selon le contexte. Mme si le nom croix est sous-entendu
lorsque ladjectif gamm est utilis, il faudrait se servir de la forme masculine si lon parlait
dun substantif masculin dnotant un objet orn de croix gammes. Le TLF en donne ainsi un
exemple : [] La caserne grise, avec un drapeau gamm dploy au-dessus du portail
[] (TLF:gamm).
Dans la mesure o rsin pourrait semployer pour dcrire un objet contenant de la rsine
de pin, et o cet objet serait dnot par un substantif fminin, il nous semble que la forme
rsine devrait galement pouvoir se manifester
468
. Lexistence du substantif rsine et du
verbe rsiner rend comprhensible ladjectif rsin qui est en fait un participe du verbe.
Pour ce qui est du nombre, il y a des mots contextes limits qui acceptent des
changements, tandis que dautres semploient soit au singulier, soit au pluriel. Ainsi, les mots
contextes limits suivants peuvent, selon les dictionnaires ou le corpus, sutiliser soit au
singulier soit au pluriel :
acabit/acabits dun bon acabit
de tous les acabits
berlue/berlues avoir la berlue
se faire des berlues
entrefaite/entrefaites sur cette entrefaite
466
Pour quun adjectif qualificatif soit utilisable, il faut quil ait un sens, tel que ce sens puisse dcrire quelque
chose. Pour ce qui est de ladjectif trmier, peut- il servir dpithte pour autre chose que pour les roses? Y a-t-
il des buissons ou des arbres trmiers? La raison dtre dune forme masculine de cet adjectif dpend de la
rponse ces questions.
467
Sur les pages www.google.fr, toutes les occurrences de trmier sont des exemples du nom de famille Trmier.
468
Cette hypothse semble saffirmer lors dune recherche sur www.google.fr. Le 24 fvrier 2003, nous avons
obtenu 71 occurrences de la forme fminine, qui se combine avec par exemple pte dans pte rsine. Dans le
corpus de journaux, il ny a cependant aucune occurrence de la forme fminine.
158
sur ces entrefaites
fam/fams N mal fam
N mal fams
gamm/gamms croix gamme
croix gammes
metteur/metteurs un metteur en scne
des metteurs en scne
noise/noises chercher noise qqn
chercher des noises qqn
pendable/pendables un cas pendable
des cas pendables
rsin/rsins N rsin
N rsins
rogatoire/rogatoires une commission rogatoire
469
des commissions rogatoires
Les cas suivants semploient uniquement au singulier :
aloi/*alois de bon aloi
*de bons alois
belle lurette/*belles lurettes il y a belle lurette
*il y a belles lurettes
escient/*escients bon escient
* bons escients
guise/*guises sa guise
* ses guises
instigation/*instigations linstigation de
*aux instigations de
main-forte/*main-fortes prter main-forte
*prter main-fortes
la nique/*les niques faire la nique
*faire les niques
le qui-vive/*les qui-vives sur le qui-vive
*sur les qui-vives
de raccroc/*de raccrocs de raccroc
*de raccrocs
rancart/*rancarts mettre au rancart
*mettre aux rancarts
rtorsion/*rtorsions mesure/-s de rtorsion
*mesure/-s de rtorsions
seing/*seings acte sous seing priv
*acte sous seings privs
talion/*talions loi du talion
*loi des talions
va-tout/*va-touts jouer son va-tout
*jouer ses va-touts
469
Commission rogatoire MOD. DR. dlgation faite par un tribunal un autre pour accomplir un acte de
procdure ou dinstruction (PR:commission).
159
Le cas de des/les clopinettes semble tre le seul des mots contextes limits qui semploie
uniquement au pluriel.
Une fois tablies, les expressions contexte unique ou contextes limits sont
probablement soumises aux mmes restrictions que dautres units de la langue. Quun
syntagme nominal ou verbal soit fig ou librement engendr, il doit tre intgr dans une
phrase selon les rgles syntaxiques tablies. Le blocage morphologique ne concerne pas plus
les expressions contexte unique que dautres expressions figes de la langue franaise.
4.3 Rapport entre non-compositionnalit et les autres critres
4.3.1 Rapport entre non-compositionnalit et syntaxe marque
Nous tenons compte du fait que les notions de non-motivation, sens figur, opacit et
inanalysabilit ont chacune leur importance pour le critre de non-compositionnalit. Ainsi,
lanalyse du rapport entre la compositionnalit et la syntaxe marque se fera en quatre tapes.
4.3.1.1 Rapport entre non-motivation et syntaxe marque
Il sagit maintenant de dcider si les mots constitutifs dune expression syntaxe marque
contribuent au sens de lexpression ou non. Il y a des expressions syntaxe marque dont un
mot ou plus sont non motivs. Dans lchapper belle, titre dexemple, la motivation de belle
nest pas trs claire. Cependant, dans la plupart des cas, les mots dune expression sont
motivs, que la syntaxe en soit marque ou non. Considrons les exemples baisser pavillon ou
donner carte blanche (expressions dont le SN manque de dterminant), dans lesquels les mots
sont motivs. Il y a ainsi des expressions figes qui sont motives tout en ayant une syntaxe
marque.
Dans les cas o les mots composants ne sont pas motivs, il semble que ce ne soit pas en
raison de la syntaxe. En ce qui concerne la syntaxe, lexpression non motive les carottes sont
cuites est une phrase canonique avec une syntaxe non marque. Encore une fois, les
ensembles dfinis par les deux critres examins se recouvrent partiellement.
non-motivation
les carottes sont cuites
syntaxe marque
lchapper belle
baisser pavillon
donner carte blanche
Figure 38. Le rapport entre la non-motivation et la syntaxe marque.
4.3.1.2 Rapport entre sens figur et syntaxe marque
Les expressions figes sens figur peuvent avoir une syntaxe marque ou pas. Les
expressions baisser pavillon et faire flche de tout bois peuvent semployer au sens figur et
elles manquent de dterminant, ce que nous avons considr comme syntaxiquement marqu.
Voir rouge a aussi une syntaxe marque et semploie au sens figur.
160
En revanche, avoir les yeux plus grands que le ventre et vendre la mche semploient au
sens figur tout en ayant une syntaxe non-marque.
Dautres expressions figes manquant de dterminant, telles que rebrousser chemin et
prter assistance sont plutt employes au sens propre. On voit galement que les expressions
avec un adjectif employ comme adverbe (un autre trait syntaxique marqu) semploient au
sens propre (sarrter net, travailler dur) ou au sens figur (voir rouge).
Il ny a pas de relation systmatique entre les deux critres de sens figur et de syntaxe
marque.
sens figur
avoi
Figure 39: Le rapport entre le sens f
i
gur et la syntaxe marque.
4.3.1.3 Rapport entre opacit et syntaxe marque
Les expressions figes opaques se retrouvent aussi bien dans des constructions syntaxe non
marque que dans des constructions syntaxe marque. Citons titre dexemples les
expressions la Saint-Glinglin, mordre la poussire, payer rubis sur longle et montrer patte
blanche. Elles peuvent tre considres comme tant opaques. Seules les deux dernires ont
une syntaxe marque.
Il y a aussi des expressions figes transparentes qui ont une syntaxe marque, telles
quavoir faim et sarrter net.
opaci
l
r les yeux plus grands que le ventre
vendre la mche
syntaxe marque
baisser pavillon
faire flche de tout bois
voir rouge
prter assistance
rebrousser chemin
sarrter net
travailler dur
t
a Saint-Glinglin
mordre la poussire
syntaxe marque
payer rubis sur longle
montrer patte blanche
avoir faim
sarrter net
Figure 40: Le rapport entre lopacit et la syntaxe marque.
161
4.3.1.4 Rapport entre inanalysabilit et syntaxe marque
Les expressions dans lesquelles on ne voit pas clairement quelle est la signification de chaque
partie sont inanalysables. Il y a des expressions figes inanalysables avec une syntaxe
marque. Les expressions bon chat bon rat, au jour le jour, baisser pavillon et montrer
patte blanche, entre autres, ont des traits des deux critres. Dautres expressions inanalysables
ont une syntaxe normale (les carottes sont cuites, prendre une veste).
Des expressions comme manger sal et sarrter net ont une syntaxe marque tout en tant
analysables.
les carottes sont cuites
inanalysabilit
prendre une veste
syntaxe marque
bon chat bon rat
au jour le jour
baisser pavillon
montrer patte blanche
manger sal
sarrter net
Figure 41: Le rapport entre linanaysabilit et la syntaxe marque.
4.3.2 Rapport entre non-compositionnalit et blocage lexical
Toutes les expressions figes sont soumises, dune manire ou dune autre, au blocage lexical.
Cela vaut galement pour les expressions identifies par les quatre notions de non-motivation,
sens figur, opacit et inanalysabilit. Cependant, les expressions figes non
compositionnelles ne sont pas plus concernes par le critre de blocage lexical que les
expressions identifies laide dautres critres. Certaines sont entirement bloques et
dautres admettent quelques variantes. Parfois un des mots dans une expression ne peut
commuter avec aucun autre mot (tant donn que le reste de lexpression est gard), tandis
quun autre mot se laisse remplacer. Un exemple dune expression la fois non motive,
sens figur, opaque et inanalysable est la bailler belle. Dans cette expression, le verbe bailler
ne se laisse pas remplacer tant quon garde le reste de lexpression. En combinaison avec la
bailler, ladjectif belle (employ comme adverbe) ne se laisse remplacer que par ladjectif
bonne. Il y a ainsi des intersections entre le blocage lexical et les quatre notions examines.
4.3.2.1 Rapport entre non-motivation et blocage lexical
Dans nos sources, lexpression les carottes sont cuites existe dans deux variantes. Les mots
constituants dans casser sa pipe et nuit blanche sont plus difficiles remplacer par dautres.
162
non-motivation
Figure 42: Le rapport entre la non-motivation et le blocage lexical.
En ce qui concerne lexpression avoir les yeux plus grands que le ventre elle est soumise au
blocage lexical tout en tant motive. Le rapport entre les deux critres examins nest pas
systmatique.
4.3.2.2 Rapport entre sens figur et blocage lexical.
Les expressions sens figur peuvent avoir ou non des variantes. Ainsi, dans lexpression
droit comme un N, il y a ou moins trois N possibles. En revanche, dans il y a N sous N,
anguille et roche sont les seuls N attests.
Il existe aussi des expressions figes sens propre qui nadmettent pas de commutation,
mme avec un synonyme.
sens figur
Figure 43: Le rapport entre le sens figur et le blocage lexical.
4.3.2.3 Rapport entre opacit et blocage lexical.
Douche cossaise est une expression fige opaque qui na pas de variantes lexicales. Il y a
cependant dautres expressions opaques qui se prtent substitutions, comme les carottes
sont/semblent cuites et tre gris/noir
470
.
163
470
Mme sil y a une petite diffrence de sens entre tre gris et tre noir, les deux expressions existent et leur
sens respectif est li linfluence de lalcool.
les carottes sont cuites
les carottes semblent cuites
blocage lexical
casser sa pipe
*casser sa bouffarde
nuit blanche
nuit claire
avoir les yeux plus grands que le ventre
*avoir les oreilles plus grands que le ventre
*avoir les yeux plus grands que lestomac
droit comme un cierge
droit comme un i
droit comme un pieu
blocage lexical
il y a anguille sous roche
* il y a poisson sous roche
*il y a anguille sous pierre
jour fri
*journe frie
toute la journe
*tout le jour
Figure 44: Le rapport entre lopacit et la syntaxe marque.
Figure 44 rend galement compte des expressions transparentes soumises au blocage lexical,
comme couvrir quelquun de boue.
4.3.2.4 Rapport entre inanalysabilit et blocage lexical.
Le verbe mettre se laisse remplacer par jeter dans lexpression inanalysable mettre/jeter qqn
hors de ses gonds. Lexpression casser sa pipe, en revanche, nadmet pas de variantes.
ina
opacit
les carottes sont cuites
les carottes semblent cuites
tre gris
tre noir
blocage lexical
douche cossaise
*bain cossais
*douche anglaise
couvrir quelquun de boue
*couvrir quelquun de vase
nalysabilit
mettre qqn hors de ses gonds
jeter qqn hors de ses gonds
blocage lexical
casser sa pipe
*briser sa pipe
*casser son cendrier
ventre terre
*estomac terre
*ventre sol
Figure 45: Le rapport entre linanaysabilit et le blocage lexical.
Lexpression analysable ventre terre est galement soumise un blocage lexical. Le blocage
lexical peut donc concerner tant les expressions analysables quinanalysables.
4.3.3 Rapport entre non-compositionnalit et blocage morphologique
Les restrictions sur lutilisation des diffrentes formes temporelles ne sont en gnral pas trop
rigoureuses.
En ce qui concerne le blocage morphologique du genre ou du nombre, il varie dune
expression lautre. Dans les cas o le N de la composition N + ADJ, (omelette norvgienne)
reprsente quelque chose de concret, elle a le plus souvent des dsinences, comme nimporte
quel syntagme nominal, surtout lorsque le nom en question est un mot comptable qui nest pas
164
prototypiquement (ou tymologiquement) issu dun nombre fixe. Cela semble valable mme
pour les expressions figes non motives, sens figur, opaques et inanalysables.
4.3.3.1 Rapport entre non-motivation et blocage morphologique.
Les expressions figes non motives de la structure VB + SN, casser sa pipe, faire la nique et
vendre la mche, semblent toutes soumises un blocage morphologique relatif la catgorie
du nombre. Elles sont toujours au singulier
471
. La mme chose vaut pour plusieurs
expressions dautres structures. Dans les carottes sont cuites cest lemploi au singulier qui est
bloqu. Comme nous lavons mentionn, les syntagmes du type N + ADJ semploient souvent
au singulier ou au pluriel. Dans dautres exemples, le blocage morphologique relatif la
catgorie du nombre est plus svre.
non-motivation
Figure 46: Le rapport entre la non-motivation et le blocage morphologique.
Les expressions motives peuvent aussi tre soumises au blocage morphologique. Dans
lexemple baisser pavillon, le nom est normalement au singulier, probablement parce quil y
avait un seul pavillon baisser quand cette expression tait utilise de manire plus concrte.
Dans marcher sur des ufs et avoir dautres chats fouetter par contre, les noms semploient
normalement au pluriel.
4.3.3.2 Rapport entre sens figur et blocage morphologique.
Le SN objet direct dune expression sens figur (jeter une pierre [dans le jardin de qqn]),
nest pas forcment soumis au blocage morphologique relatif la catgorie du nombre.
Cependant, le nombre fait parfois partie intgrante de lexpression. Comme le sens de
165
471
Employes au pluriel, elles auraient un autre sens et la squence ne serait plus interprte comme fige. Cela
est indiqu par le symbole .
omelette norvgienne
omelettes norvgiennes
blocage morphologique
casser sa pipe
casser ses pipes
faire la nique
*faire les niques
vendre la mche
vendre les mches
bon chat bon rat
* bons chats bons rats
il y a belle lurette
*il y a belles lurettes
les carottes sont cuites
la carotte est cuite
baisser pavillon
*baisser pavillons
marcher sur des ufs
marcher sur un uf
avoir dautres chats fouetter
avoir un autre chat fouetter
lexpression donner carte blanche est quon laisse quelquun linitiative de laction, on
dirait plutt On lui a donn carte blanche plusieurs fois que * On lui a donn plusieurs
cartes blanches . Il y a dans ce cas blocage morphologique en ce qui concerne le nombre.
sens figur
jeter une pierre dans le jardin de qqn
jeter des pierres dans le jardin de qqn
blocage morphologique
vendre la mche
vendre les mches
baisser pavillon
*baisser pavillons
donner carte blanche
*donner cartes blanches
baisser les bras
baisser le bras
prendre une veste
prendre deux, trois, plusieurs vestes
prendre une culotte
prendre quatre culottes
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
Figure 47: Le rapport entre le sens figur et le blocage morphologique.
Il est particulirement intressant dexaminer les syntagmes qui peuvent avoir soit un sens
figur soit un sens propre (telles que baisser les bras, prendre une veste et prendre une
culotte). Il savre alors que lexpression sens figur est effectivement soumise au blocage
morphologique, tandis que lorsquon utilise le syntagme au sens propre, on est libre de
modifier le nombre du nom. Il y a donc un rapport assez troit entre le sens figur et le
blocage morphologique. Notons quand mme quun syntagme sens propre ne subit pas le
blocage morphologique et que parmi toutes les combinaisons que nous avons examines
jusquici, cest la seule qui ne soit pas atteste. Les expressions sens propre les plus figes
sont impossibles modifier, en raison de leurs constructions plutt quen raison des blocages
morphologiques. Citons titre dexemples tt ou tard, sain et sauf et sr et certain.
4.3.3.3 Rapport entre opacit et blocage morphologique.
Le rapport entre une expression fige opaque et son blocage morphologique ventuel dpend
de lexpression en question. Ainsi, parmi les expressions fige opaques, lon retrouve celles
qui sont soumises un tel blocage, et dautres qui sont flchies en nombre.
166
Figure 48: Le rapport entre lopacit et le blocage morphologique.
Des expressions figes transparentes (avoir les yeux plus grands que le ventre, montrer les
griffes) soumises au blocage morphologique, se laissent galement reprer. Le recouvrement
entre lopacit et le blocage morphologique nest pas total. Cependant, les syntagmes du type
N + ADJ mis part, il semble y avoir un blocage de nombre.
4.3.3.4 Rapport entre inanalysabilit et blocage morphologique.
Les expressions figes inanalysables doivent galement tre examines cas par cas. Il est
pourtant difficile de reprer des expressions figes inanalysables qui ne soient pas bloques
grammaticalement
472
.
ina
Figure 49: Le rapport entre linanalysabilit et le blocage morphologique.
167
472
Cf. Misri (1987b:126-132).
opacit
omelette norvgienne
omelette norvgiennes
blocage morphologique
prendre une veste
prendre deux vestes
la Saint-Glinglin
*aux Saint-Glinglins
casser sa pipe
casser ses pipes
avoir les yeux plus grands que le ventre
*avoir un il plus grand que le ventre
montrer les griffes
montrer une griffe
nalysabilit
fausse note
blocage morphologique
au jour le jour
mordre la poussire
au fur et mesure
bon chat bon rat
prendre une veste
la bailler belle
avoir dautres chats fouetter
?avoir un autre chat fouetter
vendre la mche
huis clos
donner carte blanche
Il y a galement des expressions analysables soumises au blocage morphologique. Ainsi, le
rapport entre linanalysabilit et le blocage morphologique nest pas un rapport didentit,
mme sil semble important.
4.4 Rapport entre syntaxe marque et les autres critres
4.4.1 Rapport entre syntaxe marque et blocage lexical
Il sagit maintenant de dcider comment et pourquoi les expressions figes dont la syntaxe est
marque sont concernes par le blocage lexical. Les deux types de syntaxe marque que nous
avons identifis dans les expressions figes sont labsence de dterminant et ladjectif
employ comme adverbe.
4.4.1.1 Rapport entre expressions figes sans dterminant et blocage lexical
Les verbes sens trs gnral, comme avoir et faire, se combinent avec un nombre non
ngligeable de noms sans dterminant. Dautres verbes qui sutilisent en combinaison avec un
syntagme nominal objet, o le nom na pas de dterminant, sont entre autres baisser, dclarer,
donner, fermer, menacer, mettre, montrer, payer, perdre, plier, porter, prendre, rebrousser,
refaire et souffler
473
. La possibilit de remplacer le nom dans ces syntagmes diffre dun
verbe lautre. Dans le corpus informatis, les verbes suivants ne se laissent suivre que par un
ou deux noms sans dterminant (donns entre parenthses)
474
: baisser (pavillon, figure),
dclarer (forfait), fermer (boutique), mettre (fin), plier (bagage), rebrousser (chemin), et
refaire (alliance, surface). En revanche, les verbes donner, perdre, porter et prendre se
combinent avec 8-31 noms diffrents employs sans dterminant. Ceux-ci sont donc
concerns par le blocage lexical un moindre degr que les verbes baisser, dclarer, fermer,
mettre, plier, rebrousser et refaire qui sont employs dans les expressions figes sans
dterminant. Il est cependant question dun blocage lexical, car dans la plupart des cas, les
possibilits de faire commuter un des mots avec un autre sont restreints.
473
Voir supra 2.4.1.
474
Les verbes souffler, menacer, montrer et payer ne se manifestent pas dans la construction sans dterminant
dans notre corpus.
168
porter
porter
Figure 50: Le rapport entre la syntaxe marque (nom sans dterminant) et le blocage lexical.
Le plus souvent, la possibilit de remplacer un mot par un autre dpend de lexistence de plus
dune variante de lexpression en question il nest pas question de commutations libres.
4.4.1.2 Rapport entre les expressions figes avec adjectif employ comme adverbe et
blocage lexical
Nous avons recherch, dans le corpus, les verbes arrter, calculer, chanter, couper, coter,
crier, deviner, savoir, faire, filer, frapper, gagner, jouer, parler, penser, sentir, taper, tenir,
tourner, travailler et voler dans toutes les formes personnelles
475
, dans le but de retenir les cas
o ils sont combins avec un adjectif employ comme adverbe. Les combinaisons suivantes
ont t releves :
VERBE + ADJECTIF VERBE + ADJECTIF
chanter faux jouer hard [angl.]
chanter juste jouer juste
couper court ( qqn) jouer soft [angl.]
coter cher parler haut
crier fort penser tout haut
crier tout bas penser tout bas
crier tout haut penser trs fort
faire exprs sentir bon
filer doux
476
tenir bon
frapper fort tourner court
jouer plus court tourner rond
jouer gros
Les combinaisons crier tout haut, jouer hard, jouer soft et jouer plus court ne sont pas cites
comme figes dans les sources consultes ce sujet
477
. Cependant, les verbes cits ne sont pas
169
475
1:e personne singulier 3:e personne pluriel.
476
Filer doux obir (DEI:filer).
syntaxe marque (nom sans dterminant)
assistance
secours
prendre corps
prendre forme
blocage lexical
baisser pavillon
*baisser drapeau
*descendre pavillon
donner carte blanche
*offrir carte blanche
prendre le mors aux dents
*prendre le levier aux dents
donner sa langue au chat
*donner sa langue au tigre
combins avec dautres adjectifs dans le corpus. Il savre galement que les verbes ne se
laissent remplacer que trs rarement. Les combinaisons coter cher et tre cher ont peu prs
le mme sens :
Le commerce extrieur cote cher ltat. (ME 83 31:1)
Le dollar est cher parce quil est trs demand sur les marchs des changes [...]
(ME 38:1)
Cher se combine galement avec le verbe payer :
[...] le mdecin nest pas de ces fanatiques adeptes du naturel tout prix, dont
certains nont pas fini de payer cher les utopies. (LB860211)
part ces cas, les expressions cites sont soumises un blocage lexical assez svre.
syntaxe marque (adjectif comme adverbe)
Figure 51: Le rapport entre la syntaxe marque (adjectif employ comme adverbe) et le blocage
lexical.
videmment, les expressions dune syntaxe non marque peuvent aussi tre soumises au
blocage lexical.
4.4.2 Rapport entre syntaxe marque et blocage morphologique
Comme nous avons identifi seulement deux types de syntaxe marque parmi les expressions
figes qui apparaissent frquemment, la question de leur blocage morphologique ventuelle se
restreint quelques possibilits. Il sagit de dcider sil est possible de flchir les expressions
syntaxe marque en changeant des traits prsents dans lexpression en question.
170
477
Le Goffic (1993), Riegel et al. (1994) et Noailly (1999).
coter cher
tre cher
payer cher
blocage lexical
couper court
*trancher court
crier fort
*hurler fort
sentir bon
*f leurer bon
couper les cheveux en quatre
*couper les cheveux en trois
payer en chats et en rats
*payer en chiens et en chats
coter les yeux de la tte
*coter les oreilles de la tte
4.4.2.1 Rapport entre expressions figes avec nom sans dterminant et blocage
morphologique
Pour ce qui est des expressions figes sans dterminant, les variations pertinentes examiner
sont les variations de temps et de nombre. Nous examinerons galement les consquences de
lintroduction dun article (dfini ou indfini) devant le nom qui semploie normalement sans
dterminant dans les expressions figes. Regardons un chantillon dexemples dexpressions
figes sans dterminant :
Expression dorigine Modification du nombre
avoir droit de cit avoir droits de cit
avoir gain de cause avoir gains de cause
avoir affaire avoir affaires
baisser pavillon baisser pavillons
chanter victoire chanter victoires
crier gare crier gares
crier haro crier haros
dclarer forfait dclarer forfaits
jouer cartes sur table jouer carte sur table
donner carte blanche donner cartes blanches
tre partie remise tre parties remises
faire amende honorable faire amendes honorables
faire cavalier seul faire cavaliers seuls
faire bonne contenance faire bonnes contenances
fermer boutique fermer boutiques
mettre fin mettre fins
obtenir gain de cause obtenir gains de causes
parler argent parler argents
plier bagage plier bagages
prendre fait et cause prendre faits et causes
rebrousser chemin rebrousser chemins
refaire surface refaire surfaces
rester bouche bante rester bouches bantes
Les formes temporelles sont presque toujours possibles modifier. Elles sont plutt
restreintes par le contexte que par la syntaxe marque. Les changements de nombre semblent
moins intressants. Il est probable que les dfigements de suffixes ou de dsinences
normalement inflexibles seraient plutt pris pour des erreurs que pour des calembours.
Bien que les expressions sans dterminant relvent dune construction assez productive
478
,
le dterminant ne se laisse pas enlever dans nimporte quelle circonstance. Dans certaines
expressions qui en manquent, il nest pas facile den introduire un. Par consquent, la
construction est, au moins un certain degr, bloque grammaticalement.
Que se passe-t-il si les exemples cits sont employs avec un dterminant devant le nom ?
La rponse cette question nest pas la mme dans tous les cas. Certains syntagmes
nominaux, comme affaire ou pavillon se retrouvent dans le corpus avec ou sans dterminant.
Cependant, il faut noter que le sens nest pas toujours le mme. Souvent, lemploi dun
478
Voir 2.4.1 supra. Cf. aussi Bjrkman (1978), Norstedts franska idiombok (1991) et Gross (1996).
171
dterminant devant le nom signifie quil a un rfrent, tandis que labsence de dterminant
signale que le substantif ne rfre pas (Curat 1999:224). Comparons les exemples suivants :
Abrams a affaire une arme cure, drogue, o il arrive que les soldats
jettent des grenades sur leurs suprieurs. (MO 25 janvier 1973)
Le lieutenant Castillo confie laffaire Crockett et Tubbs... (LB871127)
Dans la phrase o affaire nest prcd daucun dterminant, cest videmment le sens de
lexpression avoir affaire qqn qui est voulu. Affaire na pas le mme sens que laffaire
dans la deuxime phrase, o un article dfini est employ devant le nom. Dans ce cas, le nom
affaire est individuellement porteur de sens et peut tre isol. Laffaire en question peut mme
tre confie quelquun dautre.
Dans lexpression baisser pavillon, qui veut dire savouer battu, le nom pavillon na pas
de dterminant :
[...] la lutte devient trop ingale et il faut baisser pavillon. (ME 84 47:1)
Les exemples suivants montrent quil peut semployer avec un article :
Larme constitue sur le sol de lAngleterre et qui combat sous le pavillon
national (marqu dune croix de Lorraine) va, elle aussi, grandir peu peu.
(MO
479
)
Au 1er juillet 1987, on comptait 269 navires battant pavillon franais et 91
contrls plus de 50% par des socits franaises mais arborant un pavillon
tranger pour des raisons de moindre cot dquipage. (ME 87 38:1)
Mme si dans les trois exemples que nous venons de citer, le mot pavillon fait rfrence
un drapeau, il nous semble que dans lexemple sans dterminant, le nom ne rfre pas un
drapeau concret et spcifique. Lintroduction dun article devant pavillon prcd par
baisser rendrait le pavillon en question plus concret il ne serait plus question de se
rendre, mais de faire descendre un drapeau concret.
On remarque la similarit avec lexpression refaire surface :
Quatre tours defforts discontinus, se faufiler de lun lautre pour, enfin,
refaire surface derrire Bayle. (SO880411)
Avec un article devant surface, il serait question de travailler sur une surface concrte et de la
refaire, tandis que refaire surface veut dire rapparatre. Il y a cependant des cas o on peut
dire que mme le nom sans dterminant rfre. Lorsque les expressions mettre fin et
rebrousser chemin sont utilises, les noms fin et chemin ont souvent des rfrents.
Cet accord met fin la grve des mtallurgistes qui, depuis le 14 mai, rclament
les trente-cinq heures. (ME 84 3:1)
479
Date non indique dans larticle.
172
[...] on apprend Washington que plusieurs navires en route vers Cuba ont
rebrouss chemin avant de parvenir dans la zone du blocus. (MO 25 octobre
1972)
On voit donc dans les exemples cits que lemploi dun dterminant l o il en manque est
effectivement souvent bloqu, puisque le sens change lors lintroduction dun dterminant.
Une expression fige syntaxe marque peut tre la fois flexible et soumise au blocage
morphologique. Les restrictions temporelles sont moins courantes que les restrictions qui
portent sur le nombre et sur la prsence du dterminant.
a
syntaxe marque (nom sans dterminant)
voir maille a partir
avait maille partir
aura maille partir
blocage morphologique
baisser pavillon
*baisser pavillons
*baisser un pavillon
avoir affaire
*avoir une affaire
vendre la mche
*vendre les mches
Figure 52: Le rapport entre la syntaxe marque (nom sans dterminant) et le blocage morphologique.
4.4.2.2 Rapport entre les expressions figes avec un adjectif employ comme adverbe et le
blocage morphologique
En ce qui concerne les expressions o un adjectif est employ la place dun adverbe, les
seuls lments susceptibles dtre modifis sont le verbe et ladjectif. Ayant constat que le
plus souvent, le blocage morphologique ne fixe pas le temps du verbe, nous examinerons le
blocage morphologique des adjectifs des exemples que voici :
VERBE + ADJECTIF VERBE + ADJECTIF
chanter faux jouer hard [angl.]
chanter juste jouer juste
couper court ( qqn) jouer soft [angl.]
coter cher parler haut
crier fort penser tout haut
crier tout bas penser tout bas
crier tout haut penser trs fort
faire exprs sentir bon
filer doux tenir bon
frapper fort tourner court
jouer plus court tourner rond
jouer gros
173
Dans les cas o les adverbes correspondant aux adjectifs cits ne sont pas employs, diverses
explications peuvent tre avances. Soit ils ne sont jamais (ou trs rarement) employs
480
, soit
le sens en est particulier ou spcialis. Nous constatons que hautement semble semployer
surtout en combinaison avec les adjectifs :
hautement positif
souhaitable
qualifi
spcialis
informel
Cependant, hautement se combine avec des verbes, entre autres dans les syntagmes dclarer
publiquement et hautement et proclamer hautement.
Plusieurs des adjectifs employs comme adverbes fonctionnent comme des adverbes de
manire. Dans la plupart des combinaisons cites, la fonction de ladverbe correspondant est
galement un adverbe de manire :
VERBE + ADJECTIF Adverbe de manire correspondant
chanter faux faussement
crier fort fortement
crier bas bassement
crier haut hautement
faire exprs expressment
filer doux doucement
frapper fort fortement
parler haut hautement
penser haut hautement
penser bas bassement
penser fort fortement
Il nous semble quil ny ait pas de raison grammaticale de nature formelle qui empche
lutilisation de ladverbe correspondant. Cependant, lemploi des adverbes de manire semble
bloqu dans les combinaisons VB + ADJ dans les cas cits.
La raison pour laquelle lemploi de ladverbe correspondant est banni est plus vidente
dans les cas o lemploi de ladverbe change le sens de la combinaison. Parfois, ladverbe
justement employ la place de ladjectif juste est plutt un adverbe affirmatif quun adverbe
de manire.
Ladverbe court a la dfinition [d]une manire courte ou de manire rendre court
(PR:court). Or, dans couper court, ce dernier mot ne dcrit pas la manire avec laquelle on
coupe et ne fonctionne ainsi pas comme adverbe de manire. Dans cette combinaison,
480
Les adverbes courtement et grossement ne sont pas attests dans nos sources, ni dans les dictionnaires, ni
dans le corpus. Cependant, lors dune recherche la page internet de www.google.fr, nous avons trouv un
nombre non ngligeable doccurrences de courtement . La plupart de ces attestations semblent se retrouver
dans un contexte scientifique qui traite de la physionomie des plantes. On retrouve galement quelques
occurrences de grossement .
174
couper court a le sens particulier dinterrompre. Ladjectif court semploie galement
comme adverbe dans jouer court et tourner court. Tourner court veut dire cesser ou chouer
brusquement (DEL:court) ou faire un brusque changement de direction (PR:court) mais a
aussi le sens figur passer dune chose lautre sans transition (PR:court). Jouer court nest
pas une expression enregistre dans les dictionnaires, mais elle sutilise dans le monde sportif.
Le seul exemple repr dans le corpus est employ dans le contexte dun match de tennis:
Aprs le premier set, que javais remport [...], il a jou plus court et ma ainsi
empch de dvelopper mon jeu dattaque. (SO990401)
Ces verbes ne semploient pas avec ladverbe courtement , qui est ici bloqu de lusage.
Dans la combinaison coter cher, cher fonctionne comme un adverbe de quantit ou
dintensit. Selon le PR, lemploi de chrement en combinaison avec les verbes acheter,
payer et vendre est vieux
481
.
Dans le PR (gros) on lit jouer gros, une grosse somme . On lit galement risquer
gros : sexposer de graves difficults et crire gros, avec de gros caractres . Jouer
gros semploie souvent avec le mme sens que risquer gros. Citons titre dexemple encore
un extrait paris dans un contexte de sport :
Mais son adversaire, champion du monde des lourds [...], jouera encore plus
gros : une dfaite mettrait irrmdiablement fin sa tentative de retour et ses
espoirs daffronter le roi amricain Mike Tyson, champion du monde reconnu
par les trois fdrations. (LB871128)
En ce qui concerne jouer hard et jouer soft, nous constatons que hard est cit dans le PR,
mais seulement comme adjectif ou nom. Ni hardement ni softement ne sont attsts dans le
corpus ou dans les dictionnaries
482
.
Bon semploie comme adverbe dans sentir bon. Il ne dcrit dans ce cas pas la manire
deffectuer laction, mais plutt la qualit de lodeur. Il est intressant que bien semploie
comme adverbe de manire, comme dans bien sentir. Bien sutilise aussi dans se sentir
bien. Lemploi de bien en combinaison avec sentir nest donc pas entirement exclu, mais bon
ne se laisse pas remplacer par bien, puisque les contextes de leurs utilisations respectives sont
nettement diversifis.
Lexpression tenir bon a le sens de bien rsister. Au cas o on voudrait parler de la
manire de tenir quelque chose, cest ladverbe bien qui est de rigeur. Ainsi, bien est bloqu
dans tenir bon.
Dans tourner rond, finalement, rond semploie comme adverbe de manire quand
quelque chose tourne dune manire rgulire. Cependant, ladverbe rondement est aussi
utilis, dans le sens avec vivacit et efficacit ou dune manire franche et directe
(PR:rondement). Rond semploie galement avec la prposition en et dcrit alors un
mouvement circulaire (PR:rond).
481
Sauf lorsquil est question dun emploi figur.
482
Lors dun recherche sur www.google.fr, hardement figure dans des sites sur lancien franais. Ce qui tonne
est que softement semble semployer comme adverbe dans certains contextes. Cependant, ni hardement ni
softement ne se combine avec le verbe jouer.
175
syntaxe marque (adjectif comme adverbe)
Figure 53: Le rapport entre la syntaxe marque (adjectif employ comme adverbe) et le blocage
morphologique.
4.5 Rapport entre blocage lexical et blocage morphologique
Nous avons constat que toutes les expressions sont soumises au blocage lexical. Les
expressions qui ne sont pas entirement bloques sont celles qui existent dans deux variantes
ou plus, mais les mots les composant ne sont normalement pas remplaables sans restrictions.
Les expressions soumises au blocage morphologique fonctionnent de la mme faon.
douche cossai
coter cher
cote cher
cota cher
couper court
coupe court
a coup cout
blocage morphologique
couper court
*couper courtement
filer doux
*filer doucement
couper les cheveux en quatre
*couper les cheveux en trois
payer en chats et en rats
*payer en chiens et en chats
coter les yeux de la tte
*coter les oreilles de la tte
blocage lexical
se
omelette norvgienne
coter cher
avoir maille partir
blocage morphologique
croix gamme
rose trmire
tirer le diable par la queue
bouche be
gueule be
Figure 54: Le rapport entre le blocage lexical et le blocage morphologique.
Nous constatons que la plupart des expressions figes contenant un verbe se prtent la
modification du temps grammatical utilis. Celles-ci ne sont donc pas soumises au blocage
morphologique.
176
4.6 Rsum
Dans le Chapitre 4, nous avons nouveau regard de prs les critres tudis dans les
chapitres prcdents, cette fois dans le but dexaminer les relations qui existent entre eux. La
question tudie est la suivante:
Y a-t-il des relations systmatiques entre les critres impliquant quune expression
fige identifie par un critre est toujours galement identifiable par un autre ?
Selon le Chapitre 3, deux des critres examins sont ncessaires pour quil y ait figement,
savoir la mmorisation et le blocage lexical. La relation entre la mmorisation et les autres
critres a ainsi t vite tablie : quel que soit le critre appliqu, on arrive identifier une
expression fige si elle est galement mmorise. La mme chose vaut pour le blocage
lexical. Nous avons tout de mme examin de plus prs les relations entre le blocage lexical et
les autres critres en raison des variantes de certaines expressions qui existent malgr tout.
Nous avons constat que le blocage morphologique des dsinences temporelles est assez
rare. Dans la plupart des cas, les expressions figes contenant un verbe peuvent apparatre
dans diffrentes formes verbales
483
. Le blocage morphologique des flexifs du genre
grammatical nest, pour la plupart, pas trs intressant et ne concerne quun nombre limit
dadjectifs, en raison de leur utilisation restreinte.
Le plus souvent, il y a une relation de chevauchement entre deux critres. Ainsi,
lapplication de deux critres diffrents peut identifier la mme expression fige.
Normalement il ny a pourtant pas identit entre les deux critres. Souvent il y a des
expressions identifies par lapplication dun des critres mais pas de lautre et vice versa.
Cela est valable pour les relations entre contexte unique et sens figur, contexte unique et
inanalysabilit, contexte unique et syntaxe marque et entre contexte unique et blocage
morphologique.
En revanche, le rapport entre contexte unique et non-motivation (et entre contexte unique et
opacit) mrite un peu plus dattention. Ici, il savre que la diffrence entre les deux types de
mots contexte unique a une importance particulire. Les thmes uniques sont toujours non
motivs, tandis que les formes uniques sont motives. (Les thmes uniques sont ainsi
pratiquement toujours opaques tandis que les formes uniques sont transparentes).
Une autre relation, plus rare, est celle entre les critres de contexte unique et de blocage
lexical. Le critre de contexte unique est compltement inclus dans celui de blocage lexical,
puisquaucune commutation ny est possible. La seule exception est le dfigement, qui
confirme plutt que contredit le blocage lexical dont il est question. En ce qui concerne le
critre de contexte limit, sa relation avec le blocage lexical est moins troite et il existe
parfois des variantes dune expression.
Les rapports entre les quatre notions regroupes sous le terme de non-compositionnalit et
la syntaxe marque ntonnent gure, puisque ces rapports impliquent toujours un
chevauchement. La mme chose vaut pour leurs relations avec le blocage lexical, si on
compte les variantes possibles comme pas entirement incluses dans le blocage lexical. Le
483
Lexception serait des phrases entires comme Pierre qui roule namasse pas mousse ou Lhabit ne fait pas le
moine, mais mme celles-ci sont attestes limparfait sur lInternet.
177
blocage lexical tant omniprsent, nous aurions pu laisser toutes les expressions figes tre
identifies par ce critre, quelles prsentent des variantes ou non.
Arrive au rapport entre le blocage morphologique et les quatre critres regroups sous le
terme de non-compositionnalit, nous avons constat que cest ici que se trouvent les
dcouvertes les plus intressantes. lexception de la squence N + ADJ , qui nest pas
souvent soumise au blocage morphologique relatif la catgorie du nombre, quelle soit une
expressions fige ou non
484
, la plupart des expressions figes semblent semployer soit au
singulier soit au pluriel. Le blocage relatif la catgorie du nombre opre peu prs de la
mme manire pour les syntagmes non motivs (casser sa pipe), les syntagmes opaques
(vendre la mche) et les syntagmes inanalysables (mordre la poussire). Le rsultat dune
modification du nombre grammatical est le plus souvent une squence qui ne semploie pas,
et qui ne donne pas leffet ludique ou expressif que peut donner le dfigement dont nous
avons parl au sujet du blocage lexical. Le nouveau syntagme semble alors plutt
bizarre: ?faire les niques, ?les bailler belle. Modifier le nombre de certaines expressions
figes sens figur rend impossible une interptation fige et lexpression devient soit une
suite sens propre, comme dans prendre une veste > prendre deux vestes, prendre une
culotte > prendre quatre culottes, baisser les bras > baisser le bras, soit une suite non
acceptable (ou du moins non utilise) comme dans baisser pavillon > *baisser pavillons ou
donner carte blanche > *donner cartes blanches.
Les rapports entre la syntaxe marque et le blocage lexical rvlent, encore une fois, que
les expressions figes de syntaxe marque sont effectivement soumises au blocage lexical. Ce
qui est intressant est que le blocage lexical est plus ou moins fort selon le verbe employ
dans lexpression. Pour examiner la relation entre syntaxe marque et blocage
morphologique, on peut, aprs avoir constat que le blocage relatif aux catgories du temps et
du nombre nest pas trs significatif, ajouter un examen de larticle. Introduire un article
devant les noms qui nen ont pas a leffet de donner au SN ainsi constitu une fonction
rfrentielle. Il sest aussi avr, lors de lexamen des expressions figes avec un adjectif
employ comme adverbe, que ladverbe correspondant ladjectif est le plus souvent bloqu
ou, dans les deux cas de courtement et grossement, nest pas attest dans nos sources.
Finalement, lexamen du rapport entre le blocage lexical et le blocage morphologique a
rvl que les expressions soumises au blocage morphologique sont aussi bloques
lexicalement. Les expressions soumises au blocage lexical (cest--dire toutes les expressions
figes) sont surtout soumises au blocage morphologique relatif la catgorie du nombre (et,
o cela est pertinent, celui du genre).
Bref, on constate que cest la structure syntaxique dune expression fige plutt que
lappartenance un ensemble cr par lapplication dun des critres qui influence
directement la possibilit de varier de quelle manire que ce soit une expression fige. Le
rapport entre le sens figur et le blocage lexical est particulirement intressant, surtout dans
les cas o une expression perd son trait fig en consquence de la modification du nombre
grammatical.
484
Les squences N + ADJ peuvent tre motives (gros bonnet) ou non (douche cossaise), au sens figur (gros
bonnet) ou au sens propre (clibataire endurci), opaques (douche cossaise) ou transparentes (fausse alerte),
analysables (clibataire endurci) ou non (gros bonnet). Lorsque le N peut tre conu comme un objet physique
ou du moins comptable, il peut semployer soit au singulier soit au pluriel.
178
5 Lexpression fige comme catgorie linguistique
Nous avons mis lhypothse que les expressions figes constituent une catgorie base sur
des ressemblances de familles plutt que sur des conditions ncessaires et suffisantes
485
. Cette
hypothse sera examine dans ce chapitre. Nous soulignons pourtant que ce chapitre ne
constitue quune bauche.
5.1 Ressemblances de famille
La thorie des ressemblances de famille, dont lorigine est gnralement attribue
Wittgenstein, propose un moyen de catgorisation dans lequel tous les membres de la
catgorie ne partagent pas forcment les mmes proprits. [L]air de famille , crit
Kleiber (1991:113) [...] caractrise un ensemble de similarits entre les diffrentes
occurrences dune mme famille, . Ces ressemblances sont des proprits qui ne sont pas
ncessairement partages par tous les membres, mais que lon retrouve au moins chez deux
membres
486
. La structuration en ressemblances de famille permettrait de se dispenser de
lapplication des conditions ncessaires et suffisantes, qui sest avre ne pas tre rentable.
Comme le montre le Chapitre 3, un seul des critres examins dans cette tude fournit des
conditions ncessaires et suffisantes pour dfinir une expression fige : le blocage lexical.
Nous avons galement montr que les seuls critres ncessaires selon ce modle de
catgorisation sont le blocage lexical et la mmorisation. Les autres critres ne seraient donc
pas ncessaires pour dcrire le phnomne de figement, bien que la plupart dentre eux
semblent pertinents pour la dfinition de lexpression fige. Voil quun examen de la notion
de ressemblance de famille simpose, afin de voir si elle peut rendre compte de la dlimitation
de la catgorie linguistique dexpression fige. Nous esprons que la thorie des
ressemblances de famille pourra expliquer comment les critres analyss aident former la
catgorie de lexpression fige sans pour autant tre des critres dcisifs.
485
Voir chapitre 3, supra.
486
Le centre dintrt de notre travail se limitant aux expressions figes et leur appartenance ventuelle une
catgorie linguistique, nous ne prsentons que brivement la thorie de la ressemblance de famille. Pour le
lecteur qui sintresse davantage cette thorie et dautres thories de catgorisation, nous renvoyons
Wittgenstein (1972), Rosch et Mervis (1975), Lakoff (1987) et Kleiber (1990).
179
5.2 Critres et indices
Puisque les critres de blocage lexical et de mmorisation sont ncessaires dans la dfinition
de lexpression fige, ils ne seront pas systmatiquement exemplifis ici. Ils sont considrer
comme omniprsents.
Comme nous lavons vu
487
, les critres de contexte unique, de non-motivation, dopacit et
dinanalysabilit sont des conditions suffisantes pour identifier une expression fige. Ils sont
donc pertinents pour la description des expressions figes. Or, comme nous lavons signal,
ils sappliquent plus ou moins facilement. Le critre de contexte unique est facile appliquer,
mais nidentifie quun groupe restreint dexpressions figes. La non-motivation concerne
souvent uniquement une partie de lexpression en question. Souvent, il y a donc non-
motivation partielle. Le critre dopacit tant difficile appliquer, il sera toutefois inclus
dans lanalyse. Prcisons quil est logique que les expressions non motives soient galement
opaques. Les expressions opaques, en revanche, ne sont pas forcment non motives.
Le sens figur nest une condition ni ncessaire ni suffisante pour rendre compte du
figement. Nous avons choisi de linclure dans lanalyse, en raison du statut dindice que nous
lui avons attribu dans le Chapitre 3
488
.
5.3 Expressions figes et critres
Lexpression fige en tant que signe linguistique a, comme la plupart des signes, un signifiant
et un signifi. Le signifiant est, comme cest souvent le cas pour les notions abstraites, plus
facile dcrire que le signifi. Cependant, on peut imaginer que les notions dcrites par les
noms des critres font partie, dune manire ou dune autre, du signifi de lexpression fige.
Toutefois, en ce qui concernent les critres, nous navons pas de termes pour dcrire leur
signifi. Il nexiste pas de mot pour dcrire ce quils auraient en commun. Le trait quils
partagent est quils arrivent cerner certaines squences de mots. Dans ce qui suit, nous
allons donc essayer didentifier les ressemblances de famille des critres laide des
expressions figes sur lesquelles ils ont t appliqus. Cest en regardant les expressions
identifies quil est possible de comparer les traits que les critres ont en commun.
Un chantillon dexpressions figes de divers types montrera que la plupart dentre elles
ont des proprits correspondant plus dun critre. Notre chantillon se compose des
expressions figes suivantes :
1 bon chat bon rat 6 douche cossaise
2 la queue leu leu 7 les carottes sont cuites
3 la Saint-Glinglin 8 mordre la poussire
4 au jour le jour 9 payer rubis sur longle
5 baisser pavillon 10 vendre la mche
Tableau 7. chantillon dexpressions figes examines.
487
Voir par exemple 3.7 supra.
488
Les critres de syntaxe marque et de blocage grammatical ont aussi t classs comme des indices plutt que
des critres. La syntaxe marque sera incluse dans lexamen des critres dans le cadre de ressemblances de
famille. En revanche, le blocage grammatical sera omis de cet examen, en raison de limpuissance de ce critre,
surtout en ce qui concerne le blocage des transformations. Ce nest quaprs avoir essay les transformations
prtendues impossibles que lon peut tirer des conclusions sur le figement ventuel des expressions concernes
par ce critre.
180
Ce choix a pour but de runir des expressions de structures diffrentes qui soient en mme
temps identifiables par plus dun critre examin. Un examen systmatique montrera quil y a
toujours plus dun critre pertinent pour chaque expression. Effectivement, les critres se
laissent organiser en ressemblances de famille.
Le schma ci-dessous, inspir par Givn (1986:78) en offre une illustration graphique :
Contexte unique Inanalysabilit Opacit
2 5 4 8 1
3 6 7 10 9
Sens figur Non-motivation Syntaxe marque
Figure 55: Les critres de figement organiss en ressemblances de famille (figure simplifie).
La rpartition des expressions proposes selon les critres permettant de les identifier est
reprsente par les chiffres correspondant au tableau 7. Notons que lordre dans lequel les
critres sont reprsents aurait pu tre diffrent. La plupart des expressions figes peuvent se
retrouver plus dun endroit dans le schma. La ralit est pourtant plus complexe que ne le
laisse souponner la figure. Les critres (ou, plus prcisment, ce quils reprsentent,) se
recouvrent beaucoup plus, ce qui est difficile dcrire de manire efficace dans une figure.
Ces recouvrements complexes expliquent vraisemblablement leur tour la confusion qui
rgne dans les tentatives de classer les expressions figes en diffrentes catgories. Il y a
souvent un consensus parmi les chercheurs sur lappartenance de telle ou telle expression la
catgorie expression fige
489
. Or, le phnomne de figement devient facilement circulaire et il
ny a pas toujours un consensus sur le fonctionnement des critres. La plupart des
phrasologues classeraient certainement la suite bon chat bon rat comme une expression
fige. Cependant, il y a lieu de croire quils ne se baseraient pas sur les mmes critres.
Certains diraient que la suite est opaque, dautres quelle est transparente. Tel chercheur
soutiendrait quelle est inanalysable, tel autre quelle est parfaitement analysable.
Dans ce chapitre, nous avons voulu rendre compte de lexpression fige en tant que
catgorie linguistique sans pour autant nous limiter lapplication des critres selon les
conditions ncessaires et suffisantes.
181
489
Voir par exemple lintroduction du Chapitre 2 supra.
6 Conclusion
Ayant parcouru de nombreuses dfinitions des expressions dites figes, nous avons pu en
conclure que des dfinitions claires qui arrivent trancher entre les diffrents types
dexpressions ou dfinir toutes les expressions figes manquent toujours. Dans le but de
mieux cerner le phnomne de figement, nous avons entrepris une recherche systmatique des
proprits souvent invoques pour les dfinir. Les difficults auxquelles on se heurte lors
dune telle analyse sont considrables. Le premier obstacle est celui de la terminologie,
surtout parce que les termes sont susceptibles de changer de contenu dun chercheur lautre.
On rencontre mme des cas o un terme doit tre rinterprt pour chaque exemple individuel
auquel on veut lappliquer. Il est donc ncessaire de bien tudier les termes employs. Pour ce
faire, nous avons choisi des critres utiliss par un grand nombre de chercheurs et qui
reprsentent les traits pertinents pour lanalyse approfondie que nous avons voulu faire du
phnomne du figement.
Dans le Chapitre 2 de cette tude, les six critres suivants ont t soumis lexamen :
mmorisation (dune squence polylexicale)
(prsence dun mot ) contexte unique (dans lexpression)
non-compositionnalit (de lexpression)
syntaxe marque (de lexpression)
blocage lexical (des mots composants de lexpression)
blocage grammatical (des mots composants de lexpression)
Ce choix na videmment pas t arbitraire. Il nous a permis de discuter la plupart des
proprits invoques dans la phrasologie.
Il nous semble quil faudra donner plus dimportance au critre de mmorisation. Il est un
des deux critres qui soient ncessaires pour identifier une expression fige. Mme sil nest
pas entirement nglig par les chercheurs, on se concentre souvent sur dautres critres. De
nombreux chercheurs citent les mmes expressions figes, bien quils nemploient pas les
mmes critres. Il arrive aussi que les mmes critres soient employs, mais interprts
diffremment. Comment expliquer cette unanimit sur lappartenance telle ou telle
catgorie, tandis que les avis sur le fonctionnement des critres divergent ? Nous tenons
souligner que la mmorisation est un facteur important dans ce contexte et que le figement
laisse des traces dans la mmoire de tout locuteur dune langue.
182
Les mots contexte unique, tels que fur, instar ou lurette, constituent un groupe facile
identifier. Nous avons dress une liste de toutes les expressions contexte unique releves
dabord dans un dictionnaire bilingue (franais-sudois), puis dans un dictionnaire
monolingue franais. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, elle contient cependant bon
nombre dexpressions figes contexte unique, ainsi identifiables directement, sans quil y ait
besoin de dcider si le lexique ou la syntaxe est archaque ou marqu. Nous avons galement
regroup des mots contextes limits, ce qui a men une discussion sur dautres termes
pertinents ce sujet, tels que collocation restrictive et polarisation ngative, entre autres.
La non-compositionnalit est la proprit la plus complexe parmi celles que nous avons
examines. Dabord nous avons stipul quil serait avantageux de sparer la notion de
compositionnalit de celle de sens figur. Cette dcision combine avec un examen rigoureux
dautres termes pertinents pour le phnomne de compositionnalit (tels que contenu lexical
vs forme grammaticale, perspectives atomiste vs holiste, opacit vs transparence et
analysabilit) a montr que la non-compositionnalit peut tre envisag sous quatre aspects.
Nous trouvons utile de faire une distinction entre les dichotomies suivantes :
motivation non-motivation
sens propre sens figur
transparence opacit
analysabilit inanalysabilit
Il est intressant de noter que la syntaxe marque, un critre souvent mentionn, ne fournit
pas beaucoup de cas. Les traits syntaxiquement marqus les plus importants relevs lors de
notre examen ont t labsence de dterminant devant les noms et les cas o les adjectifs sont
employs la place des adverbes. Autrement dit, mme sil y a effectivement des expressions
figes avec une syntaxe marque, il semble que ces traits syntaxiques dviants constituent un
petit groupe, assez bien dlimit. On constate galement quun grand nombre dexpressions
figes ont une syntaxe productive qui suit les rgles syntaxiques les plus courantes.
Le blocage lexical concerne limpossibilit de remplacer un mot par un autre dans un
syntagme. Nous avons constat la ncessit de dfinir clairement en quoi consiste
limpossibilit, car on peut en distinguer trois interprtations diffrentes. Une commutation
normalement bannie peut rendre lexpression modifie incomprhensible. La nouvelle
expression peut aussi tre comprhensible mais considre comme non idiomatique si la
convention veut quelle ne soit pas employe. Finalement, il y a les cas o lexpression
change compltement de sens lors dune commutation. Cela est particulirement important
lorsquon examine les diffrences entre le sens propre et le sens figur des expressions figes.
Les synonymes ne sont pas les seuls tre pertinents lorsquil sagit dexaminer le
phnomne de blocage lexical. Il faut galement regarder la relation entre sens figur et sens
propre (Jai un chat dans la gorg - Jai un chat) et dautres commutations (en pleine ville,
en plein centre, en plein Atlantique, *en plein voiture). La notion de dfigement est galement
importante pour le figement. Nous avons prfr la mettre en relation avec le blocage lexical,
vu que le dfigement peut tre considr comme linverse du blocage lexical.
183
Ensuite, le critre de blocage grammatical a t examine. Le degr de flexibilit varie
beaucoup dune expression lautre. Il est difficile de juger des possibilits deffectuer des
transformations, des insertions et des effacements dans les expressions figes et souvent le
linguiste se fie beaucoup sa propre intuition pour crer des contextes. En outre, des preuves
ngatives sont impossibles reprer si on veut se baser sur des exemples authentiques,
comme nous avons choisi de le faire.
Le chapitre 3 a t consacr aux critres examins dans le Chapitre 2. Cette fois, les
critres ont t rexamins en termes de conditions ncessaires et suffisantes. Notre analyse
permet de conclure quun seul critre satisfait la fois aux conditions ncessaires et
suffisantes, savoir le blocage lexical. Seuls deux des critres sont ncessaires, le blocage
lexical et la mmorisation. Ce qui tonne peut-tre plus est que deux des critres examins, la
syntaxe marque et le blocage grammatical, ne sont ni ncessaires, ni suffisants. Lorsquon
prend galement en compte les nouveaux critres, issus du terme de non-
compositionnalit, il savre que la mme chose vaut pour le sens figur : il nest ni ncessaire
ni suffisant pour identifier les expressions figes. Cependant, tous les critres examins
semblent pertinents pour le figement.
Une tude des relations qui existent entre les critres a t entreprise dans le chapitre 4.
Diffrents critres arrivent souvent identifier les mmes expressions figes. Lapplication
des critres a pour effet la cration densembles qui se recouvrent souvent partiellement.
Pour ce qui est des critres de mmorisation et de blocage lexical, ils sont prsents pour
toutes les expressions figes. Le critre de blocage lexical tant plus complexe, il a t inclus
dans la comparaison.
Dans la plupart des cas, lapplication de critres diffrents peut mener lidentification de
la mme expression, mais il ny a pas souvent identit entre les ensembles forms par deux
critres diffrents. Cependant, les thmes uniques du critre de contexte unique sont toujours
non motives. En revanche, les formes uniques sont motives. ce propos on peut noter que
le rapport entre le blocage lexical et le critre de contexte unique est trs troit. Aucune
commutation nest possible dans les expressions identifies par le critre de contexte unique.
En ce qui concerne le rapport entre le blocage lexical et les autres critres, le blocage peut
tre plus ou moins svre, puisque plusieurs expressions existent dans deux variantes ou plus.
Il est pourtant toujours question dun blocage lexical les variantes sont dun nombre
restreint et les commutations ne sont pas libres, sauf pour les expressions discontinues du type
dun N lautre.
Lexamen du critre de blocage grammatical et son rapport avec les autres critres a rvl
quun blocage morphologique relatif la catgorie du nombre nest pas rare. La plupart des
expressions figes semploient soit au singulier soit au pluriel. Si on modifie le nombre
grammatical dun syntagme, on a le plus souvent pour rsultat un syntagme pas couramment
utilis, et dont le sens serait plutt curieux quamusant. Un procd similaire au dfigement,
qui met en relief le blocage lexical, nest donc pas conseiller pour les dsinences. Il est fort
probable quune telle tentative de jouer avec la langue passerait inaperue ou rendrait
linterlocuteur confus. En ce qui concerne le blocage grammatical, nous avons pu constater
quil dpend surtout de la structure syntaxique. Cependant, le comportement de certaines
expressions sens figur est particulirement intressant. Modifier le nombre grammatical
184
des expressions telles que prendre une veste ou prendre une culotte rend plus plausible une
linterprtation au sens propre du syntagme.
Lexamen du rapport entre le blocage grammatical et la syntaxe marque a montr que
dans les expressions figes avec un adjectif employ comme adverbe, ladverbe qui
correspond ladjectif en question est soit bloqu soit non attest.
Dans le Chapitre 5, nous avons lanc lide que la thorie des ressemblances de famille
arrive mieux que les conditions ncessaires et suffisantes dfinir la catgorie des expressions
figes. Les recouvrements partiels entre les diffrents groupes dexpressions figes rsultant
des applications des critres ne se laissent pas facilement dcrire. Le fait que lensemble cr
par lapplication dun critre peut tre le mme que celui de lapplication dun autre rend
difficile une catgorisation dfinitive des expressions figes. Il nous semble quune tude
ultrieure de cette hypothse serait utile pour structurer les notions les plus importantes du
concept de figement.
185
BIBLIOGRAPHIE
Abeill, Anne (1995), The Flexibility of French Idioms: A Representation with Lexicalized
Tree Adjoining Grammar , in : Everaert, van der Linden, Schenk et Schreuder (1995),
pp. 15-42.
Abelin, sa (1999), Studies in Sound Symbolism, Department of Linguistics, Gteborg
University, Sweden.
Achard, Pierre et Fiala, Pierre (1997), La locutionalit gomtrie variable , in : Fiala,
Pierre, Lafon, Pierre et Piguet, Marie-France (1997), pp. 273-284.
Aijmer, Karin (1996), Conversational routines in English : Convention and Creativity.
Longman, New York.
Aisenstadt, Ester (1981), Restricted Collocations in English Lexicology and
Lexicography , Review of Applied Linguistics, Louvain, Belgium (ITL), 53, pp. 53-61.
Andersson, Sven (1957), Compte rendu de Bostrm, I., (1957), Studia Neophilologica, 29, pp.
270-278.
Anscombre, Jean-Claude (1984), Article zro, termes de masse et reprsentation
dvnements en franais contemporain , in : J. David et G. Kleiber, d.,
Dterminants: Syntaxe et smantique. Paris: Klicksieck, pp. 5-34. (Recherches
linguistiques, XI).
(1986), Larticle zro en franais: un imparfait du substantif ? , Langue franaise 72:
4-39.
Anward, Jan et Linell, Per (1976), Om lexikaliserade fraser i svenskan , in : Nysvenska
studier, 55-56, pp. 77-119.
Bally, Charles (1963), Trait de stylistique franaise. Librairie de lUniversit Georg & Cie
S.A. Genve.
Baudelaire, Charles (1964 [1
re
d. 1857]), Les fleurs du mal et autres pomes. Garnier-
Flammarion, Paris.
Bennett, T.J.A. (1981), Translating colour collocations , Journal des traducteurs,
Outremont, PQ, Canada (Meta), Sept., 26:3, pp. 272-280.
Benson, Morton (1985), Collocations and idioms , in : Ilson-Robert (d. et introd.);
Brumfit-C.J. (pref.), Dictionaries, Lexicography and Language Learning, Oxford:
Pergamon, viii, pp. 61-68.
Bernard, Georges (1974), Les locutions verbales franaises , La Linguistique 10, 2, pp. 5-
17.
Bjrkman, Sven (1978), Le type avoir besoin. tude sur la coalescence verbo-nominale en
franais. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Romanica Upsaliensia 21, Uppsala.
Blinkenberg, Andreas (1969 [1
re
d. 1928]), Lordre des mots en franais moderne, Bianco
Lunos bogtrykkeri.
Bobrow, Samuel A. et Bell, Susan M. (1973), On catching on to idiomatic expressions ,
Memory & Cognition, Vol. 1, No. 3, pp. 343-346.
Bolinger, Dwight (1972), Degree Words.The Hague: Mouton.
(1976-1977), Meaning and memory , Forum linguisticum, Volume 1, pp. 1-14.
(1977), Idioms have relations , Forum linguisticum 2, pp. 157-169.
Bostrm, Ingemar (1957), Les noms abstraits accompagns dun infinitif et combins avec
AVOIR. tudes Romanes de Lund 12. Lund.
Botelho da Silva, Teresa et Cutler, Anne (1993), Ill-formedness and Transformability in
Portuguese idioms , in : Cacciari, Cristina; Tabossi, Patrizia (d.), Idioms: processing,
structure and interpretation, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New
Jersey.
186
Brant, Gustaf (1944), La concurrence entre soi, et lui, eux, elle(s). tude de syntaxe
historique franaise. Hkan Ohlssons boktryckeri, Lund.
Brederode, T., van (1980), Towards a theory of collocations , in : Zonneveld-Wim (d. et
prf.); Weerman-Fred. (d. et prf.), Linguistics in the Netherlands 1977-1979,
Dordrecht: Foris, x, pp. 254-263.
Burt, Jennifer S. (1992), Against the Lexical Representation of Idioms , Canadian Journal
of Psychology, 46:4, pp. 582-605.
Bcklund, Ulf (1970), The collocation of adverbs of degree in English, Acta Universitatis
Upsaliensis, Studia Romanica Upsaliensia 13, Uppsala.
(1981), Restrictive adjective-noun collocations in English, Acta Universitatis Umensis.
Ume Studies in the Humanities 23, Ume.
Cacciari, Christina et Tabossi, Patrizia (1988), The comprehension of idioms , Journal of
memory and language, 27, pp. 668-683.
Chafe, Wallace L. (1968), Idiomaticity as an anomaly in the chomskyan paradigm ,
Foundations of Language, 4, pp. 109-127.
Conenna, Mirella (2000), Structure syntaxique des proverbes franais et italiens ,
Langages, 139, pp. 27-38.
Coubild Dictionary of Idioms (1995), Collins Cobuild. Harper Collins Publishers, London.
Coulmas, Florian (1981), Introduction : Conversational Routine , in : Coulmas, Florian
(d.) Conversational Routine. Explorations in standardized communication situations
and prepatterned speech, Mouton, The Hague.
Collins French College Dictionary (1991), Harper Collins Publishers.
Cowie, A.P. (1981), The treatment of Collocations and Idioms in Learners Dictionaries ,
Applied linguistics, Oxford, England, Autumn, 2:3, pp. 223-235.
Curat, Herv (1999), Les dterminants dans la rfrence nominale et les conditions de leur
absence. Librairie Droz S.A., Genve.
Danell, Karl Johan (1992), Nothing but phrases. About the distribution of idioms and stock
phrases , in : Edlund, Lars-Erik et Persson, Gunnar, Language - the time machine,
Ume.
(1993), La linguistique. Pratique et thorie, Studentlitteratur, Lund.
(1995), Le phnomne de concurrence en franais moderne, Acta Universitatis
Umensis. Ume Studies in the Humanities 123, Ume.
Danell, Karl Johan et Olsson, Hugo (1997), La grammaire franaise. Almqvist &
Wiksell/Liber AB. Uppsala et Stockholm.
Dagenais, Grard (1990), Dictionnaire des difficults de la langue franaise au Canada, Les
ditions franaises Inc., Boucherville.
Davidson, Donald (1984), Inquiries into truth and interpretation, Oxford, Clarendon.
Deignan, Alice (1999a), Corpus-based research into metaphor , in : Cameron, Lynne et
Low, Graham (ds.), Researching and Applying Metaphor, Cambridge University Press,
pp. 177-199.
(1999b), Linguistic Metaphors and Collocation in Nonliterary Corpus Data ,
Metaphor and symbol, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 14 (1), pp. 19-36.
Denhire, Guy et Verstigel, Jean-Claude (1996), Le traitement cognitif des expressions
idiomatiques. Activits automatiques et dlibres . in : Fiala, Pierre, Lafon, Pierre et
Piguet, Marie-France (1996), pp. 119-148.
Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage (1994), Larousse.
Dictionnaire des expressions et locutions (1993), Dictionnaires Le Robert, Paris.
Dictionnaire des expressions idiomatiques (1995), Librairie Gnrale Franaise, Paris.
Dictionnaire des proverbes sentences et maximes (1960), Librairie Larousse, Paris.
Dictionnaire historique de la langue franaise (1992), Le Robert, Paris.
187
Estill, Robert B. et Kemper, Susan (1982), Interpreting idioms , Journal of
Psycholinguistic Research, Vol. 11, No. 6, pp. 559-568.
Everaert, Martin ; van der Linden, Erik-Jan ; Schenk Andr et Schreuder, Rob (ds.) (1995),
Idioms: structural and psychological perspectives, Lawrends Erlbaum Associates,
publishers, Hillsdale, New Jersey.
Fauconnier, Gilles (1980), tude de certains aspects logiques et grammaticaux de la
quantification et de lanaphore en franais et en anglais, Atelier Reproduction des
thses, Universit de Lille III, Lille.
(1994), Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language,
Cambridge University Press.
Fiala, Pierre, Lafon, Pierre et Piguet, Marie-France (ds.) (1996), La locution : entre lexique,
syntaxe et pragmatique. Identification en corpus, traitement, apprentissage. INALF,
collection Saint-Cloud . Klincksieck, Paris.
Fillmore, Charles J., Kay, Paul et OConnor, Mary Catherine (1988), Regularity and
idiomaticity in grammatical constructions : The case of let alone , Language 64, 3,
September, pp. 501-538.
Fnagy, Ivan (1982), Situation et signification, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.
(1997), Figement et changement smantiques , in : La locution entre langue et
usages, Martins-Baltar (d.), ENS ditions, Fontenay Saint-Cloud.
Fontenelle, Thierry (1994), What on earth are collocations? , English today: the
international review of the English language, Cambridge, England, 1994, oct, 10:4 (40),
pp. 42-48.
Forsgren, Mats, Jonasson, Kerstin et Kronning, Hans (ds) (1998), Prdication, assertion,
information. Actes du colloque dUppsala en linguistique franaise, 6-9 juin 1996, Acta
Universitatis Upsaliensis, Studia Romanica Upsaliensia 56, Uppsala.
Franska ordboken (1989), Esselte Studium.
Fraser, Bruce (1970), Idioms within a transformational grammar , Foundations of
language, 6, pp. 22-42.
Fromkin, Victoria et Rodman, Robert (1988), An introduction to language, Holt, Rinehart and
Winston, Inc., New York.
Gaatone, David (1971), tude descriptive du systme de la ngation en franais
contemporain, Librairie Droz, Genve.
(1997), La locution : analyse interne et analyse globale , in ; Martins-Baltar (1997),
pp. 165-177.
(1998a), Le passif en franais, Duculot, Paris.
(1998b), Peut-on parler de verbes non prdicatifs en franais ? , in : Forsgren,
Jonasson et Kronning (ds.), pp.193-199.
Gagnire, Claude (1994), Des mots et merveilles. ditions Robert Laffont, Paris.
Gibbs Jr., Raymond W. (1980), Spilling the beans on understanding and memory for idioms
in conversation , Memory & Cognition, Vol. 8, pp. 149-156.
(1994), The Poetics of Mind : Figurative Thought, Language, and Understanding. New
York. Cambridge University Press.
(1999), Researching metaphor , in : Cameron, Lynne et Low, Graham (ds.),
Researching and Applying Metaphor, Cambridge University Press.
Gibbs, Jr., Raymond W. et Nayak, Nandini P. (1989), Psycholoinguistic studies on the
syntactic behavior of idioms , Cognitive psychology, 21, pp. 100-138.
Gibbs, Jr., Raymond W., Nayak, Nandini P. et Cutting, Cooper (1989), How to kick the
bucket and not decompose: analyzability and idiom processing , Journal of memory
and language, 28, pp. 576-593.
188
Gibbs, Jr., Raymond W., Nayak, Nandini, P., Bolton, John, L. et Keppel, Melissa E. (1989),
Speakers assumptions about the lexical flexibility of idioms , Memory & Cognition,
17 (1), pp. 58-68.
Givn, Talmy (1986), Prototypes: between Plato and Wittgenstein , in : Craig, Colette
(d.), Noun classes and categorization, John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam.
Glucksberg, Sam, Brown, Mary et McGlone, Matthew S. (1993), Conceptual metaphors are
not automatically accessed during idiom comprehension , Memory & Cognition, 21
(5), pp. 711-719.
Gosselin, Laurent (1996), Smantique de la temporalit en franais. Un modle calculatoire
et cognitif du temps et de l'aspect, Duculot, Louvain-la-Neuve.
Gougenheim, Georges (1938), Systme grammatical de la langue franaise. Bibliothque du
franais moderne , Paris.
(1971), Une catgorie lexico-grammaticale : les locutions verbales , tudes de
linguistique applique, Didier, Paris, 2, pp. 56-64.
Gregory, M. (1975), The description of English, University of Toronto.
Greimas, Algirdas Julien (1970), Du sens, ditions du Seuil, Paris.
Gross, Gaston (1988), Degr de figement des noms composs , Langages 90, juin, pp. 57-
72.
(1989), Les constructions converses du franais. Librairie Droz, Genve.
(1996), Les expressions figes en franais; noms composs et autres locutions. ditions
Ophrys, Paris.
(1997), Du bon usage de la notion de locution , in : La locution entre langue et
usages, Martins-Baltar (d.), ENS ditions, Fontenay Saint-Cloud.
Gross, Maurice (1984), Une classification des phrases figes du franais , in : Attal,
Pierre et Muller, Claude (ds.), Lingvistic Investigationes Supplementa vol. 8; De la
syntaxe la pragmatique, pp. 141-180.
Grunig, Blanche (1990), Les mots de la publicit. Larchitecture du slogan. Presses de CNRS,
Paris.
Grunig, Blanche-Nolle (1997a), Prface , in ; Martins-Baltar (1997), pp. 13-17.
(1997b), La locution comme dfi aux thories linguistiques : une solution dordre
mmoriel ? , in ; Martins-Baltar (1997), pp. 225-240.
Glich, Elisabeth et Krafft, Ulrich (1997), Le rle du prfabriqu dans les processus de
production discursive , in : Martins-Baltar (1997), pp. 241-276.
Hagge, Claude (1985), Lhomme de paroles. Contribution linguistique aux sciences
humaines, Collection Folio / Essais.
Hansen, Iah et Schwartz, Bjrn (1992), Gleerups Franska Grammatik, Gleerups, Malm.
Halliday, Michael Alexander Kirkwood (1966), Lexis as a linguistic level , in : Bazell,
C.E.; Halliday, M.A.K. and Robbins, R.H., In Memory of J.R. Firth, Longmans,
London.
Halmy [Halmy], Odile (1979), Remarques sur la distribution du couple an anne en
franais contemporain , Moderna sprk, dit pour lAssociation des professeurs de
langues modernes en Sude, 1979, pp. 65-75.
Harris, Catherine L. (1994), Coarse coding and the lexicon , in : Fuchs, Catherine et
Victorri, Bernard, Continuity in linguistic semantics, John Benjamins, Amsterdam.
Harris, Richard J. (1979), Memory for metaphors , Journal of Psycholinguistic Research,
Vol. 8, No. 1, pp. 61-71.
Hausmann, Franz Josef (1997), Tout est idiomatique dans les langues , in ; Martins-Baltar
(1997), pp. 277-290.
189
Heinz, Michaela (1993), Les locutions figures dans le Petit Robert . Description critique
de leur traitement et propositions de normalisation, Lexicographica, Series Maior 49,
Max Niemeyer Verlag Gmbh & Co. KG, Tbingen.
(1996), L-peu-prs dans les locutions et son traitement lexicographique , in : Fiala,
Pierre, Lafon, Pierre et Piguet, Marie-France (1996), pp. 213-229.
Henry, Albert (1983), Mtaphore et mtonymie, J. Duculot, Gembloux.
Hinton, Leanne; Nichols, Johanna et Ohala, John J. (ds) (1994), Sound symbolism,
Cambridge University Press, Cambridge.
Hudson, Jean (1998), Perspectives on fixedness: applied and theoretical, Lund Studies in
English 94, Lund University Press, Lund.
Hussein, Riyad Fayez (1990), Collocations: the missing link in vocabulary acquisition
amongst efl learners , Papers and studies in contrastive linguistics, Poznan, Poland
(PSCL), 23, pp. 123-136.
Katz, Jerrold, J. (1973), Compositionality, idiomaticity and lexical substitution , in :
Stephen R. Anderson and Paul Kiparsky (ds.), A festschrift for Morris Halle, New
York: Holt, Rinehart and Winston.
Kibdi Varga, ron et Bertho, Sophie (1995), Mots et Merveilles, Bonnier utbildning,
Stockholm.
Kleiber, Georges (1990), La smantique du prototype. Catgories et sens lexical. Presses
Universitaires de France, Paris.
(1991), Prototype et prototypes : encore une affaire de famille , in : Dubois, Danile
(d.), Smantique et cognition. Catgories, prototypes, typicalit, pp. 103-129.
(1999), Les proverbes : des dnominations dun type trs trs spcial , Langue
franaise 123, pp. 52-69.
Lakoff, George (1987), Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about
the Mind, The University of Chicago Press, Chicago.
Lakoff, George et Johnson, Mark (1980), Metaphors we live by, Chicago: The University of
Chicago Press.
Langacker, Ronald W. (1987), Foundations of cognitive grammar. Volume 1 : Theoretical
Prerequisites, Stanford University Press, Stanford, California.
(1999), Grammar and conceptualization. Mouton de Gruyter, Berlin.
Lavoie, Ral (1989), lcoute de la rue , Diagonales N
o
9, janvier.
Lard, Jean-Marcel (1992), Les gallicismes. tude syntaxique et smantique. ditions
Duculot, Paris.
Le Goffic, Pierre (1993), Grammaire de la Phrase Franaise, Hachette, Paris.
Lemhagen, Gunnar (1979), La concurrence entre linfinitif et la subordonne compltive
introduite par que en franais contemporain. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia
Romanica Upsaliensia 26, Uppsala.
Lorentzen, Lise R. (1994), Les quantifieurs bien des et beaucoup de introduisant des
syntagmes nominaux au pluriel , Actes du XII
e
Congrs des Romanistes Scandinaves,
Aalborg University Press.
Mackin, Ronald (1978), On collocations: words shall be known by the company they
keep , in : Strevens, Peter (d.), In Honour of A.S. Hornby. Oxford University Press,
Oxford, pp. 149-165.
Makkai, Adam (1972), Idiom structure in English, Mouton, The Hague.
Martin, Robert (1976), Infrence, antonymie et paraphrase. lments pour une thorie
smantique, Librairie C. Klincksieck.
(1997), Sur les facteurs du figement lexical , in : Martins-Baltar (d.), (1997), pp.
291-305.
190
Martins-Baltar, Michel (d.) (1996), La locution entre langue et usages, ENS ditions,
Fontenay Saint-Cloud.
McIntosh, Angus (1961), Patterns and ranges , Language, 37, 3, pp. 325-337.
Mejri, Salah (1997), Le figement lexical. Publications de la Facult des Lettres de la
Manouba.
Mel'uk, Igor (1993), La phrasologie et son rle dans l'enseignement / apprentissage d'une
langue trangre , tude de Linguistique Applique, 92, pp. 82-113.
Micaux, Wandrille et Ransbo, Gunilla (1991), Norstedts Franska Idiombok, Norstedts frlag
AB.
Michiels, Archibal (1977), Idiomaticity in English , Revue des langues vivantes, XLIII, 2,
pp. 184-199.
Miller, George A. et Johnson-Laird, Philip N. (1976), Language and perception. Cambridge
University Press, Cambridge.
Misri, Georges (1987a), Approches du figement linguistique : critres et tendances , La
linguistique : Revue de la Socit Internationale de la linguistique fonctionelle, 23:2,
Paris, pp. 71-85.
(1987b), Le figement linguistique en franais contemporain, thse de doctorat,
Universit Ren Descartes (Paris V).
Moeschler, Jacques et Reboul, Anne (1994), Dictionnaire encyclopdique de pragmatique,
ditions du Seuil.
Molander, Annelie (1999), Analyse des expressions figes franaises comportant le mot coup.
tude syntaxique et smantique. Mmoire de franais du cours D, Universit dUppsala.
Moon, Rosamund (1998), Fixed expressions and idioms in English, a corpus-based approach,
Clarendon press, Oxford.
Muller, Claude (1991), La ngation en franais. Syntaxe, smantique et lments de
comparaison avec les autres langues romanes, Librairie Droz, Genve.
Nattinger, James R. et DeCarrico, Jeanette S. (1992), Lexical phrases and language teaching,
Oxford University Press.
Newmeyer, Frederick J. (1974), The regularity of idiom behavior , Lingua 34, pp. 327-342.
Noailly, Michle (1999), Ladjectif en franais, ditions Ophrys, Paris.
Norrick, Neal, R. (1985), How proverbs mean: semantic studies in English proverbs, Mouton,
Berlin.
Nunberg, Geoffrey D. (1978), The pragmatics of reference, Dissertation, The City University
of New York.
Pedersen, John ; Spang-Hanssen, Ebbe et Vikner, Carl (1982), Fransk Universitetsgrammatik,
Norstedts Boktryckeri, Stockholm.
Nunberg, Geoffrey, Sag, Ivan et Wasow, Thomas (1994), Idioms , Language 70, 3,
September, pp. 491-528.
Ohtsuki, Minoru (2000), A cognitive linguistic study of colour symbolism. Institute for the
research and education of language, Daito-Bunka University, Tokyo.
Olsson, Hugo (1986), La concurrence entre il, ce et cela (a) en franais contemporain, Acta
Universitatis Umensis, Ume Studies in the Humanities 71, Ume.
Persson, Birger (1974), tude sur la concurrence entre les groupes du type les ctes de
France les ctes de la France les ctes franaises en franais contemporain, Acta
Universitatis Upsaliensis, Studia Romanica Upsaliensia 14, Uppsala.
Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue franaise (1993), Dictionnaires le Robert, Paris.
Picabia, Lelia (1983), Remarques sur le dterminant zro dans des squences en il y a , Le
franais moderne 51(2): 157-171.
(1986), Il y a dmonstration et dmonstration : rflexion sur la dtermination de
larticle zro , Langue franaise, 72: 80-101.
191
Rastier, Franois (1994), Tropes et smantique linguistique , Langue franaise, 101, pp.
80-101.
Dfigements smantiques en contexte , in : Martins-Baltar (d.), La locution entre
langue et usages, ENS ditions, Fontenay Saint-Cloud.
Schapira, Charlotte (1999), Les strotypes en franais : proverbes et autres formules,
ditions Ophrys.
Sullet-Nylander, Franoise (1998), Le titre de presse. Analyses syntaxique, pragmatique et
rhtorique. Cahiers de la recherche, 8. Institutionen fr franska och italienska,
Stockholms universitet.
(2002), Critres de figement et conditions ncessaires et suffisantes , XV
Skandinaviske romanistkongress, Drum, Hallvard (d.), Romansk forum nr. 16,
2002/2, <
Ricur, Paul (1975), La mtaphore vive, ditions du Seuil, Paris.
Riegel, Martin ; Pellat, Jean-Christophe et Rioul, Ren (1994), Grammaire mthodique du
franais, Presses Universitaires de France, Paris.
Ronsj, Einar (1988), Fransk grammatik fr grundskolan och gymnasieskolan, Almqvist &
Wiksell Lromedel AB, Uppsala.
Rosch, Eleanor et Mervis, Carolyn B. (1996 [1975]), Family Resemblances: Studies in the
Internal Structure of Categories . in : Geirsson, Heimir et Losonsky, Michael (ds.),
Readings in Language and Mind. MA: Blackwell Publishers Inc., Cambridge, pp. 442-
460.
Rousseau, Andr (1998), Construction prdicative et typologie des prdicats dans les
langues naturelles , in : Forsgren, Jonasson et Kronning (ds.) pp. 493-504.
Ruwet, Nicholas (1982), Du bon usage des expressions idiomatiques dans largumentation
en syntaxe gnrative . Mimographie, paratre dans Recherches linguistiques, 11,
(Universit de Paris VIII).
Saussure, Ferdinand de (1967 [1916]), Cours de linguistique gnrale, dition critique
prpare par Tullio de Mauro, ditions Payot & Rivages, Paris.
Searle, John R. (1978), Literal meaning , Erkenntnis, 13, pp. 207-224.
Sinclair, John McHardy. (1966), Beginning the Study of Lexis , in : Bazell, C.E.; Halliday,
M.A.K. and Robbins, R.H., In Memory of J.R. Firth, Longmans, London.
Sperber, Dan et Wilson, Deirdre (1995), Relevance: Communication and Cognition,
Blackwell, Oxford.
Steinvall, Anders (2002), English colour terms in context. Skrifter frn moderna sprk, Ume
Universitet, Ume.
Stubbs, Michael (2001), Words and phrases. Corpus studies of Lexical Semantics, Blackwell
publishers Ltd., Oxford.
Svensson, Mia (1998), Critres de figement et analyses dexpressions figes du franais
moderne , in : Bardel, C. et al (d.), Actes du premier Congrs des Romanistes
Scandinaves pour tudiants en doctorat, pp. 107-114. Perles. Petites tudes romanes de
Lund. Extra seriem no. 6. Universitetstryckeriet, Lund.
Svensson, Maria H. (2000), Phrasologie. Deux critres de figement : contexte unique et
non-compositionnalit , XIV Skandinaviska romanistkongressen. Stockholm 10-15
augusti 1999, Actes du XIV
e
Congrs des Romanistes Scandinaves, Nystedt, Jane (d.),
Almqvist & Wiksell International, Stockholm. CD-rom.
http://www.digbib.uio.no/roman/page21.html >. Page daccueil visit le 23
juin 2003.
Swinney, David A. et Cutler, Anne (1979), The access and processing of idiomatic
expressions , Journal of verbal learning and verbal behavior, 18, pp. 523-534.
Tesnire, Lucien (1969), lments de syntaxe structurale. ditions Klincksieck, Paris.
Togeby, Knud (1965), Structure immanente de la langue franaise. Librairie Larousse, Paris.
192
(1982), Grammaire franaise, Volume I: Le nom. Revue Romane, numro spcial hors
srie, Akademisk Forlag, Copenhague.
Westrin, Maibrit (1973), tude sur la concurrence de davantage avec plus dans la priode
allant de 1200 la rvolution, Studentlitteratur, Lund.
Yorio, Carlos A. (1980), Conventionalized Language Forms and the Development of
Communicative Competence , TESOL Quarterly, Vol. 14, N
o
4, pp. 433-442.
Treps, Marie (1994), Allons-y Alonzo ! ou le petit thtre de linterjection, Point Virgule.
ditions du Seuil, Paris.
Le Trsor de la langue franaise : Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe sicle (1789-
1960), (1971-1994), CNRS, Gallimard.
Ullman, Stephen (1967), Semantics. An introduction to the science of meaning. Basil
Blackwell, Oxford.
van der Wouden, Ton (1997), Negative contexts; collocation, polarity and multiple negation,
Routledge Studies in Germanic Linguistics.
Videkull, Marianne (1999), Jamne le champagne, tu apportes les verres ?, Acta
Universitatis Umensis, Ume Studies in the Humanities 148, Ume.
Videkull, Marianne et Lindgren, Gran (1989), Remarques sur trois paires de mots
synonymes jour/journe soir/soire matin/matine, Mmoire de 60 p, Universit
dUme.
Wall, Kerstin ; Hedman-Ekman, Monika ; Bhar, Denis et Kronning, Hans (1999), Bonniers
Franska Grammatik, Bonnier utbildning, Stockholm.
Websters Ninth New Collegiate Dictionary (1986), Merriam-Webster Inc., Publishers,
Springfield, Massachusetts, U.S.A.
Weinreich, Uriel (1969), Problems in the analysis of idioms , in : Puhvel, J. (d.)
Substance and structure of language, pp. 23-81, University of California Press,
Berkeley and Los Angeles.
Wilmet, Marc (1997), Grammaire critique du Franais, Duculot, Louvain-la-Neuve.
Wilson, David Arthur (1972), Linguistics in language teaching, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts.
Wittgenstein, Ludwig (1972), Philosophical investigations, Basil Blackwell & Mott, Ltd.,
Oxford.
193
CORPUS INFORMATIS
Textes littraires :
Le soir (SO)
12 avril 1988
Le Monde (MO)
CD-Littrature (1988), 888-1899, Dix sicles de culture
franaise, CD-ROM, Act/Cdic-Nathan.
Littrature (CDLITT)
Journaux :
La libre Belgique (LB) 1 fvrier 1986
11 fvrier 1986
12 fvrier 1986
13 fvrier 1986
14 fvrier 1986
16 fvrier 1986
29 septembre 1986
30 septembre 1986
1 octobre 1986
2 octobre 1986
3 octobre 1986
5 octobre 1986
24 novembre 1987
25 novembre 1987
26 novembre 1987
27 novembre 1987
28 novembre 1987
1 avril 1988
2 avril 1988
5 avril 1988
6 avril 1988
7 avril 1988
8 avril 1988
9 avril 1988
11 avril 1988
13 avril 1988
14 avril 1988
15 avril 1988
CD-rom (1990) : Lhistoire au jour le jour,
extraits des annes 1945-1988 de Le Monde, Act et Le
Monde.
Le Monde conomique (ME) CD-rom (1990) : Bilan conomique et social
extraits des annes 1983-1988 de Le Monde
conomique. Act et Le Monde.
Logiciel utilis pour le corpus informatis :
WordCruncher Text Retrieval Software, Electronic Text Corporation, 5600 North University
Ave., Provo, UT 84604, USA.
194
Table des matires
13
13
...................... 15
16
19
19
21
22
23
24
25
Entre catgorie et critre la mtaphore....................................................................................... 26
28
34
34
38
38
39
40
40
2 ...................................................................................................................................... 42
45
50
52
52
52
56
57
58
59
63
64
............................................................................................................ 64
66
66
67
69
71
71
73
74
81
81
82
83
84
85
86
87
87
89
89
......... 90
..................................................................................................... 91
96
Rsum.......................................................................................................................................... 97
100
1 Introduction...................................................................................................................................................
1.1 Gnralits ............................................................................................................................................
1.2 Terminologie...................................................................................................................
1.2.1 Expression fige............................................................................................................................
1.2.2 Catgories......................................................................................................................................
1.2.2.1 Idiome .......................................................................................................................................
1.2.2.2 Locution ....................................................................................................................................
1.2.2.3 Collocation................................................................................................................................
1.2.2.4 Proverbe ....................................................................................................................................
1.2.2.5 Gallicisme .................................................................................................................................
1.2.2.6 Phrasme ...................................................................................................................................
1.2.3
1.2.4 Critres ..........................................................................................................................................
1.2.5 Porte du figement ........................................................................................................................
1.2.5.1 Expressions continues ...............................................................................................................
1.2.5.2 Expressions discontinues...........................................................................................................
1.2.5.3 Synthse ....................................................................................................................................
1.3 Dlimitation du sujet .............................................................................................................................
1.4 Corpus ...................................................................................................................................................
1.5 But, mthode et disposition...................................................................................................................
Analyse des critres.
2.1 Mmorisation ........................................................................................................................................
2.2 Contexte unique ....................................................................................................................................
2.2.1 Thme unique................................................................................................................................
2.2.2 Forme unique ................................................................................................................................
2.2.3 Liste dexemples contexte unique ..............................................................................................
2.2.3.1 Commentaire de la liste.............................................................................................................
2.2.3.2 Homonymes ..............................................................................................................................
2.2.4 Contextes limits...........................................................................................................................
2.2.5 Liste dexemples contextes limits.............................................................................................
2.2.5.1 Commentaire de la liste.............................................................................................................
2.2.6 Dautres termes avec une dfinition similaire ...............................................................................
2.2.6.1 Collocations restrictives
2.2.6.2 Hapax legomena........................................................................................................................
2.2.6.3 Cranberry collocations ..............................................................................................................
2.2.6.4 Polarisation................................................................................................................................
2.2.7 Rsum..........................................................................................................................................
2.3 Non-compositionnalit..........................................................................................................................
2.3.1 La non-compositionnalit et ses caractristiques ..........................................................................
2.3.2 Motivation vs non-motivation .......................................................................................................
2.3.3 Sens propre vs sens figur .............................................................................................................
2.3.3.1 Sens propre et motiv................................................................................................................
2.3.3.2 Sens figur et motiv.................................................................................................................
2.3.3.3 Sens figur et non motiv..........................................................................................................
2.3.3.4 La motivation des noms des couleurs........................................................................................
2.3.4 Contenu lexical et forme grammaticale.........................................................................................
2.3.5 Transparence vs opacit ................................................................................................................
2.3.5.1 Sens propre, motiv et transparent ............................................................................................
2.3.5.2 Sens figur, motiv et transparent .............................................................................................
2.3.5.3 Sens figur, motiv et opaque ...................................................................................................
2.3.5.4 Sens figur, non motiv et transparent ......................................................................................
2.3.5.5 Sens figur, non motiv et opaque ............................................................................................
2.3.5.6 Comparaisons...................................................................................................................
2.3.6 Analysabilit vs inanalysabilit
2.3.7 Les perspectives atomiste et holiste ..............................................................................................
2.3.8
2.4 Syntaxe marque .................................................................................................................................
195
2.4.1 Absence de dterminant .............................................................................................................. 103
106
Une chelle syntaxique................................................................................................................ 106
107
109
110
.............................................................................................................................. 110
114
114
115
117
117
118
120
121
124
126
126
131
131
132
133
135
136
137
.......................................................................................................... 139
139
140
140
140
140
141
............................................................................................................................. 142
143
143
144
....................... 144
146
147
147
147
147
150
................................................................................ 151
152
152
155
157
160
160
160
160
161
162
............................................................. 162
162
163
163
164
164
2.4.2 Adjectif employ comme adverbe...............................................................................................
2.4.3
2.4.4 Rsum........................................................................................................................................
2.5 Blocage lexical ....................................................................................................................................
2.5.1 Commutations .............................................................................................................................
2.5.1.1 Synonymes
2.5.1.2 Autres relations paradigmatiques ............................................................................................
2.5.1.2.1 Commutations libres.........................................................................................................
2.5.1.2.2 Commutations dans le mme champ smantique.............................................................
2.5.1.2.3 Commutations hyponymiques ..........................................................................................
2.5.1.2.4 Variantes sans commutation.............................................................................................
2.5.2 Sens figur et sens propre............................................................................................................
2.5.3 Traductions..................................................................................................................................
2.5.4 Dfigement un phnomne inverse du blocage ? .....................................................................
2.5.5 Rsum........................................................................................................................................
2.6 Blocage grammatical...........................................................................................................................
2.6.1 Blocage morphologique ..............................................................................................................
2.6.2 Blocage syntaxique .....................................................................................................................
2.6.2.1 Transformations ......................................................................................................................
2.6.2.1.1 Passivation........................................................................................................................
2.6.2.1.2 Permutations de syntagmes coordonns ...........................................................................
2.6.2.1.3 Insertions ..........................................................................................................................
2.6.2.1.4 Effacements ......................................................................................................................
2.6.3 Rsum........................................................................................................................................
3 Conditions ncessaires et suffisantes
3.1 Mmorisation ......................................................................................................................................
3.2 Contexte unique ..................................................................................................................................
3.3 Non-compositionnalit........................................................................................................................
3.3.1 Non-motivation ...........................................................................................................................
3.3.2 Sens figur...................................................................................................................................
3.3.3 Opacit ........................................................................................................................................
3.3.4 Inanalysabilit
3.4 Syntaxe marque .................................................................................................................................
3.5 Blocage lexical ....................................................................................................................................
3.6 Blocage grammatical...........................................................................................................................
3.7 Rsum.........................................................................................................................
4 Rapports entre les critres de figement examins .......................................................................................
4.1 Rapport entre mmorisation et les autres critres................................................................................
4.2 Rapport entre contexte unique et les autre critres..............................................................................
4.2.1 Rapport entre contexte unique et non-compositionnalit ............................................................
4.2.1.1 Rapport entre contexte unique et non-motivation ...................................................................
4.2.1.2 Rapport entre contexte unique et sens figur...........................................................................
4.2.1.3 Rapport entre contexte unique et opacit
4.2.1.4 Rapport entre contexte unique et inanalysabilit.....................................................................
4.2.2 Rapport entre contexte unique et syntaxe marque.....................................................................
4.2.3 Rapport entre contexte unique et blocage lexical ........................................................................
4.2.4 Rapport entre contexte unique et blocage morphologique ..........................................................
4.3 Rapport entre non-compositionnalit et les autres critres..................................................................
4.3.1 Rapport entre non-compositionnalit et syntaxe marque...........................................................
4.3.1.1 Rapport entre non-motivation et syntaxe marque..................................................................
4.3.1.2 Rapport entre sens figur et syntaxe marque.........................................................................
4.3.1.3 Rapport entre opacit et syntaxe marque...............................................................................
4.3.1.4 Rapport entre inanalysabilit et syntaxe marque ...................................................................
4.3.2 Rapport entre non-compositionnalit et blocage lexical
4.3.2.1 Rapport entre non-motivation et blocage lexical.....................................................................
4.3.2.2 Rapport entre sens figur et blocage lexical. ...........................................................................
4.3.2.3 Rapport entre opacit et blocage lexical..................................................................................
4.3.2.4 Rapport entre inanalysabilit et blocage lexical. .....................................................................
4.3.3 Rapport entre non-compositionnalit et blocage morphologique................................................
196
4.3.3.1 Rapport entre non-motivation et blocage morphologique. ...................................................... 165
165
166
167
168
168
168
169
170
171
176
....................... 177
179
Ressemblances de famille ................................................................................................................... 179
180
180
182
186
4.3.3.2 Rapport entre sens figur et blocage morphologique. .............................................................
4.3.3.3 Rapport entre opacit et blocage morphologique. ...................................................................
4.3.3.4 Rapport entre inanalysabilit et blocage morphologique. .......................................................
4.4 Rapport entre syntaxe marque et les autres critres...........................................................................
4.4.1 Rapport entre syntaxe marque et blocage lexical ......................................................................
4.4.1.1 Rapport entre expressions figes sans dterminant et blocage lexical ....................................
4.4.1.2 Rapport entre les expressions figes avec adjectif employ comme adverbe et blocage lexical.
4.4.2 Rapport entre syntaxe marque et blocage morphologique.........................................................
4.4.2.1 Rapport entre expressions figes avec nom sans dterminant et blocage morphologique ......
4.4.2.2 Rapport entre les expressions figes avec un adjectif employ comme adverbe et le blocage
4.5 Rapport entre blocage lexical et blocage morphologique ...................................................................
4.6 Rsum.........................................................................................................................
5 Lexpression fige comme catgorie linguistique.......................................................................................
5.1
5.2 Critres et indices................................................................................................................................
5.3 Expressions figes et critres ..............................................................................................................
6
Bibliographie........................................................................................................................................................
Conclusion ..................................................................................................................................................
197
morphologique ........................................................................................................................ 173
198
4. Raoul J. Granqvist (ed.), Sensuality and Power in Visual Culture. 2002.
12. Mareike Jendis, Anita Malmqvist & Ingela Valfridsson (Hg.), Norden und Sden.
Festschrift fr Kjell-ke Forsgren zum 65. Geburtstag. 2004.
S K R I F T E R F R N MO D E R N A S P R K
Institutionen fr moderna sprk, Ume universitet
Skriftseriens redaktr:
Raoul J. Granqvist
1. Mareike Jendis, Mumins wundersame Deutschlandabenteuer. Zur Rezeption von Tove
Janssons Muminbchern. Diss. 2001.
2. Lena Karlsson, Multiple Affiliations: Autobiographical Narratives of Displacement by US
Women. Diss. 2001.
3. Anders Steinvall, English Colour Terms in Context. Diss. 2002.
5. Berit strm, The Politics of Tradition: Examining the History of the Old English Poems
The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer. Diss. 2002.
6. Jos J. Gamboa, La lengua despus del exilio. Influencias suecas en retornados chilenos.
Diss. 2003.
7. Katarina Gregersdotter, Watching Women, Falling Women. Power and Dialogue in Three
Novels by Margaret Atwood. Diss. 2003.
8. Thomas Peter, Hans Falladas Romane in den USA. Diss. 2003.
9. Elias Schwieler, Mutual Implications: Otherness in Theory and John Berryman's Poetry of
Loss. Diss. 2003.
10. Mats Deutschmann, Apologising in British English. Diss. 2003.
11. Raija Kangassalo & Ingmarie Mellenius (red.), Lt mig ha kvar mitt sprk. Den tredje
SUKKA-rapporten. / Antakaa minun pit kieleni. Kolmas SUKKA-raportti. 2003.
13. Philip Grey, Defining Moments: A Cultural Biography of Jane Eyre. Diss. 2004.
14. Kirsten Krull, Lieber Gott, mach mich fromm ... Zum Wort und Konzept fromm" im
Wandel der Zeit. Diss. 2004.
15. Maria Helena Svensson, Critres de figement. L'identification des expressions figes en
franais contemporain. Diss. 2004.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Lettre FDocument155 pagesLa Lettre FChristolove.040350% (2)
- Les Francais Malades de Leurs M - Loic MadecDocument122 pagesLes Francais Malades de Leurs M - Loic MadecNimoura100% (1)
- L' Amour Du Français, Contre Les Puristes Et Autres Censeurs de La Langue, REY, Alain 2007Document319 pagesL' Amour Du Français, Contre Les Puristes Et Autres Censeurs de La Langue, REY, Alain 2007ZippywowwowPas encore d'évaluation
- AN1 GalinaFloreaCahier Ex Lecture Coll PDFDocument249 pagesAN1 GalinaFloreaCahier Ex Lecture Coll PDFbasileusbyzantiumPas encore d'évaluation
- Initiez-vous à la langue Saintongeaise avec AlbertineD'EverandInitiez-vous à la langue Saintongeaise avec AlbertinePas encore d'évaluation
- LISE: Trois meurtres sans coupable - Alors, maintenant, désormais.D'EverandLISE: Trois meurtres sans coupable - Alors, maintenant, désormais.Pas encore d'évaluation
- 1 ÈreDocument3 pages1 Èreernestlemajeur0Pas encore d'évaluation
- Sur Le Bout de La langue-FrenchPDFDocument124 pagesSur Le Bout de La langue-FrenchPDFGomezPas encore d'évaluation
- Liri3 Oa tr-1Document146 pagesLiri3 Oa tr-1GabrielladeLuccaPas encore d'évaluation
- Bon Mot Dejouer Les Pieges Du FrancajhisoDocument247 pagesBon Mot Dejouer Les Pieges Du FrancajhisoACHRAF FAHMIPas encore d'évaluation
- Les volets bleus - Tome 2: Les chemins du désespoirD'EverandLes volets bleus - Tome 2: Les chemins du désespoirPas encore d'évaluation
- 1000 Expressions Preferees Des Francais EchantillonDocument78 pages1000 Expressions Preferees Des Francais EchantillonBicynthe ItouaPas encore d'évaluation
- Les Russes de La Société Métallurgique de Normandie (1919 - 1941)Document121 pagesLes Russes de La Société Métallurgique de Normandie (1919 - 1941)stefstefanoPas encore d'évaluation
- Le Bon Mot - D 233 Jouer Les Pi 232 Ges Du Fran 231 AisDocument208 pagesLe Bon Mot - D 233 Jouer Les Pi 232 Ges Du Fran 231 AisabdallahPas encore d'évaluation
- LES ANNÉES DU SILENCE, TOME 1 : LA TOURMENTE: La tourmenteD'EverandLES ANNÉES DU SILENCE, TOME 1 : LA TOURMENTE: La tourmentePas encore d'évaluation
- Defi3 Eva TransDocument7 pagesDefi3 Eva Transhelene100% (1)
- 1000 Expressions Preferees Des Francais EchantillonDocument78 pages1000 Expressions Preferees Des Francais EchantillonIleana Cosanzeana100% (2)
- Un Discours Ordinaire Sur Le PicardDocument7 pagesUn Discours Ordinaire Sur Le PicardEloyPas encore d'évaluation
- Arthur BonifayDocument78 pagesArthur Bonifayscribdhear100% (1)
- Raga Mala Ma vie en musique: Mémoires d'un des plus grands musiciens de musique traditionnelle indienneD'EverandRaga Mala Ma vie en musique: Mémoires d'un des plus grands musiciens de musique traditionnelle indiennePas encore d'évaluation
- Amour, Guerre et Echecs: 16 nouvelles à couper le souffleD'EverandAmour, Guerre et Echecs: 16 nouvelles à couper le soufflePas encore d'évaluation
- Des variations du langage français depuis le XIIe siècle: Recherche des principes qui devraient régler l'orthographe et la prononciationD'EverandDes variations du langage français depuis le XIIe siècle: Recherche des principes qui devraient régler l'orthographe et la prononciationPas encore d'évaluation
- Cassin. Discurso de IngresoDocument18 pagesCassin. Discurso de IngresoFillitPas encore d'évaluation
- Revue de Transylvanie 3Document225 pagesRevue de Transylvanie 3didi_wan6748Pas encore d'évaluation
- Le goût de la diversité linguistique: Création, promotion et réception de romans hétérolingues de la Suisse romande et du QuébecD'EverandLe goût de la diversité linguistique: Création, promotion et réception de romans hétérolingues de la Suisse romande et du QuébecPas encore d'évaluation
- 7.9 C2 PO Zoha Transcription Nancy HoustonDocument3 pages7.9 C2 PO Zoha Transcription Nancy HoustonTavazzi CatherinePas encore d'évaluation
- Peter Brook-Oublier Le Temps-JerichoDocument238 pagesPeter Brook-Oublier Le Temps-JerichorayanisPas encore d'évaluation
- Bertand Périer - Bertrand Périer - Sur Le Bout de La Langue-JC Lattès (2019)Document120 pagesBertand Périer - Bertrand Périer - Sur Le Bout de La Langue-JC Lattès (2019)Scpa KEBET-MEITEPas encore d'évaluation
- Souvenirs d'enfance: Extraits du carnet de bord d'un confinéD'EverandSouvenirs d'enfance: Extraits du carnet de bord d'un confinéPas encore d'évaluation
- Tchengkitong ChinoisDocument159 pagesTchengkitong ChinoisyieldsPas encore d'évaluation
- La bande dessinée: Perspectives linguistiques et didactiquesD'EverandLa bande dessinée: Perspectives linguistiques et didactiquesPas encore d'évaluation
- Lettre sur les sourds et muets, à l'usage de ceux qui entendent et qui voientD'EverandLettre sur les sourds et muets, à l'usage de ceux qui entendent et qui voientPas encore d'évaluation
- b24861054 PDFDocument362 pagesb24861054 PDFPedroPas encore d'évaluation
- Les Clans Ambuun (Bambunda Ou Babunda)Document149 pagesLes Clans Ambuun (Bambunda Ou Babunda)Victor RosezPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu 7-10 Avril 2022Document2 pagesCompte-Rendu 7-10 Avril 2022HafniarSonPas encore d'évaluation
- RESCOVA Joaquim 2015 ED519Document366 pagesRESCOVA Joaquim 2015 ED519Tata RumbePas encore d'évaluation
- Détaché culturel: Cinq années à la direction de l’Institut français de BarceloneD'EverandDétaché culturel: Cinq années à la direction de l’Institut français de BarcelonePas encore d'évaluation
- DALF C2 Sujet 5 TranscriptionDocument4 pagesDALF C2 Sujet 5 TranscriptionstergiosvaPas encore d'évaluation
- 2012 Rachik Hassan, Anthropologie Des Plus ProchesDocument151 pages2012 Rachik Hassan, Anthropologie Des Plus ProchesSammouni MohamedPas encore d'évaluation
- 4 6039586030997212316Document119 pages4 6039586030997212316ali aliPas encore d'évaluation
- Porche 14Document135 pagesPorche 14Charles PéguyPas encore d'évaluation
- Lucien Dialogues Des Morts Et Des DieuxDocument337 pagesLucien Dialogues Des Morts Et Des DieuxJules VernePas encore d'évaluation
- Gwendal Giguelay - Les Grands Classiques Du Piano Pour Les NulsDocument367 pagesGwendal Giguelay - Les Grands Classiques Du Piano Pour Les NulsZeQoD Susini100% (2)
- Le Dictionnaire Des Difficultés Du FrançaisDocument680 pagesLe Dictionnaire Des Difficultés Du FrançaisAnis BeyPas encore d'évaluation
- Des ravioli aux escalopes à la crème en passant par le couscousD'EverandDes ravioli aux escalopes à la crème en passant par le couscousPas encore d'évaluation
- Au Commencement Était Le Verbe... Ensuite Vint L'orthographe ! PDFDocument568 pagesAu Commencement Était Le Verbe... Ensuite Vint L'orthographe ! PDFCharles Martin100% (1)