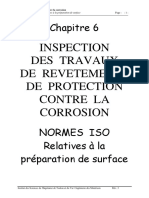Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dossier Rehabilitation
Dossier Rehabilitation
Transféré par
Amariei SebyCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dossier Rehabilitation
Dossier Rehabilitation
Transféré par
Amariei SebyDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dossier thmatique n5 Rhabilitacier 1
Source du graphique : la DAEI
(Dlgation aux affaires europennes et internationales).
La rhabilitation est la remise
en tat dun ouvrage ancien.
Rarement valorise, peu ensei-
gne dans les coles
dingnieurs et darchitectes,
elle requiert pourtant un savoir
faire spcifique, de multiples
comptences et au moins au-
tant dingniosit et de rigueur
que la construction neuve.
Cest la chirurgie fine du BTP.
Elle doit tenir compte de
contraintes techniques, rgle-
mentaires, esthtiques, fonci-
res, conomiques et environ-
nementales face auxquelles
lacier propose des solutions
intelligentes.
Pourquoi et comment rhabili-
ter, quels sont les atouts de
lacier dans ce domaine ? Cest
le sujet de ce dossier.
Plusieurs niveaux de rha-
bilitation
Rhabiliter, cest conserver une partie dun ouvrage (faades
ou structure, en tout ou en partie) et en remanier plus ou
moins profondment une autre. Cela soppose la dcons-
truction suivie dune construction neuve. Le terme de rhabili-
tation peut recouvrir diffrents types dinterventions sur le
btiment, de la plus lgre la plus profonde :
- la rnovation, qui peut dsigner une mise aux normes
de louvrage, lamlioration du confort, de lesthtique ou
de la scurit Il peut sagir par exemple de refaire
llectricit, lisolation, de changer les portes et les fen-
tres, etc. Mais aussi de remanier laspect extrieur.
- La restructuration, qui consiste remettre les volumes
au got du jour, crer par exemple dans un btiment
des niveaux intermdiaires, des
passerelles. On parle alors de surl-
vations, dextensions, de cration ou
suppression de planchers, de conso-
lidations Cest le cas du Roemer-
hof, Zrich (devenu lUnion bank of
Switzerland - photos ci-dessous), o
il sagissait de ramnager lespace
pour optimiser son utilisation, en
conservant les faades et en mainte-
nant lactivit. Autre exemple : la
tour PB12 La Dfense (cf p 5).
Objectifs : moderniser les faades,
ouvrir la vue vers lextrieur, aug-
menter de 5000 m
2
les surfaces
utiles, et adapter la tour aux normes
de construction en vigueur.
D o s s i e r t h m a t i q u e n 5
Dcembre 2004
Acier et rhabilitation
Derrire lancienne faade
du Roemerhof de
Zrich (ci-dessus et ci-
contre), construit la fin
du 19
me
sicle, lintrieur a
t compltement vid et
remplac par une ossature
en acier avec dalles de
plancher en bton.
La rhabilitation a consist
crer une stabilit
interne, renforcer les
fondations, dmolir les
planchers existants et
enfin reconfigurer les
volumes intrieurs.
Aujourdhui, en France, la rhabilitation reprsente moins de 50% du march
total du btiment, non compris les ouvrages dart.
Selon Jean-Michel Dossier (direction gnrale de lindustrie, des technologies
de linformation et des postes au ministre de lEconomie, des Finances et de
lIndustrie), limportance du parc immobilier actuel (30 millions de logements
en France) cre un march extrmement important pour la rhabilitation.
Le march de la construction est cyclique. Le graphique montre que le chiffre
daffaires de la construction neuve crot davantage que celui de la rhabilita-
tion depuis 1999. Les prvisions sur 2005 creusent encore cet cart, mais la
tendance devrait logiquement sinverser dans les prochaines annes.
La rhabilitation : un march amen voluer en France
0
10
20
30
40
50
60
70
1994 1996 1998 2000 2002 2004
Constructions neuves
Rhabilitations
Chiffre daffaires du btiment en France,
en milliards deuros
Rhabilitation (extension et cration
dune verrire)
de la maternit
de lhpital
Bclre
Clamart
A
r
c
h
i
s
:
B
.
d
e
K
o
s
m
y
;
A
.
K
e
c
h
i
c
h
i
a
n
;
F
.
L
a
v
i
g
n
e
A
r
c
h
i
s
:
B
a
e
r
l
o
c
h
e
r
-
U
n
g
e
r
Dossier thmatique n5 Rhabilitacier 2
- la reconstruction avec conservation des faades, qui
revient ne conserver que lenveloppe extrieure ou le vo-
lume global et tout refaire par ailleurs. Cest lexemple de
limmeuble du Crdit Lyonnais, Paris, dont lintrieur a t
dtruit par un incendie et entirement reconstruit.
Rhabiliter plutt que reconstruire : pourquoi ?
Dans certains cas, la rhabilitation simpose. Le plus
souvent pour des raisons culturelles, techniques, ou
foncires.
- Lorsquune construction est classe monument historique
ou est inscrite linventaire du patrimoine, videmment, on
ne peut que rhabiliter. Pour rnover lidentique (dans le
cas de btiments prestigieux comme par exemple le Grand
Palais ou le Pavillon Baltard, Paris), on va jusqu recher-
cher les plans, croquis et moules dorigine pour refaire exac-
tement les mmes poteaux de fonte, etc.
- Lorsque lon veut conserver la surface et les volumes
dorigine. Quand on dmolit pour reconstruire, les rgles
durbanisme en vigueur imposent gnralement de rduire le
volume de la construction. Seule la rhabilitation permet de
conserver ses dimensions initiales.
- Lorsque la construction a une valeur patrimoniale impor-
tante, cest--dire, un cachet, une qualit architecturale mar-
que que lon souhaite prserver (hauteur sous plafond,
grande surface). Constituant une rfrence architecturale,
ce btiment se louera et se vendra plus facilement si on le
rhabilite en prservant son esprit, son aspect dorigine.
- Lorsque la dmolition pose des problmes de vibrations, de
nuisances, dvacuation des gravats insolubles par rapport
lemplacement du btiment, sa hauteur, la scurit des
riverains.
- Lorsque il est ncessaire de remettre un btiment aux nor-
mes (thermique, incendie et notamment tout ce qui concerne
lvacuation des personnes, sanitaires par exemple sup-
pression de lamiante, etc.). Ou tout simplement quand on
change laffectation dun ouvrage (ancien ou pas), en trans-
formant des locaux industriels en bureaux, ou des bureaux en
locaux dhabitation cela modifie certaines donnes structu-
relles et les hypothses de charges et ncessite donc une
rhabilitation.
Parfois, en revanche, la rhabilitation est simplement
une alternative la construction neuve.
Il faut alors valuer si la rhabilitation vaut la peine : si rha-
biliter est intressant sur le plan architectural, financier, tech-
nique, environnemental, sur le plan de la durabilit, du temps
pass, du retour sur investissement et comment tout cela
squilibre. En dautres termes, si cest rentable, faisable et
viable sur le long terme.
Jean-Marie Farsy, conomiste spcialis dans lacier, rsume
les choses ainsi : Sil sagit dun immeuble en bton, des
annes 60, situ la Courneuve, on aura plus vite fait et
pour moins cher de dmolir et de reconstruire. Sil sagit dun
immeuble des annes 20 construit dans un centre urbain, la
rhabilitation est plus adapte. Sil sagit dun immeuble des
annes 60 ou 70, dans un centre urbain, mais o il y a des
obligations de mise en conformit (opration de dsamian-
tage, par exemple), cest le dilemme. Il va falloir tudier les
choses de plus prs pour dcider le la solution la plus adap-
te : dmolition-reconstruction, ou rhabilitation.
Cest en portant un regard global sur louvrage, son empla-
cement, son histoire, son tat, lampleur des travaux faire,
les cots dentretien et de maintenance ultrieurs que lon
dcide si la rhabilitation est rentable (et faisable) ou non.
A titre indicatif, la rnovation lourde dun lyce ou dun col-
lge cote en moyenne 30 % moins cher quune construction
neuve.
Et quoi quil arrive, trs en amont dun chantier, avant mme
que le projet soit lanc et que
larchitecte nintervienne, il faut rali-
ser une ltude de faisabilit, laborer
le budget.
Rhabiliter suppose deffectuer un
diagnostic prcis du btiment (lire p
4). Seul un spcialiste peut savoir avec
quel type de mtal (fonte, fer ou acier)
a t fait un immeuble et si les mat-
riaux peuvent peut tre conservs.
Avant aprs. La rhabilitation du collge Pierre Corneille, Tours, a reprsent 3 mois de travaux seulement.
Cest une construction de 1969, dont seule la structure a t conserve. Les faades ont t entirement rnoves
avec un bardage plan en acier laqu pos sur une ossature secondaire, et avec la cration de volumes supplmentaires en excroissance.
Une partie des planchers a t dconstruite pour raliser un vide sur 3 tages au niveau des accs.
Lors de la rhabilitation de
limmeuble du Crdit Lyonnais,
Paris, seules les faades et une
partie des structures en acier ont
t conserves.
La rhabillitation du Petit Palais,
Paris, est lexemple dune rnovation
lidentique : on consolide, mais en
conservant lesprit et les volumes.
A
r
c
h
i
:
J
.
J
.
O
r
y
A
r
c
h
i
s
:
B
.
V
a
l
e
r
o
F
.
G
a
d
a
n
A
r
c
h
i
:
C
h
.
G
i
r
a
u
l
t
3
Rhabiliter en acier : quels avantages ?
Quand la construction dorigine est en acier, on ne peut pas
la rhabiliter en bton. En revanche, quand elle est en b-
ton, on a le choix de la rhabiliter en bton ou en acier.
Lacier a donc dj l un avantage. Quels sont les autres, et
quest-ce qui incite faire le choix de solutions acier pour
rhabiliter ?
- Varit et libert architecturales
Lutilisation de lacier dans les constructions neuves, mais
aussi dans celles rhabilites, offre une libert architecturale
et une varit de formes exceptionnelles : grandes portes,
grands plateaux ramnageables, vastes volumes Elle offre
des possibilits dadaptation et de transformation pour r-
pondre lvolution des besoins et des usages, tant sur des
btiments en acier quen bton. Elle se traduit par des formes
et des couleurs indites, ainsi que des apports de lumire
plus importants (davantage de transparence en faade, por-
tes plus grandes).
- Facilit de mise en uvre, rapidit dexcution
Selon Jean-Marie Farsy, les deux arguments massue en fa-
veur de lacier sont la facilit et la rapidit dexcution quil
garantit. Ds que les dlais sont serrs, lacier est incontour-
nable. Il se monte comme un mccano, en atelier, et il ne
reste plus sur place qu assembler les lments. Les ossatu-
res mtalliques font gagner du temps, mais sont aussi co-
nomes en main duvre et en matriel pour le montage. De
plus, lacier bnficie dun rseau dentreprises comptentes,
sachant le mettre en uvre de faon optimale.
- Adaptation aux conditions
difficiles
Les ossatures mtalliques sont aussi
particulirement adaptes aux condi-
tions daccs difficiles, comme cest
souvent le cas en ville. Dominique
Quefflec ( la tte dArcora, bureau
dingnierie) pointe les avantages de
lacier sur les chantiers contrain-
tes : chantiers devant imprative-
ment tre propres, ou sans eau, ou
chantiers daccs difficile, auxquels
laspect montage mcano de
lacier convient parfaitement.
- Fiabilit des ossatu-
res mtalliques
Les ossatures en acier,
fabriques le plus souvent
avec des machines
commandes numriques,
sont prcises, donc en-
tranent peu dalas sur
chantier. Elles offrent
galement un bon com-
promis rsistance / encombrement.
- Qualit des produits de construction en acier
Les aciers de construction sont des produits manufacturs,
aux caractristiques gomtriques et mcaniques garanties,
prsentant pour les produits denveloppe des aspects varis
tant dans leurs formes que dans leurs couleurs, qui se ma-
rient facilement aux autres matriaux.
Dans la rhabilitation, un important tonnage dacier est
destination du second uvre (mtallerie, menuiserie mtalli-
que, ferronnerie, serrurerie). Dans les collges, par exem-
ple, on a rem-
plac durant
deux d-
cennies les
portes en bois
par des portes
en aluminium,
qui sont leur
tour rempla-
ces par des
portes en acier, plus rsistantes aux
choc et lusage du fait des propri-
ts mcaniques leves du matriau.
- Prennit des constructions
en acier
Faciles entretenir, et ce sans inter-
rompre la vie de louvrage (trs im-
portant pour un pont, en particulier),
les structures acier demandent une
maintenance peu contraignante.
La protection des structures contre la
corrosion et contre lincendie passe
par des moyens connus et srs.
Lacier est plus apte rsister aux
sismes grce sa ductilit et sa
capacit supporter des efforts al-
terns.
Lors de sollicitations extrmes la
construction mtallique offre plus de
possibilits de rhabilitation que dautres matriaux (exemple
du znith de Toulouse lire p 5 - dont lossature de la toi-
ture, aprs lexplosion de lusine AZF, a rsist la dflagra-
tion et na ncessit que de faibles rparations).
Depuis 1887, la cath-
drale de Chartres (
gauche) est une bonne
illustration de la prenni-
t des structures en
acier. Ci-dessus, mariage
russi de lacier avec du
verre et du bois (Collge
Ecully, 69), et avec du
verre et de la brique
(banque Lodi, en Italie
du Nord).
Les ossatures en acier sont
fabriques avec une grande
prcision
A
r
c
h
i
s
:
M
.
G
a
u
t
r
a
n
d
P
h
.
D
e
s
p
r
s
A
r
c
h
i
:
R
.
P
i
a
n
o
A
r
c
h
i
s
:
G
.
N
i
c
o
t
E
i
f
f
e
l
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
Dossier thmatique n5 Rhabilitacier 4
- Respect de lenvironnement, peu de nuisances pour
lentourage
Les rhabilitations en acier provoquent peu de perturbations
pour lentourage. Les dlais de chantier sont courts et les
nuisances sont rduites : moins de dchets, moins de bruits.
Par ailleurs, les profils en acier, trs utiliss dans la cons-
truction, sont fabriqus 100% partir de ferrailles recy-
cles. Enfin, tous les aciers sont recyclables linfini, et les
btiments acier en fin de vie peuvent tre dconstruits ou
dmonts.
- Confort : Rhabiliter en acier permet de raliser une isola-
tion par lextrieur, donnant aux architectes la possibilit de
moderniser laspect des btiments rnovs. Lacier garantit
une bonne isolation thermique et phonique.
- Lgret : Lacier offre des solutions techniques lgres
qui permettent:
- de limiter les
charges sur les
structures exis-
tantes ;
- de rduire le
nombre et la
section des po-
teaux ;
- de raliser des
planchers de
grande porte,
sans gne pour
les rseaux.
- Conformit la rglementation incendie : la tenue au
feu nest plus un obstacle lutilisation de lacier. Si la lgisla-
tion sur la scurit pouvait paratre handicapante pour lacier
il y a quelques annes, la lgislation europenne, plus raliste
en termes dingnierie incendie, lui est aujourdhui plus favo-
rable. Ds lors que le btiment prvoit un dispositif de dtec-
tion prcoce du feu et dvacuation rapide des personnes et
des fumes. Enfin, du fait de son incombustibi-
lit, lacier napporte aucune charge combusti-
ble supplmentaire dans la rnovation dun
ouvrage.
- Les solutions acier insuffisamment ex-
ploites dans la rhabilitation
Jean-Claude Dossier, du ministre de
lIndustrie, rsume les avantages de lacier
ainsi : Lacier est trs intressant dans la
rhabilitation. Il occupe peu despace par rap-
port sa portance, il peut renforcer sans dna-
turer, se marier avec tous les matriaux, apporter un gros
plus dans lisolation thermique et acoustique. Tout en rpon-
dant parfaitement aux contraintes de rglementation, no-
tamment par rapport lincendie. Lacier pourrait par exem-
ple remplacer le bois partout o il y a des problmes de ter-
mites, dans les logements. On nexploite pas suffisamment
ses possibilits.
Le diagnostic : tape fondatrice de la rhabilitation
Un des avantages de lacier est de pouvoir visualiser la struc-
ture et donc de faciliter le diagnostic.
Le diagnostic est un pralable obligatoire la rhabilitation
dun btiment : il sagit de lexamen minutieux au terme du-
quel on saura quelles conditions et moyennant quel traite-
ment louvrage peut tre restaur. Le diagnostic dune struc-
ture mtallique a pour but den valuer la capacit portante,
ltat, lquilibre.
Quand ldifice date de quelques dizaines voire centaines
dannes, on ne dispose plus des plans ni des calculs caract-
risant la structure.
Il faut raliser un travail dinvestigation, destin compren-
dre lquilibre du btiment.
Les questions se poser sont multiples : Comment est faite
la charpente ? Peut-elle supporter un poids supplmentaire,
mme faible ? O sont les points porteurs ? Que se cache-t-il
derrire ce mur apparemment sain ? Les poutres ont-elle
besoin dtre renforces ? Quel est le code de calcul utilis
lors de la construction ?
Cela demande aussi un contrle minutieux des assemblages.
Pour les ouvrages mtalliques, il faut identifier la nature et les
caractristiques du mtal constituant la structure et les pa-
rois : fonte, fer puddl, ou acier (en prcisant la nuance) ?
Puis il sagit de reprer les ventuels produits toxiques incor-
pors, dvaluer la qualit de la ralisation et ltat de vieillis-
sement, de vrifier le dimensionnement de lossature,
destimer les cots. Tout ceci en tenant compte de lvolution
des pratiques constructives, des modes de calcul, et de la
rglementation.
Le diagnostic est ralis par des bureaux dtudes spcialiss,
voire des bureaux de contrle.
Rhabilitation de lambassade de France Varso-
vie : haute technicit, lgret et lumire.
Ce btiment avait t pens dans les annes 60, par de
grands architectes franais. Il reposait sur une structure
mtallique, avec de nombreux panneaux de fonte
daluminium. On y
avait dtect de
lamiante et on vou-
lait remdier au fait
que le btiment
tait conu en deux
parties spares. Le
tout en conservant
lidentit du bti-
ment, son histoire.
Nous avons donc
pratiqu une rha-
bilitation profonde
sur les faades et la
structure, base sur une plus grande ouverture sur le
paysage et la ville. Haute technicit (portes de 22 mtres
sur 22), lgret et lumire sont les matres mots de ce
projet. Et cest lacier qui permet tout cela.
Jean-Philippe Pargade, architecte
A
r
c
h
i
:
J
.
S
t
r
m
e
r
A
r
c
h
i
:
J
.
P
h
.
P
a
r
g
a
d
e
Rhabiliter en acier garantit une lgret dans les
structures, qui rend possible lajout de niveaux
supplmentaires
tout en limitant
la surcharge
sur les
fondations.
Ici, entrept cralier rhabilit Hambourg
Matres mots de la rhabilitation de lambassade de
France Varsovie : haute technicit du fait des
grandes portes, lgret et lumire.
5
La Tour PB12 avant ( gauche), pendant (au milieu) et aprs ( droite) sa rhabilitation.
La difficult tenait la hauteur du btiment, aux dlais trs serrs, la ncessit de crer
des structures porteuses plus rsistantes et moins encombrantes que les poteaux
initiaux en bton : un march en or pour lacier.
Rhabilitation et architecture : quelques exemples
de rhabilitation en acier
- Le ministre de la Culture Paris
Jai utilis lacier pour rhabiliter lextrieur du btiment,
pour avoir une criture commune de trois btiments htro-
gnes. Cette parure dinox (au total, 4000 panneaux de 12
millimtres dpaisseur) confre une unit au ministre. Cette
dentelle de mtal est un peu comme une mantille espagnole,
qui donne aux btiments une identit unique.
Je suis parti dune uvre de la Renaissance, que jai re-
produite et dcoupe sur ordinateur et que jai laiss driver
au fil des contraintes techniques, de structures, de lumire
Le dessin a ainsi subi une dizaine de transformations pour
arriver une abstraction. Cest du dessin par dfaut.
Francis Soler, architecte.
- Tour PB12 La Dfense
Sur cette rhabilitation, nous navons gard que le noyau
central du bti-
ment et le bton
des plateaux. Le
but architectural
tait de gagner
en lumire, en
ouvertures. Ceci
a t possible
grce lacier.
Par exemple,
nous avons subs-
titu 96 poteaux
de bton espacs
d1 mtre 48 par
26 poteaux m-
talliques espacs
de 6 mtres. Tout de suite, on gagne en espace, en volume,
en clart.
Lacier sest aussi impos pour des raisons techniques. La
hauteur du btiment : il fallait pouvoir faire progresser le
chantier niveau par niveau, sans ajouter trop de poids aux
fondations. La cadence leve des travaux : peu compatible
avec du bton coul. La ncessit de soutenir les planchers
de bton existants en sinscrivant dans un volume trs petit
tout en conservant les bonnes conditions de souplesse du
plancher. Ici, lexcellent rapport rsistance / encombrement
de lacier tait un atout indispensable.
- Znith de Toulouse
A la suite de lexplosion
de lusine chimique
AZF, le znith, situ
2 km de l, a d tre
rhabilit. La structure
avait en effet subi des
efforts non prvus dans
les calculs, qui ont
dform et fissur des
pices. Il a fallu les
remplacer sans mettre
en pril ldifice (le plus grand znith de France, avec 9 000
places). Une intervention grandement facilite du fait que la
structure est en acier.
Les actions de lOtua pour promouvoir lacier dans
la rhabilitation
- Organisation de rencontres techniques sur la
rhabilitation, en avril 2004, en partenariat avec le
CTICM.
LOtua et le CTICM avaient invit des ingnieurs de bureaux
dtudes et dentreprises de construction, des tudiants ing-
nieurs et architectes (120 personnes en tout) pour les sensi-
biliser la rhabilitation utilisant lacier. On a essentiellement
abord la mthodologie pour raliser le diagnostic dun bti-
ment, entretien des ouvrages dart, le tout agrment
dexemples concrets : rhabilitations du ministre de la
Culture et du Grand Palais Paris, du znith de Toulouse, de
lambassade de France Varsovie.
- Organisation Lille, en mai 2004, dune journe sur
acier et habitat social
Journe organise par lOtua avec lassociation Acier Cons-
truction et les organismes chargs du logement social sur le
Nord, le Pas de Calais
et la Picardie.
Lobjectif tant
daccrotre la part de
lacier dans le loge-
ment (seuls 2% des
logements et des
maisons individuelles
sont en acier), en
mettant en avant
laspect modulable et
conomique de ce
type de construction.
- Formations donnes deux trois fois par an par
lOtua aux conomistes de lUntec (Union nationale de
lconomie de la construction et des coordinateurs).
Objectif : faire en sorte que les conomistes connaissent bien
lacier et ses avantages constructifs afin de lintgrer en
amont dans leurs tudes de faisabilit sur les rhabilitations.
Francis Soler, pour la rhabilitation
du ministre de la Culture Paris, a
conu une mantille dacier inox qui
confre une criture commune aux
trois btiments disparates consti-
tuant le ministre.
A
r
c
h
i
:
V
a
l
o
d
e
e
t
P
i
s
t
r
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
e
s
A
r
c
h
i
:
F
.
S
o
l
e
r
A
r
c
h
i
s
:
A
.
e
t
S
.
G
r
e
s
y
La structure en
acier du znith
de Toulouse,
rhabilite
la suite de
lexplosion
dAZF
Vous aimerez peut-être aussi
- Laminage À ChaudDocument24 pagesLaminage À ChaudjabranePas encore d'évaluation
- Vase D'expansion 02Document38 pagesVase D'expansion 02bachirPas encore d'évaluation
- MétauxDocument32 pagesMétauxanouar bennacerPas encore d'évaluation
- Extrait 42174210 PDFDocument131 pagesExtrait 42174210 PDFDarraji OmarPas encore d'évaluation
- Joint Pont ThormajointDocument16 pagesJoint Pont Thormajointfanion47Pas encore d'évaluation
- Segments de Piston Pour Les Moteurs À Combustion InterneDocument80 pagesSegments de Piston Pour Les Moteurs À Combustion InterneRazvan Cristea100% (1)
- Copie de Sécurité Des Structures en Béton ArméDocument108 pagesCopie de Sécurité Des Structures en Béton Arméabdelhadi ahzabPas encore d'évaluation
- Etude D'un Batiment en (R+8+s.sol) À Usage Multiples Contreventé Par Un Système Mixte (Voiles-Portiques) PDFDocument212 pagesEtude D'un Batiment en (R+8+s.sol) À Usage Multiples Contreventé Par Un Système Mixte (Voiles-Portiques) PDFAmine NaitPas encore d'évaluation
- Public Review Draft 2404Document87 pagesPublic Review Draft 2404Said100% (1)
- CH 06Document23 pagesCH 06Ali ClubistPas encore d'évaluation
- 16chapitre7 1Document19 pages16chapitre7 1bakhosPas encore d'évaluation
- Etude de La Mise en Place D'un FourDocument52 pagesEtude de La Mise en Place D'un FourOussamaMesbahiPas encore d'évaluation
- Telwin BUSINESSCATALOGUE PDFDocument244 pagesTelwin BUSINESSCATALOGUE PDFkallatisPas encore d'évaluation
- MetallurgicalDocument69 pagesMetallurgicalzendaoui aminePas encore d'évaluation
- Traitements ThermiquesDocument2 pagesTraitements ThermiquesMathieu DouPas encore d'évaluation
- Catalogue Sas A2r Distribution 2018Document72 pagesCatalogue Sas A2r Distribution 2018alilou2013Pas encore d'évaluation
- L'Inox en Contact Avec D'autres Matériaux MétalliquesDocument27 pagesL'Inox en Contact Avec D'autres Matériaux MétalliquesSidney RileyPas encore d'évaluation
- Chapitre 1&2 SMDocument14 pagesChapitre 1&2 SMSlimane ZadoudPas encore d'évaluation
- CC Filière Licence GI - S5 2022Document6 pagesCC Filière Licence GI - S5 2022IBTIHAL DAILYPas encore d'évaluation
- Brochure Soudage Sous Protection Gazeuse Aciers AlliesDocument4 pagesBrochure Soudage Sous Protection Gazeuse Aciers AlliesDanem HalasPas encore d'évaluation
- Barres en Acier Prétraité T4 Spécifications Techniques E01.14.220.NDocument3 pagesBarres en Acier Prétraité T4 Spécifications Techniques E01.14.220.NjlvgscribdPas encore d'évaluation
- Nouvelle en ISO 4063 - 2009Document2 pagesNouvelle en ISO 4063 - 2009Popescu AlinPas encore d'évaluation
- AciersDocument19 pagesAciersFAKHEREDDINE LAMALMIPas encore d'évaluation
- Information Technique Sur Acier Outil Travail PDF 67 Ko Serie D Lser1Document9 pagesInformation Technique Sur Acier Outil Travail PDF 67 Ko Serie D Lser1XYZAB76Pas encore d'évaluation
- BO 7259-Bis FRDocument105 pagesBO 7259-Bis FRkevin lassPas encore d'évaluation
- Acier Hardox WeldoxDocument4 pagesAcier Hardox WeldoxH_DEBIANEPas encore d'évaluation
- Documentation ParkerDocument460 pagesDocumentation Parkeryouri59490Pas encore d'évaluation
- Page 1Document158 pagesPage 1fathiPas encore d'évaluation
- Armação PVCDocument16 pagesArmação PVCAmilton SoaresPas encore d'évaluation
- M380Document50 pagesM380محمدلمين سيداحمدPas encore d'évaluation