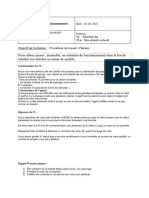Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Nouvelles Tendances Au Sein de La Coopération Décentralisée
Nouvelles Tendances Au Sein de La Coopération Décentralisée
Transféré par
NahuelOddone0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
9 vues3 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
9 vues3 pagesNouvelles Tendances Au Sein de La Coopération Décentralisée
Nouvelles Tendances Au Sein de La Coopération Décentralisée
Transféré par
NahuelOddoneDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 3
NOUVELLES TENDANCES AU SEIN DE LA COOPRATION DCENTRALISE:
VERS O NOUS DIRIGEONS NOUS ?
Nahuel Oddone possde une riche exprience thorico-pratique en ce qui concerne la
coopration internationale au dveloppement, la coopration dcentralise et la
coopration transfrontalire.
http://www.franceamsud.org/observatorio/index.php/fr/qui-sommes-nous/mots-de-
bienvenue-de-nahuel-oddone
Avec le commerce et le dialogue politique, la coopration reprsente un des piliers
fondamentaux des relations internationales euro-latino-amricaines et, en particulier des
rapports entre la France et de l'Amrique du Sud. Il s'agit d'une relation pluri-niveaux et
multi-acteurs qui permet aux collectivits locales de canaliser leurs actions
internationales en vue de contribuer au dveloppement humain et social au-del de leurs
frontires.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont permis de rduire
de manire significative les cots de transaction, stimuler les contacts interculturels
horizontaux et favoriser le transfert de bonnes pratiques de faon quasi-immdiate. De
mme, elles ont entran des changements significatifs dans l'agenda public local, en
prenant en compte et rpondant de nouvelles demandes considres comme indites ;
et, dans les processus de formulation de politiques, o s'impose naturellement peu peu
une logique de travail collaborative et en rseau, et o les expriences internationales
s'incorporent partir de processus de capitalisation et transferts.
Un Observatoire, par dfinition, suit des phnomnes et des tendances, et identifie des
actions pour ceux qui font les politiques publiques ou conoivent des projets de
coopration internationale. Cette mission implique la construction de conditions
ncessaires pour observer et diffuser l'observer , soit maintenir un agenda de travail
ouvert et permable aux processus, aux innovations et aux demandes qui caractrisent le
dveloppement et l'volution de la coopration internationale dcentralise.
L'utilit de l'Observatoire de la Coopration Dcentralise France Amrique du Sud
repose sur la ncessit d'informer et de rendre visible les diffrentes actions et
expriences de coopration auxquelles les collectivits territoriales font face, de gnrer
et construire des catalogues de capacits relles d'un ct et de l'autre de l'Atlantique, de
concevoir et mettre en pratique de nouveaux outils qui peuvent t soutenir la cration et
le renforcement de nouvelles capacits, ainsi que des formes novatrices d'associations
qui renforcent la cohsion sociale.
Depuis cet Observatoire, il devient possible de construire une communaut de
dveloppement qui vite les articulations ad hoc ; communaut dans laquelle il est
possible de construire des projets qui rpondent des processus et des dynamiques
socio-territoriaux, et qui en mme temps renforcent le profil professionnel des porteurs
de projets de coopration. Il est important que la communaut vise raliser des projets
cohrents et complmentaires, qui puissent tre appropris localement et
dmocratiquement ; aligns avec les stratgies, institutions et procdures des partenaires
; en accord avec les processus territoriaux, en harmonie avec les stratgies nationales de
dveloppement et de croissance, qui vitent la fragmentation et l'atomisation des
ressources.
La fameuse fatigue de l'aide a provoqu de nombreuses critiques sur le caractre
assistancialiste de la coopration dcentralise, son suppos manque d'efficacit et
d'efficience, et l'htrognit des pays rcepteurs. La coordination entre les plans des
partenaires metteurs et rcepteurs a rduit nant les stratgies exo-orientes ; en
relativisant la verticalit nord sud, et en laissant surgir une horizontalit sud sud, en
repensant les agendas au-del du transfert de ressources conomiques, en ouvrant un
espace pour le transfert de bonnes pratiques, l'change d'expriences et le renforcement
institutionnel.
Un Observatoire de la Coopration Dcentralise entre la France et l'Amrique du Sud
doit commencer par reconnatre que l'Argentine, le Brsil, le Chili, le Paraguay et
l'Uruguay sont tous des pays revenus intermdiaires, qui ont encore des difficults
institutionnelles rsoudre, mais qui sont des acteurs polyvalents de la coopration
internationale, savoir la fois des partenaires metteurs, rcepteurs, et stratgiques de
la coopration triangulaire.
Selon les estimations de la CEPAL (2012), l'Argentine, le Brsil, le Chili et l'Uruguay
sont des pays en dveloppement, aux revenus intermdiaires suprieurs, tandis que le
Paraguay est en pays en dveloppement aux revenus intermdiaires infrieurs . Cette
situation implique de reconnatre que s'il reste encore des difficults surmonter, ces
pays ont ralis de grandes avances, et leurs autorits territoriales sont des partenaires
part entire des stratgies de coopration, et pas de simples rcepteurs d'aide.
Cette caractristique sud-amricaine d'metteur rcepteur peut s'entendre comme un
avantage au moment de concevoir des stratgies de coopration triangulaire au sein
desquelles un partenaire peut apporter des ressources et l'autre des capacits sous une
forme proportionnelle, pour excuter des actions dans un territoire tiers, en promouvant
le leadership et la responsabilit de ce partenaire rcepteur. Sans porter atteinte au
territoire au sein duquel s'excute l'action, on prtend ainsi renforcer les systmes
d'valuation nationaux et locaux, amliorer la transparence et la prvisibilit, et
renforcer les institutions selon une logique de responsabilit partage.
Dans un contexte de renforcement croissant de la coopration sud sud, il est
primordial pour la France de comprendre la singularit des actions triangulaires, qui
peuvent tre considres comme partie prenante de la "nouvelle contractualisation" du
rapport Laignel (2013). De faon conjointe, en partenariat, ce groupe peut contribuer
aux Objectifs du Millnaire, et plus spcifiquement al OMD 8 qui cherche assurer une
association globale pour le dveloppement .
La coopration dcentralise vise renforcer les capacits sociales locales partir de la
constitution d'alliances ou de partenariats, en amliorant les comptences techniques et
de gestion locale et en stimulant la promotion d'une citoyennet active et engage pour
le dveloppement de la communaut. C'est ce qui permet une meilleure gouvernance si
on favorise l'introduction d'innovations qui visent articuler et rendre complmentaires
des territoires, trs souvent distants, partir des capacits d'inclusion et cohsion de la
socit civile locale dans le processus de dveloppement.
Dans cette nouvelle architecture de la coopration, il est possible de trouver des acteurs
historiques, comme les ONG ou les Universits aux cts d'acteurs plus rcents, comme
les entreprises prives, qui avec leurs programmes de responsabilit sociale des
entreprises, incorporent dsormais cette dimension internationale.
Le processus innovateur de la coopration a permis de faire percer des notions comme
le partenariat public-priv, la gestion intercommunale, les figures juridiques non
traditionnelles pour le financement de projets de dveloppement urbain, les relations
entre l'acadmie et la commune, la constitution de groupes interdisciplinaires ad hoc.
On peut citer pour exemple, dans le Cne Sud, l'exprience de l'Agence de Coopration
Internationale du Chili, qui a russi engager diffrentes entreprises prives dans ses
stratgies de coopration internationale dcentralise. En ce qui concernant l'association
entre l'acadmie et les gouvernements locaux, on peut relever l'exprience argentine du
Rseau Intermuni (Rseau de Responsables Municipaux de Coopration Internationale)
lance en 2012 par l'Unit de Gouvernements Locaux de l'Universit Nationale de
Quilmes, avec pour mission de favoriser le renforcement des capacits et l'appropriation
de mthodologies novatrices de coopration pour les professionnels en charge de ces
dossiers dans les municipalits, pour solidifier les relations internationales et constituer
une communaut de dveloppement.
La transversalit thmatique de la coopration internationale signifie que celle-ci peut
soutenir ou aider dans les multiples domaines du savoir-faire municipal. Il s'agit d'un
agenda tendu et complexe qui tend toujours incorporer de nouvelles thmatiques et
requiert une plus grande spcificit. Pour cela, le renforcement des capacits en gestion
de projet des communauts territoriales doit tre une tche constante des gouvernements
locaux dans leur recherche de l'excellence et de la gestion rationnelle. Hberger dans ce
mme Observatoire une base de donnes de talents peut tre de grande utilit pour la
formation d'un profil professionnel toujours plus dtermin et complexe.
Il est probable que, comme le soutient le rapport Laignel (2013), qu' aujourd'hui, il est
besoin de faire un vritable saut qualitatif et quantitatif. Les dfis internationaux
pourront seulement recevoir une rponse travers la convergence de regards plus
structurs et innovateurs qui s'orientent vers la gnration d'une gouvernance pluri-
niveaux et multiacteurs.
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Jumeaux de MananjaryDocument88 pagesLes Jumeaux de MananjaryunicefmadaPas encore d'évaluation
- Rapport Emploi Femmes Severine Lemiere PDFDocument178 pagesRapport Emploi Femmes Severine Lemiere PDFRaphaelblochPas encore d'évaluation
- 9 D 9 e 1 A 0 de 06 FDocument3 pages9 D 9 e 1 A 0 de 06 FFranco FrancoPas encore d'évaluation
- Pantel, Blaise 2015 - Strategies Politiques Et Cycles-18-52Document35 pagesPantel, Blaise 2015 - Strategies Politiques Et Cycles-18-52xcuadra_1Pas encore d'évaluation
- Entretien de Fonctionnement BUDUH YOUSSEF 02-02-22Document4 pagesEntretien de Fonctionnement BUDUH YOUSSEF 02-02-22achecomhermesPas encore d'évaluation
- Correction Bac Blanc TocquevilleDocument2 pagesCorrection Bac Blanc TocquevilleMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Comment Savoir Si Vous Êtes Noir + CorrigéDocument3 pagesComment Savoir Si Vous Êtes Noir + CorrigéHelena AldazPas encore d'évaluation
- D Tecter Le MensongeDocument9 pagesD Tecter Le MensongenomadiosPas encore d'évaluation
- Communiqué de Presse - Réforme ConstitutionnelleDocument2 pagesCommuniqué de Presse - Réforme ConstitutionnelleSamuel LambrozoPas encore d'évaluation
- Retrouver Ses Racines, Retour Aux SourcesDocument3 pagesRetrouver Ses Racines, Retour Aux SourcesLuciano Tasula De DeynPas encore d'évaluation
- Concept DéfinitionDocument6 pagesConcept DéfinitionCharaf Adam LaasselPas encore d'évaluation
- Profession de Foi de Celia FirminDocument2 pagesProfession de Foi de Celia FirminCélia FirminPas encore d'évaluation
- Fiche 1213 - Intérêts Et Limites Des Tables de Mobilité SocialeDocument2 pagesFiche 1213 - Intérêts Et Limites Des Tables de Mobilité SocialeMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Les Dates Clés Des Droits Des FemmesDocument6 pagesLes Dates Clés Des Droits Des FemmesSharifa McLeodPas encore d'évaluation
- RAPPORT de CONFERENCE Sur Vivre Sa Diférence Au Sein D'une Communauté UniversitaireDocument11 pagesRAPPORT de CONFERENCE Sur Vivre Sa Diférence Au Sein D'une Communauté UniversitaireLalah RAFANOHARANA100% (1)