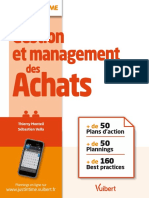Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Optimiser La MP Revue Maintenance Et Entreprise
Optimiser La MP Revue Maintenance Et Entreprise
Transféré par
sabourikhalid47450 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues4 pagesBON DOCUMENT
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentBON DOCUMENT
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues4 pagesOptimiser La MP Revue Maintenance Et Entreprise
Optimiser La MP Revue Maintenance Et Entreprise
Transféré par
sabourikhalid4745BON DOCUMENT
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
_ Méthode
> TPM
Optimiser la maintenance
préventive
La Maintenance préventive a pour objectif de vérifier ou de surveiller, en adoptant
un cert:
niveau de risque (risque de panne imprévue), qu'un composant
a évolué conformément aux prévisions de fiabilité qui ont été faites. Elle n'a pas
pour but de détecter, par une surveillance rapprochée, les dégradations forcées
a TPM nous rappelle que la maintenance priventive est
onéreuse et peu efficace tant queles conditionsnormales
exploitation (production & maintenance) des équipe-
ments ne sont pas respectées. Four construire un plan
cde maintenance, le spécaliste s'appule sur la comneissance des
parameétres de fibilité des composants8contrBler. Cette comnais-
sance est soit mathématique, ce qui nest pas toujours possible
dans Lindustre, soit obtenue a partir de différentes estimations.
Ces derniéres sont souvent implicites. Mais il est impératif de
connaitre ou d'estimer les points suivants:
# quelle est la fiabilité du composant & contrOler? Sa loi de
fiabilité définit& elle seule:
ele phénomene de détérioration (viellissement, phénomene
cataleptique ou accidentel),
la durée de vie moyenne.
quel est le risque accepte de panne imprévue entre 2 opéra-
tions de maintenance préventive ? (celu-ciintégrant ou nonla
précision de la durée de vie moyerne).
Ces éléments sont nécessaires
pour défini
= la courbe dévolution de la dégradation ou la probabilité de
deéfaillance en fonction du temps,
‘sun souil de défaillance (limite des caractéristiques entrat-
rnant la panne),
Tobin cnne
cme
rt de éndnertion
«sun seuil de sécurité pourlequelle composant doit tre changs
pour éviter, avec le risque accepté, une possible panne.
Le JIPM prend exemple de la réalisation d'une maintenance
conditionnelle (basee sure temps). Pour simplifies, nous avons
schématisé par une droite l'6volution des caractéristiques en
fonction du temps
Le seuil-de sécurité tient compte :
« du niveau de risque acceptable,
«+ de la limite basse de lintervalle de confiance
de durée de vie,
« de la fiabilité des contréles.
es inspections sont alors programmées aux temps T, (T+t1},
(T+t7412). Lorsque les caractéristiques sont jugées gales au
niveau de sécurité, une réparation est réalisée et le cycle de
maintenance préventive est relancé.
(On remarquera quil n'est pas nécessaire de programmer des
visites das la mise ou remise en service du composant. Nous
reviendrons sur ce constat dans un prochain paragrephe.
existence de dégradations forcées, nous place dans le cadre
de la2" figure en haut a gauche de la page suivante,
Une dégradation forcée permanente entraine une augmen-
tation dea vitesse de dégradation. Le seul de défaillance est
donc atteint avant la réalisation de la premiére inspection
programmée,
Pour éviter cela, le responsable peut décider de program-
mer beaucoup plus t6t la premiére inspection.
Mais cette décision est extérieure aux prévisions réalisées
et occasionne des contrétes plus fréquents donc une main-
tenance préventive plus onéreuse.
Cette détérioration peut aussi avoir lieu de maniére intem-
pestive entre 2 visites ce qui signifie que le programme d’ins-
pections a été inutile
& MBE-N'S99 - Septerbre 2007
tone
Peete
SSS.
Le non respect des conditions de base ou les dégradations
forcées ont donc pour conséquence une maintenance pré-
ventive cotiteuse (visites précoces ou trop repprochées) ou
inefficace (pannes avant le contréle ou entre deux inspec-
tions). Cette situation seraitidentique pour une maintenance
systématique.
FIABILITE ET DEGRADATIONS
FORCEES
La flablité stexprime par la probablité qu'un composant fonc-
tonne sans défailance, durant un temps donne, dans des condi-
tions dutilsation définies de maniére précise. C'est sur celles-
i que se base ingénieur lorsqu'l prend en compte la iabilits
un composant. Elles concernent les contreintes cue subit le
composant (charge, vitesse, conditions d'environnement,
etc) et les conditions de maintenance de equipement (lubri-
fication, qualité de montage et d'ajustement, état des autres
composants, et)
En TPM® ces conditions spécifiques sont désignées sousleterme
de conditions normales duutilsation du composant. Leur non
respect entraine dans le vocabulaire TPM® des dégradations
forcées.
{a fiabilitéintrinséque dun composant est définie en fonction
dees conditions. Ily aura panne lorsque les contraintes subies
par le composant seront supéricures 8 ses caractérstiques.
reer ov concicnee gare (+)
Fiabilité intrinséque / fiabilité
opérationnelle
Pour simplifier et en nous placant au niveau des utilsateurs,
‘nous inclurons dans le fiabiltéintrinséque les caractéistiques
de fiabilité déterminges par:
¢la conception (dimersionnement des organes, choix destech-
nologies, des matériaux, des tolérarces),
+a construction de 'équipement.
Suivant la figure ci-dessous, la fiabi
"2 Comment’:
intrinséque définit
sie oj
Ee) Sean =
eae
{noccse |
[ Peis a
eeuinonnee
= Comment est et doit rester !quipement. Ce qui définit sa
fiabilité donc ses probabilités de défailances naturelles.
Comment il doit étre install et explcite au niveeu Produc-
tion et Maintenance.
Fiabilité intrinséque et fatilté opérationnelle déterinent le
‘comportement des équipements et donc lactivit de la fonc-
tion maintenance.
Les conditions de maintenance: lubrification, qualité des
reparations, qualité ces pisces de rechange,efficacité de fa main-
tenance préventive, moyens dégagés pour réaliser les remises
niveau sont des paremeétres importants de la fiabilité opéra
tionnelle.
Les 2 Comment sont fixés 8 partir de 8 paramétres qui per-
mettent ¢'évaluer l'état de léquipement et de definir le
niveau SOUHAITABLE ains’ que les limites de ! ACCEPTABLE,
lls concernent:
11='apparence extérieure des organes de (équipement : état
des pices, de leurs surfaces, de leur fixation - absence de
salissures,
2-la précsion dimensionnelle : tolérances dimensionnelles
et de forme,
3-|a précision d assernblage: positions relatives forces de ser-
rage -rigiité,
4- la nature ces matériaux: adaptation aux contraintes
mécaniques, chimiques, etc. ~ résistances aux sollicita-
tions intempestives,
'5- les conditions opérationnelles: définition et respect des
conditions normales diutlisation, de réglage — accessibi-
lité pour contrdles, nettoyages et interventions,
Septembre 2007 - N°S89 - M&E
Méthode
6 - la précision dinstallation : fixation au sol — alignement —
positionnement et protection des cables et tuyauteries,
7 - les conditions fonctionnelles : respect des concitions opé-
ratoires~matrise des dégradations naturelles—absence de
degradations forcées —lubnfication — nettoyages,
8 - les conditions denvironnement : absence de contraintes
extérieures non prévues — accessbilté
Comment éviter les dagradations
forcées ?
LaTPM© fixe S conditions &respecter pour supprimer les causes
dedégyadations forcées. Galles sont représantéos parle schérna
ci-dessus.
1 - ne pas dépasser les caractéristiques nominales,
2 - respecter les conditions d'utilisation,
3 - ne négliger aucune détérioration,
4- améliorer les connaissances et le savoir-faire du personnel
de production et de maintenance,
5 - supprimer les points faibles de conception.
CRITERES DE CHOIX DE LA
POLITIQUE DE MAINTENANCE
La courbe de fiabilite ou de curée de vie des composants sou-
vent représentée par la courbe en baignoire (image dpinal
de le fiabilté) nous permet de distinguer 3 pétiodes:
* Infantile due une mauvaise qualité des composants ou une
-mawvaise qualité de montage. Cette période riest pas concer-
‘née par la maintenance préventive. Mais il faut etre conscient
‘que chaque fois que lon remplace un composant suite 4 une
‘maintenance préventive ou corrective, on risque de se retrou-
ver dans cette periode.
ie utile ou de pannes dites cataleptiques. Le taux davarie
est constant, les pannes surviennent de facon aléatoire,
imprévisible, dou leur nom, Elles sont frenches et subites et
ne sont précédées d aucun signe précurseur. Ce qui signifie quil
‘fest pas possible de prevoir la defeillance donc de feire dela
‘maintenance préventive. C'est le cas typique du matériel
4lectronique et des phénoménes de rupture.
Pour cette loi de fiabilité((oi exponentielle), la probabilité de
défaillance durant une mission de durée déterminée est ind-
pendante de ‘age du matériel mais seulement de la durée de
ta mission. On peut exprimer cette caractéristique on disant
{que chaque fois que le composant est arrété sa probabilité
est réinitialisé» a 1, Ce qui sinifie que le remplacement sys-
tématique du composant n'apporterait aucune fiabilité sup-
plémentaire et risquerait au contraire de nous faire revenir @
la période infantile. I rly a done pas de maintenance préven-
tive possible.
Cette période peut étre interrompue par un phénoméne de
Miellissement qui obligera 3 effectuer un remplacement sys-
‘ématique. La période de remplacement sera déterminge de
telle maniére que le taux d'avarie di au vieilissement ne
fasse pas augmenter de manigre importante le taux davarie de
la période de vie utile,
*Viellissement (le taux d'avarie augmente avecla durée totale
utilisation du matériel). Les phénoménes de veilissement
évoluent en général lentement et sont accompagnés de
signes précurseurs. Cette période est caractéistique des phé-
rromenes dusure, de corrosion et deftigue. Durant cette période
la maintenance préventive peut étre appliquée.
La figure ci-dessous indique comment choisir le type de
maintenance appropri.
ee eee
ood >
rec EEE
<<
Une attention partculire doit étre portée a la détermination
de: tau avarie du composant.
Four des composants soumis aun phénoméne de vellissernent
(osure, etc) et remplacés au furet mesure deleursdéfailances,
le taux de remplacernent apparent tel que les consomme-
tions magasins de ces composants est constant alors que le
taux d'avarie rel est fonction de age du compesant. Le fait
qu'un taux de replacement soit constant n'est pas un cr-
‘Bre suffisant pour dstinguer les pannes cataleptiques de celles
dues au veilissement.
‘Onvoit que a maintenance conditionnelle sera choise pour un
ipement prioritaire dont le taux d'avarie augmnente dans le
‘temps (période de vieillisserment) et pour lequel les symptmes
cde degradation sont observables.
atte maintenance pourra étre remplacée,sibesoin est, par une
maintenance prédictive lorsqu'on aura exploité ta période
précédente pour mettre en évidence une loi de corréltion entre
mesure et niveau de dégradation,
La maintenance systématique (replacement ou révsion) sera
utilsée en période dlusure dans les 2 cas suivants:
* on ne sait pas encore observer ou détecter les symptOmes
M&E - N°5S9 - Septambre 2007
d'usure (équipements neufs). Mais elle est cotteuse. En
acceptant un risque r% de panne on remplace (1-1) % de
composants qui auraient pu fonctionner plus longtemp:
+= la durée de vie moyenne est bien connue, a été amiéliorée et
présente une dispersion faible.
PLANIFICATION
DE LA MAINTENANCE
CONDITIONNELLE
Nous avons vu que la maintenance préventive sappii
des phénoménes de vieilissement: Pour ce type de phénoménes
arflabiité R() diminue avec age du composant et donc une
visite a tautre
Siles vsites de maintenance concitionnelle sont programmées
suivant une fréquence f, la probabilté d arriver en TT a la 1"
Visite est égate a R(T1)
|
feman femme aoe
LLapplication du théoréme de Lusser (multiplication des fabi-
litds) relatif aux fiabilités composées nous permet d'écrire
que la probabilité darriver sans panne en T2 & la 2" visite est
éale &
R (Te) = R(T1) xR(T1##2/T1)
R(T1+I2/T!) est la probabilité que le composant accomplisse
ta mission de durée f2 sil a dj fonctionné correcternent jus-
quati.
Le composant présentera entre la 1" et la 2° visite une fiabi-
lité R(T1+f2/71}; est, pour un composant quia déja fontionné
jusqu'au temps T1, la fiabilité conditionnelle entre
Tet T2= 1142,
R(T1+#2/71) = R(T2) / R(T)
Exemple:
Soit un composant dont la période d'usure est définie par :
b= 3.44 n= 10000 heures (phénomitne d'usure, durée de
vie moyenne de 8 900 heures - un peu plus dun an en fonc-
tionnement continu)
‘On souhaite programmer des visites de mintenance condi-
tionnelle pour maitenirentre chaque visite une probabiité de
bon fonctionnement de 99 %.
Si fest lintervalle de temps entre la visite n-1 et.
Pour la premiére visite R(F1) = 0.99 fiabilité imposée
Pourlaz:viste: R(F1+f21F") = Rf) Xx R(f2) = 099099 = 099°
Pour ta 3 visite R(F1+ 4243/2) = R(Ft+12/F1) x R(F3)
= R(f1) xR{F2) x R(B)
198x098 x099 = 0.99"
(On peut écrire que si 'équipement est en état de fonctionne-
ment a la visite n-1 la visite dordre n devra etre réalisée au
temps Tn =T+f14f24...+fn-1 tel que: R(Tn)= R(fl)
XR(I2) x .....x R(fn) =0.99"
Le graphique ci-dessous quireprésente fintervalle entre2 vsites
en fonction de leur rang nous améne au constat sulvent:
Tnterelle entre vistas
ae ae
1 /La premiere vsite peut étre planifigea unintervalle de temps.
assez long aprés le démarrage de linstallation. Ici 2 600 h
soit environ 3,5 mois, Le service maintenance pourra profiter
de-ce répit pour planfier et réaliser d'autres actions.
2 / La durée entre les autres visites diminue rapidement: 0.8 -
0,5 - 0,4 mols, Ces visites tres rapprochées représentent une
charge inadmissible. il semble préférable de remplacer le
‘composant aprés 2 0u 3 visites plutot que diexécuter des vistes
tres rapprochées.
Mise en ceuvre pratique:
Dans le cas d'une politique de maintenance systématique avec
Lun objectif de fiabilté de 99 %, il faudrait effectuer un rem-
placement systématique 8 t =2 600 h (Fiabilité de 9899 %).
En tenant compte du constat précédent, en réalisant 2 visites
cde maintenance conditionnelle & t = 2.600 et 3 200 h suivies
un remplacement systématique a 3 600 h on respecte lob-
jectf fis de fabilté en augmentant la durée d'utilisation de
la piéce de 22 % par rapport & une maintenance systéma-
tique.
= an oe ae
poses pee ea
ba | 8% oe we
ae
Jean Bufferne
Jean Bufferne est auteur du « Guide de la TPM - Total Pro-
‘ductive Maintenance » (Editions Organisation Eyrolles),
Jean Bufferne estinstricteur TPM certifié PM
‘Septembre 2007 - N°599 - M1 & E
Vous aimerez peut-être aussi
- Gestion Et Management: AchatsDocument42 pagesGestion Et Management: Achatssabourikhalid4745100% (1)
- Gestion Et Management: AchatsDocument42 pagesGestion Et Management: Achatssabourikhalid4745100% (1)
- Projet de Mise en Place D'un Système WmsDocument20 pagesProjet de Mise en Place D'un Système Wmssabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Monter Un ProjetDocument16 pagesMonter Un Projetsabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- FR Sciforma 7 1 Gestion Portefeuilles ProgrammesDocument8 pagesFR Sciforma 7 1 Gestion Portefeuilles Programmessabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Statut PersonnelDocument7 pagesStatut Personnelsabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Focus Sur L'agroalimentaire Au MarocDocument30 pagesFocus Sur L'agroalimentaire Au Marocsabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Les Analyses de Cout en Achat Et Approvisionnement D'emballage SabouriDocument87 pagesLes Analyses de Cout en Achat Et Approvisionnement D'emballage Sabourisabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Sgs SSC FSSC 22000 WP FR Web LRDocument12 pagesSgs SSC FSSC 22000 WP FR Web LRsabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Point Vue ManutanDocument8 pagesPoint Vue Manutansabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Presentation GMAO PDFDocument13 pagesPresentation GMAO PDFWil ToulousePas encore d'évaluation
- QPO12 2015 Gr09 MIM v06Document37 pagesQPO12 2015 Gr09 MIM v06sabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Guide WMS VfinDocument26 pagesGuide WMS Vfinsabourikhalid4745100% (1)
- Blagues-De-Daf To Web PDFDocument47 pagesBlagues-De-Daf To Web PDFsabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Partage D Information Dans La Chaine Logistique PDFDocument144 pagesPartage D Information Dans La Chaine Logistique PDFsabourikhalid4745100% (2)