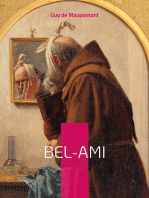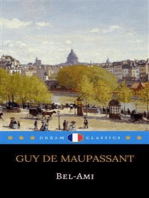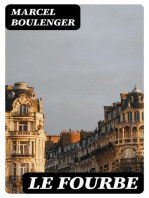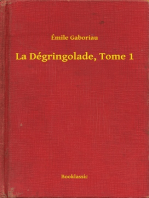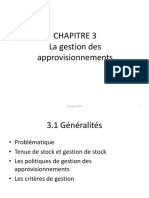Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bel Ami
Bel Ami
Transféré par
goudsesingelTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bel Ami
Bel Ami
Transféré par
goudsesingelDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bel-Ami
Guy de Maupassant
Publication: 1885
Source : Livres & Ebooks
Premire partie
1
Chapitre 1
Quand la caissire lui eut rendu la monnaie de sa pice de cent sous, Georges
Duroy sortit du restaurant.
Comme il portait beau par nature et par pose dancien sous-ofcier, il cam-
bra sa taille, frisa sa moustache dun geste militaire et familier, et jeta sur les d-
neurs attards un regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garon, qui
stendent comme des coups dpervier.
Les femmes avaient lev la tte vers lui, trois petites ouvrires, une matresse de
musique entre deux ges, mal peigne, nglige, coiffe dun chapeau toujours
poussireux et vtue toujours dune robe de travers, et deux bourgeoises avec
leurs maris, habitues de cette gargote prix xe.
Lorsquil fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce
quil allait faire. On tait au 28 juin, et il lui restait juste en poche trois francs qua-
rante pour nir le mois. Cela reprsentait deux dners sans djeuners, ou deux
djeuners sans dners, au choix. Il rchit que les repas du matin tant de vingt-
deux sous, aulieude trente que cotaient ceux dusoir, il lui resterait, ense conten-
tant des djeuners, un franc vingt centimes de boni, ce qui reprsentait encore
deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocks sur le boulevard. Ctait
l sa grande dpense et son grand plaisir des nuits ; et il se mit descendre la rue
Notre-Dame-de-Lorette.
Il marchait ainsi quau temps o il portait luniforme des hussards, la poitrine
bombe, les jambes un peu entrouvertes comme sil venait de descendre de che-
val ; et il avanait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les paules,
poussant les gens pour ne point se dranger de sa route. Il inclinait lgrement sur
loreille son chapeau haute forme assez dfrachi, et battait le pav de son talon.
Il avait lair de toujours der quelquun, les passants, les maisons, la ville entire,
par chic de beau soldat tomb dans le civil.
2
Quoique habill dun complet de soixante francs, il gardait une certaine l-
gance tapageuse, un peu commune, relle cependant. Grand, bien fait, blond,
dun blond chtain vaguement roussi, avec une moustache retrousse, qui sem-
blait mousser sur sa lvre, des yeux bleus, clairs, trous dune pupille toute petite,
des cheveux friss naturellement, spars par une raie au milieu du crne, il res-
semblait bien au mauvais sujet des romans populaires.
Ctait une de ces soires dt o lair manque dans Paris. La ville, chaude
comme une tuve, paraissait suer dans la nuit touffante. Les gouts soufaient
par leurs bouches de granit leurs haleines empestes, et les cuisines souterraines
jetaient la rue, par leurs fentres basses, les miasmes infmes des eaux de vais-
selle et des vieilles sauces.
Les concierges, en manches de chemise, cheval sur des chaises en paille, fu-
maient la pipe sous des portes cochres, et les passants allaient dun pas accabl,
le front nu, le chapeau la main.
Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il sarrta encore, indcis sur ce
quil allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-lyses et lave-
nue du bois de Boulogne pour trouver un peu dair frais sous les arbres ; mais un
dsir aussi le travaillait, celui dune rencontre amoureuse.
Comment se prsenterait-elle ? Il nen savait rien, mais il lattendait depuis trois
mois, tous les jours, tous les soirs. Quelquefois cependant, grce sa belle mine
et sa tournure galante, il volait, par-ci, par-l, un peu damour, mais il esprait
toujours plus et mieux.
La poche vide et le sang bouillant, il sallumait au contact des rdeuses qui mur-
murent, langle des rues : "Venez-vous chez moi, joli garon?"mais il nosait les
suivre, ne les pouvant payer ; et il attendait aussi autre chose, dautres baisers,
moins vulgaires.
Il aimait cependant les lieux o grouillent les lles publiques, leurs bals, leurs
cafs, leurs rues ; il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, airer leurs par-
fums violents, se sentir prs delles. Ctaient des femmes enn, des femmes damour.
Il ne les mprisait point du mpris inn des hommes de famille.
Il tourna vers la Madeleine et suivit le ot de foule qui coulait accabl par la
chaleur. Les grands cafs, pleins de monde, dbordaient sur le trottoir, talant leur
3
public de buveurs sous la lumire clatante et crue de leur devanture illumine.
Devant eux, sur de petites tables carres ou rondes, les verres contenaient des
liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances ; et dans lintrieur des
carafes on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient
la belle eau claire.
Duroy avait ralenti sa marche, et lenvie de boire lui schait la gorge.
Une soif chaude, une soif de soir dt le tenait, et il pensait la sensation d-
licieuse des boissons froides coulant dans la bouche. Mais sil buvait seulement
deux bocks dans la soire, adieu le maigre souper du lendemain, et il les connais-
sait trop, les heures affames de la n du mois.
Il se dit : "Il faut que je gagne dix heures et je prendrai mon bock lAmricain.
Nom dun chien! que jai soif tout de mme !" Et il regardait tous ces hommes
attabls et buvant, tous ces hommes qui pouvaient se dsaltrer tant quil leur
plaisait. Il allait, passant devant les cafs dun air crne et gaillard, et il jugeait
dun coup doeil, la mine, lhabit, ce que chaque consommateur devait porter
dargent sur lui. Et une colre lenvahissait contre ces gens assis et tranquilles. En
fouillant leurs poches, on trouverait de lor, de la monnaie blanche et des sous.
En moyenne, chacun devait avoir au moins deux louis ; ils taient bien une cen-
taine au caf ; cent fois deux louis font quatre mille francs ! Il murmurait : "Les co-
chons !" tout ense dandinant avec grce. Sil avait puentenir unaucoindune rue,
dans lombre bien noire, il lui aurait tordu le cou, ma foi, sans scrupule, comme il
faisait aux volailles des paysans, aux jours de grandes manuvres.
Et il se rappelait ses deux annes dAfrique, la faondont il ranonnait les Arabes
dans les petits postes du Sud. Et un sourire cruel et gai passa sur ses lvres au sou-
venir dune escapade qui avait cot la vie trois hommes de la tribu des Ouled-
Alane et qui leur avait valu, ses camarades et lui, vingt poules, deux moutons
et de lor, et de quoi rire pendant six mois.
On navait jamais trouv les coupables, quon navait gure cherch dailleurs,
lArabe tant un peu considr comme la proie naturelle du soldat.
A Paris, ctait autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, sabre au
ct et revolver au poing, loin de la justice civile, en libert, il se sentait au cur
tous les instincts dusous-off lch enpays conquis. Certes il les regrettait, ses deux
4
annes de dsert. Quel dommage de ntre pas rest l-bas ! Mais voil, il avait es-
pr mieux en revenant. Et maintenant !... Ah! oui, ctait du propre, maintenant !
Il faisait aller sa langue dans sa bouche, avec un petit claquement, comme pour
constater la scheresse de son palais.
La foule glissait autour de lui, extnue et lente, et il pensait toujours : "Tas de
brutes ! tous ces imbciles-l ont des sous dans le gilet." Il bousculait les gens de
lpaule, et sifotait des airs joyeux. Des messieurs heurts se retournaient en gro-
gnant ; des femmes prononaient : "En voil un animal !"
Il passa devant le Vaudeville, et sarrta en face du caf Amricain, se deman-
dant sil nallait pas prendre son bock, tant la soif le torturait. Avant de se dcider,
il regarda lheure aux horloges lumineuses, au milieu de la chausse. Il tait neuf
heures un quart. Il se connaissait : ds que le verre plein de bire serait devant lui,
il lavalerait. Que ferait-il ensuite jusqu onze heures ?
Il passa. "Jirai jusqu la Madeleine, se dit-il, et je reviendrai tout doucement."
Comme il arrivait au coin de la place de lOpra, il croisa un gros jeune homme,
dont il se rappela vaguement avoir vu la tte quelque part.
Il se mit le suivre en cherchant dans ses souvenirs, et rptant mi-voix : "O
diable ai-je connu ce particulier-l ?"
Il fouillait dans sa pense, sans parvenir se le rappeler ; puis tout dun coup,
par un singulier phnomne de mmoire, le mme homme lui apparut moins
gros, plus jeune, vtu dun uniforme de hussard. Il scria tout haut : "Tiens, Fo-
restier !" et, allongeant le pas, il alla frapper sur lpaule du marcheur. Lautre se
retourna, le regarda, puis dit :
"Quest-ce que vous me voulez, monsieur ?" Duroy se mit rire :
"Tu ne me reconnais pas ?
- Non.
- Georges Duroy du 6e hussards."
5
Forestier tendit les deux mains :
"Ah! mon vieux ! comment vas-tu?
- Trs bien et toi ?
- Oh! moi, pas trop; gure-toi que jai une poitrine de papier mch mainte-
nant ; je tousse six mois sur douze, la suite dune bronchite que jai attrape
Bougival, lanne de mon retour Paris, voici quatre ans maintenant.
- Tiens ! tu as lair solide, pourtant."
Et Forestier, prenant le bras de son ancien camarade, lui parla de sa maladie, lui
raconta les consultations, les opinions et les conseils des mdecins, la difcult de
suivre leurs avis dans sa position. On lui ordonnait de passer lhiver dans le Midi ;
mais le pouvait-il ? Il tait mari et journaliste, dans une belle situation.
"Je dirige la politique La Vie Franaise. Je fais le Snat au Salut, et, de temps
en temps, des chroniques littraires pour La Plante. Voil, jai fait mon chemin."
Duroy, surpris, le regardait. Il tait bien chang, bien mri. Il avait maintenant
une allure, une tenue, uncostume dhomme pos, sr de lui, et unventre dhomme
qui dne bien. Autrefois il tait maigre, mince et souple, tourdi, casseur das-
siettes, tapageur et toujours en train. En trois ans Paris en avait fait quelquun
de tout autre, de gros et de srieux, avec quelques cheveux blancs sur les tempes,
bien quil net pas plus de vingt-sept ans.
Forestier demanda :
"O vas-tu?"
Duroy rpondit :
"Nulle part, je fais un tour avant de rentrer.
- Eh bien, veux-tu maccompagner La Vie Franaise, o jai des preuves
corriger ; puis nous irons prendre un bock ensemble.
6
- Je te suis."
Et ils se mirent marcher en se tenant par le bras avec cette familiarit facile
qui subsiste entre compagnons dcole et entre camarades de rgiment.
"Quest-ce que tu fais Paris ?" dit Forestier.
Duroy haussa les paules :
"Je crve de faim, tout simplement. Une fois mon temps ni, jai voulu venir ici
pour... pour faire fortune ou plutt pour vivre Paris ; et voil six mois que je suis
employ aux bureaux du chemin de fer du Nord, quinze cents francs par an, rien
de plus."
Forestier murmura :
"Bigre, a nest pas gras.
- Je te crois. Mais comment veux-tu que je men tire ? Je suis seul, je ne connais
personne, je ne peux me recommander personne. Ce nest pas la bonne volont
qui me manque, mais les moyens."
Son camarade le regarda des pieds la tte, en homme pratique, qui juge un
sujet, puis il pronona dun ton convaincu :
"Vois-tu, mon petit, tout dpend de laplomb, ici. Un homme un peu malin de-
vient plus facilement ministre que chef de bureau. Il faut simposer et non pas de-
mander. Mais comment diable nas-tu pas trouv mieux quune place demploy
au Nord?"
Duroy reprit :
"Jai cherch partout, je nai rien dcouvert. Mais jai quelque chose en vue en
ce moment, on moffre dentrer comme cuyer au mange Pellerin. L, jaurai, au
bas mot, trois mille francs."
Forestier sarrta net !
7
"Ne fais pas a, cest stupide, quand tu devrais gagner dix mille francs. Tu te
fermes lavenir du coup. Dans ton bureau, au moins, tu es cach, personne ne te
connat, tu peux en sortir, si tu es fort, et faire ton chemin. Mais une fois cuyer,
cest ni. Cest comme si tu tais matre dhtel dans une maison o tout Paris va
dner. Quand tu auras donn des leons dquitation aux hommes du monde ou
leurs ls, ils ne pourront plus saccoutumer te considrer comme leur gal."
Il se tut, rchit quelques secondes, puis demanda :
"Es-tu bachelier ?
- Non. Jai chou deux fois.
- a ne fait rien, du moment que tu as pouss tes tudes jusquau bout. Si on
parle de Cicron ou de Tibre, tu sais peu prs ce que cest ?
- Oui, peu prs.
- Bon, personne nen sait davantage, lexception dune vingtaine dimbciles
qui ne sont pas chus de se tirer daffaire. a nest pas difcile de passer pour
fort, va ; le tout est de ne pas se faire pincer en agrant dlit dignorance. On ma-
nuvre, on esquive la difcult, on tourne lobstacle, et on colle les autres au
moyen dun dictionnaire. Tous les hommes sont btes comme des oies et igno-
rants comme des carpes."
Il parlait en gaillard tranquille qui connat la vie, et il souriait en regardant pas-
ser la foule. Mais tout dun coup il se mit tousser, et sarrta pour laisser nir la
quinte, puis, dun ton dcourag :
"Nest-ce pas assommant de ne pouvoir se dbarrasser de cette bronchite ? Et
nous sommes en plein t. Oh! cet hiver, jirai me gurir Menton. Tant pis, ma
foi, la sant avant tout. "
Ils arrivrent au boulevard Poissonnire, devant une grande porte vitre, der-
rire laquelle un journal ouvert tait coll sur les deux faces. Trois personnes arr-
tes le lisaient.
8
Au-dessus de la porte stalait, comme un appel, en grandes lettres de feu des-
sines par des ammes de gaz : La Vie Franaise. Et les promeneurs passant brus-
quement dans la clart que jetaient ces trois mots clatants apparaissaient tout
coup en pleine lumire, visibles, clairs et nets comme au milieu du jour, puis
rentraient aussitt dans lombre.
Forestier poussa cette porte : "Entre", dit-il. Duroy entra, monta un escalier
luxueux et sale que toute la rue voyait, parvint dans une antichambre, dont les
deux garons de bureau salurent son camarade, puis sarrta dans une sorte de
salon dattente, poussireux et frip, tendu de faux velours dun vert pisseux, cri-
bl de taches et rong par endroits, comme si des souris leussent grignot.
"Assieds-toi, dit Forestier, je reviens dans cinq minutes."
Et il disparut par une des trois sorties qui donnaient dans ce cabinet.
Une odeur trange, particulire, inexprimable, lodeur des salles de rdaction,
ottait dans ce lieu. Duroy demeurait immobile, un peu intimid, surpris surtout.
De temps en temps des hommes passaient devant lui, en courant, entrs par une
porte et partis par lautre avant quil et le temps de les regarder.
Ctaient tantt des jeunes gens, trs jeunes, lair affair, et tenant la main
une feuille de papier qui palpitait au vent de leur course ; tantt des ouvriers com-
positeurs, dont la blouse de toile tache dencre laissait voir un col de chemise
bien blanc et un pantalon de drap pareil celui des gens du monde ; et ils por-
taient avec prcaution des bandes de papier imprim, des preuves fraches, tout
humides. Quelquefois un petit monsieur entrait, vtu avec une lgance trop ap-
parente, la taille trop serre dans la redingote, la jambe trop moule sous ltoffe,
le pied treint dans un soulier trop pointu, quelque reporter mondain apportant
les chos de la soire.
Dautres encore arrivaient, graves, importants, coiffs de hauts chapeaux bords
plats, comme si cette forme les et distingus du reste des hommes.
Forestier reparut tenant par le bras un grand garon maigre, de trente qua-
rante ans, en habit noir et en cravate blanche, trs brun, la moustache roule en
pointes aigus, et qui avait lair insolent et content de lui.
Forestier lui dit :
9
"Adieu, cher matre."
Lautre lui serra la main :
"Au revoir, mon cher", et il descendit lescalier en sifotant, la canne sous le
bras.
Duroy demanda :
"Qui est-ce ?
- Cest Jacques Rival, tusais, le fameux chroniqueur, le duelliste. Il vient de corri-
ger ses preuves. Garin, Montel et lui sont les trois premiers chroniqueurs desprit
et dactualit que nous ayons Paris. Il gagne ici trente mille francs par an pour
deux articles par semaine."
Et comme ils sen allaient, ils rencontrrent un petit homme longs cheveux,
gros, daspect malpropre, qui montait les marches en soufant.
Forestier salua trs bas.
"Norbert de Varenne, dit-il, le pote, lauteur des Soleils morts, encore unhomme
dans les grands prix. Chaque conte quil nous donne cote trois cents francs, et les
plus longs nont pas deux cents lignes. Mais entrons au Napolitain, je commence
crever de soif."
Ds quils furent assis devant la table du caf, Forestier cria : " Deux bocks !" et
il avala le sien dun seul trait, tandis que Duroy buvait la bire lentes gorges, la
savourant et la dgustant, comme une chose prcieuse et rare.
Son compagnon se taisait, semblait rchir, puis tout coup :
"Pourquoi nessaierais-tu pas du journalisme ?"
Lautre, surpris, le regarda ; puis il dit :
"Mais... cest que... je nai jamais rien crit.
10
- Bah! on essaie, on commence. Moi, je pourrais temployer aller me chercher
des renseignements, faire des dmarches et des visites. Tu aurais, au dbut, deux
cent cinquante francs et tes voitures payes. Veux-tu que jen parle au directeur ?
- Mais certainement que je veux bien,
- Alors, fais une chose, viens dner chez moi demain; jai cinq ou six personnes
seulement, le patron, M. Walter, sa femme, Jacques Rival et Norbert de Varenne,
que tu viens de voir, plus une amie de Mme Forestier. Est-ce entendu?"
Duroy hsitait, rougissant, perplexe. Il murmura enn :
"Cest que... je nai pas de tenue convenable."
Forestier fut stupfait :
"Tu nas pas dhabit ? Bigre ! en voil une chose indispensable pourtant. A Paris,
vois-tu, il vaudrait mieux navoir pas de lit que pas dhabit."
Puis, tout coup, fouillant dans la poche de son gilet, il en tira une pince dor,
prit deux louis, les posa devant son ancien camarade, et, dun ton cordial et fami-
lier :
"Tu me rendras a quand tu pourras. Loue ou achte au mois, en donnant un
acompte, les vtements quil te faut ; enn arrange-toi, mais viens dner la mai-
son, demain, sept heures et demie, 17, rue Fontaine."
Duroy, troubl, ramassait largent en balbutiant :
"Tu es trop aimable, je te remercie bien, sois certain que je noublierai pas..."
Lautre linterrompit : "Allons, cest bon. Encore un bock, nest-ce pas ?" Et il
cria : "Garon, deux bocks !"
Puis, quand ils les eurent bus, le journaliste demanda :
"Veux-tu ner un peu, pendant une heure ?
11
- Mais certainement."
Et ils se remirent en marche vers la Madeleine.
"Quest-ce que nous ferions bien? demanda Forestier. On prtend qu Paris
un neur peut toujours soccuper ; a nest pas vrai. Moi, quand je veux ner, le
soir, je ne sais jamais o aller. Un tour au Bois nest amusant quavec une femme,
et on nen a pas toujours une sous la main; les cafs-concerts peuvent distraire
mon pharmacien et son pouse, mais pas moi. Alors, quoi faire ? Rien. Il devrait y
avoir ici un jardin dt, comme le parc Monceau, ouvert la nuit, o on entendrait
de la trs bonne musique en buvant des choses fraches sous les arbres. Ce ne
serait pas un lieu de plaisir, mais un lieu de ne ; et on paierait cher pour entrer,
an dattirer les jolies dames. On pourrait marcher dans des alles bien sables,
claires la lumire lectrique, et sasseoir quand on voudrait pour couter la
musique de prs ou de loin. Nous avons eu peu prs a autrefois chez Musard,
mais avec un got de bastringue et trop dairs de danse, pas assez dtendue, pas
assez dombre, pas assez de sombre. Il faudrait un trs beau jardin, trs vaste. Ce
serait charmant. O veux-tu aller ?"
Duroy, perplexe, ne savait que dire ; enn, il se dcida :
"Je ne connais pas les Folies-Bergre. Jy ferais volontiers un tour. "
Son compagnon scria :
"Les Folies-Bergre, bigre ? nous y cuirons comme dans une rtissoire. Enn,
soit, cest toujours drle."
Et ils pivotrent sur leurs talons pour gagner la rue du Faubourg-Montmartre.
La faade illumine de ltablissement jetait une grande lueur dans les quatre
rues qui se joignent devant elle. Une le de acres attendait la sortie.
Forestier entrait, Duroy larrta :
"Nous oublions de passer au guichet."
Lautre rpondit dun ton important :
12
"Avec moi on ne paie pas."
Quand il sapprocha du contrle, les trois contrleurs le salurent. Celui du mi-
lieu lui tendit la main. Le journaliste demanda :
"Avez-vous une bonne loge ?
- Mais certainement, monsieur Forestier."
Il prit le coupon quon lui tendait, poussa la porte matelasse, battants garnis
de cuir, et ils se trouvrent dans la salle.
Une vapeur de tabac voilait un peu, comme un trs n brouillard, les parties
lointaines, la scne et lautre ct du thtre. Et slevant sans cesse, en minces
lets blanchtres, de tous les cigares et de toutes les cigarettes que fumaient tous
ces gens, cette brume lgre montait toujours, saccumulait auplafond, et formait,
sous le large dme, autour du lustre, au-dessus de la galerie du premier charge
de spectateurs, un ciel ennuag de fume.
Dans le vaste corridor dentre qui mne la promenade circulaire, o rde la
tribu pare des lles, mle la foule sombre des hommes, un groupe de femmes
attendait les arrivants devant un des trois comptoirs o trnaient, fardes et d-
frachies, trois marchandes de boissons et damour.
Les hautes glaces, derrire elles, retaient leurs dos et les visages des passants.
Forestier ouvrait les groupes, avanait vite, en homme qui a droit la consid-
ration.
Il sapprocha dune ouvreuse.
"La loge dix-sept ? dit-il.
- Par ici, monsieur."
13
Et on les enferma dans une petite bote en bois, dcouverte, tapisse de rouge,
et qui contenait quatre chaises de mme couleur, si rapproches quon pouvait
peine se glisser entre elles. Les deux amis sassirent : et, droite comme gauche,
suivant une longue ligne arrondie aboutissant la scne par les deux bouts, une
suite de cases semblables contenait des gens assis galement et dont on ne voyait
que la tte et la poitrine.
Sur la scne, trois jeunes hommes en maillot collant, un grand, un moyen, un
petit, faisaient, tour tour, des exercices sur un trapze.
Le grand savanait dabord, pas courts et rapides, en souriant, et saluait avec
un mouvement de la main comme pour envoyer un baiser.
On voyait, sous le maillot, se dessiner les muscles des bras et des jambes ; il
gonait sa poitrine pour dissimuler son estomac trop saillant ; et sa gure sem-
blait celle dun garon coiffeur, car une raie soigne ouvrait sa chevelure en deux
parties gales, juste au milieu du crne. Il atteignait le trapze dun bond gracieux,
et, pendu par les mains, tournait autour comme une roue lance ; ou bien, les bras
raides, le corps droit, il se tenait immobile, couch horizontalement dans le vide,
attach seulement la barre xe par la force des poignets.
Puis il sautait terre, saluait de nouveau en souriant sous les applaudissements
de lorchestre, et allait se coller contre le dcor, en montrant bien, chaque pas, la
musculature de sa jambe.
Le second, moins haut, plus trapu, savanait son tour et rptait le mme
exercice, que le dernier recommenait encore, aumilieude la faveur plus marque
du public.
Mais Duroy ne soccupait gure du spectacle, et, la tte tourne, il regardait sans
cesse derrire lui le grand promenoir plein dhommes et de prostitues.
Forestier lui dit :
"Remarque donc lorchestre : rien que des bourgeois avec leurs femmes et leurs
enfants, de bonnes ttes stupides qui viennent pour voir. Aux loges, des boulevar-
diers ; quelques artistes, quelques lles de demi-choix ; et, derrire nous, le plus
drle de mlange qui soit dans Paris. Quels sont ces hommes ? Observe- les. Il y
14
a de tout, de toutes les castes, mais la crapule domine. Voici des employs, em-
ploys de banque, de magasin, de ministre, des reporters, des souteneurs, des
ofciers en bourgeois, des gommeux en habit, qui viennent de dner au caba-
ret et qui sortent de lOpra avant dentrer aux Italiens, et puis encore tout un
monde dhommes suspects qui dent lanalyse. Quant aux femmes, rien quune
marque : la soupeuse de lAmricain, la lle un ou deux louis qui guette ltran-
ger de cinq louis et prvient ses habitus quand elle est libre. On les connat toutes
depuis six ans ; on les voit tous les soirs, toute lanne, aux mmes endroits, sauf
quand elles font une station hyginique Saint- Lazare ou Lourcine."
Duroy ncoutait plus. Une de ces femmes, stant accoude leur loge, le regar-
dait. Ctait une grosse brune la chair blanchie par la pte, loeil noir, allong,
soulign par le crayon, encadr sous des sourcils normes et factices. Sa poitrine,
trop forte, tendait la soie sombre de sa robe ; et ses lvres peintes, rouges comme
une plaie, lui donnaient quelque chose de bestial, dardent, doutr, mais qui al-
lumait le dsir cependant.
Elle appela, dun signe de tte, une de ses amies qui passait, une blonde aux
cheveux rouges, grasse aussi, et elle lui dit dune voix assez forte pour tre enten-
due :
"Tiens, vl un joli garon : sil veut de moi pour dix louis, je ne dirai pas non."
Forestier se retourna, et, souriant, il tapa sur la cuisse de Duroy :
"Cest pour toi, a : tu as du succs, mon cher. Mes compliments."
Lancien sous-off avait rougi ; et il ttait, dun mouvement machinal du doigt,
les deux pices dor dans la poche de son gilet.
Le rideau stait baiss ; lorchestre maintenant jouait une valse.
Duroy dit :
"Si nous faisions un tour dans la galerie ?
- Comme tu voudras."
15
Ils sortirent, et furent aussitt entrans dans le courant des promeneurs. Pres-
ss, pousss, serrs, ballotts, ils allaient, ayant devant les yeux un peuple de cha-
peaux. Et les lles, deux par deux, passaient dans cette foule dhommes, la traver-
saient avec facilit, glissaient entre les coudes, entre les poitrines, entre les dos,
comme si elles eussent t bien chez elles, bien laise, la faon des poissons
dans leau, au milieu de ce ot de mles.
Duroy ravi, se laissait aller, buvait avec ivresse lair vici par le tabac, par lodeur
humaine et les parfums des drlesses. Mais Forestier suait, soufait, toussait.
"Allons au jardin", dit-il.
Et, tournant gauche, ils pntrrent dans une espce de jardin couvert, que
deux grandes fontaines de mauvais got rafrachissaient. Sous des ifs et des thuyas
en caisse, des hommes et des femmes buvaient sur des tables de zinc.
"Encore un bock ? demanda Forestier.
Oui, volontiers."
Ils sassirent en regardant passer le public.
De temps en temps, une rdeuse sarrtait, puis demandait avec un sourire ba-
nal : "Moffrez-vous quelque chose, monsieur ?" Et comme Forestier rpondait :
"Un verre deau la fontaine", elle sloignait en murmurant : "Va donc, mue !"
Mais la grosse brune qui stait appuye tout lheure derrire la loge des deux
camarades reparut, marchant arrogamment, le bras pass sous celui de la grosse
blonde. Cela faisait vraiment une belle paire de femmes, bien assorties.
Elle sourit en apercevant Duroy, comme si leurs yeux se fussent dit dj des
choses intimes et secrtes ; et, prenant une chaise, elle sassit tranquillement en
face de lui et t asseoir son amie, puis elle commanda dune voix claire : "Garon,
deux grenadines !" Forestier, surpris, pronona : "Tu ne te gnes pas, toi !"
Elle rpondit :
"Cest ton ami qui me sduit. Cest vraiment un joli garon. Je crois quil me
ferait faire des folies !"
16
Duroy, intimid, ne trouvait rien dire. Il retroussait sa moustache frise en
souriant dune faon niaise. Le garon apporta les sirops, que les femmes burent
dun seul trait ; puis elles se levrent, et la brune, avec un petit salut amical de la
tte et un lger coup dventail sur le bras, dit Duroy : "Merci, mon chat. Tu nas
pas la parole facile."
Et elles partirent en balanant leur croupe.
Alors Forestier se mit rire :
"Dis donc, mon vieux, sais-tu que tu as vraiment du succs auprs des femmes ?
Il faut soigner a. a peut te mener loin."
Il se tut une seconde, puis reprit, avec ce ton rveur des gens qui pensent tout
haut :
"Cest encore par elles quon arrive le plus vite."
Et comme Duroy souriait toujours sans rpondre, il demanda :
"Est-ce que tu restes encore ? Moi, je vais rentrer, jen ai assez."
Lautre murmura :
"Oui, je reste encore un peu. Il nest pas tard."
Forestier se leva :
"Eh bien, adieu, alors. A demain. Noublie pas ? 17, rue Fontaine, sept heures et
demie.
- Cest entendu; demain. Merci."
Ils se serrrent la main, et le journaliste sloigna.
Ds quil eut disparu, Duroy se sentit libre, et de nouveau il tta joyeusement les
deux pices dor dans sa poche ; puis, se levant, il se mit parcourir la foule quil
fouillait de loeil.
17
Il les aperut bientt, les deux femmes, la blonde et la brune, qui voyageaient
toujours de leur allure re de mendiantes, travers la cohue des hommes.
Il alla droit sur elles, et quand il fut tout prs, il nosa plus.
La brune lui dit :
"As-tu retrouv ta langue ?"
Il balbutia : "Parbleu", sans parvenir prononcer autre chose que cette parole.
Ils restaient debout tous les trois, arrts, arrtant le mouvement du promenoir,
formant un remous autour deux.
Alors, tout coup, elle demanda :
"Viens-tu chez moi ?"
Et lui, frmissant de convoitise, rpondit brutalement .
"Oui, mais je nai quun louis dans ma poche."
Elle sourit avec indiffrence :
"a ne fait rien."
Et elle prit son bras en signe de possession.
Comme ils sortaient, il songeait quavec les autres vingt francs il pourrait facile-
ment se procurer, en location, un costume de soire pour le lendemain.
18
Chapitre 2
"Monsieur Forestier, sil vous plat ?
- Au troisime, la porte gauche."
Le concierge avait rpondu cela dune voix aimable o apparaissait une consi-
dration pour son locataire. Et Georges Duroy monta lescalier.
Il tait un peu gn, intimid, mal laise. Il portait un habit pour la premire
fois de sa vie, et lensemble de sa toilette linquitait : Il la sentait dfectueuse
en tout, par les bottines non vernies mais assez nes cependant, car il avait la
coquetterie du pied, par la chemise de quatre francs cinquante achete le matin
mme au Louvre, et dont le plastron trop mince se cassait dj. Ses autres che-
mises, celles de tous les jours, ayant des avaries plus ou moins graves, il navait pu
utiliser mme la moins abme.
Son pantalon, un peu trop large, dessinait mal la jambe, semblait senrouler
autour du mollet, avait cette apparence fripe que prennent les vtements doc-
casion sur les membres quils recouvrent par aventure. Seul, lhabit nallait pas
mal, stant trouv peu prs juste pour la taille.
Il montait lentement les marches, le cur battant, lesprit anxieux, harcel sur-
tout par la crainte dtre ridicule ; et, soudain, il aperut en face de lui un mon-
sieur en grande toilette qui le regardait. Ils se trouvaient si prs lun de lautre que
Duroy t un mouvement en arrire, puis il demeura stupfait : ctait lui-mme,
ret par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue
perspective de galerie. Un lan de joie le t tressaillir, tant il se jugea mieux quil
naurait cru.
19
Nayant chez lui que son petit miroir barbe, il navait pu se contempler en-
tirement, et comme il ny voyait que fort mal les diverses parties de sa toilette
improvise, il sexagrait les imperfections, saffolait lide dtre grotesque.
Mais voil quen sapercevant brusquement dans la glace, il ne stait pas mme
reconnu; il stait pris pour unautre, pour unhomme du monde, quil avait trouv
fort bien, fort chic, au premier coup doeil.
Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que, vraiment, len-
semble tait satisfaisant.
Alors il studia comme font les acteurs pour apprendre leurs rles. Il se sourit,
se tendit la main, t des gestes, exprima des sentiments : ltonnement, le plaisir,
lapprobation; et il chercha les degrs du sourire et les intentions de loeil pour
se montrer galant auprs des dames, leur faire comprendre quon les admire et
quon les dsire.
Une porte souvrit dans lescalier. Il eut peur dtre surpris et il se mit monter
fort vite et avec la crainte davoir t vu, minaudant ainsi, par quelque invit de
son ami.
En arrivant au second tage, il aperut une autre glace et il ralentit sa marche
pour se regarder passer. Sa tournure lui parut vraiment lgante. Il marchait bien.
Et une conance immodre en lui-mme emplit son me. Certes, il russirait
avec cette gure-l et son dsir darriver, et la rsolution quil se connaissait et
lindpendance de son esprit. Il avait envie de courir, de sauter en gravissant le
dernier tage. Il sarrta devant la troisime glace, frisa sa moustache dun mou-
vement qui lui tait familier, ta son chapeau pour rajuster sa chevelure, et mur-
mura mi-voix, comme il faisait souvent : "Voil une excellente invention." Puis,
tendant la main vers le timbre, il sonna.
La porte souvrit presque aussitt, et il se trouva en prsence dun valet en habit
noir, grave, ras, si parfait de tenue que Duroy se troubla de nouveau sans com-
prendre do lui venait cette vague motion : dune inconsciente comparaison,
peut-tre, entre la coupe de leurs vtements. Ce laquais, qui avait des souliers ver-
nis, demanda en prenant le pardessus que Duroy tenait sur son bras par peur de
montrer les taches :
"Qui dois-je annoncer ?"
20
Et il jeta le nom derrire une porte souleve, dans un salon o il fallait entrer.
Mais Duroy, tout coup perdant son aplomb, se sentit perclus de crainte, ha-
letant. Il allait faire son premier pas dans lexistence attendue, rve. Il savana,
pourtant. Une jeune femme blonde tait debout qui lattendait, toute seule, dans
une grande pice bien claire et pleine darbustes, comme une serre.
Il sarrta net, tout fait dconcert. Quelle tait cette dame qui souriait ? Puis
il se souvint que Forestier tait mari ; et la pense que cette jolie blonde lgante
devait tre la femme de son ami acheva de leffarer.
Il balbutia : "Madame, je suis..." Elle lui tendit la main : "Je le sais, monsieur.
Charles ma racont votre rencontre dhier soir, et je suis trs heureuse quil ait eu
la bonne inspiration de vous prier de dner avec nous aujourdhui."
Il rougit jusquaux oreilles, ne sachant plus que dire ; et il se sentait examin,
inspect des pieds la tte, pes, jug.
Il avait envie de sexcuser, dinventer une raison pour expliquer les ngligences
de sa toilette ; mais il ne trouva rien, et nosa pas toucher ce sujet difcile.
Il sassit sur un fauteuil quelle lui dsignait, et quand il sentit plier sous lui le
velours lastique et doux du sige, quand il se sentit enfonc, appuy, treint par
ce meuble caressant dont le dossier et les bras capitonns le soutenaient dlica-
tement, il lui sembla quil entrait dans une vie nouvelle et charmante, quil pre-
nait possessionde quelque chose de dlicieux, quil devenait quelquun, quil tait
sauv ; et il regarda Mme Forestier dont les yeux ne lavaient point quitt.
Elle tait vtue dune robe de cachemire bleu ple qui dessinait bien sa taille
souple et sa poitrine grasse.
La chair des bras et de la gorge sortait dune mousse de dentelle blanche dont
taient garnis le corsage et les courtes manches ; et les cheveux relevs au sommet
de la tte, frisant un peu sur la nuque, faisaient un lger nuage de duvet blond au-
dessus du cou.
Duroy se rassurait sous son regard, qui lui rappelait sans quil st pourquoi,
celui de la lle rencontre la veille aux Folies-Bergre. Elle avait les yeux gris, dun
gris azur qui en rendait trange lexpression, le nez mince, les lvres fortes, le
21
menton un peu charnu, une gure irrgulire et sduisante, pleine de gentillesse
et de malice. Ctait un de ces visages de femme dont chaque ligne rvle une
grce particulire, semble avoir une signication, dont chaque mouvement parat
dire ou cacher quelque chose.
Aprs un court silence, elle lui demanda :
"Vous tes depuis longtemps Paris ?"
Il rpondit, en reprenant peu peu possession de lui :
"Depuis quelques mois seulement, madame. Jai un emploi dans les chemins
de fer ; mais Forestier ma laiss esprer que je pourrais, grce lui, pntrer dans
le journalisme."
Elle eut un sourire plus visible, plus bienveillant ; et elle murmura en baissant
la voix : "Je sais." Le timbre avait tint de nouveau. Le valet annona :
"Mme de Marelle."
Ctait une petite brune, de celles quon appelle des brunettes.
Elle entra dune allure alerte ; elle semblait dessine, moule des pieds la tte
dans une robe sombre toute simple.
Seule une rose rouge, pique dans ses cheveux noirs. attirait loeil violemment,
semblait marquer sa physionomie, accentuer son caractre spcial, lui donner la
note vive et brusque quil fallait.
Une llette en robe courte la suivait. Mme Forestier slana :
"Bonjour, Clotilde.
- Bonjour, Madeleine."
Elles sembrassrent. Puis lenfant tendit sonfront avec une assurance de grande
personne, en prononant :
22
"Bonjour, cousine."
Mme Forestier la baisa ; puis t les prsentations :
"M. Georges Duroy, un bon camarade de Charles.
"Mme de Marelle, mon amie, un peu ma parente."
Elle ajouta :
"Vous savez, nous sommes ici sans crmonie, sans faon et sans pose. Cest
entendu, nest-ce pas ?"
Le jeune homme sinclina.
Mais la porte souvrit de nouveau, et un petit gros monsieur, court et rond, pa-
rut, donnant le bras une grande et belle femme, plus haute que lui, beaucoup
plus jeune, de manires distingues et dallure grave. M. Walter, dput, nancier,
homme dargent et daffaires, juif et mridional, directeur de La Vie Franaise, et
sa femme, ne Basile-Ravalau, lle du banquier de ce nom.
Puis parurent, coup sur coup, Jacques Rival, trs lgant, et Norbert de Varenne,
dont le col dhabit luisait, un peu cir par le frottement des longs cheveux qui
tombaient jusquaux paules, et semaient dessus quelques grains de poussire
blanche.
Sa cravate, mal noue, ne semblait pas sa premire sortie. Il savana avec
des grces de vieux beau et, prenant la main de Mme Forestier, mit un baiser sur
son poignet. Dans le mouvement quil t en se baissant, sa longue chevelure se
rpandit comme de leau sur le bras nu de la jeune femme.
Et Forestier entra son tour en sexcusant dtre en retard. Mais il avait t re-
tenu au journal par laffaire Morel. M. Morel, dput radical, venait dadresser une
question au ministre sur une demande de crdit relative la colonisation de lAl-
grie.
Le domestique cria :
23
"Madame est servie !"
Et on passa dans la salle manger.
Duroy se trouvait plac entre Mme de Marelle et sa lle. Il se sentait de nouveau
gn, ayant peur de commettre quelque erreur dans le maniement conventionnel
de la fourchette, de la cuiller ou des verres. Il y en avait quatre, dont un lgrement
teint de bleu. Que pouvait-on boire dans celui-l ?
On ne dit rien pendant quon mangeait le potage, puis Norbert de Varenne de-
manda : "Avez-vous lu ce procs Gauthier ? Quelle drle de chose !"
Et on discuta sur le cas dadultre compliqu de chantage. On nen parlait point
comme on parle, au sein des familles, des vnements raconts dans les feuilles
publiques, mais comme on parle dune maladie entre mdecins ou de lgumes
entre fruitiers. On ne sindignait pas, on ne stonnait pas des faits ; on en cher-
chait les causes profondes, secrtes, avec une curiosit professionnelle et une in-
diffrence absolue pour le crime lui-mme. On tchait dexpliquer nettement les
origines des actions, de dterminer tous les phnomnes crbraux dont tait n
le drame, rsultat scientique dun tat desprit particulier. Les femmes aussi se
passionnaient cette poursuite, ce travail. Et dautres vnements rcents furent
examins, comments, tourns sous toutes leurs faces, pess leur valeur, avec
ce coup doeil pratique et cette manire de voir spciale des marchands de nou-
velles, des dbitants de comdie humaine la ligne, comme on examine, comme
on retourne et comme on pse, chez les commerants, les objets quon va livrer
au public.
Puis il fut question dun duel, et Jacques Rival prit la parole. Cela lui apparte-
nait : personne autre ne pouvait traiter cette affaire,
Duroy nosait point placer un mot. Il regardait parfois sa voisine, dont la gorge
ronde le sduisait. Un diamant tenu par un l dor pendait au bas de loreille,
comme une goutte deau qui aurait gliss sur la chair. De temps en temps, elle fai-
sait une remarque qui veillait toujours un sourire sur les lvres. Elle avait un es-
prit drle, gentil, inattendu, un esprit de gamine exprimente qui voit les choses
avec insouciance et les juge avec un scepticisme lger et bienveillant.
Duroy cherchait en vain quelque compliment lui faire, et, ne trouvant rien, il
soccupait de sa lle, lui versait boire, lui tenait ses plats, la servait. Lenfant, plus
24
svre que sa mre, remerciait avec une voix grave, faisait de courts saluts de la
tte : " Vous tes bien aimable, monsieur", et elle coutait les grandes personnes
dun petit air rchi.
Le dner tait fort bon, et chacun sextasiait. M. Walter mangeait comme un
ogre, ne parlait presque pas, et considrait dun regard oblique, gliss sous ses
lunettes, les mets quon lui prsentait. Norbert de Varenne lui tenait tte et laissait
tomber parfois des gouttes de sauce sur son plastron de chemise.
Forestier, souriant et srieux, surveillait, changeait avec sa femme des regards
dintelligence, la faon de compres accomplissant ensemble une besogne dif-
cile et qui marche souhait.
Les visages devenaient rouges, les voix senaient. De moment en moment, le
domestique murmurait loreille des convives : "Corton - Chteau-Laroze ?"
Duroy avait trouv le corton de son got et il laissait chaque fois emplir son
verre. Une gaiet dlicieuse entrait en lui ; une gaiet chaude, qui lui montait du
ventre la tte, lui courait dans les membres, le pntrait tout entier. Il se sentait
envahi par un bien-tre complet, un bien-tre de vie et de pense, de corps et
dme.
Et une envie de parler lui venait, de se faire remarquer, dtre cout, apprci
comme ces hommes dont on savourait les moindres expressions.
Mais la causerie qui allait sans cesse, accrochant les ides les unes aux autres,
sautant dun sujet lautre sur un mot, un rien, aprs avoir fait le tour des v-
nements du jour et avoir efeur, en passant, mille questions, revint la grande
interpellation de M. Morel sur la colonisation de lAlgrie.
M. Walter, entre deux services, t quelques plaisanteries, car il avait lesprit
sceptique et gras. Forestier raconta son article du lendemain. Jacques Rival r-
clama un gouvernement militaire avec des concessions de terre accordes tous
les ofciers aprs trente annes de service colonial.
"De cette faon, disait-il, vous crerez une socit nergique, ayant appris de-
puis longtemps connatre et aimer le pays, sachant sa langue et au courant
de toutes ces graves questions locales auxquelles se heurtent infailliblement les
nouveaux venus."
25
Norbert de Varenne linterrompit :
"Oui... ils sauront tout, except lagriculture. Ils parleront larabe, mais ils igno-
reront comment on repique des betteraves et comment on sme du bl. Ils seront
mme forts en escrime, mais trs faibles sur les engrais. Il faudrait au contraire
ouvrir largement ce pays neuf tout le monde. Les hommes intelligents sy feront
une place, les autres succomberont. Cest la loi sociale."
Un lger silence suivit. On souriait.
Georges Duroy ouvrit la bouche et pronona, surpris par le sonde sa voix, comme
sil ne stait jamais entendu parler :
"Ce qui manque le plus l-bas, cest la bonne terre. Les proprits vraiment
fertiles cotent aussi cher quen France, et sont achetes, comme placements de
fonds, par des Parisiens trs riches. Les vrais colons, les pauvres, ceux qui sexilent
faute de pain, sont rejets dans le dsert, o il ne pousse rien, par manque deau."
Tout le monde le regardait. Il se sentit rougir. M. Walter demanda :
"Vous connaissez lAlgrie, monsieur ?"
Il rpondit :
"Oui, monsieur, jy suis rest vingt-huit mois, et jai sjourn dans les trois pro-
vinces."
Et brusquement, oubliant la question Morel, Norbert de Varenne linterrogea
sur undtail de murs quil tenait dunofcier. Il sagissait du Mzab, cette trange
petite rpublique arabe ne au milieu du Sahara, dans la partie la plus dessche
de cette rgion brlante.
Duroy avait visit deux fois le Mzab, et il raconta les murs de ce singulier pays,
o les gouttes deau ont la valeur de lor, o chaque habitant est tenu tous les
services publics, o la probit commerciale est pousse plus loin que chez les
peuples civiliss.
26
Il parla avec une certaine verve hbleuse, excit par le vin et par le dsir de
plaire ; il raconta des anecdotes de rgiment, des traits de la vie arabe, des aven-
tures de guerre. Il trouva mme quelques mots colors pour exprimer ces contres
jaunes et nues, interminablement dsoles sous la amme dvorante du soleil.
Toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Mme Walter murmura de sa voix
lente : "Vous feriez avec vos souvenirs une charmante srie darticles. " Alors Wal-
ter considra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes, comme il faisait
pour bien voir les visages. Il regardait les plats par-dessous.
Forestier saisit le moment :
"Mon cher patron, je vous ai parl tantt de M. Georges Duroy, en vous deman-
dant de me ladjoindre pour le service des informations politiques. Depuis que
Marambot nous a quitts, je nai personne pour aller prendre des renseignements
urgents et condentiels, et le journal en souffre."
Le pre Walter devint srieux et releva tout fait ses lunettes pour regarder Du-
roy bien en face. Puis il dit :
"Il est certain que M. Duroy a un esprit original. Sil veut bien venir causer avec
moi, demain trois heures, nous arrangerons a."
Puis, aprs un silence, et se tournant tout fait vers le jeune homme :
"Mais faites-nous tout de suite une petite srie fantaisiste sur lAlgrie. Vous ra-
conterez vos souvenirs, et vous mlerez a la questionde la colonisation, comme
tout lheure. Cest dactualit, tout fait dactualit, et je suis sr que a plaira
beaucoup nos lecteurs. Mais dpchez-vous ! Il me faut le premier article pour
demain ou aprs-demain, pendant quon discute la Chambre, an damorcer le
public."
Mme Walter ajouta, avec cette grce srieuse quelle mettait en tout et qui don-
nait un air de faveurs ses paroles :
"Et vous avez un titre charmant : Souvenirs dun chasseur dAfrique ; nest-ce
pas, monsieur Norbert ?"
27
Le vieux pote, arriv tard la renomme, dtestait et redoutait les nouveaux
venus. Il rpondit dun air sec :
"Oui, excellent, condition que la suite soit dans la note, car cest l la grande
difcult ; la note juste, ce quen musique on appelle le ton."
Mme Forestier couvrait Duroy dun regard protecteur et souriant, dun regard
de connaisseur qui semblait dire : "Toi, tuarriveras." Mme de Marelle stait, plu-
sieurs reprises, tourne vers lui, et le diamant de son oreille tremblait sans cesse,
comme si la ne goutte deau allait se dtacher et tomber.
La petite lle demeurait immobile et grave, la tte baisse sur son assiette.
Mais le domestique faisait le tour de la table, versant dans les verres bleus du vin
de Johannisberg ; et Forestier portait un toast en saluant M. Walter : " A la longue
prosprit de La Vie Franaise !"
Tout le monde sinclina vers le Patron, qui souriait, et Duroy, gris de triomphe,
but dun trait. Il aurait vid de mme une barrique entire, lui semblait-il ; il au-
rait mang un buf, trangl un lion. Il se sentait dans les membres une vigueur
surhumaine, dans lesprit une rsolution invincible et une esprance innie. Il
tait chez lui, maintenant, au milieu de ces gens ; il venait dy prendre position,
dy conqurir sa place. Son regard se posait sur les visages avec une assurance
nouvelle, et il osa, pour la premire fois, adresser la parole sa voisine :
"Vous avez, madame, les plus jolies boucles doreilles que jaie jamais vues. "
Elle se tourna vers lui en souriant :
"Cest une ide moi de pendre des diamants comme a, simplement au bout
du l. On dirait vraiment de la rose, nest-ce pas ?"
Il murmura, confus de son audace et tremblant de dire une sottise :
"Cest charmant... mais loreille aussi fait valoir la chose."
Elle le remercia dun regard, dun de ces clairs regards de femme qui pntrent
jusquau cur.
28
Et comme il tournait la tte, il rencontra encore les yeux de Mme Forestier, tou-
jours bienveillants, mais il crut y voir une gaiet plus vive, une malice, un encou-
ragement.
Tous les hommes maintenant parlaient en mme temps, avec des gestes et des
clats de voix ; ondiscutait le grandprojet ducheminde fer mtropolitain. Le sujet
ne fut puis qu la n du dessert, chacun ayant une quantit de choses dire
sur la lenteur des communications dans Paris, les inconvnients des tramways,
les ennuis des omnibus et la grossiret des cochers de acre.
Puis on quitta la salle manger pour aller prendre le caf. Duroy, par plaisan-
terie, offrit son bras la petite lle. Elle le remercia gravement, et se haussa sur la
pointe des pieds pour arriver poser la main sur le coude de son voisin.
En entrant dans le salon, il eut de nouveau la sensation de pntrer dans une
serre. De grands palmiers ouvraient leurs feuilles lgantes dans les quatre coins
de la pice, montaient jusquau plafond, puis slargissaient en jets deau.
Des deux cts de la chemine, des caoutchoucs, ronds comme des colonnes,
tageaient lune sur lautre leurs longues feuilles dun vert sombre, et sur le piano
deux arbustes inconnus, ronds et couverts de eurs, lun tout rose et lautre tout
blanc, avaient lair de plantes factices, invraisemblables, tropbelles pour tre vraies.
Lair tait frais et pntr dun parfum vague, doux, quon naurait pu dnir,
dont on ne pouvait dire le nom.
Et le jeune homme, plus matre de lui, considra avec attention lappartement.
Il ntait pas grand; rien nattirait le regard en dehors des arbustes ; aucune cou-
leur vive ne frappait ; mais on se sentait son aise dedans, on se sentait tranquille,
repos ; il enveloppait doucement, il plaisait, mettait autour du corps quelque
chose comme une caresse.
Les murs taient tendus avec une toffe ancienne dun violet pass, crible de
petites eurs de soie jaune, grosses comme des mouches.
Des portires en drap bleu gris, en drap de soldat, ou lon avait brod quelques
oeillets de soie rouge, retombaient sur les portes ; et les siges, de toutes les formes,
de toutes les grandeurs, parpills au hasard dans lappartement, chaises longues,
29
fauteuils normes ouminuscules, poufs et tabourets, taient couverts de soie Louis
XVI ou du beau velours dUtrecht, fond crme dessins grenat.
"Prenez-vous du caf, monsieur Duroy ?"
Et Mme Forestier lui tendait une tasse pleine, avec ce sourire ami qui ne quittait
point sa lvre.
"Oui, madame, je vous remercie."
Il reut la tasse, et comme il se penchait plein dangoisse pour cueillir avec la
pince dargent un morceau de sucre dans le sucrier que portait la petite lle, la
jeune femme lui dit mi-voix :
"Faites donc votre cour Mme Walter."
Puis elle sloigna avant quil et pu rpondre un mot.
Il but dabord son caf quil craignait de laisser tomber sur le tapis ; puis, lesprit
plus libre, il chercha un moyen de se rapprocher de la femme de son nouveau
directeur et dentamer une conversation.
Tout coup il saperut quelle tenait la main sa tasse vide ; et, comme elle se
trouvait loin dune table, elle ne savait o la poser. Il slana.
"Permettez, madame.
- Merci, monsieur."
Il emporta la tasse, puis il revint :
"Si vous saviez, madame, quels bons moments ma fait passer La Vie Franaise
quand jtais l-bas dans le dsert. Cest vraiment le seul journal quon puisse lire
hors de France, parce quil est plus littraire, plus spirituel et moins monotone que
tous les autres. On trouve de tout l-dedans."
Elle sourit avec une indiffrence aimable, et rpondit gravement :
30
"M. Walter a eu bien du mal pour crer ce type de journal, qui rpondait un
besoin nouveau."
Et ils se mirent causer. Il avait la parole facile et banale, ducharme dans la voix,
beaucoup de grce dans le regard et une sduction irrsistible dans la moustache.
Elle sbouriffait sur sa lvre, crpue, frise, jolie, dun blond teint de roux avec
une nuance plus ple dans les poils hrisss des bouts.
Ils parlrent de Paris, des environs, des bords de la Seine, des villes deaux, des
plaisirs de lt, de toutes les choses courantes sur lesquelles on peut discourir
indniment sans se fatiguer lesprit.
Puis, comme M. Norbert de Varenne sapprochait, un verre de liqueur la main,
Duroy sloigna par discrtion.
Mme de Marelle, qui venait de causer avec Forestier, lappela :
"Eh bien, monsieur, dit-elle brusquement, vous voulez donc tter du journa-
lisme ?"
Alors il parla de ses projets, en termes vagues, puis recommena avec elle la
conversationquil venait davoir avec Mme Walter ; mais, comme il possdait mieux
son sujet, il sy montra suprieur, rptant comme de lui des choses quil venait
dentendre. Et sans cesse il regardait dans les yeux sa voisine, comme pour donner
ce quil disait un sens profond.
Elle lui raconta son tour des anecdotes, avec un entrain facile de femme qui
se sait spirituelle et qui veut toujours tre drle ; et, devenant familire, elle po-
sait la main sur son bras, baissait la voix pour dire des riens, qui prenaient ainsi
un caractre dintimit. Il sexaltait intrieurement frler cette jeune femme qui
soccupait de lui. Il aurait voulu tout de suite se dvouer pour elle, la dfendre,
montrer ce quil valait, et les retards quil mettait lui rpondre indiquaient la
proccupation de sa pense.
Mais tout coup, sans raison, Mme de Marelle appelait : "Laurine !" et la petite
lle sen vint.
"Assieds-toi l, mon enfant, tu aurais froid prs de la fentre."
31
Et Duroy fut pris dune envie folle dembrasser la llette, comme si quelque
chose de ce baiser et d retourner la mre.
Il demanda dun ton galant et paternel :
"Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mademoiselle ?"
Lenfant leva les yeux sur lui dun air surpris. Mme de Marelle dit en riant :
"Rponds : "Je veux bien, monsieur, pour aujourdhui ; mais ce ne sera pas tou-
jours comme a."
Duroy, sasseyant aussitt, prit sur son genou Laurine, puis efeura des lvres
les cheveux onds et ns de lenfant,
La mre stonna :
"Tiens, elle ne sest pas sauve ; cest stupant. Elle ne se laisse dordinaire em-
brasser que par les femmes. Vous tes irrsistible, monsieur Duroy."
II rougit, sans rpondre, et dun mouvement lger il balanait la petite lle sur
sa jambe.
Mme Forestier sapprocha, et, poussant un cri dtonnement :
"Tiens, voil Laurine apprivoise, quel miracle !"
Jacques Rival aussi sen venait, un cigare la bouche, et Duroy se leva pour par-
tir, ayant peur de gter par quelque mot maladroit la besogne faite, son uvre de
conqute commence.
Il salua, prit et serra doucement la petite main tendue des femmes, puis secoua
avec force la main des hommes. Il remarqua que celle de Jacques Rival tait sche
et chaude et rpondait cordialement sa pression; celle de Norbert de Varenne,
humide et froide et fuyait en glissant entre les doigts ; celle du pre Walter, froide
et molle, sans nergie, sans expression; celle de Forestier, grasse et tide. Son ami
lui dit mi-voix :
32
"Demain, trois heures, noublie pas.
- Oh! non, ne crains rien."
Quand il se retrouva sur lescalier, il eut envie de descendre en courant, tant sa
joie tait vhmente, et il slana, enjambant les marches deux par deux ; mais
tout coup, il aperut, dans la grande glace du second tage, un monsieur press
qui venait en gambadant sa rencontre, et il sarrta net, honteux comme sil ve-
nait dtre surpris en faute.
Puis il se regarda longuement, merveill dtre vraiment aussi joli garon; puis
il se sourit avec complaisance ; puis, prenant cong de son image, il se salua trs
bas, avec crmonie, comme on salue les grands personnages.
33
Chapitre 3
Quand Georges Duroy se retrouva dans la rue, il hsita sur ce quil ferait. Il avait
envie de courir, de rver, daller devant lui en songeant lavenir et en respirant
lair doux de la nuit ; mais la pense de la srie darticles demands par le pre
Walter le poursuivait, et il se dcida rentrer tout de suite pour se mettre autravail.
Il revint grands pas, gagna le boulevard extrieur, et le suivit jusqu la rue
Boursault quil habitait. Sa maison, haute de six tages, tait peuple par vingt
petits mnages ouvriers et bourgeois, et il prouva en montant lescalier, dont il
clairait avec des allumettes-bougies les marches sales o tranaient des bouts de
papiers, des bouts de cigarettes, des pluchures de cuisine, une curante sensa-
tion de dgot et une hte de sortir de l, de loger comme les hommes riches, en
des demeures propres, avec des tapis. Une odeur lourde de nourriture, de fosse
daisances et dhumanit, une odeur stagnante de crasse et de vieille muraille,
quaucun courant dair net pu chasser de ce logis, lemplissait du haut en bas.
La chambre du jeune homme, au cinquime tage, donnait, comme sur un
abme profond, sur limmense tranche du chemin de fer de lOuest, juste au-
dessus de la sortie du tunnel, prs de la gare des Batignolles. Duroy ouvrit sa fe-
ntre et saccouda sur lappui de fer rouill.
Au-dessous de lui, dans le fond du trou sombre, trois signaux rouges immobiles
avaient lair de gros yeux de bte ; et plus loin on en voyait dautres, et encore
dautres, encore plus loin. A tout instant des coups de sifet prolongs ou courts
passaient dans la nuit, les uns proches, les autres peine perceptibles, venus de l-
bas, du ct dAsnires. Ils avaient des modulations comme des appels de voix. Un
deux se rapprochait, poussant toujours son cri plaintif qui grandissait de seconde
en seconde, et bientt une grosse lumire jaune apparut, courant avec un grand
bruit ; et Duroy regarda le long chapelet des wagons sengouffrer sous le tunnel.
Puis il se dit : " Allons, au travail !" Il posa sa lumire sur sa table ; mais au mo-
ment de se mettre crire, il saperut quil navait chez lui quun cahier de papier
34
lettres.
Tant pis, il lutiliserait en ouvrant la feuille dans toute sa grandeur. Il trempa sa
plume dans lencre et crivit en tte, de sa plus belle criture :
Souvenirs dun chasseur dAfrique.
Puis il chercha le commencement de la premire phrase.
Il restait le front dans sa main, les yeux xs sur le carr blanc dploy devant
lui.
Quallait-il dire ? Il ne trouvait plus rien maintenant de ce quil avait racont
tout lheure, pas une anecdote, pas un fait, rien. Tout coup il pensa : "Il faut
que je dbute par mon dpart. " Et il crivit : "Ctait en 1874, aux environs du
15 mai, alors que la France puise se reposait aprs les catastrophes de lanne
terrible..."
Et il sarrta net, ne sachant comment amener ce qui suivrait, son embarque-
ment, son voyage, ses premires motions.
Aprs dix minutes de rexions il se dcida remettre au lendemain la page
prparatoire du dbut, et faire tout de suite une description dAlger.
Et il traa sur son papier : "Alger est une ville toute blanche... " sans parvenir
noncer autre chose. Il revoyait en souvenir la jolie cit claire, dgringolant,
comme une cascade de maisons plates, du haut de sa montagne dans la mer, mais
il ne trouvait plus un mot pour exprimer ce quil avait vu, ce quil avait senti.
Aprs un grand effort, il ajouta : "Elle est habite en partie par des Arabes..."
Puis il jeta sa plume sur la table et se leva.
Sur son petit lit de fer, o la place de son corps avait fait un creux, il aperut
ses habits de tous les jours jets l, vides, fatigus, asques, vilains comme des
hardes de la Morgue. Et, sur une chaise de paille, son chapeau de soie, son unique
chapeau, semblait ouvert pour recevoir laumne.
35
Ses murs, tendus dun papier gris bouquets bleus, avaient autant de taches
que de eurs, des taches anciennes, suspectes, dont on naurait pu dire la nature,
btes crases ou gouttes dhuile, bouts de doigts graisss de pommade ou cume
de la cuvette projete pendant les lavages. Cela sentait la misre honteuse, la mi-
sre en garni de Paris. Et une exaspration le souleva contre la pauvret de sa vie.
Il se dit quil fallait sortir de l, tout de suite, quil fallait en nir ds le lendemain
avec cette existence besogneuse.
Une ardeur de travail layant soudain ressaisi, il se rassit devant sa table, et re-
commena chercher des phrases pour bien raconter la physionomie trange
et charmante dAlger, cette antichambre de lAfrique mystrieuse et profonde,
lAfrique des Arabes vagabonds et des ngres inconnus, lAfrique inexplore et
tentante, dont on nous montre parfois, dans les jardins publics, les btes invrai-
semblables qui semblent cres pour des contes de fes, les autruches, ces poules
extravagantes, les gazelles, ces chvres divines, les girafes surprenantes et gro-
tesques, les chameaux graves, les hippopotames monstrueux, les rhinocros in-
formes, et les gorilles, ces frres effrayants de lhomme.
Il sentait vaguement des penses lui venir ; il les aurait dites, peut-tre, mais
il ne les pouvait point formuler avec des mots crits. Et son impuissance len-
vrant, il se leva de nouveau, les mains humides de sueur et le sang battant aux
tempes.
Et ses yeux tant tombs sur la note de sa blanchisseuse, monte, le soir mme,
par le concierge, il fut saisi brusquement par un dsespoir perdu. Toute sa joie
disparut en une seconde avec sa conance en lui et sa foi dans lavenir. Ctait
ni ; tout tait ni, il ne ferait rien; il ne serait rien; il se sentait vide, incapable,
inutile, condamn.
Et il retourna saccouder la fentre, juste au moment o un train sortait du
tunnel avec un bruit subit et violent. Il sen allait l-bas, travers les champs et les
plaines, vers la mer. Et le souvenir de ses parents entra au cur de Duroy.
Il allait passer prs deux, ce convoi, quelques lieues seulement de leur mai-
son. Il la revit, la petite maison, au haut de la cte, dominant Rouen et limmense
valle de la Seine, lentre du village de Canteleu.
Son pre et sa mre tenaient un petit cabaret, une guinguette o les bourgeois
des faubourgs venaient djeuner le dimanche : A la Belle-Vue. Ils avaient voulu
36
faire de leur ls un monsieur et lavaient mis au collge. Ses tudes nies et son
baccalaurat manqu, il tait parti pour le service avec lintention de devenir of-
cier, colonel, gnral. Mais dgot de ltat militaire bien avant davoir ni ses
cinq annes, il avait rv de faire fortune Paris.
Il y tait venu, son temps expir, malgr les prires du pre et de la mre, qui,
leur songe envol, voulaient le garder maintenant. A son tour, il esprait un ave-
nir ; il entrevoyait le triomphe au moyen dvnements encore confus dans son
esprit, quil saurait assurment faire natre et seconder.
Il avait eu au rgiment des succs de garnison, des bonnes fortunes faciles et
mme des aventures dans un monde plus lev, ayant sduit la lle dun percep-
teur, qui voulait tout quitter pour le suivre, et la femme dun avou, qui avait tent
de se noyer par dsespoir dtre dlaisse.
Ses camarades disaient de lui : "Cest un malin, cest un roublard, cest un d-
brouillard qui saura se tirer daffaire." Et il stait promis en effet dtre un malin,
un roublard et un dbrouillard.
Sa conscience native de Normand, frotte par la pratique quotidienne de lexis-
tence de garnison, distendue par les exemples de maraudages en Afrique, de b-
nefs illicites, de supercheries suspectes, fouette aussi par les ides dhonneur qui
ont cours dans larme, par les bravades militaires, les sentiments patriotiques, les
histoires magnanimes racontes entre sous-offs et par la gloriole du mtier, tait
devenue une sorte de bote triple fond o lon trouvait de tout.
Mais le dsir darriver y rgnait en matre.
Il stait remis, sans sen apercevoir, rvasser, comme il faisait chaque soir.
Il imaginait une aventure damour magnique qui lamenait, dun seul coup,
la ralisation de son esprance. Il pousait la lle dun banquier ou dun grand
seigneur rencontre dans la rue et conquise premire vue,
Le sifet strident dune locomotive qui, sortie toute seule du tunnel, comme un
gros lapin de son terrier, et courant toute vapeur sur les rails, lait vers le garage
des machines, o elle allait se reposer, le rveilla de son songe.
37
Alors, ressaisi par lespoir confus et joyeux qui hantait toujours sonesprit, il jeta,
tout hasard, un baiser dans la nuit, un baiser damour vers limage de la femme
attendue, un baiser de dsir vers la fortune convoite. puis il ferma sa fentre et
commena se dvtir en murmurant :
"Bah, je serai mieux dispos demain matin. Je nai pas lesprit libre ce soir. Et
puis, jai peut-tre aussi unpeutropbu. Onne travaille pas biendans ces conditions-
l."
Il se mit au lit, soufa la lumire, et sendormit presque aussitt.
Il se rveilla de bonne heure, comme on sveille aux jours desprance vive ou
de souci, et, sautant du lit, il alla ouvrir sa fentre pour avaler une bonne tasse
dair frais, comme il disait.
Les maisons de la rue de Rome, en face, de lautre ct du large foss du che-
min de fer, clatantes dans la lumire du soleil levant, semblaient peintes avec de
la clart blanche. Sur la droite, au loin, on apercevait les coteaux dArgenteuil, les
hauteurs de Sannois et les moulins dOrgemont dans une brume bleutre et l-
gre, semblable un petit voile ottant et transparent qui aurait t jet sur lho-
rizon.
Duroy demeura quelques minutes regarder la campagne lointaine, et il mur-
mura : "Il ferait bougrement bon, l-bas, un jour comme a. " Puis il songea quil
lui fallait travailler, et tout de suite, et aussi envoyer, moyennant dix sous, le ls de
sa concierge dire son bureau quil tait malade.
Il sassit devant sa table, trempa sa plume dans lencrier, prit son front dans sa
main et chercha des ides. Ce fut en vain. Rien ne venait.
Il ne se dcouragea pas cependant. Il pensa : "Bah, je nen ai pas lhabitude.
Cest un mtier apprendre comme tous les mtiers. Il faut quon maide les pre-
mires fois. Je vais trouver Forestier, qui me mettra mon article sur pied en dix
minutes."
Et il shabilla. Quand il fut dans la rue, il jugea quil tait encore trop tt pour se
prsenter chez son ami qui devait dormir tard. Il se promena donc, tout douce-
ment, sous les arbres du boulevard extrieur.
38
Il ntait pas encore neuf heures, et il gagna le parc Monceau tout frais de lhu-
midit des arrosages.
Stant assis sur un banc, il se remit rver. Un jeune homme allait et venait
devant lui, trs lgant, attendant une femme sans doute.
Elle parut, voile, le pied rapide, et, ayant pris son bras, aprs une courte poi-
gne de main, ils sloignrent.
Un tumultueux besoin damour entra au cur de Duroy, un besoin damours
distingues, parfumes, dlicates. Il se leva et se remit en route en songeant Fo-
restier. Avait-il de la chance, celui-l !
Il arriva devant sa porte au moment o son ami sortait.
"Te voil ! cette heure-ci ! que me voulais-tu?"
Duroy, troubl de le rencontrer ainsi comme il sen allait, balbutia :
"Cest que... cest que... je ne peux pas arriver faire mon article, tu sais, larticle
que M. Walter ma demand sur lAlgrie. a nest pas bien tonnant, tant donn
que je nai jamais crit. Il faut de la pratique pour a comme pour tout. Je my ferai
bien vite, jen suis sr, mais, pour dbuter, je ne sais pas comment my prendre.
Jai bien les ides, je les ai toutes, et je ne parviens pas les exprimer,"
Il sarrta, hsitant un peu. Forestier souriait avec malice :
"Je connais a."
Duroy reprit :
"Oui, a doit arriver tout le monde en commenant. Eh bien, je venais... je
venais te demander un coup de main... En dix minutes tu me mettrais a sur pied,
toi, tu me montrerais la tournure quil faut prendre. Tu me donnerais l une bonne
leon de style, et sans toi, je ne men tirerais pas."
Lautre souriait toujours dun air gai. Il tapa sur le bras de son ancien camarade
et lui dit :
39
"Va-tentrouver ma femme, elle tarrangera tonaffaire aussi bienque moi. Je lai
dresse cette besogne-l. Moi, je nai pas le temps ce matin, sans quoi je laurais
fait bien volontiers."
Duroy, intimid soudain, hsitait, nosait point :
"Mais cette heure-ci, je ne peux pas me prsenter devant elle ?...
Si, parfaitement. Elle est leve. Tu la trouveras dans mon cabinet de travail, en
train de mettre en ordre des notes pour moi."
Lautre refusait de monter.
"Non... a nest pas possible..."
Forestier le prit par les paules, le t pivoter sur ses talons, et le poussant vers
lescalier :
"Mais, va donc, grand serin, quand je te dis dy aller. Tu ne va pas me forcer
regrimper mes trois tages pour te prsenter et expliquer ton cas."
Alors Duroy se dcida :
"Merci, jy vais. Je lui dirai que tu mas forc, absolument forc venir la trouver.
- Oui. Elle ne te mangera pas, sois tranquille. Surtout, noublie pas tantt trois
heures.
- Oh! ne crains rien."
Et Forestier sen alla de son air press, tandis que Duroy se mit monter lente-
ment, marche marche, cherchant ce quil allait dire et inquiet de laccueil quil
recevrait.
Le domestique vint lui ouvrir. Il avait un tablier bleu et tenait un balai dans ses
mains.
"Monsieur est sorti", dit-il, sans attendre la question.
40
Duroy insista :
"Demandez Mme Forestier si elle peut me recevoir, et prvenez-la que je viens
de la part de son mari, que jai rencontr dans la rue."
Puis il attendit. Lhomme revint, ouvrit une porte droite, et annona :
"Madame attend monsieur."
Elle tait assise sur un fauteuil de bureau, dans une petite pice dont les murs
se trouvaient entirement cachs par des livres bien rangs sur des planches de
bois noir. Les reliures de tons diffrents, rouges, jaunes, vertes, violettes, et bleues,
mettaient de la couleur et de la gaiet dans cet alignement monotone de volumes.
Elle se retourna, souriant toujours, enveloppe dun peignoir blanc garni de
dentelle ; et elle tendit sa main, montrant son bras nu dans la manche largement
ouverte.
"Dj ?" dit-elle ; puis elle reprit : "Ce nest point un reproche, cest une simple
question."
Il balbutia :
"Oh! madame, je ne voulais pas monter ; mais votre mari, que jai rencontr en
bas, my a forc. Je suis tellement confus que je nose pas dire ce qui mamne."
Elle montrait un sige :
"Asseyez-vous et parlez."
Elle maniait entre deux doigts une plume doie en la tournant agilement ; et,
devant elle, une grande page de papier demeurait crite moiti, interrompue
larrive du jeune homme.
Elle avait lair chez elle devant cette table de travail, laise comme dans son
salon, occupe sa besogne ordinaire. Un parfum lger senvolait du peignoir,
le parfum frais de la toilette rcente. Et Duroy cherchait deviner, croyait voir le
corps jeune et clair, gras et chaud, doucement envelopp dans ltoffe moelleuse.
41
Elle reprit, comme il ne parlait pas :
"Eh bien, dites, quest-ce que cest ?"
Il murmura, en hsitant :
"Voil... mais vraiment... je nose pas... Cest que jai travaill hier soir trs tard...
et ce matin... trs tt... pour faire cet article sur lAlgrie que M. Walter ma de-
mand... et je narrive rien de bon... jai dchir tous mes essais... Je nai pas lha-
bitude de ce travail-l, moi ; et je venais demander Forestier de maider... pour
une fois..."
Elle linterrompit, en riant de tout son cur, heureuse, joyeuse et atte :
"Et il vous a dit de venir me trouver ?... Cest gentil a...
- Oui, madame. Il ma dit que vous me tireriez dembarras mieux que lui... Mais,
moi, je nosais pas, je, ne voulais pas. Vous comprenez ?"
Elle se leva :
"a va tre charmant de collaborer comme a. Je suis ravie de votre ide. Tenez,
asseyez-vous ma place, car on connat mon criture au journal. Et nous allons
vous tourner un article, mais l, un article succs."
Il sassit, prit une plume, tala devant lui une feuille de papier et attendit.
Mme Forestier, reste debout, le regardait faire ses prparatifs ; puis elle attei-
gnit une cigarette sur la chemine et lalluma :
"Je ne puis pas travailler sans fumer, dit-elle. Voyons, quallez-vous raconter ?"
Il leva la tte vers elle avec tonnement.
"Mais je ne sais pas, moi, puisque je suis venu vous trouver pour a. "
Elle reprit :
42
"Oui, je vous arrangerai la chose. Je ferai la sauce, mais il me faut le plat. "
Il demeurait embarrass ; enn il pronona avec hsitation :
"Je voudrais raconter mon voyage depuis le commencement..."
Alors elle sassit, en face de lui, de lautre ct de la grande table, et le regardant
dans les yeux :
"Eh bien, racontez-le-moi dabord, pour moi toute seule, vous entendez, bien
doucement, sans rien oublier, et je choisirai ce quil faut prendre."
Mais comme il ne savait par o commencer, elle se mit linterroger comme
aurait fait un prtre au confessionnal, posant des questions prcises qui lui rap-
pelaient des dtails oublis, des personnages rencontrs, des gures seulement
aperues.
Quand elle leut contraint parler ainsi pendant un petit quart dheure, elle
linterrompit tout coup :
"Maintenant, nous allons commencer. Dabord, nous supposons que vous adres-
sez un ami vos impressions, ce qui vous permet de dire un tas de btises, de faire
des remarques de toute espce, dtre naturel et drle, si nous pouvons. Commen-
cez :
"Mon cher Henry, tu veux savoir ce que cest que lAlgrie, tu le sauras. Je vais
tenvoyer, nayant rien faire dans la petite case de boue sche qui me sert dha-
bitation, une sorte de journal de ma vie, jour par jour, heure par heure. Ce sera
un peu vif quelquefois, tant pis, tu nes pas oblig de le montrer aux dames de ta
connaissance..."
Elle sinterrompit pour rallumer sa cigarette teinte, et, aussitt, le petit grince-
ment criard de la plume doie sur le papier sarrta.
"Nous continuons, dit-elle.
"LAlgrie est un grand pays franais sur la frontire des grands pays inconnus
quon appelle le dsert, le Sahara, lAfrique centrale, etc., etc.
43
"Alger est la porte, la porte blanche et charmante de cet trange continent.
"Mais dabord il faut y aller, ce qui nest pas rose pour tout le monde. Je suis, tu
le sais, un excellent cuyer, puisque je dresse les chevaux du colonel, mais on peut
tre bon cavalier et mauvais marin. Cest mon cas.
"Te rappelles-tule major Simbretas, que nous appelions le docteur Ipca ? Quand
nous nous jugions mrs pour vingt-quatre heures dinrmerie, pays bni, nous
passions la visite.
"Il tait assis sur sa chaise, avec ses grosses cuisses ouvertes dans son pantalon
rouge, les mains sur ses genoux, les bras formant pont, le coude enlair, et il roulait
ses gros yeux de loto en mordillant sa moustache blanche.
"Tu te rappelles sa prescription :
"Ce soldat est atteint dun drangement destomac. Administrez-lui le vomitif
n 3 selon ma formule, puis douze heures de repos ; il ira bien."
"Il tait souverain, ce vomitif, souverain et irrsistible. On lavalait donc, puis-
quil le fallait. Puis, quand onavait pass par la formule dudocteur Ipca, onjouis-
sait de douze heures de repos bien gagn.
"Eh bien, mon cher, pour atteindre lAfrique, il faut subir, pendant quarante
heures, une autre sorte de vomitif irrsistible, selon la formule de la Compagnie
Transatlantique."
Elle se frottait les mains, tout fait heureuse de son ide.
Elle se leva et se mit marcher, aprs avoir allum une autre cigarette, et elle
dictait, en soufant des lets de fume qui sortaient dabord tout droit dun pe-
tit trou rond au milieu de ses lvres serres, puis slargissant, svaporaient en
laissant par places, dans lair, des lignes grises, une sorte de brume transparente,
une bue pareille des ls daraigne. Parfois, dun coup de sa main ouverte, elle
effaait ces traces lgres et plus persistantes ; parfois aussi elle les coupait dun
mouvement tranchant de lindex et regardait ensuite, avec une attention grave, les
deux tronons dimperceptible vapeur disparatre lentement.
44
Et Duroy, les yeux levs, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les
mouvements de son corps et de son visage occups ce jeu vague qui ne prenait
point sa pense.
Elle imaginait maintenant les pripties de la route, portraiturait des compa-
gnons de voyage invents par elle, et bauchait une aventure damour avec la
femme dun capitaine dinfanterie qui allait rejoindre son mari.
Puis, stant assise, elle interrogea Duroy sur la topographie de lAlgrie, quelle
ignorait absolument. En dix minutes, elle en sut autant que lui, et elle t un petit
chapitre de gographie politique et coloniale pour mettre le lecteur au courant et
le bien prparer comprendre les questions srieuses qui seraient souleves dans
les articles suivants.
Puis elle continua par une excursion dans la province dOran, une excursion
fantaisiste, o il tait surtout question des femmes, des Mauresques, des Juives,
des Espagnoles.
"Il ny a que a qui intresse", disait-elle.
Elle termina par un sjour Sada, au pied des hauts plateaux, et par une jo-
lie petite intrigue entre le sous-ofcier Georges Duroy et une ouvrire espagnole
employe la manufacture dalfa de An-el-Hadjar. Elle racontait les rendez-vous,
la nuit, dans la montagne pierreuse et nue, alors que les chacals, les hynes et les
chiens arabes crient, aboient et hurlent au milieu des rocs.
Et elle pronona dune voix joyeuse : "La suite demain!" Puis, se relevant :
"Cest comme a quoncrit unarticle, moncher monsieur. Signez, sil vous plat."
Il hsitait.
"Mais signez donc !"
Alors, il se mit rire, et crivit au bas de la page :
"GEORGES DUROY."
45
Elle continuait fumer en marchant ; et il la regardait toujours, ne trouvant rien
dire pour la remercier, heureux dtre prs delle, pntr de reconnaissance et
du bonheur sensuel de cette intimit naissante. Il lui semblait que tout ce qui len-
tourait faisait partie delle, tout, jusquaux murs couverts de livres. Les siges, les
meubles, lair o ottait lodeur du tabac avaient quelque chose de particulier, de
bon, de doux, de charmant, qui venait delle.
Brusquement elle demanda :
"Quest-ce que vous pensez de mon amie Mme de Marelle ?"
Il fut surpris :
"Mais... je la trouve... je la trouve trs sduisante.
- Nest-ce pas ?
- Oui, certainement."
Il avait envie dajouter : "Mais pas autant que vous." Il nosa point.
Elle reprit :
"Et si vous saviez comme elle est drle, originale, intelligente ! Cest une bo-
hme, par exemple, une vraie bohme. Cest pour cela que son mari ne laime
gure. Il ne voit que le dfaut et napprcie point les qualits."
Duroy fut stupfait dapprendre que Mme de Marelle tait marie. Ctait bien
naturel, pourtant.
Il demanda .
"Tiens... elle est marie ? Et quest-ce que fait son mari ?"
Mme Forestier haussa tout doucement les paules et les sourcils, dunseul mou-
vement plein de signications incomprhensibles.
46
"Oh! il est inspecteur de la ligne du Nord. Il passe huit jours par mois Paris.
Ce que sa femme appelle " le service obligatoire", ou encore " la corve de se-
maine", ou encore " la semaine sainte ". Quand vous la connatrez mieux, vous
verrez comme elle est ne et gentille. Allez donc la voir un de ces jours."
Duroy ne pensait plus partir ; il lui semblait quil allait rester toujours, quil
tait chez lui.
Mais la porte souvrit sans bruit, et un grand monsieur savana, quon navait
point annonc.
Il sarrta en voyant un homme. Mme Forestier parut gne une seconde, puis
elle dit, de sa voix naturelle, bien quun peu de rose lui ft mont des paules au
visage :
"Mais entrez donc, mon cher. Je vous prsente un bon camarade de Charles, M.
Georges Duroy, un futur journaliste."
Puis, sur un ton diffrent, elle annona :
"Le meilleur et le plus intime de nos amis, le comte de Vaudrec."
Les deux hommes se salurent en se regardant au fond des yeux, et Duroy tout
aussitt se retira.
On ne le retint pas. Il balbutia quelques remerciements, serra la main tendue
de la jeune femme, sinclina encore devant le nouveau venu, qui gardait un vi-
sage froid et srieux dhomme du monde, et il sortit tout fait troubl, comme sil
venait de commettre une sottise.
En se retrouvant dans la rue, il se sentit triste, mal laise, obsd par lobscure
sensation dun chagrin voil. Il allait devant lui, se demandant pourquoi cette m-
lancolie subite lui tait venue ; il ne trouvait point, mais la gure svre du comte
de Vaudrec, un peu vieux dj, avec des cheveux gris, lair tranquille et insolent
dun particulier trs riche et sr de lui, revenait sans cesse dans son souvenir.
47
Et il saperut que larrive de cet inconnu, brisant un tte--tte charmant o
soncur saccoutumait dj, avait fait passer enlui cette impressionde froid et de
dsesprance quune parole entendue, une misre entrevue, les moindres choses
parfois sufsent nous donner.
Et il lui semblait aussi que cet homme, sans quil devint pourquoi, avait t
mcontent de le trouver l.
Il navait plus rien faire jusqu trois heures ; et il ntait pas encore midi. Il
lui restait en poche six francs cinquante : il alla djeuner au bouillon Duval. Puis
il rda sur le boulevard; et comme trois heures sonnaient, il monta lescalier-
rclame de La Vie Franaise.
Les garons de bureau, assis sur une banquette, les bras croiss, attendaient,
tandis que, derrire une sorte de petite chaire de professeur, un huissier classait
la correspondance qui venait darriver. La mise en scne tait parfaite, pour en
imposer aux visiteurs. Tout le monde avait de la tenue, de lallure, de la dignit, du
chic, comme il convenait dans lantichambre dun grand journal.
Duroy demanda :
"M. Walter, sil vous plat ?"
Lhuissier rpondit :
"M. le directeur est en confrence. Si monsieur veut bien sasseoir un peu."
Et il indiqua le salon dattente, dj plein de monde.
On voyait l des hommes graves, dcors, importants, et des hommes ngligs,
au linge invisible, dont la redingote, ferme jusquau col, portait sur la poitrine
des dessins de taches rappelant les dcoupures des continents et des mers sur les
cartes de gographie. Trois femmes taient mles ces gens. Une delles tait
jolie, souriante, pare, et avait lair dune cocotte ; sa voisine, au masque tragique,
ride, pare aussi dune faon svre, portait ce quelque chose de frip, darticiel
quont, en gnral, les anciennes actrices, une sorte de fausse jeunesse vente,
comme un parfum damour ranci.
48
La troisime femme, en deuil, se tenait dans un coin, avec une allure de veuve
dsole. Duroy pensa quelle venait demander laumne.
Cependant onne faisait entrer personne, et plus de vingt minutes staient cou-
les.
Alors Duroy eut une ide, et, retournant trouver lhuissier :
"M. Walter ma donn rendez-vous trois heures, dit-il. En tout cas, voyez si
mon ami M. Forestier nest pas ici."
Alors on le t passer par un long corridor qui lamena dans une grande salle o
quatre messieurs crivaient autour dune large table verte.
Forestier, debout devant la chemine, fumait une cigarette en jouant au bilbo-
quet. Il tait trs adroit ce jeu et piquait tous coups la bille norme en buis
jaune sur la petite pointe de bois. Il comptait : "Vingt-deux, - vingt-trois, - vingt-
quatre, - vingt-cinq."
Duroy pronona : "Vingt-six." Et son ami leva les yeux, sans arrter le mouve-
ment rgulier de son bras.
"Tiens, te voil ! - Hier, jai fait cinquante-sept coups de suite. Il ny a que Saint-
Potinqui soit plus fort que moi ici. As-tuvule patron? Il ny a riende plus drle que
de regarder cette vieille bedole de Norbert jouer au bilboquet. Il ouvre la bouche
comme pour avaler la boule."
Un des rdacteurs tourna la tte vers lui :
"Dis donc, Forestier, jen connais un vendre, un superbe, en bois des Iles. Il a
appartenu la reine dEspagne, ce quon dit. On en rclame soixante francs. a
nest pas cher."
Forestier demanda : "Ologe-t-il ?" Et comme il avait manqu sontrente-septime
coup, il ouvrit une armoire o Duroy aperut une vingtaine de bilboquets su-
perbes, rangs et numrots comme des bibelots dans une collection. Puis ayant
pos son instrument sa place ordinaire, il rpta :
"O loge-t-il, ce joyau?"
49
Le journaliste rpondit :
"Chez un marchand de billets du Vaudeville. Je tapporterai la chose demain, si
tu veux.
- Oui, cest entendu. Sil est vraiment beau, je le prends, on na jamais trop de
bilboquets."
Puis se tournant vers Duroy :
"Viens avec moi, je vais tintroduire chez le patron, sans quoi tu pourrais moisir
jusqu sept heures du soir."
Ils retraversrent le salon dattente, o les mmes personnes demeuraient dans
le mme ordre. Ds que Forestier parut, la jeune femme et la vieille actrice, se
levant vivement, vinrent lui.
Il les emmena, lune aprs lautre, dans lembrasure de la fentre, et, bien quils
prissent soin de causer voix basse, Duroy remarqua quil les tutoyait lune et
lautre.
Puis, ayant pouss deux portes capitonnes, ils pntrrent chez le directeur.
La confrence, qui durait depuis une heure, tait une partie dcart avec quelques-
uns de ces messieurs chapeaux plats que Duroy avait remarqus la veille.
M. Walter tenait les cartes et jouait avec une attention concentre et des mou-
vements cauteleux, tandis que son adversaire abattait, relevait, maniait les lgers
cartons coloris avec une souplesse, une adresse et une grce de joueur exerc.
Norbert de Varenne crivait un article, assis dans le fauteuil directorial, et Jacques
Rival, tendu tout au long sur un divan, fumait un cigare, les yeux ferms.
On sentait l-dedans le renferm, le cuir des meubles, le vieux tabac et limpri-
merie ; on sentait cette odeur particulire des salles de rdaction que connaissent
tous les journalistes.
Sur la table en bois noir aux incrustations de cuivre, un incroyable amas de pa-
pier gisait : lettres, cartes, journaux, revues, notes de fournisseurs, imprims de
toute espce.
50
Forestier serra les mains des parieurs debout derrire les joueurs, et sans dire
un mot regarda la partie ; puis, ds que le pre Walter eut gagn, il prsenta :
"Voici mon ami Duroy."
Le directeur considra brusquement le jeune homme de son coup doeil gliss
par-dessus le verre des lunettes, puis il demanda :
"Mapportez-vous mon article ? a irait trs bien aujourdhui, en mme temps
que la discussion Morel."
Duroy tira de sa poche les feuilles de papier plies en quatre :
"Voici, monsieur."
Le patron parut ravi, et, souriant :
"Trs bien, trs bien. Vous tes de parole. Il faudra me revoir a, Forestier ?"
Mais Forestier sempressa de rpondre :
"Ce nest pas la peine, monsieur Walter : jai fait la chronique avec lui pour lui
apprendre le mtier. Elle est trs bonne."
Et le directeur qui recevait prsent les cartes donnes par un grand mon-
sieur maigre, un dput du centre gauche, ajouta avec indiffrence : "Cest parfait,
alors." Forestier ne le laissa pas commencer sa nouvelle partie ; et, se baissant vers
son oreille : "Vous savez que vous mavez promis dengager Duroy pour remplacer
Marambot. Voulez-vous que je le retienne aux mmes conditions ?
- Oui, parfaitement."
Et prenant le bras de son ami, le journaliste lentrana pendant que M. Walter se
remettait jouer.
Norbert de Varenne navait pas lev la tte, il semblait navoir pas vu ou reconnu
Duroy. Jacques Rival, au contraire, lui avait serr la main avec une nergie d-
monstrative et voulue de bon camarade sur qui on peut compter en cas daffaire.
51
Ils retraversrent le salon dattente, et comme tout le monde levait les yeux,
Forestier dit la plus jeune des femmes, assez haut pour tre entendu des autres
patients : "Le directeur va vous recevoir tout lheure. Il est en confrence en ce
moment avec deux membres de la commission du budget."
Puis il passa vivement, dun air important et press, comme sil allait rdiger
aussitt une dpche de la plus extrme gravit.
Ds quils furent rentrs dans la salle de rdaction, Forestier retourna prendre
immdiatement son bilboquet, et, tout en se remettant jouer et en coupant ses
phrases pour compter les coups, il dit Duroy :
"Voil. Tu viendras ici tous les jours trois heures et je te dirai les courses et les
visites quil faudra faire, soit dans le jour, soit dans la soire, soit dans la matine.
- Un, - je vais te donner dabord une lettre dintroduction pour le chef du premier
bureau de la prfecture de police, - deux, - qui te mettra en rapport avec un de
ses employs. Et tu tarrangeras avec lui pour toutes les nouvelles importantes -
trois - du service de la prfecture, les nouvelles ofcielles et quasi ofcielles, bien
entendu. Pour tout le dtail, tu tadresseras Saint-Potin, qui est au courant, -
quatre, - tu le verras tout lheure ou demain. Il faudra surtout taccoutumer
tirer les vers du nez des gens que je tenverrai voir, - cinq, - et pntrer partout
malgr les portes fermes, - six. - Tu toucheras pour cela deux cents francs par
mois de xe, plus deux sous la ligne pour les chos intressants de ton cru, - sept,
- plus deux sous la ligne galement pour les articles quon te commandera sur des
sujets divers, - huit."
Puis il ne t plus attention qu son jeu, et il continua compter lentement, -
neuf, - dix, - onze, - douze, - treize. - Il manqua le quatorzime, et, jurant :
"Nomde Dieu de treize ! il me porte toujours la guigne, ce bougre-l. Je mourrai
un treize certainement."
Un des rdacteurs qui avait ni sa besogne prit son tour un bilboquet dans
larmoire ; ctait un tout petit homme qui avait lair dun enfant, bien quil ft g
de trente-cinq ans ; et plusieurs autres journalistes tant entrs, ils allrent lun
aprs lautre chercher le joujou qui leur appartenait. Bientt ils furent six, cte
cte, le dos au mur, qui lanaient en lair, dun mouvement pareil et rgulier, les
boules rouges, jaunes ou noires, suivant la nature du bois. Et une lutte stant ta-
blie, les deux rdacteurs qui travaillaient encore se levrent pour juger les coups.
52
Forestier gagna de onze points. Alors le petit homme lair enfantin, qui avait
perdu, sonna le garon de bureau et commanda : "Neuf bocks. " Et ils se remirent
jouer en attendant les rafrachissements.
Duroy but un verre de bire avec ses nouveaux confrres, puis il demanda son
ami :
"Que faut-il que je fasse ?" Lautre rpondit : "Je nai rien pour toi aujourdhui.
Tu peux ten aller si tu veux.
- Et... notre... notre article... est-ce ce soir quil passera ?
- Oui, mais ne ten occupe pas : je corrigerai les preuves. Fais la suite pour
demain, et viens ici trois heures, comme aujourdhui."
Et Duroy, ayant serr toutes les mains sans savoir mme le nom de leurs pos-
sesseurs, redescendit le bel escalier, le cur joyeux et lesprit allgre.
53
Chapitre 4
Georges Duroy dormit mal, tant le dsir de voir imprim son article. Ds que le
jour parut, il fut debout, et il rdait dans la rue bien avant lheure o les porteurs
de journaux vont, en courant, de kiosque en kiosque.
Alors il gagna la gare Saint-Lazare, sachant bienque La Vie Franaise y arriverait
avant de parvenir dans son quartier. Comme il tait encore trop tt, il erra sur le
trottoir.
Il vit arriver la marchande, qui ouvrit sa boutique de verre, puis il aperut un
homme portant sur sa tte un tas de grands papiers plis. Il se prcipita : ctaient
Le Figaro, le Gil-Blas, Le Gaulois, Lvnement, et deux ou trois autres feuilles du
matin; mais La Vie Franaise ny tait pas.
Une peur le saisit . "Si on avait remis au lendemain Les Souvenirs dun chasseur
dAfrique, ou si, par hasard, la chose navait pas plu, au dernier moment, au pre
Walter ?"
En redescendant vers le kiosque, il saperut quon vendait le journal, sans quil
let vu apporter. Il se prcipita, le dplia, aprs avoir jet les trois sous, et par-
courut les titres de la premire page. - Rien. - Son cur se mit battre ; il ouvrit
la feuille, et il eut une forte motion en lisant, au bas dune colonne, en grosses
lettres : "Georges Duroy." a y tait ! quelle joie !
Il se mit marcher, sans penser, le journal la main, le chapeau sur le ct, avec
une envie darrter les passants pour leur dire : "Achetez a - achetez a ! Il y a un
article, de moi." - Il aurait voulu pouvoir crier de tous ses poumons, comme font
certains hommes, le soir, sur les boulevards : "Lisez La Vie Franaise, lisez lar-
ticle de Georges Duroy : Les Souvenirs dun chasseur dAfrique." Et, tout coup,
il prouva le dsir de lire lui-mme cet article, de le lire dans un endroit public,
dans un caf, bien en vue. Et il chercha un tablissement qui ft dj frquent.
54
Il lui fallut marcher longtemps. Il sassit enn devant une espce de marchand de
vin o plusieurs consommateurs taient dj installs, et il demanda : "Un rhum",
comme il aurait demand : " Une absinthe", sans songer lheure. Puis il appela :
" Garon, donnez-moi La Vie Franaise."
Un homme tablier blanc accourut :
"Nous ne lavons pas, monsieur, nous ne recevons que Le Rappel, Le Sicle, La
Lanterne, et Le Petit Parisien."
Duroy dclara, dun ton furieux et indign : "En voil une bote ! Alors, allez me
lacheter." Le garon y courut, la rapporta. Duroy se mit lire son article ; et plu-
sieurs fois il dit, tout haut : "Trs bien, trs bien" ! pour attirer lattention des voi-
sins et leur inspirer le dsir de savoir ce quil y avait dans cette feuille. Puis il la
laissa sur la table en sen allant. Le patron sen aperut, le rappela :
"Monsieur, monsieur, vous oubliez votre journal !"
Et Duroy rpondit :
"Je vous le laisse, je lai lu. Il y a dailleurs aujourdhui, dedans, une chose trs
intressante."
Il ne dsigna pas la chose, mais il vit, en sen allant, un de ses voisins prendre La
Vie Franaise sur la table o il lavait laisse.
Il pensa : "Que vais-je faire, maintenant ?" Et il se dcida aller son bureau
toucher son mois et donner sa dmission. Il tressaillait davance de plaisir la
pense de la tte que feraient son chef et ses collgues. Lide de leffarement du
chef, surtout, le ravissait.
Il marchait lentement pour ne pas arriver avant neuf heures et demie, la caisse
nouvrant qu dix heures.
Sonbureautait une grande pice sombre, oil fallait tenir le gaz allum presque
tout le jour en hiver. Elle donnait sur une cour troite, en face dautres bureaux. Ils
taient huit employs l-dedans, plus un sous-chef dans un coin, cach derrire
un paravent.
55
Duroy alla dabord chercher ses cent dix-huit francs vingt-cinq centimes, en-
ferms dans une enveloppe jaune et dposs dans le tiroir du commis charg des
paiements, puis il pntra dun air vainqueur dans la vaste salle de travail o il
avait dj pass tant de jours.
Ds quil fut entr, le sous-chef, M. Potel, lappela :
"Ah! cest vous, monsieur Duroy ? Le chef vous a dj demand plusieurs fois.
Vous savez quil nadmet pas quonsoit malade deux jours de suite sans attestation
du mdecin."
Duroy, qui se tenait debout au milieu du bureau, prparant son effet, rpondit
dune voix forte :
"Je men che un peu, par exemple !"
Il y eut parmi les employs unmouvement de stupfaction, et la tte de M. Potel
apparut, effare, au-dessus du paravent qui lenfermait comme une bote.
Il se barricadait l-dedans, par crainte des courants dair, car il tait rhumati-
sant. Il avait seulement perc deux trous dans le papier pour surveiller son per-
sonnel.
On entendait voler les mouches. Le sous-chef, enn, demanda avec hsitation :
"Vous avez dit ?
- Jai dit que je men chais un peu. Je ne viens aujourdhui que pour donner
ma dmission. Je suis entr comme rdacteur La Vie Franaise avec cinq cents
francs par mois, plus les lignes. Jy ai mme dbut ce matin."
Il stait pourtant promis de faire durer le plaisir, mais il navait pu rsister
lenvie de tout lcher dun seul coup.
Leffet, du reste, tait complet. Personne ne bougeait.
Alors Duroy dclara :
56
"Je vais prvenir M. Perthuis, puis je viendrai vous faire mes adieux. "
Et il sortit pour aller trouver le chef, qui scria en lapercevant :
"Ah! vous voil. Vous savez que je ne veux pas..."
Lemploy lui coupa la parole :
"Ce nest pas la peine de gueuler comme a..."
M. Perthuis, un gros homme rouge comme une crte de coq, demeura suffoqu
par la surprise.
Duroy reprit :
"Jen ai assez de votre boutique. Jai dbut ce matin dans le journalisme, o on
me fait une trs belle position. Jai bien lhonneur de vous saluer."
Et il sortit. Il tait veng.
Il alla en effet serrer la main de ses anciens collgues, qui osaient peine lui
parler, par peur de se compromettre, car on avait entendu sa conversation avec le
chef, la porte tant reste ouverte.
Et il se retrouva dans la rue avec son traitement dans sa poche. Il se paya un
djeuner succulent dans un bon restaurant prix modrs quil connaissait ; puis,
ayant encore achet et laiss La Vie Franaise sur la table o il avait mang, il
pntra dans plusieurs magasins o il acheta de menus objets, rien que pour les
faire livrer chez lui et donner son nom - Georges Duroy. - Il ajoutait : "Je suis le
rdacteur de La Vie Franaise."
Puis il indiquait la rue et le numro, en ayant soin de stipuler : " Vous laisserez
chez le concierge."
Comme il avait encore du temps, il entra chez un lithographe qui fabriquait des
cartes de visite la minute, sous les yeux des passants ; et il sen t faire immdia-
tement une centaine, qui portaient, imprime sous son nom, sa nouvelle qualit.
57
Puis il se rendit au journal.
Forestier le reut de haut, comme on reoit un infrieur :
"Ah! te voil, trs bien. Jai justement plusieurs affaires pour toi. Attends-moi
dix minutes. Je vais dabord nir ma besogne."
Et il continua une lettre commence.
A lautre bout de la grande table, un petit homme trs ple, bouf, trs gras,
chauve, avec un crne tout blanc et luisant, crivait, le nez sur son papier, par
suite dune myopie excessive.
Forestier lui demanda :
"Dis donc, Saint-Potin, quelle heure vas-tu interviewer nos gens ?
- A quatre heures.
- Tu emmneras avec toi le jeune Duroy ici prsent, et tu lui dvoileras les ar-
canes du mtier.
- Cest entendu."
Puis, se tournant vers son ami, Forestier ajouta :
"As-tu apport la suite sur lAlgrie ? Le dbut de ce matin a eu beaucoup de
succs."
Duroy, interdit, balbutia :
"Non, - javais cru avoir le temps dans laprs-midi, - jai eu un tas de choses
faire, - je nai pas pu..."
Lautre leva les paules dun air mcontent :
58
"Si tu nes pas plus exact que a, tu rateras ton avenir, toi. Le pre Walter comp-
tait sur ta copie. Je vais lui dire que ce sera pour demain. Si tu crois que tu seras
pay pour ne rien faire, tu te trompes. "
Puis, aprs un silence, il ajouta :
"On doit battre le fer quand il est chaud, que diable !"
Saint-Potin se leva :
"Je suis prt", dit-il.
Alors Forestier se renversant sur sa chaise, prit une pose presque solennelle
pour donner ses instructions, et, se tournant vers Duroy :
"Voil. Nous avons Paris depuis deux jours le gnral chinois Li-Theng-Fao,
descendu au Continental, et le rajah Taposahib Ramaderao Pali, descendu lh-
tel Bristol. Vous allez leur prendre une conversation."
Puis, se tournant vers Saint-Potin :
"Noublie point les principaux points que je tai indiqus. Demande au gn-
ral et au rajah leur opinion sur les menes de lAngleterre dans lExtrme-Orient,
leurs ides sur son systme de colonisation et de domination, leurs esprances
relatives lintervention de lEurope, et de la France en particulier, dans leurs af-
faires."
Il se tut, puis il ajouta, parlant la cantonade :
"Il sera on ne peut plus intressant pour nos lecteurs de savoir en mme temps
ce quon pense en Chine et dans les Indes sur ces questions, qui passionnent si
fort lopinion publique en ce moment."
Il ajouta, pour Duroy :
"Observe comment Saint-Potin sy prendra, cest un excellent reporter, et tche
dapprendre les celles pour vider un homme en cinq minutes."
59
Puis il recommena crire avec gravit, avec lintention vidente de bien ta-
blir les distances, de bienmettre sa place sonanciencamarade et nouveauconfrre.
Ds quils eurent franchi la porte, Saint-Potin se mit rire et dit Duroy :
"En voil un faiseur ! Il nous la fait nous-mmes. On dirait vraiment quil nous
prend pour ses lecteurs." Puis ils descendirent sur le boulevard, et le reporter de-
manda :
"Buvez-vous quelque chose ?
- Oui, volontiers. Il fait trs chaud."
Ils entrrent dans un caf et se rent servir des boissons fraches. Et Saint-Potin
se mit parler. Il parla de tout le monde et dujournal avec une profusionde dtails
surprenants.
"Le patron? Un vrai juif ! Et vous savez, les juifs on ne les changera jamais.
Quelle race !" Et il cita des traits tonnants davarice, de cette avarice particulire
aux ls dIsral, des conomies de dix centimes, des marchandages de cuisinire,
des rabais honteux demands et obtenus, toute une manire dtre dusurier, de
prteur gages.
"Et avec a, pourtant, un bon zig qui ne croit rien et roule tout le monde.
Son journal, qui est ofcieux, catholique, libral, rpublicain, orlaniste, tarte
la crme et boutique treize, na t fond que pour soutenir ses oprations de
bourse et ses entreprises de toute sorte. Pour a, il est trs fort, et il gagne des
millions au moyen de socits qui nont pas quatre sous de capital..."
Il allait toujours, appelant Duroy " mon cher ami ".
"Et il a des mots la Balzac, ce grigou. Figurez-vous que, lautre jour, je me trou-
vais dans son cabinet avec cette antique bedole de Norbert, et ce Don Quichotte
de Rival, quand Montelin, notre administrateur, arrive, avec sa serviette en ma-
roquin sous le bras, cette serviette que tout Paris connat. Walter leva le nez et
demanda : "Quoi de neuf ?"
"Montelin rpondit avec navet : "Je viens de payer les seize mille francs que
nous devions au marchand de papier."
60
"Le patron t un bond, un bond tonnant.
"- Vous dites ?
"- Que je viens de payer M. Privas.
"- Mais vous tes fou!
"- Pourquoi ?
"- Pourquoi... pourquoi... pourquoi..."
"II ta ses lunettes, les essuya. Puis il sourit, dun drle de sourire qui court
autour de ses grosses joues chaque fois quil va dire quelque chose de malin ou de
fort, et avec un ton gouailleur et convaincu, il pronona : "Pourquoi ? Parce que
nous pouvions obtenir l-dessus une rduction de quatre cinq mille francs."
"Montelin, tonn, reprit : "Mais, monsieur le directeur, tous les comptes taient
rguliers, vris par moi et approuvs par vous..."
"Alors le patron, redevenu srieux, dclara : "On nest pas naf comme vous. Sa-
chez, monsieur Montelin, quil faut toujours accumuler ses dettes pour transiger."
Et Saint-Potin ajouta avec un hochement de tte de connaisseur :
"Hein? Est-il la Balzac, celui-l ?"
Duroy navait pas lu Balzac, mais il rpondit avec conviction :
"Bigre oui."
Puis le reporter parla de Mme Walter, une grande dinde, de Norbert de Varenne,
un vieux rat, de Rival, une resuce de Fervacques. Puis il en vint Forestier :
"Quant celui-l, il a de la chance davoir pous sa femme, voil tout."
Duroy demanda :
61
"Quest-ce au juste que sa femme ?"
Saint-Potin se frotta les mains :
"Oh! une roue, une ne mouche. Cest la matresse dun vieux viveur nomm
Vaudrec, le comte de Vaudrec, qui la dote et marie..."
Duroy sentit brusquement une sensation de froid, une sorte de crispation ner-
veuse, un besoin dinjurier et de gier ce bavard. Mais il linterrompit simplement
pour lui demander :
"Cest votre nom, Saint-Potin?"
Lautre rpondit avec simplicit :
"Non, je mappelle Thomas. Cest au journal quonma surnomm Saint-Potin."
Et Duroy, payant les consommations, reprit :
"Mais il me semble quil est tard et que nous avons deux nobles seigneurs
visiter."
Saint-Potin se mit rire :
"Vous tes encore naf, vous ! Alors vous croyez comme a que je vais aller de-
mander ce Chinois et cet Indien ce quils pensent de lAngleterre ? Comme si
je ne le savais pas mieux queux, ce quils doivent penser pour les lecteurs de La
Vie Franaise. Jen ai dj interview cinq cents de ces Chinois, Persans, Hindous,
Chiliens, Japonais et autres. Ils rpondent tous la mme chose, daprs moi. Je nai
qu reprendre mon article sur le dernier venu et le copier mot pour mot. Ce qui
change, par exemple, cest leur tte, leur nom, leurs titres, leur ge, leur suite. Oh!
l-dessus, il ne faut pas derreur, parce que je serais relev raide par Le Figaro ou
Le Gaulois. Mais sur ce sujet le concierge de lhtel Bristol et celui du Continental
mauront renseign en cinq minutes. Nous irons pied jusque-l en fumant un ci-
gare. Total : cent sous de voiture rclamer au journal. Voil, mon cher, comment
on sy prend quand on est pratique."
Duroy demanda :
62
"a doit rapporter bon dtre reporter dans ces conditions-l."
Le journaliste rpondit avec mystre :
"Oui, mais rien ne rapporte autant que les chos, cause des rclames dgui-
ses."
Ils staient levs et suivaient le boulevard, vers la Madeleine. Et Saint-Potin,
tout coup, dit son compagnon :
"Vous savez, si vous avez faire quelque chose, je nai pas besoin de vous, moi."
Duroy lui serra la main, et sen alla.
Lide de son article crire dans la soire le tracassait, et il se mit y songer.
Il emmagasina des ides, des rexions, des jugements, des anecdotes, tout en
marchant, et il monta jusquau bout de lavenue des Champs-lyses, o on ne
voyait que de rares promeneurs, Paris tant vide par ces jours de chaleur.
Ayant dn chez un marchand de vin auprs de larc de triomphe de ltoile, il
revint lentement pied chez lui par les boulevards extrieurs, et il sassit devant
sa table pour travailler.
Mais ds quil eut sous les yeux la grande feuille de papier blanc, tout ce quil
avait amass de matriaux senvola de son esprit, comme si sa cervelle se ft va-
pore. Il essayait de ressaisir des bribes de souvenirs et de les xer : ils lui chap-
paient mesure quil les reprenait, ou bien ils se prcipitaient ple-mle, et il ne
savait comment les prsenter, les habiller, ni par lequel commencer.
Aprs une heure defforts et cinq pages de papier noircies par des phrases de
dbut qui navaient point de suite, il se dit : "Je ne suis pas encore assez rompu au
mtier. Il faut que je prenne une nouvelle leon." Et tout de suite la perspective
dune autre matine avec Mme Forestier, lespoir de ce long tte--tte intime,
cordial si doux, le rent tressaillir de dsir. Il se coucha bien vite, ayant presque
peur prsent de se remettre la besogne et de russir tout coup.
Il ne se leva, le lendemain, quun peu tard, loignant et savourant davance le
plaisir de cette visite.
63
Il tait dix heures passes quand il sonna chez son ami.
Le domestique rpondit :
"Cest que monsieur est en train de travailler."
Duroy navait point song que le mari pouvait tre l. Il insista cependant :
"Dites-lui que cest moi, pour une affaire pressante,"
Aprs cinq minutes dattente, on le t entrer dans le cabinet o il avait pass
une si bonne matine.
A la place occupe par lui, Forestier maintenant tait assis et crivait, en robe
de chambre, les pieds dans ses pantoues, la tte couverte dune petite toque an-
glaise, tandis que sa femme, enveloppe du mme peignoir blanc, et accoude
la chemine, dictait, une cigarette la bouche.
Duroy, sarrtant sur le seuil, murmura :
"Je vous demande bien pardon; je vous drange ?"
Et son ami, ayant tourn la tte, une tte furieuse, grogna :
"Quest-ce que tu veux encore ? Dpche-toi, nous sommes presss."
Lautre interdit, balbutiait :
"Non, ce nest rien, pardon."
Mais Forestier, se fchant :
"Allons, sacrebleu! ne perds pas de temps ; tu nas pourtant pas forc ma porte
pour le plaisir de nous dire bonjour."
Alors, Duroy, fort troubl, se dcida :
64
"Non... voil... cest que... je narrive pas encore faire mon article... et tu as
t... vous avez t si... si... gentils la dernire fois que... que jesprais... que jai
os venir..."
Forestier lui coupa la parole :
"Tu te ches du monde, la n! Alors tu timagines que je vais faire ton mtier,
et que tu nauras qu passer la caisse au bout du mois, Non! elle est bonne,
celle- l !"
La jeune femme continuait fumer, sans dire un mot, souriant toujours dun
vague sourire qui semblait un masque aimable sur lironie de sa pense.
Et Duroy, rougissant, bgayait : "Excusez-moi... javais cru... javais pens..."
Puis brusquement, dune voix claire :
"Je vous demande mille fois pardon, madame, en vous adressant encore mes
remerciements les plus vifs pour la chronique si charmante que vous mavez faite
hier."
Puis il salua, dit Charles :
"Je serai trois heures au journal", et il sortit.
Il retourna chez lui, grands pas, en grommelant : "Eh bien, je men vais la faire
celle-l, et tout seul, et ils verront..."
A peine rentr, la colre lexcitant, il se mit crire.
Il continua laventure commence par Mme Forestier, accumulant des dtails
de roman feuilleton, des pripties surprenantes et des descriptions ampoules,
avec une maladresse de style de collgien et des formules de sous-ofcier. En une
heure, il eut termin une chronique qui ressemblait un chaos de folies, et il la
porta, avec assurance, La Vie Franaise.
La premire personne quil rencontra fut Saint-Potin qui, lui serrant la main
avec une nergie de complice, demanda :
65
"Vous avez lu ma conversation avec le Chinois et avec lHindou. Est-ce assez
drle ? a a amus tout Paris. Et je nai pas vu seulement le bout de leur nez."
Duroy, qui navait rien lu, prit aussitt le journal, et il parcourut de loeil un long
article intitul " Inde et Chine", pendant que le reporter lui indiquait et soulignait
les passages les plus intressants.
Forestier survint, soufant, press, lair effar :
"Ah! bon, jai besoin de vous deux."
Et il leur indiqua une srie dinformations politiques quil fallait se procurer
pour le soir mme.
Duroy lui tendit son article.
"Voici la suite sur lAlgrie,
- Trs bien, donne : je vais la remettre au patron."
Ce fut tout.
Saint-Potin entrana son nouveau confrre, et, lorsquils furent dans le corridor,
il lui dit :
"Avez-vous pass la caisse ?
- Non. Pourquoi ?
- Pourquoi ? Pour vous faire payer. Voyez-vous, il faut toujours prendre un mois
davance. On ne sait pas ce qui peut arriver.
- Mais... je ne demande pas mieux.
- Je vais vous prsenter au caissier. Il ne fera point de difcults. On paie bien
ici."
66
Et Duroy alla toucher ses deux cents francs, plus vingt-huit francs pour son ar-
ticle de la veille, qui, joints ce qui lui restait de son traitement du chemin de fer,
lui faisaient trois cent quarante francs en poche.
Jamais il navait tenupareille somme, et il se crut riche pour des temps indnis.
Puis Saint-Potin lemmena bavarder dans les bureaux de quatre ou cinq feuilles
rivales, esprant que les nouvelles quon lavait charg de recueillir avaient t
prises dj par dautres, et quil saurait bien les leur soufer, grce labondance
et lastuce de sa conversation.
Le soir venu, Duroy, qui navait plus rien faire, songea retourner aux Folies-
Bergre, et, payant daudace, il se prsenta au contrle :
"Je mappelle Georges Duroy, rdacteur La Vie Franaise. Je suis venu lautre
jour avec M. Forestier, qui mavait promis de demander mes entres. Je ne sais sil
y a song."
Onconsulta unregistre. Sonnomne sy trouvait pas inscrit. Cependant le contr-
leur, homme trs affable, lui dit :
"Entrez toujours, monsieur, et adressez vous-mme votre demande M. le di-
recteur, qui y fera droit assurment."
Il entra, et presque aussitt, il rencontra Rachel, la femme emmene le premier
soir.
Elle vint lui :
"Bonjour, mon chat. Tu vas bien?
Trs bien, et toi ?
- Moi, pas mal. Tu ne sais pas, jai rv deux fois de toi depuis lautre jour."
Duroy sourit, att :
"Ah! ah! et quest-ce que a prouve ?
67
- a prouve que tu mas plu, gros serin, et que nous recommencerons quand a
te dira.
- Aujourdhui si tu veux.
- Oui, je veux bien.
- Bon, mais coute..." Il hsitait, un peu confus de ce quil allait faire ; " Cest
que, cette fois, je nai pas le sou : je viens du cercle, o jai tout claqu."
Elle le regardait au fond des yeux, airant le mensonge avec son instinct et sa
pratique de lle habitue aux roueries et aux marchandages des hommes. Elle dit :
"Blagueur ! Tu sais, a nest pas gentil avec moi cette manire-l."
Il eut un sourire embarrass :
"Si tu veux dix francs, cest tout ce qui me reste."
Elle murmura avec un dsintressement de courtisane qui se paie un caprice :
"Ce qui te plaira, mon chri : je ne veux que toi."
Et levant ses yeux sduits vers la moustache du jeune homme, elle prit son bras
et sappuya dessus amoureusement :
"Allons boire une grenadine dabord. Et puis nous ferons un tour ensemble.
Moi, je voudrais aller lOpra, comme a, avec toi, pour te montrer. Et puis nous
rentrerons de bonne heure, nest-ce pas ?"
. . . . . . . .
Il dormit tard chez cette lle. Il faisait jour quand il sortit, et la pense lui vint
aussitt dacheter La Vie Franaise. Il ouvrit le journal dune main vreuse ; sa
chronique ny tait pas ; et il demeurait debout sur le trottoir, parcourant anxieu-
sement de loeil les colonnes imprimes avec lespoir dy trouver enn ce quil
cherchait.
68
Quelque chose de pesant tout coup accablait son cur, car, aprs la fatigue
dune nuit damour, cette contrarit tombant sur sa lassitude avait le poids dun
dsastre.
Il remonta chez lui et sendormit tout habill sur son lit.
En entrant quelques heures plus tard dans les bureaux de la rdaction, il se pr-
senta devant M. Walter :
"Jai t tout surpris ce matin, monsieur, de ne pas trouver mon second article
sur lAlgrie."
Le directeur leva la tte, et dune voix sche :
"Je lai donn votre ami Forestier, en le priant de le lire ; il ne la pas trouv
sufsant ; il faudra me le refaire."
Duroy, furieux, sortit sans rpondre un mot, et, pntrant brusquement dans le
cabinet de son camarade :
"Pourquoi nas-tu pas fait paratre, ce matin, ma chronique ?"
Le journaliste fumait une cigarette, le dos au fond de son fauteuil et les pieds
sur sa table, salissant de ses talons unarticle commenc. Il articula tranquillement
avec un son de voix ennuy et lointain, comme sil parlait du fond dun trou :
"Le patron la trouv mauvais, et ma charg de te le remettre pour le recom-
mencer. Tiens, le voil."
Et il indiquait du doigt les feuilles dplies sous un presse-papiers.
Duroy, confondu, ne trouva rien dire, et, comme il mettait sa prose dans sa
poche, Forestier reprit :
"Aujourdhui tu vas te rendre dabord la prfecture..."
Et il indiqua une srie de courses daffaires, de nouvelles recueillir. Duroy sen
alla, sans avoir pu dcouvrir le mot mordant quil cherchait.
69
Il rapporta son article le lendemain. Il lui fut rendu de nouveau. Layant refait
une troisime fois, et le voyant refus, il comprit quil allait trop vite et que la main
de Forestier pouvait seule laider dans sa route.
Il ne parla donc plus des Souvenirs dun chasseur dAfrique, en se promettant
dtre souple et rus, puisquil le fallait, et de faire, en attendant mieux, son mtier
de reporter avec zle.
Il connut les coulisses des thtres et celles de la politique, les corridors et le
vestibule des hommes dtat et de la Chambre des dputs, les gures impor-
tantes des attachs de cabinet et les mines renfrognes des huissiers endormis.
Il eut des rapports continus avec des ministres, des concierges, des gnraux,
des agents de police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassa-
deurs, des vques, des proxntes, des rastaquoures, des hommes du monde,
des grecs, des cochers de acre, des garons de caf et bien dautres, tant devenu
lami intress et indiffrent de tous ces gens, les confondant dans son estime,
les toisant la mme mesure, les jugeant avec le mme oeil, force de les voir
tous les jours, toute heure, sans transition desprit, et de parler avec eux tous
des mmes affaires concernant son mtier. Il se comparait lui-mme un homme
qui goterait coup sur coup les chantillons de tous les vins, et ne distinguerait
bientt plus le Chteau-Margaux de lArgenteuil. Il devint en peu de temps un re-
marquable reporter, sr de ses informations, rus, rapide, subtil, une vraie valeur
pour le journal, comme disait le pre Walter, qui sy connaissait en rdacteurs.
Cependant, comme il ne touchait que dix centimes la ligne, plus ses deux cents
francs de xe, et comme la vie de boulevard, la vie de caf, la vie de restaurant
cote cher, il navait jamais le sou et se dsolait de sa misre.
Cest untruc saisir, pensait-il, envoyant certains confrres aller la poche pleine
dor, sans jamais comprendre quels moyens secrets ils pouvaient bien employer
pour se procurer cette aisance. Et il souponnait avec envie des procds incon-
nus et suspects, des services rendus, toute une contrebande accepte et consentie.
Or, il lui fallait pntrer le mystre, entrer dans lassociation tacite, simposer aux
camarades qui partageaient sans lui.
Et il rvait souvent le soir, en regardant de sa fentre passer les trains, aux pro-
cds quil pourrait employer.
70
Chapitre 5
Georges Duroy dormit mal, tant le dsir de voir imprim son article. Ds que le
jour parut, il fut debout, et il rdait dans la rue bien avant lheure o les porteurs
de journaux vont, en courant, de kiosque en kiosque.
Alors il gagna la gare Saint-Lazare, sachant bienque La Vie Franaise y arriverait
avant de parvenir dans son quartier. Comme il tait encore trop tt, il erra sur le
trottoir.
Il vit arriver la marchande, qui ouvrit sa boutique de verre, puis il aperut un
homme portant sur sa tte un tas de grands papiers plis. Il se prcipita : ctaient
Le Figaro, le Gil-Blas, Le Gaulois, Lvnement, et deux ou trois autres feuilles du
matin; mais La Vie Franaise ny tait pas.
Une peur le saisit . "Si on avait remis au lendemain Les Souvenirs dun chasseur
dAfrique, ou si, par hasard, la chose navait pas plu, au dernier moment, au pre
Walter ?"
En redescendant vers le kiosque, il saperut quon vendait le journal, sans quil
let vu apporter. Il se prcipita, le dplia, aprs avoir jet les trois sous, et par-
courut les titres de la premire page. - Rien. - Son cur se mit battre ; il ouvrit
la feuille, et il eut une forte motion en lisant, au bas dune colonne, en grosses
lettres : "Georges Duroy." a y tait ! quelle joie !
Il se mit marcher, sans penser, le journal la main, le chapeau sur le ct, avec
une envie darrter les passants pour leur dire : "Achetez a - achetez a ! Il y a un
article, de moi." - Il aurait voulu pouvoir crier de tous ses poumons, comme font
certains hommes, le soir, sur les boulevards : "Lisez La Vie Franaise, lisez lar-
ticle de Georges Duroy : Les Souvenirs dun chasseur dAfrique." Et, tout coup,
il prouva le dsir de lire lui-mme cet article, de le lire dans un endroit public,
dans un caf, bien en vue. Et il chercha un tablissement qui ft dj frquent.
71
Il lui fallut marcher longtemps. Il sassit enn devant une espce de marchand de
vin o plusieurs consommateurs taient dj installs, et il demanda : "Un rhum",
comme il aurait demand : " Une absinthe", sans songer lheure. Puis il appela :
" Garon, donnez-moi La Vie Franaise."
Un homme tablier blanc accourut :
"Nous ne lavons pas, monsieur, nous ne recevons que Le Rappel, Le Sicle, La
Lanterne, et Le Petit Parisien."
Duroy dclara, dun ton furieux et indign : "En voil une bote ! Alors, allez me
lacheter." Le garon y courut, la rapporta. Duroy se mit lire son article ; et plu-
sieurs fois il dit, tout haut : "Trs bien, trs bien" ! pour attirer lattention des voi-
sins et leur inspirer le dsir de savoir ce quil y avait dans cette feuille. Puis il la
laissa sur la table en sen allant. Le patron sen aperut, le rappela :
"Monsieur, monsieur, vous oubliez votre journal !"
Et Duroy rpondit :
"Je vous le laisse, je lai lu. Il y a dailleurs aujourdhui, dedans, une chose trs
intressante."
Il ne dsigna pas la chose, mais il vit, en sen allant, un de ses voisins prendre La
Vie Franaise sur la table o il lavait laisse.
Il pensa : "Que vais-je faire, maintenant ?" Et il se dcida aller son bureau
toucher son mois et donner sa dmission. Il tressaillait davance de plaisir la
pense de la tte que feraient son chef et ses collgues. Lide de leffarement du
chef, surtout, le ravissait.
Il marchait lentement pour ne pas arriver avant neuf heures et demie, la caisse
nouvrant qu dix heures.
Sonbureautait une grande pice sombre, oil fallait tenir le gaz allum presque
tout le jour en hiver. Elle donnait sur une cour troite, en face dautres bureaux. Ils
taient huit employs l-dedans, plus un sous-chef dans un coin, cach derrire
un paravent.
72
Duroy alla dabord chercher ses cent dix-huit francs vingt-cinq centimes, en-
ferms dans une enveloppe jaune et dposs dans le tiroir du commis charg des
paiements, puis il pntra dun air vainqueur dans la vaste salle de travail o il
avait dj pass tant de jours.
Ds quil fut entr, le sous-chef, M. Potel, lappela :
"Ah! cest vous, monsieur Duroy ? Le chef vous a dj demand plusieurs fois.
Vous savez quil nadmet pas quonsoit malade deux jours de suite sans attestation
du mdecin."
Duroy, qui se tenait debout au milieu du bureau, prparant son effet, rpondit
dune voix forte :
"Je men che un peu, par exemple !"
Il y eut parmi les employs unmouvement de stupfaction, et la tte de M. Potel
apparut, effare, au-dessus du paravent qui lenfermait comme une bote.
Il se barricadait l-dedans, par crainte des courants dair, car il tait rhumati-
sant. Il avait seulement perc deux trous dans le papier pour surveiller son per-
sonnel.
On entendait voler les mouches. Le sous-chef, enn, demanda avec hsitation :
"Vous avez dit ?
- Jai dit que je men chais un peu. Je ne viens aujourdhui que pour donner
ma dmission. Je suis entr comme rdacteur La Vie Franaise avec cinq cents
francs par mois, plus les lignes. Jy ai mme dbut ce matin."
Il stait pourtant promis de faire durer le plaisir, mais il navait pu rsister
lenvie de tout lcher dun seul coup.
Leffet, du reste, tait complet. Personne ne bougeait.
Alors Duroy dclara :
73
"Je vais prvenir M. Perthuis, puis je viendrai vous faire mes adieux. "
Et il sortit pour aller trouver le chef, qui scria en lapercevant :
"Ah! vous voil. Vous savez que je ne veux pas..."
Lemploy lui coupa la parole :
"Ce nest pas la peine de gueuler comme a..."
M. Perthuis, un gros homme rouge comme une crte de coq, demeura suffoqu
par la surprise.
Duroy reprit :
"Jen ai assez de votre boutique. Jai dbut ce matin dans le journalisme, o on
me fait une trs belle position. Jai bien lhonneur de vous saluer."
Et il sortit. Il tait veng.
Il alla en effet serrer la main de ses anciens collgues, qui osaient peine lui
parler, par peur de se compromettre, car on avait entendu sa conversation avec le
chef, la porte tant reste ouverte.
Et il se retrouva dans la rue avec son traitement dans sa poche. Il se paya un
djeuner succulent dans un bon restaurant prix modrs quil connaissait ; puis,
ayant encore achet et laiss La Vie Franaise sur la table o il avait mang, il
pntra dans plusieurs magasins o il acheta de menus objets, rien que pour les
faire livrer chez lui et donner son nom - Georges Duroy. - Il ajoutait : "Je suis le
rdacteur de La Vie Franaise."
Puis il indiquait la rue et le numro, en ayant soin de stipuler : " Vous laisserez
chez le concierge."
Comme il avait encore du temps, il entra chez un lithographe qui fabriquait des
cartes de visite la minute, sous les yeux des passants ; et il sen t faire immdia-
tement une centaine, qui portaient, imprime sous son nom, sa nouvelle qualit.
74
Puis il se rendit au journal.
Forestier le reut de haut, comme on reoit un infrieur :
"Ah! te voil, trs bien. Jai justement plusieurs affaires pour toi. Attends-moi
dix minutes. Je vais dabord nir ma besogne."
Et il continua une lettre commence.
A lautre bout de la grande table, un petit homme trs ple, bouf, trs gras,
chauve, avec un crne tout blanc et luisant, crivait, le nez sur son papier, par
suite dune myopie excessive.
Forestier lui demanda :
"Dis donc, Saint-Potin, quelle heure vas-tu interviewer nos gens ?
- A quatre heures.
- Tu emmneras avec toi le jeune Duroy ici prsent, et tu lui dvoileras les ar-
canes du mtier.
- Cest entendu."
Puis, se tournant vers son ami, Forestier ajouta :
"As-tu apport la suite sur lAlgrie ? Le dbut de ce matin a eu beaucoup de
succs."
Duroy, interdit, balbutia :
"Non, - javais cru avoir le temps dans laprs-midi, - jai eu un tas de choses
faire, - je nai pas pu..."
Lautre leva les paules dun air mcontent :
75
"Si tu nes pas plus exact que a, tu rateras ton avenir, toi. Le pre Walter comp-
tait sur ta copie. Je vais lui dire que ce sera pour demain. Si tu crois que tu seras
pay pour ne rien faire, tu te trompes. "
Puis, aprs un silence, il ajouta :
"On doit battre le fer quand il est chaud, que diable !"
Saint-Potin se leva :
"Je suis prt", dit-il.
Alors Forestier se renversant sur sa chaise, prit une pose presque solennelle
pour donner ses instructions, et, se tournant vers Duroy :
"Voil. Nous avons Paris depuis deux jours le gnral chinois Li-Theng-Fao,
descendu au Continental, et le rajah Taposahib Ramaderao Pali, descendu lh-
tel Bristol. Vous allez leur prendre une conversation."
Puis, se tournant vers Saint-Potin :
"Noublie point les principaux points que je tai indiqus. Demande au gn-
ral et au rajah leur opinion sur les menes de lAngleterre dans lExtrme-Orient,
leurs ides sur son systme de colonisation et de domination, leurs esprances
relatives lintervention de lEurope, et de la France en particulier, dans leurs af-
faires."
Il se tut, puis il ajouta, parlant la cantonade :
"Il sera on ne peut plus intressant pour nos lecteurs de savoir en mme temps
ce quon pense en Chine et dans les Indes sur ces questions, qui passionnent si
fort lopinion publique en ce moment."
Il ajouta, pour Duroy :
"Observe comment Saint-Potin sy prendra, cest un excellent reporter, et tche
dapprendre les celles pour vider un homme en cinq minutes."
76
Puis il recommena crire avec gravit, avec lintention vidente de bien ta-
blir les distances, de bienmettre sa place sonanciencamarade et nouveauconfrre.
Ds quils eurent franchi la porte, Saint-Potin se mit rire et dit Duroy :
"En voil un faiseur ! Il nous la fait nous-mmes. On dirait vraiment quil nous
prend pour ses lecteurs." Puis ils descendirent sur le boulevard, et le reporter de-
manda :
"Buvez-vous quelque chose ?
- Oui, volontiers. Il fait trs chaud."
Ils entrrent dans un caf et se rent servir des boissons fraches. Et Saint-Potin
se mit parler. Il parla de tout le monde et dujournal avec une profusionde dtails
surprenants.
"Le patron? Un vrai juif ! Et vous savez, les juifs on ne les changera jamais.
Quelle race !" Et il cita des traits tonnants davarice, de cette avarice particulire
aux ls dIsral, des conomies de dix centimes, des marchandages de cuisinire,
des rabais honteux demands et obtenus, toute une manire dtre dusurier, de
prteur gages.
"Et avec a, pourtant, un bon zig qui ne croit rien et roule tout le monde.
Son journal, qui est ofcieux, catholique, libral, rpublicain, orlaniste, tarte
la crme et boutique treize, na t fond que pour soutenir ses oprations de
bourse et ses entreprises de toute sorte. Pour a, il est trs fort, et il gagne des
millions au moyen de socits qui nont pas quatre sous de capital..."
Il allait toujours, appelant Duroy " mon cher ami ".
"Et il a des mots la Balzac, ce grigou. Figurez-vous que, lautre jour, je me trou-
vais dans son cabinet avec cette antique bedole de Norbert, et ce Don Quichotte
de Rival, quand Montelin, notre administrateur, arrive, avec sa serviette en ma-
roquin sous le bras, cette serviette que tout Paris connat. Walter leva le nez et
demanda : "Quoi de neuf ?"
"Montelin rpondit avec navet : "Je viens de payer les seize mille francs que
nous devions au marchand de papier."
77
"Le patron t un bond, un bond tonnant.
"- Vous dites ?
"- Que je viens de payer M. Privas.
"- Mais vous tes fou!
"- Pourquoi ?
"- Pourquoi... pourquoi... pourquoi..."
"II ta ses lunettes, les essuya. Puis il sourit, dun drle de sourire qui court
autour de ses grosses joues chaque fois quil va dire quelque chose de malin ou de
fort, et avec un ton gouailleur et convaincu, il pronona : "Pourquoi ? Parce que
nous pouvions obtenir l-dessus une rduction de quatre cinq mille francs."
"Montelin, tonn, reprit : "Mais, monsieur le directeur, tous les comptes taient
rguliers, vris par moi et approuvs par vous..."
"Alors le patron, redevenu srieux, dclara : "On nest pas naf comme vous. Sa-
chez, monsieur Montelin, quil faut toujours accumuler ses dettes pour transiger."
Et Saint-Potin ajouta avec un hochement de tte de connaisseur :
"Hein? Est-il la Balzac, celui-l ?"
Duroy navait pas lu Balzac, mais il rpondit avec conviction :
"Bigre oui."
Puis le reporter parla de Mme Walter, une grande dinde, de Norbert de Varenne,
un vieux rat, de Rival, une resuce de Fervacques. Puis il en vint Forestier :
"Quant celui-l, il a de la chance davoir pous sa femme, voil tout."
Duroy demanda :
78
"Quest-ce au juste que sa femme ?"
Saint-Potin se frotta les mains :
"Oh! une roue, une ne mouche. Cest la matresse dun vieux viveur nomm
Vaudrec, le comte de Vaudrec, qui la dote et marie..."
Duroy sentit brusquement une sensation de froid, une sorte de crispation ner-
veuse, un besoin dinjurier et de gier ce bavard. Mais il linterrompit simplement
pour lui demander :
"Cest votre nom, Saint-Potin?"
Lautre rpondit avec simplicit :
"Non, je mappelle Thomas. Cest au journal quonma surnomm Saint-Potin."
Et Duroy, payant les consommations, reprit :
"Mais il me semble quil est tard et que nous avons deux nobles seigneurs
visiter."
Saint-Potin se mit rire :
"Vous tes encore naf, vous ! Alors vous croyez comme a que je vais aller de-
mander ce Chinois et cet Indien ce quils pensent de lAngleterre ? Comme si
je ne le savais pas mieux queux, ce quils doivent penser pour les lecteurs de La
Vie Franaise. Jen ai dj interview cinq cents de ces Chinois, Persans, Hindous,
Chiliens, Japonais et autres. Ils rpondent tous la mme chose, daprs moi. Je nai
qu reprendre mon article sur le dernier venu et le copier mot pour mot. Ce qui
change, par exemple, cest leur tte, leur nom, leurs titres, leur ge, leur suite. Oh!
l-dessus, il ne faut pas derreur, parce que je serais relev raide par Le Figaro ou
Le Gaulois. Mais sur ce sujet le concierge de lhtel Bristol et celui du Continental
mauront renseign en cinq minutes. Nous irons pied jusque-l en fumant un ci-
gare. Total : cent sous de voiture rclamer au journal. Voil, mon cher, comment
on sy prend quand on est pratique."
Duroy demanda :
79
"a doit rapporter bon dtre reporter dans ces conditions-l."
Le journaliste rpondit avec mystre :
"Oui, mais rien ne rapporte autant que les chos, cause des rclames dgui-
ses."
Ils staient levs et suivaient le boulevard, vers la Madeleine. Et Saint-Potin,
tout coup, dit son compagnon :
"Vous savez, si vous avez faire quelque chose, je nai pas besoin de vous, moi."
Duroy lui serra la main, et sen alla.
Lide de son article crire dans la soire le tracassait, et il se mit y songer.
Il emmagasina des ides, des rexions, des jugements, des anecdotes, tout en
marchant, et il monta jusquau bout de lavenue des Champs-lyses, o on ne
voyait que de rares promeneurs, Paris tant vide par ces jours de chaleur.
Ayant dn chez un marchand de vin auprs de larc de triomphe de ltoile, il
revint lentement pied chez lui par les boulevards extrieurs, et il sassit devant
sa table pour travailler.
Mais ds quil eut sous les yeux la grande feuille de papier blanc, tout ce quil
avait amass de matriaux senvola de son esprit, comme si sa cervelle se ft va-
pore. Il essayait de ressaisir des bribes de souvenirs et de les xer : ils lui chap-
paient mesure quil les reprenait, ou bien ils se prcipitaient ple-mle, et il ne
savait comment les prsenter, les habiller, ni par lequel commencer.
Aprs une heure defforts et cinq pages de papier noircies par des phrases de
dbut qui navaient point de suite, il se dit : "Je ne suis pas encore assez rompu au
mtier. Il faut que je prenne une nouvelle leon." Et tout de suite la perspective
dune autre matine avec Mme Forestier, lespoir de ce long tte--tte intime,
cordial si doux, le rent tressaillir de dsir. Il se coucha bien vite, ayant presque
peur prsent de se remettre la besogne et de russir tout coup.
Il ne se leva, le lendemain, quun peu tard, loignant et savourant davance le
plaisir de cette visite.
80
Il tait dix heures passes quand il sonna chez son ami.
Le domestique rpondit :
"Cest que monsieur est en train de travailler."
Duroy navait point song que le mari pouvait tre l. Il insista cependant :
"Dites-lui que cest moi, pour une affaire pressante,"
Aprs cinq minutes dattente, on le t entrer dans le cabinet o il avait pass
une si bonne matine.
A la place occupe par lui, Forestier maintenant tait assis et crivait, en robe
de chambre, les pieds dans ses pantoues, la tte couverte dune petite toque an-
glaise, tandis que sa femme, enveloppe du mme peignoir blanc, et accoude
la chemine, dictait, une cigarette la bouche.
Duroy, sarrtant sur le seuil, murmura :
"Je vous demande bien pardon; je vous drange ?"
Et son ami, ayant tourn la tte, une tte furieuse, grogna :
"Quest-ce que tu veux encore ? Dpche-toi, nous sommes presss."
Lautre interdit, balbutiait :
"Non, ce nest rien, pardon."
Mais Forestier, se fchant :
"Allons, sacrebleu! ne perds pas de temps ; tu nas pourtant pas forc ma porte
pour le plaisir de nous dire bonjour."
Alors, Duroy, fort troubl, se dcida :
81
"Non... voil... cest que... je narrive pas encore faire mon article... et tu as
t... vous avez t si... si... gentils la dernire fois que... que jesprais... que jai
os venir..."
Forestier lui coupa la parole :
"Tu te ches du monde, la n! Alors tu timagines que je vais faire ton mtier,
et que tu nauras qu passer la caisse au bout du mois, Non! elle est bonne,
celle- l !"
La jeune femme continuait fumer, sans dire un mot, souriant toujours dun
vague sourire qui semblait un masque aimable sur lironie de sa pense.
Et Duroy, rougissant, bgayait : "Excusez-moi... javais cru... javais pens..."
Puis brusquement, dune voix claire :
"Je vous demande mille fois pardon, madame, en vous adressant encore mes
remerciements les plus vifs pour la chronique si charmante que vous mavez faite
hier."
Puis il salua, dit Charles :
"Je serai trois heures au journal", et il sortit.
Il retourna chez lui, grands pas, en grommelant : "Eh bien, je men vais la faire
celle-l, et tout seul, et ils verront..."
A peine rentr, la colre lexcitant, il se mit crire.
Il continua laventure commence par Mme Forestier, accumulant des dtails
de roman feuilleton, des pripties surprenantes et des descriptions ampoules,
avec une maladresse de style de collgien et des formules de sous-ofcier. En une
heure, il eut termin une chronique qui ressemblait un chaos de folies, et il la
porta, avec assurance, La Vie Franaise.
La premire personne quil rencontra fut Saint-Potin qui, lui serrant la main
avec une nergie de complice, demanda :
82
"Vous avez lu ma conversation avec le Chinois et avec lHindou. Est-ce assez
drle ? a a amus tout Paris. Et je nai pas vu seulement le bout de leur nez."
Duroy, qui navait rien lu, prit aussitt le journal, et il parcourut de loeil un long
article intitul " Inde et Chine", pendant que le reporter lui indiquait et soulignait
les passages les plus intressants.
Forestier survint, soufant, press, lair effar :
"Ah! bon, jai besoin de vous deux."
Et il leur indiqua une srie dinformations politiques quil fallait se procurer
pour le soir mme.
Duroy lui tendit son article.
"Voici la suite sur lAlgrie,
- Trs bien, donne : je vais la remettre au patron."
Ce fut tout.
Saint-Potin entrana son nouveau confrre, et, lorsquils furent dans le corridor,
il lui dit :
"Avez-vous pass la caisse ?
- Non. Pourquoi ?
- Pourquoi ? Pour vous faire payer. Voyez-vous, il faut toujours prendre un mois
davance. On ne sait pas ce qui peut arriver.
- Mais... je ne demande pas mieux.
- Je vais vous prsenter au caissier. Il ne fera point de difcults. On paie bien
ici."
83
Et Duroy alla toucher ses deux cents francs, plus vingt-huit francs pour son ar-
ticle de la veille, qui, joints ce qui lui restait de son traitement du chemin de fer,
lui faisaient trois cent quarante francs en poche.
Jamais il navait tenupareille somme, et il se crut riche pour des temps indnis.
Puis Saint-Potin lemmena bavarder dans les bureaux de quatre ou cinq feuilles
rivales, esprant que les nouvelles quon lavait charg de recueillir avaient t
prises dj par dautres, et quil saurait bien les leur soufer, grce labondance
et lastuce de sa conversation.
Le soir venu, Duroy, qui navait plus rien faire, songea retourner aux Folies-
Bergre, et, payant daudace, il se prsenta au contrle :
"Je mappelle Georges Duroy, rdacteur La Vie Franaise. Je suis venu lautre
jour avec M. Forestier, qui mavait promis de demander mes entres. Je ne sais sil
y a song."
Onconsulta unregistre. Sonnomne sy trouvait pas inscrit. Cependant le contr-
leur, homme trs affable, lui dit :
"Entrez toujours, monsieur, et adressez vous-mme votre demande M. le di-
recteur, qui y fera droit assurment."
Il entra, et presque aussitt, il rencontra Rachel, la femme emmene le premier
soir.
Elle vint lui :
"Bonjour, mon chat. Tu vas bien?
Trs bien, et toi ?
- Moi, pas mal. Tu ne sais pas, jai rv deux fois de toi depuis lautre jour."
Duroy sourit, att :
"Ah! ah! et quest-ce que a prouve ?
84
- a prouve que tu mas plu, gros serin, et que nous recommencerons quand a
te dira.
- Aujourdhui si tu veux.
- Oui, je veux bien.
- Bon, mais coute..." Il hsitait, un peu confus de ce quil allait faire ; " Cest
que, cette fois, je nai pas le sou : je viens du cercle, o jai tout claqu."
Elle le regardait au fond des yeux, airant le mensonge avec son instinct et sa
pratique de lle habitue aux roueries et aux marchandages des hommes. Elle dit :
"Blagueur ! Tu sais, a nest pas gentil avec moi cette manire-l."
Il eut un sourire embarrass :
"Si tu veux dix francs, cest tout ce qui me reste."
Elle murmura avec un dsintressement de courtisane qui se paie un caprice :
"Ce qui te plaira, mon chri : je ne veux que toi."
Et levant ses yeux sduits vers la moustache du jeune homme, elle prit son bras
et sappuya dessus amoureusement :
"Allons boire une grenadine dabord. Et puis nous ferons un tour ensemble.
Moi, je voudrais aller lOpra, comme a, avec toi, pour te montrer. Et puis nous
rentrerons de bonne heure, nest-ce pas ?"
. . . . . . . .
Il dormit tard chez cette lle. Il faisait jour quand il sortit, et la pense lui vint
aussitt dacheter La Vie Franaise. Il ouvrit le journal dune main vreuse ; sa
chronique ny tait pas ; et il demeurait debout sur le trottoir, parcourant anxieu-
sement de loeil les colonnes imprimes avec lespoir dy trouver enn ce quil
cherchait.
85
Quelque chose de pesant tout coup accablait son cur, car, aprs la fatigue
dune nuit damour, cette contrarit tombant sur sa lassitude avait le poids dun
dsastre.
Il remonta chez lui et sendormit tout habill sur son lit.
En entrant quelques heures plus tard dans les bureaux de la rdaction, il se pr-
senta devant M. Walter :
"Jai t tout surpris ce matin, monsieur, de ne pas trouver mon second article
sur lAlgrie."
Le directeur leva la tte, et dune voix sche :
"Je lai donn votre ami Forestier, en le priant de le lire ; il ne la pas trouv
sufsant ; il faudra me le refaire."
Duroy, furieux, sortit sans rpondre un mot, et, pntrant brusquement dans le
cabinet de son camarade :
"Pourquoi nas-tu pas fait paratre, ce matin, ma chronique ?"
Le journaliste fumait une cigarette, le dos au fond de son fauteuil et les pieds
sur sa table, salissant de ses talons unarticle commenc. Il articula tranquillement
avec un son de voix ennuy et lointain, comme sil parlait du fond dun trou :
"Le patron la trouv mauvais, et ma charg de te le remettre pour le recom-
mencer. Tiens, le voil."
Et il indiquait du doigt les feuilles dplies sous un presse-papiers.
Duroy, confondu, ne trouva rien dire, et, comme il mettait sa prose dans sa
poche, Forestier reprit :
"Aujourdhui tu vas te rendre dabord la prfecture..."
Et il indiqua une srie de courses daffaires, de nouvelles recueillir. Duroy sen
alla, sans avoir pu dcouvrir le mot mordant quil cherchait.
86
Il rapporta son article le lendemain. Il lui fut rendu de nouveau. Layant refait
une troisime fois, et le voyant refus, il comprit quil allait trop vite et que la main
de Forestier pouvait seule laider dans sa route.
Il ne parla donc plus des Souvenirs dun chasseur dAfrique, en se promettant
dtre souple et rus, puisquil le fallait, et de faire, en attendant mieux, son mtier
de reporter avec zle.
Il connut les coulisses des thtres et celles de la politique, les corridors et le
vestibule des hommes dtat et de la Chambre des dputs, les gures impor-
tantes des attachs de cabinet et les mines renfrognes des huissiers endormis.
Il eut des rapports continus avec des ministres, des concierges, des gnraux,
des agents de police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassa-
deurs, des vques, des proxntes, des rastaquoures, des hommes du monde,
des grecs, des cochers de acre, des garons de caf et bien dautres, tant devenu
lami intress et indiffrent de tous ces gens, les confondant dans son estime,
les toisant la mme mesure, les jugeant avec le mme oeil, force de les voir
tous les jours, toute heure, sans transition desprit, et de parler avec eux tous
des mmes affaires concernant son mtier. Il se comparait lui-mme un homme
qui goterait coup sur coup les chantillons de tous les vins, et ne distinguerait
bientt plus le Chteau-Margaux de lArgenteuil. Il devint en peu de temps un re-
marquable reporter, sr de ses informations, rus, rapide, subtil, une vraie valeur
pour le journal, comme disait le pre Walter, qui sy connaissait en rdacteurs.
Cependant, comme il ne touchait que dix centimes la ligne, plus ses deux cents
francs de xe, et comme la vie de boulevard, la vie de caf, la vie de restaurant
cote cher, il navait jamais le sou et se dsolait de sa misre.
Cest untruc saisir, pensait-il, envoyant certains confrres aller la poche pleine
dor, sans jamais comprendre quels moyens secrets ils pouvaient bien employer
pour se procurer cette aisance. Et il souponnait avec envie des procds incon-
nus et suspects, des services rendus, toute une contrebande accepte et consentie.
Or, il lui fallait pntrer le mystre, entrer dans lassociation tacite, simposer aux
camarades qui partageaient sans lui.
Et il rvait souvent le soir, en regardant de sa fentre passer les trains, aux pro-
cds quil pourrait employer.
87
Chapitre 6
Georges Duroy eut le rveil triste, le lendemain.
Il shabilla lentement, puis sassit devant sa fentre et se mit rchir. Il se
sentait, dans tout le corps, une espce de courbature, comme sil avait reu, la
veille, une vole de coups de bton.
Enn, la ncessit de trouver de largent laiguillonna et il se rendit chez Fores-
tier.
Son ami le reut, les pieds au feu, dans son cabinet.
"Quest-ce qui ta fait lever si tt ?
- Une affaire trs grave. Jai une dette dhonneur.
- De jeu?"
Il hsita, puis avoua :
"De jeu.
- Grosse ?
- Cinq cents francs !"
Il nen devait que deux cent quatre-vingt.
Forestier, sceptique, demanda :
88
"A qui dois-tu a ?"
Duroy ne put pas rpondre tout de suite.
"... Mais ... ... un monsieur de Carleville.
- Ah! Et o demeure-t-il ?
- Rue... rue..."
Forestier se mit rire : "Rue du Cherche-Midi quatorze heures, nest-ce pas ?
Je connais ce monsieur-l, mon cher. Si tu veux vingt francs, jai encore a ta
disposition, mais pas davantage."
Duroy accepta la pice dor.
Puis il alla, de porte en porte, chez toutes les personnes quil connaissait, et il
nit par runir, vers cinq heures, quatre-vingts francs.
Comme il lui en fallait trouver encore deux cents, il prit son parti rsolument,
et, gardant ce quil avait recueilli, il murmura : "Zut, je ne vais pas me faire de bile
pour cette garce-l. Je la paierai quand je pourrai."
Pendant quinze jours il vcut dune vie conome, rgle et chaste, lesprit plein
de rsolutions nergiques. Puis il fut pris dun grand dsir damour. Il lui semblait
que plusieurs annes staient coules depuis quil navait tenu une femme dans
ses bras, et, comme le matelot qui saffole en revoyant la terre, toutes les. jupes
rencontres le faisaient frissonner.
Alors il retourna, un soir, aux Folies-Bergre, avec lespoir dy trouver Rachel. Il
laperut, en effet, ds lentre, car elle ne quittait gure cet tablissement.
Il alla vers elle souriant, la main tendue. Mais elle le toisa de la tte aux pieds :
"Quest-ce que vous me voulez ?"
Il essaya de rire :
89
"Allons, ne fais pas ta poire."
Elle lui tourna les talons en dclarant :
"Je ne frquente pas les dos verts."
Elle avait cherch la plus grossire injure. Il sentit le sang lui empourprer la face,
et il rentra seul.
Forestier, malade, affaibli, toussant toujours, lui faisait, au journal, une exis-
tence pnible, semblait se creuser lesprit pour lui trouver des corves ennuyeuses.
Un jour mme, dans un moment dirritation nerveuse, et aprs une longue quinte
dtouffement, comme Duroy ne lui apportait point un renseignement demand,
il grogna : "Cristi, tu es plus bte que je naurais cru."
Lautre faillit le gier, mais il se contint et sen alla en murmurant : " Toi, je te
rattraperai." Une pense rapide lui traversa lesprit, et il ajouta : "Je vas te faire
cocu, mon vieux." Et il sen alla en se frottant les mains, rjoui par ce projet.
Il voulut, ds le jour suivant, en commencer lexcution. Il t Mme Forestier
une visite en claireur.
Il la trouva qui lisait un livre, tendue tout au long sur un canap.
Elle lui tendit la main, sans bouger, tournant seulement la tte, et elle dit : "Bon-
jour, Bel-Ami." Il eut la sensation dun soufet reu : " Pourquoi mappelez-vous
ainsi ?"
Elle rpondit en souriant :
"Jai vu Mme de Marelle lautre semaine, et jai su comment on vous avait bap-
tis chez elle."
Il se rassura devant lair aimable de la jeune femme. Comment aurait-il pucraindre,
dailleurs ?
Elle reprit :
90
"Vous la gtez ! Quant moi, on me vient voir quand on y pense, les trente-six
du mois, ou peu sen faut ?"
Il stait assis prs delle et il la regardait avec une curiosit nouvelle, une cu-
riosit damateur qui bibelote. Elle tait charmante, blonde dun blond tendre et
chaud, faite pour les caresses ; et il pensa : "Elle est mieux que lautre, certaine-
ment." Il ne doutait point du succs, il naurait qu allonger la main, lui semblait-
il, et la prendre, comme on cueille un fruit.
Il dit rsolument :
"Je ne venais point vous voir parce que cela valait mieux."
Elle demanda, sans comprendre :
"Comment ? Pourquoi ?
- Pourquoi ? Vous ne devinez pas.
- Non, pas du tout.
- Parce que je suis amoureux de vous... oh! un peu, rien quun peu... et que je
ne veux pas le devenir tout fait..."
Elle ne parut ni tonne, ni choque, ni atte ; elle continuait sourire du
mme sourire indiffrent, et elle rpondit avec tranquillit :
"Oh! vous pouvez venir tout de mme. On nest jamais amoureux de moi long-
temps."
Il fut surpris du ton plus encore que des paroles, et il demanda :
"Pourquoi ?
- Parce que cest inutile et que je le fais comprendre tout de suite. Si vous maviez
racont plus tt votre crainte, je vous aurais rassur et engag au contraire venir
le plus possible. "
91
Il scria, dun ton pathtique :
"Avec a quon peut commander aux sentiments !"
Elle se tourna vers lui :
"Mon cher ami, pour moi un homme amoureux est ray du nombre des vivants.
Il devient idiot, pas seulement idiot, mais dangereux. Je cesse, avec les gens qui
maiment damour, ou qui le prtendent, toute relation intime, parce quils men-
nuient dabord, et puis parce quils me sont suspects comme un chien enrag qui
peut avoir une crise. Je les mets donc en quarantaine morale jusqu ce que leur
maladie soit passe. Ne loubliez point. Je sais bien que chez vous lamour nest
autre chose quune espce dapptit, tandis que chez moi ce serait, au contraire,
une espce de... de... de communion des mes qui nentre pas dans la religion des
hommes. Vous en comprenez la lettre, et moi lesprit. Mais... regardez-moi bien
en face..."
Elle ne souriait plus. Elle avait un visage calme et froid et elle dit en appuyant
sur chaque mot :
"Je ne serai jamais, jamais votre matresse, entendez-vous. Il est donc abso-
lument inutile, il serait mme mauvais pour vous de persister dans ce dsir... Et
maintenant que... lopration est faite... voulez-vous que nous soyons amis, bons
amis, mais l, de vrais amis, sans arrire-pense ?"
Il avait compris que toute tentative resterait strile devant cette sentence sans
appel. Il en prit son parti tout de suite, franchement, et, ravi de pouvoir se faire
cette allie dans lexistence, il lui tendit les deux mains :
"Je suis vous, madame, comme il vous plaira."
Elle sentit la sincrit de la pense dans la voix, et elle donna ses mains.
Il les baisa, lune aprs lautre, puis il dit simplement en relevant la tte : "Cristi,
si javais trouv une femme comme vous, avec quel bonheur je laurais pouse !"
Elle fut touche, cette fois, caresse par cette phrase comme les femmes le sont
par les compliments qui trouvent leur cur, et elle lui jeta un de ces regards ra-
pides et reconnaissants qui nous font leurs esclaves.
92
Puis, comme il ne trouvait pas de transition pour reprendre la conversation, elle
pronona, dune voix douce, en posant un doigt sur son bras :
"Et je vais commencer tout de suite mon mtier damie. Vous tes maladroit,
mon cher..."
Elle hsita, et demanda :
"Puis-je parler librement ?
- Oui.
- Tout fait ?
- Tout fait.
- Eh bien, allez donc voir Mme Walter, qui vous apprcie beaucoup, et plaisez-
lui. Vous trouverez placer par l vos compliments, bien quelle soit honnte,
entendez-moi bien, tout fait honnte. Oh! pas despoir de... de maraudage non
plus de ce ct. Vous y pourrez trouver mieux, en vous faisant bien voir. Je sais que
vous occupez encore dans le journal une place infrieure. Mais ne craignez rien,
ils reoivent tous les rdacteurs avec la mme bienveillance. Allez-y croyez-moi."
Il dit, en souriant : "Merci, vous tes un ange... un ange gardien. " Puis ils par-
lrent de choses et dautres.
Il resta longtemps, voulant prouver quil avait plaisir se trouver prs delle ; et,
en la quittant, il demanda encore :
"Cest entendu, nous sommes des amis ?
- Cest entendu."
Comme il avait senti leffet de son compliment, tout lheure, il lappuya, ajou-
tant :
"Et si vous devenez jamais veuve, je minscris."
93
Puis il se sauva bien vite pour ne point lui laisser le loisir de se fcher.
Une visite Mme Walter gnait un peu Duroy, car il navait point t autoris
se prsenter chez elle, et il ne voulait pas commettre de maladresse. Le patron lui
tmoignait de la bienveillance, apprciait ses services, lemployait de prfrence
aux besognes difciles ; pourquoi ne proterait-il pas de cette faveur pour pn-
trer dans la maison?
Un jour donc, stant lev de bonne heure, il se rendit aux halles au moment
des ventes, et il se procura, moyennant une dizaine de francs, une vingtaine dad-
mirables poires. Les ayant celes avec soin dans une bourriche pour faire croire
quelles venaient de loin, il les porta chez le concierge de la patronne avec sa carte
o il avait crit :
Georges Duroy
Prie humblement Mme Walter daccepter ces quelques fruits quil a reus ce
matin de Normandie.
Il trouva le lendemaindans sa bote aux lettres, aujournal, une enveloppe conte-
nant, en retour, la carte de Mme Walter " qui remerciait bien vivement M. Georges
Duroy, et restait chez elle tous les samedis ".
Le samedi suivant, il se prsenta.
M. Walter habitait, boulevard Malesherbes, une maisondouble lui appartenant,
et dont une partie tait loue, procd conomique de gens pratiques. Un seul
concierge, gt entre les deux portes cochres, tirait le cordon pour le propritaire
et pour le locataire, et donnait chacune des entres un grand air dhtel riche et
comme il faut par sa belle tenue de suisse dglise, ses gros mollets emmaillots
en des bas blancs, et son vtement de reprsentation boutons dor et revers
carlates.
Les salons de rception taient au premier tage, prcds dune antichambre
tendue de tapisseries et enferme par des portires. Deux valets sommeillaient
sur des siges. Undeux prit le pardessus de Duroy, et lautre sempara de sa canne,
ouvrit une porte, devana de quelques pas le visiteur, puis, seffaant, le laissa pas-
ser en criant son nom dans un appartement vide.
94
Le jeune homme, embarrass, regardait de tous les cts, quand il aperut dans
une glace des gens assis et qui semblaient fort loin. Il se trompa dabord de di-
rection, le miroir ayant gar son oeil, puis il traversa encore deux salons vides
pour arriver dans une sorte de petit boudoir tendu de soie bleue boutons dor o
quatre dames causaient mi-voix autour dune table ronde qui portait des tasses
de th.
Malgr lassurance quil avait gagne dans son existence parisienne et surtout
dans son mtier de reporter qui le mettait incessamment en contact avec des per-
sonnages marquants, Duroy se sentait un peu intimid par la mise en scne de
lentre et par la traverse des salons dserts.
Il balbutia : "Madame, je me suis permis..." en cherchant de loeil la matresse
de la maison.
Elle lui tendit la main, quil prit en sinclinant, et lui ayant dit : "Vous tes fort ai-
mable, monsieur, de venir me voir", elle lui montra un sige o, voulant sasseoir,
il se laissa tomber, layant cru beaucoup plus haut.
On stait tu. Une des femmes se remit parler. Il sagissait du froid qui de-
venait violent, pas assez cependant pour arrter lpidmie de vre typhode ni
pour permettre de patiner. Et chacune donna son avis sur cette entre en scne
de la gele Paris ; puis elles exprimrent leurs prfrences dans les saisons, avec
toutes les raisons banales qui tranent dans les esprits comme la poussire dans
les appartements.
Un bruit lger de porte t retourner la tte de Duroy, et il aperut, travers deux
glaces sans tain, une grosse dame qui sen venait. Ds quelle apparut dans le bou-
doir, une des visiteuses se leva, serra les mains, puis partit ; et le jeune homme
suivit du regard, par les autres salons, son dos noir o brillaient des perles de jais.
Quand lagitation de ce changement de personnes se fut calme, on parla spon-
tanment, sans transition, de la question du Maroc et de la guerre en Orient, et
aussi des embarras de lAngleterre lextrmit de lAfrique.
Ces dames discutaient ces choses de mmoire, comme si elles eussent rcit
une comdie mondaine et convenable, rpte bien souvent.
95
Une nouvelle entre eut lieu, celle dune petite blonde frise, qui dtermina la
sortie dune grande personne sche, entre deux ges.
Et on parla des chances quavait M. Linet pour entrer lAcadmie. La nouvelle
venue pensait fermement quil serait battu par M. Cabanon-Lebas, lauteur de la
belle adaptation en vers franais de Don Quichotte pour le thtre.
"Vous savez que ce sera jou lOdon lhiver prochain!
- Ah! vraiment. Jirai certainement voir cette tentative trs littraire."
Mme Walter rpondait gracieusement, avec calme et indiffrence, sans hsiter
jamais sur ce quelle devait dire, son opinion tant toujours prte davance.
Mais elle saperut que la nuit venait et elle sonna pour les lampes, tout encou-
tant la causerie qui coulait comme un ruisseau de guimauve, et en pensant quelle
avait oubli de passer chez le graveur pour les cartes dinvitation du prochain d-
ner.
Elle tait un peu trop grasse, belle encore, lge dangereux o la dbcle est
proche. Elle se maintenait force de soins, de prcautions, dhygine et de ptes
pour la peau. Elle semblait sage entout, modre et raisonnable, une de ces femmes
dont lesprit est align comme un jardin franais. On y circule sans surprise, tout
en y trouvant un certain charme. Elle avait de la raison, une raison ne, discrte
et sre, qui lui tenait lieu de fantaisie, de la bont, du dvouement, et une bien-
veillance tranquille, large pour tout le monde et pour tout.
Elle remarqua que Duroy navait rien dit, quon ne lui avait point parl, et quil
semblait un peu contraint ; et comme ces dames ntaient point sorties de lAca-
dmie, ce sujet prfr les retenant toujours longtemps, elle demanda :
"Et vous qui devez tre renseign mieux que personne, monsieur Duroy, pour
qui sont vos prfrences ?"
Il rpondit sans hsiter :
96
"Dans cette question, madame, je nenvisagerais jamais le mrite, toujours contes-
table, des candidats, mais leur ge et leur sant. Je ne demanderais point leurs
titres, mais leur mal. Je ne rechercherais point sils ont fait une traductionrime de
Lope de Vega, mais jaurais soin de minformer de ltat de leur foie, de leur cur,
de leurs reins et de leur moelle pinire. Pour moi, une bonne hypertrophie, une
bonne albuminurie, et surtout un bon commencement dataxie locomotrice vau-
draient cent fois mieux que quarante volumes de digressions sur lide de patrie
dans la posie barbaresque."
Un silence tonn suivit cette opinion.
Mme Walter, souriant, reprit : "Pourquoi donc ?" Il rpondit : "Parce que je ne
cherche jamais que le plaisir quune chose peut causer aux femmes. Or, madame,
lAcadmie na vraiment dintrt pour vous que lorsquun acadmicien meurt.
Plus il en meurt, plus vous devez tre heureuses. Mais pour quils meurent vite, il
faut les nommer vieux et malades."
Comme on demeurait un peu surpris, il ajouta : "Je suis comme vous dailleurs
et jaime beaucoup lire dans les chos de Paris le dcs dun acadmicien. Je me
demande tout de suite : "Qui va le remplacer ? " Et je fais ma liste. Cest un jeu, un
petit jeu trs gentil auquel on joue dans tous les salons parisiens chaque trpas
dimmortel : " Le jeu de la mort et des quarante vieillards."
Ces dames, un peu dconcertes encore, commenaient cependant sourire,
tant tait juste sa remarque.
Il conclut, en se levant : "Cest vous qui les nommez, mesdames, et vous ne les
nommez que pour les voir mourir. Choisissez-les donc vieux, trs vieux, le plus
vieux possible, et ne vous occupez jamais du reste."
Puis il sen alla avec beaucoup de grce.
Ds quil fut parti, une des femmes dclara : "Il est drle, ce garon. Qui est-ce ?"
Mme Walter rpondit : "Un de nos rdacteurs, qui ne fait encore que la menue
besogne du journal, mais je ne doute pas quil arrive vite."
Duroy descendait le boulevard Malesherbes gaiement, grands pas dansants,
content de sa sortie et murmurant : "Bon dpart."
97
Il se rconcilia avec Rachel, ce soir-l.
La semaine suivante lui apporta deux vnements. Il fut nomm chef des chos
et invit dner chez Mme Walter. Il vit tout de suite un lien entre les deux nou-
velles.
La Vie Franaise tait avant tout un journal dargent, le patron tant un homme
dargent qui la presse et la dputation avaient servi de leviers. Se faisant de la
bonhomie une arme, il avait toujours manuvr sous un masque souriant de
brave homme, mais il nemployait ses besognes, quelles quelles fussent, que des
gens quil avait tts, prouvs, airs, quil sentait retors, audacieux et souples.
Duroy, nomm chef des chos, lui semblait un garon prcieux.
Cette fonction avait t remplie jusque-l par le secrtaire de la rdaction, M.
Boisrenard, un vieux journaliste correct, ponctuel et mticuleux comme un em-
ploy. Depuis trente ans il avait t secrtaire de la rdaction de onze journaux
diffrents, sans modier en rien sa manire de faire ou de voir. Il passait dune
rdaction dans une autre comme on change de restaurant, sapercevant peine
que la cuisine navait pas tout fait le mme got. Les opinions politiques et re-
ligieuses lui demeuraient trangres. Il tait dvou au journal quel quil ft, en-
tendu dans la besogne, et prcieux par son exprience. Il travaillait comme un
aveugle qui ne voit rien, comme un sourd qui nentend rien, et comme un muet
qui ne parle jamais de rien. Il avait cependant une grande loyaut professionnelle,
et ne se ft point prt une chose quil naurait pas juge honnte, loyale et cor-
recte au point de vue spcial de son mtier.
M. Walter, qui lapprciait cependant, avait souvent dsir un autre homme
pour lui coner les chos, qui sont, disait-il, la moelle du journal. Cest par eux
quon lance les nouvelles, quon fait courir les bruits, quon agit sur le public et
sur la rente. Entre deux soires mondaines, il faut savoir glisser, sans avoir lair de
rien, la chose importante, plutt insinue que dite. Il faut, par des sous-entendus,
laisser deviner ce quon veut, dmentir de telle sorte que la rumeur safrme, ou
afrmer de telle manire que personne ne croie au fait annonc. Il faut que, dans
les chos, chacun trouve chaque jour une ligne au moins qui lintresse, an que
tout le monde les lise. Il faut penser tout et tous, tous les mondes, toutes
les professions, Paris et la Province, lArme et aux Peintres, au Clerg et
lUniversit, aux Magistrats et aux Courtisanes.
98
Lhomme qui les dirige et qui commande au bataillon des reporters doit tre
toujours en veil, et toujours en garde, mant, prvoyant, rus, alerte et souple,
arm de toutes les astuces et dou dun air infaillible pour dcouvrir la nouvelle
fausse du premier coup doeil, pour juger ce qui est bon dire et bon celer, pour
deviner ce qui portera sur le public ; et il doit savoir le prsenter de telle faon que
leffet en soit multipli.
M. Boisrenard, qui avait pour lui une longue pratique, manquait de matrise
et de chic ; il manquait surtout de la rouerie native quil fallait pour pressentir
chaque jour les ides secrtes du patron.
Duroy devait faire laffaire en perfection, et il compltait admirablement la r-
daction de cette feuille " qui naviguait sur les fonds de ltat et sur les bas-fonds
de la politique", selon lexpression de Norbert de Varenne.
Les inspirateurs et vritables rdacteurs de La Vie Franaise taient une demi-
douzaine de dputs intresss dans toutes les spculations que lanait ou que
soutenait le directeur. On les nommait la Chambre " la bande Walter", et on les
enviait parce quils devaient gagner de largent avec lui et par lui.
Forestier, rdacteur politique, ntait que lhomme de paille de ces hommes
daffaires, lexcuteur des intentions suggres par eux. Ils lui soufaient ses ar-
ticles de fond, quil allait toujours crire chez lui pour tre tranquille, disait-il.
Mais, an de donner au journal une allure littraire et parisienne, on y avait
attach deux crivains clbres en des genres diffrents, Jacques Rival, chroni-
queur dactualit, et Norbert de Varenne, pote et chroniqueur fantaisiste, ou plu-
tt conteur, suivant la nouvelle cole.
Puis on stait procur, bas prix, des critiques dart, de peinture, de musique,
de thtre, un rdacteur criminaliste et un rdacteur hippique, parmi la grande
tribu mercenaire des crivains tout faire. Deux femmes du monde, " Domino
rose " et " Patte blanche", envoyaient des varits mondaines, traitaient les ques-
tions de mode, de vie lgante, dtiquette, de savoir-vivre, et commettaient des
indiscrtions sur les grandes dames.
Et La Vie Franaise " naviguait sur les fonds et bas-fonds", manuvre par
toutes ces mains diffrentes.
99
Duroy tait dans toute la joie de sa nomination aux fonctions de chef des chos
quand il reut un petit carton grav, o il lut : "M. et Mme Walter prient Monsieur
Georges Duroy de leur faire le plaisir de venir dner chez eux le jeudi 20 janvier."
Cette nouvelle faveur, tombant sur lautre, lemplit dune telle joie quil baisa
linvitation comme il et fait dune lettre damour. Puis il alla trouver le caissier
pour traiter la grosse question des fonds.
Un chef des chos a gnralement son budget sur lequel il paie ses reporters
et les nouvelles, bonnes ou mdiocres, apportes par lun ou lautre, comme les
jardiniers apportent leurs fruits chez un marchand de primeurs.
Douze cents francs par mois, au dbut, taient allous Duroy, qui se proposait
bien den garder une forte partie.
Le caissier, sur ses reprsentations pressantes, avait ni par lui avancer quatre
cents francs. Il eut, au premier moment, lintention formelle de renvoyer Mme
de Marelle les deux cent quatre-vingts francs quil lui devait, mais il rchit presque
aussitt quil ne lui resterait plus entre les mains que cent vingt francs, somme
tout fait insufsante pour faire marcher, dune faon convenable, son nouveau
service, et il remit cette restitution des temps plus loigns.
Pendant deux jours, il soccupa de son installation, car il hritait dune table
particulire et de casiers lettres, dans la vaste pice commune toute la rdac-
tion. Il occupait un bout de cette pice, tandis que Boisrenard, dont les cheveux
dun noir dbne, malgr son ge, taient toujours penchs sur une feuille de pa-
pier, tenait lautre bout.
La longue table du centre appartenait aux rdacteurs volants. Gnralement
elle servait de banc pour sasseoir, soit les jambes pendantes le long des bords,
soit la turque sur le milieu. Ils taient quelquefois cinq ou six accroupis sur cette
table, et jouant au bilboquet avec persvrance, dans une pose de magots chinois.
Duroy avait ni par prendre got ce divertissement, et il commenait deve-
nir fort, sous la direction et grce aux conseils de Saint-Potin.
Forestier, de plus en plus souffrant, lui avait con son beau bilboquet en bois
des Iles, le dernier achet, quil trouvait un peu lourd, et Duroy manuvrait dun
100
bras vigoureux la grosse boule noire au bout de sa corde, en comptant tout bas :
"Un - deux - trois - quatre - cinq - six"
Il arriva justement, pour la premire fois, faire vingt points de suite, le jour
mme o il devait dner chez Mme Walter. " Bonne journe, pensa-t-il, jai tous
les succs." Car ladresse au bilboquet confrait vraiment une sorte de supriorit
dans les bureaux de La Vie Franaise.
Il quitta la rdaction de bonne heure pour avoir le temps de shabiller, et il re-
montait la rue de Londres quand il vit trotter devant lui une petite femme qui avait
la tournure de Mme de Marelle. Il sentit une chaleur lui monter au visage, et son
cur se mit battre. Il traversa la rue pour la regarder de prol. Elle sarrta pour
traverser aussi. Il stait tromp ; il respira.
Il stait souvent demand comment il devrait se comporter en la rencontrant
face face. La saluerait-il, ou bien aurait-il lair de ne la point voir ?
"Je ne la verrais pas", pensa-t-il.
Il faisait froid, les ruisseaux gels gardaient des emptements de glace. Les trot-
toirs taient secs et gris sous la lueur du gaz.
Quand le jeune homme entra chez lui, il songea : "Il faut que je change de loge-
ment. Cela ne me suft plus maintenant." Il se sentait nerveux et gai, capable de
courir sur les toits, et il rptait tout haut, en allant de son lit la fentre : "Cest la
fortune qui arrive ! cest la fortune ! Il faudra que jcrive papa."
De temps en temps, il crivait son pre ; et la lettre apportait toujours une joie
vive dans le petit cabaret normand, au bord de la route, au haut de la grande cte
do lon domine Rouen et la large valle de la Seine.
De temps en temps aussi il recevait une enveloppe bleue dont ladresse tait
trace dune grosse criture tremble, et il lisait infailliblement les mmes lignes
au dbut de la lettre paternelle :
"Mon cher ls, la prsente est pour te dire que nous allons bien, ta mre et moi.
Pas grand-chose de nouveau dans le pays. Je tapprendrai cependant..."
101
Et il gardait au cur un intrt pour les choses du village, pour les nouvelles des
voisins et pour ltat des terres et des rcoltes.
Il se rptait, en nouant sa cravate blanche devant sa petite glace : "Il faut que
jcrive papa ds demain. Sil me voyait, ce soir, dans la maison o je vais, serait-
il pat, le vieux ! Sacristi, je ferai tout lheure un dner comme il nen a jamais
fait." Et il revit brusquement la cuisine noire de l-bas, derrire la salle de caf
vide, les casseroles jetant des lueurs jaunes le long des murs, le chat dans la chemi-
ne, le nez au feu, avec sa pose de Chimre accroupie, la table de bois graisse par
le temps et par les liquides rpandus, une soupire fumant au milieu, et une chan-
delle allume entre deux assiettes. Et il les aperut aussi lhomme et la femme, le
pre et la mre, les deux paysans aux gestes lents, mangeant la soupe petites gor-
ges. Il connaissait les moindres plis de leurs vieilles gures, les moindres mouve-
ments de leurs bras et de leur tte. Il savait mme ce quils se disaient, chaque soir,
en soupant face face.
Il pensa encore : "Il faudra pourtant que je nisse par aller les voir. " Mais comme
sa toilette tait termine, il soufa sa lumire et descendit.
Le long du boulevard extrieur, des lles laccostrent. Il leur rpondait en d-
gageant son bras : "Fichez-moi donc la paix !" avec un ddain violent, comme si
elles leussent insult, mconnu... Pour qui le prenaient-elles ? Ces rouleuses-l
ne savaient donc point distinguer les hommes ? La sensation de son habit noir en-
doss pour aller dner chez des gens trs riches, trs connus, trs importants lui
donnait le sentiment dune personnalit nouvelle, la conscience dtre devenu un
autre homme, un homme du monde, du vrai monde.
Il entra avec assurance dans lantichambre claire par les hautes torchres de
bronze et il remit, dun geste naturel, sa canne et son pardessus aux deux valets
qui staient approchs de lui.
Tous les salons taient illumins. Mme Walter recevait dans le second, le plus
grand. Elle laccueillit avec unsourire charmant, et il serra la maindes deux hommes
arrivs avant lui, M. Firminet M. Laroche-Mathieu, dputs, rdacteurs anonymes
de La Vie Franaise. M. Laroche-Mathieu avait dans le journal une autorit sp-
ciale provenant dune grande inuence sur la Chambre. Personne ne doutait quil
ne ft ministre un jour.
102
Puis arrivrent les Forestier, la femme en rose, et ravissante. Duroy fut stupfait
de la voir intime avec les deux reprsentants du pays. Elle causa tout bas, au coin
de la chemine, pendant plus de cinq minutes, avec M. Laroche-Mathieu. Charles
paraissait extnu. Il avait beaucoup maigri depuis un mois, et il toussait sans
cesse en rptant : "Je devrais me dcider aller nir lhiver dans le Midi."
Norbert de Varenne et Jacques Rival apparurent ensemble. Puis une porte stant
ouverte au fond de lappartement, M. Walter entra avec deux grandes jeunes lles
de seize dix-huit ans, une laide et lautre jolie.
Duroy savait pourtant que le patron tait pre de famille, mais il fut saisi dton-
nement. Il navait jamais song aux lles de son directeur que comme on songe
aux pays lointains quon ne verra jamais. Et puis il se les tait gures toutes pe-
tites et il voyait des femmes. Il en ressentait le lger trouble moral que produit un
changement vue.
Elles lui tendirent la main, lune aprs lautre, aprs la prsentation, et elles al-
lrent sasseoir une petite table qui leur tait sans doute rserve, o elles se
mirent remuer un tas de bobines de soie dans une bannette.
On attendait encore quelquun, et on demeurait silencieux, dans cette sorte de
gne qui prcde les dners entre gens qui ne se trouvent pas dans la mme at-
mosphre desprit, aprs les occupations diffrentes de leur journe. Duroy ayant
lev par dsuvrement les yeux vers le mur, M. Walter lui dit, de loin, avec un
dsir visible de faire valoir son bien : "Vous regardez mes tableaux ?"
- Le mes sonna. - " Je vais vous les montrer." Et il prit une lampe pour quon pt
distinguer tous les dtails.
"Ici les paysages", dit-il.
Au centre du panneau on voyait une grande toile de Guillemet, une plage de
Normandie sous un ciel dorage. Au-dessous, un bois de Harpignies, puis une
plaine dAlgrie, par Guillaumet, avec un chameau lhorizon, un grand chameau
sur ses hautes jambes, pareil un trange monument.
M. Walter passa au mur voisin et annona, avec un ton srieux, comme un
matre de crmonies : "La grande peinture. " Ctaient quatre toiles : "Une Visite
dhpital", par Gervex ; " une Moissonneuse", par Bastien-Lepage ; " une Veuve",
103
par Bouguereau, et " une Excution", par Jean-Paul Laurens. Cette dernire uvre
reprsentait un prtre venden fusill contre le mur de son glise par un dtache-
ment de Bleus.
Un sourire passa sur la gure grave du patron en indiquant le panneau suivant :
"Ici les fantaisistes." On apercevait dabord une petite toile de Jean Braud, in-
titule : "Le Haut et le Bas." Ctait une jolie Parisienne montant lescalier dun
tramway en marche. Sa tte apparaissait au niveau de limpriale, et les messieurs
assis sur les bancs dcouvraient, avec une satisfaction avide, le jeune visage qui
venait vers eux, tandis que les hommes debout sur la plate-forme du bas consid-
raient les jambes de la jeune femme avec une expression diffrente de dpit et de
convoitise.
M. Walter tenait la lampe bout de bras, et rptait en riant dun rire polisson :
"Hein? Est-ce drle ? est-ce drle ? "
Puis il claira : "Un sauvetage", par Lambert.
Au milieu dune table desservie, un jeune chat, assis sur son derrire, exami-
nait avec tonnement et perplexit une mouche se noyant dans un verre deau. Il
avait une patte leve, prt cueillir linsecte dun coup rapide. Mais il ntait point
dcid. Il hsitait. Que ferait-il ?
Puis le patron montra un Detaille : "La Leon", qui reprsentait un soldat dans
une caserne, apprenant un caniche jouer du tambour, et il dclara : "En voil
de lesprit !"
Duroy riait dunrire approbateur et sextasiait : "Comme cest charmant, comme
cest charmant, char..."
Il sarrta net, en entendant derrire lui la voix de Mme de Marelle qui venait
dentrer.
Le patron continuait clairer les toiles, en les expliquant.
Il montrait maintenant une aquarelle de Maurice Leloir : "LObstacle. " Ctait
une chaise porteurs arrte, la rue se trouvant barre par une bataille entre deux
hommes du peuple, deux gaillards luttant comme des hercules. Et on voyait sortir
104
par la fentre de la chaise un ravissant visage de femme qui regardait... qui regar-
dait... sans impatience, sans peur, et avec une certaine admiration le combat de
ces deux brutes.
M. Walter disait toujours : "Jen ai dautres dans les pices suivantes, mais ils
sont de gens moins connus, moins classs. Ici cest mon Salon carr. Jachte des
jeunes en ce moment, des tout jeunes, et je les mets en rserve dans les appar-
tements intimes, en attendant le moment o les auteurs seront clbres." Puis il
pronona tout bas : "Cest linstant dacheter des tableaux. Les peintres crvent de
faim. Ils nont pas le sou, pas le sou..."
Mais Duroy ne voyait rien, entendait sans comprendre. Mme de Marelle tait l,
derrire lui. Que devait-il faire ? Sil la saluait, nallait-elle point lui tourner le dos
ou lui jeter quelque insolence ? Sil ne sapprochait pas delle, que penserait-on?
Il se dit : "Je vais toujours gagner du temps." Il tait tellement mu quil eut
lide un moment de simuler une indisposition subite qui lui permettrait de sen
aller.
La visite des murs tait nie. Le patronalla reposer sa lampe et saluer la dernire
venue, tandis que Duroy recommenait tout seul lexamen des toiles comme sil
ne se ft pas lass de les admirer.
Il avait lesprit boulevers. Que devait-il faire ? Il entendait les voix, il distinguait
la conversation. Mme Forestier lappela : "Dites donc, monsieur Duroy." Il courut
vers elle. Ctait pour lui recommander une amie qui donnait une fte et qui aurait
bien voulu une citation dans les chos de La Vie Franaise.
Il balbutiait : "Mais certainement, madame, certainement..."
Mme de Marelle se trouvait maintenant tout prs de lui. Il nosait point se re-
tourner pour sen aller. Tout coup, il se crut devenu fou; elle avait dit, haute
voix :
"Bonjour, Bel-Ami. Vous ne me reconnaissez donc plus ?"
Il pivota sur ses talons avec rapidit. Elle se tenait debout devant lui, souriante,
loeil plein de gaiet et daffection. Et elle lui tendit la main.
105
Il la prit en tremblant, craignant encore quelque ruse et quelque perdie. Elle
ajouta avec srnit :
"Que devenez-vous ? On ne vous voit plus."
Il bgayait, sans parvenir reprendre son sang-froid :
"Mais jai eu beaucoup faire, madame, beaucoup faire. M. Walter ma con
un nouveau service qui me donne normment doccupation."
Elle rpondit, en le regardant toujours en face, sans quil pt dcouvrir dans son
oeil autre chose que de la bienveillance : "Je le sais. Mais ce nest pas une raison
pour oublier vos amis."
Ils furent spars par une grosse dame qui entrait, une grosse dame dcollete,
aux bras rouges, aux joues rouges, vtue et coiffe avec prtention, et marchant si
lourdement quon sentait, la voir aller, le poids et lpaisseur de ses cuisses.
Comme on paraissait la traiter avec beaucoup dgards, Duroy demanda Mme
Forestier :
"Quelle est cette personne ?
- La vicomtesse de Percemur, celle qui signe : "Patte blanche ".
Il fut stupfait et saisi par une envie de rire :
"Patte blanche ! Patte blanche ! Moi qui voyais, en pense, une jeune femme
comme vous ! Cest a, Patte blanche ? Ah! elle est bien bonne ! bien bonne !"
Un domestique apparut dans la porte et annona :
"Madame est servie."
106
Le dner fut banal et gai, un de ces dners o lon parle de tout sans rien dire.
Duroy se trouvait entre la lle ane du patron, la laide, Mlle Rose, et Mme de
Marelle. Ce dernier voisinage le gnait un peu, bien quelle et lair fort laise et
caust avec son esprit ordinaire. Il se trouva dabord contraint, hsitant, comme
un musicien qui a perdu le ton. Peu peu, cependant, lassurance lui revenait,
et leurs yeux, se rencontrant sans cesse, sinterrogeaient, mlaient leurs regards
dune faon intime, presque sensuelle, comme autrefois.
Tout coup, il crut sentir, sous la table, quelque chose efeurer son pied. Il
avana doucement la jambe et rencontra celle de sa voisine qui ne recula point
ce contact. Ils ne parlaient pas, en ce moment, tourns tous deux vers leurs autres
voisins.
Duroy, le cur battant, poussa un peu plus son genou. Une pression lgre lui
rpondit. Alors il comprit que leurs amours recommenaient.
Que dirent-ils ensuite ? Pas grand-chose ; mais leurs lvres frmissaient chaque
fois quils se regardaient.
Le jeune homme, cependant, voulant tre aimable pour la lle de son patron,
lui adressait une phrase de temps en temps. Elle y rpondait, comme laurait fait
sa mre, nhsitant jamais sur ce quelle devait dire.
A la droite de M. Walter, la vicomtesse de Percemur prenait des allures de prin-
cesse ; et Duroy, sgayant la regarder, demanda tout bas Mme de Marelle :
"Est-ce que vous connaissez lautre, celle qui signe : "Domino rose " ?
- Oui, parfaitement ; la baronne de Livar !
- Est-elle du mme cru?
- Non. Mais aussi drle. Une grande sche, soixante ans, frisons faux, dents
langlaise, esprit de la Restauration, toilettes mme poque.
- O ont-ils dnich ces phnomnes de lettres ?
- Les paves de la noblesse sont toujours recueillies par les bourgeois parvenus.
107
- Pas dautre raison?
- Aucune autre."
Puis une discussionpolitique commena entre le patron, les deux dputs, Nor-
bert de Varenne et Jacques Rival ; et elle dura jusquau dessert.
Quand on fut retourn dans le salon, Duroy sapprocha de nouveau de Mme de
Marelle, et, la regardant au fond des yeux : "Voulez-vous que je vous reconduise,
ce soir ?
- Non.
- Pourquoi ?
- Parce que M. Laroche-Mathieu, qui est monvoisin, me laisse ma porte chaque
fois que je dne ici.
- Quand vous verrai-je ?
- Venez djeuner avec moi, demain."
Et ils se sparrent sans rien dire de plus.
Duroy ne resta pas tard, trouvant monotone la soire. Comme il descendait les-
calier, il rattrapa Norbert de Varenne qui venait aussi de partir. Le vieux pote lui
prit le bras. Nayant plus de rivalit redouter dans le journal, leur collaboration
tant essentiellement diffrente, il tmoignait maintenant au jeune homme une
bienveillance daeul.
"Eh bien, vous allez me reconduire un bout de chemin?" dit-il.
Duroy rpondit : "Avec joie, cher matre."
Et ils se mirent en route, en descendant le boulevard Malesherbes, petits pas.
108
Paris tait presque dsert cette nuit-l, une nuit froide, une de ces nuits quon
dirait plus vastes que les autres, o les toiles sont plus hautes, o lair semble
apporter dans ses soufes glacs quelque chose venu de plus loin que les astres.
Les deux hommes ne parlrent point dans les premiers moments. Puis Duroy,
pour dire quelque chose, pronona :
"Ce M. Laroche-Mathieu a lair fort intelligent et fort instruit."
Le vieux pote murmura : "Vous trouvez ?."
Le jeune homme, surpris, hsitait ; " Mais oui ; il passe dailleurs pour un des
hommes les plus capables de la Chambre.
- Cest possible. Dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois. Tous ces
gens-l, voyez-vous, sont des mdiocres, parce quils ont lesprit entre deux murs,
- largent et la politique. - Ce sont des cuistres, mon cher, avec qui il est impossible
de parler de rien, de rien de ce que nous aimons. Leur intelligence est fond de
vase, ou plutt fond de dpotoir, comme la Seine Asnires.
"Ah! cest quil est difcile de trouver un homme qui ait de lespace dans la
pense, qui vous donne la sensationde ces grandes haleines dularge quonrespire
sur les ctes de la mer. Jen ai connu quelques-uns, ils sont morts."
Norbert de Varenne parlait dune voix claire, mais retenue, qui aurait sonn
dans le silence de la nuit sil lavait laisse schapper. Il semblait surexcit et triste,
dune de ces tristesses qui tombent parfois sur les mes et les rendent vibrantes
comme la terre sous la gele.
Il reprit :
"Quimporte, dailleurs, un peu plus ou un peu moins de gnie, puisque tout
doit nir !"
Et il se tut. Duroy, qui se sentait le cur gai, ce soir-l, dit, en souriant :
"Vous avez du noir, aujourdhui, cher matre."
109
Le pote rpondit .
"Jen ai toujours, mon enfant, et vous en aurez autant que moi dans quelques
annes. La vie est une cte. Tant quon monte, on regarde le sommet, et on se sent
heureux ; mais, lorsquon arrive en haut, on aperoit tout dun coup la descente,
et la n qui est la mort. a va lentement quand on monte, mais a va vite quand
on descend. A votre ge, on est joyeux. On espre tant de choses, qui narrivent
jamais dailleurs. Au mien, on nattend plus rien... que la mort. "
Duroy se mit rire :
"Bigre, vous me donnez froid dans le dos."
Norbert de Varenne reprit :
"Non, vous ne me comprenez pas aujourdhui, mais vous vous rappellerez plus
tard ce que je vous dis en ce moment.
"Il arrive un jour, voyez-vous, et il arrive de bonne heure pour beaucoup, o
cest ni de rire, comme on dit, parce que derrire tout ce quon regarde, cest la
mort quon aperoit.
"Oh! vous ne comprenez mme pas ce mot-l, vous, la mort. A votre ge, a ne
signie rien. Au mien, il est terrible.
"Oui, on le comprend tout dun coup, on ne sait pas pourquoi ni propos de
quoi, et alors tout change daspect, dans la vie. Moi, depuis quinze ans, je la sens
qui me travaille comme si je portais en moi une bte rongeuse. Je lai sentie peu
peu, mois par mois, heure par heure, me dgrader ainsi quune maison qui
scroule. Elle ma dgur si compltement que je ne me reconnais pas. Je nai
plus rien de moi, de moi lhomme radieux, frais et fort que jtais trente ans. Je
lai vue teindre en blanc mes cheveux noirs, et avec quelle lenteur savante et m-
chante ! Elle ma pris ma peau ferme, mes muscles, mes dents, tout mon corps de
jadis, ne me laissant quune me dsespre quelle enlvera bientt aussi.
"Oui, elle ma miett, la gueuse, elle a accompli doucement et terriblement
la longue destruction de mon tre, seconde par seconde. Et maintenant je me
110
sens mourir en tout ce que je fais. Chaque pas mapproche delle, chaque mouve-
ment, chaque soufe hte son odieuse besogne. Respirer, dormir, boire, manger,
travailler, rver, tout ce que nous faisons, cest mourir. Vivre enn, cest mourir !
"Oh! vous saurez cela ! Si vous rchissiez seulement un quart dheure, vous la
verriez.
"Quattendez-vous ? De lamour ? Encore quelques baisers, et vous serez im-
puissant.
"Et puis, aprs ? De largent ? Pour quoi faire ? Pour payer des femmes ? Joli bon-
heur ? Pour manger beaucoup, devenir obse et crier des nuits entires sous les
morsures de la goutte ?
"Et puis encore ? De la gloire ? Aquoi cela sert-il quand onne peut plus la cueillir
sous forme damour ?
"Et puis, aprs ? Toujours la mort pour nir.
"Moi, maintenant, je la vois de si prs que jai souvent envie dtendre les bras
pour la repousser. Elle couvre la terre et emplit lespace. Je la dcouvre partout. Les
petites btes crases sur les routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperu
dans la barbe dun ami me ravagent le cur et me crient : "La voil !"
"Elle me gte tout ce que je fais, tout ce que je vois, ce que je mange et ce que
je bois, tout ce que jaime, les clairs de lune, les levers de soleil, la grande mer, les
belles rivires, et lair des soirs dt, si doux respirer !"
Il allait doucement, un peu essouf, rvant tout haut, oubliant presque quon
lcoutait.
Il reprit : "Et jamais un tre ne revient, jamais... On garde les moules des sta-
tues, les empreintes qui refont toujours des objets pareils ; mais mon corps, mon
visage, mes penses, mes dsirs ne reparatront jamais. Et pourtant il natra des
millions, des milliards dtres qui auront dans quelques centimtres carrs unnez,
des yeux, un front, des joues et une bouche comme moi, et aussi une me comme
moi, sans que jamais je revienne, moi, sans que jamais mme quelque chose de
moi reconnaissable reparaisse dans ces cratures innombrables et diffrentes, in-
dniment diffrentes bien que pareilles peu prs.
111
"A quoi se rattacher ? Vers qui jeter des cris de dtresse ? A quoi pouvons-nous
croire ?
"Toutes les religions sont stupides, avec leur morale purile et leurs promesses
gostes, monstrueusement btes.
"La mort seule est certaine."
Il sarrta, prit Duroy par les deux extrmits du col de son pardessus, et, dune
voix lente :
"Pensez tout cela, jeune homme, pensez-y pendant des jours, des mois et des
annes, et vous verrez lexistence dune autre faon. Essayez donc de vous dgager
de tout ce qui vous enferme, faites cet effort surhumain de sortir vivant de votre
corps, de vos intrts, de vos penses et de lhumanit tout entire, pour regarder
ailleurs, et vous comprendrez combien ont peu dimportance les querelles des
romantiques et des naturalistes, et la discussion du budget."
Il se remit marcher dun pas rapide.
"Mais aussi vous sentirez leffroyable dtresse des dsesprs. Vous vous dbat-
trez, perdu, noy, dans les incertitudes. Vous crierez " A laide " de tous les cts,
et personne ne vous rpondra. Vous tendrez les bras, vous appellerez pour tre
secouru, aim, consol, sauv ; et personne ne viendra.
"Pourquoi souffrons-nous ainsi ? Cest que nous tions ns sans doute pour
vivre davantage selon la matire et moins selon lesprit ; mais, force de pen-
ser, une disproportion sest faite entre ltat de notre intelligence agrandie et les
conditions immuables de notre vie.
"Regardez les gens mdiocres : moins de grands dsastres tombant sur eux ils
se trouvent satisfaits, sans souffrir du malheur commun. Les btes non plus ne le
sentent pas."
Il sarrta encore, rchit quelques secondes, puis dun air las et rsign :
"Moi, je suis un tre perdu. Je nai ni pre, ni mre, ni frre, ni sur, ni femme,
ni enfants, ni Dieu."
112
Il ajouta, aprs un silence : "Je nai que la rime,"
Puis, levant la tte vers le rmament, o luisait la face ple de la pleine lune, il
dclama :
Et je cherche le mot de cet obscur problme
Dans le ciel noir et vide o otte un astre blme.
Ils arrivaient au pont de la Concorde, ils le traversrent en silence, puis ils lon-
grent le Palais-Bourbon. Norbert de Varenne se remit parler :
"Mariez-vous, mon ami, vous ne savez pas ce que cest que de vivre seul, mon
ge. La solitude, aujourdhui, memplit dune angoisse horrible ; la solitude dans le
logis, auprs du feu, le soir. Il me semble alors que je suis seul sur la terre, affreu-
sement seul, mais entour de dangers vagues, de choses inconnues et terribles ;
et la cloison, qui me spare de mon voisin que je ne connais pas, mloigne de lui
autant que des toiles aperues par ma fentre. Une sorte de vre menvahit, une
vre de douleur et de crainte, et le silence des murs mpouvante. Il est si pro-
fond et si triste, le silence de la chambre o lon vit seul. Ce nest pas seulement
un silence autour du corps, mais un silence autour de lme, et, quand un meuble
craque, on tressaille jusquau cur, car aucun bruit nest attendu dans ce morne
logis."
Il se tut encore une fois, puis ajouta :
"Quand on est vieux, ce serait bon, tout de mme, des enfants !"
Ils taient arrivs vers le milieu de la rue de Bourgogne. Le pote sarrta devant
une haute maison, sonna, serra la main de Duroy, et lui dit :
"Oubliez tout ce rabchage de vieux, jeune homme, et vivez selon votre ge ;
adieu!"
Et il disparut dans le corridor noir.
113
Duroy se remit enroute, le cur serr. Il lui semblait quonvenait de lui montrer
quelque trou plein dossements, un trou invitable o il lui faudrait tomber un
jour. Il murmura : "Bigre, a ne doit pas tre gai, chez lui. Je ne voudrais pas un
fauteuil de balcon pour assister au dl de ses ides, nom dun chien!"
Mais, stant arrt pour laisser passer une femme parfume qui descendait de
voiture et rentrait chez elle, il aspira dun grand soufe avide la senteur de ver-
veine et diris envole dans lair. Ses poumons et son cur palpitrent brusque-
ment desprance et de joie ; et le souvenir de Mme de Marelle quil reverrait le
lendemain lenvahit des pieds la tte.
Tout lui souriait, la vie laccueillait avec tendresse. Comme ctait bon, la rali-
sation des esprances.
Il sendormit dans livresse et se leva de bonne heure pour faire un tour pied,
dans lavenue du Bois-de-Boulogne, avant daller son rendez-vous.
Le vent ayant chang, le temps stait adouci pendant la nuit, et il faisait une
tideur et un soleil davril. Tous les habitus du Bois taient sortis ce matin-l,
cdant lappel du ciel clair et doux.
Duroy marchait lentement, buvant lair lger, savoureux comme une friandise
de printemps. Il passa larc de triomphe de ltoile et sengagea dans la grande
avenue, duct oppos aux cavaliers. Il les regardait, trottant ougalopant, hommes
et femmes, les riches du monde, et cest peine sil les enviait maintenant. Il les
connaissait presque tous de nom, savait le chiffre de leur fortune et lhistoire se-
crte de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte dalmanach des clbrits
et des scandales parisiens.
Les amazones passaient, minces et moules dans le drap sombre de leur taille,
avec ce quelque chose de hautain et dinabordable quont beaucoup de femmes
cheval ; et Duroy samusait rciter mi-voix, comme on rcite des litanies dans
une glise, les noms, titres et qualits des amants quelles avaient eus ou quon
leur prtait ; et, quelquefois mme, au lieu de dire :
"Baron de Tanquelet,
Prince de la Tour-Enguerrand" ;
114
il murmurait : "Ct Lesbos
Louise Michot, du Vaudeville,
Rose Marquetin, de lOpra."
Ce jeulamusait beaucoup, comme sil et constat, sous les svres apparences,
lternelle et profonde infamie de lhomme, et que cela let rjoui, excit, consol.
Puis il pronona tout haut : "Tas dhypocrites !" et chercha de loeil les cavaliers
sur qui couraient les plus grosses histoires.
Il en vit beaucoup souponns de tricher au jeu, pour qui les cercles, en tout
cas, taient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte coup sr.
Dautres, fort clbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, ctait
connu; dautres, des rentes de leurs matresses, on lafrmait. Beaucoup avaient
pay leurs dettes ( acte honorable ), sans quon et jamais devin do leur tait
venu largent ncessaire ( mystre bien louche ). Il vit des hommes de nance
dont limmense fortune avait un vol pour origine, et quon recevait partout, dans
les plus nobles maisons, puis des hommes si respects que les petits bourgeois se
dcouvraient sur leur passage, mais dont les tripotages effronts, dans les grandes
entreprises nationales, ntaient un mystre pour aucun de ceux qui savaient les
dessous du monde.
Tous avaient lair hautain, la lvre re, loeil insolent, ceux favoris et ceux
moustaches.
Duroy riait toujours, rptant : "Cest dupropre, tas de crapules, tas descarpes !"
Mais une voiture passa, dcouverte, basse et charmante, trane au grand trot
par deux minces chevaux blancs dont la crinire et la queue voltigeaient, et conduite
par une petite jeune femme blonde, une courtisane connue qui avait deux grooms
assis derrire elle. Duroy sarrta, avec une envie de saluer et dapplaudir cette par-
venue de lamour qui talait avec audace dans cette promenade et cette heure
des hypocrites aristocrates, le luxe crne gagn sur ses draps. Il sentait peut-tre
vaguement quil y avait quelque chose de commun entre eux, un lien de nature,
quils taient de mme race, de mme me, et que son succs aurait des procds
audacieux de mme ordre.
115
Il revint plus doucement, le cur chaudde satisfaction, et il arriva, unpeuavant
lheure, la porte de son ancienne matresse.
Elle le reut, les lvres tendues, comme si aucune rupture navait eu lieu, et elle
oublia mme, pendant quelques instants, la sage prudence quelle opposait, chez
elle, leurs caresses. Puis elle lui dit, enbaisant les bouts friss de ses moustaches :
"Tu ne sais pas lennui qui marrive, mon chri ?
Jesprais une bonne lune de miel, et voil mon mari qui me tombe sur le dos
pour six semaines ; il a pris cong. Mais je ne veux pas rester six semaines sans te
voir, surtout aprs notre petite brouille, et voil comment jai arrang les choses.
Tu viendras me demander dner lundi, je lui ai dj parl de toi. Je te prsente-
rai."
Duroy hsitait, un peu perplexe, ne stant jamais trouv encore en face dun
homme dont il possdait la femme. Il craignait que quelque chose le traht, un
peu de gne, un regard, nimporte quoi. Il balbutiait :
"Non, jaime mieux ne pas faire la connaissance de ton mari." Elle insista, fort
tonne, debout devant lui et ouvrant des yeux nafs : " Mais pourquoi ? quelle
drle de chose ? a arrive tous les jours, a ! Je ne taurais pas cru si nigaud, par
exemple."
Il fut bless :
"Eh bien, soit, je viendrai dner lundi."
Elle ajouta :
"Pour que ce soit bien naturel, jaurai les Forestier. a ne mamuse pourtant pas
de recevoir du monde chez moi."
Jusquau lundi, Duroy ne pensa plus gure cette entrevue ; mais voil quen
montant lescalier de Mme de Marelle, il se sentit trangement troubl, non pas
quil lui rpugnt de prendre la main de ce mari, de boire son vin et de manger
son pain, mais il avait peur de quelque chose, sans savoir de quoi.
116
On le t, entrer dans le salon, et il attendit, comme toujours. Puis la porte de la
chambre souvrit, et il aperut un grand homme barbe blanche, dcor, grave et
correct, qui vint lui avec une politesse minutieuse :
"Ma femme ma souvent parl de vous, monsieur, et je suis charm de faire votre
connaissance."
Duroy savana en tchant de donner sa physionomie un air de cordialit ex-
pressive et il serra avec une nergie exagre la main tendue de son hte. Puis,
stant assis, il ne trouva rien lui dire.
M. de Marelle remit un morceau de bois au feu, et demanda :
"Voici longtemps que vous vous occupez de journalisme ?"
Duroy rpondit :
"Depuis quelques mois seulement.
- Ah! vous avez march vite.
- Oui, assez vite", - et il se mit parler au hasard, sans trop songer ce quil di-
sait, dbitant toutes les banalits en usage entre gens qui ne se connaissent point.
Il se rassurait maintenant et commenait trouver la situation fort amusante. Il
regardait la gure srieuse et respectable de M. de Marelle, avec une envie de rire
sur les lvres, en pensant : "Toi, je te fais cocu, mon vieux, je te fais cocu." Et une
satisfaction intime, vicieuse, le pntrait, une joie de voleur qui a russi et quon
ne souponne pas, une joie fourbe, dlicieuse. Il avait envie, tout coup, dtre
lami de cet homme, de gagner sa conance, de lui faire raconter les choses se-
crtes de sa vie.
Mme de Marelle entra brusquement, et les ayant couverts dun coup doeil sou-
riant et impntrable, elle alla vers Duroy qui nosa point, devant le mari, lui baiser
la main, ainsi quil le faisait toujours.
Elle tait tranquille et gaie comme une personne habitue tout, qui trouvait
cette rencontre naturelle et simple, en sa rouerie native et franche. Laurine ap-
parut, et vint, plus sagement que de coutume, tendre son front Georges, la pr-
sence de son pre lintimidant. Sa mre lui dit : "Eh bien, tu ne lappelles plus
117
Bel-Ami, aujourdhui." Et lenfant rougit, comme si on venait de commettre une
grosse indiscrtion, de rvler une chose quon ne devait pas dire, de dvoiler un
secret intime et un peu coupable de son cur.
Quand les Forestier arrivrent, on fut effray de ltat de Charles. Il avait maigri
et pli affreusement en une semaine et il toussait sans cesse. Il annona dailleurs
quils partaient pour Cannes le jeudi suivant, sur lordre formel du mdecin.
Ils se retirrent de bonne heure, et Duroy dit en hochant la tte :
"Je crois quil le un bien mauvais coton. Il ne fera pas de vieux os." Mme de
Marelle afrma avec srnit : "Oh! il est perdu! En voil un qui avait eu de la
chance de trouver une femme comme la sienne."
Duroy demanda :
"Elle laide beaucoup?
- Cest--dire quelle fait tout. Elle est au courant de tout, elle connat tout le
monde sans avoir lair de voir personne ; elle obtient ce quelle veut, comme elle
veut, et quand elle veut. Oh! elle est ne, adroite et intrigante comme aucune,
celle-l. En voil un trsor pour un homme qui veut parvenir."
Georges reprit :
"Elle se remariera bien vite, sans doute ?"
Mme de Marelle rpondit : .
"Oui. Je ne serais mme pas tonne quelle et en vue quelquun... un dput...
moins que... quil ne veuille pas..., car... car... il y aurait peut-tre de gros obs-
tacles... moraux... Enn, voil. Je ne sais rien."
M. de Marelle grommela avec une lente impatience :
"Tu laisses toujours souponner un tas de choses que je naime pas. Ne nous
mlons jamais des affaires des autres. Notre conscience nous suft gouverner.
Ce devrait tre une rgle pour tout le monde. "
118
Duroy se retira, le cur troubl et lesprit plein de vagues combinaisons.
Il alla le lendemain faire une visite aux Forestier et il les trouva terminant leurs
bagages. Charles, tendu sur un canap, exagrait la fatigue de sa respiration et
rptait : "Il y a un mois que je devrais tre parti", puis il t Duroy une srie
de recommandations pour le journal, bien que tout ft rgl et convenu avec M.
Walter.
Quand Georges sen alla, il serra nergiquement les mains de son camarade :
"Eh bien, mon vieux, bientt !" Mais, comme Mme Forestier le reconduisait jus-
qu la porte, il lui dit vivement : "Vous navez pas oubli notre pacte ? Nous sommes
des amis et des allis, nest-ce pas ? Donc, si vous avez besoin de moi, en quoi que
ce soit, nhsitez point. Une dpche ou une lettre, et jobirai."
Elle murmura : "Merci, je noublierai pas." Et son oeil lui dit : "Merci", dune
faon plus profonde et plus douce.
Comme Duroy descendait lescalier, il rencontra, montant pas lents, M. de
Vaudrec, quune fois dj il avait vu chez elle. Le comte semblait triste - de ce
dpart, peut-tre ?
Voulant se montrer homme du monde, le journaliste le salua avec empresse-
ment.
Lautre rendit avec courtoisie, mais dune manire un peu re.
Le mnage Forestier partit le jeudi soir.
119
Chapitre 7
La disparition de Charles donna Duroy une importance plus grande dans
la rdaction de La Vie Franaise. Il signa quelques articles de fond, tout en si-
gnant aussi ses chos, car le patron voulait que chacun gardt la responsabilit
de sa copie. Il eut quelques polmiques dont il se tira avec esprit ; et ses relations
constantes avec les hommes dtat le prparaient peu peu devenir son tour
un rdacteur politique adroit et perspicace.
Il ne voyait quune tache dans tout son horizon. Elle venait dun petit journal
frondeur qui lattaquait constamment, ou plutt qui attaquait en lui le chef des
chos de La Vie Franaise, le chef des chos surprises de M. Walter, disait le
rdacteur anonyme de cette feuille appele : La Plume. Ctaient, chaque jour,
des perdies, des traits mordants, des insinuations de toute nature.
Jacques Rival dit un jour Duroy : "Vous tes patient."
Lautre balbutia : "Que voulez-vous, il ny a pas dattaque directe."
Or, un aprs-midi, comme il entrait dans la salle de rdaction, Boisrenard lui
tendit le numro de La Plume :
"Tenez, il y a encore une note dsagrable pour vous.
- Ah! propos de quoi ?
- Apropos de rien, de larrestationdune dame Aubert par unagent des murs."
Georges prit le journal quon lui tendait, et lut, sous ce titre : Duroy samuse.
120
"Lillustre reporter de La Vie Franaise nous apprend aujourdhui que la dame
Aubert, dont nous avons annonc larrestation par un agent de lodieuse brigade
des murs, nexiste que dans notre imagination. Or, la personne en question de-
meure 18, rue de lcureuil, Montmartre. Nous comprenons trop, dailleurs, quel
intrt ou quels intrts peuvent avoir les agents de la banque Walter soute-
nir ceux du prfet de police qui tolre leur commerce. Quant au reporter dont il
sagit, il ferait mieux de nous donner quelquune de ces bonnes nouvelles sen-
sation dont il a le secret : nouvelles de morts dmenties le lendemain, nouvelles
de batailles qui nont pas eu lieu, annonce de paroles graves prononces par des
souverains qui nont rien dit, toutes les informations enn qui constituent les "
Prots Walter", ou mme quelquune des petites indiscrtions sur des soires de
femmes succs, ou sur lexcellence de certains produits qui sont dune grande
ressource quelques-uns de nos confrres."
Le jeune homme demeurait interdit, plus quirrit, comprenant seulement quil
y avait l-dedans quelque chose de fort dsagrable pour lui.
Boisrenard reprit :
"Qui vous a donn cet cho?"
Duroy cherchait, ne se rappelant plus. Puis, tout coup, le souvenir lui revint :
"Ah! oui, cest Saint-Potin." Puis il relut lalina de La Plume, et il rougit brus-
quement, rvolt par laccusation de vnalit.
Il scria : "Comment, on prtend que je suis pay pour..."
Boisrenard linterrompit :
"Dame, oui. Cest embtant pour vous. Le patron est fort sur loeil ce sujet. a
pourrait arriver si souvent dans les chos..."
Saint-Potin, justement, entrait. Duroy courut lui :
"Vous avez vu la note de La Plume ?
- Oui, et je viens de chez la dame Aubert. Elle existe parfaitement, mais elle na
pas t arrte. Ce bruit na aucun fondement. "
121
Alors Duroy slana chez le patron quil trouva un peu froid, avec un oeil soup-
onneux. Aprs avoir cout le cas, M. Walter rpondit : "Allez vous-mme chez
cette dame et dmentez de faon quon ncrive plus de pareilles choses sur vous.
Je parle de ce qui suit. Cest fort ennuyeux pour le journal, pour moi et pour vous.
Pas plus que la femme de Csar, un journaliste ne doit tre souponn."
Duroy monta en acre avec Saint-Potin pour guide, et il cria au cocher : "18, rue
de lcureuil, Montmartre."
Ctait dans une immense maison dont il fallut escalader les six tages. Une
vieille femme encaraco de laine vint lui ouvrir : " Quest-ce que vous me rvoulez ?"
dit-elle en apercevant Saint-Potin.
Il rpondit :
"Je vous amne monsieur, qui est inspecteur de police et qui voudrait bien sa-
voir votre affaire."
Alors elle les t entrer, en racontant :
"Il en est encore rvenu deux dpuis vous pour un journal, je nsais point lquel."
Puis, se tournant vers Duroy : "Donc, cest monsieur qui dsire savoir ?
- Oui. Est-ce que vous avez t arrte par un agent des murs ?"
Elle leva les bras :
"Jamais dla vie, mon bon monsieur, jamais dla vie. Voil la chose. Jai un bou-
cher qui sert bienmais qui pse mal. Je menai aperu souvent sans riendire, mais
comme je lui demandais deux livres de ctelettes, vu que jaurais ma lle et mon
gendre, je maperois quil me pse des os de dchet, des os de ctelettes, cest
vrai, mais pas des miennes. Jaurais pu en faire du ragot, cest encore vrai, mais
quand je demande des ctelettes, cest pas pour avoir le dchet des autres. Je re-
fuse donc, alors y me traite de vieux rat, je lui rplique vieux fripon; bref, de l en
aiguille, nous nous sommes chamaills quil y avait plus de cent personnes devant
la boutique et qui riaient, qui riaient ! Tant quenn un agent fut attir et nous in-
vita nous expliquer chez le commissaire. Nous y fmes, et on nous renvoya dos
dos. Moi, depuis, je msers ailleurs, et je npasse mme pu devant la porte, pour
viter des esclandres."
122
Elle se tut. Duroy demanda :
"Cest tout ?
- Cest toute la vrit, mon cher monsieur " et, lui ayant offert un verre de cassis,
quil refusa de boire, la vieille insista pour quon parlt dans le rapport des fausses
peses du boucher.
De retour au journal, Duroy rdigea sa rponse :
"Uncrivaillonanonyme de La Plume, sentant arrach une, me cherche noise
ausujet dune vieille femme quil prtendavoir t arrte par unagent des murs,
ce que je nie. Jai vu moi-mme la dame Aubert, ge de soixante ans au moins, et
elle ma racont par le menu sa querelle avec un boucher, au sujet dune pese de
ctelettes, ce qui ncessita une explication devant le commissaire de police.
"Voil toute la vrit.
"Quant aux autres insinuations du rdacteur de La Plume, je les mprise. On
ne rpond pas, dailleurs, de pareilles choses, quand elles sont crites sous le
masque.
"GEORGES DUROY."
M. Walter et Jacques Rival, qui venait darriver, trouvrent cette note sufsante,
et il fut dcid quelle passerait le jour mme, la suite des chos.
Duroy rentra tt chez lui, unpeuagit, onpeuinquiet. Quallait rpondre lautre ?
Qui tait-il ? Pourquoi cette attaque brutale ? Avec les murs brusques des jour-
nalistes, cette btise pouvait aller loin, trs loin. Il dormit mal.
Quand il relut sa note dans le journal, le lendemain, il la trouva plus agressive
imprime que manuscrite. Il aurait pu, lui semblait-il, attnuer certains termes.
Il fut vreux tout le jour et il dormit mal encore la nuit suivante. Il se leva ds
laurore pour chercher le numro de La Plume qui devait rpondre sa rplique.
Le temps stait remis au froid; il gelait dur. Les ruisseaux, saisis comme ils cou-
laient encore, droulaient le long des trottoirs deux rubans de glace.
123
Les journaux ntaient point arrivs chez les marchands, et Duroy se rappela le
jour de son premier article : Les Souvenirs dun chasseur dAfrique. Ses mains et
ses pieds sengourdissaient, devenaient douloureux, au bout des doigts surtout ;
et il se mit courir en rond autour du kiosque vitr, o la vendeuse, accroupie sur
sa chaufferette, ne laissait voir, par la petite fentre, quun nez et des joues rouges
dans un capuchon de laine.
Enn le distributeur de feuilles publiques passa le paquet attendu par louver-
ture du carreau, et la bonne femme tendit Duroy La Plume grande ouverte. Il
chercha son nom dun coup doeil et ne vit rien dabord. Il respirait dj, quand il
aperut la chose entre deux tirets :
"Le sieur Duroy, de La Vie Franaise, nous donne un dmenti ; et, en nous d-
mentant, il ment. Il avoue cependant quil existe une femme Aubert, et quun
agent la conduite la police. Il ne reste donc qu ajouter deux mots : "des murs
" aprs le mot " agent " et cest dit.
"Mais la conscience de certains journalistes est au niveau de leur talent.
"Et je signe : LOUIS LANGREMONT."
Alors le cur de Georges se mit battre violemment, et il rentra chez lui pour
shabiller, sans trop savoir ce quil faisait. Donc, on lavait insult, et dune telle
faon quaucune hsitation ntait possible. Pourquoi ? Pour rien. A propos dune
vieille femme qui stait querelle avec son boucher.
Il shabilla bien vite et se rendit chez M. Walter, quoiquil ft peine huit heures
du matin.
M. Walter, dj lev, lisait La Plume.
"Eh bien, dit-il avec un visage grave, en apercevant Duroy, vous ne pouvez pas
reculer ?"
Le jeune homme ne rpondit rien. Le directeur reprit :
"Allez tout de suite trouver Rival qui se chargera de vos intrts."
124
Duroy balbutia quelques mots vagues et sortit pour se rendre chez le chro-
niqueur, qui dormait encore. Il sauta du lit, au coup de sonnette, puis ayant lu
lcho : "Bigre, il faut y aller. Qui voyez-vous comme autre tmoin?
- Mais, je ne sais pas, moi.
- Boisrenard? - Quen pensez-vous ?
- Oui, Boisrenard.
- tes-vous fort aux armes ?
- Pas du tout.
- Ah! diable ! Et au pistolet ?
- Je tire un peu.
- Bon. Vous allez vous exercer pendant que je moccuperai de tout. Attendez-
moi une minute."
Il passa dans son cabinet de toilette et reparut bientt, lav, ras, correct.
"Venez avec moi", dit-il.
Il habitait au rez-de-chausse dun petit htel, et il t descendre Duroy dans la
cave, une cave norme, convertie en salle darmes et en tir, toutes les ouvertures
sur la rue tant bouches.
Aprs avoir allum une ligne de becs de gaz conduisant jusquau fond dun se-
cond caveau, o se dressait un homme de fer peint en rouge et en bleu, il posa sur
une table deux paires de pistolets dun systme nouveau chargeant par la culasse,
et il commena les commandements dune voix brve comme si on et t sur le
terrain.
Prt ?
Feu! - un, deux, trois.
125
Duroy, ananti, obissait, levait les bras, visait, tirait, et comme il atteignait sou-
vent le mannequin en plein ventre, car il stait beaucoup servi dans sa premire
jeunesse dun vieux pistolet daron de son pre pour tuer des oiseaux dans la
cour, Jacques Rival, satisfait, dclarait : "Bien - trs bien " - trs bien - vous irez -
vous irez."
Puis il le quitta :
"Tirez comme a jusqu midi. Voil des munitions, nayez pas peur de les br-
ler. Je viendrai vous prendre pour djeuner et vous donner des nouvelles."
Et il sortit.
Rest seul, Duroy tira encore quelques coups, puis il sassit et se mit rchir.
Comme ctait bte tout de mme, ces choses-l. Quest-ce que a prouvait ? Un
lou tait-il moins un lou aprs stre battu? Que gagnait un honnte homme
insult risquer sa vie contre une crapule ? Et son esprit vagabondant dans le noir
se rappela les choses dites par Norbert de Varenne sur la pauvret desprit des
hommes, la mdiocrit de leurs ides et de leurs proccupations, la niaiserie de
leur morale !
Et il dclara tout haut : "Comme il a raison, sacristi !"
Puis il sentit quil avait soif, et ayant entendu un bruit de gouttes deau derrire
lui, il aperut un appareil douches et il alla boire au bout de la lance. Puis il se
remit songer. Il faisait triste dans cette cave, triste comme dans un tombeau. Le
roulement lointain et sourd des voitures semblait un tremblement dorage loi-
gn. Quelle heure pouvait-il tre ? Les heures passaient l-dedans comme elles de-
vaient passer au fond des prisons, sans que rienles indique et que rienles marque,
sauf les retours du gelier portant les plats. Il attendit, longtemps, longtemps.
Puis tout dun coup il entendit des pas, des voix, et Jacques Rival reparut, ac-
compagn de Boisrenard. Il cria ds quil aperut Duroy : "Cest arrang !"
Lautre crut laffaire termine par quelque lettre dexcuses ; son cur bondit, et
il balbutia :
"Ah!... merci."
126
Le chroniqueur reprit :
"Ce Langremont est trs carr, il a accept toutes nos conditions. Vingt-cinq
pas, une balle au commandement en levant le pistolet. On a le bras beaucoup
plus sr ainsi quen labaissant. Tenez, Boisrenard, voyez ce que je vous disais."
Et prenant des armes il se mit tirer en dmontrant comment on conservait
bien mieux la ligne en levant le bras.
Puis il dit :
"Maintenant, allons djeuner, il est midi pass."
Et ils se rendirent dans un restaurant voisin. Duroy ne parlait plus gure. Il man-
gea pour navoir pas lair davoir peur, puis dans le jour il accompagna Boisre-
nard au journal et il t sa besogne dune faon distraite et machinale. On le trouva
crne.
Jacques Rival vint lui serrer la mainvers le milieude laprs-midi ; et il fut convenu
que ses tmoins le prendraient chez lui en landau, le lendemain sept heures du
matin, pour se rendre au bois du Vsinet o la rencontre aurait lieu.
Tout cela stait fait inopinment, sans quil y prt part, sans quil dt un mot,
sans quil donnt son avis, sans quil acceptt ou refust, et avec tant de rapidit
quil demeurait tourdi, effar, sans trop comprendre ce qui se passait.
Il se retrouva chez lui vers neuf heures du soir aprs avoir dn chez Boisrenard,
qui ne lavait point quitt de tout le jour par dvouement.
Ds quil fut seul, il marcha pendant quelques minutes, grands pas vifs, tra-
vers sa chambre. Il tait trop troubl pour rchir rien. Une seule ide emplis-
sait son esprit : - Un duel demain, - sans que cette ide veillt en lui autre chose
quune motion confuse et puissante. Il avait t soldat, il avait tir sur des Arabes,
sans grand danger pour lui, dailleurs, un peu comme on tire sur un sanglier, la
chasse.
En somme, il avait fait ce quil devait faire. Il stait montr ce quil devait tre.
On en parlerait, on lapprouverait, on le fliciterait. Puis il pronona haute voix,
comme on parle dans les grandes secousses de pense :
127
"Quelle brute que cet homme !"
Il sassit et se mit rchir. Il avait jet sur sa petite table une carte de son
adversaire remise par Rival, an de garder son adresse. Il la relut comme il lavait
dj lue vingt fois dans la journe. Louis Langremont, 176, rue Montmartre. Rien
de plus.
Il examinait ces lettres assembles qui lui paraissaient mystrieuses, pleines
de sens inquitants. "Louis Langremont", qui tait cet homme ? De quel ge ? De
quelle taille ? De quelle gure ? Ntait-ce pas rvoltant quuntranger, uninconnu,
vnt ainsi troubler notre vie, tout dun coup, sans raison, par pur caprice, propos
dune vieille femme qui stait querelle avec son boucher ?
Il rpta encore une fois, haute voix : "Quelle brute ! "
Et il demeura immobile, songeant, le regard toujours plant sur la carte. Une
colre sveillait en lui contre ce morceau de papier, une colre haineuse o se
mlait une trange sentiment de malaise. Ctait stupide, cette histoire-l ! Il prit
une paire de ciseaux ongles qui tranaient et il les piqua au milieu du nom im-
prim comme sil et poignard quelquun.
Donc il allait se battre, et se battre au pistolet ? Pourquoi navait-il pas choisi
lpe ! Il en aurait t quitte pour une piqre au bras ou la main, tandis quavec
le pistolet on ne savait jamais les suites possibles.
Il dit : "Allons, il faut tre crne."
Le son de sa voix le t tressaillir, et il regarda autour de lui. Il commenait se
sentir fort nerveux. Il but un verre deau, puis se coucha.
Ds quil fut au lit, il soufa sa lumire et ferma les yeux.
Il avait trs chaud dans ses draps, bien quil t trs froid dans sa chambre, mais
il ne pouvait parvenir sassoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait cinq
minutes sur le dos, puis se plaait sur le ct gauche, puis se roulait sur le ct
droit.
Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquitude le saisit : "Est-ce
que jaurais peur ?"
128
Pourquoi son cur se mettait-il battre follement chaque bruit connu de sa
chambre ? Quand son coucou allait sonner, le petit grincement du ressort lui fai-
sait faire unsursaut ; et il lui fallait ouvrir la bouche pour respirer pendant quelques
secondes, tant il demeurait oppress.
Il se mit raisonner en philosophe sur la possibilit de cette chose : "Aurais-je
peur ?"
Non certes il naurait pas peur puisquil tait rsolu aller jusquau bout, puis-
quil avait cette volont bien arrte de se battre, de ne pas trembler. Mais il se
sentait si profondment mu quil se demanda : "Peut-on avoir peur malgr soi ?"
Et ce doute lenvahit, cette inquitude, cette pouvante ! Si une force plus puis-
sante que sa volont, dominatrice, irrsistible, le domptait, quarriverait-il ? Oui,
que pouvait-il arriver ?
Certes il irait sur le terrain puisquil voulait y aller. Mais sil tremblait ? Mais sil
perdait connaissance ? Et il songea sa situation, sa rputation, son avenir.
Et un singulier besoin le prit tout coup de se relever pour se regarder dans la
glace. Il ralluma sa bougie. Quand il aperut son visage ret dans le verre poli, il
se reconnut peine, et il lui sembla quil ne stait jamais vu. Ses yeux lui parurent
normes ; et il tait ple, certes, il tait ple, trs ple.
Tout dun coup, cette pense entra en lui la faon dune balle : "Demain,
cette heure-ci, je serai peut-tre mort." Et soncur se remit battre furieusement.
Il se retourna vers sa couche et il se vit distinctement tendu sur le dos dans
ces mmes draps quil venait de quitter. Il avait ce visage creux quont les morts et
cette blancheur des mains qui ne remueront plus.
Alors il eut peur de son lit, et an de ne plus le voir il ouvrit la fentre pour
regarder dehors.
Un froid glacial lui mordit la chair de la tte aux pieds, et il se recula, haletant.
La pense lui vint de faire du feu. Il lattisa lentement sans se retourner. Ses
mains tremblaient un peu dun frmissement nerveux quand elles touchaient les
objets. Sa tte sgarait ; ses penses tournoyantes, haches, devenaient fuyantes,
douloureuses ; une ivresse envahissait son esprit comme sil et bu.
129
Et sans cesse il se demandait : "Que vais-je faire ? que vais-je devenir ?"
Il se remit marcher, rptant, dune faon continue, machinale : "Il faut que je
sois nergique, trs nergique."
Puis il se dit : "Je vais crire mes parents, en cas daccident."
Il sassit de nouveau, prit un cahier de papier lettres, traa : "Mon cher papa,
ma chre maman..."
Puis il jugea ces termes trop familiers dans une circonstance aussi tragique. Il
dchira la premire feuille, et recommena : "Mon cher pre, ma chre mre ; je
vais me battre au point du jour, et comme il peut arriver que..."
Il nosa pas crire le reste et se releva dune secousse.
Cette pense lcrasait maintenant." Il allait se battre en duel. Il ne pouvait plus
viter cela. Que se passait-il donc en lui ? Il voulait se battre ; il avait cette intention
et cette rsolution fermement arrtes ; et il lui semblait, malgr tout leffort de
sa volont, quil ne pourrait mme pas conserver la force ncessaire pour aller
jusquau lieu de la rencontre."
De temps en temps ses dents sentrechoquaient dans sa bouche avec un petit
bruit sec ; et il demandait :
"Mon adversaire sest-il dj battu? a-t-il frquent les tirs ? est-il connu? est-il
class ?" Il navait jamais entendu prononcer ce nom. Et cependant si cet homme
ntait pas un tireur au pistolet remarquable, il naurait point accept ainsi, sans
hsitation, sans discussion, cette arme dangereuse.
Alors Duroy se gurait leur rencontre, son attitude lui et la tenue de son en-
nemi. Il se fatiguait la pense imaginer les moindres dtails du combat ; et tout
coup il voyait en face de lui ce petit trou noir et profond du canon dont allait sortir
une balle.
Et il fut pris brusquement dune crise de dsespoir pouvantable. Tout soncorps
vibrait, parcouru de tressaillements saccads. Il serrait les dents pour ne pas crier,
avec un besoin fou de se rouler par terre, de dchirer quelque chose, de mordre.
130
Mais il aperut un verre sur sa chemine et il se rappela quil possdait dans son
armoire un litre deau-de-vie presque plein; car il avait conserv lhabitude mili-
taire de tuer le ver chaque matin.
Il saisit la bouteille et but, mme le goulot, longues gorges, avec avidit. Et
il la reposa seulement lorsque le soufe lui manqua. Elle tait vide dun tiers.
Une chaleur pareille une amme lui brla bientt lestomac, se rpandit dans
ses membres, raffermit son me en ltourdissant.
Il se dit : "Je tiens le moyen." Et comme il se sentait maintenant la peaubrlante,
il rouvrit la fentre.
Le jour naissait, calme et glacial. L-haut, les toiles semblaient mourir au fond
du rmament clairci, et dans la tranche profonde du chemin de fer les signaux
verts, rouges et blancs plissaient.
Les premires locomotives sortaient du garage et sen venaient en sifant cher-
cher les premiers trains. Dautres, dans le lointain, jetaient des appels aigus et r-
pts, leurs cris de rveil, comme font les coqs dans les champs.
Duroy pensait : "Je ne verrai peut-tre plus tout a." Mais comme il sentit quil
allait de nouveau sattendrir sur lui-mme, il ragit violemment : "Allons, il ne faut
songer rien jusquau moment de la rencontre, cest le seul moyen dtre crne."
Et il se mit sa toilette. Il eut encore, en se rasant, une seconde de dfaillance
en songeant que ctait peut-tre la dernire fois quil regardait son visage.
Il but une nouvelle gorge deau-de-vie, et acheva de shabiller.
Lheure qui suivit fut difcile passer. Il marchait de long en large en seffor-
ant en effet dimmobiliser son me. Lorsquil entendit frapper sa porte, il faillit
sabattre sur le dos, tant la commotion fut violente. Ctaient ses tmoins.
"Dj !"
Ils taient envelopps de fourrures. Rival dclara, aprs avoir serr la main de
son client :
131
"Il fait un froid de Sibrie." Puis il demanda : "a va bien?
- Oui, trs bien.
- On est calme ?
- Trs calme.
- Allons, a ira. Avez-vous bu et mang quelque chose ?
- Oui, je nai besoin de rien."
Boisrenard, pour la circonstance, portait une dcorationtrangre, verte et jaune,
que Duroy ne lui avait jamais vue.
Ils descendirent. Un monsieur les attendait dans le landau. Rival nomma : "Le
docteur Le Brument." Duroy lui serra la main en balbutiant : "Je vous remercie",
puis il voulut prendre place sur la banquette du devant et il sassit sur quelque
chose de dur qui le t relever comme si un ressort let redress. Ctait la bote
aux pistolets.
Rival rptait : "Non! Au fond le combattant et le mdecin, au fond!" Duroy nit
par comprendre et il saffaissa ct du docteur.
Les deux tmoins montrent leur tour et le cocher partit. Il savait o on devait
aller.
Mais la bote aux pistolets gnait tout le monde, surtout Duroy, qui et prfr
ne pas la voir. On essaya de la placer derrire le dos ; elle cassait les reins ; puis on
la mit debout entre Rival et Boisrenard; elle tombait tout le temps. On nit par la
glisser sous les pieds.
La conversation languissait, bien que le mdecin racontt des anecdotes. Rival
seul rpondait. Duroy et voulu prouver de la prsence desprit, mais il avait peur
de perdre le l de ses ides, de montrer le trouble de son me ; et il tait hant par
la crainte torturante de se mettre trembler.
132
La voiture fut bientt en pleine campagne. Il tait neuf heures environ. Ctait
une de ces rudes matines dhiver o toute la nature est luisante, cassante et dure
comme du cristal. Les arbres, vtus de givre, semblent avoir su de la glace ; la
terre sonne sous les pas ; lair sec porte au loin les moindres bruits : le ciel bleu
parat brillant la faon des miroirs et le soleil passe dans. lespace, clatant et
froid lui-mme, jetant sur la cration gele des rayons qui nchauffent rien.
Rival disait Duroy :
"Jai pris les pistolets chez Gastine-Renette. Il les a chargs lui-mme. La bote
est cachete. On les tirera au sort, dailleurs, avec ceux de notre adversaire."
Duroy rpondit machinalement :
"Je vous remercie."
Alors Rival lui t des recommandations minutieuses, car il tenait ce que son
client ne commt aucune erreur. Il insistait sur chaque point plusieurs fois : "Quand
on demandera : "tes-vous prts, messieurs ?" vous rpondrez dune voix forte :
"Oui !" Quand on commandera "Feu!" vous lverez vivement le bras, et vous ti-
rerez avant quon ait prononc trois."
Et Duroy se rptait mentalement : "Quand on commandera feu, jlverai le
bras, - quand on commandera feu, jlverai le bras, - quand on commandera feu,
jlverai le bras."
Il apprenait cela comme les enfants apprennent leurs leons, en le murmurant
satit pour se le bien graver dans la tte. "Quand on commandera feu, jlverai
le bras."
Le landau entra sous un bois, tourna droite dans une avenue, puis encore
droite. Rival, brusquement, ouvrit la portire pour crier au cocher : "L, par ce
petit chemin." Et la voiture sengagea dans une route ornires entre deux taillis
o tremblotaient des feuilles mortes bordes dun lisr de glace.
Duroy marmottait toujours :
133
"Quand on commandera feu, jlverai le bras." Et il pensa quun accident de
voiture arrangerait tout. Oh! si on pouvait verser, quelle chance ! sil pouvait se
casser une jambe !..."
Mais il aperut au bout dune clairire une autre voiture arrte et quatre mes-
sieurs qui pitinaient pour schauffer les pieds ; et il fut oblig douvrir la bouche
tant sa respiration devenait pnible.
Les tmoins descendirent dabord, puis le mdecin et le combattant. Rival avait
pris la bote aux pistolets et il sen alla avec Boisrenard vers deux des trangers
qui venaient eux. Duroy les vit se saluer avec crmonie puis marcher ensemble
dans la clairire en regardant tantt par terre et tantt dans les arbres, comme sils
avaient cherch quelque chose qui aurait pu tomber ou senvoler. Puis ils com-
ptrent des pas et enfoncrent avec grand-peine deux cannes dans le sol gel. Ils
se runirent ensuite en groupe et ils rent les mouvements du jeu de pile ou face,
comme des enfants qui samusent.
Le docteur Le Brument demandait Duroy :
"Vous vous sentez bien? Vous navez besoin de rien?
- Non, de rien, merci."
Il lui semblait quil tait fou, quil dormait, quil rvait, que quelque chose de
surnaturel tait survenu qui lenveloppait.
Avait-il peur ? Peut-tre ? Mais il ne savait pas. Tout tait chang autour de lui.
Jacques Rival revint et lui annona tout bas avec satisfaction :
"Tout est prt. La chance nous a favoriss pour les pistolets. "
Voil une chose qui tait indiffrente Duroy.
On lui ta son pardessus. Il se laissa faire. On tta les poches de sa redingote
pour sassurer quil ne portait point de papiers ni de portefeuille protecteur.
Il rptait en lui-mme, comme une prire : "Quand on commandera feu, jl-
verai le bras."
134
Puis on lamena jusqu une des cannes piques en terre et on lui remit son pis-
tolet. Alors il aperut un homme debout, en face de lui, tout prs, un petit homme
ventru, chauve, qui portait des lunettes. Ctait son adversaire.
Il le vit trs bien, mais il ne pensait rien qu ceci : " Quand on commandera
feu, jlverai le bras et je tirerai. " Une voix rsonna dans le grand silence de les-
pace, une voix qui semblait venir de trs loin, et elle demanda :
"tes-vous prts, messieurs ?"
Georges cria :
"Oui."
Alors la mme voix ordonna :
"Feu!"
Il ncouta rien de plus, il ne saperut de rien, il ne se rendit compte de rien, il
sentit seulement quil levait le bras en appuyant de toute sa force sur la gchette.
Et il nentendit rien.
Mais il vit aussitt unpeu de fume au bout du canonde sonpistolet ; et comme
lhomme en face de lui demeurait toujours debout, dans la mme posture gale-
ment, il aperut aussi unautre petit nuage blanc qui senvolait au-dessus de la tte
de son adversaire.
Ils avaient tir tous les deux. Ctait ni.
Ses tmoins et le mdecin le touchaient, le palpaient, dboutonnaient ses vte-
ments en demandant avec anxit :
"Vous ntes pas bless ?" Il rpondit au hasard .
"Non, je ne crois pas."
135
Langremont dailleurs demeurait aussi intact que son ennemi, et Jacques Rival
murmura dun ton mcontent :
"Avec ce sacr pistolet, cest toujours comme a, on se rate ou on se tue. Quel
sale instrument !"
Duroy ne bougeait point, paralys de surprise et de joie : " Ctait ni !" Il fal-
lut lui enlever son arme quil tenait toujours serre dans sa main. Il lui semblait
maintenant quil se serait battu contre lunivers entier. Ctait ni. Quel bonheur !
il se sentait brave tout coup provoquer nimporte qui.
Tous les tmoins causrent quelques minutes, prenant rendez-vous dans le jour
pour la rdaction du procs-verbal, puis on remonta dans la voiture, et le cocher,
qui riait sur son sige, repartit en faisant claquer son fouet.
Ils djeunrent tous les quatre sur le boulevard, en causant de lvnement. Du-
roy disait ses impressions.
"a ne ma rien fait, absolument rien. Vous avez d le voir du reste ?"
Rival rpondit :
"Oui, vous vous tes bien tenu."
Quand le procs-verbal fut rdig, on le prsenta Duroy qui devait linsrer
dans les chos. Il stonna de voir quil avait chang deux balles avec M. Louis
Langremont, et, un peu inquiet, il interrogea Rival :
"Mais nous navons tir quune balle."
Lautre sourit :
"Oui, une balle... une balle chacun... a fait deux balles."
Et Duroy, trouvant lexplication satisfaisante, ninsista pas. Le pre Walter lem-
brassa :
"Bravo, bravo, vous avez dfendu le drapeau de La Vie Franaise, bravo!"
136
Georges se montra, le soir, dans les principaux grands journaux et dans les prin-
cipaux grands cafs du boulevard. Il rencontra deux fois son adversaire qui se
montrait galement.
Ils ne se salurent pas. Si lun des deux avait t bless, ils se seraient serr les
mains. Chacun jurait dailleurs avec conviction avoir entendu sifer la balle de
lautre.
Le lendemain, vers onze heures du matin, Duroy reut un petit bleu : " Mon
Dieu, que jai eupeur ! Viens donc tantt rue de Constantinople, que je tembrasse,
mon amour. Comme tu es brave - je tadore. - Clo."
Il alla au rendez-vous et elle slana dans ses bras, le couvrant de baisers :
"Oh! mon chri, si tu savais mon motion quand jai lu les journaux ce matin.
Oh! raconte-moi. Dis-moi tout. Je veux savoir."
Il dut raconter les dtails avec minutie. Elle demandait :
"Comme tu as d avoir une mauvaise nuit avant le duel !
- Mais non. Jai bien dormi.
- Moi, je naurais pas ferm loeil. Et sur le terrain, dis-moi comment a sest
pass."
Il t un rcit dramatique :
"Lorsque nous fmes en face lun de lautre, vingt pas, quatre fois seulement
la longueur de cette chambre, Jacques, aprs avoir demand si nous tions prts,
commanda : "Feu." Jai lev mon bras immdiatement, bien en ligne, mais jai
eu le tort de vouloir viser la tte. Javais une arme fort dure et je suis accoutum
des pistolets bien doux, de sorte que la rsistance de la gchette a relev le coup.
Nimporte, a na pas d passer loin. Lui aussi il tire bien, le gredin. Sa balle ma
efeur la tempe. Jen ai senti le vent."
Elle tait assise sur ses genoux et le tenait dans ses bras comme pour prendre
part son danger. Elle balbutiait : "Oh! mon pauvre chri, mon pauvre chri..."
137
Puis, quand il eut ni de conter, elle lui dit :
"Tu ne sais pas, je ne peux plus me passer de toi ! Il faut que je te voie, et, avec
mon mari Paris, a nest pas commode. Souvent, jaurais une heure le matin,
avant que tu sois lev, et je pourrais aller tembrasser, mais je ne veux pas rentrer
dans ton affreuse maison. Comment faire ?"
Il eut brusquement une inspiration et demanda :
"Combien paies-tu ici ?
- Cent francs par mois.
- Eh bien, je prends lappartement mon compte et je vais lhabiter tout fait.
Le mien nest plus sufsant dans ma nouvelle position."
Elle rchit quelques instants, puis rpondit :
"Non. Je ne veux pas."
Il stonna :
"Pourquoi a ?
- Parce que...
- Ce nest pas une raison. Ce logement me convient trs bien. Jy suis. Jy reste."
Il se mit rire :
"Dailleurs, il est mon nom."
Mais elle refusait toujours :
"Non, non, je ne veux pas...
- Pourquoi a, enn?"
138
Alors elle chuchota tout bas, tendrement : "Parce que tuy amnerais des femmes,
et je ne veux pas."
Il sindigna :
"Jamais de la vie, par exemple. Je te le promets.
- Non, tu en amnerais tout de mme.
- Je te le jure.
- Bien vrai ?
- Bien vrai. Parole dhonneur. Cest notre maison, a, rien qu nous."
Elle ltreignit dans un lan damour :
"Alors je veux bien, mon chri. Mais tu sais, si tu me trompes une fois, rien
quune fois, ce sera ni entre nous, ni pour toujours."
Il jura encore avec des protestations, et il fut convenu quil sinstallerait le jour
mme, an quelle pt le voir quand elle passerait devant la porte.
Puis elle lui dit :
"En tout cas, viens dner dimanche. Mon mari te trouve charmant."
Il fut att :
"Ah! vraiment ?...
- Oui, tu as fait sa conqute. Et puis coute, tu mas dit que tu avais t lev
dans un chteau la campagne, nest-ce pas ?
- Oui, pourquoi ?
- Alors tu dois connatre un peu la culture ?
139
- Oui.
- Eh bien, parle-lui de jardinage et de rcoltes, il aime beaucoup a.
- Bon. Je noublierai pas."
Elle le quitta, aprs lavoir indniment embrass, ce duel ayant exaspr sa
tendresse.
Et Duroy pensait, ense rendant aujournal : "Quel drle dtre a fait ! Quelle tte
doiseau! Sait-on ce quelle veut et ce quelle aime ? Et quel drle de mnage ! Quel
fantaisiste a bien pu prparer laccouplement de ce vieux et de cette cervele ?
Quel raisonnement a dcid cet inspecteur pouser cette tudiante ? Mystre !
Qui sait ? Lamour, peut-tre ?"
Puis il conclut : "Enn, cest une bien gentille matresse. Je serais rudement bte
de la lcher."
140
Chapitre 8
Son duel avait fait passer Duroy au nombre des chroniqueurs de tte de La Vie
Franaise ; mais, comme il prouvait une peine innie dcouvrir des ides, il
prit la spcialit des dclamations sur la dcadence des murs, sur labaissement
des caractres, laffaissement du patriotisme et lanmie de lhonneur franais. (
Il avait trouv le mot " anmie " dont il tait er. )
Et quand Mme de Marelle, pleine de cet esprit gouailleur, sceptique et gobeur
quon appelle lesprit de Paris, se moquait de ses tirades quelle crevait dune pi-
gramme, il rpondait en souriant : "Bah! a me fait une bonne rputation pour
plus tard."
Il habitait maintenant rue de Constantinople, o il avait transport sa malle, sa
brosse, son rasoir et son savon, ce qui constituait son dmnagement. Deux ou
trois fois par semaine, la jeune femme arrivait avant quil ft lev, se dshabillait
en une minute et se glissait dans le lit, toute frmissante du froid du dehors.
Duroy, par contre, dnait tous les jeudis dans le mnage et faisait la cour au mari
en lui parlant agriculture ; et comme il aimait lui-mme les choses de la terre, ils
sintressaient parfois tellement tous les deux la causerie quils oubliaient tout
fait leur femme sommeillant sur le canap.
Laurine aussi sendormait, tantt sur les genoux de son pre, tantt sur les ge-
noux de Bel-Ami.
Et quand le journaliste tait parti, M. de Marelle ne manquait point de dclarer
avec ce tondoctrinaire dont il disait les moindres choses : " Ce garonest vraiment
fort agrable. Il a lesprit trs cultiv."
Fvrier touchait sa n. On commenait sentir la violette dans les rues en
passant le matin auprs des voitures tranes par les marchandes de eurs.
141
Duroy vivait sans un nuage dans son ciel.
Or, une nuit, comme il rentrait, il trouva une lettre glisse sous sa porte. Il re-
garda le timbre et il vit " Cannes ". Layant ouverte, il lut :
Cannes, villa Jolie.
"Cher monsieur et ami, vous mavez dit, nest-ce pas, que je pouvais compter
sur vous en tout ? Eh bien, jai vous demander un cruel service, cest de venir
massister, de ne pas me laisser seule aux derniers moments de Charles qui va
mourir. Il ne passera peut-tre pas la semaine, bien quil se lve encore, mais le
mdecin ma prvenue.
"Je nai plus la force ni le courage de voir cette agonie jour et nuit. Et je songe
avec terreur aux derniers moments qui approchent. Je ne puis demander une pa-
reille chose qu vous, car mon mari na plus de famille. Vous tiez son camarade ;
il vous a ouvert la porte du journal. Venez, je vous en supplie. Je nai personne
appeler.
"Croyez-moi votre camarade toute dvoue.
"MADELEINE FORESTIER."
Un singulier sentiment entra comme un soufe dair au cur de Georges, un
sentiment de dlivrance, despace qui souvrait devant lui, et il murmura : "Certes,
jirai. Ce pauvre Charles ! Ce que cest que de nous, tout de mme !"
Le patron, qui il communiqua la lettre de la jeune femme, donna en grognant
son autorisation. Il rptait :
"Mais revenez vite, vous nous tes indispensable."
Georges Duroy partit pour Cannes le lendemain par le rapide de sept heures,
aprs avoir prvenu le mnage de Marelle par un tlgramme.
Il arriva, le jour suivant, vers quatre heures du soir.
Un commissionnaire le guida vers la villa Jolie, btie mi-cte, dans cette fort
de sapins peuple de maisons blanches, qui va du Cannet au golfe Juan.
142
La maison tait petite, basse, de style italien, au bord de la route qui monte en
zigzag travers les arbres, montrant chaque dtour dadmirables points de vue.
Le domestique ouvrit la porte et scria :
"Oh! monsieur, madame vous attend avec bien de limpatience."
Duroy demanda :
"Comment va votre matre ?
- Oh! pas bien, monsieur. Il nen a pas pour longtemps."
Le salon o le jeune homme entra tait tendu de perse rose dessins bleus. La
fentre, large et haute, donnait sur la ville et sur la mer.
Duroy murmurait : "Bigre, cest chic ici comme maison de campagne. O diable
prennent-ils tout cet argent-l ?"
Un bruit de robe le t se retourner.
Mme Forestier lui tendait les deux mains : "Comme vous tes gentil, comme
cest gentil dtre venu!" Et brusquement elle lembrassa. Puis ils se regardrent.
Elle tait un peu plie, un peu maigrie, mais toujours frache, et peut-tre plus
jolie encore avec son air plus dlicat. Elle murmura :
"Il est terrible, voyez-vous, il se sait perdu et il me tyrannise atrocement. Je lui
ai annonc votre arrive. Mais o est votre malle ? "
Duroy rpondit :
"Je lai laisse aucheminde fer, ne sachant pas dans quel htel vous me conseille-
riez de descendre pour tre prs de vous."
Elle hsita, puis reprit :
143
"Vous descendrez ici, dans la villa. Votre chambre est prte, du reste. Il peut
mourir dun moment lautre, et si cela arrivait la nuit, je serais seule. Jenverrai
chercher votre bagage."
Il sinclina :
"Comme vous voudrez.
- Maintenant, montons", dit-elle,
Il la suivit. Elle ouvrit une porte aupremier tage, et Duroy aperut auprs dune
fentre, assis dans un fauteuil et enroul dans des couvertures, livide sous la clart
rouge dusoleil couchant, une espce de cadavre qui le regardait. Il le reconnaissait
peine ; il devina plutt que ctait son ami.
Onsentait dans cette chambre la vre, la tisane, lther, le goudron, cette odeur
innommable et lourde des appartements o respire un poitrinaire.
Forestier souleva sa main dun geste pnible et lent.
"Te voil, dit-il, tu viens me voir mourir. Je te remercie."
Duroy affecta de rire : "Te voir mourir ! ce ne serait pas un spectacle amusant, et
je ne choisirais point cette occasion-l pour visiter Cannes. Je viens te dire bonjour
et me reposer un peu."
Lautre murmura : "Assieds-toi", et il baissa la tte comme enfonc en des m-
ditations dsespres.
Il respirait dune faon rapide, essoufe, et parfois poussait une sorte de g-
missement, comme sil et voulu rappeler aux autres combien il tait malade.
Voyant quil ne parlait point, sa femme vint sappuyer la fentre et elle dit en
montrant lhorizon dun coup de tte : " Regardez cela ! Est-ce beau?"
144
En face deux, la cte seme de villas descendait jusqu la ville qui tait cou-
che le long du rivage en demi-cercle, avec sa tte droite vers la jete que domi-
nait la vieille cit surmonte dun vieux beffroi, et ses pieds gauche la pointe
de la Croisette, en face des les de Lrins. Elles avaient lair, ces les, de deux taches
vertes, dans leau toute bleue. On et dit quelles ottaient comme deux feuilles
immenses, tant elles semblaient plates de l-haut.
Et, tout au loin, fermant lhorizon de lautre ct du golfe, au-dessus de la jete
et du beffroi, une longue suite de montagnes bleutres dessinait sur un ciel cla-
tant une ligne bizarre et charmante de sommets tantt arrondis, tantt crochus,
tantt pointus, et qui nissait par un grand mont en pyramide plongeant son pied
dans la pleine mer.
Mme Forestier lindiqua : "Cest lEstrel."
Lespace derrire les cimes sombres tait rouge, dun rouge sanglant et dor que
loeil ne pouvait soutenir.
Duroy subissait malgr lui la majest de cette n du jour.
Il murmura, ne trouvant point dautre terme assez imag pour exprimer son
admiration :
"Oh! oui, cest patant, a !"
Forestier releva la tte vers sa femme et demanda :
"Donne-moi un peu dair."
Elle rpondit :
"Prends garde, il est tard, le soleil se couche, tu vas encore attraper froid, et tu
sais que a ne te vaut rien dans ton tat de sant. "
Il t de la main droite un geste fbrile et faible qui aurait voulu tre un coup
de poing et il murmura avec une grimace de colre, une grimace de mourant qui
montrait la minceur des lvres, la maigreur des joues et la saillie de tous les os :
145
"Je te dis que jtouffe. Quest-ce que a te fait que je meure un jour plus tt ou
un jour plus tard, puisque je suis foutu..."
Elle ouvrit toute grande la fentre.
Le soufe qui entra les surprit tous les trois comme une caresse. Ctait une
brise molle, tide, paisible, une brise de printemps nourrie dj par les parfums
des arbustes et des eurs capiteuses qui poussent sur cette cte. On y distinguait
un got puissant de rsine et lcre saveur des eucalyptus.
Forestier la buvait dune haleine courte et vreuse. Il crispa les ongles de ses
mains sur les bras de son fauteuil, et dit dune voix basse, sifante, rageuse :
"Ferme la fentre. Cela me fait mal. Jaimerais mieux crever dans une cave."
Et sa femme ferma la fentre lentement, puis elle regarda au loin, le front contre
la vitre.
Duroy, mal laise, aurait voulu causer avec le malade, le rassurer.
Mais il nimaginait rien de propre le rconforter.
Il balbutia :
"Alors a ne va pas mieux depuis que tu es ici ?"
Lautre haussa les paules avec une impatience accable : "Tu le vois bien." Et il
baissa de nouveau la tte.
Duroy reprit :
"Sacristi, il fait rudement bonici, comparativement Paris. L-bas onest encore
en plein hiver. Il neige, il grle, il pleut, et il fait sombre allumer les lampes ds
trois heures de laprs-midi."
Forestier demanda :
"Rien de nouveau au journal ?
146
- Rien de nouveau. On a pris pour te remplacer le petit Lacrin qui sort du Vol-
taire ; mais il nest pas mr. Il est temps que tu reviennes ! "
Le malade balbutia :
"Moi ? Jirai faire de la chronique six pieds sous terre maintenant. "
Lide xe revenait comme uncoupde cloche propos de tout, reparaissait sans
cesse dans chaque pense, dans chaque phrase.
Il y eut un long silence ; un silence douloureux et profond. Lardeur du couchant
se calmait lentement ; et les montagnes devenaient noires sur le ciel rouge qui
sassombrissait. Une ombre colore, un commencement de nuit qui gardait des
lueurs de brasier mourant, entrait dans la chambre, semblait teindre les meubles,
les murs, les tentures, les coins avec des tons mls dencre et de pourpre. La glace
de la chemine, retant lhorizon, avait lair dune plaque de sang.
Mme Forestier ne remuait point, toujours debout, le dos lappartement, le
visage contre le carreau.
Et Forestier se mit parler dune voix saccade, essoufe, dchirante en-
tendre :
"Combien est-ce que jen verrai encore, de couchers de soleil ?... huit... dix...
quinze ou vingt... peut-tre trente, pas plus... Vous avez du temps, vous autres...
moi, cest ni... Et a continuera... aprs moi, comme si jtais l..."
Il demeura muet quelques minutes, puis reprit :
"Tout ce que je vois me rappelle que je ne le verrai plus dans quelques jours...
Cest horrible... je ne verrai plus rien... rien de ce qui existe... les plus petits ob-
jets quon manie... les verres... les assiettes... les lits o lon se repose si bien... les
voitures. Cest bon de se promener en voiture, le soir... Comme jaimais tout ."
Il faisait avec les doigts de chaque mainunmouvement nerveux et lger, comme
sil et jou du piano sur les deux bras de son sige. Et chacun de ses silences tait
plus pnible que ses paroles, tant on sentait quil devait penser dpouvantables
choses.
147
Et Duroy tout coup se rappela ce que lui disait Norbert de Varenne, quelques
semaines auparavant :
"Moi, maintenant, je vois la mort de si prs que jai souvent envie dtendre le
bras pour la repousser... Je la dcouvre partout. Les petites btes crases sur les
routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperu dans la barbe dun ami, me
ravagent le cur et me crient : La voil !"
Il navait pas compris, ce jour-l, maintenant il comprenait en regardant Fores-
tier. Et une angoisse inconnue, atroce, entrait enlui, comme sil et senti tout prs,
sur ce fauteuil o haletait cet homme, la hideuse mort porte de sa main. Il avait
envie de se lever, de sen aller, de se sauver, de retourner Paris tout de suite ! Oh!
sil avait su, il ne serait pas venu.
La nuit maintenant stait rpandue dans la chambre comme un deuil htif qui
serait tomb sur ce moribond. Seule la fentre restait visible encore, dessinant,
dans son carr plus clair, la silhouette immobile de la jeune femme.
Et Forestier demanda avec irritation :
"Eh bien, on napporte pas la lampe aujourdhui ? Voil ce quon appelle soigner
un malade."
Lombre du corps qui se dcoupait sur les carreaux disparut, et on entendit tin-
ter un timbre lectrique dans la maison sonore.
Un domestique entra bientt qui posa une lampe sur la chemine. Mme Fores-
tier dit son mari :
"Veux-tu te coucher, ou descendras-tu pour dner ?"
Il murmura :
"Je descendrai."
148
Et lattente du repas les t demeurer encore prs dune heure immobiles, tous
les trois, prononant seulement parfois un mot, un mot quelconque, inutile, ba-
nal, comme sil y et du danger, un danger mystrieux, laisser durer trop long-
temps ce silence, laisser se ger lair muet de cette chambre, de cette chambre
o rdait la mort.
Enn le dner fut annonc. Il sembla long Duroy, interminable. Ils ne par-
laient pas, ils mangeaient sans bruit, puis miettaient du pain du bout des doigts.
Et le domestique faisait le service, marchait, allait et venait sans quon entendit
ses pieds, car le bruit des semelles irritant Charles, lhomme tait chauss de sa-
vates. Seul le tic-tac dur dune horloge de bois troublait le calme des murs de son
mouvement mcanique et rgulier.
Ds quon eut ni de manger, Duroy, sous prtexte de fatigue, se retira dans
sa chambre, et, accoud sa fentre, il regardait la pleine lune au milieu du ciel,
comme un globe de lampe norme, jeter sur les murs blancs des villas sa clart
sche et voile, et semer sur la mer une sorte dcaille de lumire mouvante et
douce. Et il cherchait une raison pour sen aller bien vite, inventant des ruses, des
tlgrammes quil allait recevoir, un appel de M. Walter.
Mais ses rsolutions de fuite lui parurent plus difciles raliser, en sveillant
le lendemain. Mme Forestier ne se laisserait point prendre ses adresses, et il
perdrait par sa couardise tout le bnce de son dvouement. Il se dit : "Bah! cest
embtant ; eh bien, tant pis, il y a des passes dsagrables dans la vie ; et puis, a
ne sera peut-tre pas long."
Il faisait un temps bleu, de ce bleu du Midi qui vous emplit le cur de joie ;
et Duroy descendit jusqu la mer, trouvant quil serait assez tt de voir Forestier
dans la journe.
Quand il rentra pour djeuner, le domestique lui dit :
"Monsieur a dj demand monsieur deux ou trois fois. Si monsieur veut mon-
ter chez monsieur." Il monta. Forestier semblait dormir dans unfauteuil. Sa femme
lisait, allonge sur le canap.
Le malade releva la tte. Duroy demanda :
"Eh bien, comment vas-tu? Tu mas lair gaillard ce matin."
149
Lautre murmura :
"Oui, a va mieux, jai repris des forces. Djeune bienvite avec Madeleine, parce
que nous allons faire un tour en voiture."
La jeune femme, ds quelle fut seule avec Duroy, lui dit :
"Voil ! aujourdhui il se croit sauv. Il fait des projets depuis le matin. Nous
allons tout lheure au golfe Juan acheter des faences pour notre appartement de
Paris. Il veut sortir toute force, mais jai horriblement peur dun accident. Il ne
pourra pas supporter les secousses de la route."
Quand le landau fut arriv, Forestier descendit lescalier pas pas, soutenu par
son domestique. Mais ds quil aperut la voiture, il voulut quon la dcouvrt.
Sa femme rsistait :
"Tu vas prendre froid. Cest de la folie."
Il sobstina :
"Non, je vais beaucoup mieux. Je le sens bien."
On passa dabord dans ces chemins ombreux qui vont toujours entre deux jar-
dins et qui font de Cannes une sorte de parc anglais, puis on gagna la route dAn-
tibes, le long de la mer.
Forestier expliquait le pays. Il avait indiqu dabord la villa du comte de Pa-
ris. Il en nommait dautres. Il tait gai, dune gaiet voulue, factice et dbile de
condamn. Il levait le doigt, nayant point la force de tendre le bras.
"Tiens, voici lle Sainte-Marguerite et le chteau dont Bazaine sest vad. Nous
en a-t-on donn garder avec cette affaire-l !"
Puis il eut des souvenirs de rgiment ; il nomma des ofciers qui leur rappe-
laient des histoires. Mais, tout coup, la route ayant tourn, on dcouvrit le golfe
Juan tout entier avec son village blanc dans le fond et la pointe dAntibes lautre
bout.
150
Et Forestier, saisi soudain dune joie enfantine, balbutia :
"Ah! lescadre, tu vas voir lescadre !"
Au milieu de la vaste baie, on apercevait, en effet, une demi-douzaine de gros
navires qui ressemblaient des rochers couverts de ramures. Ils taient bizarres,
difformes, normes, avec des excroissances, des tours, des perons senfonant
dans leau comme pour aller prendre racine sous la mer.
On ne comprenait pas que cela pt se dplacer, remuer, tant ils semblaient
lourds et attachs au fond. Une batterie ottante, ronde, haute, en forme dob-
servatoire, ressemblait ces phares quon btit sur des. cueils.
Et un grand trois-mts passait auprs deux pour gagner le large, toutes ses
voiles dployes, blanches et joyeuses. Il tait gracieux et joli auprs des monstres
de guerre, des monstres de fer, des vilains monstres accroupis sur leau.
Forestier sefforait de les reconnatre. Il nommait : "Le Colbert, Le Suffren,
LAmiral-Duperr, Le Redoutable, La Dvastation", puis il reprenait : "Non, je me
trompe, cest celui-l La Dvastation."
Ils arrivrent devant une sorte de grand pavillon o on lisait : " Faences dart du
golfe Juan", et la voiture ayant tourn autour dun gazon sarrta devant la porte.
Forestier voulait acheter deux vases pour les poser sur sa bibliothque. Comme
il ne pouvait gure descendre de voiture, on lui apportait les modles lun aprs
lautre. Il fut longtemps choisir, consultant sa femme et Duroy :
"Tu sais, cest pour le meuble au fond de mon cabinet. De mon fauteuil, jai cela
sous les yeux tout le temps. Je tiens une forme ancienne, une forme grecque."
Il examinait les chantillons, sen faisait apporter dautres, reprenait les pre-
miers. Enn, il se dcida ; et ayant pay, il exigea que lexpdition ft faite tout de
suite.
"Je retourne Paris dans quelques jours", disait-il.
Ils revinrent, mais, le long du golfe, un courant dair froid les frappa soudain
gliss dans le pli dun vallon, et le malade se mit tousser.
151
Ce ne fut rien dabord, une petite crise ; mais elle grandit, devint une quinte
ininterrompue, puis une sorte de hoquet, un rle.
Forestier suffoquait, et chaque fois quil voulait respirer la toux lui dchirait la
gorge, sortie du fond de sa poitrine. Rien ne la calmait, rien ne lapaisait. Il fallut le
porter du landau dans sa chambre, et Duroy, qui lui tenait les jambes, sentait les
secousses de ses pieds, chaque convulsion de ses poumons.
La chaleur du lit narrta point laccs qui dura jusqu minuit ; puis les narco-
tiques, enn, engourdirent les spasmes mortels de la toux. Et le malade demeura
jusquau jour, assis dans son lit, les yeux ouverts.
Les premires paroles quil pronona furent pour demander le barbier, car il te-
nait tre ras chaque matin. Il se leva pour cette opration de toilette ; mais il
fallut le recoucher aussitt, et il se mit respirer dune faon si courte, si dure, si
pnible, que Mme Forestier, pouvante, t rveiller Duroy, qui venait de se cou-
cher, pour le prier daller chercher le mdecin.
Il ramena presque immdiatement le docteur Gavaut qui prescrivit unbreuvage
et donna quelques conseils ; mais comme le journaliste le reconduisait pour lui
demander son avis :
"Cest lagonie, dit-il. Il sera mort demain matin. Prvenez cette pauvre jeune
femme et envoyez chercher un prtre. Moi, je nai plus rien faire. Je me tiens
cependant entirement votre disposition."
Duroy t appeler Mme Forestier :
"Il va mourir. Le docteur conseille denvoyer chercher un prtre. Que voulez-
vous faire ?"
Elle hsita longtemps, puis, dune voix lente, ayant tout calcul :
"Oui, a vaut mieux... sous bien des rapports... Je vais le prparer, lui dire que
le cur dsire le voir... Je ne sais quoi, enn. Vous seriez bien gentil, vous, daller
menchercher un, uncur, et de le choisir. Prenez-enunqui ne nous fasse pas trop
de simagres. Tchez quil se contente de la confession, et nous tienne quittes du
reste."
152
Le jeune homme ramena un vieil ecclsiastique complaisant qui se prtait la
situation. Ds quil fut entr chez lagonisant, Mme Forestier sortit, et sassit, avec
Duroy, dans la pice voisine.
"a la boulevers, dit-elle. Quand jai parl dun prtre, sa gure a pris une ex-
pression pouvantable comme... comme sil avait senti... senti... un soufe... vous
savez... Il a compris que ctait ni, enn, et quil fallait compter les heures..."
Elle tait fort ple. Elle reprit :
"Je noublierai jamais lexpression de son visage. Certes, il a vu la mort ce
moment-l. Il la vue..."
Ils entendaient le prtre, qui parlait un peu haut, tant un peu sourd, et qui
disait :
"Mais non, mais non, vous ntes pas si bas que a. Vous tes malade, mais nul-
lement en danger. Et la preuve cest que je viens en ami, en voisin."
Ils ne distingurent pas ce que rpondit Forestier. Le vieillard reprit :
"Non, je ne vous ferai pas communier. Nous causerons de a quand vous irez
bien. Si vous voulez proter de ma visite pour vous confesser par exemple, je ne
demande pas mieux. Je suis un pasteur, moi, je saisis toutes les occasions pour
ramener mes brebis."
Unlong silence suivit. Forestier devait parler de sa voix haletante et sans timbre.
Puis tout dun coup, le prtre pronona, dun ton diffrent, dun ton dofciant
lautel :
"La misricorde de Dieu est innie, rcitez le Conteor, mon enfant. - Vous
lavez peut-tre oubli, je vais vous aider. - Rptez avec moi : Conteor Deo om-
nipotenti... Beatae Mariae semper virgini..."
Il sarrtait de temps en temps pour permettre au moribond de le rattraper. Puis
il dit :
153
"Maintenant, confessez-vous..."
La jeune femme et Duroy ne remuaient plus, saisis par un trouble singulier,
mus dune attente anxieuse.
Le malade avait murmur quelque chose. Le prtre rpta :
"Vous avez eu des complaisances coupables... de quelle nature, mon enfant ? "
La jeune femme se leva, et dit simplement :
"Descendons un peu au jardin. Il ne faut pas couter ses secrets."
Et ils allrent sasseoir sur un banc, devant la porte, au-dessous dun rosier
euri, et derrire une corbeille doeillets qui rpandait dans lair pur son parfum
puissant et doux.
Duroy aprs quelques minutes de silence, demanda :
"Est-ce que vous tarderez beaucoup rentrer Paris ?"
Elle rpondit :
"Oh! non. Ds que tout sera ni je reviendrai.
- Dans une dizaine de jours ?
- Oui, au plus."
Il reprit :
"Il na donc aucun parent ?
- Aucun, sauf des cousins. Son pre et sa mre sont morts comme il tait tout
jeune."
154
Ils regardaient tous deux un papillon cueillant sa vie sur les oeillets, allant de
lun lautre avec une rapide palpitation des ailes qui continuaient battre lente-
ment quand il stait pos sur la eur. Et ils restrent longtemps silencieux.
Le domestique vint les prvenir que " M. le cur avait ni ". Et ils remontrent
ensemble.
Forestier semblait avoir encore maigri depuis la veille.
Le prtre lui tenait la main.
"Au revoir, mon enfant, je reviendrai demain matin."
Et il sen alla.
Ds quil fut sorti, le moribond, qui haletait, essaya de soulever ses deux mains
vers sa femme et il bgaya :
"Sauve-moi... sauve-moi... ma chrie... je ne veux pas mourir... je ne veux pas
mourir... Oh! sauvez-moi... Dites ce quil faut faire, allez chercher le mdecin... Je
prendrai ce quon voudra... Je ne veux pas... Je ne veux pas..."
Il pleurait. De grosses larmes coulaient de ses yeux sur ses joues dcharnes ;
et les coins maigres de sa bouche se plissaient comme ceux des petits enfants qui
ont du chagrin.
Alors ses mains retombes sur le lit commencrent un mouvement continu,
lent et rgulier, comme pour recueillir quelque chose sur les draps.
Sa femme qui se mettait pleurer aussi balbutiait :
"Mais non, ce nest rien. Cest une crise, demain tu iras mieux, tu tes fatigu
hier avec cette promenade."
Lhaleine de Forestier tait plus rapide que celle dun chien qui vient de courir,
si presse quon ne la pouvait point compter, et si faible quon lentendait peine.
Il rptait toujours :
155
"Je ne veux pas mourir !... Oh! mon Dieu... mon Dieu... mon Dieu... quest-ce
qui va marriver ? Je ne verrai plus rien... plus rien... jamais... Oh! mon Dieu!"
Il regardait devant lui quelque chose dinvisible pour les autres et de hideux,
dont ses yeux xes retaient lpouvante. Ses deux mains continuaient ensemble
leur geste horrible et fatigant.
Soudain il tressaillit dun frisson brusque quon vit courir dun bout lautre de
son corps et il balbutia :
"Le cimetire... moi... mon Dieu!..."
Et il ne parla plus. Il restait immobile, hagard et haletant.
Le temps passait ; midi sonna lhorloge dun couvent voisin. Duroy sortit de
la chambre pour aller manger un peu. Il revint une heure plus tard. Mme Fores-
tier refusa de rien prendre. Le malade navait point boug. Il tranait toujours ses
doigts maigres sur le drap comme pour le ramener vers sa face.
La jeune femme tait assise dans un fauteuil, au pied du lit. Duroy en prit un
autre ct delle, et ils attendirent en silence.
Une garde tait venue, envoye par le mdecin; elle sommeillait prs de la fe-
ntre.
Duroy lui-mme commenait sassoupir quandil eut la sensationque quelque
chose survenait. Il ouvrit les yeux juste temps pour voir Forestier fermer les siens
comme deux lumires qui steignent. Un petit hoquet agita la gorge du mourant,
et deux lets de sang apparurent aux coins de sa bouche, puis coulrent sur sa
chemise. Ses mains cessrent leur hideuse promenade. Il avait ni de respirer.
Sa femme comprit, et, poussant une sorte de cri, elle sabattit sur les genoux en
sanglotant dans le drap. Georges, surpris et effar, t machinalement le signe de
la croix. La garde, stant rveille, sapprocha du lit : "a y est", dit-elle. Et Duroy
qui reprenait son sang-froid murmura, avec un soupir de dlivrance : "a a t
moins long que je naurais cru."
156
Lorsque fut dissip le premier tonnement, aprs les premires larmes verses,
on soccupa de tous les soins et de toutes les dmarches que rclame un mort.
Duroy courut jusqu la nuit.
Il avait grand-faim en rentrant. Mme Forestier mangea quelque peu, puis ils
sinstallrent tous deux dans la chambre funbre pour veiller le corps.
Deux bougies brlaient sur la table de nuit ct dune assiette o trempait une
branche de mimosa dans un peu deau, car on navait point trouv le rameau de
buis ncessaire.
Ils taient seuls, le jeune homme et la jeune femme, auprs de lui, qui ntait
plus. Ils demeuraient sans parler, pensant et le regardant.
Mais Georges, que lombre inquitait auprs de ce cadavre, le contemplait obs-
tinment. Son oeil et son esprit attirs, fascins, par ce visage dcharn que la
lumire vacillante faisait paratre encore plus creux, restaient xes sur lui. Ctait
l son ami, Charles Forestier, qui lui parlait hier encore ! Quelle chose trange et
pouvantable que cette n complte dun tre ! Oh! il se les rappelait maintenant
les paroles de Norbert de Varenne hant par la peur de la mort. - " Jamais un tre
ne revient." Il en natrait des millions et des milliards, peu prs pareils, avec des
yeux, un nez, une bouche, un crne, et dedans une pense, sans que jamais celui-
ci repart, qui tait couch dans ce lit.
Pendant quelques annes il avait vcu, mang, ri, aim, espr, comme tout le
monde. Et ctait ni, pour lui, ni pour toujours. Une vie ! quelques jours, et puis
plus rien! On nat, on grandit, on est heureux, on attend, puis on meurt. Adieu!
homme ou femme, tu ne reviendras point sur la terre ! Et pourtant chacun porte
en soi le dsir vreux et irralisable de lternit, chacun est une sorte duni-
vers dans lunivers, et chacun sanantit bientt compltement dans le fumier
des germes nouveaux. Les plantes, les btes, les hommes, les toiles, les mondes,
tout sanime, puis meurt pour se transformer. Et jamais un tre ne revient, insecte,
homme ou plante !
Une terreur confuse, immense, crasante, pesait sur lme de Duroy, la terreur
de ce nant illimit, invitable, dtruisant indniment toutes les existences si
rapides et si misrables. Il courbait dj le front sous sa menace. Il pensait aux
mouches qui vivent quelques heures, aux btes qui vivent quelques jours, aux
157
hommes qui vivent quelques ans, aux terres qui vivent quelques sicles. Quelle
diffrence donc entre les uns et les autres ? Quelques aurores de plus, voil tout.
Il dtourna les yeux pour ne plus regarder le cadavre.
Mme Forestier, la tte baisse, semblait songer aussi des choses douloureuses.
Ses cheveux blonds taient si jolis sur sa gure triste, quune sensation douce
comme le toucher dune esprance passa dans le cur du jeune homme. Pour-
quoi se dsoler quand il avait encore tant dannes devant lui ?
Et il se mit la contempler. Elle ne le voyait point, perdue dans sa mditation.
Il se disait : "Voil pourtant la seule chose de la vie : lamour ! tenir dans ses bras
une femme aime ! L est la limite du bonheur humain."
Quelle chance il avait eue, ce mort, de rencontrer cette compagne intelligente et
charmante. Comment staient-ils connus ? Comment avait-elle consenti, elle,
pouser ce garon mdiocre et pauvre ? Comment avait-elle ni par en faire quel-
quun?
Alors il songea tous les mystres cachs dans les existences. Il se rappela ce
quon chuchotait du comte de Vaudrec qui lavait dote et marie, disait-on.
Quallait-elle faire maintenant ? Qui pouserait-elle ? Undput, comme le pen-
sait Mme de Marelle, ou quelque gaillard davenir, un Forestier suprieur ? Avait-
elle des projets, des plans, des ides arrtes ? Comme il et dsir savoir cela !
Mais pourquoi ce souci de ce quelle ferait ? Il se le demanda, et saperut que son
inquitude venait dune de ces arrire-penses confuses, secrtes, quon se cache
soi-mme et quon ne dcouvre quen allant fouiller au fond de soi.
Oui, pourquoi nessaierait-il pas lui-mme cette conqute ? Comme il serait fort
avec elle, et redoutable ! Comme il pourrait aller vite et loin, et srement !
Et pourquoi ne russirait-il pas ? Il sentait bien quil lui plaisait, quelle avait
pour lui plus que de la sympathie, une de ces affections qui naissent entre deux
natures semblables et qui tiennent autant dune sduction rciproque que dune
sorte de complicit muette.
Elle le savait intelligent, rsolu, tenace ; elle pouvait avoir conance en lui.
158
Ne lavait-elle pas fait venir en cette circonstance si grave ? Et pourquoi lavait-
elle appel ? Ne devait-il pas voir l une sorte de choix, une sorte daveu, une sorte
de dsignation? Si elle avait pens lui, juste ce moment o elle allait devenir
veuve, cest que, peut-tre, elle avait song celui qui deviendrait de nouveau son
compagnon, son alli ?
Et une envie impatiente le saisit de savoir, de linterroger, de connatre ses in-
tentions. Il devait repartir le surlendemain, ne pouvant demeurer seul avec cette
jeune femme dans cette maison. Donc il fallait se hter, il fallait, avant de retour-
ner Paris, surprendre avec adresse, avec dlicatesse, ses projets, et ne pas la lais-
ser revenir, cder aux sollicitations dun autre peut-tre, et sengager sans retour.
Le silence de la chambre tait profond; on nentendait que le balancier de la
pendule qui battait sur la chemine son tic-tac mtallique et rgulier.
Il murmura :
"Vous devez tre bien fatigue ?"
Elle rpondit :
"Oui, mais je suis surtout accable."
Le bruit de leur voix les tonna, sonnant trangement dans cet appartement
sinistre. Et ils regardrent soudain le visage du mort, comme sils se fussent atten-
dus le voir remuer, lentendre leur parler, ainsi quil faisait, quelques heures
plus tt.
Duroy reprit :
"Oh! cest un gros coup pour vous, et un changement si complet dans votre vie,
un vrai bouleversement du cur et de lexistence entire."
Elle soupira longuement sans rpondre.
Il continua :
"Cest si triste pour une jeune femme de se trouver seule comme vous allez
ltre."
159
Puis il se tut. Elle ne dit rien. Il balbutia :
"Dans tous les cas, vous savez le pacte conclu entre nous. Vous pouvez disposer
de moi comme vous voudrez. Je vous appartiens."
Elle lui tendit la main en jetant sur lui un de ces regards mlancoliques et doux
qui remuent en nous jusquaux moelles des os.
"Merci, vous tes bon, excellent. Si josais et si je pouvais quelque chose pour
vous, je dirais aussi : Comptez sur moi."
Il avait pris la main offerte et il la gardait, la serrant, avec une envie ardente
de la baiser. Il sy dcida enn, et lapprochant lentement de sa bouche, il tint
longtemps la peau ne, un peu chaude, vreuse et parfume contre ses lvres.
Puis quand il sentit que cette caresse dami allait devenir trop prolonge, il sut
laisser retomber la petite main. Elle sen revint mollement sur le genou de la jeune
femme qui pronona gravement :
"Oui, je vais tre bien seule, mais je mefforcerai dtre courageuse."
Il ne savait comment lui laisser comprendre quil serait heureux, bien heureux,
de lavoir pour femme son tour. Certes il ne pouvait pas le lui dire, cette heure,
en ce lieu, devant ce corps ; cependant il pouvait, lui semblait-il, trouver une de
ces phrases ambigus, convenables et compliques, qui ont des sens cachs sous
les mots, et qui expriment tout ce quon veut par leurs rticences calcules.
Mais le cadavre le gnait, le cadavre rigide, tendu devant eux, et quil sentait
entre eux. Depuis quelque temps dailleurs il croyait saisir dans lair enferm de
la pice une odeur suspecte, une haleine pourrie, venue de cette poitrine dcom-
pose, le premier soufe de charogne que les pauvres morts couchs en leur lit
jettent aux parents qui les veillent, soufe horrible dont ils emplissent bientt la
bote creuse de leur cercueil.
Duroy demanda :
"Ne pourrait-on ouvrir un peu la fentre ? Il me semble que lair est corrompu."
Elle rpondit :
160
"Mais oui. Je venais aussi de men apercevoir."
Il alla vers la fentre et louvrit. Toute la fracheur parfume de la nuit entra,
troublant la amme des deux bougies allumes auprs du lit. La lune rpandait,
comme lautre soir, sa lumire abondante et calme sur les murs blancs des villas et
sur la grande nappe luisante de la mer. Duroy, respirant pleins poumons, se sen-
tit brusquement assailli desprances, comme soulev par lapproche frmissante
du bonheur.
Il se retourna.
"Venez donc prendre un peu le frais, dit-il, il fait un temps admirable."
Elle sen vint tranquillement et saccouda prs de lui.
Alors il murmura, voix basse :
"coutez-moi, et comprenez bien ce que je veux vous dire. Ne vous indignez
pas, surtout, de ce que je vous parle dune pareille chose en un semblable mo-
ment, mais je vous quitterai aprs-demain, et quand vous reviendrez Paris il sera
peut-tre trop tard. Voil... Je ne suis quun pauvre diable sans fortune et dont la
position est faire, vous le savez. Mais jai de la volont, quelque intelligence
ce que je crois, et je suis en route, en bonne route. Avec un homme arriv on sait
ce quon prend; avec un homme qui commence on ne sait pas o il ira. Tant pis,
ou tant mieux. Enn je vous ai dit un jour, chez vous, que mon rve le plus cher
aurait t dpouser une femme comme vous. Je vous rpte aujourdhui ce d-
sir. Ne me rpondez pas. Laissez-moi continuer. Ce nest point une demande que
je vous adresse. Le lieu et linstant la rendraient odieuse. Je tiens seulement ne
point vous laisser ignorer que vous pouvez me rendre heureux dun mot, que vous
pouvez faire de moi soit un ami fraternel, soit mme un mari, votre gr, que mon
cur et ma personne sont vous. Je ne veux pas que vous me rpondiez mainte-
nant ; je ne veux plus que nous parlions de cela, ici. Quand nous nous reverrons,
Paris, vous me ferez comprendre ce que vous aurez rsolu. Jusque-l plus un mot,
nest-ce pas ?"
Il avait dbit cela sans la regarder, comme sil et sem ses paroles dans la
nuit devant lui. Et elle semblait navoir point entendu, tant elle tait demeure
immobile, regardant aussi devant elle, dun oeil xe et vague, le grand paysage
ple clair par la lune.
161
Ils demeurrent longtemps cte cte, coude contre coude, silencieux et m-
ditant.
Puis elle murmura :
"Il fait un peu froid", et, stant retourne, elle revint vers le lit. Il la suivit.
Lorsquil sapprocha, il reconnut que vraiment Forestier commenait sentir ;
et il loigna son fauteuil, car il naurait pu supporter longtemps cette odeur de
pourriture. Il dit :
"Il faudra le mettre en bire ds le matin."
Elle rpondit :
"Oui, oui, cest entendu; le menuisier viendra vers huit heures."
Et Duroy ayant soupir : "Pauvre garon!" elle poussa son tour un long soupir
de rsignation navre.
Ils le regardaient moins souvent, accoutums dj lide de cette mort, com-
menant consentir mentalement cette disparition qui, tout lheure encore,
les rvoltait et les indignait, eux qui taient mortels aussi.
Ils ne parlaient plus, continuant veiller dune faon convenable, sans dor-
mir. Mais, vers minuit, Duroy sassoupit le premier. Quand il se rveilla, il vit que
Mme Forestier sommeillait galement, et ayant pris une posture plus commode, il
ferma de nouveau les yeux en grommelant : "Sacristi ! on est mieux dans ses draps,
tout de mme."
Un bruit soudain le t tressauter. La garde entrait. Il faisait grand jour. La jeune
femme, sur le fauteuil en face, semblait aussi surprise que lui. Elle tait un peu
ple, mais toujours jolie, frache, gentille, malgr cette nuit passe sur un sige.
Alors, ayant regard le cadavre, Duroy tressaillit et scria : " Oh! sa barbe !" Elle
avait pouss, cette barbe, en quelques heures, sur cette chair qui se dcompo-
sait, comme elle poussait en quelques jours sur la face dun vivant. Et ils demeu-
raient effars par cette vie qui continuait sur ce mort, comme devant un prodige
162
affreux, devant une menace surnaturelle de rsurrection, devant une des choses
anormales, effrayantes qui bouleversent et confondent lintelligence.
Ils allrent ensuite tous les deux se reposer jusqu onze heures. Puis ils mirent
Charles au cercueil, et ils se sentirent aussitt allgs, rassrns. Ils sassirent
en face lun de lautre pour djeuner avec une envie veille de parler de choses
consolantes, plus gaies, de rentrer dans la vie, puisquils en avaient ni avec la
mort.
Par la fentre, grande ouverte, la douce chaleur du printemps entrait, apportant
le soufe parfum de la corbeille doeillets eurie devant la porte.
Mme Forestier proposa Duroy de faire un tour dans le jardin, et ils se mirent
marcher doucement autour du petit gazon en respirant avec dlices lair tide
plein de lodeur des sapins et des eucalyptus.
Et tout coup, elle lui parla, sans tourner la tte vers lui, comme il avait fait
pendant la nuit, l-haut. Elle prononait les mots lentement, dune voix basse et
srieuse :
"coutez, moncher ami, jai bienrchi... dj... ce que vous mavez propos,
et je ne veux pas vous laisser partir sans vous rpondre un mot. Je ne vous dirai,
dailleurs, ni oui ni non. Nous attendrons, nous verrons, nous nous connatrons
mieux. Rchissez beaucoup de votre ct. Nobissez pas un entranement
trop facile. Mais, si je vous parle de cela, avant mme que ce pauvre Charles soit
descendu dans sa tombe, cest quil importe, aprs ce que vous mavez dit, que
vous sachiez bien qui je suis, an de ne pas nourrir plus longtemps la pense que
vous mavez exprime, si vous ntes pas dun... dun... caractre me comprendre
et me supporter.
"Comprenez-moi bien. Le mariage pour moi nest pas une chane, mais une as-
sociation. Jentends tre libre, tout fait libre de mes actes, de mes dmarches,
de mes sorties, toujours. Je ne pourrais tolrer ni contrle, ni jalousie, ni discus-
sion sur ma conduite. Je mengagerais, bien entendu, ne jamais compromettre
le nom de lhomme que jaurais pous, ne jamais le rendre odieux ou ridicule.
Mais il faudrait aussi que cet homme sengaget voir en moi une gale, une al-
lie, et non pas une infrieure ni une pouse obissante et soumise. Mes ides, je
le sais, ne sont pas celles de tout le monde, mais je nen changerai point. Voil.
163
"Jajoute aussi : Ne me rpondez pas, ce serait inutile et inconvenant. Nous nous
reverrons et nous reparlerons peut-tre de tout cela, plus tard.
"Maintenant, allez faire un tour. Moi je retourne prs de lui. A ce soir."
Il lui baisa longuement la main et sen alla sans prononcer un mot.
Le soir, ils ne se virent qu lheure dudner. Puis ils montrent leurs chambres,
tant tous deux briss de fatigue.
Charles Forestier fut enterr le lendemain, sans aucune pompe, dans le cime-
tire de Cannes. Et Georges Duroy voulut prendre le rapide de Paris qui passe
une heure et demie.
Mme Forestier lavait conduit la gare. Ils se promenaient tranquillement sur
le quai, en attendant lheure du dpart, et parlaient de choses indiffrentes.
Le train arriva, trs court, un vrai rapide, nayant que cinq wagons.
Le journaliste choisit sa place, puis redescendit pour causer encore quelques
instants avec elle, saisi soudain dune tristesse, dun chagrin, dun regret violent
de la quitter, comme sil allait la perdre pour toujours.
Un employ criait : "Marseille, Lyon, Paris, en voiture !" Duroy monta, puis sac-
couda la portire pour lui dire encore quelques mots. La locomotive sifa et le
convoi doucement se mit en marche.
Le jeune homme, pench hors du wagon, regardait la jeune femme immobile
sur le quai et dont le regard le suivait. Et soudain, comme il allait la perdre de vue,
il prit avec ses deux mains un baiser sur sa bouche pour le jeter vers elle.
Elle le lui renvoya dun geste plus discret, hsitant, bauch seulement.
164
Deuxime partie
165
Chapitre 9
Georges Duroy avait retrouv toutes ses habitudes anciennes.
Install maintenant dans le petit rez-de-chausse de la rue de Constantinople,
il vivait sagement, en homme qui prpare une existence nouvelle. Ses relations
avec Mme de Marelle avaient mme pris une allure conjugale, comme sil se ft
exerc davance lvnement prochain; et sa matresse, stonnant souvent de la
tranquillit rgle de leur union, rptait en riant : "Tu es encore plus popote que
mon mari, a ntait pas la peine de changer."
Mme Forestier ntait pas revenue. Elle sattardait Cannes. Il reut une lettre
delle, annonant son retour seulement pour le milieu davril, sans un mot dal-
lusion leurs adieux. Il attendit. Il tait bien rsolu maintenant prendre tous
les moyens pour lpouser, si elle semblait hsiter. Mais il avait conance en sa
fortune, conance en cette force de sduction quil sentait en lui, force vague et
irrsistible que subissaient toutes les femmes.
Un court billet le prvint que lheure dcisive allait sonner.
"Je suis Paris. Venez me voir.
"MADELEINE FORESTIER."
Rien de plus. Il lavait reu par le courrier de neuf heures. Il entrait chez elle
trois heures, le mme jour.
Elle lui tendit les deux mains, en souriant de son joli sourire aimable ; et ils se
regardrent pendant quelques secondes, au fond des yeux.
Puis elle murmura :
166
"Comme vous avez t bon de venir l-bas dans ces circonstances terribles."
Il rpondit :
"Jaurais fait tout ce que vous mauriez ordonn."
Et ils sassirent. Elle sinforma des nouvelles, des Walter, de tous les confrres et
du journal. Elle y pensait souvent, au journal.
"a me manque beaucoup, disait-elle, mais beaucoup. Jtais devenue journa-
liste dans lme. Que voulez-vous, jaime ce mtier-l."
Puis elle se tut. Il crut comprendre, il crut trouver dans son sourire, dans le ton
de sa voix, dans ses paroles elles-mmes, une sorte dinvitation; et bien quil se
ft promis de ne pas brusquer les choses, il balbutia :
"Eh bien... pourquoi... pourquoi ne le reprendriez-vous pas... ce mtier... sous...
sous le nom de Duroy ?"
Elle redevint brusquement srieuse et, posant la main sur son bras, elle mur-
mura :
"Ne parlons pas encore de a."
Mais il devina quelle acceptait, et tombant genoux il se mit lui baiser pas-
sionnment les mains en rptant, en bgayant :
"Merci, merci, comme je vous aime !"
Elle se leva. Il t comme elle et il saperut quelle tait fort ple. Alors il comprit
quil lui avait plu, depuis longtemps peut-tre ; et comme ils se trouvaient face
face, il ltreignit, puis il lembrassa sur le front, dun long baiser tendre et srieux.
Quand elle se fut dgage, en glissant sur sa poitrine, elle reprit dun ton grave :
"coutez, mon ami, je ne suis encore dcide rien. Cependant il se pourrait
que ce ft oui. Mais vous allez me promettre le secret absolu jusqu ce que je
vous en dlie."
167
Il jura et partit, le cur dbordant de joie.
Il mit dsormais beaucoup de discrtion dans les visites quil lui t et il ne solli-
cita pas de consentement plus prcis, car elle avait une manire de parler de lave-
nir, de dire " plus tard", de faire des projets o leurs deux existences se trouvaient
mles, qui rpondait sans cesse, mieux et plus dlicatement, quune formelle ac-
ceptation.
Duroy travaillait dur, dpensait peu, tchait dconomiser quelque argent pour
ntre point sans le sou au moment de son mariage, et il devenait aussi avare quil
avait t prodigue.
Lt se passa, puis lautomne, sans quaucun soupon vnt personne, car ils
se voyaient peu, et le plus naturellement du monde.
Un soir Madeleine lui dit, en le regardant au fond des yeux :
"Vous navez pas encore annonc notre projet Mme de Marelle ?
- Non, mon amie. Vous ayant promis le secret je nen ai ouvert la bouche me
qui vive.
- Eh bien, il serait temps de la prvenir. Moi, je me charge des Walter. Ce sera
fait cette semaine, nest-ce pas ?"
Il avait rougi.
"Oui, ds demain."
Elle dtourna doucement les yeux, comme pour ne point remarquer sontrouble,
et reprit :
"Si vous le voulez, nous pourrons nous marier au commencement de mai . Ce
serait trs convenable.
- Jobis en tout avec joie.
168
- Le 10 mai, qui est un samedi, me plairait beaucoup, parce que cest mon jour
de naissance.
- Soit, le 10 mai.
- Vos parents habitent prs de Rouen, nest-ce pas ? Vous me lavez dit du moins.
- Oui, prs de Rouen, Canteleu.
- Quest-ce quils font ?
- Ils sont... ils sont petits rentiers.
- Ah! Jai un grand dsir de les connatre."
Il hsita, fort perplexe :
"Mais... cest que, ils sont..."
Puis il prit son parti en homme vraiment fort :
"Ma chre amie, ce sont des paysans, des cabaretiers qui se sont saigns aux
quatre membres pour me faire faire des tudes. Moi, je ne rougis pas deux, mais
leur... simplicit... leur... rusticit pourrait peut-tre vous gner."
Elle souriait dlicieusement, le visage illumin dune bont douce.
"Non. Je les aimerai beaucoup. Nous irons les voir. Je le veux. Je vous reparlerai
de a. Moi aussi je suis lle de petite gens... mais je les ai perdus, moi, mes parents.
Je nai plus personne au monde... - elle lui tendit la main et ajouta... - que vous."
Et il se sentit attendri, remu, conquis comme il ne lavait pas encore t par
aucune femme.
"Jai pens quelque chose, dit-elle, mais cest assez difcile expliquer."
Il demanda :
169
"Quoi donc ?
- Eh bien, voil, mon cher, je suis comme toutes les femmes, jai mes... mes
faiblesses, mes petitesses, jaime ce qui brille, ce qui sonne. Jaurais ador porter
un nom noble. Est-ce que vous ne pourriez pas, loccasion de notre mariage,
vous... vous anoblir un peu?"
Elle avait rougi, son tour ; comme si elle lui et propos une indlicatesse.
Il rpondit simplement :
"Jy ai bien souvent song, mais cela ne me parat pas facile.
- Pourquoi donc ?"
Il se mit rire :
"Parce que jai peur de me rendre ridicule."
Elle haussa les paules :
"Mais pas du tout, pas du tout. Tout le monde le fait et personne nen rit. Spa-
rez votre nom en deux : "Du Roy." a va trs bien. "
Il rpondit aussitt, en homme qui connat la question :
"Non, a ne va pas. Cest un procd trop simple, trop commun, trop connu.
Moi javais pens prendre le nom de mon pays, comme pseudonyme littraire
dabord, puis lajouter peu peu au mien, puis mme, plus tard, couper en
deux mon nom comme vous me le proposiez."
Elle demanda :
"Votre pays cest Canteleu?
- Oui."
Mais elle hsitait :
170
"Non. Je nen aime pas la terminaison. Voyons, est-ce que nous ne pourrions
pas modier un peu ce mot... Canteleu?"
Elle avait pris une plume sur la table et elle griffonnait des noms en tudiant
leur physionomie. Soudain elle scria :
"Tenez, tenez, voici."
Et elle lui tendit un papier o il lut " Madame Duroy de Cantel."
Il rchit quelques secondes, puis il dclara avec gravit :
"Oui, cest trs bon."
Elle tait enchante et rptait :
"Duroy de Cantel, Duroy de Cantel, Madame Duroy de Cantel. Cest excellent,
excellent !"
Elle ajouta, dun air convaincu :
"Et vous verrez comme cest facile faire accepter par tout le monde. Mais il
faut saisir loccasion. Car il serait trop tard ensuite. Vous allez, ds demain, signer
vos chroniques D. de Cantel, et vos chos tout simplement Duroy. a se fait tous
les jours dans la presse et personne ne stonnera de vous voir prendre un nom
de guerre. Au moment de notre mariage, nous pourrons encore modier un peu
cela en disant aux amis que vous aviez renonc votre du par modestie, tant
donn votre position, ou mme sans rien dire du tout. Quel est le petit nom de
votre pre ?
- Alexandre."
Elle murmura deux ou trois fois de suite : "Alexandre, Alexandre", en coutant
la sonorit des syllabes, puis elle crivit sur une feuille toute blanche :
"Monsieur et Madame Alexandre du Roy de Cantel ont lhonneur de vous faire
part du mariage de Monsieur Georges du Roy de Cantel, leur ls, avec Madame
Madeleine Forestier."
171
Elle regardait son criture dun peu loin, ravie de leffet, et elle dclara :
"Avec un rien de mthode, on arrive russir tout ce quon veut."
Quand il se retrouva dans la rue, bien dtermin sappeler dsormais du Roy,
et mme du Roy de Cantel, il lui sembla quil venait de prendre une importance
nouvelle. Il marchait plus crnement, le front plus haut, la moustache plus re,
comme doit marcher un gentilhomme. Il sentait en lui une sorte denvie joyeuse
de raconter aux passants :
"Je mappelle du Roy de Cantel."
Mais peine rentr chez lui, la pense de Mme de Marelle linquita et il lui
crivit aussitt, an de lui demander un rendez-vous pour le lendemain.
"a sera dur, pensait-il. Je vais recevoir une bourrasque de premier ordre."
Puis il en prit son parti avec linsouciance naturelle qui lui faisait ngliger les
choses dsagrables de la vie, et il se mit faire un article fantaisiste sur les impts
nouveaux tablir an de rassurer lquilibre du budget.
Il y t gurer la particule nobiliaire pour cent francs par an, et les titres, depuis
baron jusqu prince, pour cinq cents jusqu mille francs.
Et il signa : D. de Cantel.
Il reut le lendemain un petit bleu de sa matresse annonant quelle arriverait
une heure.
Il lattendit avec un peu de vre, rsolu dailleurs brusquer les choses, tout
dire ds le dbut, puis, aprs la premire motion, argumenter avec sagesse pour
lui dmontrer quil ne pouvait pas rester garon indniment, et que M. de Ma-
relle sobstinant vivre, il avait d songer une autre quelle pour en faire sa com-
pagne lgitime.
Il se sentait mu cependant. Quand il entendit le coup de sonnette, son cur se
mit battre.
172
Elle se jeta dans ses bras." Bonjour, Bel-Ami."
Puis, trouvant froide son treinte, elle le considra et demanda :
"Quest-ce que tu as ?
- Assieds-toi, dit-il. Nous allons causer srieusement."
Elle sassit sans ter sonchapeau, relevant seulement sa voilette jusquau-dessus
du front, et elle attendit.
Il avait baiss les yeux ; il prparait son dbut. Il commena dune voix lente :
"Ma chre amie, tu me vois fort troubl, fort triste et fort embarrass de ce que
jai tavouer. Je taime beaucoup, je taime vraiment du fond du cur, aussi la
crainte de te faire de la peine mafige-t-elle plus encore que la nouvelle mme
que je vais tapprendre."
Elle plissait, se sentant trembler, et elle balbutia :
"Quest-ce quil y a ? Dis vite !"
Il pronona dun ton triste mais rsolu, avec cet accablement feint dont on use
pour annoncer les malheurs heureux : "Il y a que je me marie."
Elle poussa un soupir de femme qui va perdre connaissance, un soupir doulou-
reux venu du fond de la poitrine, et elle se mit suffoquer, sans pouvoir parler,
tant elle haletait.
Voyant quelle ne disait rien, il reprit :
"Tu ne te gures pas combien jai souffert avant darriver cette rsolution.
Mais je nai ni situation ni argent. Je suis seul, perdu dans Paris. Il me fallait au-
prs de moi quelquun qui ft surtout un conseil, une consolation et un soutien.
Cest une associe, une allie que jai cherche et que jai trouve."
Il se tut, esprant quelle rpondrait, sattendant une colre furieuse, des
violences, des injures.
173
Elle avait appuy une main sur son cur comme pour le contenir et elle respi-
rait toujours par secousses pnibles qui lui soulevaient les seins et lui remuaient
la tte.
Il prit la main reste sur le bras du fauteuil, mais elle la retira brusquement. Puis
elle murmura comme tombe dans une sorte dhbtude :
"Oh!... mon Dieu..."
Il sagenouilla devant elle, sans oser la toucher cependant, et il balbutia, plus
mu par ce silence quil ne let t par des emportements :
"Clo, ma petite Clo, comprends bien ma situation, comprends bien ce que je
suis. Oh! si javais putpouser, toi, quel bonheur ! Mais tues marie. Que pouvais-
je faire ? Rchis, voyons, rchis ! Il faut que je me pose dans le monde, et je ne
le puis pas faire tant que je naurai pas dintrieur. Si tu savais !... Il y a des jours o
javais envie de tuer ton mari..."
Il parlait de sa voix douce, voile, sduisante, une voix qui entrait comme une
musique dans loreille. Il vit deux larmes grossir lentement dans les yeux xes de
sa matresse, puis couler sur ses joues, tandis que deux autres se formaient dj
au bord des paupires.
Il murmura :
"Oh! ne pleure pas, Clo, ne pleure pas, je ten supplie. Tu me fends le cur."
Alors, elle t un effort, un grand effort pour tre digne et re ; et elle demanda
avec ce ton chevrotant des femmes qui vont sangloter :
"Qui est-ce ?"
Il hsita une seconde, puis, comprenant quil le fallait :
"Madeleine Forestier."
Mme de Marelle tressaillit de tout son corps, puis elle demeura muette, son-
geant avec une telle attention quelle paraissait avoir oubli quil tait ses pieds.
174
Et deux gouttes transparentes se formaient sans cesse dans ses yeux, tombaient,
se reformaient encore.
Elle se leva. Duroy devina quelle allait partir sans lui dire un mot, sans re-
proches et sans pardon : et il en fut bless, humili au fond de lme. Voulant la
retenir, il saisit pleins bras sa robe, enlaant travers ltoffe ses jambes rondes
quil sentit se roidir pour rsister.
Il suppliait :
"Je ten conjure, ne ten va pas comme a." Alors elle le regarda, de haut en bas,
elle le regarda avec cet oeil mouill, dsespr, si charmant et si triste qui montre
toute la douleur dun cur de femme, et elle balbutia : "Je nai... je nai rien dire...
je nai... rien faire... Tu... tu as raison... tu... tu... as bien choisi ce quil te fallait..."
Et stant dgage dun mouvement en arrire, elle sen alla, sans quil tentt de
la retenir plus longtemps.
Demeur seul, il se releva, tourdi comme sil avait reu un horion sur la tte ;
puis prenant son parti, il murmura : "Ma foi, tant pis ou tant mieux. a y est...
sans scne. Jaime autant a." Et, soulag dun poids norme, se sentant tout
coup libre, dlivr, laise pour sa vie nouvelle, il se mit boxer contre le mur en
lanant de grands coups de poing, dans une sorte divresse de succs et de force,
comme sil se ft battu contre la Destine.
Quand Mme Forestier lui demanda : "Vous avez prvenu Mme de Marelle ? "
Il rpondit avec tranquillit : "Mais oui..."
Elle le fouillait de son oeil clair.
"Et a ne la pas mue ?
- Mais non, pas du tout. Elle a trouv a trs bien, au contraire."
La nouvelle fut bientt connue. Les uns stonnrent, dautres prtendirent lavoir
prvu, dautres encore sourirent en laissant entendre que a ne les surprenait
point.
175
Le jeune homme qui signait maintenant D. de Cantel ses chroniques, Duroy
ses chos, et du Roy les articles politiques quil commenait donner de temps en
temps, passait la moiti des jours chez sa ance qui le traitait avec une familiarit
fraternelle o entrait cependant une tendresse vraie mais cache, une sorte de
dsir dissimul comme une faiblesse. Elle avait dcid que le mariage se ferait
en grand secret, en prsence des seuls tmoins, et quon partirait le soir mme
pour Rouen. On irait le lendemain embrasser les vieux parents du journaliste, et
on demeurerait quelques jours auprs deux.
Duroy stait efforc de la faire renoncer ce projet, mais nayant pu y parvenir,
il stait soumis, la n.
Donc, le 10 mai tant venu, les nouveaux poux, ayant jug inutiles les crmo-
nies religieuses, puisquils navaient invit personne, rentrrent pour fermer leurs
malles, aprs un court passage la mairie, et ils prirent la gare Saint-Lazare le
train de six heures du soir qui les emporta vers la Normandie.
Ils navaient gure chang vingt paroles jusquau moment o ils se trouvrent
seuls dans le wagon. Ds quils se sentirent en route, ils se regardrent et se mirent
rire, pour cacher une certaine gne, quils ne voulaient point laisser voir.
Le train traversait doucement la longue gare des Batignolles, puis il franchit la
plaine galeuse qui va des fortications la Seine.
Duroy et sa femme, de temps en temps, prononaient quelques mots inutiles,
puis se tournaient de nouveau vers la portire.
Quand ils passrent le pont dAsnires, une gaiet les saisit la vue de la rivire
couverte de bateaux, de pcheurs et de canotiers. Le soleil, un puissant soleil de
mai, rpandait sa lumire oblique sur les embarcations et sur le euve calme qui
semblait immobile, sans courant et sans remous, g sous la chaleur et la clart du
jour nissant. Une barque voile, au milieu de la rivire, ayant tendu sur ses deux
bords deux grands triangles de toile blanche pour cueillir les moindres soufes de
brise, avait lair dun norme oiseau prt senvoler.
Duroy murmura :
"Jadore les environs de Paris, jai des souvenirs de fritures qui sont les meilleurs
de mon existence."
176
Elle rpondit :
"Et les canots ! Comme cest gentil de glisser sur leau au coucher du soleil. "
Puis ils se turent comme sils navaient point os continuer ces panchements
sur leur vie passe, et ils demeurrent muets, savourant peut-tre dj la posie
des regrets.
Duroy, assis en face de sa femme, prit sa main et la baisa lentement.
"Quand nous serons revenus, dit-il, nous irons quelquefois dner Chatou."
Elle murmura :
"Nous aurons tant de choses faire !" sur un ton qui semblait signier : "Il fau-
dra sacrier lagrable lutile."
Il tenait toujours sa main, se demandant avec inquitude par quelle transition
il arriverait aux caresses. Il net point t troubl de mme devant lignorance
dune jeune lle ; mais lintelligence alerte et ruse quil sentait en Madeleine ren-
dait embarrasse son attitude. Il avait peur de lui sembler niais, trop timide ou
trop brutal, trop lent ou trop prompt.
Il serrait cette main par petites pressions, sans quelle rpondt son appel. Il
dit :
"a me semble trs drle que vous soyez ma femme."
Elle parut surprise :
"Pourquoi a ?
- Je ne sais pas. a me semble drle. Jai envie de vous embrasser, et je mtonne
den avoir le droit."
Elle lui tendit tranquillement sa joue, quil baisa comme il et bais celle dune
sur.
177
Il reprit :
"La premire fois que je vous ai vue ( vous savez bien, ce dner o mavait
invit Forestier ), jai pens : " Sacristi, si je pouvais dcouvrir une femme comme
a." Eh bien, cest fait. Je lai."
Elle murmura :
"Cest gentil." Et elle le regardait tout droit, nement, de son oeil toujours sou-
riant.
Il songeait : "Je suis trop froid. Je suis stupide. Je devrais aller plus vite que a."
Et il demanda :
"Comment aviez-vous donc fait la connaissance de Forestier ?"
Elle rpondit, avec une malice provocante :
"Est-ce que nous allons Rouen pour parler de lui ?"
Il rougit : "Je suis bte. Vous mintimidez beaucoup."
Elle fut ravie : "Moi ! Pas possible ? Do vient a ?"
Il stait assis ct delle, tout prs. Elle cria : "Oh! un cerf !"
Le train traversait la fort de Saint-Germain; et elle avait vu un chevreuil effray
franchir dun bond une alle.
Duroy stant pench pendant quelle regardait par la portire ouverte posa un
long baiser, un baiser damant dans les cheveux de son cou.
Elle demeura quelques moments immobile ; puis, relevant la tte :
"Vous me chatouillez, nissez."
Mais il ne sen allait point, promenant doucement, en une caresse nervante et
prolonge, sa moustache frise sur la chair blanche.
178
Elle se secoua :
"Finissez donc."
Il avait saisi la tte de sa main droite glisse derrire elle, et il la tournait vers lui.
Puis il se jeta sur sa bouche comme un pervier sur une proie.
Elle se dbattait, le repoussait, tchait de se dgager. Elle y parvint enn, et r-
pta :
"Mais nissez donc."
Il ne lcoutait, plus, ltreignant, la baisant dune lvre avide et frmissante,
essayant de la renverser sur les coussins du wagon.
Elle se dgagea dun grand effort, et, se levant avec vivacit :
"Oh! voyons, Georges, nissez. Nous ne sommes pourtant plus des enfants,
nous pouvons bien attendre Rouen."
Il demeurait assis, trs rouge, et glac par ces mots raisonnables ; puis, ayant
repris quelque sang-froid :
"Soit, jattendrai, dit-il avec gaiet, mais je ne suis plus chu de prononcer vingt
paroles jusqu larrive. Et songez que nous traversons Poissy.
- Cest moi qui parlerai", dit-elle.
Elle se rassit doucement auprs de lui.
Et elle parla, avec prcision, de ce quils feraient leur retour. Ils devaient conser-
ver lappartement quelle habitait avec son premier mari, et Duroy hritait aussi
des fonctions et du traitement de Forestier La Vie Franaise.
Avant leur union, du reste, elle avait rgl, avec une sret dhomme daffaires,
tous les dtails nanciers du mnage.
179
Ils staient associs sous le rgime de la sparation de biens, et tous les cas
taient prvus qui pouvaient survenir : mort, divorce, naissance dun ou de plu-
sieurs enfants. Le jeune homme apportait quatre mille francs, disait-il, mais, sur
cette somme, il en avait emprunt quinze cents. Le reste provenait dconomies
faites dans lanne, en prvision de lvnement. La jeune femme apportait qua-
rante mille francs que lui avait laisss Forestier, disait-elle.
Elle revint lui, citant son exemple :
"Ctait un garon trs conome, trs rang, trs travailleur. Il aurait fait fortune
en peu de temps. "
Duroy ncoutait plus, tout occup dautres penses.
Elle sarrtait parfois pour suivre une ide intime, puis reprenait :
"Dici trois ou quatre ans, vous pouvez fort bien gagner de trente quarante
mille francs par an. Cest ce quaurait eu Charles, sil avait vcu."
Georges, qui commenait trouver longue la leon, rpondit :
"Il me semblait que nous nallions pas Rouen pour parler de lui."
Elle lui donna une petite tape sur la joue :
"Cest vrai, jai tort."
Elle riait.
Il affectait de tenir ses mains sur ses genoux, comme les petits garons bien
sages.
"Vous avez lair niais, comme a", dit-elle.
Il rpliqua :
"Cest mon rle, auquel vous mavez dailleurs rappel tout lheure, et je nen
sortirai plus.
180
- Pourquoi ?
- Parce que cest vous qui prenez la direction de la maison, et mme celle de ma
personne. Cela vous regarde, en effet, comme veuve !"
Elle fut tonne :
"Que voulez-vous dire au juste ?
- Que vous avez une exprience qui doit dissiper mon ignorance, et une pra-
tique du mariage qui doit dgourdir mon innocence de clibataire, voil, na !"
Elle scria :
"Cest trop fort !"
Il rpondit :
"Cest comme a. Je ne connais pas les femmes, moi, - na, - et vous connaissez
les hommes, vous, puisque vous tes veuve, - na, - cest vous qui allez faire mon
ducation... ce soir, - na, - et vous pouvez mme commencer tout de suite, si vous
voulez, - na."
Elle scria, trs gaye :
"Oh! par exemple, si vous comptez sur moi pour a !..."
Il pronona, avec une voix de collgien qui bredouille sa leon :
"Mais oui, - na, - jy compte. Je compte mme que vous me donnerez une ins-
truction solide... en vingt leons... dix pour les lments... la lecture et la gram-
maire... dix pour les perfectionnements et la rhtorique... Je ne sais rien, moi -
na."
Elle scria, samusant beaucoup :
"Tes bte."
181
Il reprit :
"Puisque tu commences par me tutoyer, jimiterai aussitt cet exemple, et je te
dirai, mon amour, que je tadore de plus en plus, de seconde en seconde, et que je
trouve Rouen bien loin!"
Il parlait maintenant avec des intonations dacteur, avec un jeu plaisant de -
gure qui divertissaient la jeune femme habitue aux manires et aux joyeusets de
la grande bohme des hommes de lettres.
Elle le regardait de ct, le trouvant vraiment charmant, prouvant lenvie quon
a de croquer unfruit sur larbre, et lhsitationdu raisonnement qui conseille dat-
tendre le dner pour le manger son heure.
Alors elle dit, devenant un peu rouge aux penses qui lassaillaient :
"Mon petit lve, croyez mon exprience, ma grande exprience. Les baisers en
wagon ne valent rien. Ils tournent sur lestomac."
Puis elle rougit davantage encore, en murmurant :
"Il ne faut jamais couper son bl en herbe."
Il ricanait, excit par les sous-entendus quil sentait glisser dans cette jolie bouche ;
et il t le signe de la croix avec un marmottement des lvres, comme sil et mur-
mur une prire, puis il dclara :
"Je viens de me mettre sous la protection de saint Antoine, patron des Tenta-
tions. Maintenant, je suis de bronze."
La nuit venait doucement, enveloppant dombre transparente, comme duncrpe
lger, la grande campagne qui stendait droite. Le train longeait la Seine, et les
jeunes gens se mirent regarder dans le euve, droul comme un large ruban de
mtal poli ct de la voie, des reets rouges, des taches tombes du ciel que le
soleil en sen allant avait frott de pourpre et de feu. Ces lueurs steignaient peu
peu, devenaient fonces, sassombrissant tristement. Et la campagne se noyait
dans le noir, avec ce frisson sinistre, ce frisson de mort que chaque crpuscule fait
passer sur la terre.
182
Cette mlancolie du soir entrant par la portire ouverte pntrait les mes, si
gaies tout lheure, des deux poux devenus silencieux.
Ils staient rapprochs lun de lautre pour regarder cette agonie du jour, de ce
beau jour clair de mai.
A Mantes, on avait allum le petit quinquet lhuile qui rpandait sur le drap
gris des capitons sa clart jaune et tremblotante.
Duroy enlaa la taille de sa femme et la serra contre lui. Son dsir aigu de tout
lheure devenait de la tendresse, une tendresse alanguie, une envie molle de me-
nues caresses consolantes, de ces caresses dont on berce les enfants.
Il murmura, tout bas :
"Je taimerai bien, ma petite Made."
La douceur de cette voix mut la jeune femme, lui t passer sur la chair un fr-
missement rapide, et elle offrit sa bouche, en se penchant vers lui, car il avait pos
sa joue sur le tide appui des seins.
Ce fut un trs long baiser, muet et profond, puis un sursaut, une brusque et folle
treinte, une courte lutte essoufe, un accouplement violent et maladroit. Puis
ils restrent aux bras lun de lautre, un peu dus tous deux, las et tendres encore,
jusqu ce que le sifet du train annont une gare prochaine.
Elle dclara, entapotant dubout des doigts les cheveux bouriffs de ses tempes :
"Cest trs bte. Nous sommes des gamins."
Mais il lui baisait les mains, allant de lune lautre avec une rapidit vreuse
et il rpondit :
"Je tadore, ma petite Made."
Jusqu Rouen ils demeurrent presque immobiles, la joue contre la joue, les
yeux dans la nuit de la portire o lon voyait passer parfois les lumires des mai-
sons ; et ils rvassaient, contents de se sentir si proches et dans lattente grandis-
sante dune treinte plus intime et plus libre.
183
Ils descendirent dans un htel dont les fentres donnaient sur le quai, et ils se
mirent au lit aprs avoir un peu soup, trs peu. La femme de chambre les rveilla,
le lendemain, lorsque huit heures venaient de sonner.
Quand ils eurent bu la tasse de th pose sur la table de nuit, Duroy regarda sa
femme, puis brusquement avec llan joyeux dun homme heureux qui vient de
trouver un trsor, il la saisit dans ses bras, en balbutiant :
"Ma petite Made, je sens que je taime beaucoup... beaucoup... beaucoup..."
Elle souriait de son sourire conant et satisfait et elle murmura, en lui rendant
ses baisers :
"Et moi aussi... peut-tre."
Mais il demeurait inquiet de cette visite ses parents.
Il avait dj souvent prvenu sa femme ; il lavait prpare, sermonne. Il crut
bon de recommencer.
"Tu sais, ce sont des paysans, des paysans de campagne, et non pas dopra-
comique."
Elle riait :
"Mais je le sais, tu me las assez dit. Voyons, lve-toi et laisse-moi me lever
aussi."
Il sauta du lit, et mettant ses chaussettes :
"Nous serons trs mal la maison, trs mal. Il ny a quun vieux lit paillasse
dans ma chambre. On ne connat pas les sommiers, Canteleu."
Elle semblait enchante :
"Tant mieux. Ce sera charmant de mal dormir... auprs de... auprs de toi... et
dtre rveille par le chant des coqs."
184
Elle avait pass son peignoir, un grand peignoir de anelle blanche, que Duroy
reconnut aussitt. Cette vue lui fut dsagrable. Pourquoi ? Sa femme possdait, il
le savait bien, une douzaine entire de ces vtements de matine. Elle ne pouvait
pourtant point dtruire son trousseau pour en acheter un neuf ? Nimporte, il et
voulu que son linge de chambre, son linge de nuit, son linge damour ne ft plus
le mme quavec lautre. Il lui semblait que ltoffe moelleuse et tide devait avoir
gard quelque chose du contact de Forestier.
Et il alla vers la fentre en allumant une cigarette. La vue du port, du large euve
plein de navires aux mts lgers, de vapeurs trapus, que des machines tournantes
vidaient grand bruit sur les quais, le remua, bien quil connt cela depuis long-
temps. Et il scria :
"Bigre, que cest beau!"
Madeleine accourut et posant ses deux mains sur une paule de son mari, pen-
che vers lui dans un geste abandonn, elle demeura ravie, mue. Elle rptait :
"Oh! que cest joli ! que cest joli ! Je ne savais pas quil y et tant de bateaux que
a ?"
Ils partirent une heure plus tard, car ils devaient djeuner chez les vieux, pr-
venus depuis quelques jours. Un acre dcouvert et rouill les emporta avec un
bruit de chaudronnerie secoue. Ils suivirent un long boulevard assez laid, puis
traversrent des prairies o coulait une rivire, puis ils commencrent gravir la
cte.
Madeleine, fatigue, stait assoupie sous la caresse pntrante du soleil qui la
chauffait dlicieusement au fond de la vieille voiture, comme si elle et t cou-
che dans un bain tide de lumire et dair champtre.
Son mari la rveilla.
"Regarde", dit-il.
Ils venaient de sarrter aux deux tiers de la monte, unendroit renomm pour
la vue, o lon conduit tous les voyageurs.
185
On dominait limmense valle, longue et large, que le euve clair parcourait
dunbout lautre, avec de grandes ondulations. Onle voyait venir de l-bas, tach
par des les nombreuses et dcrivant une courbe avant de traverser Rouen. Puis la
ville apparaissait sur la rive droite, un peu noye dans la brume matinale, avec
des clats de soleil sur ses toits, et ses mille clochers lgers, pointus ou trapus,
frles et travaills comme des bijoux gants, ses tours carres ou rondes coiffes
de couronnes hraldiques, ses beffrois, ses clochetons, tout le peuple gothique
des sommets dglises que dominait la che aigu de la cathdrale, surprenante
aiguille de bronze, laide, trange et dmesure, la plus haute qui soit au monde.
Mais en face, de lautre ct du euve, slevaient, rondes et renes leur fate,
les minces chemines dusines du vaste faubourg de Saint-Sever.
Plus nombreuses que leurs frres les clochers, elles dressaient jusque dans la
campagne lointaine leurs longues colonnes de briques et soufaient dans le ciel
bleu leur haleine noire de charbon.
Et la plus leve de toutes, aussi haute que la pyramide de Chops, le second
des sommets dus au travail humain, presque lgale de sa re commre la che
de la cathdrale, la grande pompe feu de la Foudre semblait la reine du peuple
travailleur et fumant des usines, comme sa voisine tait la reine de la foule pointue
des monuments sacrs.
L-bas, derrire la ville ouvrire, stendait une fort de sapins ; et la Seine, ayant
pass entre les deux cits, continuait sa route, longeait une grande cte onduleuse
boise en haut et montrant par place ses os de pierre blanche, puis elle disparais-
sait lhorizon aprs avoir encore dcrit une longue courbe arrondie. On voyait
des navires montant et descendant le euve, trans par des barques vapeur
grosses comme des mouches et qui crachaient une fume paisse. Des les, ta-
les sur leau, salignaient toujours lune au bout de lautre, ou bien laissant entre
elles de grands intervalles, comme les grains ingaux dun chapelet verdoyant.
Le cocher duacre attendait que les voyageurs eussent ni de sextasier. Il connais-
sait par exprience la dure de ladmiration de toutes les races de promeneurs.
Mais quand il se remit en marche, Duroy aperut soudain, quelques centaines
de mtres, deux vieilles gens qui sen venaient, et il sauta de la voiture, en criant :
"Les voil. Je les reconnais."
186
Ctaient deux paysans, lhomme et la femme, qui marchaient dun pas rgu-
lier, en se balanant et se heurtant parfois de lpaule. Lhomme tait petit, trapu,
rouge et un peu ventru, vigoureux malgr son ge ; la femme, grande, sche, vo-
te, triste, la vraie femme de peine des champs qui a travaill ds lenfance et qui
na jamais ri, tandis que le mari blaguait en buvant avec les pratiques.
Madeleine aussi tait descendue de voiture et elle regardait venir ces deux pauvres
tres avec un serrement de cur, une tristesse quelle navait point prvue. Ils ne
reconnaissaient point leur ls, ce beau monsieur, et ils nauraient jamais devin
leur bru dans cette belle dame en robe claire.
Ils allaient, sans parler et vite, au-devant de lenfant attendu, sans regarder ces
personnes de la ville que suivait une voiture.
Ils passaient. Georges, qui riait, cria :
"Bonjour, p Duroy."
Ils sarrtrent net, tous les deux, stupfaits dabord, puis abrutis de surprise. La
vieille se remit la premire et balbutia, sans faire un pas :
"Cest-i t, not eu?"
Le jeune homme rpondit :
"Mais oui, cest moi, la m Duroy !" et marchant elle, il lembrassa sur les deux
joues, dun gros baiser de ls. Puis il frotta ses tempes contre les tempes du pre,
qui avait t sa casquette, une casquette la mode de Rouen, en soie noire, trs
haute, pareille celle des marchands de bufs.
Puis Georges annona : "Voil ma femme." Et les deux campagnards regardrent
Madeleine. Ils la regardrent comme on regarde un phnomne, avec une crainte
inquite, jointe une sorte dapprobation satisfaite chez le pre, une inimiti
jalouse chez la mre.
Lhomme, qui tait dun naturel joyeux, tout imbib par une gaiet de cidre
doux et dalcool, senhardit et demanda, avec une malice au coin de loeil :
"Jpouvons-ti lembrasser tout dmme ?"
187
Le ls rpondit : "Parbleu." Et Madeleine, mal laise, tendit ses deux joues aux
bcots sonores du paysan qui sessuya ensuite les lvres dun revers de main.
La vieille, son tour, baisa sa belle-lle avec une rserve hostile. Non, ce ntait
point la bru de ses rves, la grosse et frache fermire, rouge comme une pomme
et ronde comme une jument poulinire. Elle avait lair dune trane, cette dame-
l, avec ses falbalas et son musc. Car tous les parfums, pour la vieille, taient du
musc.
Et on se remit en marche la suite du acre qui portait la malle des nouveaux
poux.
Le vieux prit son ls par le bras, et le retenant en arrire, il demanda avec int-
rt :
"Eh ben, a va-t-il, les affaires ?
- Mais oui, trs bien.
- Allons suft, tant mieux ! Dis-m, ta femme, est-i aise ? "
Georges rpondit :
"Quarante mille francs."
Le pre poussa unlger sifement dadmirationet ne put que murmurer : "Bougre !"
tant il fut mu par la somme. Puis il ajouta avec une conviction srieuse : "Nom
dun nom, cest une belle femme. " Car il la trouvait de son got, lui. Et il avait
pass pour connaisseur, dans le temps.
Madeleine et la mre marchaient cte cte, sans dire unmot. Les deux hommes
les rejoignirent.
On arrivait au village, un petit village en bordure sur la route, form de dix mai-
sons de chaque ct, maisons de bourg et masures de fermes, les unes en briques,
les autres en argile, celles-ci coiffes de chaume et celles-l dardoise. La caf du
pre Duroy : "A la belle vue", une bicoque compose dun rez-de-chausse et dun
grenier, se trouvait lentre dupays, gauche. Une branche de pin, accroche sur
la porte, indiquait, la mode ancienne, que les gens altrs pouvaient entrer.
188
Le couvert tait mis dans la salle du cabaret, sur deux tables rapproches et
caches par deux serviettes. Une voisine, venue pour aider au service, salua dune
grande rvrence en voyant apparatre une aussi belle dame, puis reconnaissant
Georges, elle scria : "Seigneur Jsus, cest-i t, petiot ?"
Il rpondit gaiement :
"Oui, cest moi, la m Brulin!"
Et il lembrassa aussitt comme il avait embrass pre et mre.
Puis il se tourna vers sa femme :
"Viens dans notre chambre, dit-il, tu te dbarrasseras de ton chapeau. "
Il la t entrer par la porte de droite dans une pice froide, carrele, toute blanche,
avec ses murs peints la chaux et son lit aux rideaux de coton. Un crucix au-
dessus dun bnitier, et deux images colories reprsentant Paul et Virginie sous
un palmier bleu et Napolon Ier sur un cheval jaune, ornaient seuls cet apparte-
ment propre et dsolant.
Ds quils furent seuls, il embrassa Madeleine :
"Bonjour, Made. Je suis content de revoir les vieux. Quand on est Paris, on ny
pense pas, et puis quand on se retrouve, a fait plaisir tout de mme."
Mais le pre criait en tapant du poing la cloison :
"Allons, allons, la soupe est cuite."
Et il fallut se mettre table.
Ce fut un long djeuner de paysans avec une suite de plats mal assortis, une
andouille aprs un gigot, une omelette aprs landouille. Le pre Duroy, mis en
joie par le cidre et quelques verres de vin, lchait le robinet de ses plaisanteries
de choix, celles quil rservait pour les grandes ftes, histoires grivoises et mal-
propres arrives ses amis, afrmait-il. Georges, qui les connaissait toutes, riait
189
cependant, gris par lair natal, ressaisi par lamour inn du pays, des lieux fami-
liers dans lenfance, par toutes les sensations, tous les souvenirs retrouvs, toutes
les choses dautrefois revues, des riens, une marque de couteau dans une porte,
une chaise boiteuse rappelant un petit fait, des odeurs de sol, le grand soufe de
rsine et darbres venu de la fort voisine, les senteurs du logis, du ruisseau, du
fumier.
La mre Duroy ne parlait point, toujours triste et svre, piant de loeil sa bru
avec une haine veille dans le cur, une haine de vieille travailleuse, de vieille
rustique aux doigts uss, aux membres dforms par les dures besognes, contre
cette femme de ville qui lui inspirait une rpulsion de maudite, de rprouve,
dtre impur fait pour la fainantise et le pch. Elle se levait tout moment pour
aller chercher les plats, pour verser dans les verres la boisson jaune et aigre de la
carafe ou le cidre doux mousseux et sucr des bouteilles dont le bouchon sautait
comme celui de la limonade gazeuse.
Madeleine ne mangeait gure, ne parlait gure, demeurait triste avec son sou-
rire ordinaire g sur les lvres, mais un sourire morne, rsign. Elle tait due,
navre. Pourquoi ? Elle avait voulu venir. Elle nignorait point quelle allait chez
des paysans, chez des petits paysans. Comment les avait-elle donc rvs, elle qui
ne rvait pas dordinaire ?
Le savait-elle ? Est-ce que les femmes nesprent point toujours autre chose que
ce qui est ! Les avait-elle vus de loin plus potiques ? Non, mais plus littraires
peut-tre, plus nobles, plus affectueux, plus dcoratifs. Pourtant elle ne les dsirait
point distingus comme ceux des romans. Do venait donc quils la choquaient
par mille choses menues, invisibles, par mille grossirets insaisissables, par leur
nature mme de rustres, par ce quils disaient, par leurs gestes et leur gaiet ?
Elle se rappelait sa mre elle, dont elle ne parlait jamais personne, une insti-
tutrice sduite, leve Saint-Denis et morte de misre et de chagrin quand Ma-
deleine avait douze ans. Un inconnu avait fait lever la petite lle. Son pre, sans
doute ? Qui tait-il ? Elle ne le sut point au juste, bien quelle et de vagues soup-
ons.
Le djeuner ne nissait pas. Des consommateurs entraient maintenant, ser-
raient les mains du pre Duroy, sexclamaient en voyant le ls, et, regardant de
ct la jeune femme, clignaient de loeil avec malice ; ce qui signiait : "Sacr m-
tin! elle nest pas pique des vers, lpouse Georges Duroy."
190
Dautres, moins intimes, sasseyaient devant les tables de bois, et criaient : " Un
litre ! - Une chope ! -
Deux nes ! - Un raspail !" Et ils se mettaient jouer aux dominos en tapant
grand bruit les petits carrs dos blancs et noirs.
La mre Duroy ne cessait plus daller et de venir, servant les pratiques avec son
air lamentable, recevant largent, essuyant les tables du coin de son tablier bleu.
La fume des pipes de terre et des cigares dunsouemplissait la salle. Madeleine
se mit tousser et demanda : "Si nous sortions ? je nen puis plus."
On navait point encore ni. Le vieux Duroy fut mcontent. Alors elle se leva et
alla sasseoir sur une chaise, devant la porte, sur la route, en attendant que son
beau-pre et son mari eussent achev leur caf et leurs petits verres.
Georges la rejoignit bientt.
"Veux-tu dgringoler jusqu la Seine ?" dit-il.
Elle accepta avec joie :
"Oh! oui. Allons."
Ils descendirent la montagne, lourent un bateau Croisset, et ils passrent le
reste de laprs-midi le long dune le, sous les saules, somnolents tous deux, dans
la chaleur douce du printemps, et bercs par les petites vagues du euve.
Puis ils remontrent la nuit tombante.
Le repas du soir, la lueur dune chandelle, fut plus pnible encore pour Ma-
deleine que celui du matin. Le pre Duroy, qui avait une demi-solerie, ne parlait
plus. La mre gardait sa mine revche.
La pauvre lumire jetait sur les murs gris les ombres des ttes avec des nez
normes et des gestes dmesurs. On voyait parfois une main gante lever une
fourchette pareille une fourche vers une bouche qui souvrait comme une gueule
de monstre, quandquelquun, se tournant unpeu, prsentait sonprol la amme
jaune et tremblotante.
191
Ds que le dner fut achev, Madeleine entrana son mari dehors pour ne point
demeurer dans cette salle sombre o ottait toujours une odeur cre de vieilles
pipes et de boissons rpandues.
Quand ils furent sortis :
"Tu tennuies dj", dit-il.
Elle voulut protester. Il larrta :
"Non. Je lai bien vu. Si tu le dsires, nous partirons demain."
Elle murmura :
"Oui. Je veux bien."
Ils allaient devant eux doucement. Ctait une nuit tide dont lombre cares-
sante et profonde semblait pleine de bruits lgers, de frlements, de soufes. Ils
taient entrs dans une alle troite, sous des arbres trs hauts, entre deux taillis
dun noir impntrable.
Elle demanda :
"O sommes-nous ?"
Il rpondit :
"Dans la fort.
- Elle est grande ?
- Trs grande, une des plus grandes de la France."
Une senteur de terre, darbres, de mousse, ce parfumfrais et vieux des bois touf-
fus, fait de la sve des bourgeons et de lherbe morte et moisie des fourrs, sem-
blait dormir dans cette alle. En levant la tte, Madeleine apercevait des toiles
entre les sommets des arbres, et bien quaucune brise ne remut les branches,
elle sentait autour delle la vague palpitation de cet ocan de feuilles.
192
Un frisson singulier lui passa dans lme et lui courut sur la peau; une angoisse
confuse lui serra le cur. Pourquoi ? Elle ne comprenait pas. Mais il lui semblait
quelle tait perdue, noye, entoure de prils, abandonne de tous, seule, seule
au monde, sous cette vote vivante qui frmissait l-haut.
Elle murmura :
"Jai un peu peur. Je voudrais retourner.
- Eh bien, revenons.
- Et... nous repartirons pour Paris demain?
- Oui, demain..
- Demain matin?
- Demain matin, si tu veux."
Ils rentrrent. Les vieux taient couchs. Elle dormit mal, rveille sans cesse
par tous les bruits nouveaux pour elle de la campagne, les cris des chouettes, le
grognement dun porc enferm dans une hutte contre le mur, et le chant dun coq
qui claironna ds minuit.
Elle fut leve et prte partir aux premires lueurs de laurore.
Quand Georges annona aux parents quil allait sen retourner, ils demeurrent
saisis tous deux, puis ils comprirent do venait cette volont.
Le pre demanda simplement :
"J te rverrons-ti bientt ?
- Mais oui. Dans le courant de lt.
- Allons, tant mieux."
La vieille grogna :
193
"J te souhaite de n point regretter cque tas fait."
Il leur laissa deux cents francs en cadeau, pour calmer leur mcontentement ; et
le acre, quun gamin tait all chercher, ayant paru vers dix heures, les nouveaux
poux embrassrent les vieux paysans et repartirent.
Comme ils descendaient la cte, Duroy se mit rire :
"Voil, dit-il, je tavais prvenue. Je naurais pas d te faire connatre M. et Mme
du Roy de Cantel, pre et mre. "
Elle se mit rire aussi, et rpliqua :
"Je suis enchante maintenant. Ce sont de braves gens que je commence ai-
mer beaucoup. Je leur enverrai des gteries de Paris."
Puis elle murmura :
"Du Roy de Cantel... Tu verras que personne ne stonnera de nos lettres de
faire-part. Nous raconterons que nous avons pass huit jours dans la proprit de
tes parents."
Et, se rapprochant de lui, elle efeura dun baiser le bout de sa moustache : "
Bonjour, Geo!"
Il rpondit : "Bonjour, Made", en passant une main derrire sa taille.
On apercevait au loin, dans le fond de la valle, le grand euve droul comme
un ruban dargent sous le soleil du matin, et toutes les chemines des usines qui
soufaient dans le ciel leurs nuages de charbon, et tous les clochers pointus dres-
ss sur la vieille cit.
194
Chapitre 10
Les Du Roy taient rentrs Paris depuis deux jours et le journaliste avait re-
pris son ancienne besogne en attendant quil quittt le service des chos pour
semparer dnitivement des fonctions de Forestier et se consacrer tout fait la
politique.
Il remontait chez lui, ce soir-l, au logis de son prdcesseur, le cur joyeux,
pour dner, avec le dsir veill dembrasser tout lheure sa femme dont il subis-
sait vivement le charme physique et linsensible domination. En passant devant
un euriste, au bas de la rue Notre-Dame-de-Lorette, il eut lide dacheter un
bouquet pour Madeleine et il prit une grosse botte de roses peine ouvertes, un
paquet de boutons parfums.
A chaque tage de son nouvel escalier il se regardait complaisamment dans
cette glace dont la vue lui rappelait sans cesse sa premire entre dans la maison.
Il sonna, ayant oubli sa clef, et le mme domestique, quil avait gard aussi sur
le conseil de sa femme, vint ouvrir.
Georges demanda :
"Madame est rentre ?
- Oui, monsieur."
Mais en traversant la salle manger il demeura fort surpris dapercevoir trois
couverts ; et, la portire dusalontant souleve, il vit Madeleine qui disposait dans
unvase de la chemine une botte de roses toute pareille la sienne. Il fut contrari,
mcontent, comme si on lui et vol son ide, son attention et tout le plaisir quil
en attendait.
195
Il demanda en entrant :
"Tu as donc invit quelquun?"
Elle rpondit sans se retourner, en continuant arranger ses eurs : "Oui et
non. Cest mon vieil ami le comte de Vaudrec qui a lhabitude de dner ici tous les
lundis, et qui vient comme autrefois."
Georges murmura :
"Ah! trs bien."
Il restait debout derrire elle, sonbouquet la main, avec une envie de le cacher,
de le jeter. Il dit cependant :
"Tiens, je tai apport des roses !"
Elle se retourna brusquement, toute souriante, criant :
"Ah! que tu es gentil davoir pens a."
Et elle lui tendit ses bras et ses lvres avec un lan de plaisir si vrai quil se sentit
consol.
Elle prit les eurs, les respira, et, avec une vivacit denfant ravie, les plaa dans
le vase rest vide en face du premier. Puis elle murmura en regardant leffet :
"Que je suis contente ! Voil ma chemine garnie maintenant."
Elle ajouta, presque aussitt, dun air convaincu :
"Tu sais, il est charmant, Vaudrec, tu seras tout de suite intime avec lui. "
Un coup de timbre annona le comte. Il entra, tranquille, trs laise, comme
chez lui. Aprs avoir bais galamment les doigts de la jeune femme il se tourna
vers le mari et lui tendit la main avec cordialit en demandant :
"a va bien, mon cher Du Roy ?"
196
Il navait plus son air roide, son air gourm de jadis, mais un air affable, rv-
lant bien que la situation ntait plus la mme. Le journaliste, surpris, tcha de se
montrer gentil pour rpondre ces avances. On et cru, aprs cinq minutes, quils
se connaissaient et sadoraient depuis dix ans.
Alors Madeleine, dont le visage tait radieux, leur dit :
"Je vous laisse ensemble. Jai besoin de jeter un coup doeil ma cuisine." Et
elle se sauva, suivie par le regard des deux hommes.
Quand elle revint, elle les trouva causant thtre, propos dune pice nouvelle,
et si compltement du mme avis quune sorte damiti rapide sveillait dans
leurs yeux la dcouverte de cette absolue parit dides.
Le dner fut charmant, tout intime et cordial ; et le comte demeura fort tard dans
la soire, tant il se sentait bien dans cette maison, dans ce joli nouveau mnage.
Ds quil fut parti, Madeleine dit son mari :
"Nest-ce pas quil est parfait ? Il gagne du tout au tout tre connu. En voil un
bon ami, sr, dvou, dle. Ah! sans lui..."
Elle nacheva point sa pense, et Georges rpondit :
"Oui, je le trouve fort agrable. Je crois que nous nous entendrons trs bien."
Mais elle reprit aussitt :
"Tune sais pas, nous avons travailler, ce soir, avant de nous coucher. Je nai pas
eu le temps de te parler de a avant le dner, parce que Vaudrec est arriv tout de
suite. On ma apport des nouvelles graves, tantt, des nouvelles du Maroc. Cest
Laroche-Mathieu le dput, le futur ministre, qui me les a donnes. Il faut que
nous fassions un grand article, un article sensation. Jai des faits et des chiffres.
Nous allons nous mettre la besogne immdiatement. Tiens, prends la lampe."
Il la prit et ils passrent dans le cabinet de travail.
197
Les mmes livres salignaient dans la bibliothque qui portait maintenant sur
son fate les trois vases achets au golfe Juan par Forestier, la veille de son dernier
jour. Sous la table, la chancelire du mort attendait les pieds de Du Roy, qui sem-
para, aprs stre assis, du porte-plume divoire, un peu mch au bout par la dent
de lautre.
Madeleine sappuya la chemine, et ayant allum une cigarette, elle raconta
ses nouvelles, puis exposa ses ides, et le plan de larticle quelle rvait.
Il lcoutait avec attention, tout en griffonnant des notes, et quand il eut ni
il souleva des objections, reprit la question, lagrandit, dveloppa son tour non
plus un plan darticle, mais un plan de campagne contre le ministre actuel. Cette
attaque serait le dbut. Sa femme avait cess de fumer, tant son intrt sveillait,
tant elle voyait large et loin en suivant la pense de Georges.
Elle murmurait de temps en temps :
"Oui... oui... Cest trs bon... Cest excellent... Cest trs fort..."
Et quand il eut achev, son tour, de parler :
"Maintenant crivons", dit-elle.
Mais il avait toujours le dbut difcile et il cherchait ses mots avec peine. Alors
elle vint doucement se pencher sur son paule et elle se mit lui soufer ses
phrases tout bas, dans loreille.
De temps en temps elle hsitait et demandait :
"Est-ce bien a que tu veux dire ?"
Il rpondait :
"Oui, parfaitement."
Elle avait des traits piquants, des traits venimeux de femme pour blesser le chef
duConseil, et elle mlait des railleries sur sonvisage celles sur sa politique, dune
faon drle qui faisait rire et saisissait en mme temps par la justesse de lobser-
vation.
198
Du Roy, parfois, ajoutait quelques lignes qui rendaient plus profonde et plus
puissante la porte dune attaque. Il savait, en outre, lart des sous-entendus per-
des, quil avait appris enaiguisant des chos, et quand unfait donn pour certain
par Madeleine lui paraissait douteux ou compromettant, il excellait le faire de-
viner et limposer lesprit avec plus de force que sil let afrm.
Quand leur article fut termin, Georges le relut tout haut, en le dclamant. Ils
le jugrent admirable dun commun accord et ils se souriaient, enchants et sur-
pris, comme sils venaient de se rvler lun lautre. Ils se regardaient au fond
des yeux, mus dadmiration et dattendrissement, et ils sembrassrent avec lan,
avec une ardeur damour communique de leurs esprits leurs corps.
Du Roy reprit la lampe : "Et maintenant, dodo", dit-il avec un regard allum.
Elle rpondit :
"Passez, mon matre, puisque vous clairez la route."
Il passa, et elle le suivit dans leur chambre en lui chatouillant le cou du bout du
doigt, entre le col et les cheveux pour le faire aller plus vite, car il redoutait cette
caresse.
Larticle parut sous la signature de Georges Du Roy de Cantel, et t grand bruit.
On sen mut la Chambre. Le pre Walter en flicita lauteur et le chargea de la
rdaction politique de La Vie Franaise. Les chos revinrent Boisrenard.
Alors commena, dans le journal, une campagne habile et violente contre le
ministre qui dirigeait les affaires. Lattaque, toujours adroite et nourrie de faits,
tantt ironique, tantt srieuse, parfois plaisante, parfois virulente, frappait avec
une sret et une continuit dont tout le monde stonnait. Les autres feuilles ci-
taient sans cesse La Vie Franaise, y coupaient des passages entiers, et les hommes
du pouvoir sinformrent si on ne pouvait pas billonner avec une prfecture cet
ennemi inconnu et acharn.
Du Roy devenait clbre dans les groupes politiques. Il sentait grandir son in-
uence la pression des poignes de main et lallure des coups de chapeau. Sa
femme, dailleurs, lemplissait de stupeur et dadmiration par lingniosit de son
esprit, lhabilet de ses informations et le nombre de ses connaissances.
199
A tout moment, il trouvait dans son salon, en rentrant chez lui, un snateur,
un dput, un magistrat, un gnral, qui traitaient Madeleine en vieille amie, avec
une familiarit srieuse. Oavait-elle connutous ces gens ? Dans le monde, disait-
elle. Mais comment avait-elle su capter leur conance et leur affection? Il ne le
comprenait pas.
"a ferait une rude diplomate", pensait-il.
Elle rentrait souvent en retard aux heures des repas, essoufe, rouge frmis-
sante, et, avant mme davoir t son voile, elle disait :
"Jen ai du nanan, aujourdhui. Figure-toi que le ministre de la Justice vient de
nommer deux magistrats qui ont fait partie des commissions mixtes. Nous allons
lui anquer un abattage dont il se souviendra."
Et on anquait un abattage au ministre, et on lui en reanquait un autre le len-
demain et un troisime le jour suivant. Le dput Laroche-Mathieu qui dnait rue
Fontaine tous les mardis, aprs le comte de Vaudrec qui commenait la semaine,
serrait vigoureusement les mains de la femme et du mari avec des dmonstra-
tions de joie excessives. Il ne cessait de rpter : "Cristi, quelle campagne. Si nous
ne russissons pas aprs a ?"
Il esprait bienrussir eneffet dcrocher le portefeuille des Affaires trangres
quil visait depuis longtemps.
Ctait un de ces hommes politiques plusieurs faces, sans conviction, sans
grands moyens, sans audace et sans connaissances srieuses, avocat de province,
joli homme de chef-lieu, gardant un quilibre de naud entre tous les partis ex-
trmes, sorte de jsuite rpublicain et de champignon libral de nature douteuse,
comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel.
Son machiavlisme de village le faisait passer pour fort parmi ses collgues,
parmi tous les dclasss et les avorts dont on fait des dputs. Il tait assez soi-
gn, assez correct, assez familier, assez aimable pour russir. Il avait des succs
dans le monde, dans la socit mle, trouble et peu ne des hauts fonctionnaires
du moment.
On disait partout de lui : "Laroche sera ministre", et il pensait aussi plus ferme-
ment que tous les autres que Laroche serait ministre.
200
Il tait un des principaux actionnaires du journal du pre Walter, son collgue
et son associ en beaucoup daffaires de nances.
Du Roy le soutenait avec conance et avec des esprances confuses pour plus
tard. Il ne faisait que continuer dailleurs luvre commence par Forestier, qui
Laroche-Mathieu avait promis la croix, quand serait venu le jour du triomphe. La
dcoration irait sur la poitrine du nouveau mari de Madeleine ; voil tout. Rien
ntait chang, en somme.
On sentait si bien que rien ntait chang, que les confrres de Du Roy lui mon-
taient une scie dont il commenait se fcher.
On ne lappelait plus que Forestier.
Aussitt quil arrivait au journal, quelquun criait : "Dis donc, Forestier."
Il feignait de ne pas entendre et cherchait les lettres dans son casier. La voix
reprenait, avec plus de force : "H ! Forestier." Quelques rires touffs couraient.
Comme DuRoy gagnait le bureaududirecteur, celui qui lavait appel larrtait :
"Oh! pardon; cest toi que je veux parler. Cest stupide, je te confonds toujours
avec ce pauvre Charles. Cela tient ce que tes articles ressemblent bigrement aux
siens. Tout le monde sy trompe."
Du Roy ne rpondait rien, mais il rageait ; et une colre sourde naissait en lui
contre le mort.
Le pre Walter lui-mme avait dclar, alors quon stonnait de similitudes a-
grantes de tournures et dinspiration entre les chroniques du nouveau rdacteur
politique et celles de lancien : " Oui, cest du Forestier, mais du Forestier plus
nourri, plus nerveux, plus viril."
Une autre fois, Du Roy en ouvrant par hasard larmoire aux bilboquets avait
trouv ceux de son prdcesseur avec un crpe autour du manche, et le sien, celui
dont il se servait quand il sexerait sous la direction de Saint-Potin, tait orn
dune faveur rose. Tous avaient t rangs sur la mme planche, par rang de taille ;
et une pancarte, pareille celle des muses, portait crit : "Ancienne collection
201
Forestier et Cie, Forestier-Du Roy, successeur, brevet S.G.D.G. Articles inusables
pouvant servir en toutes circonstances, mme en voyage."
Il referma larmoire avec calme, en prononant assez haut pour tre entendu :
"Il y a des imbciles et des envieux partout."
Mais il tait bless dans son orgueil, bless dans sa vanit, cette vanit et cet or-
gueil ombrageux dcrivain, qui produisent cette susceptibilit nerveuse toujours
en veil, gale chez le reporter et chez le pote gnial.
Ce mot : "Forestier " dchirait sonoreille ; il avait peur de lentendre, et se sentait
rougir en lentendant.
Il tait pour lui, ce nom, une raillerie mordante, plus quune raillerie, presque
une insulte. Il lui criait : "Cest ta femme qui fait ta besogne comme elle faisait
celle de lautre. Tu ne serais rien sans elle."
Il admettait parfaitement que Forestier net rien t sans Madeleine ; mais
quant lui, allons donc !
Puis, rentr chez lui, lobsession continuait. Ctait la maisontout entire main-
tenant qui lui rappelait le mort, tout le mobilier, tous les bibelots, tout ce quil tou-
chait. Il ne pensait gure cela dans les premiers temps ; mais la scie monte par
ses confrres avait fait ensonesprit une sorte de plaie quuntas de riens inaperus
jusquici envenimaient prsent.
Il ne pouvait plus prendre unobjet sans quil crt voir aussitt la mainde Charles
pose dessus. Il ne regardait et ne maniait que des choses lui ayant servi autrefois,
des choses quil avait achetes, aimes et possdes. Et Georges commenait
sirriter mme la pense des relations anciennes de son ami et de sa femme.
Il stonnait parfois de cette rvolte de son cur, quil ne comprenait point, et
se demandait : "Comment diable cela se fait-il ? Je ne suis pas jaloux des amis de
Madeleine. Je ne minquite jamais de ce quelle fait. Elle rentre et sort son gr,
et le souvenir de cette brute de Charles me met en rage !"
Il ajoutait, mentalement : "Au fond, ce ntait quun crtin; cest sans doute a
qui me blesse. Je me fche que Madeleine ait pu pouser un pareil sot."
202
Et sans cesse il se rptait : "Comment se fait-il que cette femme-l ait gob un
seul instant un semblable animal ?"
Et sa rancune saugmentait chaque jour par mille dtails insigniants qui le pi-
quaient comme des coups daiguille, par le rappel incessant de lautre, venu dun
mot de Madeleine, dunmot dudomestique oudunmot de la femme de chambre.
Un soir, Du Roy qui aimait les plats sucrs demanda :
"Pourquoi navons-nous pas dentremets ? Tu nen fais jamais servir."
La jeune femme rpondit gaiement :
"Cest vrai, je ny pense pas. Cela tient ce que Charles les avait en horreur..."
Il lui coupa la parole dans unmouvement dimpatience dont il ne fut pas matre.
"Ah! tu sais, Charles commence membter. Cest toujours Charles par-ci,
Charles par-l. Charles aimait ci, Charles aimait a. Puisque Charles est crev,
quon le laisse tranquille."
Madeleine regardait son mari avec stupeur, sans rien comprendre cette colre
subite. Puis, comme elle tait ne, elle devina un peu ce qui se passait en lui, ce
travail lent de jalousie posthume grandissant chaque seconde par tout ce qui
rappelait lautre.
Elle jugea cela puril, peut-tre, mais elle fut atte et ne rpondit rien.
Il sen voulut, lui, de cette irritation, quil navait pu cacher. Or, comme ils fai-
saient, ce soir-l, aprs dner, un article pour le lendemain, il sembarrassa dans
la chancelire. Ne parvenant point la retourner, il la rejeta dun coup de pied, et
demanda en riant :
"Charles avait donc toujours froid aux pattes ?"
Elle rpondit, riant aussi :
"Oh! il vivait dans la terreur des rhumes ; il navait pas la poitrine solide."
203
Du Roy reprit avec frocit : "Il la bien prouv, dailleurs." Puis il ajouta avec
galanterie : "Heureusement pour moi." Et il baisa la main de sa femme.
Mais en se couchant, toujours hant par la mme pense, il demanda encore :
"Est-ce que Charles portait des bonnets de coton pour viter les courants dair
dans les oreilles ?"
Elle se prta la plaisanterie et rpondit :
"Non, un madras nou sur le front."
Georges haussa les paules et pronona avec un mpris suprieur :
"Quel serin!"
Ds lors, Charles devint pour lui un sujet dentretien continuel. Il parlait de lui
tout propos, ne lappelant plus que : "ce pauvre Charles", dun air de piti innie.
Et quand il revenait du journal, o il stait entendu deux ou trois fois inter-
peller sous le nom de Forestier, il se vengeait en poursuivant le mort de raille-
ries haineuses au fond de son tombeau. Il rappelait ses dfauts, ses ridicules, ses
petitesses, les numrait avec complaisance, les dveloppant et les grossissant
comme sil et voulu combattre, dans le cur de sa femme, linuence dun ri-
val redout.
Il rptait :
"Dis donc, Made, te rappelles-tu le jour o ce cornichon de Forestier a prtendu
nous prouver que les gros hommes taient plus vigoureux que les maigres ?"
Puis il voulut savoir sur le dfunt un tas de dtails intimes et secrets que la jeune
femme, mal laise, refusait de dire. Mais il insistait, sobstinait.
"Allons, voyons, raconte-moi a. Il devait tre bien drle dans ce moment-l ?"
Elle murmurait du bout des lvres :
204
"Voyons, laisse-le tranquille, la n."
Il reprenait :
"Non, dis-moi ! cest vrai quil devait tre godiche au lit, cet animal !"
Et il nissait toujours par conclure :
"Quelle brute ctait !"
Un soir, vers la n de juin, comme il fumait une cigarette sa fentre, la grande
chaleur de la soire lui donna lenvie de faire une promenade.
Il demanda :
Ma petite Made, veux-tu venir jusquau Bois ?
- Mais oui, certainement."
Ils prirent un acre dcouvert, gagnrent les Champs-lyses, puis lavenue du
Bois-de-Boulogne. Ctait une nuit sans vent, une de ces nuits dtuve o lair de
Paris surchauff entre dans la poitrine comme une vapeur de four. Une arme de
acres menait sous les arbres tout un peuple damoureux. Ils allaient, ces acres,
lun derrire lautre, sans cesse.
Georges et Madeleine samusaient regarder tous ces couples enlacs, passant
dans ces voitures, la femme enrobe claire et lhomme sombre. Ctait unimmense
euve damants qui coulait vers le Bois sous le ciel toil et brlant. On nenten-
dait aucun bruit que le sourd roulement des roues sur la terre. Ils passaient, pas-
saient, les deux tres de chaque acre, allongs sur les coussins, muets, serrs lun
contre lautre, perdus dans dhallucination du dsir, frmissant dans lattente de
ltreinte prochaine. Lombre chaude semblait pleine de baisers. Une sensation
de tendresse ottante, damour bestial pandu alourdissait lair, le rendait plus
touffant. Tous ces gens accoupls, griss de la mme pense, de la mme ardeur,
faisaient courir une vre autour deux. Toutes ces voitures charges damour, sur
qui semblaient voltiger des caresses, jetaient sur leur passage une sorte de soufe
sensuel, subtil et troublant.
205
Georges et Madeleine se sentirent eux-mme gagns par la contagion de la ten-
dresse. Ils se prirent doucement la main, sans dire un mot, un peu oppresss par
la pesanteur de latmosphre et par lmotion qui les envahissait.
Comme ils arrivaient au tournant qui suit les fortications, ils sembrassrent,
et elle balbutia un peu confuse :
"Nous sommes aussi gamins quen allant Rouen."
Le grand courant des voitures stait spar lentre des taillis. Dans le che-
min des Lacs que suivaient les jeunes gens, les acres sespaaient un peu, mais
la nuit paisse des arbres, lair vivi par les feuilles et par lhumidit des ruis-
selets quon entendait couler sous les branches, une sorte de fracheur du large
espace nocturne tout par dastres, donnaient aux baisers des couples roulants
un charme plus pntrant et une ombre plus mystrieuse.
Georges murmura : "Oh! ma petite Made", en la serrant contre lui.
Elle lui dit :
"Te rappelles-tula fort de chez toi, comme ctait sinistre. Il me semblait quelle
tait pleine de btes affreuses et quelle navait pas de bout. Tandis quici, cest
charmant. Onsent des caresses dans le vent, et je sais bienque Svres est de lautre
ct du Bois."
Il rpondit :
"Oh! dans la fort de chez moi, il ny avait pas autre chose que des cerfs, des
renards, des chevreuils et des sangliers, et, par-ci, par-l, une maison de forestier."
Ce mot, ce nom du mort sorti de sa bouche, le surprit comme si quelquun le
lui et cri du fond dun fourr, et il se tut brusquement, ressaisi par ce malaise
trange et persistant, par cette irritation jalouse, rongeuse, invincible qui lui gtait
la vie depuis quelque temps.
Au bout dune minute, il demanda :
"Es-tu venue quelquefois ici comme a, le soir, avec Charles ?"
206
Elle rpondit :
"Mais oui, souvent."
Et, tout coup, il eut envie de retourner chez eux, une envie nerveuse qui lui
serrait le cur. Mais limage de Forestier tait rentre en son esprit, le possdait,
ltreignait. Il ne pouvait plus penser qu lui, parler que de lui.
Il demanda avec un accent mchant :
"Dis donc, Made ?
- Quoi, mon ami ?
- Las-tu fait cocu, ce pauvre Charles ?"
Elle murmura, ddaigneuse :
"Que tu deviens bte avec ta rengaine."
Mais il ne lchait pas son ide.
"Voyons, ma petite Made, sois bien franche, avoue-le ? Tu las fait cocu, dis ?
Avoue que tu las fait cocu?"
Elle se taisait, choque comme toutes les femmes le sont par ce mot.
Il reprit, obstin :
"Sacristi, si quelquun en avait la tte, cest bien lui, par exemple. Oh! oui, oh!
oui. Cest a qui mamuserait de savoir si Forestier tait cocu. Hein! quelle bonne
binette de jobard?"
Il sentit quelle souriait quelque souvenir peut-tre, et il insista :
"Voyons, dis-le. Quest-ce que a fait ? Ce serait biendrle, aucontraire, de mavouer
que tu las tromp, de mavouer a, moi."
207
Il frmissait, en effet, de lespoir et de lenvie que Charles, lodieux Charles, le
mort dtest, le mort excr, et port ce ridicule honteux. Et pourtant... pourtant
une autre motion, plus confuse, aiguillonnait son dsir de savoir.
Il rptait :
"Made, ma petite Made, je ten prie, dis-le. En voil un qui ne laurait pas vol.
Tu aurais eu joliment tort de ne pas lui faire porter a. Voyons, Made, avoue."
Elle trouvait plaisante, maintenant, sans doute, cette insistance, car elle riait,
par petits rires brefs, saccads.
Il avait mis ses lvres tout prs de loreille de sa femme :
"Voyons... voyons... avoue-le."
Elle sloigna dun mouvement sec et dclara brusquement :
"Mais tu es stupide. Est-ce quon rpond des questions pareilles ?"
Elle avait dit cela dun ton si singulier quun frisson de froid courut dans les
veines de son mari et il demeura interdit, effar, un peu essouf, comme sil avait
reu une commotion morale.
Le acre maintenant longeait le lac, o le ciel semblait avoir gren ses toiles.
Deux cygnes vagues nageaient trs lentement, peine visibles dans lombre.
Georges cria au cocher :
"Retournons, " Et la voiture sen revint, croisant les autres, qui allaient au pas,
et dont les grosses lanternes brillaient comme des yeux dans la nuit du Bois.
Comme elle avait dit cela dune trange faon! DuRoy se demandait : "Est-ce un
aveu?" Et cette presque certitude quelle avait tromp son premier mari laffolait
de colre prsent. Il avait envie de la battre, de ltrangler, de lui arracher les
cheveux !
208
Oh! si elle lui et rpondu : "Mais, mon chri, si javais d le tromper, cest avec
toi que je laurais fait." Comme il laurait embrasse, treinte, adore !
Il demeurait immobile, les bras croiss, les yeux au ciel, lesprit trop agit pour
rchir encore. Il sentait seulement en lui fermenter cette rancune et grossir
cette colre qui couvent au cur de tous les mles devant les caprices du d-
sir fminin. Il sentait pour la premire fois cette angoisse confuse de lpoux qui
souponne ! Il tait jaloux enn, jaloux pour le mort, jaloux pour le compte de Fo-
restier ! jaloux dune trange et poignante faon, o entrait subitement de la haine
contre Madeleine. Puisquelle avait tromp lautre, comment pourrait-il avoir conance
en elle, lui !
Puis, peu peu, une espce de calme se t en son esprit, et se roidissant contre
sa souffrance, il pensa : "Toutes les femmes sont des lles, il faut sen servir et ne
rien leur donner de soi."
Lamertume de son cur lui montait aux lvres en paroles de mpris et de d-
got. Il ne les laissa point spandre cependant. Il se rptait : "Le monde est aux
forts. Il faut tre fort. Il faut tre au-dessus de tout."
La voiture allait plus vite. Elle repassa les fortications. Du Roy regardait devant
lui une clart rougetre dans le ciel, pareille une lueur de forge dmesure ; et il
entendait une rumeur confuse, immense, continue, faite de bruits innombrables
et diffrents, une rumeur sourde, proche, lointaine, une vague et norme palpita-
tion de vie, le soufe de Paris respirant, dans cette nuit dt, comme un colosse
puis de fatigue.
Georges songeait : "Je serais bien bte de me faire de la bile. Chacun pour soi. La
victoire est aux audacieux. Tout nest que de lgosme. Lgosme pour lambition
et la fortune vaut mieux que lgosme pour la femme et pour lamour."
Larc de triomphe de ltoile apparaissait debout lentre de la ville sur ses
deux jambes monstrueuses, sorte de gant informe qui semblait prt se mettre
en marche pour descendre la large avenue ouverte devant lui.
Georges et Madeleine se retrouvaient l dans le dl des voitures ramenant au
logis, au lit dsir, lternel couple, silencieux et enlac. Il semblait que lhumanit
tout entire glissait ct deux, grise de joie, de plaisir, de bonheur.
209
La jeune femme, qui avait bien pressenti quelque chose de ce qui se passait en
son mari, demanda de sa voix douce :
"A quoi songes-tu, mon ami ? Depuis une demi-heure tu nas point prononc
une parole."
Il rpondit en ricanant :
"Je songe tous ces imbciles qui sembrassent, et je me dis que, vraiment, on
a autre chose faire dans lexistence."
Elle murmura :
"Oui... mais cest bon quelquefois.
- Cest bon... cest bon... quand on na rien de mieux !"
La pense de Georges allait toujours, dvtant la vie de sa robe de posie, dans
une sorte de rage mchante : "Je serais bienbte de me gner, de me priver de quoi
que ce soit, de me troubler, de me tracasser, de me ronger lme comme je le fais
depuis quelque temps." Limage de Forestier lui traversa lesprit sans y faire natre
aucune irritation. Il lui sembla quils venaient de se rconcilier, quils redevenaient
amis. Il avait envie de lui crier : " Bonsoir, vieux."
Madeleine, que ce silence gnait, demanda :
"Si nous allions prendre une glace chez Tortoni, avant de rentrer."
Il la regarda de coin. Son n prol blond lui apparut sous lclat vif dune guir-
lande de gaz qui annonait un caf-chantant.
Il pensa : "Elle est jolie ! Eh! tant mieux. A bon chat bon rat, ma camarade. Mais
si on me reprend me tourmenter pour toi, il fera chaud au ple Nord." Puis il r-
pondit : "Mais certainement, ma chrie." Et, pour quelle ne devint rien, il lem-
brassa.
Il sembla la jeune femme que les lvres de son mari taient glaces.
210
Il souriait cependant de son sourire ordinaire en lui donnant la main pour des-
cendre devant les marches du caf.
211
Chapitre 11
En entrant au journal, le lendemain, Du Roy alla trouver Boisrenard.
"Mon cher ami, dit-il, jai un service te demander. On trouve drle depuis
quelque temps de mappeler Forestier. Moi, je commence trouver a bte. Veux-
tu avoir la complaisance de prvenir doucement les camarades que je gierai le
premier qui se permettra de nouveau cette plaisanterie.
"Ce sera eux de rchir si cette blague-l vaut un coup dpe. Je madresse
toi parce que tu es un homme calme qui peut empcher des extrmits fcheuses,
et aussi parce que tu mas servi de tmoin dans notre affaire."
Boisrenard se chargea de la commission.
Du Roy sortit pour faire des courses, puis revint une heure plus tard. Personne
ne lappela Forestier.
Comme il rentrait chez lui, il entendit des voix de femmes dans le salon. Il de-
manda : "Qui est l ?"
Le domestique rpondit : "Mme Walter et Mme de Marelle."
Un petit battement lui secoua le cur, puis il se dit :
"Tiens, voyons", et il ouvrit la porte.
Clotilde tait au coin de la chemine, dans un rayon de jour venu de la fentre.
Il sembla Georges quelle plissait un peu en lapercevant. Ayant dabord salu
Mme Walter et ses deux lles assises, comme deux sentinelles aux cts de leur
mre, il se tourna vers son ancienne matresse. Elle lui tendait la main; il la prit et
212
la serra avec intention comme pour dire : "Je vous aime toujours. " Elle rpondit
cette pression.
Il demanda :
"Vous vous tes bien porte pendant le sicle coul depuis notre dernire ren-
contre ?"
Elle rpondit avec aisance :
"Mais, oui, et vous, Bel-Ami ?"
Puis, se tournant vers Madeleine, elle ajouta :
"Tu permets que je lappelle toujours Bel-Ami ?
- Certainement, ma chre, je permets tout ce que tu voudras."
Une nuance dironie semblait cache dans cette parole.
Mme Walter parlait dune fte quallait donner Jacques Rival dans son logis de
garon, un grand assaut darmes o assisteraient des femmes du monde ; elle di-
sait :
"Ce sera trs intressant. Mais je suis dsole, nous navons personne pour nous
y conduire, mon mari devant sabsenter ce moment-l."
DuRoy soffrit aussitt. Elle accepta." Nous vous enserons trs reconnaissantes,
mes lles et moi."
Il regardait la plus jeune des demoiselles Walter, et pensait : "Elle nest pas mal
du tout, cette petite Suzanne, mais pas du tout." Elle avait lair dune frle pou-
pe blonde, trop petite, mais ne, avec la taille mince, des hanches et de la poi-
trine, une gure de miniature, des yeux dmail dunbleugris dessins aupinceau,
qui semblaient nuancs par un peintre minutieux et fantaisiste, de la chair trop
blanche, trop lisse, polie, unie, sans grain, sans teinte, et des cheveux bouriffs,
friss, une broussaille savante, lgre, un nuage charmant, tout pareil en effet la
chevelure des jolies poupes de luxe quon voit passer dans les bras de gamines
beaucoup moins hautes que leur joujou.
213
La sur ane, Rose, tait laide, plate, insigniante, une de ces lles quon ne
voit pas, qui on ne parle pas et dont on ne dit rien.
La mre se leva, et se tournant vers Georges :
"Ainsi je compte sur vous jeudi prochain, deux heures."
Il rpondit :
"Comptez sur moi, madame."
Ds quelle fut partie, Mme de Marelle se leva son tour.
"Au revoir, Bel-Ami."
Ce fut elle alors qui lui serra la main trs fort, trs longtemps ; et il se sentit
remu par cet aveu silencieux, repris dun brusque bguin pour cette petite bour-
geoise bohme et bon enfant, qui laimait vraiment, peut-tre.
"Jirai la voir demain", pensa-t-il.
Ds quil fut seul en face de sa femme, Madeleine se mit rire, dun rire franc et
gai, et le regardant bien en face :
"Tu sais que tu as inspir une passion Mme Walter ?"
Il rpondit incrdule :
"Allons donc !
- Mais oui, je te lafrme, elle ma parl de toi avec un enthousiasme fou. Cest si
singulier de sa part ! Elle voudrait trouver deux maris comme toi pour ses lles !...
Heureusement quavec elle ces choses-l sont sans importance."
Il ne comprenait pas ce quelle voulait dire :
"Comment, sans importance ?"
214
Elle rpondit, avec une conviction de femme sre de son jugement :
"Oh! Mme Walter est une de celles dont on na jamais rien murmur, mais tu
sais, l, jamais, jamais. Elle est inattaquable sous tous les rapports. Son mari, tu
le connais comme moi. Mais elle, cest autre chose. Elle a dailleurs assez souffert
davoir pous un juif, mais elle lui est reste dle. Cest une honnte femme."
Du Roy fut surpris :
"Je la croyais juive aussi.
- Elle ? pas du tout. Elle est dame patronnesse de toutes les bonnes uvres de
la Madeleine. Elle est mme marie religieusement. Je ne sais plus sil y a eu un
simulacre de baptme du patron, ou bien si lglise a ferm les yeux."
Georges murmura :
Ah!... alors... elle... me gobe ?
- Positivement, et compltement. Si tu ntais pas engag, je te conseillerais de
demander la main de... de Suzanne, nest-ce pas, plutt que celle de Rose ?"
Il rpondit, en frisant sa moustache :
"Eh! la mre nest pas encore pique des vers."
Mais Madeleine simpatienta :
"Tu sais, mon petit, la mre, je te la souhaite. Mais je nai pas peur. Ce nest point
son ge quon commet sa premire faute. Il faut sy prendre plus tt."
Georges songeait : "Si ctait vrai, pourtant, que jeusse pupouser Suzanne ?...."
Puis il haussa les paules : "Bah!... cest fou!... Est-ce que le pre maurait jamais
accept ?"
215
Il se promit toutefois dobserver dsormais avec plus de soin les manires de
Mme Walter son gard, sans se demander dailleurs sil en pourrait jamais tirer
quelque avantage.
Tout le soir, il fut hant par des souvenirs de son amour avec Clotilde, des sou-
venirs tendres et sensuels en mme temps. Il se rappelait ses drleries, ses gen-
tillesses, leurs escapades. Il se rptait lui-mme : "Elle est vraiment bien gen-
tille. Oui, jirai la voir demain."
Ds quil eut djeun, le lendemain, il se rendit en effet rue de Verneuil. La
mme bonne lui ouvrit la porte, et, familirement la faon des domestiques de
petits bourgeois, elle demanda :
"a va bien, monsieur ?"
Il rpondit :
"Mais oui, mon enfant."
Et il entra dans le salon, o une main maladroite faisait des gammes sur le
piano. Ctait Laurine. Il crut quelle allait lui sauter au cou. Elle se leva grave-
ment, salua avec crmonie, ainsi quaurait fait une grande personne, et se retira
dune faon digne.
Elle avait une telle allure de femme outrage, quil demeura surpris. Sa mre
entra. Il lui prit et lui baisa les mains.
"Combien jai pens vous, dit-il.
- Et moi", dit-elle.
Ils sassirent. Ils se souriaient, les yeux dans les yeux avec une envie de sem-
brasser sur les lvres.
"Ma chre petite Clo, je vous aime.
- Et moi aussi.
216
- Alors... alors... tu ne men as pas trop voulu?
- Oui et non... a ma fait de la peine, et puis jai compris ta raison, et je me suis
dit : "Bah! il me reviendra un jour ou lautre."
- Je nosais pas revenir ; je me demandais comment je serais reu. Je nosais pas,
mais jen avais rudement envie. A propos, dis-moi donc ce qua Laurine. Elle ma
peine dit bonjour et elle est partie dun air furieux.
- Je ne sais pas. Mais onne peut plus lui parler de toi depuis tonmariage. Je crois
vraiment quelle est jalouse.
- Allons donc !
- Mais oui, mon cher. Elle ne tappelle plus Bel-Ami, elle te nomme M. Fores-
tier."
Du Roy rougit, puis, sapprochant de la jeune femme :
"Donne ta bouche."
Elle la donna.
"O pourrons-nous nous revoir ? dit-il.
- Mais... rue de Constantinople.
- Ah!... Lappartement nest donc pas lou ?
- Non, je lai gard !
- Tu las gard ?
- Oui, jai pens que tu y reviendrais."
Une bouffe de joie orgueilleuse lui gona la poitrine. Elle laimait donc, celle-
l, dun amour vrai, constant, profond.
217
Il murmura : "Je tadore." Puis il demanda : "Ton mari va bien?
- Oui, trs bien. Il vient de passer un mois ici ; il est parti davant-hier."
Du Roy ne put sempcher de rire :
"Comme a tombe !"
Elle rpondit navement :
"Oh! oui, a tombe bien.
"Mais il nest pas gnant quand il est ici, tout de mme. Tu le sais !
- a cest vrai. Cest dailleurs un charmant homme.
- Et toi, dit-elle, comment prends-tu ta nouvelle vie ?
- Ni bien ni mal. Ma femme est une camarade, une associe.
- Rien de plus ?
- Rien de plus... Quant au cur...
- Je comprends bien. Elle est gentille, pourtant.
- Oui, mais elle ne me trouble pas."
Il se rapprocha de Clotilde, et murmura :
"Quand nous reverrons-nous ?
- Mais... demain... si tu veux ?
- Oui. Demain, deux heures ?
- Deux heures."
218
Il se leva pour partir, puis il balbutia, un peu gn :
"Tu sais, jentends reprendre, seul, lappartement de la rue de Constantinople.
Je le veux. Il ne manquerait plus quil ft pay par toi."
Ce fut elle qui baisa ses mains avec unmouvement dadoration, enmurmurant :
"Tu feras comme tu voudras. Il me suft de lavoir gard pour nous y revoir."
Et Du Roy sen alla, lme pleine de satisfaction.
Comme il passait devant la vitrine dun photographe, le portrait dune grande
femme aux larges yeux lui rappela Mme Walter : "Cest gal, se dit-il, elle ne doit
pas tre mal encore. Comment se fait-il que je ne laie jamais remarque. Jai envie
de voir quelle tte elle me fera jeudi."
Il se frottait les mains, tout en marchant avec une joie intime, la joie du succs
sous toutes ses formes, la joie goste de lhomme adroit qui russit, la joie sub-
tile, faite de vanit atte et de sensualit contente, que donne la tendresse des
femmes.
Le jeudi venu, il dit Madeleine :
Tu ne viens pas cet assaut chez Rival ?
- Oh! non. Cela ne mamuse gure, moi ; jirai la Chambre des dputs."
Et il alla chercher Mme Walter, en landau dcouvert, car il faisait un admirable
temps.
Il eut une surprise en la voyant, tant il la trouva belle et jeune.
Elle tait en toilette claire dont le corsage un peu fendu laissait deviner, sous
une dentelle blonde, le soulvement gras des seins. Jamais elle ne lui avait paru
si frache. Il la jugea vraiment dsirable. Elle avait son air calme et comme il faut,
une certaine allure de maman tranquille qui la faisait passer presque inaperue
aux yeux galants des hommes. Elle ne parlait gure dailleurs que pour dire des
choses connues, convenues et modres, ses ides tant sages, mthodiques, bien
ordonnes, labri de tous les excs.
219
Sa lle Suzanne, tout en rose, semblait un Watteau frais verni ; et sa sur ane
paraissait tre linstitutrice charge de tenir compagnie ce joli bibelot de llette.
Devant la porte de Rival, une le de voitures tait range. Du Roy offrit son bras
Mme Walter, et ils entrrent.
Lassaut tait donn au prot des orphelins du sixime arrondissement de Paris,
sous le patronage de toutes les femmes des snateurs et dputs qui avaient des
relations avec La Vie Franaise.
Mme Walter avait promis de venir avec ses lles, en refusant le titre de dame
patronnesse, parce quelle naidait de son nom que les uvres entreprises par le
clerg, nonpas quelle ft trs dvote, mais sonmariage avec unIsralite la forait,
croyait-elle, une certaine tenue religieuse ; et la fte organise par le journaliste
prenait une sorte de signication rpublicaine qui pouvait sembler anticlricale.
On avait lu dans les journaux de toutes les nuances, depuis trois semaines :
"Notre minent confrre Jacques Rival vient davoir lide aussi ingnieuse que
gnreuse dorganiser, au prot des orphelins du sixime arrondissement de Pa-
ris, un grand assaut dans sa jolie salle darmes attenant son appartement de
garon.
"Les invitations sont faites par Mmes Laloigne, Remontel, Rissolin, femmes des
snateurs de ce nom, et par Mmes Laroche-Mathieu, Percerol, Firmin, femmes
des dputs bien connus. Une simple qute aura lieu pendant lentracte de las-
saut, et le montant sera vers immdiatement entre les mains dumaire du sixime
arrondissement ou de son reprsentant."
Ctait une rclame monstre que le journaliste adroit avait imagin son prot.
Jacques Rival recevait les arrivants lentre de son logis o un buffet avait t
install, les frais devant tre prlevs sur la recette.
Puis il indiquait, dun geste aimable, le petit escalier par o on descendait dans
la cave, o il avait install la salle darmes et le tir ; et il disait : "Au-dessous, mes-
dames, au-dessous. Lassaut a lieu en des appartements souterrains."
220
Il se prcipita au-devant de la femme de son directeur ; puis, serrant la main de
Du Roy :
"Bonjour, Bel-Ami."
Lautre fut surpris :
"Qui vous a dit que..."
Rival lui coupa la parole :
"Mme Walter, ici prsente, qui trouve ce surnom trs gentil."
Mme Walter rougit :
"Oui, javoue que, si je vous connaissais davantage, je ferais comme la petite
Laurine, je vous appellerais aussi Bel-Ami. a vous va trs bien. "
Du Roy riait :
Mais, je vous en prie, madame, faites-le."
Elle avait baiss les yeux :
Non. Nous ne sommes pas assez lis."
Il murmura :
"Voulez-vous me laisser esprer que nous le deviendrons davantage ?
- Eh bien, nous verrons, alors", dit-elle.
Il seffaa lentre de la descente troite quclairait unbec de gaz ; et la brusque
transitionde la lumire dujour cette clart jaune avait quelque chose de lugubre.
Une odeur de souterrainmontait par cette chelle tournante, une senteur dhumi-
dit chauffe, de murs moisis essuys pour la circonstance, et aussi des soufes de
benjoin qui rappelaient les ofces sacrs, et des manations fminines de Lubin,
de verveine, diris, de violette.
221
On entendait dans ce trou un grand bruit de voix, un frmissement de foule
agite.
Toute la cave tait illumine avec des guirlandes de gaz et des lanternes vni-
tiennes caches en des feuillages qui voilaient les murs de pierre salptrs. On ne
voyait rien que des branchages. Le plafond tait garni de fougres, le sol couvert
de feuilles et de eurs.
On trouvait cela charmant, dune imagination dlicieuse. Dans le petit caveau
du fond slevait une estrade pour les tireurs, entre deux rangs de chaises pour les
juges.
Et dans toute la cave, les banquettes, alignes par dix, autant droite qu gauche,
pouvaient porter prs de deux cents personnes. On en avait invit quatre cents.
Devant lestrade, des jeunes gens encostumes dassaut, minces, avec des membres
longs, la taille cambre, la moustache en croc, posaient dj devant les specta-
teurs. On se les nommait, on dsignait les matres et les amateurs, toutes les no-
tabilits de lescrime. Autour deux causaient des messieurs en redingote, jeunes
et vieux, qui avaient un air de famille avec les tireurs en tenue de combat. Ils cher-
chaient aussi tre vus, reconnus et nomms, ctaient des princes de lpe en
civil, les experts en coups de bouton.
Presque toutes les banquettes taient couvertes de femmes, qui faisaient un
grand froissement dtoffes remues et un grand murmure de voix. Elles sven-
taient comme au thtre, car il faisait dj une chaleur dtuve dans cette grotte
feuillue. Un farceur criait de temps en temps : "Orgeat ! limonade ! bire !"
Mme Walter et ses lles gagnrent leurs places rserves au premier rang. Du
Roy les ayant installes allait partir, il murmura :
"Je suis oblig de vous quitter, les hommes ne peuvent accaparer les banquettes."
Mais Mme Walter rpondit en hsitant :
"Jai bien envie de vous garder tout de mme. Vous me nommerez les tireurs.
Tenez, si vous restiez debout au coin de ce banc, vous ne gneriez personne."
222
Elle le regardait de ses grands yeux doux. Elle insista : "Voyons, restez avec nous...
monsieur... monsieur Bel-Ami. Nous avons besoin de vous.
Il rpondit :
"Jobirai... avec plaisir, madame."
On entendait rpter de tous les cts : "Cest trs drle, cette cave, cest trs
gentil."
Georges la connaissait bien. cette salle vote ! Il se rappelait le matin quil y
avait pass, la veille de son duel, tout seul, en face dun petit carton blanc qui le
regardait du fond du second caveau comme un oeil norme et redoutable.
La voix de Jacques Rival rsonna, venue de lescalier : "On va commencer, mes-
dames."
Et six messieurs, trs serrs en leurs vtements pour faire saillir davantage le
thorax, montrent sur lestrade et sassirent sur les chaises destines au jury.
Leurs noms coururent : Le gnral de Raynaldi, prsident, un petit homme
grandes moustaches ; le peintre JosphinRouget, ungrandhomme chauve longue
barbe ; Mattho de Ujar, Simon Ramoncel, Pierre de Carvin, trois jeunes hommes
lgants, et Gaspard Merleron, un matre.
Deux pancartes furent accroches aux deux cts du caveau. Celle de droite
portait : M. Crvecur, et celle de gauche : M. Plumeau.
Ctaient deux matres, deux bons matres de second ordre. Ils apparurent, secs
tous deux, avec unair militaire. des gestes unpeuraides. Ayant fait le salut darmes
avec des mouvements dautomates, ils commencrent sattaquer, pareils, dans
leur costume de toile et de peau blanche, deux pierrots-soldats qui se seraient
battus pour rire.
De temps en temps, on entendait ce mot : "Touch !" Et les six messieurs du
jury inclinaient la tte en avant dun air connaisseur. Le public ne voyait rien que
deux marionnettes vivantes qui sagitaient en tendant le bras ; il ne comprenait
rien, mais il tait content. Ces deux bonshommes lui semblaient cependant peu
223
gracieux et vaguement ridicules. On songeait aux lutteurs de bois quon vend, au
jour de lan, sur les boulevards.
Les deux premiers tireurs furent remplacs par MM. Planton et Carapin, un
matre civil et un matre militaire. M. Planton tait tout petit et M. Carapin trs
gros. On et dit que le premier coup de euret dgonerait ce ballon comme un
lphant de baudruche. On riait. M. Planton sautait comme un singe. M. Carapin
ne remuait que son bras, le reste de son corps se trouvant immobilis par lem-
bonpoint, et il se fendait toutes les cinq minutes avec une telle pesanteur et un tel
effort en avant quil semblait prendre la rsolution la plus nergique de sa vie. Il
avait ensuite beaucoup de mal se relever.
Les connaisseurs dclarrent sonjeutrs ferme et trs serr. Et le public, conant,
lapprcia.
Puis vinrent MM. Porion et Lapalme, un matre et un amateur qui se livrrent
une gymnastique effrne, courant lun sur lautre avec furie, forant les juges
fuir en emportant leurs chaises, traversant et retraversant lestrade dun bout
lautre, lun avanant et lautre reculant par bonds vigoureux et comiques. Ils
avaient de petits sauts en arrire qui faisaient rire les dames, et de grands lans
en avant qui motionnaient un peu cependant. Cet assaut au pas gymnastique
fut caractris par un titi inconnu qui cria : "Vous reintez pas, cest lheure !"
Lassistance, froisse par ce manque de got, t : "Chut !" Le jugement des experts
circula. Les tireurs avaient montr beaucoup de vigueur et manqu parfois d-
propos.
La premire partie fut clture par une fort belle passe darmes entre Jacques
Rival et le fameux professeur belge Lebgue. Rival fut fort got des femmes. Il
tait vraiment beau garon, bien fait, souple, agile, et plus gracieux que tous ceux
qui lavaient prcd. Il apportait dans sa faon de se tenir en garde et de se fendre
une certaine lgance mondaine qui plaisait et faisait contraste avec la manire
nergique, mais commune de sonadversaire." Onsent lhomme bienlev", disait-
on.
Il eut la belle. On lapplaudit.
Mais depuis quelques minutes, un bruit singulier, ltage au-dessus, inqui-
tait les spectateurs. Ctait un grand pitinement accompagn de rires bruyants.
Les deux cents invits qui navaient pu descendre dans la cave samusaient sans
224
doute, leur faon. Dans le petit escalier tournant une cinquantaine dhommes
taient tasss. La chaleur devenait terrible en bas. On criait : "De lair !" "A boire !"
Le mme farceur glapissait sur un ton aigu qui dominait le murmure des conver-
sations :
"Orgeat ! limonade ! bire !"
Rival apparut trs rouge, ayant gard son costume dassaut." Je vais faire appor-
ter des rafrachissements", dit-il - et il courut dans lescalier. Mais toute commu-
nication tait coupe avec le rez-de-chausse. Il et t aussi facile de percer le
plafond que de traverser la muraille humaine entasse sur les marches.
Rival criait : Faites passer des glaces pour les dames !"
Cinquante voix rptaient : "Des glaces !" Un plateau apparut enn. Mais il ne
portait que des verres vides, les rafrachissements ayant t cueillis en route.
Une forte voix hurla :
"On touffe l-dedans, nissons vite et allons-nous-en."
Une autre voix lana : "La qute !" Et tout le public, haletant, mais gai tout de
mme, rpta : "La qute... la qute..."
Alors six dames se mirent circuler entre les banquettes et on entendit un petit
bruit dargent tombant dans les bourses.
Du Roy nommait les hommes clbres Mme Walter. Ctaient des mondains,
des journalistes, ceux des grands journaux, des vieux journaux, qui regardaient
de haut La Vie Franaise, avec une certaine rserve ne de leur exprience. Ils
en avaient tant vu mourir de ces feuilles politico-nancires, lles dune combi-
naison louche, et crases par la chute dun ministre. On apercevait aussi l des
peintres et des sculpteurs, qui sont, en gnral, hommes de sport, un pote aca-
dmicien quon montrait, deux musiciens et beaucoup de nobles trangers dont
Du Roy faisait suivre le nom de la syllabe Rast ( ce qui signiait Rastaquoure ),
pour imiter, disait-il, les Anglais qui mettent Esq. sur leurs cartes.
Quelquun lui cria : "Bonjour, cher ami." Ctait le comte de Vaudrec. Stant
excus auprs des dames, Du Roy alla lui serrer la main.
225
Il dclara, en revenant : "Il est charmant, Vaudrec. Comme on sent la race, chez
lui."
Mme Walter ne rpondit rien. Elle tait un peu fatigue et sa poitrine se soule-
vait avec effort chaque soufe de ses poumons, ce qui attirait loeil de Du Roy. Et
de temps en temps, il rencontrait le regard de " la Patronne " - un regard trouble,
hsitant, qui se posait sur lui et fuyait tout de suite. Et il se disait : "Tiens... tiens...
tiens... Est-ce que je laurais leve aussi, celle-l ?"
Les quteuses passrent. Leurs bourses taient pleines dargent et dor. Et une
nouvelle pancarte fut accroche sur lestrade annonant : "Grrrrande surprise."
Les membres du jury remontrent leurs places. On attendit.
Deux femmes parurent, un euret la main, en costume de salle, vtues dun
maillot sombre, dun trs court jupon tombant la moiti des cuisses, et dun
plastron si gon sur la poitrine quil les forait porter haut la tte. Elle taient
jolies et jeunes. Elles souriaient ensaluant lassistance. Onles acclama longtemps.
Et elles se mirent en garde au milieu dune rumeur galante et de plaisanteries
chuchotes.
Un sourire aimable stait x sur les lvres des juges, qui approuvaient les
coups par un petit bravo.
Le public apprciait beaucoup cet assaut et le tmoignait aux deux combat-
tantes qui allumaient des dsirs chez les hommes et rveillaient chez les femmes
le got naturel du public parisien pour les gentillesses un peu polissonnes, pour
les lgances du genre canaille, pour le faux-joli et le faux-gracieux, les chanteuses
de caf-concert et les couplets doprette.
Chaque fois quune des tireuses se fendait, un frisson de joie courait dans le
public. Celle qui tournait le dos la salle, un dos bien replet, faisait souvrir les
bouches et sarrondir les yeux ; et ce ntait pas le jeu de son poignet quon regar-
dait le plus.
On les applaudit avec frnsie.
226
Un assaut de sabre suivit, mais personne ne le regarda, car toute lattention
fut captive par ce qui se passait au-dessus. Pendant quelques minutes on avait
cout un grand bruit de meubles remus, trans sur le parquet comme si on d-
mnageait lappartement. Puis tout coup, le son du piano traversa le plafond; et
on entendit distinctement un bruit rythm de pieds sautant en cadence. Les gens
den haut soffraient un bal, pour se ddommager de ne rien voir.
Un grand rire sleva dabord dans le public de la salle darmes, puis le dsir
de danser sveillant chez les femmes, elles cessrent de soccuper de ce qui se
passait sur lestrade et se mirent parler tout haut.
On trouvait drle cette ide de bal organis par les retardataires. Ils ne devaient
pas sembter ceux-l. On aurait bien voulu tre au-dessus.
Mais deux nouveaux combattants staient salus ; et ils tombrent en garde
avec tant dautorit que tous les regards suivaient leurs mouvements.
Ils se fendaient et se relevaient avec une grce lastique, avec une vigueur me-
sure, avec une telle sret de force, une telle sobrit de gestes, une telle correc-
tion dallure, une telle mesure dans le jeu que la foule ignorante fut surprise et
charme.
Leur promptitude calme, leur sage souplesse, leurs mouvements rapides, si cal-
culs quils semblaient lents, attiraient et captivaient loeil par la seule puissance
de la perfection. Le public sentit quil voyait l une chose belle et rare, que deux
grands artistes dans leur mtier lui montraient ce quon pouvait voir de mieux,
tout ce quil tait possible deux matres de dployer dhabilet, de ruse, de science
raisonne et dadresse physique.
Personne ne parlait plus, tant on les regardait. Puis, quand ils se furent serr la
main, aprs le dernier coup de bouton, des cris clatrent, des hourras. On tr-
pignait, on hurlait. Tout le monde connaissait leurs noms : ctaient Sergent et
Ravignac.
Les esprits exalts devenaient querelleurs. Les hommes regardaient leurs voi-
sins avec des envies de dispute. On se serait provoqu pour un sourire. Ceux qui
navaient jamais tenu un euret en leur main esquissaient avec leur canne des
attaques et des parades.
227
Mais peu peu la foule remontait par le petit escalier. On allait boire, enn.
Ce fut une indignation quand on constata que les gens du bal avaient dvalis le
buffet, puis sen taient alls en dclarant quil tait malhonnte de dranger deux
cents personnes pour ne leur rien montrer.
Il ne restait pas un gteau, pas une goutte de champagne, de sirop ou de bire,
pas un bonbon, pas un fruit, rien, rien de rien. Ils avaient saccag, ravag, nettoy
tout.
Onse faisait raconter les dtails par les servants qui prenaient des visages tristes
en cachant leur envie de rire. "Les dames taient plus enrages que les hommes,
afrmaient-ils, et avaient mang et bu sen rendre malades." On aurait cru en-
tendre le rcit des survivants aprs le pillage et le sac dune ville pendant linva-
sion.
Il fallut donc sen aller. Des messieurs regrettaient les vingt francs donns la
qute ; ils sindignaient que ceux den haut eussent ripaill sans rien payer.
Les dames patronnesses avaient recueilli plus de trois mille francs. Il resta, tous
frais pays, deux cent vingt francs pour les orphelins du sixime arrondissement.
Du Roy, escortant la famille Walter, attendait son landau. En reconduisant la Pa-
tronne, comme il se trouvait assis en face delle, il rencontra encore une fois son
oeil caressant et fuyant, qui semblait troubl. Il pensait : " Bigre, je crois quelle
mord", et il souriait en reconnaissant quil avait vraiment de la chance auprs des
femmes, car Mme de Marelle, depuis le recommencement de leur tendresse, pa-
raissait laimer avec frnsie.
Il rentra chez lui dun pied joyeux.
Madeleine lattendait dans le salon.
"Jai des nouvelles, dit-elle. Laffaire du Maroc se complique. La France pourrait
bieny envoyer une expditiondici quelques mois. Dans tous les cas onva se servir
de a pour renverser le ministre, et Laroche protera de loccasion pour attraper
les Affaires trangres."
Du Roy, pour taquiner sa femme, feignit de nen rien croire. On ne serait pas
assez fou pour recommencer la btise de Tunis.
228
Mais elle haussait les paules avec impatience. "Je te dis que si ! Je te dis que si !
Tu ne comprends donc pas que cest une grosse question dargent pour eux. Au-
jourdhui, mon cher, dans les combinaisons politiques, il ne faut pas dire : "Cher-
chez la femme", mais : "Cherchez laffaire."
Il murmura : "Bah!" avec un air de mpris, pour lexciter.
Elle sirritait :
"Tiens, tu es aussi naf que Forestier."
Elle voulait le blesser et sattendait une colre. Mais il sourit et rpondit :
"Que ce cocu de Forestier ?"
Elle demeura saisie, et murmura :
"Oh! Georges !"
Il avait lair insolent et railleur, et il reprit :
"Eh bien, quoi ? Me las-tu pas avou, lautre soir, que Forestier tait cocu?"
Et il ajouta : "Pauvre diable !" sur un ton de piti profonde.
Madeleine lui tourna le dos, ddaignant de rpondre ; puis aprs une minute de
silence, elle reprit :
"Nous aurons du monde mardi : Mme Laroche-Mathieu viendra dner avec la
comtesse de Percemur. Veux-tu inviter Rival et Norbert de Varenne ? Jirai demain
chez Mmes Walter et de Marelle. Peut-tre aussi aurons-nous Mme Rissolin."
Depuis quelque temps, elle se faisait des relations, usant de linuence poli-
tique de son mari, pour attirer chez elle, de gr ou de force, les femmes des sna-
teurs et des dputs qui avaient besoin de lappui de La Vie Franaise.
Du Roy rpondit :
229
"Trs bien. Je me charge de Rival et de Norbert."
Il tait content et il se frottait les mains, car il avait trouv une bonne scie pour
embter sa femme et satisfaire lobscure rancune, la confuse et mordante jalousie
ne en lui depuis leur promenade au Bois. Il ne parlerait plus de Forestier sans le
qualier de cocu. Il sentait bien que cela nirait par rendre Madeleine enrage.
Et dix fois pendant la soire il trouva moyen de prononcer avec une bonhomie
ironique le nom de ce " cocu de Forestier ".
Il nen voulait plus au mort ; il le vengeait.
Sa femme feignait de ne pas entendre et demeurait, en face de lui, souriante et
indiffrente.
Le lendemain, comme elle devait aller adresser son invitation Mme Walter, il
voulut la devancer, pour trouver seule la Patronne et voir si vraiment elle en tenait
pour lui. Cela lamusait et le attait. Et puis... pourquoi pas... si ctait possible.
Il se prsenta boulevard Malesherbes ds deux heures. On le t entrer dans le
salon. Il attendit.
Mme Walter parut, la main tendue avec un empressement heureux.
"Quel bon vent vous amne ?
- Aucun bon vent, mais un dsir de vous voir. Une force ma pouss chez vous,
je ne sais pourquoi, je nai rien vous dire. Je suis venu, me voil ! me pardonnez-
vous cette visite matinale et la franchise de lexplication?"
Il disait cela dun ton galant et badin, avec un sourire sur les lvres et un accent
srieux dans la voix.
Elle restait tonne, un peu rouge, balbutiant :
"Mais... vraiment... je ne comprends pas... vous me surprenez..."
Il ajouta :
230
"Cest une dclaration sur un air gai, pour ne pas vous effrayer."
Ils staient assis lun prs de lautre. Elle prit la chose de faon plaisante.
"Alors, cest une dclaration... srieuse ?
- Mais oui ! Voici longtemps que je voulais vous la faire, trs longtemps mme.
Et puis, je nosais pas. On vous dit si svre, si rigide..."
Elle avait retrouv son assurance. Elle rpondit :
"Pourquoi avez-vous choisi aujourdhui ?
- Je ne sais pas." Puis il baissa la voix : "Ou plutt, cest parce que je ne pense
qu vous, depuis hier."
Elle balbutia, plie tout coup :
"Voyons, assez denfantillages, et parlons dautre chose."
Mais il tait tomb ses genoux si brusquement quelle eut peur. Elle voulut
se lever ; il la tenait assise de force et ses deux bras enlacs la taille et il rptait
dune voix passionne :
"Oui, cest vrai que je vous aime, follement, depuis longtemps. Ne me rpondez
pas. Que voulez-vous. je suis fou! Je vous aime... Oh! si vous saviez, comme je vous
aime !"
Elle suffoquait, haletait, essayait de parler et ne pouvait prononcer un mot. Elle
le repoussait de ses deux mains, layant saisi aux cheveux pour empcher lap-
proche de cette bouche quelle sentait venir vers la sienne. Et elle tournait la tte
de droite gauche et de gauche droite, dun mouvement rapide, en fermant les
yeux pour ne plus le voir.
Il la touchait travers sa robe, la maniait, la palpait ; et elle dfaillait sous cette
caresse brutale et forte. Il se releva brusquement et voulut ltreindre, mais, libre
une seconde, elle stait chappe en se rejetant en arrire, et elle fuyait mainte-
nant de fauteuil en fauteuil.
231
Il jugea ridicule cette poursuite, et il se laissa tomber sur une chaise, la gure
dans ses mains, en feignant des sanglots convulsifs.
Puis il se redressa, cria : "Adieu! adieu!" et il senfuit.
Il reprit tranquillement sa canne dans le vestibule et gagna la rue en se disant :
"Cristi, je crois que a y est." Et il passa au tlgraphe pour envoyer un petit bleu
Clotilde, lui donnant rendez-vous le lendemain.
En rentrant chez lui, lheure ordinaire, il dit sa femme :
"Eh bien, as-tu tout ton monde pour ton dner ?"
Elle rpondit :
"Oui ; il ny a que Mme Walter qui nest pas sre dtre libre. Elle hsite ; elle ma
parl de je ne sais quoi, dengagement, de conscience. Enn elle ma eu lair trs
drle. Nimporte, jespre quelle viendra tout de mme."
Il haussa les paules :
"Eh, parbleu oui, elle viendra."
Il nen tait pas certain, cependant, et il demeura inquiet jusquau jour du dner.
Le matin mme, Madeleine reut un petit mot de la Patronne : "Je me suis ren-
due libre grand-peine et je serai des vtres. Mais mon mari ne pourra pas mac-
compagner."
Du Roy pensa : "Jai rudement bien fait de ny pas retourner. La voil calme.
Attention."
Il attendit cependant sonentre avec unpeudinquitude. Elle parut, trs calme,
un peu froide, un peu hautaine. Il se t trs humble, trs discret et soumis.
232
Mmes Laroche-Mathieu et Rissolin accompagnaient leurs maris. La vicomtesse
de Percemur parla du grand monde. Mme de Marelle tait ravissante dans une
toilette dune fantaisie singulire, jaune et noire, uncostume espagnol qui moulait
bien sa jolie taille, sa poitrine et ses bras potels, et rendait nergique sa petite tte
doiseau.
DuRoy avait pris sa droite Mme Walter, et il ne lui parla, durant le dner, que de
choses srieuses, avec un respect exagr. De temps en temps il regardait Clotilde.
"Elle est vraiment plus jolie et plus frache", pensait-il. Puis ses yeux revenaient
vers sa femme quil ne trouvait pas mal non plus, bien quil et gard contre elle
une colre rentre, tenace et mchante.
Mais la Patronne lexcitait par la difcult de la conqute, et par cette nouveaut
toujours dsire des hommes.
Elle voulut rentrer de bonne heure.
"Je vous accompagnerai", dit-il.
Elle refusa. Il insistait :
"Pourquoi ne voulez-vous pas ? Vous allez me blesser vivement. Ne me laissez
pas croire que vous ne mavez point pardonn. Vous voyez comme je suis calme."
Elle rpondit :
"Vous ne pouvez pas abandonner ainsi vos invits."
Il sourit :
"Bah! je serai vingt minutes absent. On ne sen apercevra mme pas. Si vous me
refusez, vous me froisserez jusquau cur."
Elle murmura :
"Eh bien, jaccepte."
233
Mais ds quils furent dans la voiture, il lui saisit la main, et la baisant avec pas-
sion :
"Je vous aime, je vous aime. Laissez-moi vous le dire. Je ne vous toucherai pas.
Je veux seulement vous rpter que je vous aime."
Elle balbutiait :
"Oh!,. aprs ce que vous mavez promis... Cest mal... cest mal... "
Il parut faire un grand effort, puis il reprit, dune voix contenue :
"Tenez, vous voyez comme je me matrise. Et pourtant... Mais laissez-moi vous
dire seulement ceci. Je vous aime... et vous le rpter tous les jours... oui, laissez-
moi aller chez vous magenouiller cinq minutes vos pieds pour prononcer ces
trois mots, en regardant votre visage ador."
Elle lui avait abandonn sa main, et elle rpondit en haletant :
"Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Songez ce quon dirait, mes domes-
tiques, mes lles. Non, non, cest impossible... "
Il reprit :
"Je ne peux plus vivre sans vous voir. Que ce soit chez vous ou ailleurs, il faut
que je vous voie, ne ft-ce quune minute tous les jours, que je touche votre main,
que je respire lair soulev par votre robe, que je contemple la ligne de votre corps,
et vos beaux grands yeux qui maffolent."
Elle coutait, frmissante, cette banale musique damour et elle bgayait :
"Non... non... cest impossible. Taisez-vous !"
Il lui parlait tout bas, dans loreille, comprenant quil fallait la prendre peu peu,
celle-l, cette femme simple, quil fallait la dcider lui donner des rendez-vous,
o elle voudrait dabord, o il voudrait ensuite :
234
"coutez... Il le faut... je vous verrai... je vous attendrai devant votre porte...
comme un pauvre... Si vous ne descendez pas, je monterai chez vous... mais je
vous verrai... je vous verrai... demain."
Elle rptait : "Non, non, ne venez pas. Je ne vous recevrai point. Songez mes
lles.
- Alors dites-moi o je vous rencontrerai... dans la rue... nimporte o... lheure
que vous voudrez... pourvu que je vous voie... Je vous saluerai... Je vous dirai : "Je
vous aime", et je men irai."
Elle hsitait, perdue. Et comme le coup passait la porte de son htel, elle mur-
mura trs vite :
"Eh bien, jentrerai la Trinit, demain, trois heures et demie."
Puis, tant descendue, elle cria son cocher :
"Reconduisez M. Du Roy chez lui."
Comme il rentrait, sa femme lui demanda :
"O tais-tu donc pass ?"
Il rpondit, voix basse :
"Jai t jusquau tlgraphe pour une dpche presse."
Mme de Marelle sapprochait :
"Vous me reconduisez, Bel-Ami, vous savez que je ne viens dner si loin qu
cette condition?"
Puis se tournant vers Madeleine :
"Tu nes pas jalouse ?"
Mme Du Roy rpondit lentement :
235
"Non, pas trop."
Les convives sen allaient. Mme Laroche Mathieu avait lair dune petite bonne
de province. Ctait la lle dun notaire, pouse par Laroche qui ntait alors que
mdiocre avocat. Mme Rissolin, vieille et prtentieuse, donnait lide dune an-
cienne sage-femme dont lducation se serait faite dans les cabinets de lecture. La
vicomtesse de Percemur les regardait du haut. Sa " patte blanche " touchait avec
rpugnance ces mains communes.
Clotilde, enveloppe de dentelles, dit Madeleine en franchissant la porte de
lescalier :
"Ctait parfait, ton dner. Tu auras dans quelque temps le premier salon poli-
tique de Paris."
Ds quelle fut seule avec Georges, elle le serra dans ses bras :
"Oh! mon chri Bel-Ami, je taime tous les jours davantage."
Le acre qui les portait roulait comme un navire.
"a ne vaut point notre chambre", dit-elle.
Il rpondit : Oh! non." Mais il pensait Mme Walter.
236
Chapitre 12
La place de la Trinit tait presque dserte, sous un clatant soleil de juillet.
Une chaleur pesante crasait Paris, comme si lair de l-haut, alourdi, brl, tait
retomb sur la ville, de lair pais et cuisant qui faisait mal dans la poitrine.
Les chutes deau, devant lglise, tombaient mollement. Elles semblaient fati-
gues de couler, lasses et molles aussi, et le liquide du bassin o ottaient des
feuilles et des bouts de papier avait lair un peu verdtre, pais et glauque.
Un chien, ayant saut par-dessus le rebord de pierre, se baignait dans cette
onde douteuse. Quelques personnes, assises sur les bancs du petit jardin rond qui
contourne le portail, regardaient cette bte avec envie.
Du Roy tira sa montre. Il ntait encore que trois heures. Il avait trente minutes
davance.
Il riait enpensant ce rendez-vous. "Les glises lui sont bonnes tous les usages,
se disait-il. Elles la consolent davoir pous un juif, lui donnent une attitude de
protestation dans le monde politique, une allure comme il faut dans le monde
distingu, et un abri pour ses rencontres galantes. Ce que cest que lhabitude de
se servir de la religion comme on se sert dun en-tout-cas. Sil fait beau, cest une
canne ; sil fait du soleil, cest une ombrelle ; sil pleut, cest un parapluie, et, si on
ne sort pas, on le laisse dans lantichambre. Et elles sont des centaines comme a,
qui se chent du bon Dieu comme dune guigne, mais qui ne veulent pas quon en
dise du mal et qui le prennent loccasion pour entremetteur. Si on leur proposait
dentrer dans un htel meubl, elles trouveraient a une infamie, et il leur semble
tout simple de ler lamour au pied des autels."
Il marchait lentement le long du bassin; puis il regarda lheure de nouveau
lhorloge du clocher, qui avanait de deux minutes sur sa montre. Elle indiquait
trois heures cinq.
237
Il jugea quil serait encore mieux dedans ; et il entra.
Une fracheur de cave le saisit ; il laspira avec bonheur, puis il t le tour de la
nef pour bien connatre lendroit.
Une autre marche rgulire, interrompue parfois, puis recommenant, rpon-
dait, au fond du vaste monument, au bruit de ses pieds qui montait sonore sous la
haute vote. La curiosit lui vint de connatre ce promeneur. Il le chercha. Ctait
un gros homme chauve, qui allait le nez en lair, le chapeau derrire le dos.
De place enplace, une vieille femme agenouille priait, la gure dans ses mains.
Une sensation de solitude, de dsert, de repos, saisissait lesprit. La lumire,
nuance par les vitraux, tait douce aux yeux.
Du Roy trouva quil faisait " rudement bon " l-dedans.
Il revint prs de la porte, et regarda de nouveau sa montre. Il ntait encore que
trois heures quinze. Il sassit lentre de lalle principale, en regrettant quon ne
pt pas fumer une cigarette. On entendait toujours, au bout de lglise, prs du
chur, la promenade lente du gros monsieur.
Quelquunentra. Georges se retourna brusquement. Ctait une femme dupeuple,
en jupe de laine, une pauvre femme, qui tomba a genoux prs de la premire
chaise, et resta immobile, les doigts croiss, le regard au ciel, lme envole dans
la prire.
Du Roy la regardait avec intrt, se demandant quel chagrin, quelle douleur,
quel dsespoir pouvaient broyer ce cur inme. Elle crevait de misre ; ctait vi-
sible. Elle avait peut-tre encore un mari qui la tuait de coups ou bien un enfant
mourant.
Il murmurait mentalement : "Les pauvres tres. Y en a-t-il qui souffrent pour-
tant." Et une colre lui vint contre limpitoyable nature. Puis il rchit que ces
gueux croyaient au moins quon soccupait deux l-haut et que leur tat civil se
trouvait inscrit sur les registres du ciel avec la balance de la dette et de lavoir.
"L-haut." O donc ?
238
Et Du Roy, que le silence de lglise poussait aux vastes rves, jugeant dune
pense la cration, pronona, du bout des lvres : "Comme cest bte tout a."
Un bruit de robe le t tressaillir. Ctait elle.
Il se leva, savana vivement. Elle ne lui tendit pas la main, et murmura, voix
basse :
"Je nai que peu dinstants. Il faut que je rentre, mettez-vous genoux, prs de
moi, pour quon ne nous remarque pas."
Et elle savana dans la grande nef, cherchant un endroit convenable et sr, en
femme qui connat bien la maison. Sa gure tait cache par un voile pais, et elle
marchait pas sourds quon entendait peine.
Quand elle fut arrive prs du chur, elle se retourna et marmotta, de ce ton
toujours mystrieux quon garde dans les glises :
"Les bas-cts vaudront mieux. On est trop en vue par ici."
Elle salua le tabernacle du matre-autel dune grande inclinaison de tte, ren-
force dune lgre rvrence, et elle tourna droite, revint un peu vers lentre,
puis, prenant une rsolution, elle sempara dun prie-Dieu et sagenouilla.
Georges prit possession du prie-Dieu voisin, et, ds quils furent immobiles,
dans lattitude de loraison :
"Merci, merci, dit-il. Je vous adore. Je voudrais vous le dire toujours, vous ra-
conter comment jai commenc vous aimer, comment jai t sduit la premire
fois que je vous ai vue... Me permettrez-vous, un jour, de vider mon cur, de vous
exprimer tout cela ? "
Elle lcoutait dans une attitude de mditation profonde, comme si elle net
rien entendu. Elle rpondit entre ses doigts :
"Je suis folle de vous laisser me parler ainsi, folle dtre venue, folle de faire ce
que je fais, de vous laisser croire que cette... cette... cette aventure peut avoir une
suite. Oubliez cela, il le faut, et ne men reparlez jamais."
239
Elle attendit. Il cherchait une rponse, des mots dcisifs, passionns, mais ne
pouvant joindre le gestes aux paroles, son action se trouvait paralyse.
Il reprit :
"Je nattends rien... je nespre rien. Je vous aime. Quoi que vous fassiez, je vous
le rpterai si souvent, avec tant de force et dardeur, que vous nirez bien par
le comprendre. Je veux faire pntrer en vous ma tendresse, vous la verser dans
lme, mot par mot, heure par heure, jour par jour, de sorte quenn elle vous im-
prgne comme une liqueur tombe goutte goutte, quelle vous adoucisse, vous
amollisse et vous force, plus tard, me rpondre : "Moi aussi je vous aime."
Il sentait trembler sonpaule contre lui et sa gorge palpiter ; et elle balbutia, trs
vite :
"Moi aussi, je vous aime."
Il eut un sursaut, comme si un grand coup lui ft tomb sur la tte, et il soupira :
"Oh! mon Dieu!..."
Elle reprit, dune voix haletante :
"Est-ce que je devrais vous dire cela ? Je me sens coupable et mprisable... moi...
qui ai deux lles... mais je ne peux pas... je ne peux pas... Je naurais pas cru... je
naurais jamais pens... cest plus fort... plus fort que moi. coutez... coutez... je
nai jamais aim... que vous... je vous le jure. Et je vous aime depuis un an, en
secret, dans le secret de mon cur. Oh! jai souffert, allez, et lutt, je ne peux plus,
je vous aime..."
Elle pleurait dans ses doigts croiss sur son visage, et tout son corps frmissait,
secou par la violence de son motion.
George murmura :
"Donnez-moi votre main, que je la touche, que je la presse..."
Elle ta lentement sa main de sa gure. Il vit sa joue toute mouille, et une
goutte deau prte tomber encore au bord des cils.
240
Il avait pris cette main, il la serrait :
"Oh! comme je voudrais boire vos larmes."
Elle dit dune voix basse et brise, qui ressemblait un gmissement :
"Nabusez pas de moi... je me suis perdue !"
Il eut envie de sourire. Comment aurait-il abus delle en ce lieu? Il posa sur son
cur la main quil tenait, en demandant : "Le sentez-vous battre ?" Car il tait
bout de phrases passionnes.
Mais, depuis quelques instants, le pas rgulier du promeneur se rapprochait.
Il avait fait le tour des autels, et il redescendait, pour la seconde fois au moins,
par la petite nef de droite. Quand Mme Walter lentendit tout prs du pilier qui la
cachait, elle arracha ses doigts de ltreinte de Georges, et, de nouveau, se couvrit
la gure.
Et ils restrent tous deux immobiles, agenouills comme sils eussent adress
ensemble au ciel des supplications ardentes. Le gros monsieur passa prs deux,
leur jeta un regard indiffrent, et sloigna vers le bas de lglise en tenant toujours
son chapeau dans son dos.
Mais Du Roy, qui songeait obtenir unrendez-vous ailleurs qu la Trinit, mur-
mura :
"O vous verrai-je demain?"
Elle ne rpondit pas. Elle semblait inanime, change en statue de la Prire.
Il reprit :
"Demain, voulez-vous que je vous retrouve au parc Monceau?"
Elle tourna vers lui sa face redcouverte, une face livide, crispe par une souf-
france affreuse :, et, dune voix saccade :
241
"Laissez-moi... laissez-moi, maintenant... allez-vous-en... allez-vous-en... seule-
ment cinq minutes ; je souffre trop, prs de vous... je veux prier... je ne peux pas...
allez-vous-en... laissez-moi prier... seule... cinq minutes... je ne peux pas... laissez-
moi implorer Dieu quil me pardonne... quil me sauve... laissez-moi... cinq mi-
nutes..."
Elle avait un visage tellement boulevers, une gure si douloureuse, quil se leva
sans dire un mot, puis aprs un peu dhsitation, il demanda :
"Je reviendrai tout lheure ?"
Elle t un signe de tte, qui voulait dire : "Oui, tout lheure." Et il remonta vers
le chur.
Alors, elle tenta de prier. Elle t un effort dinvocation surhumaine pour appeler
Dieu, et, le corps vibrant, lme perdue, elle cria : " Piti !" vers le ciel.
Elle fermait ses yeux avec rage pour ne plus voir celui qui venait de sen aller !
Elle le chassait de sa pense, elle se dbattait contre lui, mais au lieu de lappa-
rition cleste attendue dans la dtresse de son cur, elle apercevait toujours la
moustache frise du jeune homme.
Depuis un an, elle luttait ainsi tous les jours, tous les soirs, contre cette obses-
sion grandissante, contre cette image qui hantait ses rves, qui hantait sa chair et
troublait ses nuits. Elle se sentait prise comme une bte dans un let, lie, jete
entre les bras de ce mle qui lavait vaincue, conquise, rien que par le poil de sa
lvre et par la couleur de ses yeux.
Et maintenant, dans cette glise, tout prs de Dieu, elle se sentait plus faible,
plus abandonne, plus perdue encore que chez elle. Elle ne pouvait plus prier,
elle ne pouvait penser qu lui. Elle souffrait dj quil se ft loign. Elle luttait
cependant en dsespre, elle se dfendait, appelait du secours de toute la force
de sonme. Elle et voulumourir, plutt que de tomber ainsi, elle qui navait point
failli. Elle murmurait des paroles perdues de supplication; mais elle coutait le
pas de Georges saffaiblir dans le lointain des votes.
Elle comprit que ctait ni, que la lutte tait inutile ! Elle ne voulait pas c-
der pourtant ; et elle fut saisie par une de ces crises dnervement qui jettent les
femmes, palpitantes, hurlantes et tordues sur le sol. Elle tremblait de tous ses
242
membres, sentant bien quelle allait tomber, se rouler entre les chaises en pous-
sant des cris aigus.
Quelquunsapprochait dune marche rapide. Elle tourna la tte. Ctait unprtre.
Alors elle se leva, courut lui en tendant ses mains jointes, et elle balbutia : "Oh!
sauvez-moi ! sauvez-moi ! "
Il sarrta surpris :
"Quest-ce que vous dsirez, madame ?
- Je veux que nous me sauviez. Ayez piti de moi. Si vous ne venez pas mon
aide, je suis perdue."
Il la regardait, se demandant si elle ntait pas folle. Il reprit :
"Que puis-je faire pour vous ?"
Ctait un jeune homme, grand, un peu gras, aux joues pleines et tombantes,
teintes de noir par la barbe rase avec soin, un beau vicaire de ville, de quartier
opulent, habitu aux riches pnitentes.
"Recevez ma confession, dit-elle, et conseillez-moi, soutenez-moi, dites-moi ce
quil faut faire !"
Il rpondit :
"Je confesse tous les samedis, de trois heures six heures."
Ayant saisi son bras, elle le serrait en rptant :
"Non! non! non! tout de suite ! tout de suite ! Il le faut ! Il est l ! Dans cette
glise ! Il mattend."
Le prtre demanda :
Qui est-ce qui vous attend?
243
- Un homme... qui va me perdre... qui va me prendre, si vous ne me sauvez pas...
Je ne peux plus le fuir...
Je suis trop faible... trop faible... si faible... si faible !..."
Elle sabattit ses genoux, et sanglotant :
"Oh! ayez piti de moi, mon pre ! Sauvez-moi, au nom de Dieu, sauvez-moi !"
Elle le tenait par sa robe noire pour quil ne pt schapper ; et lui, inquiet, re-
gardait de tous les cts si quelque oeil malveillant ou dvot ne voyait point cette
femme tombe ses pieds.
Comprenant, enn, quil ne lui chapperait pas :
"Relevez-vous, dit-il, jai justement sur moi la clef duconfessionnal." Et fouillant
dans sa poche, il en tira un anneau garni de clefs, puis il en choisit une, et il se di-
rigea, dun pas rapide, vers les petites cabanes de bois, sorte de botes aux ordures
de lme, o les croyants vident leurs pchs.
Il entra par la porte du milieu quil referma sur lui, et Mme Walter, stant jete
dans ltroite case d ct, balbutia avec ferveur, avec un lan passionn desp-
rance :
"Bnissez-moi, mon pre, parce que jai pch."
. . . . . . . .
Du Roy, ayant fait le tour du chur, descendit la nef de gauche. Il arrivait au mi-
lieu quand il rencontra le gros monsieur chauve, allant toujours de son pas tran-
quille, et il se demanda :
"Quest-ce que ce particulier-l peut bien faire ici ?"
Le promeneur aussi avait ralenti sa marche et regardait Georges avec un dsir
visible de lui parler. Quand il fut tout prs, il salua, et trs poliment :
244
"Je vous demande pardon, monsieur, de vous dranger, mais pourriez-vous me
dire quelle poque a t construit ce monument ?"
Du Roy rpondit :
"Ma foi, je nen sais trop rien, je pense quil y a vingt ans, ou vingt-cinq ans.
Cest, dailleurs, la premire fois que jy entre.
- Moi aussi. Je ne lavais jamais vu."
Alors, le journaliste, quun intrt gagnait, reprit :
"Il me semble que vous le visitez avec grand soin. Vous ltudiez dans ses d-
tails."
Lautre, avec rsignation :
"Je ne le visite pas, monsieur, jattends ma femme qui ma donn rendez-vous
ici, et qui est fort en retard."
Puis il se tut, et aprs quelques secondes :
"Il fait rudement chaud, dehors."
Du Roy le considrait, lui trouvant une bonne tte, et, tout coup, il simagina
quil ressemblait Forestier.
"Vous tes de la province ? dit-il.
- Oui. Je suis de Rennes. Et vous, monsieur, cest par curiosit que vous tes
entr dans cette glise ?
- Non. Jattends une femme, moi."
Et layant salu, le journaliste sloigna, le sourire aux lvres.
En approchant de la grande porte, il revit la pauvresse, toujours genoux et
priant toujours. Il pensa :
245
"Cristi ! elle a linvocation tenace." Il ntait plus mu, il ne la plaignait plus.
Il passa, et, doucement, se mit remonter la nef de droite pour retrouver Mme
Walter.
Il guettait de loinla place o il lavait laisse, stonnant de ne pas lapercevoir. Il
crut stre tromp de pilier, alla jusquau dernier, et revint ensuite. Elle tait donc
partie ! Il demeurait surpris et furieux. Puis il simagina quelle le cherchait, et il
ret le tour de lglise. Ne layant point trouve, il retourna sasseoir sur la chaise
quelle avait occupe, esprant quelle ly rejoindrait. Et il attendit.
Bientt un lger murmure de voix veilla son attention. Il navait vu personne
dans ce coin de lglise. Do venait donc ce chuchotement ? Il se leva pour cher-
cher, et il aperut, dans la chapelle voisine, les portes duconfessionnal. Unbout de
robe sortait de lune et tranait sur le pav. Il sapprocha pour examiner la femme.
Il la reconnut. Elle se confessait !...
Il sentit un dsir violent de la prendre par les paules et de larracher de cette
bote. Puis il pensa : "Bah! cest le tour du cur, ce sera le mien demain." Et il
sassit tranquillement en face des guichets de la pnitence, attendant son heure,
et ricanant, prsent, de laventure.
Il attendit longtemps. Enn, Mme Walter se releva, se retourna, le vit et vint
lui. Elle avait un visage froid et svre.
"Monsieur, dit-elle, je vous prie de ne pas maccompagner, de ne pas me suivre,
et de ne plus venir, seul, chez moi. Vous ne seriez point reu. Adieu!"
Et elle sen alla, dune dmarche digne.
Il la laissa sloigner, car il avait pour principe de ne jamais forcer les vne-
ments. Puis comme le prtre, un peu troubl, sortait son tour de son rduit, il
marcha droit lui, et le regardant au fond des yeux, il lui grogna dans le nez :
"Si vous ne portiez point une jupe, vous, quelle paire de soufets sur votre vilain
museau."
Puis il pivota sur ses talons et sortit de lglise en sifotant.
246
Debout sous le portail, le gros monsieur, le chapeau sur la tte et les mains der-
rire le dos, las dattendre, parcourait du regard la vaste place et toutes les rues qui
sy rejoignent.
Quand Du Roy passa prs de lui, ils se salurent.
Le journaliste, se trouvant libre, descendit La Vie Franaise. Ds lentre, il
vit la mine affaire des garons quil se passait des choses anormales, et il entra
brusquement dans le cabinet du directeur.
Le pre Walter, debout, nerveux, dictait un article par phrases haches, don-
nait, entre deux alinas, des missions ses reporters qui lentouraient, faisait des
recommandations Boisrenard, et dcachetait des lettres.
Quand Du Roy entra, le patron poussa un cri de joie :
"Ah! quelle chance, voil Bel-Ami !"
Il sarrta net, un peu confus, et sexcusa :
"Je vous demande pardon de vous avoir appel ainsi, je suis trs troubl par les
circonstances. Et puis, jentends ma femme et mes lles vous nommer " Bel-Ami
" du matin au soir, et je nis par en prendre moi-mme lhabitude. Vous ne men
voulez pas ?"
Georges riait :
"Pas du tout. Ce surnom na rien qui me dplaise."
Le pre Walter reprit :
"Trs bien, alors je vous baptise Bel-Ami comme tout le monde. Eh bien! voil,
nous avons de gros vnements. Le ministre est tomb sur un vote de trois cent
dix voix contre cent deux. Nos vacances sont encore remises, remises aux calendes
grecques, et nous voici au 28 juillet. LEspagne se fche pour le Maroc, cest ce qui
a jet bas Durand de lAine et ses acolytes. Nous sommes dans le ptrin jusquau
cou. Marrot est charg de former un nouveau cabinet. Il prend le gnral Boutin
dAcre la Guerre et notre ami Laroche-Mathieu aux Affaires trangres. Il garde
247
lui-mme le portefeuille de lIntrieur, avec la prsidence du Conseil. Nous allons
devenir une feuille ofcieuse. Je fais larticle de tte, une simple dclaration de
principes, en traant leur voie aux ministres."
Le bonhomme sourit et reprit :
"La voie quils comptent suivre, bienentendu. Mais il me faudrait quelque chose
dintressant sur la question du Maroc, une actualit, une chronique effet, sen-
sation, je ne sais quoi ? Trouvez-moi a, vous."
Du Roy rchit une seconde puis rpondit :
"Jai votre affaire. Je vous donne une tude sur la situation politique de toute
notre colonie africaine, avec la Tunisie gauche, lAlgrie au milieu, et le Maroc
droite, lhistoire des races qui peuplent ce grand territoire, et le rcit dune excur-
sion sur la frontire marocaine jusqu la grande oasis de Figuig o aucun Euro-
pen na pntr et qui est la cause du conit actuel. a vous va-t-il ?"
Le pre Walter scria :
"Admirable ! Et quel titre ?
- De Tunis Tanger !
- Superbe."
Et Du Roy sen alla fouiller dans la collection de La Vie Franaise pour retrouver
son premier article : "Les Mmoires dun chasseur dAfrique", qui, dbaptis, re-
tap et modi, ferait admirablement laffaire, dun bout lautre, puisquil y tait
question de politique coloniale, de la population algrienne et dune excursion
dans la province dOran.
En trois quarts dheure, la chose fut refaite, rastole, mise au point, avec une
saveur dactualit et des louanges pour le nouveau cabinet.
Le directeur, ayant lu larticle, dclara :
"Cest parfait... parfait... parfait. Vous tes un homme prcieux. Tous mes com-
pliments."
248
Et Du Roy rentra dner, enchant de sa journe, malgr lchec de la Trinit, car
il sentait bien la partie gagne.
Sa femme, vreuse, lattendait. Elle scria en le voyant :
"Tu sais que Laroche est ministre des Affaires trangres.
- Oui, je viens mme de faire un article sur lAlgrie ce sujet.
- Quoi donc ?
- Tu le connais, le premier que nous ayons crit ensemble : "Les Mmoires dun
chasseur dAfrique", revu et corrig pour la circonstance."
Elle sourit.
"Ah! oui, mais a va trs bien."
Puis aprs avoir song quelques instants :
"Jy pense, cette suite que tu devais faire alors, et que tu as... laisse en route.
Nous pouvons nous y mettre prsent. a nous donnera une jolie srie bien en
situation."
Il rpondit en sasseyant devant son potage :
"Parfaitement. Rien ne sy oppose plus, maintenant que ce cocu de Forestier est
trpass."
Elle rpliqua vivement dun ton sec, bless :
"Cette plaisanterie est plus que dplace, et je te prie dy mettre un terme. Voil
trop longtemps quelle dure."
Il allait riposter avec ironie ; on lui apporta une dpche contenant cette seule
phrase, sans signature :
249
"Javais perdu la tte. Pardonnez-moi et venez demain, quatre heures, au parc
Monceau."
Il comprit, et, le cur tout coup plein de joie, il dit sa femme, en glissant le
papier bleu dans sa poche :
"Je ne le ferai plus, ma chrie. Cest bte. Je le reconnais."
Et il recommena dner.
Tout en mangeant, il se rptait ces quelques mots :
"Javais perdu la tte, pardonnez-moi, et venez demain, quatre heures, au parc
Monceau." Donc elle cdait. Cela voulait dire : "Je me rends, je suis vous, o vous
voudrez, quand vous voudrez."
Il se mit rire. Madeleine demanda :
"Quest-ce que tu as ?
- Pas grand-chose. Je pense un cur que jai rencontr tantt, et qui avait une
bonne binette."
Du Roy arriva juste lheure au rendez-vous du lendemain. Sur tous les bancs
du parc taient assis des bourgeois accabls par la chaleur, et des bonnes noncha-
lantes qui semblaient rver pendant que les enfants se roulaient dans le sable des
chemins.
Il trouva Mme Walter dans la petite ruine antique o coule une source. Elle fai-
sait le tour du cirque troit de colonnettes, dun air inquiet et malheureux.
Aussitt quil leut salue :
"Comme il y a du monde dans ce jardin!" dit-elle.
Il saisit loccasion :
Oui, cest vrai ; voulez-vous venir autre part ?
250
- Mais o?
- Nimporte o, dans une voiture, par exemple. Vous baisserez le store de votre
ct, et vous serez bien labri.
- Oui, jaime mieux a ; ici je meurs de peur.
- Eh bien, vous allez me retrouver dans cinq minutes la porte qui donne sur le
boulevard extrieur. Jy arriverai avec un acre."
Et il partit en courant. Ds quelle leut rejoint et quelle eut bien voil la vitre de
son ct, elle demanda :
"O avez-vous dit au cocher de nous conduire ?"
Georges rpondit :
"Ne vous occupez de rien, il est au courant."
Il avait donn lhomme ladresse de son appartement de la rue de Constanti-
nople.
Elle reprit :
"Vous ne vous gurez pas comme je souffre cause de vous, comme je suis tour-
mente et torture. Hier, jai t dure, dans lglise, mais je voulais vous fuir tout
prix. Jai tellement peur de me trouver seule avec vous. Mavez-vous pardonn ?"
Il lui serrait les mains :
"Oui, oui. Quest-ce que je ne vous pardonnerais pas, vous aimant comme je
vous aime ?"
Elle le regardait dun air suppliant.
"coutez, il faut me promettre de me respecter... de ne pas... de ne pas... autre-
ment je ne pourrais plus vous revoir."
251
Il ne rpondit point dabord; il avait sous la moustache ce sourire n qui trou-
blait les femmes. Il nit par murmurer :
"Je suis votre esclave."
Alors elle se mit lui raconter comment elle stait aperue quelle laimait en
apprenant quil allait pouser Madeleine Forestier. Elle donnait des dtails, de pe-
tits dtails de dates et de choses intimes.
Soudain elle se tut. La voiture venait de sarrter. Du Roy ouvrit la portire.
"O sommes-nous ?" dit-elle.
Il rpondit :
"Descendez et entrez dans cette maison. Nous y serons plus tranquilles.
- Mais o sommes-nous ?
- Chez moi. Cest mon appartement de garon que jai repris... pour quelques
jours... pour avoir un coin o nous puissions nous voir."
Elle stait cramponne au capiton du acre, pouvante lide de ce tte--
tte, et elle balbutiait :
"Non, non, je ne veux pas ! Je ne veux pas !"
Il pronona dune voix nergique :
"Je vous jure de vous respecter. Venez. Vous voyez bien quon nous regarde,
quon va se rassembler autour de nous. Dpchez-vous... dpchez-vous... des-
cendez."
Et il rpta :
"Je vous jure de vous respecter."
252
Un marchand de vin sur sa porte les regardait dun air curieux. Elle fut saisie de
terreur et slana dans la maison.
Elle allait monter lescalier. Il la retint par le bras :
"Cest ici, au rez-de-chausse."
Et il la poussa dans son logis.
Ds quil eut referm la porte, il la saisit comme une proie. Elle se dbattait,
luttait, bgayait :
"Oh! mon Dieu!... oh! mon Dieu!..."
Il lui baisait le cou, les yeux, les lvres avec emportement, sans quelle pt viter
ses caresses furieuses ; et tout en le repoussant, tout en fuyant sa bouche, elle lui
rendait, malgr elle, ses baisers.
Tout dun coup elle cessa de se dbattre, et vaincue, rsigne, se laissa dvtir
par lui. Il enlevait une une, adroitement et vite, toutes les parties de soncostume,
avec des doigts lgers de femme de chambre.
Elle lui avait arrach des mains son corsage pour se cacher la gure dedans, et
elle demeurait debout, toute blanche, au milieu de ses robes abattues ses pieds.
Il lui laissa ses bottines et lemporta dans ses bras vers le lit. Alors, elle lui mur-
mura loreille, dune voix brise : "Je vous jure... je vous jure... que je nai jamais
eu damant." Comme une jeune lle aurait dit : "Je vous jure que je suis vierge."
Et il pensait : "Voil ce qui mest bien gal, par exemple."
253
Chapitre 13
La place de la Trinit tait presque dserte, sous un clatant soleil de juillet.
Une chaleur pesante crasait Paris, comme si lair de l-haut, alourdi, brl, tait
retomb sur la ville, de lair pais et cuisant qui faisait mal dans la poitrine.
Les chutes deau, devant lglise, tombaient mollement. Elles semblaient fati-
gues de couler, lasses et molles aussi, et le liquide du bassin o ottaient des
feuilles et des bouts de papier avait lair un peu verdtre, pais et glauque.
Un chien, ayant saut par-dessus le rebord de pierre, se baignait dans cette
onde douteuse. Quelques personnes, assises sur les bancs du petit jardin rond qui
contourne le portail, regardaient cette bte avec envie.
Du Roy tira sa montre. Il ntait encore que trois heures. Il avait trente minutes
davance.
Il riait enpensant ce rendez-vous. "Les glises lui sont bonnes tous les usages,
se disait-il. Elles la consolent davoir pous un juif, lui donnent une attitude de
protestation dans le monde politique, une allure comme il faut dans le monde
distingu, et un abri pour ses rencontres galantes. Ce que cest que lhabitude de
se servir de la religion comme on se sert dun en-tout-cas. Sil fait beau, cest une
canne ; sil fait du soleil, cest une ombrelle ; sil pleut, cest un parapluie, et, si on
ne sort pas, on le laisse dans lantichambre. Et elles sont des centaines comme a,
qui se chent du bon Dieu comme dune guigne, mais qui ne veulent pas quon en
dise du mal et qui le prennent loccasion pour entremetteur. Si on leur proposait
dentrer dans un htel meubl, elles trouveraient a une infamie, et il leur semble
tout simple de ler lamour au pied des autels."
Il marchait lentement le long du bassin; puis il regarda lheure de nouveau
lhorloge du clocher, qui avanait de deux minutes sur sa montre. Elle indiquait
trois heures cinq.
254
Il jugea quil serait encore mieux dedans ; et il entra.
Une fracheur de cave le saisit ; il laspira avec bonheur, puis il t le tour de la
nef pour bien connatre lendroit.
Une autre marche rgulire, interrompue parfois, puis recommenant, rpon-
dait, au fond du vaste monument, au bruit de ses pieds qui montait sonore sous la
haute vote. La curiosit lui vint de connatre ce promeneur. Il le chercha. Ctait
un gros homme chauve, qui allait le nez en lair, le chapeau derrire le dos.
De place enplace, une vieille femme agenouille priait, la gure dans ses mains.
Une sensation de solitude, de dsert, de repos, saisissait lesprit. La lumire,
nuance par les vitraux, tait douce aux yeux.
Du Roy trouva quil faisait " rudement bon " l-dedans.
Il revint prs de la porte, et regarda de nouveau sa montre. Il ntait encore que
trois heures quinze. Il sassit lentre de lalle principale, en regrettant quon ne
pt pas fumer une cigarette. On entendait toujours, au bout de lglise, prs du
chur, la promenade lente du gros monsieur.
Quelquunentra. Georges se retourna brusquement. Ctait une femme dupeuple,
en jupe de laine, une pauvre femme, qui tomba a genoux prs de la premire
chaise, et resta immobile, les doigts croiss, le regard au ciel, lme envole dans
la prire.
Du Roy la regardait avec intrt, se demandant quel chagrin, quelle douleur,
quel dsespoir pouvaient broyer ce cur inme. Elle crevait de misre ; ctait vi-
sible. Elle avait peut-tre encore un mari qui la tuait de coups ou bien un enfant
mourant.
Il murmurait mentalement : "Les pauvres tres. Y en a-t-il qui souffrent pour-
tant." Et une colre lui vint contre limpitoyable nature. Puis il rchit que ces
gueux croyaient au moins quon soccupait deux l-haut et que leur tat civil se
trouvait inscrit sur les registres du ciel avec la balance de la dette et de lavoir.
"L-haut." O donc ?
255
Et Du Roy, que le silence de lglise poussait aux vastes rves, jugeant dune
pense la cration, pronona, du bout des lvres : "Comme cest bte tout a."
Un bruit de robe le t tressaillir. Ctait elle.
Il se leva, savana vivement. Elle ne lui tendit pas la main, et murmura, voix
basse :
"Je nai que peu dinstants. Il faut que je rentre, mettez-vous genoux, prs de
moi, pour quon ne nous remarque pas."
Et elle savana dans la grande nef, cherchant un endroit convenable et sr, en
femme qui connat bien la maison. Sa gure tait cache par un voile pais, et elle
marchait pas sourds quon entendait peine.
Quand elle fut arrive prs du chur, elle se retourna et marmotta, de ce ton
toujours mystrieux quon garde dans les glises :
"Les bas-cts vaudront mieux. On est trop en vue par ici."
Elle salua le tabernacle du matre-autel dune grande inclinaison de tte, ren-
force dune lgre rvrence, et elle tourna droite, revint un peu vers lentre,
puis, prenant une rsolution, elle sempara dun prie-Dieu et sagenouilla.
Georges prit possession du prie-Dieu voisin, et, ds quils furent immobiles,
dans lattitude de loraison :
"Merci, merci, dit-il. Je vous adore. Je voudrais vous le dire toujours, vous ra-
conter comment jai commenc vous aimer, comment jai t sduit la premire
fois que je vous ai vue... Me permettrez-vous, un jour, de vider mon cur, de vous
exprimer tout cela ? "
Elle lcoutait dans une attitude de mditation profonde, comme si elle net
rien entendu. Elle rpondit entre ses doigts :
"Je suis folle de vous laisser me parler ainsi, folle dtre venue, folle de faire ce
que je fais, de vous laisser croire que cette... cette... cette aventure peut avoir une
suite. Oubliez cela, il le faut, et ne men reparlez jamais."
256
Elle attendit. Il cherchait une rponse, des mots dcisifs, passionns, mais ne
pouvant joindre le gestes aux paroles, son action se trouvait paralyse.
Il reprit :
"Je nattends rien... je nespre rien. Je vous aime. Quoi que vous fassiez, je vous
le rpterai si souvent, avec tant de force et dardeur, que vous nirez bien par
le comprendre. Je veux faire pntrer en vous ma tendresse, vous la verser dans
lme, mot par mot, heure par heure, jour par jour, de sorte quenn elle vous im-
prgne comme une liqueur tombe goutte goutte, quelle vous adoucisse, vous
amollisse et vous force, plus tard, me rpondre : "Moi aussi je vous aime."
Il sentait trembler sonpaule contre lui et sa gorge palpiter ; et elle balbutia, trs
vite :
"Moi aussi, je vous aime."
Il eut un sursaut, comme si un grand coup lui ft tomb sur la tte, et il soupira :
"Oh! mon Dieu!..."
Elle reprit, dune voix haletante :
"Est-ce que je devrais vous dire cela ? Je me sens coupable et mprisable... moi...
qui ai deux lles... mais je ne peux pas... je ne peux pas... Je naurais pas cru... je
naurais jamais pens... cest plus fort... plus fort que moi. coutez... coutez... je
nai jamais aim... que vous... je vous le jure. Et je vous aime depuis un an, en
secret, dans le secret de mon cur. Oh! jai souffert, allez, et lutt, je ne peux plus,
je vous aime..."
Elle pleurait dans ses doigts croiss sur son visage, et tout son corps frmissait,
secou par la violence de son motion.
George murmura :
"Donnez-moi votre main, que je la touche, que je la presse..."
Elle ta lentement sa main de sa gure. Il vit sa joue toute mouille, et une
goutte deau prte tomber encore au bord des cils.
257
Il avait pris cette main, il la serrait :
"Oh! comme je voudrais boire vos larmes."
Elle dit dune voix basse et brise, qui ressemblait un gmissement :
"Nabusez pas de moi... je me suis perdue !"
Il eut envie de sourire. Comment aurait-il abus delle en ce lieu? Il posa sur son
cur la main quil tenait, en demandant : "Le sentez-vous battre ?" Car il tait
bout de phrases passionnes.
Mais, depuis quelques instants, le pas rgulier du promeneur se rapprochait.
Il avait fait le tour des autels, et il redescendait, pour la seconde fois au moins,
par la petite nef de droite. Quand Mme Walter lentendit tout prs du pilier qui la
cachait, elle arracha ses doigts de ltreinte de Georges, et, de nouveau, se couvrit
la gure.
Et ils restrent tous deux immobiles, agenouills comme sils eussent adress
ensemble au ciel des supplications ardentes. Le gros monsieur passa prs deux,
leur jeta un regard indiffrent, et sloigna vers le bas de lglise en tenant toujours
son chapeau dans son dos.
Mais Du Roy, qui songeait obtenir unrendez-vous ailleurs qu la Trinit, mur-
mura :
"O vous verrai-je demain?"
Elle ne rpondit pas. Elle semblait inanime, change en statue de la Prire.
Il reprit :
"Demain, voulez-vous que je vous retrouve au parc Monceau?"
Elle tourna vers lui sa face redcouverte, une face livide, crispe par une souf-
france affreuse :, et, dune voix saccade :
258
"Laissez-moi... laissez-moi, maintenant... allez-vous-en... allez-vous-en... seule-
ment cinq minutes ; je souffre trop, prs de vous... je veux prier... je ne peux pas...
allez-vous-en... laissez-moi prier... seule... cinq minutes... je ne peux pas... laissez-
moi implorer Dieu quil me pardonne... quil me sauve... laissez-moi... cinq mi-
nutes..."
Elle avait un visage tellement boulevers, une gure si douloureuse, quil se leva
sans dire un mot, puis aprs un peu dhsitation, il demanda :
"Je reviendrai tout lheure ?"
Elle t un signe de tte, qui voulait dire : "Oui, tout lheure." Et il remonta vers
le chur.
Alors, elle tenta de prier. Elle t un effort dinvocation surhumaine pour appeler
Dieu, et, le corps vibrant, lme perdue, elle cria : " Piti !" vers le ciel.
Elle fermait ses yeux avec rage pour ne plus voir celui qui venait de sen aller !
Elle le chassait de sa pense, elle se dbattait contre lui, mais au lieu de lappa-
rition cleste attendue dans la dtresse de son cur, elle apercevait toujours la
moustache frise du jeune homme.
Depuis un an, elle luttait ainsi tous les jours, tous les soirs, contre cette obses-
sion grandissante, contre cette image qui hantait ses rves, qui hantait sa chair et
troublait ses nuits. Elle se sentait prise comme une bte dans un let, lie, jete
entre les bras de ce mle qui lavait vaincue, conquise, rien que par le poil de sa
lvre et par la couleur de ses yeux.
Et maintenant, dans cette glise, tout prs de Dieu, elle se sentait plus faible,
plus abandonne, plus perdue encore que chez elle. Elle ne pouvait plus prier,
elle ne pouvait penser qu lui. Elle souffrait dj quil se ft loign. Elle luttait
cependant en dsespre, elle se dfendait, appelait du secours de toute la force
de sonme. Elle et voulumourir, plutt que de tomber ainsi, elle qui navait point
failli. Elle murmurait des paroles perdues de supplication; mais elle coutait le
pas de Georges saffaiblir dans le lointain des votes.
Elle comprit que ctait ni, que la lutte tait inutile ! Elle ne voulait pas c-
der pourtant ; et elle fut saisie par une de ces crises dnervement qui jettent les
femmes, palpitantes, hurlantes et tordues sur le sol. Elle tremblait de tous ses
259
membres, sentant bien quelle allait tomber, se rouler entre les chaises en pous-
sant des cris aigus.
Quelquunsapprochait dune marche rapide. Elle tourna la tte. Ctait unprtre.
Alors elle se leva, courut lui en tendant ses mains jointes, et elle balbutia : "Oh!
sauvez-moi ! sauvez-moi ! "
Il sarrta surpris :
"Quest-ce que vous dsirez, madame ?
- Je veux que nous me sauviez. Ayez piti de moi. Si vous ne venez pas mon
aide, je suis perdue."
Il la regardait, se demandant si elle ntait pas folle. Il reprit :
"Que puis-je faire pour vous ?"
Ctait un jeune homme, grand, un peu gras, aux joues pleines et tombantes,
teintes de noir par la barbe rase avec soin, un beau vicaire de ville, de quartier
opulent, habitu aux riches pnitentes.
"Recevez ma confession, dit-elle, et conseillez-moi, soutenez-moi, dites-moi ce
quil faut faire !"
Il rpondit :
"Je confesse tous les samedis, de trois heures six heures."
Ayant saisi son bras, elle le serrait en rptant :
"Non! non! non! tout de suite ! tout de suite ! Il le faut ! Il est l ! Dans cette
glise ! Il mattend."
Le prtre demanda :
Qui est-ce qui vous attend?
260
- Un homme... qui va me perdre... qui va me prendre, si vous ne me sauvez pas...
Je ne peux plus le fuir...
Je suis trop faible... trop faible... si faible... si faible !..."
Elle sabattit ses genoux, et sanglotant :
"Oh! ayez piti de moi, mon pre ! Sauvez-moi, au nom de Dieu, sauvez-moi !"
Elle le tenait par sa robe noire pour quil ne pt schapper ; et lui, inquiet, re-
gardait de tous les cts si quelque oeil malveillant ou dvot ne voyait point cette
femme tombe ses pieds.
Comprenant, enn, quil ne lui chapperait pas :
"Relevez-vous, dit-il, jai justement sur moi la clef duconfessionnal." Et fouillant
dans sa poche, il en tira un anneau garni de clefs, puis il en choisit une, et il se di-
rigea, dun pas rapide, vers les petites cabanes de bois, sorte de botes aux ordures
de lme, o les croyants vident leurs pchs.
Il entra par la porte du milieu quil referma sur lui, et Mme Walter, stant jete
dans ltroite case d ct, balbutia avec ferveur, avec un lan passionn desp-
rance :
"Bnissez-moi, mon pre, parce que jai pch."
. . . . . . . .
Du Roy, ayant fait le tour du chur, descendit la nef de gauche. Il arrivait au mi-
lieu quand il rencontra le gros monsieur chauve, allant toujours de son pas tran-
quille, et il se demanda :
"Quest-ce que ce particulier-l peut bien faire ici ?"
Le promeneur aussi avait ralenti sa marche et regardait Georges avec un dsir
visible de lui parler. Quand il fut tout prs, il salua, et trs poliment :
261
"Je vous demande pardon, monsieur, de vous dranger, mais pourriez-vous me
dire quelle poque a t construit ce monument ?"
Du Roy rpondit :
"Ma foi, je nen sais trop rien, je pense quil y a vingt ans, ou vingt-cinq ans.
Cest, dailleurs, la premire fois que jy entre.
- Moi aussi. Je ne lavais jamais vu."
Alors, le journaliste, quun intrt gagnait, reprit :
"Il me semble que vous le visitez avec grand soin. Vous ltudiez dans ses d-
tails."
Lautre, avec rsignation :
"Je ne le visite pas, monsieur, jattends ma femme qui ma donn rendez-vous
ici, et qui est fort en retard."
Puis il se tut, et aprs quelques secondes :
"Il fait rudement chaud, dehors."
Du Roy le considrait, lui trouvant une bonne tte, et, tout coup, il simagina
quil ressemblait Forestier.
"Vous tes de la province ? dit-il.
- Oui. Je suis de Rennes. Et vous, monsieur, cest par curiosit que vous tes
entr dans cette glise ?
- Non. Jattends une femme, moi."
Et layant salu, le journaliste sloigna, le sourire aux lvres.
En approchant de la grande porte, il revit la pauvresse, toujours genoux et
priant toujours. Il pensa :
262
"Cristi ! elle a linvocation tenace." Il ntait plus mu, il ne la plaignait plus.
Il passa, et, doucement, se mit remonter la nef de droite pour retrouver Mme
Walter.
Il guettait de loinla place o il lavait laisse, stonnant de ne pas lapercevoir. Il
crut stre tromp de pilier, alla jusquau dernier, et revint ensuite. Elle tait donc
partie ! Il demeurait surpris et furieux. Puis il simagina quelle le cherchait, et il
ret le tour de lglise. Ne layant point trouve, il retourna sasseoir sur la chaise
quelle avait occupe, esprant quelle ly rejoindrait. Et il attendit.
Bientt un lger murmure de voix veilla son attention. Il navait vu personne
dans ce coin de lglise. Do venait donc ce chuchotement ? Il se leva pour cher-
cher, et il aperut, dans la chapelle voisine, les portes duconfessionnal. Unbout de
robe sortait de lune et tranait sur le pav. Il sapprocha pour examiner la femme.
Il la reconnut. Elle se confessait !...
Il sentit un dsir violent de la prendre par les paules et de larracher de cette
bote. Puis il pensa : "Bah! cest le tour du cur, ce sera le mien demain." Et il
sassit tranquillement en face des guichets de la pnitence, attendant son heure,
et ricanant, prsent, de laventure.
Il attendit longtemps. Enn, Mme Walter se releva, se retourna, le vit et vint
lui. Elle avait un visage froid et svre.
"Monsieur, dit-elle, je vous prie de ne pas maccompagner, de ne pas me suivre,
et de ne plus venir, seul, chez moi. Vous ne seriez point reu. Adieu!"
Et elle sen alla, dune dmarche digne.
Il la laissa sloigner, car il avait pour principe de ne jamais forcer les vne-
ments. Puis comme le prtre, un peu troubl, sortait son tour de son rduit, il
marcha droit lui, et le regardant au fond des yeux, il lui grogna dans le nez :
"Si vous ne portiez point une jupe, vous, quelle paire de soufets sur votre vilain
museau."
Puis il pivota sur ses talons et sortit de lglise en sifotant.
263
Debout sous le portail, le gros monsieur, le chapeau sur la tte et les mains der-
rire le dos, las dattendre, parcourait du regard la vaste place et toutes les rues qui
sy rejoignent.
Quand Du Roy passa prs de lui, ils se salurent.
Le journaliste, se trouvant libre, descendit La Vie Franaise. Ds lentre, il
vit la mine affaire des garons quil se passait des choses anormales, et il entra
brusquement dans le cabinet du directeur.
Le pre Walter, debout, nerveux, dictait un article par phrases haches, don-
nait, entre deux alinas, des missions ses reporters qui lentouraient, faisait des
recommandations Boisrenard, et dcachetait des lettres.
Quand Du Roy entra, le patron poussa un cri de joie :
"Ah! quelle chance, voil Bel-Ami !"
Il sarrta net, un peu confus, et sexcusa :
"Je vous demande pardon de vous avoir appel ainsi, je suis trs troubl par les
circonstances. Et puis, jentends ma femme et mes lles vous nommer " Bel-Ami
" du matin au soir, et je nis par en prendre moi-mme lhabitude. Vous ne men
voulez pas ?"
Georges riait :
"Pas du tout. Ce surnom na rien qui me dplaise."
Le pre Walter reprit :
"Trs bien, alors je vous baptise Bel-Ami comme tout le monde. Eh bien! voil,
nous avons de gros vnements. Le ministre est tomb sur un vote de trois cent
dix voix contre cent deux. Nos vacances sont encore remises, remises aux calendes
grecques, et nous voici au 28 juillet. LEspagne se fche pour le Maroc, cest ce qui
a jet bas Durand de lAine et ses acolytes. Nous sommes dans le ptrin jusquau
cou. Marrot est charg de former un nouveau cabinet. Il prend le gnral Boutin
dAcre la Guerre et notre ami Laroche-Mathieu aux Affaires trangres. Il garde
264
lui-mme le portefeuille de lIntrieur, avec la prsidence du Conseil. Nous allons
devenir une feuille ofcieuse. Je fais larticle de tte, une simple dclaration de
principes, en traant leur voie aux ministres."
Le bonhomme sourit et reprit :
"La voie quils comptent suivre, bienentendu. Mais il me faudrait quelque chose
dintressant sur la question du Maroc, une actualit, une chronique effet, sen-
sation, je ne sais quoi ? Trouvez-moi a, vous."
Du Roy rchit une seconde puis rpondit :
"Jai votre affaire. Je vous donne une tude sur la situation politique de toute
notre colonie africaine, avec la Tunisie gauche, lAlgrie au milieu, et le Maroc
droite, lhistoire des races qui peuplent ce grand territoire, et le rcit dune excur-
sion sur la frontire marocaine jusqu la grande oasis de Figuig o aucun Euro-
pen na pntr et qui est la cause du conit actuel. a vous va-t-il ?"
Le pre Walter scria :
"Admirable ! Et quel titre ?
- De Tunis Tanger !
- Superbe."
Et Du Roy sen alla fouiller dans la collection de La Vie Franaise pour retrouver
son premier article : "Les Mmoires dun chasseur dAfrique", qui, dbaptis, re-
tap et modi, ferait admirablement laffaire, dun bout lautre, puisquil y tait
question de politique coloniale, de la population algrienne et dune excursion
dans la province dOran.
En trois quarts dheure, la chose fut refaite, rastole, mise au point, avec une
saveur dactualit et des louanges pour le nouveau cabinet.
Le directeur, ayant lu larticle, dclara :
"Cest parfait... parfait... parfait. Vous tes un homme prcieux. Tous mes com-
pliments."
265
Et Du Roy rentra dner, enchant de sa journe, malgr lchec de la Trinit, car
il sentait bien la partie gagne.
Sa femme, vreuse, lattendait. Elle scria en le voyant :
"Tu sais que Laroche est ministre des Affaires trangres.
- Oui, je viens mme de faire un article sur lAlgrie ce sujet.
- Quoi donc ?
- Tu le connais, le premier que nous ayons crit ensemble : "Les Mmoires dun
chasseur dAfrique", revu et corrig pour la circonstance."
Elle sourit.
"Ah! oui, mais a va trs bien."
Puis aprs avoir song quelques instants :
"Jy pense, cette suite que tu devais faire alors, et que tu as... laisse en route.
Nous pouvons nous y mettre prsent. a nous donnera une jolie srie bien en
situation."
Il rpondit en sasseyant devant son potage :
"Parfaitement. Rien ne sy oppose plus, maintenant que ce cocu de Forestier est
trpass."
Elle rpliqua vivement dun ton sec, bless :
"Cette plaisanterie est plus que dplace, et je te prie dy mettre un terme. Voil
trop longtemps quelle dure."
Il allait riposter avec ironie ; on lui apporta une dpche contenant cette seule
phrase, sans signature :
266
"Javais perdu la tte. Pardonnez-moi et venez demain, quatre heures, au parc
Monceau."
Il comprit, et, le cur tout coup plein de joie, il dit sa femme, en glissant le
papier bleu dans sa poche :
"Je ne le ferai plus, ma chrie. Cest bte. Je le reconnais."
Et il recommena dner.
Tout en mangeant, il se rptait ces quelques mots :
"Javais perdu la tte, pardonnez-moi, et venez demain, quatre heures, au parc
Monceau." Donc elle cdait. Cela voulait dire : "Je me rends, je suis vous, o vous
voudrez, quand vous voudrez."
Il se mit rire. Madeleine demanda :
"Quest-ce que tu as ?
- Pas grand-chose. Je pense un cur que jai rencontr tantt, et qui avait une
bonne binette."
Du Roy arriva juste lheure au rendez-vous du lendemain. Sur tous les bancs
du parc taient assis des bourgeois accabls par la chaleur, et des bonnes noncha-
lantes qui semblaient rver pendant que les enfants se roulaient dans le sable des
chemins.
Il trouva Mme Walter dans la petite ruine antique o coule une source. Elle fai-
sait le tour du cirque troit de colonnettes, dun air inquiet et malheureux.
Aussitt quil leut salue :
"Comme il y a du monde dans ce jardin!" dit-elle.
Il saisit loccasion :
Oui, cest vrai ; voulez-vous venir autre part ?
267
- Mais o?
- Nimporte o, dans une voiture, par exemple. Vous baisserez le store de votre
ct, et vous serez bien labri.
- Oui, jaime mieux a ; ici je meurs de peur.
- Eh bien, vous allez me retrouver dans cinq minutes la porte qui donne sur le
boulevard extrieur. Jy arriverai avec un acre."
Et il partit en courant. Ds quelle leut rejoint et quelle eut bien voil la vitre de
son ct, elle demanda :
"O avez-vous dit au cocher de nous conduire ?"
Georges rpondit :
"Ne vous occupez de rien, il est au courant."
Il avait donn lhomme ladresse de son appartement de la rue de Constanti-
nople.
Elle reprit :
"Vous ne vous gurez pas comme je souffre cause de vous, comme je suis tour-
mente et torture. Hier, jai t dure, dans lglise, mais je voulais vous fuir tout
prix. Jai tellement peur de me trouver seule avec vous. Mavez-vous pardonn ?"
Il lui serrait les mains :
"Oui, oui. Quest-ce que je ne vous pardonnerais pas, vous aimant comme je
vous aime ?"
Elle le regardait dun air suppliant.
"coutez, il faut me promettre de me respecter... de ne pas... de ne pas... autre-
ment je ne pourrais plus vous revoir."
268
Il ne rpondit point dabord; il avait sous la moustache ce sourire n qui trou-
blait les femmes. Il nit par murmurer :
"Je suis votre esclave."
Alors elle se mit lui raconter comment elle stait aperue quelle laimait en
apprenant quil allait pouser Madeleine Forestier. Elle donnait des dtails, de pe-
tits dtails de dates et de choses intimes.
Soudain elle se tut. La voiture venait de sarrter. Du Roy ouvrit la portire.
"O sommes-nous ?" dit-elle.
Il rpondit :
"Descendez et entrez dans cette maison. Nous y serons plus tranquilles.
- Mais o sommes-nous ?
- Chez moi. Cest mon appartement de garon que jai repris... pour quelques
jours... pour avoir un coin o nous puissions nous voir."
Elle stait cramponne au capiton du acre, pouvante lide de ce tte--
tte, et elle balbutiait :
"Non, non, je ne veux pas ! Je ne veux pas !"
Il pronona dune voix nergique :
"Je vous jure de vous respecter. Venez. Vous voyez bien quon nous regarde,
quon va se rassembler autour de nous. Dpchez-vous... dpchez-vous... des-
cendez."
Et il rpta :
"Je vous jure de vous respecter."
269
Un marchand de vin sur sa porte les regardait dun air curieux. Elle fut saisie de
terreur et slana dans la maison.
Elle allait monter lescalier. Il la retint par le bras :
"Cest ici, au rez-de-chausse."
Et il la poussa dans son logis.
Ds quil eut referm la porte, il la saisit comme une proie. Elle se dbattait,
luttait, bgayait :
"Oh! mon Dieu!... oh! mon Dieu!..."
Il lui baisait le cou, les yeux, les lvres avec emportement, sans quelle pt viter
ses caresses furieuses ; et tout en le repoussant, tout en fuyant sa bouche, elle lui
rendait, malgr elle, ses baisers.
Tout dun coup elle cessa de se dbattre, et vaincue, rsigne, se laissa dvtir
par lui. Il enlevait une une, adroitement et vite, toutes les parties de soncostume,
avec des doigts lgers de femme de chambre.
Elle lui avait arrach des mains son corsage pour se cacher la gure dedans, et
elle demeurait debout, toute blanche, au milieu de ses robes abattues ses pieds.
Il lui laissa ses bottines et lemporta dans ses bras vers le lit. Alors, elle lui mur-
mura loreille, dune voix brise : "Je vous jure... je vous jure... que je nai jamais
eu damant." Comme une jeune lle aurait dit : "Je vous jure que je suis vierge."
Et il pensait : "Voil ce qui mest bien gal, par exemple."
270
Chapitre 14
Lglise tait tendue de noir, et, sur le portail, un grand cusson coiff dune
couronne annonait aux passants quon enterrait un gentilhomme.
La crmonie venait de nir, les assistants sen allaient lentement, dlant de-
vant le cercueil et devant le neveu du comte de Vaudrec, qui serrait les mains et
rendait les saluts.
Quand Georges Du Roy et sa femme furent sortis, ils se mirent marcher cte
cte, pour rentrer chez eux. Ils se taisaient, proccups.
Enn, Georges pronona, comme parlant lui-mme :
"Vraiment, cest bien tonnant !"
Madeleine demanda :
"Quoi donc, mon ami ?
- Que Vaudrec ne nous ait rien laiss !"
Elle rougit brusquement, comme si un voile rose se ft tendu tout coup sur
sa peau blanche, en montant de la gorge au visage, et elle dit :
"Pourquoi nous aurait-il laiss quelque chose ? Il ny avait aucune raison pour
a !"
Puis, aprs quelques instants de silence, elle reprit :
"Il existe peut-tre un testament chez un notaire. Nous ne saurions rien en-
core."
271
Il rchit, puis murmura :
"Oui, cest probable, car, enn, ctait notre meilleur ami, tous les deux. Il
dnait deux fois par semaine la maison, il venait tout moment. Il tait chez lui
chez nous, tout fait chez lui. Il taimait comme unpre, et il navait pas de famille,
pas denfants, pas de frres ni de surs, rien quun neveu, un neveu loign. Oui,
il doit y avoir un testament. Je ne tiendrais pas grand-chose, un souvenir, pour
prouver quil a pens nous, quil nous aimait, quil reconnaissait laffection que
nous avions pour lui. Il nous devait bien une marque damiti."
Elle dit, dun air pensif et indiffrent :
"Cest possible, en effet, quil y ait un testament."
Comme ils rentraient chez eux, le domestique prsenta une lettre Madeleine.
Elle louvrit, puis la tendit son mari.
tude de Matre Lamaneur
Notaire
17, rue des Vosges
Madame,
Jai lhonneur de vous prier de vouloir bien passer mon tude, de deux heures
quatre heures, mardi, mercredi ou jeudi, pour affaire qui vous concerne.
Recevez, etc.
LAMANEUR.
Georges avait rougi, son tour :
"a doit tre a. Cest drle que ce soit toi quil appelle, et non moi qui suis
lgalement le chef de famille."
Elle ne rpondit point dabord, puis aprs une courte rexion :
272
"Veux-tu que nous y allions tout lheure ?
- Oui, je veux bien."
Ils se mirent en route ds quils eurent djeun.
Lorsquils entrrent dans ltude de matre Lamaneur, le premier clerc se leva
avec un empressement marqu et les t pntrer chez son patron.
Le notaire tait un petit homme tout rond, rond de partout. Sa tte avait lair
dune boule cloue sur une autre boule que portaient deux jambes si petites, si
courtes quelles ressemblaient aussi presque des boules.
Il salua, indiqua des siges, et dit en se tournant vers Madeleine :
"Madame, je vous ai appele an de vous donner connaissance du testament
du comte de Vaudrec qui vous concerne."
Georges ne put se tenir de murmurer :
"Je men tais dout."
Le notaire ajouta :
"Je vais vous communiquer cette pice, trs courte dailleurs. "
Il atteignit un papier dans un carton devant lui, et lut :
"Je soussign, Paul-mile-Cyprien-Gontran, comte de Vaudrec, sain de corps et
desprit, exprime ici mes dernires volonts.
"La mort pouvant nous emporter tout moment, je veux prendre, en prvision
de son atteinte, la prcaution dcrire mon testament qui sera dpos chez matre
Lamaneur.
273
"Nayant pas dhritiers directs, je lgue toute ma fortune, compose de valeurs
de bourse pour six cent mille francs et de biens-fonds pour cinq cent mille francs
environ, Mme Claire-Madeleine Du Roy, sans aucune charge ou condition. Je la
prie daccepter ce don dun ami mort, comme preuve dune affection dvoue,
profonde et respectueuse."
Le notaire ajouta :
"Cest tout. Cette pice est date du mois daot dernier et a remplac un do-
cument de mme nature, fait il y a deux ans, au nom de Mme Claire-Madeleine
Forestier. Jai ce premier testament qui pourrait prouver, en cas de contestation
de la part de la famille, que la volont de M. le comte de Vaudrec na point vari."
Madeleine, trs ple, regardait ses pieds. Georges, nerveux, roulait entre ses
doigts le bout de sa moustache. Le notaire reprit, aprs un moment de silence :
"Il est bien entendu, monsieur, que madame ne peut accepter ce legs sans votre
consentement."
Du Roy se leva, et, dun ton sec :
"Je demande le temps de rchir."
Le notaire, qui souriait, sinclina, et dune voix aimable :
"Je comprends le scrupule qui vous fait hsiter, monsieur. Je dois ajouter que le
neveu de M. de Vaudrec, qui a pris connaissance, ce matin mme, des dernires
intentions de son oncle, se dclare prt les respecter si on lui abandonne une
somme de cent mille francs. A mon avis, le testament est inattaquable, mais un
procs ferait du bruit quil vous conviendra peut-tre dviter. Le monde a souvent
des jugements malveillants. Dans tous les cas, pourrez-vous me faire connatre
votre rponse sur tous les points avant samedi ?"
Georges sinclina : "Oui, monsieur." Puis il salua avec crmonie, t passer sa
femme demeure muette, et il sortit dun air tellement roide que le notaire ne
souriait plus.
Ds quils furent rentrs chez eux, DuRoy ferma brusquement la porte, et, jetant
son chapeau sur le lit :
274
"Tu as t la matresse de Vaudrec ?"
Madeleine, qui enlevait son voile, se retourna dune secousse :
"Moi ? Oh!
- Oui, toi. On ne laisse pas toute sa fortune une femme, sans que... "
Elle tait devenue tremblante et ne parvenait point ter les pingles qui rete-
naient le tissu transparent.
Aprs un moment de rexion, elle balbutia, dune voix agite :
"Voyons... voyons... tues fou... tues... tues... Est-ce que toi-mme... tout lheure...
tu nesprais pas... quil te laisserait quelque chose ?"
Georges restait debout, prs delle, suivant toutes ses motions, comme un ma-
gistrat qui cherche surprendre les moindres dfaillances dun prvenu. Il pro-
nona, en insistant sur chaque mot :
"Oui... il pouvait me laisser quelque chose, moi... moi, ton mari... moi, son
ami... entends-tu... mais pas toi... toi, son amie... toi, ma femme. La distinc-
tion est capitale, essentielle, au point de vue des convenances... et de lopinion
publique."
Madeleine, son tour, le regardait xement, dans la transparence des yeux,
dune faon profonde et singulire, comme pour y lire quelque chose, comme
pour y dcouvrir cet inconnu de ltre quon ne pntre jamais et quon peut
peine entrevoir en des secondes rapides, en ces moments de non-garde, ou
dabandon, ou dinattention, qui sont comme des portes laisses entrouvertes sur
les mystrieux dedans de lesprit. Et elle articula lentement :
"Il me semble pourtant que si... quon et trouv au moins aussi trange un legs
de cette importance, de lui... toi."
Il demanda brusquement :
"Pourquoi a ?"
275
Elle dit :
"Parce que..."
Elle hsita, puis reprit :
"Parce que tu es mon mari... que tu ne le connais en somme que depuis peu...
parce que je suis son amie depuis trs longtemps... moi... parce que son premier
testament, fait du vivant de Forestier, tait dj en ma faveur."
Georges stait mis marcher grands pas. Il dclara :
"Tu ne peux pas accepter a."
Elle rpondit avec indiffrence :
"Parfaitement ; alors, ce nest pas la peine dattendre samedi ; nous pouvons
faire prvenir tout de suite matre Lamaneur."
Il sarrta en face delle ; et ils demeurrent de nouveau quelques instants les
yeux dans les yeux, sefforant daller jusqu limpntrable secret de leurs curs,
de se sonder jusquau vif de la pense. Ils tchaient de se voir nu la conscience
en une interrogation ardente et muette : lutte intime de deux tres qui, vivant cte
cte, signorent toujours, se souponnent, se airent, se guettent, mais ne se
connaissent pas jusquau fond vaseux de lme.
Et, brusquement, il lui murmura dans le visage, voix basse :
"Allons, avoue que tu tais la matresse de Vaudrec."
Elle haussa les paules :
"Tues stupide... Vaudrec avait beaucoupdaffectionpour moi, beaucoup... mais
rien de plus... jamais."
Il frappa du pied :
"Tu mens. Ce nest pas possible."
276
Elle rpondit tranquillement :
"Cest comme a, pourtant."
Il se mit marcher, puis, sarrtant encore :
"Explique-moi, alors, pourquoi il te laisse toute sa fortune, toi... "
Elle le t avec un air nonchalant et dsintress :
"Cest tout simple. Comme tu le disais tantt, il navait que nous damis, ou plu-
tt que moi, car il ma connue enfant. Ma mre tait dame de compagnie chez des
parents lui. Il venait sans cesse ici, et, comme il navait pas dhritiers naturels,
il a pens moi. Quil ait eu un peu damour pour moi, cest possible. Mais quelle
est la femme qui na jamais t aime ainsi ? Que cette tendresse cache, secrte,
ait mis mon nom sous sa plume quand il a pens prendre des dispositions der-
nires, pourquoi pas ? Il mapportait des eurs, chaque lundi. Tu ne ten tonnais
nullement et il ne ten donnait point, toi, nest-ce pas ? Aujourdhui, il me donne
sa fortune par la mme raison et parce quil na personne qui loffrir. Il serait,
au contraire, extrmement surprenant quil te let laisse ? Pourquoi ? Que lui es-
tu?"
Elle parlait avec tant de naturel et de tranquillit que Georges hsitait.
Il reprit :
"Cest gal, nous ne pouvons accepter cet hritage dans ces conditions. Ce se-
rait duneffet dplorable. Tout le monde croirait la chose, tout le monde enjaserait
et rirait de moi. Les confrres sont dj tropdisposs me jalouser et mattaquer.
Je dois avoir plus que personne le souci de mon honneur et le soin de ma rpu-
tation. Il mest impossible dadmettre et de permettre que ma femme accepte un
legs de cette nature dun homme que la rumeur publique lui a dj prt pour
amant. Forestier aurait peut-tre tolr cela, lui, mais moi, non."
Elle murmura avec douceur :
"Eh bien, mon ami, nacceptons pas, ce sera un million de moins dans notre
poche, voil tout."
277
Il marchait toujours, et il se mit penser tout haut, parlant pour sa femme sans
sadresser elle.
"Eh bien, oui... un million... tant pis... Il na pas compris en testant quelle faute
de tact, quel oubli des convenances il commettait. Il na pas vu dans quelle posi-
tion fausse, ridicule, il allait me mettre... Tout est affaire de nuances dans la vie...
Il fallait quil men laisst la moiti, a arrangeait tout."
Il sassit, croisa ses jambes et se mit rouler le bout de ses moustaches, comme
il faisait aux heures dennui, dinquitude et de rexion difcile.
Madeleine prit une tapisserie laquelle elle travaillait de temps en temps, et
elle dit en choisissant ses laines :
"Moi, je nai qu me taire. Cest toi de rchir."
Il fut longtemps sans rpondre, puis il pronona, en hsitant :
"Le monde ne comprendra jamais et que Vaudrec ait fait de toi son unique h-
ritire et que jaie admis cela, moi. Recevoir cette fortune de cette faon, ce serait
avouer... avouer de ta part une liaisoncoupable, et de la mienne une complaisance
infme... Comprends-tu comment on interprterait notre acceptation? Il faudrait
trouver un biais, un moyen adroit de pallier la chose. Il faudrait laisser entendre,
par exemple, quil a partag entre nous cette fortune, en donnant la moiti au
mari, la moiti la femme."
Elle demanda :
"Je ne vois pas comment cela pourrait se faire, puisque le testament est formel."
Il rpondit :
"Oh! cest bien simple. Tu pourrais me laisser la moiti de lhritage par dona-
tion entre vifs. Nous navons pas denfants, cest donc possible. De cette faon, on
fermerait la bouche la malignit publique."
Elle rpliqua, un peu impatiente :
278
"Je ne vois pas non plus comment on fermerait la bouche la malignit pu-
blique, puisque lacte est l, sign par Vaudrec."
Il reprit avec colre :
"Avons-nous besoin de le montrer et de lafcher sur les murs ? Tu es stupide,
la n. Nous dirons que le comte de Vaudrec nous a laiss sa fortune par moiti...
Voil... Or, tu ne peux accepter ce legs sans mon autorisation. Je te la donne, la
seule condition dun partage qui mempchera de devenir la rise du monde."
Elle le regarda encore dun regard perant.
"Comme tu voudras. Je suis prte."
Alors il se leva et se remit marcher. Il paraissait hsiter de nouveau et il vitait
maintenant loeil pntrant de sa femme. Il disait :
"Non... dcidment non... peut-tre vaut-il mieux y renoncer tout fait... cest
plus digne.. plus correct... plus honorable... Pourtant, de cette faon on naurait
rien supposer, absolument rien. Les gens les plus scrupuleux ne pourraient que
sincliner."
Il sarrta devant Madeleine :
"Eh bien, si tu veux, ma chrie, je vais retourner tout seul chez matre Lamaneur
pour le consulter et lui expliquer la chose. Je lui dirai mon scrupule, et jajouterai
que nous nous sommes arrts lide dun partage, par convenance, pour quon
ne puisse pas jaboter. Du moment que jaccepte la moiti de cet hritage, il est
bien vident que personne na plus le droit de sourire. Cest dire hautement : "Ma
femme accepte parce que jaccepte, moi, son mari, qui suis juge de ce quelle peut
faire sans se compromettre." Autrement, a aurait fait scandale."
Madeleine murmura simplement :
"Comme tu voudras."
279
Il commena parler avec abondance : "Oui, cest clair comme le jour avec cet
arrangement de la sparationpar moiti. Nous hritons dunami qui na pas voulu
tablir de diffrence entre nous, qui na pas voulu faire de distinction, qui na pas
voulu avoir lair de dire : "Je prfre lun ou lautre aprs ma mort comme je lai
prfr dans ma vie." Il aimait mieux la femme, bien entendu, mais en laissant sa
fortune lun comme lautre il a voulu exprimer nettement que sa prfrence
tait toute platonique. Et sois certaine que, sil y avait song, cest ce quil aurait
fait. Il na pas rchi, il na pas prvu les consquences. Comme tu le disais fort
bien tout lheure, cest toi quil offrait des eurs chaque semaine, cest toi
quil a voulu laisser son dernier souvenir sans se rendre compte..."
Elle larrta avec une nuance dirritation :
"Cest entendu. Jai compris. Tu nas pas besoin de tant dexplications. Va tout
de suite chez le notaire."
Il balbutia, rougissant :
"Tu as raison, jy vais."
Il prit son chapeau, puis, au moment de sortir :
"Je vais tcher darranger la difcult du neveu pour cinquante mille francs,
nest-ce pas ?"
Elle rpondit avec hauteur :
"Non. Donne-lui les cent mille francs quil demande. Et prends-les sur ma part,
si tu veux."
Il murmura, honteux soudain :
"Ah! mais non, nous partagerons. En laissant cinquante mille francs chacun, il
nous reste encore un million net."
Puis il ajouta :
"A tout lheure, ma petite Made."
280
Et il alla expliquer au notaire la combinaison quil prtendit imagine par sa
femme.
Ils signrent le lendemain une donation entre vifs de cinq cent mille francs que
Madeleine Du Roy abandonnait son mari.
Puis, en sortant de ltude, comme il faisait beau, Georges proposa de des-
cendre pied jusquaux boulevards. Il se montrait gentil, plein de soins, dgards,
de tendresse. Il riait, heureux de tout, tandis quelle demeurait songeuse et un peu
svre.
Ctait un jour dautomne assez froid. La foule semblait presse et marchait
pas rapides. Du Roy conduisit sa femme devant la boutique o il avait regard si
souvent le chronomtre dsir.
"Veux-tu que je toffre un bijou?" dit-il.
Elle murmura, avec indiffrence :
"Comme il te plaira."
Ils entrrent. Il demanda :
"Que prfres-tu, un collier, un bracelet, ou des boucles doreilles ?"
La vue des bibelots dor et des pierres nes emportait sa froideur voulue, et elle
parcourait dun oeil allum et curieux les vitrines pleines de joyaux.
Et soudain, mue par un dsir :
"Voil un bien joli bracelet."
Ctait une chane dune forme bizarre, dont chaque anneau portait une pierre
diffrente.
Georges demanda :
"Combien ce bracelet ?"
281
Le joaillier rpondit :
"Trois mille francs, monsieur.
- Si vous me le laissez deux mille cinq, cest une affaire entendue. "
Lhomme hsita, puis rpondit :
"Non, monsieur, cest impossible."
Du Roy reprit :
"Tenez, vous ajouterez ce chronomtre pour quinze cents francs, cela fait quatre
mille, que je paierai comptant. Est-ce dit ? Si vous ne voulez pas, je vais ailleurs."
Le bijoutier, perplexe, nit par accepter.
"Eh bien, soit, monsieur."
Et le journaliste, aprs avoir donn son adresse, ajouta :
"Vous ferez graver sur le chronomtre mes initiales G.R.C., en lettres enlaces
au-dessous dune couronne de baron."
Madeleine, surprise, se mit sourire. Et quand ils sortirent, elle prit son bras
avec une certaine tendresse. Elle le trouvait vraiment adroit et fort. Maintenant
quil avait des rentes, il lui fallait un titre, ctait juste.
Le marchand le saluait :
"Vous pouvez compter sur moi, ce sera prt pour jeudi, monsieur le baron."
Ils passrent devant le Vaudeville. On y jouait une pice nouvelle.
"Si tu veux, dit-il, nous irons ce soir au thtre, tchons de trouver une loge."
Ils trouvrent une loge et la prirent. Il ajouta :
282
"Si nous dnions au cabaret ?
- Oh! oui, je veux bien."
Il tait heureux comme un souverain, et cherchait ce quils pourraient bien faire
encore.
"Si nous allions chercher Mme de Marelle pour passer la soire avec nous ? Son
mari est ici, ma-t-on dit. Je serai enchant de lui serrer la main."
Ils y allrent. Georges, qui redoutait un peu la premire rencontre avec sa ma-
tresse, ntait point fch que sa femme ft prsente pour viter toute explication.
Mais Clotilde parut ne se souvenir de rien et fora mme son mari accepter
linvitation.
Le dner fut gai et la soire charmante.
Georges et Madeleine rentrrent fort tard. Le gaz tait teint. Pour clairer les
marches, le journaliste enammait de temps en temps une allumette-bougie.
En arrivant sur le palier du premier tage, la amme subite clatant sous le frot-
tement t surgir dans la glace leurs deux gures illumines au milieu des tnbres
de lescalier.
Ils avaient lair de fantmes apparus et prts svanouir dans la nuit.
Du Roy leva la main pour bien clairer leurs images, et il dit, avec un rire de
triomphe :
"Voil des millionnaires qui passent."
283
Chapitre 15
Depuis deux mois la conqute du Maroc tait accomplie. La France, matresse
de Tanger, possdait toute la cte africaine de la Mditerrane jusqu la rgence
de Tripoli, et elle avait garanti la dette du nouveau pays annex.
On disait que deux ministres gagnaient l une vingtaine de millions, et on citait,
presque tout haut, Laroche-Mathieu.
Quand Walter, personne dans Paris nignorait quil avait fait coup double et
encaiss de trente quarante millions sur lemprunt, et de huit dix millions sur
des mines de cuivre et de fer, ainsi que sur dimmenses terrains achets pour rien
avant la conqute et revendus le lendemain de loccupation franaise des com-
pagnies de colonisation.
Il tait devenu, en quelques jours, un des matres du monde, un de ces nan-
ciers omnipotents, plus forts que des rois, qui font courber les ttes, balbutier les
bouches et sortir tout ce quil y a de bassesse, de lchet et denvie au fond du
cur humain.
Il ntait plus le juif Walter, patron dune banque louche, directeur dun journal
suspect, dput souponn de tripotages vreux. Il tait Monsieur Walter, le riche
Isralite.
Il le voulut montrer.
Sachant la gne du prince de Carlsbourg qui possdait un des plus beaux htels
de la rue du Faubourg-Saint-Honor, avec jardin sur les Champs-lyses, il lui
proposa dacheter, en vingt-quatre heures, cet immeuble, avec ses meubles, sans
changer de place un fauteuil. Il en offrait trois millions. Le prince, tent par la
somme, accepta.
284
Le lendemain, Walter sinstallait dans son nouveau domicile.
Alors il eut une autre ide, une vritable ide de conqurant qui veut prendre
Paris, une ide la Bonaparte.
Toute la ville allait voir en ce moment un grand tableau du peintre hongrois
Karl Marcowitch, expos chez lexpert Jacques Lenoble, et reprsentant le Christ
marchant sur les ots.
Les critiques dart, enthousiasms, dclaraient cette toile le plus magnique
chef-duvre du sicle.
Walter lacheta cinq cent mille francs et lenleva, coupant ainsi du jour au len-
demain le courant tabli de la curiosit publique et forant Paris entier parler de
lui pour lenvier, le blmer ou lapprouver.
Puis, il t annoncer par les journaux quil inviterait tous les gens connus dans
la socit parisienne contempler, chez lui, un soir, luvre magistrale du matre
tranger, an quon ne pt pas dire quil avait squestr une uvre dart.
Sa maison serait ouverte. Y viendrait qui voudrait. Il sufrait de montrer la
porte la lettre de convocation.
Elle tait rdige ainsi : "Monsieur et Madame Walter vous prient de leur faire
lhonneur de venir voir chez eux, le 30 dcembre, de neuf heures minuit, la toile
de Karl Marcowitch : Jsus marchant sur les ots, claire " la lumire lectrique
".
Puis, en post-scriptum, en toutes petites lettres, on pouvait lire : "On dansera
aprs minuit."
Donc, ceux qui voudraient rester resteraient, et parmi ceux-l les Walter recru-
teraient leurs connaissances du lendemain.
Les autres regarderaient la toile, lhtel et les propritaires, avec une curiosit
mondaine, insolente ou indiffrente, puis sen iraient comme ils taient venus. Et
le pre Walter savait bien quils reviendraient, plus tard, comme ils taient alls
chez ses frres isralites devenus riches comme lui.
285
Il fallait dabord quils entrassent dans sa maison, tous les panns titrs quon
cite dans les feuilles ; et ils y entreraient pour voir la gure dun homme qui a ga-
gn cinquante millions en six semaines ; ils y entreraient aussi pour voir et comp-
ter ceux qui viendraient l ; ils y entreraient encore parce quil avait eu le bon got
et ladresse de les appeler admirer un tableau chrtien chez lui, ls dIsral.
Il semblait leur dire : "Voyez, jai pay cinq cent mille francs le chef-duvre re-
ligieux de Marcowitch, Jsus marchant sur les ots. Et ce chef-duvre demeurera
chez moi, sous mes yeux, toujours, dans la maison du juif Walter."
Dans le monde, dans le monde des duchesses et du Jockey, on avait beaucoup
discut cette invitation qui nengageait rien, en somme. On irait l comme on
allait voir des aquarelles chez M. Petit. Les Walter possdaient un chef-duvre ;
ils ouvraient leurs portes un soir pour que tout le monde pt ladmirer. Rien de
mieux.
La Vie Franaise, depuis quinze jours, faisait chaque matin un cho sur cette
soire du 30 dcembre et sefforait dallumer la curiosit publique.
Du Roy rageait du triomphe du Patron.
Il stait cru riche avec les cinq cent mille francs extorqus sa femme, et main-
tenant il se jugeait pauvre, affreusement pauvre, en comparant sa pitre fortune
la pluie de millions tombe autour de lui, sans quil et su en rien ramasser.
Sa colre envieuse augmentait chaque jour. Il en voulait tout le monde, aux
Walter quil navait plus t voir chez eux, sa femme qui, trompe par Laroche,
lui avait dconseill de prendre des fonds marocains, et il en voulait surtout au
ministre qui lavait jou, qui stait servi de lui et qui dnait sa table deux fois
par semaine ; Georges lui servait de secrtaire, dagent, de porte-plume, et quand
il crivait sous sa dicte, il se sentait des envies folles dtrangler ce belltre triom-
phant. Comme ministre, Laroche avait le succs modeste, et pour garder son por-
tefeuille, il ne laissait point deviner quil tait gon dor. Mais Du Roy le sentait,
cet or, dans la parole plus hautaine de lavocat parvenu, dans son geste plus inso-
lent, dans ses afrmations plus hardies, dans sa conance en lui complte.
Laroche rgnait, maintenant, dans la maison Du Roy, ayant pris la place et les
jours du comte de Vaudrec, et parlant aux domestiques ainsi quaurait fait un se-
cond matre.
286
Georges le tolrait en frmissant, comme un chien qui veut mordre et nose pas.
Mais il tait souvent dur et brutal pour Madeleine, qui haussait les paules et le
traitait en enfant maladroit. Elle stonnait dailleurs de sa constante mauvaise
humeur et rptait :
"Je ne te comprends pas. Tu es toujours te plaindre. Ta position est pourtant
superbe."
Il tournait le dos et ne rpondait rien.
Il avait dclar dabord quil nirait point la fte du Patron, et quil ne voulait
plus mettre les pieds chez ce sale juif.
Depuis deux mois, Mme Walter lui crivait chaque jour pour le supplier de ve-
nir, de lui donner un rendez-vous o il lui plairait, an quelle lui remt, disait-elle,
les soixante-dix mille francs quelle avait gagns pour lui.
Il ne rpondait pas et jetait au feu ces lettres dsespres. Non pas quil et
renonc recevoir sa part de leur bnce, mais il voulait laffoler, la traiter par le
mpris, la fouler aux pieds. Elle tait trop riche ! Il voulait se montrer er.
Le jour mme de lexposition du tableau, comme Madeleine lui reprsentait
quil avait grand tort de ny vouloir pas aller, il rpondit :
Fiche-moi la paix. Je reste chez moi."
Puis, aprs le dner, il dclara tout coup :
"Il vaut tout de mme mieux subir cette corve. Prpare-toi vite."
Elle sy attendait.
"Je serai prte dans un quart dheure", dit-elle.
Il shabilla en grognant, et mme dans le acre il continua expectorer sa bile.
287
La cour dhonneur de lhtel de Carlsbourg tait illumine par quatre globes
lectriques qui avaient lair de quatre petites lunes bleutres, aux quatre coins. Un
magnique tapis descendait les degrs du haut perron et, sur chacun, un homme
en livre restait roide comme une statue.
Du Roy murmura :
"En voil de lpate."
Il levait les paules, le cur crisp de jalousie.
Sa femme lui dit :
"Tais-toi donc et fais-en autant."
Ils entrrent et remirent leurs lourds vtements de sortie aux valets de pied qui
savancrent.
Plusieurs femmes taient l avec leurs maris, se dbarrassaient aussi de leurs
fourrures. On entendait murmurer : "Cest fort beau! fort beau!"
Le vestibule norme tait tendu de tapisseries qui reprsentaient laventure de
Mars et de Vnus. A droite et gauche partaient les deux bras dun escalier mo-
numental, qui se rejoignaient au premier tage. La rampe tait une merveille de
fer forg, dont la vieille dorure teinte faisait courir une lueur discrte le long des
marches de marbre rouge.
A lentre des salons, deux petites lles, habilles lune en folie rose, et lautre
en folie bleue, offraient des bouquets aux dames. On trouvait cela charmant.
Il y avait dj foule dans les salons.
La plupart des femmes taient en toilette de ville pour bien indiquer quelles
venaient l comme elles allaient toutes les expositions particulires. Celles qui
comptaient rester au bal avaient les bras et la gorge nus.
Mme Walter, entoure damies, se tenait dans la seconde pice, et rpondait aux
saluts des visiteurs.
288
Beaucoup ne la connaissaient point et se promenaient comme dans un muse,
sans soccuper des matres du logis.
Quand elle aperut Du Roy, elle devint livide et t un mouvement pour aller
lui. Puis elle demeura immobile, lattendant. Il la salua avec crmonie, tandis
que Madeleine laccablait de tendresses et de compliments. Alors Georges laissa
sa femme auprs de la Patronne ; et il se perdit au milieu du public pour couter
les choses malveillantes quon devait dire, assurment.
Cinq salons se suivaient, tendus dtoffes prcieuses, de broderies italiennes
ou de tapis dOrient de nuances et de styles diffrents, et portant sur leurs mu-
railles des tableaux de matres anciens. On sarrtait surtout pour admirer une pe-
tite pice Louis XVI, une sorte de boudoir tout capitonn en soie bouquets roses
sur un fond bleu ple. Les meubles bas, en bois dor, couverts dtoffe pareille
celle des murs, taient dune admirable nesse.
Georges reconnaissait des gens clbres, la duchesse de Terracine, le comte et la
comtesse de Ravenel, le gnral prince dAndremont, la toute belle marquise des
Dunes, puis tous ceux et toutes celles quon voit aux premires reprsentations.
On le saisit par le bras et une voix jeune, une voix heureuse lui murmura dans
loreille :
"Ah! vous voil enn, mchant Bel-Ami. Pourquoi ne vous voit-on plus ?"
Ctait Suzanne Walter le regardant avec ses yeux dmail n, sous le nuage fris
de ses cheveux blonds.
Il fut enchant de la revoir et lui serra franchement la main. Puis sexcusant :
"Je nai pas pu. Jai eu tant faire, depuis deux mois, que je ne suis pas sorti."
Elle reprit dun air srieux :
"Cest mal, trs mal, trs mal. Vous nous faites beaucoup de peine, car nous
vous adorons, maman et moi. Quant moi, je ne puis me passer de vous. Si vous
ntes pas l, je mennuie mourir. Vous voyez que je vous le dis carrment pour
que vous nayez plus le droit de disparatre comme a. Donnez-moi le bras, je vais
289
vous montrer moi-mme Jsus marchant sur les ots, cest tout au fond, derrire
la serre. Papa la mis l-bas an quon soit oblig de passer partout. Cest ton-
nant, comme il fait le paon, papa, avec cet htel."
Ils allaient doucement travers la foule. On se retournait pour regarder ce beau
garon et cette ravissante poupe.
Un peintre connu pronona :
"Tiens ! Voil un joli couple. Il est amusant comme tout."
Georges pensait : "Si javais t vraiment fort, cest celle-l que jaurais pou-
se. Ctait possible, pourtant. Comment ny ai-je pas song ? Comment me suis-je
laiss aller prendre lautre ? Quelle folie ! On agit toujours trop vite, on ne r-
chit jamais assez."
Et lenvie, lenvie amre, lui tombait dans lme goutte goutte, comme un el
qui corrompait toutes ses joies, rendait odieuse son existence.
Suzanne disait :
"Oh! venez souvent, Bel-Ami, nous ferons des folies maintenant que papa est si
riche. Nous nous amuserons comme des toqus."
Il rpondit, suivant toujours son ide :
"Oh! vous allez vous marier maintenant. Vous pouserez quelque beau prince,
un peu ruin, et nous ne nous verrons plus gure."
Elle scria avec franchise :
"Oh! non, pas encore, je veux quelquun qui me plaise, qui me plaise beaucoup,
qui me plaise tout fait. Je suis assez riche pour deux."
Il souriait dun sourire ironique et hautain, et il se mit lui nommer les gens qui
passaient, des gens trs nobles, qui avaient venduleurs titres rouills des lles de
nanciers comme elle, et qui vivaient maintenant prs ou loin de leurs femmes,
mais libres, impudents, connus et respects.
290
Il conclut :
"Je ne vous donne pas six mois pour vous laisser prendre cet appt-l. Vous
serez madame la Marquise, madame la Duchesse ou madame la Princesse, et vous
me regarderez de trs haut, mamzelle."
Elle sindignait, lui tapait sur le bras avec son ventail, jurait quelle ne se ma-
rierait que selon son cur.
Il ricanait :
Nous verrons bien, vous tes trop riche."
Elle lui dit :
Mais vous aussi, vous avez eu un hritage."
Il t un " Oh!" de piti :
"Parlons-en. A peine vingt mille livres de rentes. Ce nest pas lourd par le temps
prsent.
- Mais votre femme a hrit galement.
- Oui. Un million nous deux. Quarante mille de revenu. Nous ne pouvons
mme pas avoir une voiture nous avec a."
Ils arrivaient au dernier salon, et en face deux souvrait la serre, un large jardin
dhiver plein de grands arbres des pays chauds abritant des massifs de eurs rares.
En entrant sous cette verdure sombre o la lumire glissait comme une onde
dargent, on respirait la fracheur tide de la terre humide et un soufe lourd de
parfums. Ctait une trange sensation douce, malsaine et charmante, de nature
factice, nervante et molle. On marchait sur des tapis tout pareils de la mousse
entre deux pais massifs darbustes. Soudain Du Roy aperut sa gauche, sous
un large dme de palmiers, un vaste bassin de marbre blanc o lon aurait pu se
baigner et sur les bords duquel quatre grands cygnes en faence de Delft laissaient
tomber leau de leurs becs entrouverts.
291
Le fonddubassintait sabl de poudre dor et lonvoyait nager dedans quelques
normes poissons rouges, bizarres monstres chinois aux yeux saillants, aux cailles
bordes de bleu, sortes de mandarins des ondes qui rappelaient, errants et sus-
pendus ainsi sur ce fond dor, les tranges broderies de l-bas.
Le journaliste sarrta le cur battant. Il se disait :
"Voil, voil du luxe. Voil les maisons o il faut vivre. Dautres y sont parvenus.
Pourquoi ny arriverais-je point ?" Il songeait aux moyens, nen trouvait pas sur-le-
champ, et sirritait de son impuissance.
Sa compagne ne parlait plus, un peu songeuse. Il la regarda de ct et il pensa
encore une fois : "Il sufsait pourtant dpouser cette marionnette de chair."
Mais Suzanne tout dun coup parut se rveiller :
"Attention", dit-elle.
Elle poussa Georges travers un groupe qui barrait leur chemin, et le t brus-
quement tourner droite.
Aumilieudunbosquet de plantes singulires qui tendaient enlair leurs feuilles
tremblantes, ouvertes comme des mains aux doigts minces, onapercevait unhomme
immobile, debout sur la mer.
Leffet tait surprenant. Le tableau, dont les cts se trouvaient cachs dans les
verdures mobiles, semblait un trou noir sur un lointain fantastique et saisissant.
Il fallait bien regarder pour comprendre. Le cadre coupait le milieu de la barque
ose trouvaient les aptres peine clairs par les rayons obliques dune lanterne,
dont lun deux, assis sur le bordage, projetait toute la lumire sur Jsus qui sen
venait.
Le Christ avanait le pied sur une vague quon voyait se creuser, soumise, apla-
nie, caressante sous le pas divinqui la foulait. Tout tait sombre autour de lHomme-
Dieu. Seules les toiles brillaient au ciel.
Les gures des aptres, dans la lueur vague du fanal port par celui qui montrait
le Seigneur, paraissaient convulses par la surprise.
292
Ctait bien l luvre puissante et inattendue dun matre, une de ces uvres
qui bouleversent la pense et vous laissent du rve pour des annes.
Les gens qui regardaient cela demeuraient dabord silencieux, puis senallaient,
songeurs, et ne parlaient quensuite de la valeur de la peinture.
Du Roy, layant contemple quelque temps, dclara :
"Cest chic de pouvoir se payer ces bibelots-l."
Mais comme on le heurtait, en le poussant pour voir, il repartit, gardant tou-
jours sous son bras la petite main de Suzanne quil serrait un peu.
Elle lui demanda :
"Voulez-vous boire unverre de champagne ? Allons aubuffet. Nous y trouverons
papa."
Et ils retraversrent lentement tous les salons o la foule grossissait, houleuse,
chez elle, une foule lgante de fte publique.
Georges soudain crut entendre une voix prononcer :
"Cest Laroche et Mme Du Roy." Ces paroles lui efeurrent loreille comme ces
bruits lointains qui courent dans le vent. Do venaient-elles ?
Il chercha de tous les cts, et il aperut en effet sa femme qui passait, au bras
du ministre. Ils causaient tout bas dune faon intime en souriant, et les yeux dans
les yeux.
Il simagina remarquer quon chuchotait en les regardant, et il sentit en lui une
envie brutale et stupide de sauter sur ces deux tres et de les assommer coups
de poing.
Elle le rendait ridicule. Il pensa Forestier. On disait peut-tre : "Ce cocu de Du
Roy." Qui tait-elle ? une petite parvenue assez adroite, mais sans grands moyens,
en vrit. On venait chez lui parce quon le redoutait, parce quon le sentait fort,
mais on devait parler sans gne de ce petit mnage de journalistes. Jamais il nirait
293
loin avec cette femme qui faisait sa maison toujours suspecte, qui se compromet-
trait toujours, dont lallure dnonait lintrigante. Elle serait maintenant un bou-
let son pied. Ah! sil avait devin, sil avait su! Comme il aurait jou un peu plus
large, plus fort ! Quelle belle partie il aurait pu gagner avec la petite Suzanne pour
enjeu! Comment avait-il t assez aveugle pour ne pas comprendre a ?
Ils arrivaient la salle manger, une immense pice colonnes de marbre, aux
murs tendus de vieux Gobelins.
Walter aperut son chroniqueur et slana pour lui prendre les mains. Il tait
ivre de joie :
"Avez-vous tout vu? Dis, Suzanne, lui as-tu tout montr ? Que de monde, nest-
ce pas, Bel-Ami ? Avez-vous vu le prince de Guerche ? Il est venu boire un verre de
punch, tout lheure."
Puis il slana vers le snateur Rissolin qui tranait sa femme tourdie et orne
comme une boutique foraine.
Un monsieur saluait Suzanne, un grand garon mince, favoris blonds, un peu
chauve, avec cet air mondain quon reconnat partout. Georges lentendit nom-
mer : le marquis de Cazolles, et il fut brusquement jaloux de cet homme. Depuis
quand le connaissait-elle ? Depuis sa fortune sans doute ? Il devinait un prten-
dant.
On le prit par le bras. Ctait Norbert de Varenne. Le vieux pote promenait ses
cheveux gras et son habit fatigu dun air indiffrent et las.
"Voil ce quon appelle samuser, dit-il. Tout lheure on dansera ; et puis on
se couchera ; et les petites lles seront contentes. Prenez du champagne, il est ex-
cellent."
Il se t emplir un verre et, saluant Du Roy qui en avait pris un autre :
"Je bois la revanche de lesprit sur les millions."
Puis il ajouta, dune voix douce :
294
"Non pas quils me gnent chez les autres ou que je leur en veuille. Mais je pro-
teste par principe."
Georges ne lcoutait plus. Il cherchait Suzanne qui venait de disparatre avec
le marquis de Cazolles, et quittant brusquement Norbert de Varenne, il se mit la
poursuite de la jeune lle.
Une cohue paisse qui voulait boire larrta. Comme il lavait enn franchie, il
se trouva nez nez avec le mnage de Marelle.
Il voyait toujours la femme ; mais il navait pas rencontr depuis longtemps le
mari, qui lui saisit les deux mains :
"Que je vous remercie, mon cher, du conseil que vous mavez fait donner par
Clotilde. Jai gagn prs de cent mille francs avec lemprunt marocain. Cest vous
que je les dois. On peut dire que vous tes un ami prcieux."
Des hommes se retournaient pour regarder cette brunette lgante et jolie. Du
Roy rpondit :
"Enchange de ce service, moncher, je prends votre femme ouplutt je lui offre
mon bras. Il faut toujours sparer les poux."
M. de Marelle sinclina :
"Cest juste. Si je vous perds, nous nous retrouverons ici dans une heure.
- Parfaitement."
Et les deux jeunes gens senfoncrent dans la foule, suivis par le mari. Clotilde
rptait :
"Quels veinards que ces Walter. Ce que cest tout de mme que davoir lintelli-
gence des affaires."
Georges rpondit :
"Bah! Les hommes forts arrivent toujours, soit par unmoyen, soit par unautre."
295
Elle reprit :
"Voil deux lles qui auront de vingt trente millions chacune. Sans compter
que Suzanne est jolie."
Il ne dit rien. Sa propre pense sortie dune autre bouche lirritait.
Elle navait pas encore vu Jsus marchant sur les ots. Il proposa de ly conduire.
Ils samusaient dire du mal des gens, se moquer des gures inconnues. Saint-
Potin passa prs deux, portant sur le revers de son habit des dcorations nom-
breuses, ce qui les amusa beaucoup. Un ancien ambassadeur, venant derrire,
montrait une brochette moins garnie.
Du Roy dclara :
"Quelle salade de socit."
Boisrenard, qui lui serra la main, avait aussi orn sa boutonnire de ruban vert
et jaune sorti le jour du duel.
La vicomtesse de Percemur, norme et pare, causait avec un duc dans le petit
boudoir Louis XVI.
Georges murmura :
"Un tte--tte galant."
Mais en traversant la serre, il revit sa femme assise prs de Laroche-Mathieu,
presque cachs tous deux derrire un bouquet de plantes. Ils semblaient dire :
"Nous nous sommes donns un rendez-vous ici, un rendez-vous public. Car
nous nous chons de lopinion."
Mme de Marelle reconnut que ce Jsus de Karl Marcowitch tait trs tonnant ;
et ils revinrent. Ils avaient perdu le mari.
Il demanda :
296
"Et Laurine, est-ce quelle men veut toujours ?
- Oui, toujours autant. Elle refuse de te voir et sen va quand on parle de toi."
Il ne rpondit rien. Linimiti de cette llette le chagrinait et lui pesait.
Suzanne les saisit au dtour dune porte, criant :
- Ah! vous voil ! Eh bien, Bel-Ami, vous allez rester seul. Jenlve la belle Clo-
tilde pour lui montrer ma chambre."
Et les deux femmes sen allrent, dun pas press, glissant travers le monde, de
ce mouvement onduleux, de ce mouvement de couleuvre quelles savent prendre
dans les foules.
Presque aussitt une voix murmura : "Georges !"
Ctait Mme Walter. Elle reprit trs bas : "Oh! que vous tes frocement cruel !
Que vous me faites souffrir inutilement. Jai charg Suzette demmener celle qui
vous accompagnait an de pouvoir vous dire un mot. coutez, il faut... que je vous
parle ce soir... ou bien... ou bien... vous ne savez pas ce que je ferai. Allez dans la
serre. Vous y trouverez une porte gauche et vous sortirez dans le jardin. Suivez
lalle qui est en face. Tout au bout vous verrez une tonnelle. Attendez-moi l dans
dix minutes. Si vous ne voulez pas, je vous jure que je fais un scandale, ici, tout de
suite !"
Il rpondit avec hauteur :
"Soit. Jy serai dans dix minutes lendroit que vous mindiquez."
Et ils se sparrent. Mais Jacques Rival faillit le mettre enretard. Il lavait pris par
le bras et lui racontait un tas de choses avec lair trs exalt. Il venait sans doute
du buffet. Enn Du Roy le laissa aux mains de M. de Marelle retrouv entre deux
portes, et il senfuit. Il lui fallut encore prendre garde de ntre pas vu par sa femme
et par Laroche. Il y parvint, car ils semblaient fort anims, et il se trouva dans le
jardin.
Lair froid le saisit comme un bain de glace. Il pensa :
297
"Cristi, je vais attraper un rhume", et il mit son mouchoir son cou en manire
de cravate. Puis il suivit pas lents lalle, y voyant mal au sortir de la grande lu-
mire des salons.
Il distinguait sa droite et sa gauche des arbustes sans feuilles dont les branches
menues frmissaient. Des lueurs grises passaient dans ces ramures, des lueurs ve-
nues des fentres de lhtel. Il aperut quelque chose de blanc, au milieu du che-
min, devant lui, et Mme Walter, les bras nus, la gorge nue, balbutia dune voix
frmissante :
"Ah! te voil ? tu veux donc me tuer ?"
Il rpondit tranquillement :
"Je ten prie, pas de drame, nest-ce pas, ou je che le camp tout de suite. "
Elle lavait saisi par le cou, et, les lvres tout prs des lvres, elle disait :
"Mais quest-ce que je tai fait ? Tu te conduis avec moi comme un misrable !
Quest-ce que je tai fait ?"
Il essayait de la repousser :
"Tu as entortill tes cheveux tous mes boutons la dernire fois que je tai vue,
et a a failli amener une rupture entre ma femme et moi."
Elle demeura surprise, puis, faisant " non " de la tte :
"Oh! ta femme sen moque bien. Cest quelquune de tes matresses qui taura
fait une scne.
- Je nai pas de matresses.
- Tais-toi donc ! Mais pourquoi ne viens-tuplus mme me voir ? Pourquoi refuses-
tu de dner, rien quun jour par semaine, avec moi ? Cest atroce ce que je souffre ;
je taime navoir plus une pense qui ne soit pour toi, ne pouvoir rien regarder
sans te voir devant mes yeux, ne plus oser prononcer un mot sans avoir peur de
dire ton nom! Tu ne comprends pas a, toi ! Il me semble que je suis prise dans des
298
griffes, noue dans un sac, je ne sais pas. Ton souvenir, toujours prsent, me serre
la gorge, me dchire quelque chose l, dans la poitrine, sous le sein, me casse les
jambes ne plus me laisser la force de marcher. Et je reste comme une bte, toute
la journe, sur une chaise, en pensant toi."
Il la regardait avec tonnement. Ce ntait plus la grosse gamine foltre quil
avait connue, mais une femme perdue, dsespre, capable de tout.
Un projet vague, cependant, naissant dans son esprit.
Il rpondit :
"Ma chre, lamour nest pas ternel. On se prend et on se quitte. Mais quand
a dure comme entre nous a devient un boulet horrible. Je nen veux plus. Voil
la vrit. Cependant, si tu sais devenir raisonnable, me recevoir et me traiter ainsi
quun ami, je reviendrai comme autrefois. Te sens-tu capable de a ?"
Elle posa ses deux bras nus sur lhabit noir de Georges et murmura :
"Je suis capable de tout pour te voir.
- Alors, cest convenu, dit-il, nous sommes amis, rien de plus."
Elle balbutia :
"Cest convenu." Puis tendant ses lvres vers lui :
" Encore un baiser... le dernier."
Il refusa doucement.
Non. Il faut tenir nos conventions."
Elle se dtourna en essuyant deux larmes, puis tirant de son corsage un paquet
de papiers nous avec un ruban de soie rose, elle loffrit Du Roy : "Tiens. Cest
ta part de bnce dans laffaire du Maroc. Jtais si contente davoir gagn cela
pour toi. Tiens, prends-le donc..."
299
Il voulait refuser :
"Non, je ne recevrai point cet argent !"
Alors elle se rvolta.
"Ah! tu ne me feras pas a, maintenant. Il est toi, rien qu toi. Si tu ne le
prends point, je le jetterai dans un gout. Tu ne me feras pas cela, Georges ?"
Il reut le petit paquet et le glissa dans sa poche.
"Il faut rentrer, dit-il, tu vas attraper une uxion de poitrine."
Elle murmura :
"Tant mieux ! si je pouvais mourir."
Elle lui prit une main, la baisa avec passion, avec rage, avec dsespoir, et elle se
sauva vers lhtel.
Il revint doucement, en rchissant. Puis il rentra dans la serre, le front hau-
tain, la lvre souriante.
Sa femme et Laroche ntaient plus l. La foule diminuait. Il devenait vident
quon ne resterait pas au bal. Il aperut Suzanne qui tenait le bras de sa sur. Elles
vinrent vers lui toutes les deux pour lui demander de danser le premier quadrille
avec le comte de Latour-Yvelin.
Il stonna.
"Quest-ce encore que celui-l ?"
Suzanne rpondit avec malice :
"Cest un nouvel ami de ma sur."
Rose rougit et murmura :
300
"Tu es mchante, Suzette, ce monsieur nest pas plus mon ami que le tien."
Lautre souriait :
"Je mentends."
Rose, fche, leur tourna le dos et sloigna.
Du Roy prit familirement le coude de la jeune lle reste prs de lui et de sa
voix caressante :
"coutez, ma chre petite, me croyez-vous bien votre ami ?
- Mais oui, Bel-Ami.
- Vous avez conance en moi ?
- Tout fait.
- Vous vous rappelez ce que je vous disais tantt ?
- A propos de quoi ?
- A propos de votre mariage, ou plutt de lhomme que vous pouserez.
- Oui.
- Eh bien, voulez-vous me promettre une chose ?
- Oui, mais quoi ?
- Cest de me consulter toutes les fois quon demandera votre main, et de nac-
cepter personne sans avoir pris mon avis.
- Oui, je veux bien.
- Et cest un secret entre nous deux. Pas un mot de a votre pre ni votre
mre.
301
- Pas un mot.
- Cest jur ?
- Cest jur."
Rival arrivait, lair affair :
"Mademoiselle, votre papa vous demande pour le bal."
Elle dit :
"Allons, Bel-Ami."
Mais il refusa, dcid partir tout de suite, voulant tre seul pour penser. Trop
de choses nouvelles venaient de pntrer dans son esprit et il se mit chercher sa
femme. Au bout de quelque temps il laperut qui buvait du chocolat, au buffet,
avec deux messieurs inconnus. Elle leur prsenta son mari, sans les nommer lui.
Aprs quelques instants il demanda :
"Partons-nous ?
- Quand tu voudras."
Elle prit son bras et ils retraversrent les salons o le public devenait rare.
Elle demanda :
"O est la Patronne ? je voudrais lui dire adieu.
- Cest inutile. Elle essaierait de nous garder au bal et jen ai assez.
- Cest vrai, tu as raison."
Tout le long de la route ils furent silencieux. Mais, aussitt rentrs enleur chambre,
Madeleine souriante lui dit, sans mme ter son voile :
302
"Tu ne sais pas, jai une surprise pour toi.,"
Il grogna avec mauvaise humeur :
"Quoi donc ?
- Devine.
- Je ne ferai pas cet effort.
- Eh bien, cest aprs-demain le premier janvier.
- Oui.
- Cest le moment des trennes.
Oui.
- Voici les tiennes, que Laroche ma remises tout lheure."
Elle lui prsenta une petite bote noire qui semblait un crin bijoux.
Il louvrit avec indiffrence et aperut la croix de la Lgion dhonneur.
Il devint un peu ple, puis il sourit et dclara :
"Jaurais prfr dix millions. Cela ne lui cote pas cher."
Elle sattendait un transport de joie, et elle fut irrite de cette froideur.
"Tu es vraiment incroyable. Rien ne te satisfait maintenant."
Il rpondit tranquillement :
"Cet homme ne fait que payer sa dette. Et il me doit encore beaucoup."
Elle fut tonne de son accent, et reprit :
303
"Cest pourtant beau, ton ge."
Il dclara :
"Tout est relatif. Je pourrais avoir davantage, aujourdhui."
Il avait pris lcrin, il le posa tout ouvert sur la chemine, considra quelques
instants ltoile brillante couche dedans. Puis il le referma, et se mit au lit en
haussant les paules.
LOfciel du ler janvier annona, en effet, la nomination de M. Prosper-Georges
Du Roy, publiciste, au grade de chevalier de la Lgion dhonneur, pour services
exceptionnels. Le nom tait crit en deux mots, ce qui t Georges plus de plaisir
que la dcoration mme.
Une heure aprs avoir lu cette nouvelle devenue publique, il reut un mot de
la Patronne qui le suppliait de venir dner chez elle, le soir mme, avec sa femme,
pour fter cette distinction. Il hsita quelques minutes, puis jetant au feu ce billet
crit entermes ambigus, il dit Madeleine : Nous dnerons ce soir chez les Walter."
Elle fut tonne.
Tiens ! mais je croyais que tu ne voulais plus y mettre les pieds ?"
Il murmura seulement :
"Jai chang davis."
Quand ils arrivrent, la Patronne tait seule dans le petit boudoir Louis XVI
adopt pour ses rceptions intimes. Vtue de noir, elle avait poudr ses cheveux,
ce qui la rendait charmante. Elle avait lair, de loin, dune vieille, de prs, dune
jeune, et, quand on la regardait bien, dun joli pige pour les yeux.
"Vous tes en deuil ?" demanda Madeleine.
Elle rpondit tristement :
304
"Oui et non. Je nai perdu personne des miens. Mais je suis arrive lge o
on fait le deuil de sa vie. Je le porte aujourdhui pour linaugurer. Dsormais je le
porterai dans mon cur. "
Du Roy pensa : "a tiendra-t-il, cette rsolution l ? "
Le dner fut un peu morne. Seule Suzanne bavardait sans cesse. Rose semblait
proccupe. On flicita beaucoup le journaliste.
Le soir on sen alla, errant et causant, par les salons et par la serre. Comme Du
Roy marchait derrire, avec la Patronne, elle le retint par le bras.
"coutez, dit-elle voix basse... Je ne vous parlerai plus de rien, jamais... Mais
venez me voir, Georges. Vous voyez que je ne vous tutoie plus. Il mest impossible
de vivre sans vous, impossible. Cest une torture inimaginable. Je vous sens, je
vous garde dans mes yeux, dans mon cur et dans ma chair tout le jour et toute la
nuit. Cest comme si vous maviez fait boire unpoisonqui me rongerait endedans.
Je ne puis pas. Non. Je ne puis pas. Je veux bien ntre pour vous quune vieille
femme. Je me suis mise en cheveux blancs pour vous le montrer ; mais venez ici,
venez de temps en temps, en ami."
Elle lui avait pris la main et elle la serrait, la broyait, enfonant ses ongles dans
sa chair.
Il rpondit avec calme :
Cest entendu. Il est inutile de reparler de a. Vous voyez bien que je suis venu
aujourdhui, tout de suite, sur votre lettre."
Walter, qui allait devant avec ses deux lles et Madeleine, attendit Du Roy au-
prs du Jsus marchant sur les ots.
"Figurez-vous, dit-il en riant, que jai trouv ma femme hier genoux devant ce
tableau comme dans une chapelle. Elle faisait l ses dvotions. Ce que jai ri !"
Mme Walter rpliqua dune voix ferme, dune voix o vibrait une exaltation se-
crte :
305
"Cest ce Christ-l qui sauvera mon me. Il me donne du courage et de la force
toutes les fois que je le regarde."
Et, sarrtant en face du Dieu debout sur la mer, elle murmura :
"Comme il est beau! Comme ils enont peur et comme ils laiment, ces hommes !
Regardez donc sa tte, ses yeux, comme il est simple et surnaturel enmme temps !"
Suzanne scria :
"Mais il vous ressemble, Bel-Ami. Je suis sre quil vous ressemble. Si vous aviez
des favoris, ou bien sil tait ras, vous seriez tout pareils tous les deux. Oh! mais
cest frappant !"
Elle voulut quil se mt debout ct du tableau; et tout le monde reconnut, en
effet, que les deux gures se ressemblaient !
Chacun stonna. Walter trouva la chose bien singulire. Madeleine, en sou-
riant, dclara que Jsus avait lair plus viril.
Mme Walter demeurait immobile, contemplant dun oeil xe le visage de son
amant ct du visage du Christ, et elle tait devenue aussi blanche que ses che-
veux blancs.
306
Chapitre 16
Pendant le reste de lhiver, les Du Roy allrent souvent chez les Walter. Georges
mme y dnait seul tout instant, Madeleine se disant fatigue et prfrant rester
chez elle.
Il avait adopt le vendredi comme jour xe, et la Patronne ninvitait jamais per-
sonne ce soir-l ; il appartenait Bel-Ami, rien qu lui. Aprs dner, on jouait aux
cartes, on donnait manger aux poissons chinois, on vivait et on samusait en fa-
mille. Plusieurs fois, derrire une porte, derrire unmassif de la serre, dans uncoin
sombre, Mme Walter avait saisi brusquement dans ses bras le jeune homme, et, le
serrant de toute sa force sur sa poitrine, lui avait jet dans loreille : "Je taime !... je
taime !... je taime en mourir !" Mais toujours il lavait repousse froidement, en
rpondant dun ton sec : "Si vous recommencez, je ne viendrai plus ici. "
Vers la n de mars, on parla tout coup du mariage des deux surs. Rose devait
pouser disait-on, le comte de Latour-Yvelin, et Suzanne, le marquis de Cazolles.
Ces deux hommes taient devenus des familiers de la maison, de ces familiers
qui on accorde des faveurs spciales, des prrogatives sensibles.
Georges et Suzanne vivaient dans une sorte dintimit fraternelle et libre, bavar-
daient pendant des heures, se moquaient de tout le monde et semblaient se plaire
beaucoup ensemble.
Jamais ils navaient reparl du mariage possible de la jeune lle, ni des prten-
dants qui se prsentaient.
Comme le Patron avait emmen Du Roy pour djeuner, un matin, Mme Wal-
ter, aprs le repas, fut appele pour rpondre un fournisseur. Et Georges dit
Suzanne : "Allons donner du pain aux poissons rouges."
307
Ils prirent chacun sur la table un gros morceau de mie et sen allrent dans la
serre.
Tout le long de la vasque de marbre on laissait par terre des coussins an quon
pt se mettre genoux autour du bassin, pour tre plus prs des btes nageantes.
Les jeunes gens enprirent chacunun, cte cte, et, penchs vers leau, commen-
crent jeter dedans des boulettes quils roulaient entre leurs doigts. Les poissons,
ds quils les aperurent, sen vinrent, en remuant la queue, battant des nageoires,
roulant leurs gros yeux saillants, tournant sur eux-mmes, plongeant pour attra-
per la proie ronde qui senfonait, et remontant aussitt pour en demander une
autre.
Ils avaient des mouvements drles de la bouche, des lans brusques et rapides,
une allure trange de petits monstres ; et sur le sable dor dufondils se dtachaient
en rouge ardent, passant comme des ammes dans londe transparente, ou mon-
trant, aussitt quils sarrtaient, le let bleu qui bordait leurs cailles.
Georges et Suzanne voyaient leurs propres gures renverses dans leau, et ils
souriaient leurs images.
Tout coup, il dit voix basse :
"Ce nest pas bien de me faire des cachotteries, Suzanne."
Elle demanda :
"Quoi donc, Bel-Ami ?
- Vous ne vous rappelez pas ce que vous mavez promis, ici mme, le soir de la
fte ?
- Mais non!
- De me consulter toutes les fois quon demanderait votre main.
- Eh bien?
- Eh bien, on la demande.
308
- Qui a ?
- Vous le savez bien.
- Non. Je vous jure.
- Si, vous le savez ! Ce grand fat de marquis de Cazolles.
- Il nest pas fat, dabord.
- Cest possible ! mais il est stupide ; ruin par le jeu et us par la noce. Cest
vraiment un joli parti pour vous, si jolie, si frache, et si intelligente."
Elle demanda en souriant :
"Quest-ce que vous avez contre lui ?
- Moi ? Rien.
- Mais si. Il nest pas tout ce que vous dites.
- Allons donc. Cest un sot et un intrigant."
Elle se tourna un peu, cessant de regarder dans leau :
"Voyons, quest-ce que vous avez ?"
Il pronona, comme si on lui et arrach un secret du fond du cur.
"Jai... jai... jai que je suis jaloux de lui."
Elle stonna modrment :
"Vous ?
- Oui, moi !
309
- Tiens. Pourquoi a ?
- Parce que je suis amoureux de vous, et vous le savez bien, mchante ! "
Alors elle dit dun ton svre :
" Vous tes fou, Bel-Ami !"
Il reprit :
"Je le sais bien que je suis fou. Est-ce que je devrais vous avouer cela, moi,
un homme mari, vous, une jeune lle ? Je suis plus que fou, je suis coupable,
presque misrable. Je nai pas despoir possible, et je perds la raison cette pen-
se. Et quand jentends dire que vous allez vous marier, jai des accs de fureur
tuer quelquun. Il faut me pardonner a, Suzanne !"
Il se tut. Les poissons qui on ne jetait plus de pain demeuraient immobiles,
rangs presque en lignes, pareils des soldats anglais, et regardant les gures pen-
ches de ces deux personnes qui ne soccupaient plus deux.
La jeune lle murmura, moiti tristement, moiti gaiement :
"Cest dommage que vous soyez mari. Que voulez-vous ? On ny peut rien.
Cest ni !"
Il se retourna brusquement vers elle, et il lui dit, tout prs, dans la gure :
"Si jtais libre, moi, mpouseriez-vous ?"
Elle rpondit, avec un accent sincre :
"Oui, Bel-Ami, je vous pouserais, car vous me plaisez beaucoup plus que tous
les autres."
Il se leva, et balbutiant :
"Merci..., merci..., je vous en supplie, ne dites " oui " personne ? Attendez en-
core un peu. Je vous en supplie ! Me le promettez-vous ?"
310
Elle murmura, un peu trouble et sans comprendre ce quil voulait :
"Je vous le promets."
Du Roy jeta dans leau le gros morceau de pain quil tenait encore aux mains, et
il senfuit, comme sil et perdu la tte, sans dire adieu.
Tous les poissons se jetrent avidement sur ce paquet de mie qui ottait nayant
point t ptri par les doigts, et ils le dpecrent de leurs bouches voraces. Ils len-
tranaient lautre bout du bassin, sagitaient au-dessous, formant maintenant
une grappe mouvante, une espce de eur anime et tournoyante, une eur vi-
vante, tombe leau la tte en bas.
Suzanne, surprise, inquite, se redressa, et sen revint tout doucement. Le jour-
naliste tait parti.
Il rentra chez lui, fort calme, et comme Madeleine crivait des lettres, il lui de-
manda :
"Dnes-tu vendredi chez les Walter ? Moi, jirai."
Elle hsita :
"Non. Je suis un peu souffrante. Jaime mieux rester ici."
Il rpondit :
"Comme il te plaira. Personne ne te force."
Puis il reprit son chapeau et ressortit aussitt.
Depuis longtemps il lpiait, la surveillait et la suivait, sachant toutes ses d-
marches. Lheure quil attendait tait enn venue. Il ne stait point tromp au ton
dont elle avait rpondu : "Jaime mieux rester ici."
Il fut aimable pour elle pendant les jours qui suivirent. Il parut mme gai, ce qui
ne lui tait plus ordinaire. Elle disait : "Voil que tu redeviens gentil."
311
Il shabilla de bonne heure le vendredi pour faire quelques courses avant daller
chez le Patron, afrmait-il.
Puis il partit vers six heures, aprs avoir embrass sa femme, et il alla chercher
un acre place Notre-Dame-de-Lorette.
Il dit au cocher :
"Vous vous arrterez en face du numro 17, rue Fontaine, et vous resterez l
jusqu ce que je vous donne lordre de vous en aller. Vous me conduirez ensuite
au restaurant du Coq-Faisan, rue Lafayette. "
La voiture se mit en route au trot lent du cheval, et Du Roy baissa les stores.
Ds quil fut en face de sa porte, il ne la quitta plus des yeux. Aprs dix minutes
dattente, il vit sortir Madeleine qui remonta vers les boulevards extrieurs.
Aussitt quelle fut loin, il passa la tte " la portire, et il cria :
"Allez."
Le acre se remit enmarche, et le dposa devant le Coq-Faisan, restaurant bour-
geois connu dans le quartier. Georges entra dans la salle commune, et mangea
doucement, en regardant lheure sa montre de temps en temps. A sept heures et
demie, comme il avait bu son caf, pris deux verres de ne champagne et fum,
avec lenteur, un bon cigare, il sortit, hla une autre voiture qui passait vide, et se
t conduire rue La Rochefoucauld.
Il monta, sans rien demander au concierge, au troisime tage de la maison
quil avait indique, et quand une bonne lui eut ouvert :
"M. Guibert de Lorme est chez lui, nest-ce pas ?
- Oui, monsieur."
On le t pntrer dans le salon, o il attendit quelques instants. Puis un homme
entra, grand, dcor, avec lair militaire, et portant des cheveux gris, bien quil ft
jeune encore.
312
Du Roy le salua, puis lui dit :
"Comme je le prvoyais, monsieur le commissaire de police, ma femme dne
avec son amant dans le logement garni quils ont lou rue des Martyrs."
Le magistrat sinclina :
"Je suis votre disposition, monsieur."
Georges reprit :
"Vous avez jusqu neuf heures, nest-ce pas ? Cette limite passe, vous ne pou-
vez plus pntrer dans un domicile particulier pour y constater un adultre.
- Non, monsieur, sept heures en hiver, neuf heures partir du 31 mars. Nous
sommes au 5 avril, nous avons donc jusqu neuf heures.
- Ehbien, monsieur le commissaire, jai une voiture enbas, nous pouvons prendre
les agents qui vous accompagneront, puis nous attendrons unpeudevant la porte.
Plus nous arriverons tard, plus nous avons de chance de bien les surprendre en
agrant dlit.
- Comme il vous plaira, monsieur."
Le commissaire sortit, puis revint, vtu dun pardessus qui cachait sa ceinture
tricolore. Il seffaa pour laisser passer Du Roy. Mais le journaliste, dont lesprit
tait proccup, refusait de sortir le premier, et rptait : "Aprs vous... aprs vous."
Le magistrat pronona :
"Passez donc, monsieur, je suis chez moi."
Lautre, aussitt, franchit la porte en saluant.
Ils allrent dabord au commissariat chercher trois agents en bourgeois qui at-
tendaient, car Georges avait prvenu dans la journe que la surprise aurait lieu
ce soir-l. Un des hommes monta sur le sige, ct du cocher. Les deux autres
entrrent dans le acre, qui gagna la rue des Martyrs.
313
Du Roy disait :
"Jai le plan de lappartement. Cest au second. Nous trouverons dabord un pe-
tit vestibule, puis la chambre coucher. Les trois pices se commandent. Aucune
sortie ne peut faciliter la fuite. Il y a un serrurier un peu plus loin. Il se tiendra prt
tre rquisitionn par vous."
Quand ils furent devant la maison indique, il ntait encore que huit heures un
quart, et ils attendirent en silence pendant plus de vingt minutes. Mais lorsquil vit
que les trois quarts allaient sonner, Georges dit : " Allons maintenant." Et ils mon-
trent lescalier sans soccuper du portier, qui ne les remarqua point, dailleurs.
Un des agents demeura dans la rue pour surveiller la sortie.
Les quatre hommes sarrtrent au second tage, et Du Roy colla dabord son
oreille contre la porte, puis son oeil au trou de la serrure. Il nentendit rien et ne
vit rien. Il sonna.
Le commissaire dit ses agents :
"Vous resterez ici, prts tout appel."
Et ils attendirent. Au bout de deux ou trois minutes Georges tira de nouveau le
bouton du timbre plusieurs fois de suite. Ils perurent un bruit au fond de lappar-
tement ; puis un pas lger sapprocha. Quelquun venait pier. Le journaliste alors
frappa vivement avec son doigt pli contre le bois des panneaux.
Une voix, une voix de femme, quon cherchait dguiser, demanda :
"Qui est l ?"
Lofcier municipal rpondit :
"Ouvrez, au nom de la loi."
La voix rpta :
"Qui tes-vous ?
314
- Je suis le commissaire de police. Ouvrez, ou je fais forcer la porte."
La voix reprit :
"Que voulez-vous ?
Et Du Roy dit :
Cest moi. Il est inutile de chercher nous chapper."
Le pas lger, un pas de pieds nus, sloigna, puis revint au bout de quelques
secondes.
Georges dit :
Si vous ne voulez pas ouvrir, nous enfonons la porte."
Il serrait la poigne de cuivre, et dune paule il poussait lentement. Comme on
ne rpondait plus, il donna tout coup une secousse si violente et si vigoureuse
que la vieille serrure de cette maison meuble cda. Les vis arraches sortirent
du bois et le jeune homme faillit tomber sur Madeleine qui se tenait debout dans
lantichambre, vtue dune chemise et dun jupon, les cheveux dfaits, les jambes
dvtues, une bougie la main.
Il scria : Cest elle, nous les tenons." Et il se jeta dans lappartement. Le com-
missaire ayant t son chapeau, le suivit. Et la jeune femme effare sen vint der-
rire eux en les clairant.
Ils traversrent une salle manger dont la table non desservie montrait les
restes du repas : des bouteilles champagne vides, une terrine de foies gras ou-
verte, une carcasse de poulet et des morceaux de pain moiti mangs. Deux as-
siettes poses sur le dressoir portaient des piles dcailles dhutres.
La chambre semblait ravage par une lutte. Une robe coiffait une chaise, une
culotte dhomme restait cheval sur le bras dun fauteuil. Quatre bottines, deux
grandes et deux petites, tranaient au pied du lit, tombes sur le anc.
315
Ctait une chambre de maison garnie, aux meubles communs, o ottait cette
odeur odieuse et fade des appartements dhtel, odeur mane des rideaux, des
matelas, des murs, des siges, odeur de toutes les personnes qui avaient couch
ou vcu, un jour ou six mois, dans ce logis public, et laiss l un peu de leur sen-
teur, de cette senteur humaine qui, sajoutant celle des devanciers, formait la
longue une puanteur confuse, douce et intolrable, la mme dans tous ces lieux.
Une assiette gteaux, une bouteille de chartreuse et deux petits verres encore
moiti pleins encombraient la chemine. Le sujet de la pendule de bronze tait
cach par un grand chapeau dhomme.
Le commissaire se retourna vivement, et regardant Madeleine dans les yeux :
"Vous tes bien Mme Claire-Madeleine Du Roy, pouse lgitime de M. Prosper-
Georges Du Roy, publiciste, ici prsent ? "
Elle articula, dune voix trangle :
"Oui, monsieur.
- Que faites-vous ici ?"
Elle ne rpondit pas.
Le magistrat reprit : "Que faites-vous ici ? Je vous trouve hors de chez vous,
presque dvtue dans un appartement meubl. Qutes-vous venue y faire ?"
Il attendit quelques instants. Puis, comme elle gardait toujours le silence :
- Du moment que vous ne voulez pas lavouer, madame, je vais tre contraint
de le constater."
On voyait dans le lit la forme dun corps cach sous le drap.
Le commissaire sapprocha et appela :
"Monsieur ?"
316
Lhomme cach ne remua pas. Il paraissait tourner le dos, la tte enfonce sous
un oreiller.
Lofcier toucha ce qui semblait tre lpaule, et rpta : "Monsieur, ne me for-
cez pas, je vous prie, des actes."
Mais le corps voil demeurait aussi immobile que sil et t mort.
Du Roy, qui stait avanc vivement, saisit la couverture, la tira et, arrachant
loreiller, dcouvrit la gure livide de M. Laroche-Mathieu. Il se pencha vers lui et,
frmissant de lenvie de le saisir au cou pour ltrangler, il lui dit, les dents serres :
"Ayez donc au moins le courage de votre infamie."
Le magistrat demanda encore :
"Qui tes-vous ?" Lamant, perdu, ne rpondant pas, il reprit :
"Je suis commissaire de police et je vous somme de me dire votre nom!"
Georges, quune colre bestiale faisait trembler, cria :
"Mais rpondez donc, lche, ou je vais vous nommer, moi."
Alors lhomme couch balbutia :
"Monsieur le commissaire, vous ne devez pas me laisser insulter par cet indi-
vidu. Est-ce vous ou lui que jai affaire ? Est-ce vous ou lui que je dois r-
pondre ?"
Il paraissait navoir plus de salive dans la bouche.
Lofcier rpondit :
"Cest moi, monsieur, moi seul. Je vous demande qui vous tes ?"
Lautre se tut. Il tenait le drap serr contre son cou et roulait des yeux effars.
Ses petites moustaches retrousses semblaient toutes noires sur sa gure blme.
317
Le commissaire reprit :
"Vous ne voulez pas rpondre ? Alors je serai forc de vous arrter. Dans tous les
cas, levez-vous. Je vous interrogerai lorsque vous serez vtu."
Le corps sagita dans le lit, et la tte murmura :
"Mais je ne peux pas devant vous."
Le magistrat demanda :
"Pourquoi a ?"
Lautre balbutia :
Cest que je suis... je suis... je suis tout nu."
Du Roy se mit ricaner, et ramassant une chemise tombe terre, il la jeta sur
la couche en criant :
"Allons donc... levez-vous... Puisque vous vous tes dshabill devant ma femme,
vous pouvez bien vous habiller devant moi."
Puis il tourna le dos et revint vers la chemine.
Madeleine avait retrouv son sang-froid, et voyant tout perdu, elle tait prte
tout oser. Une audace de bravade faisait briller son oeil ; et, roulant un morceau de
papier, elle alluma, comme pour une rception, les dix bougies des vilains cand-
labres poss au coinde la chemine. Puis elle sadossa au marbre et tendant au feu
mourant un de ses pieds nus, qui soulevait par derrire son jupon peine arrt
sur les hanches, elle prit une cigarette dans un tui de papier rose, lenamma et
se mit fumer.
Le commissaire tait revenu vers elle, attendant que son complice ft debout.
Elle demanda avec insolence :
"Vous faites souvent ce mtier-l, monsieur ?"
318
Il rpondit gravement :
"Le moins possible, madame."
Elle lui souriait sous le nez :
"Je vous en flicite, a nest pas propre."
Elle affectait de ne pas regarder, de ne pas voir son mari.
Mais le monsieur du lit shabillait. Il avait pass son pantalon, chauss ses bot-
tines et il se rapprocha, en endossant son gilet.
Lofcier de police se tourna vers lui :
"Maintenant, monsieur, voulez-vous me dire qui vous tes ?"
Lautre ne rpondit pas.
Le commissaire pronona :
"Je me vois forc de vous arrter."
Alors lhomme scria brusquement :
"Ne me touchez pas. Je suis inviolable !"
Du Roy slana vers lui, comme pour le terrasser, et il lui grogna dans la gure :
"II y a agrant dlit... agrant dlit. Je peux vous faire arrter, si je veux... oui, je
le peux."
Puis, dun ton vibrant :
"Cet homme sappelle Laroche-Mathieu, ministre des Affaires trangres."
Le commissaire de police recula stupfait, et balbutiant :
319
"En vrit, monsieur, voulez-vous me dire qui vous tes, la n?"
Lhomme se dcida, et avec force :
"Pour une fois, ce misrable-l na point menti. Je me nomme, eneffet, Laroche-
Mathieu, ministre."
Puis tendant le bras vers la poitrine de Georges, o apparaissait comme une
lueur, un petit point rouge, il ajouta :
"Et le gredin que voici porte sur son habit la croix dhonneur que je lui ai don-
ne."
Du Roy tait devenu livide. Dun geste rapide, il arracha de sa boutonnire la
courte amme de ruban, et, la jetant dans la chemine :
"Voil ce que vaut une dcoration qui vient de salops de votre espce."
Ils taient face face, les dents prs des dents, exasprs, les poings serrs, lun
maigre et la moustache au vent, lautre gras et la moustache en croc.
Le commissaire passa vivement entre les deux et, les cartant avec ses mains :
"Messieurs, vous vous oubliez, vous manquez de dignit !"
Ils se turent et se tournrent les talons. Madeleine, immobile, fumait toujours,
en souriant.
Lofcier de police reprit :
- " Monsieur le ministre, je vous ai surpris, seul avec Mme Du Roy, que voici,
vous couch, elle presque nue. Vos vtements tant jets ple-mle travers lap-
partement, cela constitue un agrant dlit dadultre. Vous ne pouvez nier lvi-
dence. Quavez-vous rpondre ?"
Laroche-Mathieu murmura :
"Je nai rien dire, faites votre devoir."
320
Le commissaire sadressa Madeleine :
"Avouez-vous, madame, que monsieur soit votre amant ?"
Elle pronona crnement :
"Je ne le nie pas, il est mon amant !
- Cela suft,"
Puis le magistrat prit quelques notes sur ltat et la disposition du logis. Comme
il nissait dcrire, le ministre qui avait achev de shabiller et qui attendait, le
paletot sur le bras, le chapeau la main, demanda :
"Avez-vous encore besoin de moi, monsieur ? Que dois-je faire ? Puis-je me re-
tirer ?"
Du Roy se retourna vers lui et souriant avec insolence :
"Pourquoi donc ? Nous avons ni. Vous pouvez vous recoucher, monsieur ; nous
allons vous laisser seuls."
Et posant le doigt sur le bras de lofcier de police :
"Retirons-nous, monsieur le commissaire, nous navons plus rien faire en ce
lieu."
Un peu surpris, le magistrat le suivit ; mais, sur le seuil de la chambre, Georges
sarrta pour le laisser passer. Lautre sy refusait par crmonie.
Du Roy insistait : "Passez donc, monsieur." Le commissaire dit : " Aprs vous."
Alors le journaliste salua, et sur le ton dune politesse ironique : "Cest votre tour,
monsieur le commissaire de police. Je suis presque chez moi, ici."
Puis il referma la porte doucement, avec un air de discrtion.
Une heure plus tard, Georges Du Roy entrait dans les bureaux de La Vie Fran-
aise.
321
M. Walter tait dj l, car il continuait diriger et surveiller avec sollicitude
son journal qui avait pris une extension norme et qui favorisait beaucoup les
oprations grandissantes de sa banque.
Le directeur leva la tte et demanda :
"Tiens, vous voici ? Vous semblez tout drle ! Pourquoi ntes-vous pas venu d-
ner la maison? Do sortez-vous donc ?"
Le jeune homme, qui tait sr de son effet, dclara, en pesant sur chaque mot :
"Je viens de jeter bas le ministre des Affaires trangres."
Lautre crut quil plaisantait.
"De jeter bas... Comment ?
- Je vais changer le cabinet. Voil tout ! Il nest pas trop tt de chasser cette cha-
rogne."
Le vieux, stupfait, crut que son chroniqueur tait gris. Il murmura :
"Voyons, vous draisonnez.
- Pas dutout. Je viens de surprendre M. Laroche-Mathieuenagrant dlit dadul-
tre avec ma femme. Le commissaire de police a constat la chose. Le ministre est
foutu."
Walter, interdit, releva tout fait ses lunettes sur son front et demanda :
"Vous ne vous moquez pas de moi ?
- Pas du tout. Je vais mme faire un cho l-dessus.
- Mais alors que voulez-vous ?
- Jeter bas ce fripon, ce misrable, ce malfaiteur public !"
322
Georges posa son chapeau sur un fauteuil, puis ajouta :
"Gare ceux que je trouve sur mon chemin. Je ne pardonne jamais."
Le directeur hsitait encore comprendre. Il murmura :
"Mais... votre femme ?
- Ma demande en divorce sera faite ds demain matin. Je la renvoie feu Fores-
tier.
- Vous voulez divorcer ?
- Parbleu. Jtais ridicule. Mais il me fallait faire la bte pour les surprendre. a
y est. Je suis matre de la situation."
M. Walter nen revenait pas ; et il regardait Du Roy avec des yeux effars, pen-
sant : "Bigre. est un gaillard bon mnager."
Georges reprit :
"Me voici libre... Jai une certaine fortune. Je me prsenterai aux lections au
renouvellement doctobre, dans mon pays o je suis fort connu. Je ne pouvais
pas me poser ni me faire respecter avec cette femme qui tait suspecte tout
le monde. Elle mavait pris comme un niais, elle mavait enjl et captur. Mais
depuis que je savais son jeu, je la surveillais, la gredine."
Il se mit rire et ajouta :
"Cest ce pauvre Forestier qui tait cocu... cocu sans sen douter, conant et
tranquille. Me voici dbarrass de la teigne quil mavait laisse. Jai les mains d-
lies. Maintenant, jirai loin."
Il stait mis califourchon sur une chaise. Il rpta, comme sil et song :
"Jirai loin."
Et le pre Walter le regardait toujours de ses yeux dcouverts, ses lunettes res-
tant releves sur le front, et il se disait : "Oui, il ira loin, le gredin."
323
Georges se releva :
"Je vais rdiger lcho. Il faut le faire avec discrtion. Mais vous savez, il sera
terrible pour le ministre. Cest un homme la mer. On ne peut pas le repcher. La
Vie Franaise na plus dintrt le mnager."
Le vieux hsita quelques instants, puis il en prit son parti :
"Faites, dit-il, tant pis pour ceux qui se chent dans ces ptrins-l."
324
Chapitre 17
Trois mois staient couls. Le divorce de Du Roy venait dtre prononc. Sa
femme avait repris son nom de Forestier, et comme les Walter devaient partir, le
15 juillet, pour Trouville, on dcida de passer une journe la campagne, avant de
se sparer.
On choisit un jeudi, et on se mit en route ds neuf heures du matin, dans un
grand landau de voyage six places, attel en poste quatre chevaux.
Onallait djeuner Saint-Germain, aupavillonHenri-IV. Bel-Ami avait demand
tre le seul homme de la partie, car il ne pouvait supporter la prsence et la -
gure du marquis de Cazolles. Mais, au dernier moment, il fut dcid que le comte
de Latour-Yvelin serait enlev, au saut du lit. On lavait prvenu la veille.
La voiture remonta au grand trot lavenue des Champs-lyses, puis traversa le
bois de Boulogne.
Il faisait un admirable temps dt, pas trop chaud. Les hirondelles traaient
sur le bleu du ciel de grandes lignes courbes quon croyait voir encore quand elles
taient passes.
Les trois femmes se tenaient au fond du landau, la mre entre ses deux lles ; et
les trois hommes, reculons, Walter entre les deux invits.
On traversa la Seine, on contourna le Mont-Valrien, puis on gagna Bougival,
pour longer ensuite la rivire jusquau Pecq.
Le comte de Latour-Yvelin, unhomme unpeu mr longs favoris lgers, dont le
moindre soufe dair agitaient les pointes, ce qui faisait dire Du Roy : "Il obtient
de jolis effets de vent dans sa barbe", contemplait Rose tendrement. Ils taient
ancs depuis un mois.
325
Georges, fort ple, regardait souvent Suzanne, qui tait ple aussi. Leurs yeux
se rencontraient, semblaient se concerter, se comprendre, changer secrtement
une pense, puis se fuyaient. Mme Walter tait tranquille, heureuse.
Le djeuner fut long. Avant de repartir pour Paris, Georges proposa de faire un
tour sur la terrasse.
On sarrta dabord pour examiner la vue. Tout le monde se mit en ligne le long
du mur et on sextasia sur ltendue de lhorizon. La Seine, au pied dune longue
colline, coulait vers Maisons-Laftte, comme un immense serpent couch dans la
verdure. A droite, sur le sommet de la cte, laqueduc de Marly projetait sur le ciel
son prol norme de chenille grandes pattes, et Marly disparaissait, au-dessous,
dans un pais bouquet darbres.
Par la plaine immense qui stendait en face, on voyait des villages, de place en
place. Les pices deau du Vsinet faisaient des taches nettes et propres dans la
maigre verdure de la petite fort. A gauche, tout au loin, on apercevait en lair le
clocher pointu de Sartrouville.
Walter dclara :
"On ne peut trouver nulle part au monde un semblable panorama. Il ny en a
pas un pareil en Suisse."
Puis on se mit en marche doucement pour faire une promenade et jouir un peu
de cette perspective.
Georges et Suzanne restrent en arrire. Ds quils furent carts de quelques
pas, il lui dit dune voix basse et contenue :
"Suzanne, je vous adore. Je vous aime en perdre la tte."
Elle murmura :
"Moi aussi, Bel-Ami."
Il reprit :
326
"Si je ne vous ai pas pour femme, je quitterai Paris et ce pays."
Elle rpondit :
"Essayez donc de me demander papa. Peut-tre quil voudra bien. "
Il eut un petit geste dimpatience :
"Non, je vous le rpte pour la dixime fois, cest inutile. On me fermera la porte
de votre maison; onmexpulsera dujournal ; et nous ne pourrons plus mme nous
voir. Voil le joli rsultat auquel je suis certain darriver par une demande en rgle.
On vous a promise au marquis de Cazolles. On espre que vous nirez par dire :
"Oui." Et on attend."
Elle demanda :
"Quest-ce quil faut faire alors ?"
Il hsitait, la regardant de ct :
"Maimez-vous assez pour commettre une folie ?"
Elle rpondit rsolument :
"Oui.
- Une grande folie ?
- Oui.
- La plus grande des folies ?
- Oui.
- Aurez-vous aussi assez de courage pour braver votre pre et votre mre ?
- Oui.
327
- Bien vrai ?
- Oui.
- Eh bien, il y a un moyen, un seul ! Il faut que la chose vienne de vous, et pas
de moi. Vous tes une enfant gte, on vous laisse tout dire, on ne stonnera pas
trop dune audace de plus de votre part. coutez donc. Ce soir, en rentrant, vous
irez trouver votre maman, dabord, votre maman toute seule. Et vous lui avouerez
que vous voulez mpouser. Elle aura une grosse motion et une grosse colre..."
Suzanne linterrompit :
"Oh! maman voudra bien."
Il reprit vivement :
"Non. Vous ne la connaissez pas. Elle sera plus fche et plus furieuse que votre
pre. Vous verrez comme elle refusera. Mais vous tiendrez bon, vous ne cderez
pas ; vous rpterez que vous voulez mpouser, moi, seul, rien que moi. Le ferez-
vous ?
- Je le ferai.
- Et en sortant de chez votre mre, vous direz la mme chose votre pre, dun
air trs srieux et trs dcid.
- Oui, oui. Et puis ?
- Et puis, cest l que a devient grave. Si vous tes rsolue, bien rsolue, bien,
bien, bien rsolue tre ma femme, ma chre, chre petite Suzanne... Je vous... je
vous enlverai !"
Elle eut une grande secousse de joie et faillit battre des mains.
"Oh! quel bonheur ! vous menlverez ? Quand a menlverez-vous ?"
Toute la vieille posie des enlvements nocturnes, des chaises de poste, des au-
berges, toutes les charmantes aventures des livres lui passrent dun coup dans
lesprit comme un songe enchanteur prt se raliser.
328
Elle rpta :
"Quand a menlverez-vous ?"
Il rpondit trs bas :
"Mais... ce soir... cette nuit."
Elle demanda, frmissante :
"Et o irons-nous ?
- a, cest mon secret. Rchissez ce que vous faites. Songez bien quaprs
cette fuite vous ne pourrez plus tre que ma femme ! Cest le seul moyen, mais il
est... il est trs dangereux... pour vous."
Elle dclara :
"Je suis dcide... o vous retrouverai-je ?
- Vous pourrez sortir de lhtel, toute seule ?
- Oui. Je sais ouvrir la petite porte.
- Eh bien, quand le concierge sera couch, vers minuit, venez me rejoindre
place de la Concorde. Vous me trouverez dans unacre arrt enface du ministre
de la Marine.
- Jirai.
- Bien vrai ?
- Bien vrai."
Il lui prit la main et la serra :
"Oh! que je vous aime ! Comme vous tes bonne et brave ! Alors, vous ne voulez
pas pouser M. de Cazolles ?
329
- Oh! non.
- Votre pre sest beaucoup fch quand vous avez dit non?
- Je crois bien, il voulait me remettre au couvent.
- Vous voyez quil est ncessaire dtre nergique.
- Je le serai."
Elle regardait le vaste horizon, la tte pleine de cette ide denlvement. Elle irait
plus loin que l-bas... avec lui !... Elle serait enleve !... Elle tait re de a ! Elle ne
songeait gure sa rputation, ce qui pouvait lui arriver dinfme. Le savait-elle,
mme ? Le souponnait-elle ?
Mme Walter, se retournant, cria :
"Mais viens donc, petite. Quest-ce que tu fais avec Bel-Ami ?"
Ils rejoignirent les autres. On parlait des bains de mer o on serait bientt.
Puis on revint par Chatou pour ne pas refaire la mme route.
George ne disait plus rien. Il songeait : Donc, si cette petite avait un peu dau-
dace, il allait russir, enn! Depuis trois mois, il lenveloppait dans lirrsistible
let de sa tendresse. Il la sduisait, la captivait, la conqurait. Il stait fait aimer
par elle, comme il savait se faire aimer. Il avait cueilli sans peine son me lgre de
poupe.
Il avait obtenu dabord quelle refust M. de Cazolles. Il venait dobtenir quelle
senfut avec lui. Car il ny avait pas dautre moyen.
Mme Walter, il le comprenait bien, ne consentirait jamais lui donner sa lle.
Elle laimait encore, elle laimerait toujours, avec une violence intraitable. Il la
contenait par sa froideur calcule, mais il la sentait ronge par une passion im-
puissante et vorace. Jamais il ne pourrait la chir. Jamais elle nadmettrait quil
prt Suzanne.
330
Mais une fois quil tiendrait la petite au loin, il traiterait de puissance puis-
sance, avec le pre.
Pensant tout cela, il rpondait par phrases haches aux choses quon lui disait
et quil ncoutait gure. Il parut revenir lui lorsquil rentra dans Paris.
Suzanne aussi songeait ; et le grelot des quatre chevaux sonnait dans sa tte,
lui faisait voir des grandes routes innies sous des clairs de lune ternels, des fo-
rts sombres traverses, des auberges au bord du chemin, et la hte des hommes
dcurie changer lattelage, car tout le monde devine quils sont poursuivis.
Quand le landau fut arriv dans la cour de lhtel, on voulut retenir Georges
dner. Il refusa et revint chez lui.
Aprs avoir un peu mang, il mit de lordre dans ses papiers comme sil allait
faire un grand voyage. Il brla des lettres compromettantes, en cacha dautres,
crivit quelques amis.
De temps en temps il regardait la pendule, en pensant : "a doit chauffer l-
bas." Et une inquitude le mordait au cur. Sil allait chouer ? Mais que pouvait-
il craindre ? Il se tirerait toujours daffaire ! Pourtant ctait une grosse partie quil
jouait, ce soir-l !
Il ressortit vers onze heures, erra quelque temps, prit un acre et se t arrter
place de la Concorde, le long des arcades du ministre de la Marine.
De temps entemps il enammait une allumette pour regarder lheure sa montre.
Quand il vit approcher minuit, son impatience devint vreuse. A tout moment il
passait la tte la portire pour regarder.
Une horloge lointaine sonna douze coups, puis une autre plus prs, puis deux
ensemble, puis une dernire trs loin. Quand celle-l eut cess de tinter, il pensa :
"Cest ni. Cest rat. Elle ne viendra pas."
Il tait cependant rsolu demeurer jusquau jour.
Dans ces cas-l il faut tre patient.
331
Il entendit encore sonner le quart, puis la demie, puis les trois quarts ; et toutes
les horloges rptrent une heure comme elles avaient annonc minuit. Il natten-
dait plus, il restait, creusant sa pense pour deviner ce qui avait pu arriver. Tout
coup une tte de femme passa par la portire et demanda :
"tes-vous l, Bel-Ami ?"
Il eut un sursaut et une suffocation.
"Cest vous, Suzanne ?
- Oui, cest moi."
Il ne parvenait point tourner la poigne assez vite, et rptait :
"Ah!... cest vous... cest vous... entrez."
Elle entra et se laissa tomber contre lui. Il cria au cocher : "Allez !" Et le acre se
mit en route.
Elle haletait, sans parler.
Il demanda :
"Eh bien, comment a sest-il pass ?"
Alors elle murmura, presque dfaillante :
"Oh! a a t terrible, chez maman surtout."
Il tait inquiet et frmissant.
"Votre maman? Quest-ce quelle a dit ? Contez-moi a.
332
- Oh! a a t affreux. Je suis entre chez elle et je lui ai rcit ma petite affaire
que javais bien prpare. Alors elle a pli, puis elle a cri : "Jamais ! jamais !" Moi,
jai pleur, je me suis fche, jai jur que je npouserais que vous. Jai cru quelle
allait me battre. Elle est devenue comme folle ; elle a dclar quon me renverrait
au couvent, ds le lendemain. Je ne lavais jamais vue comme a, jamais ! Alors
papa est arriv en lentendant dbiter toutes ses sottises. Il ne sest pas fch tant
quelle, mais il a dclar que vous ntiez pas un assez beau parti.
"Comme ils mavaient mise en colre aussi, jai cri plus fort queux. Et papa
ma dit de sortir avec un air dramatique qui ne lui allait pas du tout. Cest ce qui
ma dcide me sauver avec vous. Me voil, o allons-nous ?"
Il avait enlac sa taille doucement ; et il coutait de toutes ses oreilles, le cur
battant, une rancune haineuse sveillant en lui contre ces gens. Mais il la tenait,
leur lle. Ils verraient, prsent.
Il rpondit :
"Il est trop tard pour prendre le train; cette voiture-l va donc nous conduire
Svres onous passerons la nuit. Et demainnous partirons pour La Roche-Guyon.
Cest un joli village, au bord de la Seine, entre Mantes et Bonnires."
Elle murmura :
"Cest que je nai pas deffets. Je nai rien."
Il sourit, avec insouciance :
"Bah! nous nous arrangerons l-bas."
Le acre roulait le long des rues. Georges prit une main de la jeune lle et se
mit la baiser, lentement, avec respect. Il ne savait que lui raconter, ntant gure
accoutum aux tendresses platoniques. Mais soudain il crut sapercevoir quelle
pleurait.
Il demanda, avec terreur :
"Quest-ce que vous avez, ma chre petite ?"
333
Elle rpondit, dune voix toute mouille :
"Cest ma pauvre maman qui ne doit pas dormir cette heure, si elle sest aper-
ue de mon dpart."
Sa mre, en effet, ne dormait pas.
Aussitt Suzanne sortie de sa chambre, Mme Walter tait reste en face de son
mari.
Elle demanda, perdue, atterre :
"Mon Dieu! Quest-ce que cela veut dire ?"
Walter cria, furieux :
"a veut dire que cet intrigant la enjle. Cest lui qui a fait refuser Cazolles. Il
trouve la dot bonne, parbleu!"
Il se mit marcher avec rage travers lappartement et reprit :
"Tu lattirais sans cesse, aussi, toi, tu le attais, tu le cajolais, tu navais pas assez
de chatteries pour lui.
Ctait Bel-Ami par-ci, Bel-Ami par-l, du matin au soir. Te voil paye."
Elle murmura, livide :
"Moi ?... je lattirais !"
Il lui vocifra dans le nez :
"Oui, toi ! Vous tes toutes folles de lui, la Marelle, Suzanne et les autres. Crois-
tu que je ne voyais pas que tu ne pouvais point rester deux jours sans le faire venir
ici ?"
Elle se dressa, tragique :
334
"Je ne vous permettrai pas de me parler ainsi. Vous oubliez que je nai pas t
leve, comme vous, dans une boutique."
Il demeura dabord immobile et stupfait, puis il lcha un "Nom de Dieu" furi-
bond, et il sortit en tapant la porte.
Ds quelle fut seule, elle alla, par instinct, vers la glace pour se regarder, comme
pour voir si rien ntait chang en elle, tant ce qui arrivait lui paraissait impossible,
monstrueux. Suzanne tait amoureuse de Bel-Ami ! et Bel-Ami voulait pouser Su-
zanne ! Non! elle stait trompe, ce ntait pas vrai. La llette avait euune toquade
bien naturelle pour ce beau garon, elle avait espr quon le lui donnerait pour
mari ; elle avait fait son petit coup de tte ! Mais lui ? lui ne pouvait pas tre com-
plice de a ! Elle rchissait, trouble comme on lest devant les grandes catas-
trophes. Non, Bel-Ami ne devait rien savoir de lescapade de Suzanne.
Et elle songea longtemps la perdie et linnocence possibles de cet homme.
Quel misrable, sil avait prpar le coup! Et quarriverait-il ? Que de dangers et de
tourments elle prvoyait !
Sil ne savait rien, tout pouvait sarranger encore. On ferait un voyage avec Su-
zanne pendant six mois, et ce serait ni. Mais comment pourrait-elle le revoir, elle,
ensuite ? Car elle laimait toujours. Cette passion tait entre en elle la faon de
ces pointes de che quon ne peut plus arracher.
Vivre sans lui tait impossible. Autant mourir. Sa pense sgarait dans ces an-
goisses et dans ces incertitudes. Une douleur commenait poindre dans sa tte ;
ses ides devenaient pnibles, troubles, lui faisaient mal. Elle snervait cher-
cher, sexasprait de ne pas savoir. Elle regarda sa pendule, il tait une heure pas-
se. Elle se dit : "Je ne veux pas rester ainsi, je deviens folle. Il faut que je sache. Je
vais rveiller Suzanne pour linterroger."
Et elle sen alla, dchausse, pour ne pas faire de bruit, une bougie la main,
vers la chambre de sa lle. Elle louvrit bien doucement, entra, regarda le lit. Il
ntait pas dfait. Elle ne comprit point dabord, et pensa que la llette discutait
encore avec son pre. Mais aussitt un soupon horrible lefeura et elle courut
chez son mari. Elle y arriva dun lan; blme et haletante. Il tait couch et lisait
encore.
Il demanda effar :
335
"Eh bien! quoi ? Quest-ce que tu as ?"
Elle balbutiait :
"As-tu vu Suzanne ?
- Moi ? Non. Pourquoi ?
- Elle est... elle est... partie. Elle nest pas dans sa chambre."
Il sauta dun bond sur le tapis, chaussa ses pantoues et, sans caleon, la che-
mise au vent, il se prcipita son tour vers lappartement de sa lle.
Ds quil leut vu, il ne conserva point de doute. Elle stait enfuie.
Il tomba sur un fauteuil et posa sa lampe par terre devant lui.
Sa femme lavait rejoint. Elle bgaya :
"Eh bien?"
Il navait plus la force de rpondre ; il navait plus de colre, il gmit :
"Cest fait, il la tient. Nous sommes perdus."
Elle ne comprenait pas :
"Comment perdus ?
- Eh! oui, parbleu. Il faut bien quil lpouse maintenant."
Elle poussa une sorte de cri de bte :
"Lui ! jamais ! Tu es donc fou?"
Il rpondit tristement :
336
"a ne sert rien de hurler. Il la enleve, il la dshonore. Le mieux est encore
de la lui donner. En sy prenant bien, personne ne saura cette aventure."
Elle rpta, secoue dune motion terrible :
"Jamais ! jamais il naura Suzanne ! Jamais je ne consentirai !"
Walter murmura avec accablement :
"Mais il la. Cest fait. Et il la gardera et la cachera tant que nous naurons point
cd. Donc, pour viter le scandale, il faut cder tout de suite."
Sa femme, dchire par une inavouable douleur, rpta :
"Non! non. Jamais je ne consentirai !"
Il reprit, simpatientant :
"Mais il ny a pas discuter. Il le faut. Ah! le gredin, comme il nous a jous... Il
est fort tout de mme. Nous aurions pu trouver beaucoup mieux comme position,
mais pas comme intelligence et comme avenir. Cest un homme davenir. Il sera
dput et ministre."
Mme Walter dclara, avec une nergie farouche :
"Jamais je ne lui laisserai pouser Suzanne... Tu entends... jamais ! "
Il nit par se fcher et par prendre, en homme pratique, la dfense de Bel-Ami.
"Mais, tais-toi donc... Je te rpte quil le faut... quil le faut absolument. Et qui
sait ? Peut-tre ne le regretterons-nous pas. Avec les tres de cette trempe l, on
ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu as vu comme il a jet bas, en trois articles, ce
niais de Laroche-Mathieu, et comme il la fait avec dignit, ce qui tait rudement
difcile dans sa situation de mari. Enn nous verrons. Toujours est-il que nous
sommes pris. Nous ne pouvons plus nous tirer de l."
Elle avait envie de crier, de se rouler par terre, de sarracher les cheveux. Elle
pronona encore, dune voix exaspre :
337
"II ne laura pas... Je... ne... veux... pas !"
Walter se leva, ramassa sa lampe, reprit :
"Tiens, tu es stupide comme toutes les femmes. Vous nagissez jamais que par
passion. Vous ne savez pas vous plier aux circonstances... vous tes stupides ! Moi,
je te dis quil lpousera... Il le faut."
Et il sortit en tranant ses pantoues. Il traversa, fantme comique en chemise
de nuit, le large corridor du vaste htel endormi, et rentra, sans bruit, dans sa
chambre.
Mme Walter restait debout, dchire par une intolrable douleur. Elle ne com-
prenait pas encore bien, dailleurs. Elle souffrait seulement. Puis il lui sembla quelle
ne pourrait pas demeurer l, immobile, jusquau jour. Elle sentait en elle un be-
soin violent de se sauver, de courir devant elle, de sen aller, de chercher de laide,
dtre secourue.
Elle cherchait qui elle pourrait bien appeler elle. Quel homme ! Elle nen trou-
vait pas ! Un prtre ! oui, un prtre ! Elle se jetterait ses pieds, lui avouerait tout,
lui confesserait sa faute et son dsespoir. Il comprendrait, lui, que ce misrable ne
pouvait pas pouser Suzanne et il empcherait cela.
Il lui fallait un prtre tout de suite ! Mais o le trouver ? O aller ? Pourtant elle
ne pouvait rester ainsi.
Alors passa devant ses yeux, ainsi quune vision, limage sereine de Jsus mar-
chant sur les ots. Elle le vit comme elle le voyait en regardant le tableau. Donc il
lappelait. Il lui disait : "Venez moi. Venez vous agenouiller mes pieds. Je vous
consolerai et je vous inspirerai ce quil faut faire."
Elle prit sa bougie, sortit, et descendit pour gagner la serre. Le Jsus tait tout au
bout, dans un petit salon quon fermait par une porte vitre an que lhumidit
des terres ne dtriort point la toile.
Cela faisait une sorte de chapelle dans une fort darbres singuliers.
338
Quand Mme Walter entra dans le jardin dhiver, ne layant jamais vu que plein
de lumire, elle demeura saisie devant sa profondeur obscure. Les lourdes plantes
des pays chauds paississaient latmosphre de leur haleine pesante. Et les portes
ntant plus ouvertes, lair de ce bois trange, enferm sous un dme de verre, en-
trait dans la poitrine avec peine, tourdissait, grisait, faisait plaisir et mal, donnait
la chair une sensation confuse de volupt nervante et de mort.
La pauvre femme marchait doucement, mue par les tnbres o apparais-
saient, la lueur errante de sa bougie, des plantes extravagantes, avec des aspects
de monstres, des apparences dtres, des difformits bizarres.
Tout dun coup, elle aperut le Christ. Elle ouvrit la porte qui le sparait delle,
et tomba sur les genoux.
Elle le pria dabord perdument, balbutiant des mots damour, des invocations
passionnes et dsespres. Puis, lardeur de son appel se calmant, elle leva les
yeux vers lui, et demeura saisie dangoisse. Il ressemblait tellement Bel-Ami,
la clart tremblante de cette seule lumire lclairant peine et den bas, que ce
ntait plus Dieu, ctait son amant qui la regardait. Ctaient ses yeux, son front,
lexpression de son visage, son air froid et hautain!
Elle balbutiait : "Jsus ! - Jsus ! - Jsus !" Et le mot "Georges" lui venait aux
lvres. Tout coup, elle pensa qu cette heure mme, Georges, peut-tre, pos-
sdait sa lle. Il tait seul avec elle, quelque part, dans une chambre. Lui ! lui ! avec
Suzanne !
Elle rptait : "Jsus !... Jsus !" Mais elle pensait eux... sa lle et son amant !
Ils taient seuls, dans une chambre... et ctait la nuit. Elle les voyait. Elle les voyait
si nettement quils se dressaient devant elle, la place du tableau. Ils se souriaient.
Ils sembrassaient. La chambre tait sombre, le lit entrouvert. Elle se souleva pour
aller vers eux, pour prendre sa lle par les cheveux et larracher cette treinte.
Elle allait la saisir la gorge, ltrangler, sa lle quelle hassait, sa lle qui se don-
nait cet homme. Elle la touchait... ses mains rencontrrent la toile. Elle heurtait
les pieds du Christ.
Elle poussa un grand cri et tomba sur le dos. Sa bougie, renverse, steignit.
339
Que se passa-t-il ensuite ? Elle rva longtemps des choses tranges, effrayantes.
Toujours Georges et Suzanne passaient devant ses yeux, enlacs, avec Jsus-Christ
qui bnissait leur horrible amour.
Elle sentait vaguement quelle ntait point chez elle. Elle voulait se lever, fuir,
elle ne le pouvait pas. Une torpeur lavait envahie, qui liait ses membres et ne
lui laissait que sa pense en veil, trouble cependant, torture par des images af-
freuses, irrelles, fantastiques, perdue dans un songe malsain, le songe trange
et parfois mortel que font entrer dans les cerveaux humains les plantes endor-
meuses des pays chauds, aux formes bizarres et aux parfums pais.
Le jour venu, on ramassa Mme Walter, tendue sans connaissance, presque as-
phyxie, devant Jsus marchant sur les ots. Elle fut si malade quon craignit pour
sa vie. Elle ne reprit que le lendemain lusage complet de sa raison. Alors, elle se
mit pleurer.
La disparition de Suzanne fut explique aux domestiques par un envoi brusque
au couvent. Et M. Walter rpondit une longue lettre de Du Roy, en lui accordant
la main de sa lle.
Bel-Ami avait jet cette ptre la poste au moment de quitter Paris, car il lavait
prpare davance le soir de son dpart. Il y disait, en termes respectueux, quil ai-
mait depuis longtemps la jeune lle, que jamais aucun accord navait eu lieu entre
eux, mais que la voyant venir lui, en toute libert, pour lui dire : " Je serai votre
femme", il se jugeait autoris la garder, la cacher mme, jusqu ce quil et
obtenu une rponse des parents dont la volont lgale avait pour lui une valeur
moindre que la volont de sa ance.
Il demandait que M. Walter rpondt poste restante, un ami devant lui faire par-
venir la lettre.
Quand il eut obtenu ce quil voulait, il ramena Suzanne Paris et la renvoya
chez ses parents, sabstenant lui-mme de paratre avant quelque temps.
Ils avaient pass six jours au bord de la Seine, La Roche-Guyon.
Jamais la jeune lle ne stait tant amuse. Elle avait jou la bergre. Comme
il la faisait passer pour sa sur, ils vivaient dans une intimit libre et chaste, une
340
sorte de camaraderie amoureuse. Il jugeait habile de la respecter. Ds le lende-
main de leur arrive, elle acheta du linge et des vtements de paysanne, et elle se
mit pcher la ligne, la tte couverte dun immense chapeau de paille orn de
eurs des champs. Elle trouvait le pays dlicieux. Il y avait l une vieille tour et un
vieux chteau o lon montrait dadmirables tapisseries.
Georges, vtu dune vareuse achete toute faite chez un commerant du pays,
promenait Suzanne, soit pied, le long des berges, soit en bateau. Ils sembras-
saient tout moment, frmissants, elle innocente et lui prt succomber. Mais il
savait tre fort ; et quand il lui dit : "Nous retournerons Paris demain, votre pre
maccorde votre main", elle murmura navement : "Dj, a mamusait tant dtre
votre femme !"
341
Chapitre 18
Trois mois staient couls. Le divorce de Du Roy venait dtre prononc. Sa
femme avait repris son nom de Forestier, et comme les Walter devaient partir, le
15 juillet, pour Trouville, on dcida de passer une journe la campagne, avant de
se sparer.
On choisit un jeudi, et on se mit en route ds neuf heures du matin, dans un
grand landau de voyage six places, attel en poste quatre chevaux.
Onallait djeuner Saint-Germain, aupavillonHenri-IV. Bel-Ami avait demand
tre le seul homme de la partie, car il ne pouvait supporter la prsence et la -
gure du marquis de Cazolles. Mais, au dernier moment, il fut dcid que le comte
de Latour-Yvelin serait enlev, au saut du lit. On lavait prvenu la veille.
La voiture remonta au grand trot lavenue des Champs-lyses, puis traversa le
bois de Boulogne.
Il faisait un admirable temps dt, pas trop chaud. Les hirondelles traaient
sur le bleu du ciel de grandes lignes courbes quon croyait voir encore quand elles
taient passes.
Les trois femmes se tenaient au fond du landau, la mre entre ses deux lles ; et
les trois hommes, reculons, Walter entre les deux invits.
On traversa la Seine, on contourna le Mont-Valrien, puis on gagna Bougival,
pour longer ensuite la rivire jusquau Pecq.
Le comte de Latour-Yvelin, unhomme unpeu mr longs favoris lgers, dont le
moindre soufe dair agitaient les pointes, ce qui faisait dire Du Roy : "Il obtient
de jolis effets de vent dans sa barbe", contemplait Rose tendrement. Ils taient
ancs depuis un mois.
342
Georges, fort ple, regardait souvent Suzanne, qui tait ple aussi. Leurs yeux
se rencontraient, semblaient se concerter, se comprendre, changer secrtement
une pense, puis se fuyaient. Mme Walter tait tranquille, heureuse.
Le djeuner fut long. Avant de repartir pour Paris, Georges proposa de faire un
tour sur la terrasse.
On sarrta dabord pour examiner la vue. Tout le monde se mit en ligne le long
du mur et on sextasia sur ltendue de lhorizon. La Seine, au pied dune longue
colline, coulait vers Maisons-Laftte, comme un immense serpent couch dans la
verdure. A droite, sur le sommet de la cte, laqueduc de Marly projetait sur le ciel
son prol norme de chenille grandes pattes, et Marly disparaissait, au-dessous,
dans un pais bouquet darbres.
Par la plaine immense qui stendait en face, on voyait des villages, de place en
place. Les pices deau du Vsinet faisaient des taches nettes et propres dans la
maigre verdure de la petite fort. A gauche, tout au loin, on apercevait en lair le
clocher pointu de Sartrouville.
Walter dclara :
"On ne peut trouver nulle part au monde un semblable panorama. Il ny en a
pas un pareil en Suisse."
Puis on se mit en marche doucement pour faire une promenade et jouir un peu
de cette perspective.
Georges et Suzanne restrent en arrire. Ds quils furent carts de quelques
pas, il lui dit dune voix basse et contenue :
"Suzanne, je vous adore. Je vous aime en perdre la tte."
Elle murmura :
"Moi aussi, Bel-Ami."
Il reprit :
343
"Si je ne vous ai pas pour femme, je quitterai Paris et ce pays."
Elle rpondit :
"Essayez donc de me demander papa. Peut-tre quil voudra bien. "
Il eut un petit geste dimpatience :
"Non, je vous le rpte pour la dixime fois, cest inutile. On me fermera la porte
de votre maison; onmexpulsera dujournal ; et nous ne pourrons plus mme nous
voir. Voil le joli rsultat auquel je suis certain darriver par une demande en rgle.
On vous a promise au marquis de Cazolles. On espre que vous nirez par dire :
"Oui." Et on attend."
Elle demanda :
"Quest-ce quil faut faire alors ?"
Il hsitait, la regardant de ct :
"Maimez-vous assez pour commettre une folie ?"
Elle rpondit rsolument :
"Oui.
- Une grande folie ?
- Oui.
- La plus grande des folies ?
- Oui.
- Aurez-vous aussi assez de courage pour braver votre pre et votre mre ?
- Oui.
344
- Bien vrai ?
- Oui.
- Eh bien, il y a un moyen, un seul ! Il faut que la chose vienne de vous, et pas
de moi. Vous tes une enfant gte, on vous laisse tout dire, on ne stonnera pas
trop dune audace de plus de votre part. coutez donc. Ce soir, en rentrant, vous
irez trouver votre maman, dabord, votre maman toute seule. Et vous lui avouerez
que vous voulez mpouser. Elle aura une grosse motion et une grosse colre..."
Suzanne linterrompit :
"Oh! maman voudra bien."
Il reprit vivement :
"Non. Vous ne la connaissez pas. Elle sera plus fche et plus furieuse que votre
pre. Vous verrez comme elle refusera. Mais vous tiendrez bon, vous ne cderez
pas ; vous rpterez que vous voulez mpouser, moi, seul, rien que moi. Le ferez-
vous ?
- Je le ferai.
- Et en sortant de chez votre mre, vous direz la mme chose votre pre, dun
air trs srieux et trs dcid.
- Oui, oui. Et puis ?
- Et puis, cest l que a devient grave. Si vous tes rsolue, bien rsolue, bien,
bien, bien rsolue tre ma femme, ma chre, chre petite Suzanne... Je vous... je
vous enlverai !"
Elle eut une grande secousse de joie et faillit battre des mains.
"Oh! quel bonheur ! vous menlverez ? Quand a menlverez-vous ?"
Toute la vieille posie des enlvements nocturnes, des chaises de poste, des au-
berges, toutes les charmantes aventures des livres lui passrent dun coup dans
lesprit comme un songe enchanteur prt se raliser.
345
Elle rpta :
"Quand a menlverez-vous ?"
Il rpondit trs bas :
"Mais... ce soir... cette nuit."
Elle demanda, frmissante :
"Et o irons-nous ?
- a, cest mon secret. Rchissez ce que vous faites. Songez bien quaprs
cette fuite vous ne pourrez plus tre que ma femme ! Cest le seul moyen, mais il
est... il est trs dangereux... pour vous."
Elle dclara :
"Je suis dcide... o vous retrouverai-je ?
- Vous pourrez sortir de lhtel, toute seule ?
- Oui. Je sais ouvrir la petite porte.
- Eh bien, quand le concierge sera couch, vers minuit, venez me rejoindre
place de la Concorde. Vous me trouverez dans unacre arrt enface du ministre
de la Marine.
- Jirai.
- Bien vrai ?
- Bien vrai."
Il lui prit la main et la serra :
"Oh! que je vous aime ! Comme vous tes bonne et brave ! Alors, vous ne voulez
pas pouser M. de Cazolles ?
346
- Oh! non.
- Votre pre sest beaucoup fch quand vous avez dit non?
- Je crois bien, il voulait me remettre au couvent.
- Vous voyez quil est ncessaire dtre nergique.
- Je le serai."
Elle regardait le vaste horizon, la tte pleine de cette ide denlvement. Elle irait
plus loin que l-bas... avec lui !... Elle serait enleve !... Elle tait re de a ! Elle ne
songeait gure sa rputation, ce qui pouvait lui arriver dinfme. Le savait-elle,
mme ? Le souponnait-elle ?
Mme Walter, se retournant, cria :
"Mais viens donc, petite. Quest-ce que tu fais avec Bel-Ami ?"
Ils rejoignirent les autres. On parlait des bains de mer o on serait bientt.
Puis on revint par Chatou pour ne pas refaire la mme route.
George ne disait plus rien. Il songeait : Donc, si cette petite avait un peu dau-
dace, il allait russir, enn! Depuis trois mois, il lenveloppait dans lirrsistible
let de sa tendresse. Il la sduisait, la captivait, la conqurait. Il stait fait aimer
par elle, comme il savait se faire aimer. Il avait cueilli sans peine son me lgre de
poupe.
Il avait obtenu dabord quelle refust M. de Cazolles. Il venait dobtenir quelle
senfut avec lui. Car il ny avait pas dautre moyen.
Mme Walter, il le comprenait bien, ne consentirait jamais lui donner sa lle.
Elle laimait encore, elle laimerait toujours, avec une violence intraitable. Il la
contenait par sa froideur calcule, mais il la sentait ronge par une passion im-
puissante et vorace. Jamais il ne pourrait la chir. Jamais elle nadmettrait quil
prt Suzanne.
347
Mais une fois quil tiendrait la petite au loin, il traiterait de puissance puis-
sance, avec le pre.
Pensant tout cela, il rpondait par phrases haches aux choses quon lui disait
et quil ncoutait gure. Il parut revenir lui lorsquil rentra dans Paris.
Suzanne aussi songeait ; et le grelot des quatre chevaux sonnait dans sa tte,
lui faisait voir des grandes routes innies sous des clairs de lune ternels, des fo-
rts sombres traverses, des auberges au bord du chemin, et la hte des hommes
dcurie changer lattelage, car tout le monde devine quils sont poursuivis.
Quand le landau fut arriv dans la cour de lhtel, on voulut retenir Georges
dner. Il refusa et revint chez lui.
Aprs avoir un peu mang, il mit de lordre dans ses papiers comme sil allait
faire un grand voyage. Il brla des lettres compromettantes, en cacha dautres,
crivit quelques amis.
De temps en temps il regardait la pendule, en pensant : "a doit chauffer l-
bas." Et une inquitude le mordait au cur. Sil allait chouer ? Mais que pouvait-
il craindre ? Il se tirerait toujours daffaire ! Pourtant ctait une grosse partie quil
jouait, ce soir-l !
Il ressortit vers onze heures, erra quelque temps, prit un acre et se t arrter
place de la Concorde, le long des arcades du ministre de la Marine.
De temps entemps il enammait une allumette pour regarder lheure sa montre.
Quand il vit approcher minuit, son impatience devint vreuse. A tout moment il
passait la tte la portire pour regarder.
Une horloge lointaine sonna douze coups, puis une autre plus prs, puis deux
ensemble, puis une dernire trs loin. Quand celle-l eut cess de tinter, il pensa :
"Cest ni. Cest rat. Elle ne viendra pas."
Il tait cependant rsolu demeurer jusquau jour.
Dans ces cas-l il faut tre patient.
348
Il entendit encore sonner le quart, puis la demie, puis les trois quarts ; et toutes
les horloges rptrent une heure comme elles avaient annonc minuit. Il natten-
dait plus, il restait, creusant sa pense pour deviner ce qui avait pu arriver. Tout
coup une tte de femme passa par la portire et demanda :
"tes-vous l, Bel-Ami ?"
Il eut un sursaut et une suffocation.
"Cest vous, Suzanne ?
- Oui, cest moi."
Il ne parvenait point tourner la poigne assez vite, et rptait :
"Ah!... cest vous... cest vous... entrez."
Elle entra et se laissa tomber contre lui. Il cria au cocher : "Allez !" Et le acre se
mit en route.
Elle haletait, sans parler.
Il demanda :
"Eh bien, comment a sest-il pass ?"
Alors elle murmura, presque dfaillante :
"Oh! a a t terrible, chez maman surtout."
Il tait inquiet et frmissant.
"Votre maman? Quest-ce quelle a dit ? Contez-moi a.
349
- Oh! a a t affreux. Je suis entre chez elle et je lui ai rcit ma petite affaire
que javais bien prpare. Alors elle a pli, puis elle a cri : "Jamais ! jamais !" Moi,
jai pleur, je me suis fche, jai jur que je npouserais que vous. Jai cru quelle
allait me battre. Elle est devenue comme folle ; elle a dclar quon me renverrait
au couvent, ds le lendemain. Je ne lavais jamais vue comme a, jamais ! Alors
papa est arriv en lentendant dbiter toutes ses sottises. Il ne sest pas fch tant
quelle, mais il a dclar que vous ntiez pas un assez beau parti.
"Comme ils mavaient mise en colre aussi, jai cri plus fort queux. Et papa
ma dit de sortir avec un air dramatique qui ne lui allait pas du tout. Cest ce qui
ma dcide me sauver avec vous. Me voil, o allons-nous ?"
Il avait enlac sa taille doucement ; et il coutait de toutes ses oreilles, le cur
battant, une rancune haineuse sveillant en lui contre ces gens. Mais il la tenait,
leur lle. Ils verraient, prsent.
Il rpondit :
"Il est trop tard pour prendre le train; cette voiture-l va donc nous conduire
Svres onous passerons la nuit. Et demainnous partirons pour La Roche-Guyon.
Cest un joli village, au bord de la Seine, entre Mantes et Bonnires."
Elle murmura :
"Cest que je nai pas deffets. Je nai rien."
Il sourit, avec insouciance :
"Bah! nous nous arrangerons l-bas."
Le acre roulait le long des rues. Georges prit une main de la jeune lle et se
mit la baiser, lentement, avec respect. Il ne savait que lui raconter, ntant gure
accoutum aux tendresses platoniques. Mais soudain il crut sapercevoir quelle
pleurait.
Il demanda, avec terreur :
"Quest-ce que vous avez, ma chre petite ?"
350
Elle rpondit, dune voix toute mouille :
"Cest ma pauvre maman qui ne doit pas dormir cette heure, si elle sest aper-
ue de mon dpart."
Sa mre, en effet, ne dormait pas.
Aussitt Suzanne sortie de sa chambre, Mme Walter tait reste en face de son
mari.
Elle demanda, perdue, atterre :
"Mon Dieu! Quest-ce que cela veut dire ?"
Walter cria, furieux :
"a veut dire que cet intrigant la enjle. Cest lui qui a fait refuser Cazolles. Il
trouve la dot bonne, parbleu!"
Il se mit marcher avec rage travers lappartement et reprit :
"Tu lattirais sans cesse, aussi, toi, tu le attais, tu le cajolais, tu navais pas assez
de chatteries pour lui.
Ctait Bel-Ami par-ci, Bel-Ami par-l, du matin au soir. Te voil paye."
Elle murmura, livide :
"Moi ?... je lattirais !"
Il lui vocifra dans le nez :
"Oui, toi ! Vous tes toutes folles de lui, la Marelle, Suzanne et les autres. Crois-
tu que je ne voyais pas que tu ne pouvais point rester deux jours sans le faire venir
ici ?"
Elle se dressa, tragique :
351
"Je ne vous permettrai pas de me parler ainsi. Vous oubliez que je nai pas t
leve, comme vous, dans une boutique."
Il demeura dabord immobile et stupfait, puis il lcha un "Nom de Dieu" furi-
bond, et il sortit en tapant la porte.
Ds quelle fut seule, elle alla, par instinct, vers la glace pour se regarder, comme
pour voir si rien ntait chang en elle, tant ce qui arrivait lui paraissait impossible,
monstrueux. Suzanne tait amoureuse de Bel-Ami ! et Bel-Ami voulait pouser Su-
zanne ! Non! elle stait trompe, ce ntait pas vrai. La llette avait euune toquade
bien naturelle pour ce beau garon, elle avait espr quon le lui donnerait pour
mari ; elle avait fait son petit coup de tte ! Mais lui ? lui ne pouvait pas tre com-
plice de a ! Elle rchissait, trouble comme on lest devant les grandes catas-
trophes. Non, Bel-Ami ne devait rien savoir de lescapade de Suzanne.
Et elle songea longtemps la perdie et linnocence possibles de cet homme.
Quel misrable, sil avait prpar le coup! Et quarriverait-il ? Que de dangers et de
tourments elle prvoyait !
Sil ne savait rien, tout pouvait sarranger encore. On ferait un voyage avec Su-
zanne pendant six mois, et ce serait ni. Mais comment pourrait-elle le revoir, elle,
ensuite ? Car elle laimait toujours. Cette passion tait entre en elle la faon de
ces pointes de che quon ne peut plus arracher.
Vivre sans lui tait impossible. Autant mourir. Sa pense sgarait dans ces an-
goisses et dans ces incertitudes. Une douleur commenait poindre dans sa tte ;
ses ides devenaient pnibles, troubles, lui faisaient mal. Elle snervait cher-
cher, sexasprait de ne pas savoir. Elle regarda sa pendule, il tait une heure pas-
se. Elle se dit : "Je ne veux pas rester ainsi, je deviens folle. Il faut que je sache. Je
vais rveiller Suzanne pour linterroger."
Et elle sen alla, dchausse, pour ne pas faire de bruit, une bougie la main,
vers la chambre de sa lle. Elle louvrit bien doucement, entra, regarda le lit. Il
ntait pas dfait. Elle ne comprit point dabord, et pensa que la llette discutait
encore avec son pre. Mais aussitt un soupon horrible lefeura et elle courut
chez son mari. Elle y arriva dun lan; blme et haletante. Il tait couch et lisait
encore.
Il demanda effar :
352
"Eh bien! quoi ? Quest-ce que tu as ?"
Elle balbutiait :
"As-tu vu Suzanne ?
- Moi ? Non. Pourquoi ?
- Elle est... elle est... partie. Elle nest pas dans sa chambre."
Il sauta dun bond sur le tapis, chaussa ses pantoues et, sans caleon, la che-
mise au vent, il se prcipita son tour vers lappartement de sa lle.
Ds quil leut vu, il ne conserva point de doute. Elle stait enfuie.
Il tomba sur un fauteuil et posa sa lampe par terre devant lui.
Sa femme lavait rejoint. Elle bgaya :
"Eh bien?"
Il navait plus la force de rpondre ; il navait plus de colre, il gmit :
"Cest fait, il la tient. Nous sommes perdus."
Elle ne comprenait pas :
"Comment perdus ?
- Eh! oui, parbleu. Il faut bien quil lpouse maintenant."
Elle poussa une sorte de cri de bte :
"Lui ! jamais ! Tu es donc fou?"
Il rpondit tristement :
353
"a ne sert rien de hurler. Il la enleve, il la dshonore. Le mieux est encore
de la lui donner. En sy prenant bien, personne ne saura cette aventure."
Elle rpta, secoue dune motion terrible :
"Jamais ! jamais il naura Suzanne ! Jamais je ne consentirai !"
Walter murmura avec accablement :
"Mais il la. Cest fait. Et il la gardera et la cachera tant que nous naurons point
cd. Donc, pour viter le scandale, il faut cder tout de suite."
Sa femme, dchire par une inavouable douleur, rpta :
"Non! non. Jamais je ne consentirai !"
Il reprit, simpatientant :
"Mais il ny a pas discuter. Il le faut. Ah! le gredin, comme il nous a jous... Il
est fort tout de mme. Nous aurions pu trouver beaucoup mieux comme position,
mais pas comme intelligence et comme avenir. Cest un homme davenir. Il sera
dput et ministre."
Mme Walter dclara, avec une nergie farouche :
"Jamais je ne lui laisserai pouser Suzanne... Tu entends... jamais ! "
Il nit par se fcher et par prendre, en homme pratique, la dfense de Bel-Ami.
"Mais, tais-toi donc... Je te rpte quil le faut... quil le faut absolument. Et qui
sait ? Peut-tre ne le regretterons-nous pas. Avec les tres de cette trempe l, on
ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu as vu comme il a jet bas, en trois articles, ce
niais de Laroche-Mathieu, et comme il la fait avec dignit, ce qui tait rudement
difcile dans sa situation de mari. Enn nous verrons. Toujours est-il que nous
sommes pris. Nous ne pouvons plus nous tirer de l."
Elle avait envie de crier, de se rouler par terre, de sarracher les cheveux. Elle
pronona encore, dune voix exaspre :
354
"II ne laura pas... Je... ne... veux... pas !"
Walter se leva, ramassa sa lampe, reprit :
"Tiens, tu es stupide comme toutes les femmes. Vous nagissez jamais que par
passion. Vous ne savez pas vous plier aux circonstances... vous tes stupides ! Moi,
je te dis quil lpousera... Il le faut."
Et il sortit en tranant ses pantoues. Il traversa, fantme comique en chemise
de nuit, le large corridor du vaste htel endormi, et rentra, sans bruit, dans sa
chambre.
Mme Walter restait debout, dchire par une intolrable douleur. Elle ne com-
prenait pas encore bien, dailleurs. Elle souffrait seulement. Puis il lui sembla quelle
ne pourrait pas demeurer l, immobile, jusquau jour. Elle sentait en elle un be-
soin violent de se sauver, de courir devant elle, de sen aller, de chercher de laide,
dtre secourue.
Elle cherchait qui elle pourrait bien appeler elle. Quel homme ! Elle nen trou-
vait pas ! Un prtre ! oui, un prtre ! Elle se jetterait ses pieds, lui avouerait tout,
lui confesserait sa faute et son dsespoir. Il comprendrait, lui, que ce misrable ne
pouvait pas pouser Suzanne et il empcherait cela.
Il lui fallait un prtre tout de suite ! Mais o le trouver ? O aller ? Pourtant elle
ne pouvait rester ainsi.
Alors passa devant ses yeux, ainsi quune vision, limage sereine de Jsus mar-
chant sur les ots. Elle le vit comme elle le voyait en regardant le tableau. Donc il
lappelait. Il lui disait : "Venez moi. Venez vous agenouiller mes pieds. Je vous
consolerai et je vous inspirerai ce quil faut faire."
Elle prit sa bougie, sortit, et descendit pour gagner la serre. Le Jsus tait tout au
bout, dans un petit salon quon fermait par une porte vitre an que lhumidit
des terres ne dtriort point la toile.
Cela faisait une sorte de chapelle dans une fort darbres singuliers.
355
Quand Mme Walter entra dans le jardin dhiver, ne layant jamais vu que plein
de lumire, elle demeura saisie devant sa profondeur obscure. Les lourdes plantes
des pays chauds paississaient latmosphre de leur haleine pesante. Et les portes
ntant plus ouvertes, lair de ce bois trange, enferm sous un dme de verre, en-
trait dans la poitrine avec peine, tourdissait, grisait, faisait plaisir et mal, donnait
la chair une sensation confuse de volupt nervante et de mort.
La pauvre femme marchait doucement, mue par les tnbres o apparais-
saient, la lueur errante de sa bougie, des plantes extravagantes, avec des aspects
de monstres, des apparences dtres, des difformits bizarres.
Tout dun coup, elle aperut le Christ. Elle ouvrit la porte qui le sparait delle,
et tomba sur les genoux.
Elle le pria dabord perdument, balbutiant des mots damour, des invocations
passionnes et dsespres. Puis, lardeur de son appel se calmant, elle leva les
yeux vers lui, et demeura saisie dangoisse. Il ressemblait tellement Bel-Ami,
la clart tremblante de cette seule lumire lclairant peine et den bas, que ce
ntait plus Dieu, ctait son amant qui la regardait. Ctaient ses yeux, son front,
lexpression de son visage, son air froid et hautain!
Elle balbutiait : "Jsus ! - Jsus ! - Jsus !" Et le mot "Georges" lui venait aux
lvres. Tout coup, elle pensa qu cette heure mme, Georges, peut-tre, pos-
sdait sa lle. Il tait seul avec elle, quelque part, dans une chambre. Lui ! lui ! avec
Suzanne !
Elle rptait : "Jsus !... Jsus !" Mais elle pensait eux... sa lle et son amant !
Ils taient seuls, dans une chambre... et ctait la nuit. Elle les voyait. Elle les voyait
si nettement quils se dressaient devant elle, la place du tableau. Ils se souriaient.
Ils sembrassaient. La chambre tait sombre, le lit entrouvert. Elle se souleva pour
aller vers eux, pour prendre sa lle par les cheveux et larracher cette treinte.
Elle allait la saisir la gorge, ltrangler, sa lle quelle hassait, sa lle qui se don-
nait cet homme. Elle la touchait... ses mains rencontrrent la toile. Elle heurtait
les pieds du Christ.
Elle poussa un grand cri et tomba sur le dos. Sa bougie, renverse, steignit.
356
Que se passa-t-il ensuite ? Elle rva longtemps des choses tranges, effrayantes.
Toujours Georges et Suzanne passaient devant ses yeux, enlacs, avec Jsus-Christ
qui bnissait leur horrible amour.
Elle sentait vaguement quelle ntait point chez elle. Elle voulait se lever, fuir,
elle ne le pouvait pas. Une torpeur lavait envahie, qui liait ses membres et ne
lui laissait que sa pense en veil, trouble cependant, torture par des images af-
freuses, irrelles, fantastiques, perdue dans un songe malsain, le songe trange
et parfois mortel que font entrer dans les cerveaux humains les plantes endor-
meuses des pays chauds, aux formes bizarres et aux parfums pais.
Le jour venu, on ramassa Mme Walter, tendue sans connaissance, presque as-
phyxie, devant Jsus marchant sur les ots. Elle fut si malade quon craignit pour
sa vie. Elle ne reprit que le lendemain lusage complet de sa raison. Alors, elle se
mit pleurer.
La disparition de Suzanne fut explique aux domestiques par un envoi brusque
au couvent. Et M. Walter rpondit une longue lettre de Du Roy, en lui accordant
la main de sa lle.
Bel-Ami avait jet cette ptre la poste au moment de quitter Paris, car il lavait
prpare davance le soir de son dpart. Il y disait, en termes respectueux, quil ai-
mait depuis longtemps la jeune lle, que jamais aucun accord navait eu lieu entre
eux, mais que la voyant venir lui, en toute libert, pour lui dire : " Je serai votre
femme", il se jugeait autoris la garder, la cacher mme, jusqu ce quil et
obtenu une rponse des parents dont la volont lgale avait pour lui une valeur
moindre que la volont de sa ance.
Il demandait que M. Walter rpondt poste restante, un ami devant lui faire par-
venir la lettre.
Quand il eut obtenu ce quil voulait, il ramena Suzanne Paris et la renvoya
chez ses parents, sabstenant lui-mme de paratre avant quelque temps.
Ils avaient pass six jours au bord de la Seine, La Roche-Guyon.
Jamais la jeune lle ne stait tant amuse. Elle avait jou la bergre. Comme
il la faisait passer pour sa sur, ils vivaient dans une intimit libre et chaste, une
357
sorte de camaraderie amoureuse. Il jugeait habile de la respecter. Ds le lende-
main de leur arrive, elle acheta du linge et des vtements de paysanne, et elle se
mit pcher la ligne, la tte couverte dun immense chapeau de paille orn de
eurs des champs. Elle trouvait le pays dlicieux. Il y avait l une vieille tour et un
vieux chteau o lon montrait dadmirables tapisseries.
Georges, vtu dune vareuse achete toute faite chez un commerant du pays,
promenait Suzanne, soit pied, le long des berges, soit en bateau. Ils sembras-
saient tout moment, frmissants, elle innocente et lui prt succomber. Mais il
savait tre fort ; et quand il lui dit : "Nous retournerons Paris demain, votre pre
maccorde votre main", elle murmura navement : "Dj, a mamusait tant dtre
votre femme !"
358
Vous aimerez peut-être aussi
- Rituel D Evocation Des 72 Anges-Genies de Mercure (A) PDFDocument52 pagesRituel D Evocation Des 72 Anges-Genies de Mercure (A) PDFLudovic Ouedraogo56% (9)
- Textes Et Cours OuvriersDocument3 pagesTextes Et Cours OuvriersMax FournierPas encore d'évaluation
- Des Femmes Qui Tombent - Pierre DesprogesDocument111 pagesDes Femmes Qui Tombent - Pierre DesprogesextravolPas encore d'évaluation
- Rapport UML PDFDocument70 pagesRapport UML PDFSAWADOGO IbrahimPas encore d'évaluation
- Bel-Ami: un roman réaliste de Guy de Maupassant publié sous forme de feuilleton dans le quotidien Gil Blas en 1885D'EverandBel-Ami: un roman réaliste de Guy de Maupassant publié sous forme de feuilleton dans le quotidien Gil Blas en 1885Pas encore d'évaluation
- Guy de Maupassant - Bel AmiDocument293 pagesGuy de Maupassant - Bel Amitgoreci100% (2)
- Bel-Ami by Guy de MaupassantDocument13 pagesBel-Ami by Guy de MaupassantAlexander Vassiliev100% (1)
- Incipit Bel AmiDocument1 pageIncipit Bel Amileilagheraby2007Pas encore d'évaluation
- Maupassant Contes de La BecasseDocument150 pagesMaupassant Contes de La BecassemuzettoPas encore d'évaluation
- Le Coup de pouce: Un roman policier inspiré du conflit entre la France et la PrusseD'EverandLe Coup de pouce: Un roman policier inspiré du conflit entre la France et la PrussePas encore d'évaluation
- Oeuvres posthumes: Tome II - Les dimanches d'un bourgeois de Paris - La vie d'un paysagiste - Etude sur Gustave Flaubert - L'âme étrangère - L'angélusD'EverandOeuvres posthumes: Tome II - Les dimanches d'un bourgeois de Paris - La vie d'un paysagiste - Etude sur Gustave Flaubert - L'âme étrangère - L'angélusPas encore d'évaluation
- Croisiere Dans Le TempsDocument122 pagesCroisiere Dans Le TempsRenè CamusPas encore d'évaluation
- Zola Emile - L ArgentDocument394 pagesZola Emile - L ArgentDiderot NahPas encore d'évaluation
- Philippe-Monsieur: Roman historique (Les événements de l'année 1462)D'EverandPhilippe-Monsieur: Roman historique (Les événements de l'année 1462)Pas encore d'évaluation
- La Peau de Cesar - Rene BarjavelDocument177 pagesLa Peau de Cesar - Rene BarjavelYvesPas encore d'évaluation
- FRB340325101 Ag1 076Document4 pagesFRB340325101 Ag1 076Occitanica Médiathèque Numérique OccitanePas encore d'évaluation
- SEANCE 4 Bel AmiDocument2 pagesSEANCE 4 Bel AmiFabianPas encore d'évaluation
- Lou Gal. - Nouvembre 1919 - N°101 (Cinquièma Annada)Document4 pagesLou Gal. - Nouvembre 1919 - N°101 (Cinquièma Annada)Occitanica Médiathèque Numérique Occitane100% (1)
- La Maison TellierDocument24 pagesLa Maison TellierDream “The Studio Vicma” LabelPas encore d'évaluation
- Dévoir ROMANDocument2 pagesDévoir ROMANHalima HasnaPas encore d'évaluation
- En Famille MaupassantDocument20 pagesEn Famille Maupassantmariana5184Pas encore d'évaluation
- Traduceri FR BunDocument36 pagesTraduceri FR Bunandrei madaPas encore d'évaluation
- Les Coquillages de M. Chabre - Émile ZolaDocument16 pagesLes Coquillages de M. Chabre - Émile ZolaLuxPas encore d'évaluation
- 2BAC - Cours de Français - IRHOUNAIN AISSAMDocument8 pages2BAC - Cours de Français - IRHOUNAIN AISSAMHAKIM SAADIPas encore d'évaluation
- Leblanc-La Cagliostro Se VengeDocument292 pagesLeblanc-La Cagliostro Se VengeDenis BogdanPas encore d'évaluation
- La FicelleDocument7 pagesLa Ficelleplanzone planzonePas encore d'évaluation
- Balzac-L Auberge RougeDocument31 pagesBalzac-L Auberge Rougefelicefiorito2Pas encore d'évaluation
- Gaboriau Emile - L Argent Des Autres IDocument289 pagesGaboriau Emile - L Argent Des Autres IinyasPas encore d'évaluation
- Une Vie by Maupassant, Guy De, 1850-1893Document191 pagesUne Vie by Maupassant, Guy De, 1850-1893Gutenberg.orgPas encore d'évaluation
- Reclams de Biarn e Gascougne. - Anade 49, N°10-12 (Octoubre-Mes Mourt 1945)Document36 pagesReclams de Biarn e Gascougne. - Anade 49, N°10-12 (Octoubre-Mes Mourt 1945)Occitanica Médiathèque Numérique OccitanePas encore d'évaluation
- Dumas - Le Vicomte de Bragelonne-242Document1 866 pagesDumas - Le Vicomte de Bragelonne-242DabaPas encore d'évaluation
- Stan Le Tueur by Simenon, GeorgesDocument25 pagesStan Le Tueur by Simenon, GeorgesErwan KetchaPas encore d'évaluation
- Jekyll HydeDocument69 pagesJekyll HydeJean FrancisPas encore d'évaluation
- Fort Comme La Mort by Maupassant, Guy De, 1850-1893Document154 pagesFort Comme La Mort by Maupassant, Guy De, 1850-1893Gutenberg.org100% (1)
- Lou Gal - N°31 Du 1er Octobre 1916 (2ème Année)Document4 pagesLou Gal - N°31 Du 1er Octobre 1916 (2ème Année)Occitanica Médiathèque Numérique OccitanePas encore d'évaluation
- Declaration Cession VehiculeDocument3 pagesDeclaration Cession VehiculeTaher GarbaaPas encore d'évaluation
- M.T 116 01Document71 pagesM.T 116 01Tul IpePas encore d'évaluation
- DECRET #74-704 DU 1ER AOUT 1974 Portant Réglementation Utilisation Vehicules AdmtifDocument7 pagesDECRET #74-704 DU 1ER AOUT 1974 Portant Réglementation Utilisation Vehicules AdmtifTCHADEU TCHOKOTE MARIANEPas encore d'évaluation
- Haccp AbcdefghDocument75 pagesHaccp AbcdefghHermann A. TONHONPas encore d'évaluation
- 3 Methodologie DirecteDocument2 pages3 Methodologie DirecteAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation
- Fiche Entretien 8F5A - PSADDocument2 pagesFiche Entretien 8F5A - PSADpatpat83Pas encore d'évaluation
- 50 Defis MathsDocument77 pages50 Defis MathsrnouaillesPas encore d'évaluation
- Sur Une Tempête D'aimé Césaire: Thomas A. HaleDocument15 pagesSur Une Tempête D'aimé Césaire: Thomas A. HaleArron EyaPas encore d'évaluation
- Poncelet Greta Abbassi Léa Dossier AnalyseDocument17 pagesPoncelet Greta Abbassi Léa Dossier AnalyseSarah Ben SlimaPas encore d'évaluation
- 2-3 Gestion D'approvisionnementDocument25 pages2-3 Gestion D'approvisionnementIbtihal AmraouiPas encore d'évaluation
- Intelligence Artificielle - TD 2: Lgorithmes de Recherche enDocument2 pagesIntelligence Artificielle - TD 2: Lgorithmes de Recherche enmmorad aamraouyPas encore d'évaluation
- Le FOS: Une Évaluation Des Ressources Pédagogiques en LigneDocument13 pagesLe FOS: Une Évaluation Des Ressources Pédagogiques en LigneCarlos ValcárcelPas encore d'évaluation
- TD Melanges 2020 LSLL - Wahab DiopDocument2 pagesTD Melanges 2020 LSLL - Wahab DiopBilel BelhajamorPas encore d'évaluation
- Livret de Formation Tuyaux en EcheveauxDocument24 pagesLivret de Formation Tuyaux en EcheveauxAlain DrtPas encore d'évaluation
- Domingo I Chaya (SATB A Peralta Ar. Ruben UrbiztondoDocument8 pagesDomingo I Chaya (SATB A Peralta Ar. Ruben UrbiztondoclaudiovcvPas encore d'évaluation
- 53-Article Text-202-1-10-20200807Document17 pages53-Article Text-202-1-10-20200807abdelli onsPas encore d'évaluation
- Une Ecole Pour Enfants Aveugles de Boulsa 2010Document7 pagesUne Ecole Pour Enfants Aveugles de Boulsa 2010Mahroug AissaPas encore d'évaluation
- Corrige Boitier PharmaDocument5 pagesCorrige Boitier PharmaFelix DelattrePas encore d'évaluation
- Ndivin PDFDocument406 pagesNdivin PDFDorismond EdelynPas encore d'évaluation
- M472 PDFDocument51 pagesM472 PDFSeba AkonoPas encore d'évaluation
- Conduite F15 AlgérieDocument111 pagesConduite F15 Algériekarim abdelkadirPas encore d'évaluation
- CelebrityDocument24 pagesCelebrityAbdelbadia BouhallaPas encore d'évaluation
- DELF A1 Past Papers PDF With AnswersDocument10 pagesDELF A1 Past Papers PDF With AnswersLucie PassadorouPas encore d'évaluation
- Mathematics Applications and Interpretation Paper 1 TZ1 SL MarkschemeDocument14 pagesMathematics Applications and Interpretation Paper 1 TZ1 SL MarkschemeIsmaila MbodjPas encore d'évaluation
- Corrigé EXBLANC 3 01 2019-1Document28 pagesCorrigé EXBLANC 3 01 2019-1Anass AkrimPas encore d'évaluation
- Aphasie PonttDocument316 pagesAphasie PonttSandra Moiteiro Lopes100% (1)
- Plaquette Habilec 6 InitialDocument2 pagesPlaquette Habilec 6 InitialTantely RazafimahatratraPas encore d'évaluation
- Le Dessin RéussiDocument22 pagesLe Dessin RéussiBoubacar Sidiky SangaréPas encore d'évaluation