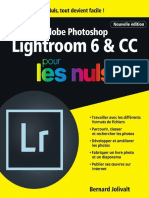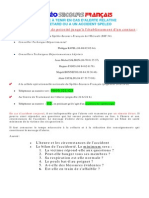Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Vétrans de Chemtou
Les Vétrans de Chemtou
Transféré par
Zaher Kammoun NaturalisteTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Vétrans de Chemtou
Les Vétrans de Chemtou
Transféré par
Zaher Kammoun NaturalisteDroits d'auteur :
Formats disponibles
Jean-Marie Lassre
Les vtrans de Chemtou (Tunisie)
In: Antiquits africaines, 33,1997. pp. 115-118.
Rsum L'inscription CIL, VIII, 14608, de Chemtou (Tunisie), dont l'interprtation a t trs discute, pourrait recevoir un nouvel clairage de la comparaison avec quelques autres documents, dont un ostracon de Bou Njem (Libye). Abstract The epigraph CIL, VIII, 14608, from Chemtou (Tunisia), whose interpretation has been widely disputed, might be considered in another light if compared with some other inscriptions, especially an ostracon from Bou Njem (Libya).
Citer ce document / Cite this document : Lassre Jean-Marie. Les vtrans de Chemtou (Tunisie). In: Antiquits africaines, 33,1997. pp. 115-118. doi : 10.3406/antaf.1997.1271 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/antaf_0066-4871_1997_num_33_1_1271
Les vtrans
de
Chemtou (Tunisie)
Jean-Marie Lassre'
Mots-clefs : inscription, Chemtou, Tunisie, Bou Njem, Libye. Key words : epigraph, Chemtou, Tunisia, Bou Njem, Libya. Rsum L'inscription CIL, VLll, 14608, de Chemtou (Tunisie), dont l'interprtation a t trs discute, pourrait recevoir un nouv elclairage de la comparaison avec quelques autres documents, dont un ostracon de Bou Njem (Libye). Abstract : The epigraph CIL, VLLL, 14608, from Chemtou (Tunisia), whose interpretation has been widely disputed, might be consi dered in another light if compared with some other inscriptions, especially an ostracon from Bou Njem (Libya). :
Un peu avant 1980, les Antiquits africaines, dont Georges Souville dirigeait le comit de rdaction, accept aient de publier dans leur tome 16, ddi Jean Lassus, une tude que j'avais consacre au peuplement de la colonie de Simitthus. peu prs vingt ans plus tard, c'est Georges Souville lui-mme que les africanistes ont cur d'honorer. Comme entre temps notre connais sance de Chemtou a progress, en particulier grce aux efforts de notre collgue tunisien M. Khanoussi, je vou drais revenir sur un point de cette tude. Que G. Souville y voie l'expression d'une amiti qui remonte un demi-sicle. Une inscription importante retrouve Chemtou au dbut de ce sicle fait connatre l'existence d'un groupe de vtrans qui ont assur la pose de la pierre tombale de L. Silicius Optatus, surpris en chemin par la mort , * Professeur l'Universit III de Montpellier, responsable du Groupe de Recherches sur l'Afrique antique. 1. CIL, VIII, 14608 = ILS, 2470 = Ben Abdallah Z., ILBardo, 1986, n 249 (photographie) Lfucius) Silicius Optai tus uix(it) an(nis) L, [i]nterceptus initinere. Huic ueteranli] morantfesj Simittu [de] suo fecer(unt). Il s'agit d'une stle calcaire brise en haut (hauteur subsis tante 0,95 m; largeur 0,44 m); l'inscription est grave dans une cuvett e, en lettres de 4,2 2 cm ; elle est surmonte de la reprsentation mal adroite d'un homme de face, vtu sans doute d'une toge, dont le buste et la tte manquent ; il est debout entre deux colonnes. On ne sait si la stle tait carre, arrondie ou pointue, ni si les colonnes supportaient un fronton orn de quelque symbole, voire de l'invocation aux Mnes. Les lettres, assez rgulires, sont toutefois un peu gauches. L'S aux boucles inharmonieuses est nettement inclin vers la droite. Il se pourrait qu' I : I I I : : Antiquits africaines, t. 33, 1997, p. 115-118
sans doute non loin de la cit. Il avait cinquante ans selon son pitaphe, qui n'est pas consacre aux Mnes et qui est dpourvue des formules d'adieu courantes {sit Ubi terra leuis, ossa tua bene quiescant). On ne trouve la fin du texte que la mention collective des ddicants, qui ont eux-mmes pay le monument l. Dans les pitaphes de l'Afrique Proconsulaire la conscration aux Mnes n'apparat gure avant la fin du Ier sicle p.C, ou du moins l'poque flavienne. Si ce te rminus ante quem peut tre admis pour notre inscrip tion, on est embarrass pour rechercher l'autre date limite. La solution (s'il en est une) passe par l'identifica tion des vtrans qui sont les ddicants du tombeau de Silicius Optatus. Ils se disent eux-mmes ueterani morantes Simittu. Cette formule, qui n'avait suscit aucun commentaire de l'poque de la mort de Silicius Optatus on n'ait pas eu de bon graveur Simitthus. On sait que les vtrans peuvent depuis Auguste fonder des collges (RE, IX, 2, 1962, col. l608-l609; Le Bohec Y., L'arme romaine, 1989, p. 204-205). Mais le texte prcise que ce sont les vtrans, et non un ventuel collge, qui ont pay la spulture de suo situation normale car, bien que dpourvu de famille d'aprs son pitaphe, Silicius Optatus n'est certainement pas un ancien militaire (le texte funraire ne l'aurait pas omis). Il est probable que, civil, il entretenait des rapports amicaux avec le groupe de vtrans qui lui ont rendu les derniers devoirs. Je signalerai pourtant l'impression que ce texte a laisse notre ami commun G. Devallet, Professeur de latin la dernire phrase pouvait fort bien se comprendre sans huic; l'ajout de ce dmonstratif parat la marque d'un lien qui pourrait tre corporatif. : CNRS DITIONS, Paris, 1998 :
116 Cagnat au CIL, ou de Dessau aux ILS, a cependant intr igu juste titre divers savants, dont le premier fut Pallu de Lessert, qui crivait non sans prudence que la fo rmule ueterani morantes voquait moins l'ide d'une colonie militaire que celle d'une ville o les anciens sol dats forment simplement un groupe part 2. Sans forti fier son opinion par une tude linguistique, Pallu de Lessert hsitait donc tablir un lien entre ce groupe de vtrans anonymes du Ier sicle 3 et la colonia Iulia Augusta Numidica Simitthus. Dans mon tude de 1980, j'avais risqu l'hypothse sans qu'on le puisse affi rmer, Simitthus devint colonie sous Auguste quand le nouvel empereur rsolut d'acclrer la romanisation d'une ville aux ressources importantes par l'installation d'un groupe de vtrans qui pourraient en outre veiller sur sa scurit 4. Cette interprtation fut aussi celle de C. Lepelley 5. Mais dans sa notice des ILBardo, Madame Z. Ben Abdallah, en 1986, revient la position de Pallu de Lessert en la durcissant quelque peu : ces vtrans ne possdaient pas de terre et n'avaient aucune attache avec la cit . Elle est approuve par M. Khanoussi 6. La question n'est pas en fait de dterminer le sens que pouvait avoir moravi dans son emploi intransitif, car il est assez clair : s'arrter, et surtout demeurer de faon stable et prolonge ; mais plutt de savoir si ce verbe peut recevoir une signification institutionnelle prcise. Dans l'pigraphie africaine il a t relev quatre autres fois ce jour par A. Beschaouch 7, avec les mentions des dues Romani qui uico Hateriano morantur (CIL, VIII, 23125 = ILS, 6777) ; des dues Romani qui Vreu morantur (AE, 1974, 691); des dues Romani qui Suo morantur (ILTun, 682) ; des dues Romani qui Thinissut morantur (ILAfr, 306). On peut ajouter cette liste une inscription brise lue au Ksar Hellal par Mademoiselle N. Ferchiou, qui propose de restituer une formule comme [du(es) : 2. Pallu de Lessert A.C., Les colonies attribues Csar, 1911, p. 97. 3. En partie sans doute parce qu'il ne se prononait pas sur la date du monument il serait intressant d'avoir la date de ce texte > (ibid.). 4. Ant. afr, 16, 1980, p. 32. 5. Lepelley C, Les cits, II, 1981, p. 163 une colonie de vtrans y fut installe par Auguste ds 27 a.C. . 6. Khanoussi M., Nouveaux documents, 1991, p. 835 rien n'autorise reconnatre dans ces vtrans des citoyens de la colonie. Ils se disent tout simplement morantes Simittu. Ce qui montre qu'ils n'avaient aucun lien juridique avec la cit . 7. Beschaouch ., La dcouverte de trois cits, 1974, p. 233. : : : Antiquits africaines, t. 33, 1997, p. 115-118
J.-M. Lassere R(omani) ou conu(entus) c(iuium) R(omanorum q]ui occ [loco] moran [tur] ou [A]uiocc [al(aj\ moran [tes] 8. A. Beschaouch estime qu'il s'agit de citoyens Romains en rsidence, temporaire ou permanente, dans des cits autochtones ou de grands domaines... mais ils n'avaient aucune attache avec le sol et leur groupement n'avait, du point de vue du droit public, aucune exis tence . Il propose de les assimiler des consistentes. Ce second terme est attest formellement deux fois dans les inscriptions d'Afrique les Rusg(unienses) et Rusg(uniis) consistentes (CIL, VIII, 9250), et les ueterani et pagani consistentes aput Rapidum. . intra eundem murum inhabitant(es) (CIL, VIII, 20834-20835) ; quoi l'on peut ajouter l'inscription des cultores Victoriae Aug(ustae) qui Sigus consistunt (ILAlg, 2, 6503), o la formule n'est pas exactement la mme ; on laisse en revanche de ct le texte mutil CIL, VIII, I6367, o la qualit de ceux qui consistunt a en fait dis paru de la pierre et ne fait l'objet que de restitutions. L'examen de ces derniers textes montre que, la di ffrence de ceux o apparat le verbe morari et l'e xception du texte de Sigus 9, consistentes dfinit une cat gorie d'habitants associe une autre : les Rusgunienses et ceux qui sont installs Rusguniae . D'une autre manire, les deux textes de Rapidum sont tout aussi prcis dans la formule ueterani et pagani consistentes il est vident que consistentes porte sur pagani seulement, car on prcise plus loin que les deux composantes de la population de Rapidum sont intra eundem murum inhabitantes. Au contraire, sur les pierres o apparat morantes, le terme se rapporte toujours une seule catgorie jur idique, celle des dues Romani, l'exception toutefois de la clbre donation de Sicca Veneria (qui, elle, intresse en fait le droit priv) elle prvoit le cas des incolae qui l'avenir liraient domicile l'intrieur des construc tions comprises dans la colonie ; il est probable que dans ce texte on a donn morari son sens intransitif gnral. Ailleurs, on semble plutt dsigner par consis tentes un groupe secondaire d'habitants, ou jouissant d'un moindre statut, incolae, peregrins ou autres, ins: . 8. Ferchiou N., Glanes, 1996, XI, p. 1336-1339. 9 Voir le commentaire prudent de H. -G. Pflaum, ad loe. - il s'agit d'un collge d'habitants de Sigus, vraisemblablement citoyens Romains, ant rieur l'rection de cette localit en commune indpendante . CNRS EDITIONS, Paris, 1998 : : :
Les vtrans de Chemtou
117
tall ct de citoyens Romains ou latins. Ce sens est appels tout naturellement milites morantes Golas 14. d'ailleurs celui qu'il faut retenir dans la ddicace de Le terme morantes est ici charg d'un sens administratif Napoca faite par les Galates rsidant dans le muni- prcis, celui du lien entre les soldats et le poste o ils cipe 10. L'quivalence entre consistentes et morantes sont affects, de faon temporaire sans doute mais en n'est donc peut-tre pas totale. Il convient alors de ten excution d'un ordre suprieur. Comme le lgionnaire ter de discerner si morari n'a que le sens banal de en garnison Cuicul pendant prs de six ans au s'installer librement quelque part, de faon temporaire Ier sicle (et contemporain vraisemblablement des vt ou permanente . rans de Chemtou) et comme les fourrageurs de Casae Un secours nous vient de trois textes africains, prc sous Septime Svre et Caracalla, en 259 les milites isment relatifs des militaires. C'est d'abord une pimorantes Golas appartiennent la Legio III Augusta de taphe trs endommage de Tigzirt, relative un miles Lmbese ou des corps d'auxiliaires 15. Ils sont dtachs moratus Cuido ann(os) V et menses VIIII; uixit an(nis) au poste, qui n'est pas leur affectation principale, mais XX[.] n. Puis une inscription retrouve Casae (El ils y sont prsents pour un temps assez long, selon des Mahder), dans le territorium de la IIIe Lgion Auguste, mutations ordonnes par le commandement. Le terme qui mentionne un groupe de lgionnaires dtachs en morantes ne peut donc - au moins dans ces trois cas ce lieu pour rcolter le foin, des uexillarii legionis III dsigner une installation individuelle en un endroit Augustae morantes ad fenum secandum 12; il s'agit librement choisi par eux. d'une ddicace Jupiter Optimus Maximus et aux Je ne saurais dire si hors d'Afrique ce mot est attest Nymphes, d'poque svrienne, martele, puis regrave dans la langue des militaires par d'autres documents. en 253, ce qui suppose la permanence de ce dtache Mais les textes de Tigzirt, d'El Mahder et de Bou Njem ment de fourrageurs. C'est enfin un ostracon de Bou incitent tout de mme ne pas carter totalement une Njem, une lettre d'accompagnement date de la fin hypothse dont on rsumera ainsi les donnes. Les de juillet 259 13 : anciens militaires de Chemtou, quelle que soit leur ori [ ]o d(ecurioni) prepsito salutem [ab Au] relio gine (dtachement du praesidium, legio III Augusta ou Donato milite] ; suscipies ab Glareo asgatui dua semis, autre, ou unit auxiliaire), semblent bien agir en orga facent m(odios) triginta, ad usus militum moran Hum nisme reconnu (au moins par l'opinion) dans la ddi Golas, [III?] kal(endas) Augustas, Aemil liano et Basso cace de cette pitaphe au lieu de leurs noms, ils font graver leur qualit commune, certains d'tre bien identi cos(ulibus). fis par les lecteurs ventuels du texte funraire. Cela On voit tout de suite l'intrt de ces textes pour tant, s'ils ont utilis, non le terme consistentes, mais le notre propos : les deux asgatui et demi qui font 30 bois terme morantes, c'est peut-tre en lui donnant, comme seaux (de bl?) sont destins la consommation des les fourrageurs anonymes, le soldat de Cuicul et militaires de la garnison de Golas (Bou Njem), que dans Aurelius Donatus Bou Njem, le sens rvlateur du lien, son style trs rglementaire le soldat Aurelius Donatus a rsultant d'une dcision officielle, qu'ils pouvaient avoir avec la colonie augustenne. Juillet 1997 10. CIL, III, 860 = ILS, 4082 Galatae consistentes municipio posierunt I I I I I 11. CIL, VIII, 20713; Le Bohec Y., La Troisime Lgion Auguste, 1989, p. 155, n. 66 et p. 268. L'auteur place la carrire de cet homme sous les Julio-Claudiens. 12. CIL, VIII, 4322, cf. 18527 = ILS, 2484. 13. Marichal R., Les ostraca de Bu Njem, 1992, n 81 (p. 188-189). : 14. R. Marichal, ad loc, note qu'Aurelius Donatus n'est certainement pas un trs grand clerc, mais qu'il a une bonne connaissance de l'cri ture des bureaux . 15. Le Bohec Y., o.L, p. 441-443 et n. 444. :
Antiquits africaines, t. 33, 1997, p. 115-118
CNRS EDITIONS, Paris, 1998
118
J.-M. Lassere
Bibliographie
Ben Abdallah Z., 1986, Catalogue des ins criptions latines paennes du Muse du Bardo (Collection EFR, vol. 92), Rome. Beschaouch ., 1974, La dcouverte de trois cits d'Afrique Proconsulaire (Tunisie) Aima, Vreu et Asadi ; une contribution l'tude de la politique municipale de l'Empire Romain, CRAI, p. 219-234. Ferchiou N., 1996, Glanes pigraphiques dans la rgion de Fahs - Bou Arada, dans L'Africa Romana, XI, 1994, p. 1329-1339. :
Khanoussi M., 1991, Nouveaux docu ments sur la prsence militaire dans la colonie julienne augustenne de Simitthus (Chemtou, Tunisie), CRAI, p. 825-839. Lassre J.-M., 1980, Remarques sur le peu plement de la Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthus, Ant. afr., l6, p. 27-44. Le Bohec Y., 1989, La Troisime Lgion Auguste, Editions du CNRS (Etudes d'Antiquits africaines), Paris.
Le Bohec Y., 1989, L'arme romaine sous le Haut-Empire, Paris. Lepelley C, 1981, Les cits de l Afrique romaine au Bas-Empire, Paris. Marichal R., 1992, Les ostraca de Bu Njem, (Supplments de Libya Anti qua, VII), Dpartement des Antiquit s, Tripoli. Pallu de Lessert A.C., 1911, Les colonies attribues Csar (coloniae Julia) de l'Afrique romaine, Mm. de la Soc. nat. des Antiquaires de Fr., LXXI, p. 29-110.
Antiquits africaines, t. 33, 1997, p. 115-118
CNRS EDITIONS, Paris, 1998
Vous aimerez peut-être aussi
- TounesDocument429 pagesTounesZaher Kammoun NaturalistePas encore d'évaluation
- Consignes AccidentDocument1 pageConsignes AccidentZaher Kammoun NaturalistePas encore d'évaluation
- Pendage Trois PointsDocument1 pagePendage Trois PointsZaher Kammoun NaturalistePas encore d'évaluation
- Speleo FDocument2 pagesSpeleo FZaher Kammoun NaturalistePas encore d'évaluation
- Carthage PuniqueDocument3 pagesCarthage PuniqueZaher Kammoun NaturalistePas encore d'évaluation
- Sarcophage en BoisDocument16 pagesSarcophage en BoisZaher Kammoun Naturaliste100% (1)
- Motra L7DDocument3 pagesMotra L7DEl Mehdi El FadliPas encore d'évaluation
- TP 1, Initiation A La Programmation Du Pic 16F877A Premiere Approche Des Logiciels UtilisesDocument6 pagesTP 1, Initiation A La Programmation Du Pic 16F877A Premiere Approche Des Logiciels UtilisesNaima BajouPas encore d'évaluation
- Pr. Nawal BENSAID Cours Evaluation Des Entreprises S6Document16 pagesPr. Nawal BENSAID Cours Evaluation Des Entreprises S6Manal TataPas encore d'évaluation
- EFF Théorique TEMI 2013 Corrigé - (WWW - Diploma.ma)Document5 pagesEFF Théorique TEMI 2013 Corrigé - (WWW - Diploma.ma)Hamza NiouarPas encore d'évaluation
- TD Sang CorrigéDocument5 pagesTD Sang CorrigéBouhamey Traore100% (1)
- PPPT Présentation de ProjetDocument16 pagesPPPT Présentation de Projetالحمد للهPas encore d'évaluation
- CVDocument1 pageCVMarion GirodPas encore d'évaluation
- Ouverture Carrefour Market Marrakech Abd KhattabiDocument20 pagesOuverture Carrefour Market Marrakech Abd KhattabiIsmail FatheddinePas encore d'évaluation
- UntitledDocument282 pagesUntitledSerge AnthonyPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Calculs AlgébriquesDocument11 pagesChapitre 2 - Calculs AlgébriquesDavid DupontPas encore d'évaluation
- 2021 Poenaru Psychopathologie Capitalisme Cognitivo ComportementalDocument12 pages2021 Poenaru Psychopathologie Capitalisme Cognitivo ComportementalChloé PlaziatPas encore d'évaluation
- Essais MecaniquesDocument10 pagesEssais MecaniqueshamidochPas encore d'évaluation
- Couche Reseau TCP/IPDocument49 pagesCouche Reseau TCP/IPwissal choukriPas encore d'évaluation
- 09 Machines Tournantes PDFDocument294 pages09 Machines Tournantes PDFMohamed OuichaouiPas encore d'évaluation
- 5 - Type MDocument29 pages5 - Type Msouheil80100% (1)
- Livre Final de Chimie P (C D)Document90 pagesLivre Final de Chimie P (C D)Valeria PeredaPas encore d'évaluation
- Traité de L'harmonie Tonale Réduite À Ses Principes NaturelsDocument628 pagesTraité de L'harmonie Tonale Réduite À Ses Principes NaturelsBenjamin Coudrin100% (2)
- L'oxydation Des Fruits FicheDocument3 pagesL'oxydation Des Fruits FicheBGH BGH100% (2)
- Chapitre 3: L'Impot Sur Le RevenuDocument29 pagesChapitre 3: L'Impot Sur Le RevenuTouriya BoufouchkPas encore d'évaluation
- E Classification de MortierDocument2 pagesE Classification de MortierVictor Fon EtotPas encore d'évaluation
- Attestation Loyer PDFDocument1 pageAttestation Loyer PDFtrabucco.kristinaPas encore d'évaluation
- Racine Carre 3 CorrigeDocument3 pagesRacine Carre 3 CorrigeMedAmine FilaliPas encore d'évaluation
- Étude Comparative Des Méthodes D'estimation de Canal À L'aide Des Pilotes Dans Les Systèmes OFDM À Travers Un Canal Multi-TrajetsDocument124 pagesÉtude Comparative Des Méthodes D'estimation de Canal À L'aide Des Pilotes Dans Les Systèmes OFDM À Travers Un Canal Multi-TrajetsInconnuPas encore d'évaluation
- TP GRH GroupknDocument18 pagesTP GRH GroupknBigstone LunumbePas encore d'évaluation
- Cours - Méthodes Numériques ApprofondiesDocument12 pagesCours - Méthodes Numériques ApprofondiesMarouane RebiaiPas encore d'évaluation
- Mouvements Anormaux - Sans VideospptxDocument23 pagesMouvements Anormaux - Sans Videospptxcopie masterPas encore d'évaluation
- L'Alphabet Japonais - DécouverteDocument20 pagesL'Alphabet Japonais - DécouverteAssane BollyPas encore d'évaluation
- Go MathsDocument3 pagesGo Mathsquivymanon94Pas encore d'évaluation
- Expose DetecteursDocument15 pagesExpose DetecteursPatrice CamaraPas encore d'évaluation
- C 110309Document24 pagesC 110309actionregionalePas encore d'évaluation