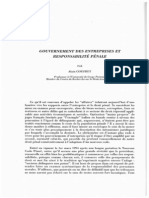Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lectures D'Été: Le Corps À L'ère de La Bioéconomie
Lectures D'Été: Le Corps À L'ère de La Bioéconomie
Transféré par
Marc-Andre LavoieTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lectures D'Été: Le Corps À L'ère de La Bioéconomie
Lectures D'Été: Le Corps À L'ère de La Bioéconomie
Transféré par
Marc-Andre LavoieDroits d'auteur :
Formats disponibles
L E
D E V O I R ,
L E S
S A M E D I
1 4
E T
D I M A N C H E
1 5
J U I N
F 7
2 0 1 4
LECTURES DT
Le corps lre de la bioconomie
ANTOINE ROBITAILLE
oins de fin de vie, mres
S
porteuses, dons dorganes,
brevetage des gnes,
embryons surnumraires, etc.
Dans lactualit, les phnomnes lis aux dveloppements biotechnologiques qui
chambardent notre vision du
corps se multiplient.
Si on a lhabitude de dire
que la vie na pas de prix ,
comme le rappelle la sociologue qubcoise Cline
Lafontaine dans son dernier
essai, Le corps-march, est-ce
encore vrai ? Sang, tissus, cellules, gnes, ovules : Le corps
humain, mis sur le march en
pices dtaches, est devenu la
source dune nouvelle plus-value
au sein de ce que lon appelle
dsormais la bioconomie.
Dans cet ouvrage tof f
un vritable essai et non une
collection darticles , la professeure lUniversit de Montral poursuit une ambitieuse investigation sociologique. Tout a
commenc pour elle avec lanalyse de lavnement et de la
popularisation de la cyberntique. En 2004, elle publiait
Lempire cyberntique. Des machines penser la pense machine (Seuil) o elle dmontrait
que la thorie de linformation
de Norbert Wiener, dveloppe
dans laprs-guerre, avait une
ambition bien plus grande quil
ny paraissait: adapter ltre humain de manire extrme une
logique de machine et, en bout
de course, faire un homme nouveau. Depuis, Lafontaine suit ce
filon, obstinment.
Dans son essai suivant, elle
dveloppait la thse selon laquelle ce nouveau paradigme
nous a fait basculer dans ce
quelle a appel la socit postmortelle (Seuil, 2008). Dailleurs, ce corps-march qui
YAN DOUBLET LE DEVOIR
Dans Le corps-march, Cline Lafontaine dploie nergie et talent exposer lampleur de questions
que les comits de biothique se contentent trop souvent dexplorer au cas par cas.
donne son titre lessai constitue linfrastructure conomique de
la socit postmortelle, dans laquelle le maintien, le contrle,
lamlioration et le prolongement
de la vitalit corporelle sont devenus les garants du sens donn
lexistence . Dans son rcent
livre, selon son habitude, Cline
Lafontaine dploie nergie et talent exposer lampleur de questions que les comits de biothique se contentent trop souvent dexplorer au cas par cas,
par le petit bout de la lorgnette.
Corps social
Notre Code civil, en son article 25, stipule que lalination que fait une personne
dune partie ou de produits de
son corps doit tre gratuite .
Lafontaine dmontre quel
point le grand principe inscrit
dans le marbre de la loi est
contredit, viol.
Nos socits vieillissantes et
rvant de sant parfaite ont
intgr le corps et ses composantes la mondialisation capitaliste dans sa portion bioconomie. Mme lorsque tout
est fait dans lapparence de la
gratuit et du don. Le corps (et
plus souvent celui des femmes)
devient un bioracteur, un
producteur de matriel naturel
exploiter. Lafontaine sait
critiquer les notions souvent
consensuelles ( consentement
clair ) et les lieux communs
qui simposent lorsque ces
questions sont souleves.
Si, dans ce meilleur des
mondes, des problmes de
sant individuels sont rgls,
certains vieux problmes collectifs saggravent: Face aux cots
grandissants des soins et la dmultiplication des innovations
biomdicales, les ingalits dj
prsentes risquent de saccrotre.
lire la sociologue, on pourrait croire parfois que le politique a finalement t totalement dilu dans la technique
et quil ny a plus dissue possible. Lafontaine clt pour tant
son ouvrage en appelant de
ses vux une nouvelle politique de la vie ainsi qu une
socio-thique partir desquelles
chaque nouvelle avance scientifique pourrait tre juge en
fonction des consquences sur le
corps social . Mais comment
dfinir une telle politique ?
Comment la mettre en pratique ? Faire des rfrendums
sur lapplication des dernires
dcouver tes concer nant le
corps ? Le dbat est ouvert. Et
les travaux de Lafontaine nous
y aideront assurment.
Le Devoir
LE CORPS-MARCH
LA MARCHANDISATION
DE LA VIE HUMAINE LRE
DE LA BIOCONOMIE
Cline Lafontaine
Seuil
Paris, 2014, 267 pages
Pguy : lambigu soldat de la paix
Il y a cent ans, le lieutenant et pote mourut laube de la Premire Guerre mondiale
MICHEL LAPIERRE
ne balle allemande en
plein front fait taire pour
U
toujours un lieutenant de
rser ve franais qui, en 1914,
debout, crie de tirer ses
hommes craintifs, dans un
champ de betteraves prs de
Paris. Un vers de cet homme,
aussi pote, acquiert l une vibrante authenticit : Heureux
ceux qui sont mor ts pour leur
tre et leur feu. Si Charles
Pguy, qui la crit dans ve
(1913), est moins moderne en
posie que son
contemporain
Guillaume Apollinaire, sa voix reste
aussi vraie.
Jean-Pierre
Rioux, historien de
la France de
lpoque, nous en
convainc dans La mort du lieutenant Pguy. Cer tes, il souligne que celui-ci, pour tant
socialiste dans lme et dreyfusard, ne pardonna jamais un
homme de tendance politique
semblable, le tribun Jean
Jaurs, de stre oppos la
guerre par pacifisme et internationalisme. Mais il insiste davantage sur la dclaration que
Pguy fit une grande amie :
Je pars soldat de la Rpublique,
pour le dsarmement gnral,
pour la dernire des guerres.
Par ce poignant paradoxe, le
fils du peuple rve de se bat-
AGENCE FRANCE-PRESSE
Heureux ceux qui sont morts pour leur tre et leur feu , a crit
le lieutenant et pote Charles Pguy.
tre, au pril de sa vie, pour la
patrie charnelle afin de
rconcilier le monde entier.
Ses mots dadieu permettent
de mieux comprendre la triste
ncessit que prche lun des
personnages paysans et
mdivaux de son Mystre de
la charit de Jeanne dArc
(1910) : Pour tuer la guerre, il
faut faire la guerre.
Courants contraires
Fils dun menuisier et dune
rempailleuse de chaises,
Pguy, en particulier dans son
essai Largent (1913), sidentifie au peuple de lancienne
France , quil dcrit comme
un admirable monde ouvrier
et paysan . Il prfre le patriotisme militaire inn de ces
gens simples, chrtiens nafs,
au pacifisme et linternationalisme de la gauche intellectuelle et embourgeoise que
Jaurs incarne ses yeux.
Cette attitude trahit lambigut de sa pense. Chez
Pguy, la probit ouvrire et
le sens communautaire du
devoir, rempli jusquau sacrifice, entretiennent, hlas, une
confusion entre la conscience
sociale progressiste et le
populisme ractionnaire !
Comme Rioux lexplique,
lcrivain influencera des courants opposs.
Si des catholiques de
gauche, comme Emmanuel
Mounier et Alber t Bguin,
clbreront la fracheur populaire de sa posie et la franchise vanglique de ses
crits de combat, dautres,
comme le maurrassien Henri
Massis, aimeront lordre
conser vateur que supposait
son culte fantasmatique du
Moyen ge.
En 1913, lanne o Pguy
salue, lancienne, la cathdrale de Chartres, pi le plus
dur qui soit jamais mont ,
Apollinaire chante Paris, sur
un ton nouveau, la tour Eiffel
et le troupeau des ponts qui
ble . Pguy croyait participer la dernire des guerres,
mais, ironiquement pour lui,
une deuxime hcatombe
mondiale, de 1939 1945,
encore plus hor rible que la
premire, svira, car Hitler
aura mythifi une race, plus
populaire que bourgeoise, et
un pass trs lointain.
Collaborateur
Le Devoir
LA MORT
DU LIEUTENANT PGUY
5 SEPTEMBRE 1914
Jean-Pierre Rioux
Tallandier
Paris, 2014, 272 pages
LA PLAGE OU SUR LE BALCON, JE LIS SMAPHORE
JEAN-FRANOIS AUB
FREDERICK LETIA
Les yeux de
la Nation
Les chroniques
de linquitude
NOUVELLES | 117 PAGES | 16,95 $
NOUVELLES | 131 PAGES | 17,95 $
Des nouvelles grinantes,
ironiques, qui ont du
chien, du style ! Il est drle,
cinglant, sardonique !
Cest jouissif !
FRANCE BOISVERT,
Le pays des livres,
Radio Ville-Marie
NOS GRANDS CRUS 2014
Scrutant les ressorts de ce
mal minemment moderne,
Frederick Letia tmoigne de
notre tonnante facilit nous
drober, voire manipuler
autrui ou cder la panique.
www.editionssemaphore.qc.ca
Vous aimerez peut-être aussi
- Cellier 25 Hiv FRDocument116 pagesCellier 25 Hiv FRMarc-Andre LavoiePas encore d'évaluation
- Louis-René Des Forêts: Quand Le Plus Silencieux Des Écrivains... Nous Parlait - Bibliobs - L'ObsDocument11 pagesLouis-René Des Forêts: Quand Le Plus Silencieux Des Écrivains... Nous Parlait - Bibliobs - L'ObsMarc-Andre LavoiePas encore d'évaluation
- Henri Maldiney Et Gilles Deleuze. La Station Rythmique de Loeuvre DartDocument8 pagesHenri Maldiney Et Gilles Deleuze. La Station Rythmique de Loeuvre DartMarc-Andre LavoiePas encore d'évaluation
- Sartre Par Lui MemeDocument197 pagesSartre Par Lui MemeCristina MaximPas encore d'évaluation
- Equilibres Précaires: ChroniquesDocument1 pageEquilibres Précaires: ChroniquesMarc-Andre LavoiePas encore d'évaluation
- Alain CoeuretDocument15 pagesAlain CoeuretKhalilTawïlPas encore d'évaluation
- Methodologie PfeDocument33 pagesMethodologie PfeX TrooperPas encore d'évaluation
- Lexique Dictionnaire Francais Arabe Presse Medias Economie Economique Politique MilitaireDocument6 pagesLexique Dictionnaire Francais Arabe Presse Medias Economie Economique Politique MilitairescribdPas encore d'évaluation
- Norme B2 Identif Parcours Soins 1205Document5 pagesNorme B2 Identif Parcours Soins 1205Deepuk Ku;qrPas encore d'évaluation
- Le Vrai Visage de Manuel Valls, RivarolDocument1 pageLe Vrai Visage de Manuel Valls, RivarolCanardDuDoutePas encore d'évaluation
- Memoires Analyse EconomiqueDocument3 pagesMemoires Analyse Economiquekistidi33Pas encore d'évaluation
- Lutte Corruption Et TranspDocument28 pagesLutte Corruption Et TranspNathan FowlerPas encore d'évaluation
- F2019057 PDFDocument24 pagesF2019057 PDFRaidPas encore d'évaluation
- Cours Droit Des AffairesDocument55 pagesCours Droit Des AffairesMed Amine RifiPas encore d'évaluation
- Je Suis Chez MoiDocument3 pagesJe Suis Chez MoiFernando Plans100% (1)
- 20120517Document30 pages20120517tahar_chaouchPas encore d'évaluation
- Mama Told Ya X Nuits SonoresDocument1 pageMama Told Ya X Nuits Sonoresjulien.margetinPas encore d'évaluation
- Journal Officiel: Mercredi Aouel Safar 1427 Correspondant Au 1er Mars 2006 N 12 45ème ANNEEDocument32 pagesJournal Officiel: Mercredi Aouel Safar 1427 Correspondant Au 1er Mars 2006 N 12 45ème ANNEEInstitut SofimPas encore d'évaluation
- La Preuve Qui A Forcé Le Pape Benoît XVI À Démissionner Est Maintenant Disponible - Meurtre Par DécretDocument6 pagesLa Preuve Qui A Forcé Le Pape Benoît XVI À Démissionner Est Maintenant Disponible - Meurtre Par DécretWal WalterPas encore d'évaluation
- Code Postaux FranceDocument1 624 pagesCode Postaux FranceJacques BarbieriPas encore d'évaluation
- Pieds-Noirs - WikipédiaDocument23 pagesPieds-Noirs - WikipédiaBouamara RédaPas encore d'évaluation
- Compte RDocument2 pagesCompte RsfjisjfppsPas encore d'évaluation
- Voici L Amour Qui Seul Fait VivreDocument1 pageVoici L Amour Qui Seul Fait VivreGloire KadiatPas encore d'évaluation
- Claudine Poirier, Notaire: Rédaction de Testament NotariéDocument10 pagesClaudine Poirier, Notaire: Rédaction de Testament NotariéClaudinePoirierPas encore d'évaluation
- Supreme Court of Canada 2005scr2 - 100Document88 pagesSupreme Court of Canada 2005scr2 - 100Kernal StefaniePas encore d'évaluation
- These ASSI 2018aDocument382 pagesThese ASSI 2018aalae00Pas encore d'évaluation
- Les Dates Cles de L'histoire Du TOGODocument6 pagesLes Dates Cles de L'histoire Du TOGOYaconelly SpoletoPas encore d'évaluation
- Demande de Passpeort Adulte - Adult Passport ApplicationDocument6 pagesDemande de Passpeort Adulte - Adult Passport ApplicationTarek RabaiPas encore d'évaluation
- Arrêts Portées Strat S4Document11 pagesArrêts Portées Strat S4Anaïs BarrymorePas encore d'évaluation
- Le Système Monétaire International: Évaluation Et Pistes de RéformeDocument12 pagesLe Système Monétaire International: Évaluation Et Pistes de RéformeFatima ZahraePas encore d'évaluation
- Manuel de La Composition Des AlimentsDocument302 pagesManuel de La Composition Des AlimentsAdama KONEPas encore d'évaluation
- La Procédure CivileDocument55 pagesLa Procédure CivileSalwa Ghallab100% (13)
- Gramsci Etat Bucci-GlucksmannDocument8 pagesGramsci Etat Bucci-GlucksmannAnonymous jPZuQHNPas encore d'évaluation