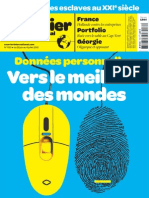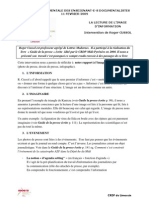Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Revue Des Livres - n10
Revue Des Livres - n10
Transféré par
Aris Papathéodorou0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues84 pagesRevue des livres - n10
Titre original
Revue des livres - n10
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentRevue des livres - n10
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues84 pagesRevue Des Livres - n10
Revue Des Livres - n10
Transféré par
Aris PapathéodorouRevue des livres - n10
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 84
CE QUE LIRE VEUT DIRE
La lecture, une affaire politique
par Frangois Cusset
Egalement dans ce numéro
Le démon de la bureaucratie néolibérale
Occupy toujours ! * Colonisation et environnement
Politiques des drogues + Notre-Dame-des-Landes
Mors Marxisme noir « L’impérialisme sexuel en débat
2013 Deligny et les territoires du commun
n°O10
SOMMAIRE
‘journos pose
‘ot procs regan
entactekdprassecon,
LES RENCONTRES DE LA Ral 2 Le point sur
ee Les politiques des drogues
Le démon de Ia bureaucratic
tose tp Anne Cope Oe Dot
otal lie popens solide gst re
‘La Burenuerasaion du monde deve nbltbéate Géographie de la critique
Bea Katka, The Demon of Witing HERVE KEDOE
Alexander R. Galhoway, Protocol pa Un, deux, trois, mille
Notre-Dame-des-Landes! Entretien
Saasegais Coste Proposrecuilis par Alice Le Roy
‘Ce que lire veut dre. Lalecture,
See ee eee cance ot Charlotte Nordmann, Poy
Apropos de Marielle Macé Expérimentations politiques
acon de is, manires dre Par ANDREA BENVENUTO
Les banquets des sourds-muets
‘au xa siécle et la naissance
du mouvement sourd p69
Débat
empire de «la sexualité en question p.17 SANDRA AINAREZ DE TOLEDO,
Deligny ~ Cartographier
les territoires du commun. Entretien
ropes ecuelis tines
par Chariotte Newnan
Apropos de Carte et lignes dere
‘Occupy Wall street :
fin ou début d'un mouvement ?
‘propos do Thomas Frank
‘Oceuper Wal Street, un mouvement
tombs amourvux de lu-méme» pa
MATTHEW RENAULT henner
Cartes et lignes d'erre
Black Marxism. C.L. R. James et
Pindépendance des luttes noires arésena Deliaew bit
apropos de CLR. ames, Surla question noe 9.34
‘ORSULAIRE DABONNEMENE p4o Alive sur www.revuedeslivres.tr
La courbe de la Bastille, osEPH MASSAD
Paris, le 6 mai 2012, pat Lempire de « la sexualité », ou Peut-on
ea ne pas étre homosexuel (ou hétérosexuel) ?
"rRANGoIs DUMASY ope
Coionisation frangaise et protection
de environnement au Maghreb:
histolres mélées
~ A propos de Diana K. Davis,
Props recueiis par Flix Boggio Ewanié-Epse ot
Stella Mapian-Belkacem
propor de Joseph Massa, Desiring Arabs
Les Mytesenvironnementaus coutectt
dela colonisation francaiseau Maghreb p48 The Trouble is The Banks. Letters to Wall Street
ile porte (entraits)
ENRIQUE DUSSEL LIS MARIENEZ ANDRADE
La théologie politique au service Enrique Dussel. Pour une philosophie de la
de la libération. Entretien libération. Portrait
ropes recellis par
Luis Martinez Andrade pst
Remerclements &
andra Alvatez do Toledo et Anats Masson (LA rachnéen), Adsion Beni, Thierry Boccon-Gibod, Gisele Durand-Ruiz,
Hossoin Sadeghi (Le Liov-Dit) ct ux eamarades do Rotimpres de Routage Catalan et dos depts de La Poste Paris
Brune et Perpignan Roussllo PIC.
La Ral n°N1 (mal-juin 2013) sera en klosque le vendredi 1“ mal et en librairie le jeudl 16 mal.
Vous souhaitez nous faire part de vos remaraues et suagestions ou nous proposer un article?
Ecrivez-nous 8 info@revuedeslivres fr
‘Sulvez-nous sur Facebook et sur Twitter (revuedeslivres).
Inscription & la lettre d'information électronique liste @revuedeslivres.tr.
LES RENCONTRES DE LA RDL
LES MEMOIRES CONFLICTUELLES DE LA COMMUNE
le mardi 12 mars 2013, 219 h
au Lieu-Dit, 6 rue Sorbier, 8 Paris
(MP Méniimontant)
Rencontre avec Eric FOURNIER
autour de
La Commune nest pas morte d'Eric Fournier (Libertalia, 2013)
« Avjourd'hui analyse par les histriens comme un singolierergpuscule des
revolutions dx" ice Ia Comme de Pars fut longtemps consideree comme
Paurore de revolutions du xx ile, conse une fle tpoursuivr. Cet sab
che ses sages politiques des anémoies dec! événementwagique dont
son our, contribuant patois aux victoires de forces de gauche
{en France, lors du Frost populaire notamment La Commune est alors polit
quement vivant. Aprés le chant du eygne du centenaie 1971). went le temps
ddeapaisement et ddéctin, Massa Commune peinea mobilise aujount h
son mythe apparailinderacinable el ressaritponctuellement dans fe cham
peltique. » (Présentation de Téditeur)
Eric Fourier, agrége et dacteur en histoire, enseigne en Iyege depuis une
‘winzaine années. Il et Fauteur de Parse ines, Di Paris haustmannien
{uals commmunand(Uinago, 2007): Ci dusang Les bawchers de Lat Vita
ont Droyfs (Libotaia, 2008): La Belle ule. D'Wvanhoea la Shoah (Champ
Vallon, 219),
POUR EN FINIR AVEC «LA GUERRE CONTRE LES DROGUES»
le mara 9 avril 2013, & 19 heures
au Lieu-Dit, 6 rue Sorbier, 8 Paris
(MP Méniimontant)
Rencontre avec Anne COPPEL, Olivier DOUBRE et Aude LALANDE
autour de
Drogues, sortir de I’impasse d'Anne Coppel et Olivier Doubre (La Découverte, 2012)
La guerre contre es drgues» et un désistre,Himporte den dresser am bilan
ausspréisetrigoureus que possible, demettre un terme ainstrumentalisation
poliicieane de a= police» des drogues et de defini eolletivement une autre
Politique des drogues, prazmatique et istrute des experiences alternatives
Feussies developpees dans le mone.
‘Aane Coppel Sciologue, sé président de « Limiter la case», association
qu impulsé en France la eduction des risques Flle est aotammentFauteute,
avec Christian Bachmann, de La Drogue dans le monde. Elle afegu en 1996.2
Floreace. le pris international Rlleston Award de a réduoton des eas
Dvir Doub est journalist a Polit Ha poblié de nombreux acti res
westions lige aux droguce (dene Vacarme, Swaps, Asd-Journl. fi Manifesto
fie) Ha cooslonné aves Anne Coppel en 2002-200) ls premivie experience
ux drogues
Frangaise de democrat patisinativ locale sur les problemes
ws de drogues|
1 leurs modalités de socialisation. Elles public divers articles sue ces sujets
ddansla revue Vacarme (vacarme-org)ouelle a notamment animé une rubrigue
consscrée atx « psychotropes comme enjeu politique»
LIRE ENSEMBLE ? PRATIQUES ET POLITIQUES DE LA LECTURE
le mardi 23 avril 2013, & 19h
au Lieu-Dit, 6 rue Sorbier, 8 Paris
(MP Méniimontant)
Rencontre avec Francois Cusset
autour de
Fagons de lire, maniéres d’étre de Marielle Macé (Gallimard, 2011)
Lon aestjamais tout aitseul quand on it. Lalecture est toujours une affaire
plus ou moins colletive. Elle peut sequérir une dimension proprement
politique. C'est au désrypiage des pratique et des expérinees conlemporaines
mergentes ops lables, enviag
2s que cette rencontre avee Francs
sonnoment: Tide qui n'y aura pas de edeploiement dune poliique
qui, au cours du xx" sitcle,
multiplé les eglements, les procédures, les entraves,
ct, dans leur sillon, des ribambelles de fonctionnaires
cet de formulaires plus
Lalibre concurrene: igré ses cruautés
parfois inhumaines, n'a-Lelle pas au moins le mérite
dela simplicité: chacun fait ce qui lui plait, et que le
ameilleur gagne!
La double bureaucratisation du monde
Dans son dernier livre, Béatrice Hibou, auteur de
La Force de lobéissance (2006) et ’Anatomie poli
tigue de la domination (2011), bat en bréche de tls
clichés, Elle ous invite considérer ere néolibérale
comme celle d'une ebureaucratisation du monde>.
‘Non seulement le Marché ne se développe qu'au sein
de réglementations de plus en plus tatillonnes, des
tinges 3 assurer «une concurrence libre et non faus-
sée» par le biais des ionctionnaires et formulaires de
PUE et de 'OMC. Mais surtout linstitution-entre
prise, obsédée par sa rentabilité (bottom line), nest
pas moins bureaueratique que linstitution-Etat: «la
strategie d'entreprise, le processus de normalisation
etde certification des produits, des modes de produc
tion et de gestion, la ligne marketing, le management
des achats, les relations publiques, les relations avec
les fournisseurs, les sous-traitants et les prestataires
#'YeesCitton est protesscur de literature franyaise du xvi sitle A 'université de Grenobl
de services|... sont définis de fagon stricte et proce:
durale, de sorte que les marchés et la concurrence, les
comportements des clients et les cireuis de distribu-
tion, la presse et les pouvoirs publics, Fensemble de
la chatne de production soient matris6s»
Alors que les logiciels obsoletes qui continuent
A régir nos débats politiques sobstinent & opposer
partisans du Marché et partisans de Etat, nos ré3-
lités sociales se tissent au fil d'une bureaucratisation
croissante qui fait converger Marchés et Etats vers
‘un horizon multipliant leurs absurdités conjuguées.
Test désormais patent que le régne de la concur-
rence marchande est aussi enclin que ladministra:
tion étatique & engendrer ce qui faisait essence de
la bureaucratie dans I'étude classique qu’en a don-
née Fanthropolozue Michael Herzfeld: la production
sociale de lindifférence?
La tyrannie comptable
Le livre de Béatrice Hibou souvre sur la description
(p. 142)
La résistance est (futile
horizon protocolaire de la bureaucratisation néoi
hérale du monde a certes de quoi faire frissonner. LA
‘ol ke «nouveau capitalisme» (postindustrel, cogni-
tif, exéatif) faisat miroiter une dé-bureaucratisation
promettant une autonomie décisionnelle, une flexi-
bilité, une imlormalité prétes & accueillir toutes les
hétérogénéités pour garantir une inventivité maxi
male, nous nous retrouvons coincés entre des armées
d'évaluateurs obsédés par des chiffres déconnectés
de la ralité et des formulairesen ligne rendant maté-
tellement impossible toute réponse non exécutable
selon les standards rigiifiés parla duret¢ implacable
du hardware, Cela méme qui, au nom de la neutra-
lité du Net, saffiche comme pouvant accueillir tous
les contenu, sans higrarchisation ni discrimination.
repose sur une homogéneisation — standardisation,
simplification'® — devenue incontournable: si<('In-
ternet est univers mass médiatique le plus hautement
contr6lé connu d ce jour», cela est di au «cout trés
dlevé imposé @ tout écart revendigué par ceux qui
choisiraient dignorer Tusage global de ces technolo-
sies. Nepasentrer dans faconimunauté protocolaire
se paye sicher que rejter le protocole serait insensé.
[.] Le succes méme du protocoteexclut ls positions
outsiders: seuls les participants peuvent se connec-
ter et donc, par définition, il ne peut pas y avoir de
résistance au protocole (p. 147)
La soumission m’est pourtant pas la seule alterna.
tive. Alexander Galloway suggére deux voies pour
agir sur le protocol de Tintérieur, retrouvant au sein
de Tunivers numérique les gréves du z2le et autres
‘manducations de papier pratiquées envers la paperas-
serie de jas. Sura base du principe que, «afin détre
olitiquement progressste le protocole doit d'abord
‘tre partiellement réactionnaire» (p. 244), il suggere de
se plier 2 la standardisation exigée pour entrer dans
Je réseau, afin de pouvoir le rotravailler de 'intéricur.
Sur cette prémisse il propose deux modes de com>
portement. D'une part, «a meilleure réponse tac-
tique envers le protocole n'est pas la résistance, mats
Uhypertrophie», la multiplication (p. 244). Diautre
part, un usage tactique des médias numériques
La ot le «nouveau capitalisme»
faisait miroiter une dé-bureaucratisation,
promettant une autonomie décisionnelle,
nous nous retrouvons coincés entre
des armées d’évaluateurs obsédés
par des chiffres déconnectés de
la réalité et des formulaires en ligne
rendant matériellement impossible
toute réponse non exécutable selon
des standards rigidifiés.
promeut «les phénomenes susceptibles d'exploiter
des failles des commandes et des contrdles protoco-
daires et proprietaires, non pour détruire la techno-
dogie, mais pour scuipter le protocole afin de mieux
Vadapter aux désirsréels des gens» (p. 176). Meme
si ce programme date déja d'une dizaine d'années
ts les expoirs suscités par Thactivisme ont récem-
ment t€ revises Ia basse, y compris par Alexander
Galloway dans son dernier ouvrage', la double voie
de hypertrophic et de Fexploitation des falles reste
valide pour apprendre a «sculpter» les protocoles
puta qu’ les subie
Un formulaire sur deux
‘On peut dds lors faire le point sur ce que ces trois
livres suggerent pour combattre limpression d'im-
puissance et d’crasement qu'impose la bureau-
cratisation néolibérale d'un monde en voie de
protacolisation:
1° Exiger de toutes les institutions auxquelles on
souhaite participer qu‘lles mettent la réduction des
formalités au premier rang de leurs priorités: au
Jicu du dogme imbécile de non-remplacement d'un
fonctionnaire sur deux, un gouvernement éclaité
imposerait & tous ses ministéres /éfimination d'un
formulaire sur deux.
2 Observer sans regret la fagon dont la tyrannie
de la transparence comptable sera vouge a gripper
et ctouffer fatalement toute institution assez. faible
[Pour se soumettre a ses dietats (il est malheureu-
sement 8 ctaindre que les universités frangaises ne
soient d inscrire dans cette catégori).
3° Exploiter de maniere inventive les propriétés
du médium bureaucratique pour neutraliser des
réformes réactionnaires ou s'infiltrer dans les failles
de procédutes évasives
4° Défendre pied a pied les zones d'opacité per-
‘mettant A nos collaborations de se développer sur le
régime de la confiance plutot que sur celui de
uation abstraite,
5° Promouvoir tous azimuts des modes diéduea-
tion et dauto-valorisation basés sur le bidouillage des
protocoles (hacking), plutot que sur leur acceptation
passive,
6° Opérer une distinction ferme, parmi les pro-
tocoles, entre ceux dont la standardisation n'est ini-
tiglement réactionnaize qu'afin détre politiquement
progressiste dans ses effets (selon le modéle originel
un Internet fibre), et ceux dont les pré-paramétrages.
ne visent qu’ réduire le coiit de notre soumission.
Les premiers peuvent faire objet dinvestissements,
taetiques; les seconds ne méritent que d'étre sabotés.
Ces trois ouvrages nous invitent & approcher la
bureaucratisation du monde comme un redéploie-
‘ment de la politique, le démon d’éerire comme une
guerre inhérente a notre rapport au pouvoir, le
protocole comme la condition d'existence de notre
postmodernité: tous trois conduisent a contrer la
rigidité des formulaires par 'imprévisibilité de nos
reformulations.
NOTES
1. Béatrice Hibou, La Bureaucrasationdumonde dre néol
brat, Pats, ta TDgcounerte, 2012, p. 28-2, Michoel Here,
The Social Production of nference. Exploring the Sombie
Roots of Western Burenucracy, Chictgo, Univer of Chicago
Dress, sogz. 3 Angélique del Rey, La Frannie de evaluation,
aris, La Déeouverte, 20134 Mariya Suathern, «The Tyranny
of Transparency» ritish Blucational Research Jonna, vo 2
1° 3 (in 2000), p. 309-21. 5. Friedrich Melchior Grimm,
Correspondance iterate, philosophique et erlgue du juillet
+764, edition Tourneu, Paris, Gamer, 1877-188, v0.6, p30
6 Louis Sebastien Mercer, Tableau de Paris, Amsterdam. 1780,
vol, chapitre nex p. 57.7. Louis Antoine Léon SuintTus
"Lar militate dela Nation et a bureaucrat, Rapport nom
‘hy Comite de Salut public da rer octobre 179 disponible en
ligne sur www.assemblec-nationale.tr/histoire/7el.asp.
S:Alexander R Galloway, Protocol. How Contol Exist aes
Decentralization, Camblge Ma, MIT Press, 2004.9. 15-15,
9 Woir sur ee point article de Friedich Kites, « Thee Is No
Softwates. en ligne aur waw.ctheory.nctaticles ape
10, Voirle denne live de lea Michel Beanie, Eom in
biifie. Le syndrome de la touche etoile, Paci, Fayard, 2
TH. Voir Alexander Gallonay. Te Interface Effet. Cmmbrids.
Polity Pos, 2012 et Geert Lavink, Networks Wihout a Cause
A Critique of Soctl Metin, Cambridge, Polity Pres, 202,
CE QUE LIRE VEUT DIRE:
LA LECTURE, UNE AFFAIRE COLLECTIVE,
UNE AFFAIRE POLITIQUE
PAR FRANCOIS CUSSET*
APROPOS DE
‘Marielle Macé,
Facons de lire, maniéres d'étre,
Paris, Gallimard / NRF Essais,
201T, 304 p.. I880€,
Dans Facons de lire, maniéres d’étre, Marielle Macé envisage la lecture comme une stylisation de
s0i, et une experience irréductiblement individuelle, N'est-ce pas occulter que la lecture est aussi
tne pratique collective, qu'elle n'est jamais « hors du monde », mais est au contraire traversée par
des enjeux politiques, qui la transforment et la renouvellont ?
Lit stojous ten France, paren pave det
grande famille lttérare. La lecture est chez nous
sans méme avoir A étre déplige, cette bordure exte.
rieure, et triviale, du grand mystére littéraire. Plas
\olontiers conceptualisée et politisée autrement au-
dela des mers, et suspectée par la méme en France
de collusion avec tous les relativismes, a lecture n'a
jamais été un bon objet pour la théorie et histoire
littgraires frangaises. Tout a leur culte de labsolu
de Iécriture, et aux débats sur les intertextes et les
contextes du! grand ceuvre, nos litéraires lassent la
question de la lecture aux sociologues, aux histo-
riens, voire aux psychanalystes-lesquels ont des lors
devant eux un vaste terrain vierge que personne ne
vient leur disputer: Pierre Bourdieu pour y démonter
la mécanique de la lecture légitime, Roger Chartier
pour y inscrire les procédures de «mise en livre
dans histoire sociale de la Renaissance, ou Michel
Picard pour y débusquer les vertus émancipatrices du
«jeu lecteur!, Et pour peu que nos théoriciens lité
‘aires jettent néanmoins leur dévolu sur cette vieille
question de la lecture, ils le feront, presque exclusi
vement, dans la lignée d'une tradition phénoméno-
logique, qui emprunte aussi bien & la philosophie de
Merleau-Ponty qu’ des intuitions fortes puisées chez
les penseurs suisses de I Ecole dite de Geneve® (Jean
Rousset, Jean Starobinski..) ou les Allemands de
I'Beole de Constance’ (Hans Robert Fauss, Wolfgang
Iser..). Cette tradition phénoménologique sintéresse
davantage & la perception lectrice, et au faisceau de
relations entre un texte donné et un lecteur indivi
‘uel, qua la lecture en elle-méme, comme opération
dle sémantisation, vecteur de socialisation, subjecti-
vation politique ou juste plateforme institationnelle
La demigre preuve en date ena été fournie,en 2011
par Pélégante étude de Marielle Macé, au ttre digne
des meilleurs traités Wanthropologie des techniques
Fagons de lire, maniéres détre. Et par sa réception
critique enthousiaste, et plut6t large pour un livre exi-
geant :médias et médiateurs, ils nen dscernaient pas
toutes les subtilités, semblaient célébrer, avec ce livre,
[es joies de la lecture litéraire, de ses jeux dinitigs, de
ses ruses codées,sinon d'un entre solitaire auguel is
associent, sans bien sien rendre compte, 'idée meme
de littérature. Mais e’tait aussi une manitre de féli-
citer Fautcure —qu’on avait remarquée cing ans aupa-
‘avant pour son étude magistrale du genre de essai
dans la France du xx" sitele!— pour les authentiques
bonheurs de lecture quelle leur avait procurés. Et
pour cause : parmi de nombreux morceaux de bra:
voure, ce livre-ci marque notamment ses lecteurs par
ses pages aziles et enlevées sur ce moment clé dune
lecture qui consiste a «lever les yeux de son livre»,
‘pour laisse sen recombiner autrement les impressions
premieres, ou sur les fabuleuses péripéties de la per-
ception (mobile et coitré la fois) ds qu’on Sessaie &
«lire dans le train. Mais Vambition de Marielle Macé
est plus vaste que la seule phénoménologie raffinge
des situations de lecture,
Entre littérature et psychologie:
ja lecture comme invention de sol
Tout en revendiquant cette filiation phénoménolo-
gique dans son approcke de la lecture, Facons de
live, maniores d'etre y ajoute une triple originalité.
Dans la méthode d'abord, allégre et rigoureuse
la fois, associant en spirale la récurrence d'une
thse simple (on devient en lisant) et la maieutique
« Frongois Cust et presser d'études américince a universté de Paris Ouest Nanterre, Son dernier vee, abr alu déclin du
‘mond
aria editions BOLL en 203,
2
CE QUE LIRE VEUT DIRE
RDL_N*10 ~ MARS-AVRIL 2015
graduelle un point 'aboutissement (ou d'une ligne
de fuite) qui se veut la vie méme, et alternant, pour
ce faire, les lectures rapprochées de textes de grands
lecteurs et les échappées plus conceptuelles, de
Roland Barthes a Paul Ricceur, de Gilles Deleuze a
Jean-Claude Milner, sur la toile de temps et ineer-
titude dont est tramée toute existence.
‘Danses rélérences ensuite, moins éclectiques que
duelles, conformément a ce dualisme premier de la
vie et du texte : aux réérences du canon littéraire
répondent, plus discrétes, souvent implicites, mais
décisives dans la perspective du livre, les références
aux neurosciences et au cognitivisme, toute une
psychologie du lire néo-comportementale et parfois
‘méme directement physiologique ~ mimétisme des
grands auteurs d'un c6té, scientisme du cerveau lec-
teur de Pautre, qui soudain s‘arriment Pun 3 Fautre,
se répondent, comme lorsque Macé place, au détour
une phrase, les «approches cognitives» de la lee-
ture dans la lignée directe de ce qu’a pu en dire
Marcel Proust (p. 190).
Originalité enfin, et surtout, dans Youverture du
spectre, inédite dans la petite histoire des phéno-
ménologies littéraires du lire : la lecture, ic, n'est
cenvisagée ni in abstracto ni localement, & tel recoin
Cun texte ou tel moment d'une vie, mais plutot «a
Vechelle globate d une existence» (p. 107). La delicate
analyse qu’élabore Marielle Macé des rapports du
lire et du vivte, de «lexpérience cognitive» lectrice
et du «maniérisme de existence», se veut en effet
anerée dans la longue durée des lectures et de leurs
effets de leur mémoire involontaire et des possibles
quelles ouvrent, méme a contretemps :il y va dune
« (p. 190), C'est aussi que la
fine observation proposée ici des modalités de Patten-
tion lectrice et des transpositions perceptives qu'elle
induit a pour toile de fond, plus ou moins explicite,
Téthique humaniste classique d'un épanouissement
psychique et d'une «augmentation du monde (Selon
Je mot de Ricoeur") par les vertus du texte Iu. Mais
lune éthique remise au goit du jour, enrichie de toute
tune «pragmatique du rapport ésoi et au monde sen-
sible», dans la mesure exacte oit la lecture invite «d
essayer de nowvelles dispositions cognitives, un autre
corps, un autre “soi” [..., [oa] elfe restitue aux sujeis
leurs capacités de stlisation’>, en empruntant aussi
bien les «questions dl usage» ou les «inierprétations
pratiques» au vocabulaire de Michel de Certeau® et
‘au vocabulaire foucaldien tardif «lexercice ascétique
et souverain dune stlistique de existence» (p. 184).
‘Limportant, pour Macé, reste la série des continuités
et des échos dela littérature avec le monde sensible,
tout ce «mouvement déchange entre le temps exis-
tentiel et le temps narratif» (p. 130). Les pages sur la
«narvatvitéinchoative» de nos vies, cette «structure
prénarrative de Uexistence »chere Ricoeur, sur la
EXTRAIT / LE «NOUS» QUI INTERPRETE EST UN «NOUS» COMMUNAUTAIRE, NON UN INDIVIDU ISOLE
Lasaienetacae tates
lente snt ait am tounge
sso fais pa esses ince
thes que nous mttns en eave POUT
dt ne suis ps conan a
Subjctvit dans la metre ot er moyens par
esque ces objtssom ats sont sociaux ct
omventionelsAdtement ikon gu
‘eal le travalnterpreatif qui met es
poomes,lssuts de ov ct es ates
Ftstour dans emonde cnt ux =o
commas ton un indivi sl. Nol
SFeneenows a ae eile le matin st 3
trang a1
cng a nouveau ste cdueati u ne
Acide de jeter seit a rot Sune
fom organisation ae eaueemsot
criginale Nous ne lana en de out sla
Pe que ns ne porrons pea,
Pures gu es operation melas Ue ous
pons exter sont imide pares
{nations dans squcles nos sommes dd
dass Cesinaitstions now precedent
est solemonton lee bain om tant
ais par elles que aos avons secs ax
publique. Dans
Systeme i
om
ecivit ot subject
pore qu donne
ETitdes signin
sens publics tconventionnls quelle:
Droduisent. ins, i et sa qe nous
{Erconsla possi ets suet de devoiret les
lists), aous a ctCons au moyen do strategies
tnterpétaives qui ne sont inalement pas es
notre. mais qui ont leur source dans un
systeme dimteligibilie de dispor
fn mesare ole syste (on
ire dans es) nos
34s fagonne également. nous
‘munissant ds eatdgoies de compichension
avec lesgueles nous fagonnons & notre tour
lesentités que nous pouvons alors dsigne.
En bee, alist bjs fis ou const,
ous dens ous jouer nous- memes,
Pisque, tout autant que les poms et es
fujot de devoits, nous somanes ls prods
Adeschomes de ponsce sociaux ct eultuels
Foraler le probleme de cette maniere
revient a comprendre que opposition entre
ie est aus pusaue
‘Tue m aut renstent dans Ia forme
isa valeur Fopposition.
tons ne sent aso
tives objectives, du mins pas dans lex
termes porés par ceux quien débattent
‘teria lt cade taditonne eles ne
Seront pas objectives parce quills seron le
produit dun point de vue pte que
implement lust» get elles ne seront pas
Subjectves parce que ce point de vue sera
toujours social ov insttutionael.[.J Lego
existe pus en dchos des eatdgories de
pense conventionnelles et commana
{qui habliten ses opérations (penser, vir,
Tne), Une fs qu'on a dcouvet que es
conceptions qui remplissent la conscience,
jusqw In conception de son propre stata
ont toutes sues dla culture, ls notion
meme diego now contrat de conscience
Pleinement ct dangereusement litre, devicat
incomprehensible
Stanley Fish, «Comment reconnaitr an
potme quand on en voit un Quand lire
st fae. Linutrlé des communaiies,
Imerprétaves, tad °E. Dobenesque,
Paris, Les Prarie ordinates, 2007,
per,
ROL N*10 ~ MARS-AVRIL 2015
CE QUE LIRE VEUT DIRE
fonction consolatrice du récit et la fonetion mimé-
Ligue de la fable, sont particulitrement intéressantes,
Mace y disséquant le rapport entre la rencontre avec
un récit et la «passibilisation de sol», chez Sartre ou
méme Bourdieu, et y suivant écheveau complexe
des ramifications du narratif dans la lecture, en par=
ticulier la «concurrence » quelle institue au cceur de
la subjectivité «entre une
“identitésstyistiques”..» (p. 106).
Une bien curleuse solitude
Pew peu, pourtant, la lecture de ce live suscite une
zene, une Curieuse frustration, quelque chose comme
unmangue de monde. Les dominos habilement alignés
‘paraissentretomber dans autre sens, déwiler une face
Vide : tout ce qui semblait juste phénoménologique-
ment et existentiellement se trouve, au fur et mesure,
renvoyé a soi, invalidé par Fabsence criante de autre,
. Et quand elle
critique «/es sarcasmes de Bourdieu» doutant de la
«force culturelle de la littérature», ou oppose un peu
vite aux Régles de Uiart «la valeur existentielle de “la
forme”...» (p. 169), elle va jusqu’a donner au socio-
Jogue une legon de catharsis littraite i conseilant,
sans cles, Vindividuel contre le social, et Vamor fat
lecteur contre le « désespoir» théorique. C'est dai
Teurs au détour de ces memes pages que le social et le
collectf se trouvent évacués en une seule parenthese:
contre les thises de la domination culturelle, Macé
décréte, comme une évidence, que «la chance d'une
sylisation de so [est partagée par tous» et que «tous
‘peuvent trouver dans ta littérature une puissance de
‘nuance ¢p. 167). Wishful thinking ou lapsus élitste?
La lecture de Marielle Macé n’est pas erronée,
quelle suive sur toute leur euvre les auteurs ftiches
dees grands lecteurs ou quelle mette Paccent sur les
Intes incessantes «entre la fermeté au moins promise
une identité narrative [1] et la protestation [chez
ces auteurs lecteurs} de rvihmes, de styles dtr et
de maniéres (p. 180) elle est pluto biaisée, incom-
plete hémiplégique parfois, tant il est vrai que Sartre
lisait aussi en marxiste, Bourdieu malgré tout en
sociologue, et Baudelaire plus d'une fois en témoin
CE QUE LIRE VEUT DIRE
RDL_N*10 ~ MARS-AVRIL 2015,
crucial de Ja modernité urbaine et de ses tableaux
parisiens. Lecture sans monde, en quelque sorte.
‘Au fond, c'est une higrarchie venue de loin qui sur-
détermine toute cette vision : la subordination de la
Jecture Mécriture, celle-1a ne pouvant au mieux que
««profonger »celle-i(verbe récurrent sous la plume de
‘Macé), un rapport & Teruvre qui ne peut étre que «le
desir d imitation» (quil faut, précise-telle page 207,
‘«arracher é wn sentiment trop simple daliénation »).
la logique du «consentement» ici réenchanté, le retour
conven au «modéle», tout un «hovarysme lecteur»
docile et assujetti pour lequel la référence & Jacques
Raneire est pour le moins 4 contre-emploi (le paral-
le étant delle, et pas de lui, entre Emma perplexe
face aux mots diffciles et les prolétaires, ses vonter-
porains, voulant donner un sens aux grands mots de
emancipation politique). Higrarchie constamment
martelée : «les phrases [Iues] nous devaneent» (p.
203) et «f'écrivain [..] marche devant moi» (p. 215), et
Sil este aux auteurs-lecteurs le recours la citation,
Cet juste «pour ne pas étre seul d écrire» (p. 217), les
détournements et les stratégies dela citation semblant
‘impensables, comme sils n’vaient pas été explorés
illya déja plus de trente ans’.
Et la solitude en question, parfois brisée par la
citation ou menacée par la relation, ne gagne rien &
etre, dans univers idiosyncratique de Macé, car lire
ici cist aussi le risque de basculer «du plaisir d'éire
soi la menace de ne pas étre le seul a éire tel» : ai
décrit-elle la «blessure du lecteur» quand il réalise
que ce qui avait era &tre Alvi «était déja dit ailleurs,
ef mieux, par un autre» (p. 230-231), sans que nulle
part puisse étre envisagée la reduction de cette méme
solitude telle que peuvent y conduire la lecture et
ses latéralités, son nuancier social et ses jeux (dé)
ientificatoires ~ «lire n'est pas autre chose iss
‘relle méme dans une parenthse stupéfiante, «{que]
devoirentendre sans cesse d'autres “moi..» (p-233).
(Chez Macé, en un mot, la lecture est le grand paral-
[ele des egos on lit seul, on écrit seul, et tant mieux,
‘murmure--elle, pour la littérature,
La lecture, un acte collectif et politique
Le fantasme auguel ressortit une telle lecture est
celui d'une table rase des contextes et des interac-
tions, le fantasme d'un lecteur en feuille blanche sur
laquelle s‘inserirait expérience de lecture et que
Yiendrait plier la forme méme de Feuvre. Fantasme
dominateur qui ne laisse pas de poser probleme,
sans que les jolis oxymores forgés par Pauteure ne
nous fournissent de solution : Ia lecture comme
«force {d'un} abandon », ou «émancipation dans
Facquiescement une influence ». Le critique amé-
ricain Harold Bloom, avant de devenir derridien puis
conservateur, avait jadis tiré de cette veille question
de influence (des textes les uns sur les autres, du lu
sure lecteur.) des pistes autrement prometteuses*
‘Au contraire, si quelque chose comme une éman-
cipation par la lecture est possible ~ mais rien n'est
moins sir n'est-ce pas aussi, sinon méme avant
tout, par le dépassement de Vindividualité, ou au
‘moins son déplacement, parle renversement & méme
Vacte de lecture des higrarchies canoniques, par
Varrachement @ la transcendance de Veuvre? A la
fin de son essai, Marielle Macé va jusqu’a recom-
rmander un retour vers a substantialité de leeuvre
contre les devenirs et les désirs que «la pensée des
années 1970.4 justement thématisels}», un retour aux
modes et aux influences contre «Jes injonetions
contemporaines [.] au ressatsissemiend souverain de
EXTRAIT / xvIEXViI
SIECLES, EXPERIENCES COLLECTIVES DE LA LECTURE
cette représcntation dela lecture de
Tindvialit, les homes di
‘r'sgcleen on oppose une ate of une
lecture haute voit tassemble une fall,
‘une maisonnce, dansune éeoite partagée,
[CT En consiraisintimplictement ane
‘poston entre la lecture slencicse
titan t noble et la etune haute voix
(pout les autres mais asl pour so-méme),
populaie et paysanne, les images et les
fetes dela seconde moti du xv isle
indiquent Ie ve d'une lecture del
Iransparence,rassemblantsgeset conditions
sttour du livre decitit,
En fit, construction de ces deux
mages antithétiques de a lesture, maniges
au xvi see pour fire ressortirles
‘postions ente vile t campagne, ltrs
tt paysan,frivole et vertu, masque
esistence autres relations a Téerit
imprimé ole tent est decile en
‘commun, i par ceux qui sven eu qui
Savent mains ou pas du tout, paris manié
‘ou labor colletivement, Alrxv sible, de
fels usages de Timprimé peuvent etre
econmus dans les sesembles protestants,
les prtiquesdatlo, les eonecres fests,
‘nscrivant le maniement du ivre dans un
cnsemble d experiences fondamentales.
habituant méme les analphabetes &
encontrer impr, ats plus familie,
iv apprvoie, Pour le peuple tan,
Cette relation collective aux mateiauxsortis
des presses sans daute te dune
‘importance déesve,autorisant une
progresivesasculturstion typographiqae
Parallel ou substtase au apprentisages
Scolsires. Deux silos plus tard, de tls
sages ne sont pas perdus, ct a ille les
fccasons une lecture communautaire i
‘nest pas seulement écoate dw lester sant
|Uhaute voix mais rppert direct, physique
veel matéria imprime, sont ombreuses
‘tour de marehands de chanson, face aux
Mfiches et placards, pus tard dans les clubs
‘tle sections, Ente les eleutes da privé et
les lctures des veilles, authentiques ot
idealiaces, existent done autres stations
de lecture ot salient es competences
indvidelles, 08 sai wa rapport,
pedagogique immedi et spontané.
Roger Chartier, «Du ives ie
Roger Charter ir), Pravques tela
Fecture, Paris, Payot, 1985, 96-100.
soi» (qu'elle voit a tort comme le propre des «philo-
sophies modernes dela difference», p. 261), et vers la
vvie-comme-ceuvre contre la «ite» vers Vextérieur
difficile de ne pas voir dans un tel retour une sacrée
rézression, et dans une telle psychologic relation
nelle de la lecture littéraire un coup de grace porté
la théorie littéraire en France, apres trois décen-
ries passées i la dépolitiser et a la reterritorialiser.
ifficile aussi de ne pas voir dans cet angle mort
de la lecture «2-plus-d'un» la raison majeure d'une
résistance frangaise encore forte aujourd'hui aux
politiques anglo-américaines de la lecture littéraire.
Inversement, en face, Fessor depuis un quart de sigele
des champs d'études identitaires et minoritaires
dans les départements de littérature outre-Atlan-
tigue sxplique aussi, et peut-étre avant tout, par la
ccentralité de la question de la lecture dans le champ
litigraire américain et dans Phistoire de Tuniversité
étatsunienne ~ ot la discipline reine des humanités
4 toujours été proto-coloniale : « English literature»
induisant en effet ds le départ cette distance critique
au canon par laquelle la lecture litéraire peut deve-
nis un enjeu collect.
‘Meme plus ou moins décollectivisée au fil des trois
derniers sitcles par lvolution des structures sociales
et des pratiques culturelles (comme le montre le
travail historique de Roger Chartier), la lecture,
Tittéraire ou philosophique, engage toujours dire
tement [2tre-ensemble, ct peut méme en renouveler
les modalités,
Trois innovations des derniéres décennies. qu'on
sien rgjouisse ou les regrette, en attestent ainsi a coup
sir, sans parvenir pour autant a ébranler les certi-
tudes inactuelles des phénoménologues de la lecture.
‘Trois exemples sans rapport ni commune mesure
Ty a bien sir les pratiques américaines de redé-
coupage et de recomposition de la communauté
lectrice en fonction des identités, officiclles ou sub-
jectives, imposées ou déniges, des lecteurs, lesquels
‘rouvent dans la critique des canons littéraires blancs,
européens et masculins, du moins au sein de Puni-
versité, les ressources de nouvelles subjectivations
collectives et de nouvelles stratégies énonciatives.
Mais ily a aussi, dans un tout autre genre, ce que
Taucuns appellent le «tournant festivatier®» de la
littérature: la multiplication récente des salons, des
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Petits Loustics 1Document58 pagesLes Petits Loustics 1Pilarh100% (5)
- Courrier International 2013Document56 pagesCourrier International 2013perico1962Pas encore d'évaluation
- Le Guide Des Metiers Et Competences 5 2008 2009Document196 pagesLe Guide Des Metiers Et Competences 5 2008 2009thyry100% (2)
- Littératures Policières Pour La JeunesseDocument16 pagesLittératures Policières Pour La Jeunessela médiatheque de MeudonPas encore d'évaluation
- MoebiusDocument2 pagesMoebiusdavidlevraiPas encore d'évaluation
- Faits Et Documents 321Document12 pagesFaits Et Documents 321stefstefanoPas encore d'évaluation
- Repertoire Methodes Fos PDFDocument17 pagesRepertoire Methodes Fos PDFRocsaine100% (2)
- Le Quotidien Urbain Essais Sur Les Temps Des VillesDocument187 pagesLe Quotidien Urbain Essais Sur Les Temps Des VillesachlihiPas encore d'évaluation
- Rebatet Lucien Romain - Les Mémoires D'un Fasciste - Tome IIDocument146 pagesRebatet Lucien Romain - Les Mémoires D'un Fasciste - Tome IImarkck12345Pas encore d'évaluation
- AD Collector Hors-Série No.13 - Special Design 2015Document228 pagesAD Collector Hors-Série No.13 - Special Design 2015skechroudbeghdadiPas encore d'évaluation
- Nouvelles MythologiesDocument2 pagesNouvelles MythologiesVincenzo SqueoPas encore d'évaluation
- 1287 PDFDocument24 pages1287 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Edition N°17Document8 pagesEdition N°17villevequePas encore d'évaluation
- Le Survenant PDFDocument367 pagesLe Survenant PDFhappybacon22Pas encore d'évaluation
- La Tribune 2012-01-30Document24 pagesLa Tribune 2012-01-30senialesPas encore d'évaluation
- Simone Bodève BiographieDocument27 pagesSimone Bodève BiographieDominique HoffmanPas encore d'évaluation
- La Lettre de La FFJDR n.3 - Janvier 1998Document21 pagesLa Lettre de La FFJDR n.3 - Janvier 1998vil_farfadetPas encore d'évaluation
- Desvois. La PresseDocument33 pagesDesvois. La PressevzaccariPas encore d'évaluation
- TzeinerlinDocument2 pagesTzeinerlintikepoPas encore d'évaluation
- BouquinsDocument13 pagesBouquinsSkro98990% (1)
- Conditions de SoutenancesDocument3 pagesConditions de SoutenancesMourad MakhloufPas encore d'évaluation
- FG Revue PresseDocument2 pagesFG Revue PresseambinintsoaPas encore d'évaluation
- Lou Gal - N°31 Du 1er Octobre 1916 (2ème Année)Document4 pagesLou Gal - N°31 Du 1er Octobre 1916 (2ème Année)Occitanica Médiathèque Numérique OccitanePas encore d'évaluation
- La Lecture de L'image D'information - Intervention de Roger CussolDocument2 pagesLa Lecture de L'image D'information - Intervention de Roger CussolCRDP LimousinPas encore d'évaluation
- Dossier Pedagogique 2016Document36 pagesDossier Pedagogique 2016Juliana SantosPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Francais Espagnol PDFDocument333 pagesDictionnaire Francais Espagnol PDFJulian LadinoPas encore d'évaluation