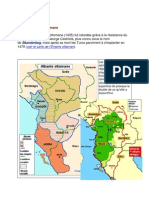Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Patrolixe Part40
Patrolixe Part40
Transféré par
derfgh2Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Patrolixe Part40
Patrolixe Part40
Transféré par
derfgh2Droits d'auteur :
Formats disponibles
CHAPITRE
LES GRECS
SI.
XIII
'.
crivains htrodoxes. Svre d'Antioche.
Quatre hrsies surtout ont troubl, pendant la priode que nous tudions, l'glise grecque
le nestoria-
monophysisme, le monothlisme et Terreur
iconoclaste. Mais la premire, exile d'abord Edesse,
nisme,
le
puis chasse de l'empire en 457 et 489, n'est gure
plus reprsente que par des auteurs de langue syriaque. Photius a seulement signal {cod. 42 et 107)
nestorien d'Antioche, Basile de Cilicie
un prtre
(premire moiti du vi sicle), qui crivit, en trois
une histoire commenant avec le rgne de Marcien (450) et se poursuivant jusqu' la fin du rgne de
livres,
et, en seize livres, un ouvrage d'invectives
de controverse contre Jean de Scythopolis ^ le tout<
est perdu. D'autre part, les premiers adversaires des
images ne paraissent pas avoir crit. Nous n'aurons
donc parler ici que des crivains grecs monophysites et monothlithes.
Parmi les monophysites eux-mmes, il faut distin-
Justin (527)
et
\. Sur tout ce chapitre on peut voir J. Pargoire, L'glise byzantine
de 527 847, Paris, 1905.
2. Photius souponne (cod. 93) qu'il tait aussi l'auteur d'un ouvrage
Contre Nestorius, rfut par Jean de Scythopolis; mais cela parat bien
invraisemblable, puisque cet ouvrage soutenait le monophysismC;
PRECIS DE PATROLOGIE.
376
guer avec soin le parti eiitychien^ qui admettait une
sorte de fusion en une seule nature des deux lments,
divin et humain, qui composaient la personne de JsusChrist, et le parti proprement monophysite qui, tout
en confessant la distinction relle de ces lments
mme aprs l'union, se refusait dire deux natures
et repoussait la terminologie et les dcisions du conde Chalcdoine.
L'eutychianisme avait sa source dans l'enseignement
personnel d Eutychs, lequel avait dclar, au concile
de Constantinople de 448, qu'il ne regardait pas l'humanit de Jsus-Christ comme consubstantielle la
ntre. Il ne semble pas qu'Eutychs ait crit autre
chose que quelques lettres. Plus tard, vers 515-519,
un de ses partisans, Sergius le Grammairien, eut,
avec Svre d'Antioche, une discussion par correspondance dont les pices existent encore, et la fm de laquelle Sergius s'avoua vaincu^. Par contre, Svre
rencontra une absolue rsistance dans un autre monophysite tendance eutychienne, l'vque d'Halicarnasse, Julien, chef des aphthartodoctes ou incorrupticoles, qui regardaient le corps de Jsus-Christ, mme
pendant sa vie mortelle, comme incorruptible et immuable dans ses lments. La controverse commena
avant 528. C'est dans des traductions syriaques surtout que se sont conserves les uvres de Julien. Elles
comprennent des lettres, un tome de discussions patristiques, des Additions, une Apologie, des traits
notamment contre les eutychianistesetles manichens,
etc. Un commentaire sur Job, conserv en grec, n'a
t dit compltement que dans une traduction lacile
tine
\.
^.
Voir J. Lebon, Le
538 et suiv.
;
Voir J. Lebon, Op.
monophysisme
svrien, Louvain, 1009, p. 463 et
suiv.
2.
cit., p.
173 et suiv. et les rfrences qu'il donne.
TROISIME PRIODE. LES GRECS.
377
Cependant le parti eutychien ne comptait en somme
que le plus petit nombre des adversaires du concile
de Chalcdoine. Le gros de l'opposition tait form
par le parti proprement monophysite. C'est l aussi
que se trouvaient les meilleures ttes. Entre les crivains qui l'ont illustr,
il
faut
nommer
le
patriarche
DioscouE, successeur de saint Cyrille Alexandrie,
dpos en 451 et mort en exil en 454 on connat de
lui des lettres et fragments de lettres et peut-tre six
anathmatismes contre le concile de Chalcdoine^;
puis son successeur monophysite, Timothe JElvru
[f vers 477), auteur de deux crits contre le mme
concile et le tome de saint Lon, de lettres et d'un
Licre de rcits sur le& controverses du temps ^ puis
un moine nomm Cyrus, signal par Gennadius Vir.
et
ilL, 81), auteur d'un ouvrage contre Nestorius
:
enfin et surtout le patriarche d'Antioche,
Svre.
n Sozopolis en Pisidie, de parents
paens, avait tudi Alexandrie et Beyrouth avant d'tre baptis Tripoli en 488. Devenu moine Maouma
prs de Gaza et ordonn prtre, il fait Constantinople
un premier sjour en 508-511, et est lev par lesmonophysites sur le sige d'Antioche en 512. Mais il doit
se retirer en Egypte en 518, la suite du triomphe de
l'orthodoxie sous l'empereur Justin. Justinien cepen-
Svre
^,
dition d'Origne par Gnbrabd, Paris, 1574. H. Usener, AAetn.
Musum,
N. F., LV (1900), 321-340.
Voir J. Lebon, Op. cit., p. 84 et suiv.
2. Voir J.Lebon, Op. cit., p. 9i et suiv., etson articleLa Christologie de
4.
Timothe Mlure dans
la
Revue d'histoire ecclsiastique,
ix (1908), t>77et
Buiv.
3.
On
n'a
ancune collection un peu complte de ses
oeuvres. L.
w^
Brooks, The sixth book of the slect Letters of Severus, Londres, 1902hymnes et lettres dans Pafrol. orient, iv, vi-vni, Kii,
XIV, XVI, XVIII. Fragments et citations dans P. G., lxxxvi, 1 et 2. Doctrina
Patrum (dit. Diekamp), etc. Voir J. Lebon, Le monophysisme svrien,
p. 118 et suiv. M. Peisker, Severus von Antiochien, Halle, 1903; et les
ouvrages sur Lonce de Byzance.
1004. Homnliei!,
PRCIS DE PATROLOGIE.
378
Constantinople en 534-535
dant
le rappelle
reste
un an ou deux. Oblig de
il
quitter la ville imp-
riale par une nouvelle raction chalcdonienne, il va
mourir Xos, au sud d'Alexandrie, le 8 fvrier 538.
Au point de vue moral, Svre est imprieux et dur:
c'est un sectaire intrigant et hardi
au point de vue
:
intellectuel, c'est
un
esprit puissant et souple, le meil-
mieux quilibr et le plus fcond
de son parti. Prtendant n'tre que le fidle disciple
de saint Cyrille d'Alexandrie, s'il combat de toutes
ses forces contre l'orthodoxie chalcdonienne, il ne bataille pas avec moins d'ardeur contre l'eutychianisme
leur thologien, le
proprement
dit, et contre ce qui lui parat y conduire,
de Julien d'Halicarnasse. Ses uvres, traduites de bonne heure en syriaque, sont encore en
grande partie indites. On connat de lui des lettres,
des homlies, des hymnes, des crits de polmique et
de controverse; deux traits contre Nephalius; un Cyrille ou Philalte, qui est de 509-511; une dfense du
Philalte, qui est de 510-512; un ouvrage
le plus
important de tous
contre Jean le Grammairien
(vers 519) une rfutation de deux ouvrages de Julien
d'Halicarnasse (avant 528), etc. Sa plume infatigable
renouvelle sans cesse ses arguments quand ses adversaires croient l'avoir saisi, il est encore assez subtil
pour leur chapper.
l'erreur
Du monophysisme
sortit la secte des Agnotes dont
fondateur ou du moins le principal dfenseur fut un
diacre svrien d'Alexandrie nomm Themistius (vers
le
540). Photius [cod. 108) a connu de lui une Apologie
dans laquelle il soutenait son erreur et [cod. 23) un
crit contre Jean Philopon.
Ce Jean Philopon, grammairien alexandrin du milieu du vi sicle, est le principal reprsentant de ces
monophysites qui, par suite d'un abus de terminologie,
TROISIME PRIODE. LES GRECS.
879
encoururent le reproche de trithisme. On a de lui
un ouvrage trinitaire et christolog'ique intitul V Aret entirement en
bitre, conserv en partie en grec
syriaque, des traits Sur l'ternit du monde contre
Proclus ^, un commentaire Sur la cration du monde^,
un trait Sur la rsurrecet un livre Sur la Pque^
tion est perdu. A ce parti trithiste appartenait aussi
Etienne Gobaros (vers 600) dont Photius [cod. 232) a
analys une compilation singulire, suite de tmoignages contradictoires sur le mme sujet, qui rappelle
^
non d'Abailard.
le Sic et
Les auteurs mentionns jusqu'ici sont tous des thologiens; mais les monophysites grecs se sont aussi
servis de l'histoire pour combattre leurs adversaires orthodoxes.
Le premier en date de leurs historiens et l'un des
plus importants est Zacharie, vque de Mitylne, surnomm le Rhteur. Peu aprs 491 et tant encore laque,
crivit
il
une Histoire
fort prcieuse des
vnements
qui vont de 450 jusqu'en 491. L'original grec de cette
histoire a pri, mais elle s'est retrouve traduite ou remanie en syriaque et engage dans une compilation
historique du vi" sicle en douze livres, dont elle forme
les livres iii-vi. On possde encore de Zacharie, en
grec un dialogue Sur la cration du monde et un fragment d'ouvrage contre les manichens et, dans des
traductions syriaques, une Vie du moine hae (-f 488)
et une Vie de Svre d'Antioche. Ses Vies de Pierre
ribrien et de Thodore d'Antino sont perdues ^.
C'est peu aprs Zacharie (vers 515) que l'vque de
1.
Voir
s.
Jean damascne,
De
haeresibus, 83.
dit. H. Rabe, Leipzig, 4899.
3. dit. G. Reichardt, Leipzig, 4897.
4. dit. C. Walter, lena, 1899.
8. Traductions de l'Histoire par K. Ahrkns
2.
et G. Kruf.ger, Die sogen
Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, Leipzig, 4899, et per Hamilton
PRCIS DE PATROLOGIE.
380
Maouma, Jean Rufus, composa ses Plropkories\
conserves encore dans une traduction syriaque. Elles
ne mritent gure le nom d'histoire, car elles ne font
que rapporter une suite de visions, de prdictions et
de prodiges, tous dirigs contre le concile de Clialcdoine c'est une uvre de basse polmique.
Enfin, vers l'an 700, l'vque Jean de Nikiou crivit,
au point de vue monophysite, une chronique qui commence avec l'origine du monde, et qui est importante
pour ce qu'elle rapporte du vu" sicle de notre re.
Elle s'est conserve dans une traduction thiopienne.
On se demande seulement si la langue originale en
tait le grec ou le copte ^.
:
est infiniment moins riche
monophysite en uvres et en crivains. Ses principaux chefs, Sergius de Constantinople (610-638), Cyrus de Phasis et ensuite d'Alexandrie (631-641), Pyrrhus (638-641) et Paul (641-654) de
Constantinople n'ont gure crit que des lettres, dont
quelques-unes sont restes clbres, celle de Sergius
au pape Honorius par exemple. On les trouve dans les
collections des conciles. Le plus fcond crivain de
la secte parat avoir t l'vque de Pharan, Thodore,
condamn au concile de Latran de 649. Le concile fit
lire, dans la troisime session, divers extraits de ses u-
La littrature monothlite
que
la littrature
notamment d'un trait Des oprations du Christ,
adress Sergius d'Arsino, d'un commentaire sur
divers passages des saints Pres et d'une Lettre
vres,
et Brooks, Londres, 1899. La Vie de Svre est dans la Pairologia
orienialis, il (Kugener); la Vie d'Isaie dans Corpus script, christ,
oriental.. Script., syri, srie m, vol. xxv, Paris, 1907 (Bhooks). Les textes
grecs (ians P. G., lxxxv, 10H-H44, et Pitp.a, Analecta sacra, i, 67-70.
1. dit. F. Nau, dans Pairologia orienialis, vin.
2. dit. H. ZoTENBERG, dans Extrait des Notices des manuscrits, xxiv,
1, Paris, 1883.
TROISIME PRIODE. LS GRECS.
S81
Paul. Le patriarche d'Antioche, Macaire, condamn
au concile de Gonstantinople de 681, est galement
l'auteur d'une Profession de foi prsente au concile.
2.
Le Pseudo-Denys l'Aropagite
i.
Entre les autorits souvent invoques dans les luttes
monopliysites et surtout monothlites, se trouvent les
crits d'un auteur qui se nomme lui-mme Denys et
veut videmment passer pour saint Denys l'Aropagite, disciple de saint Paul etvque d'Athnes. Nous
avons encore ces crits. Ils comprennent quatre traits
et dix lettres.
Les traits sont ddis par l'auteur son collgue
en presbytrat ((u(x7vpa:6xef)o),Timothe. C'est d'abord
un livre Sur la hirarchie cleste (lcpt t^ opaviot
tspap/^i'ai;) en quinze chapitres, qui traite des anges, de
leurs fonctions et de leurs noms, et de leurs ordres
respectifs. C'est l que, pour la premire fois, on
trouve les anges distribus en trois classes comprenant
elles-mmes chacune trois choeurs ce sont, par ordre
descendant, les sraphins, les chrubins et les trnes,
occups seulement de Dieu; les dominations, les puissances et les vertus, qui est confi le soin du monde
en gnral; les principauts, les archanges et les
anges, qui doivent veiller sur les hommes en particu:
lier.
Le second
(Ilepi
T^
trait,
De
ExxXriffiaffxtx^;
montre d'abord que
la hirarchie ecclsiastique
epap;(^ta),
en sept chapitres,
cette hirarchie est calque sur la
hirarchie cleste, et exerce des fonctions analogues.
Puis
il
dcrit les rites
uvres dans
du
baptraie,
de l'eucharistie,
P. G., m, iv. Traduct. franc. parDARBOv, 1845 et Dulaw,
Les travaux capitau": sont ceux de J. Stigujiayr, dans de nombreux
articles, 189j-1900, et de Koch, Mayence, 1900-11901.
1.
185.
DE PATROLOGIE.
PRCIS
3S2
de la confirmation, des diverses ordinations (vques,
prtres et diacres) et de la profession monastique solennelle. Viennent enfin des indications sur les cr-
monies des funrailles et sur le baptme des enfants.
C'est dans cet ouvrage que l'on a cru trouver plus
tard indiqus les trois degrs de la vie spirituelle,
voie purgative, voie illuminatie, voie unitive.
Le troisime
[jLaTtov)
s'est
Des noms
divins
(lepl et'wv ovo-
explique, en treize chapitres, les
noms que Dieu
trait
donns lui-mme dans l'Ecriture,
et qui
nous
font connatre ses perfections.
De la thologie mystique
en cinq chapitres, traite de
Enfin, le quatrime trait.
(Ilepi Ti [AucTixT^ EoXoYta),
Dieu comme de l'tre superintelligible et ineffable,
qui cependant nous pouvons tre unis, ds cette vie,
d'une union intime et plus ou moins extatique.
Les dix lettres que nous possdons sont adresses,
les quatre premires au thrapeute (moine) Caius la
cinquime au liturge (diacre) Dorothe sur l'obscurit
divine; la sixime au prtre Sosipater; la septime au
hirarque (vque) Polycarpe; la huitime au moine
Dmophile; la neuvime au hirarque Tite; la dixime
;
Jean le Thologien, aptre et vangliste, exil
de Patmos
Trois autres lettres qui n'exisTimothe et
Tite, ne sont pas de l'auteur des crits aropagitiques.
C'est au colloque qui se tint, en 533, Constanti-
dans
l'le
tent plus qu'en latin, Allophanes,
nople, entre catholiques et
monophy sites svriens, que
ces crits firent, pour la premire fois, leur apparition.
Cits par les svriens comme l'uvre de Denys l'A-
ropagite,
comme un
ils
furent repousss par les catholiques
Au sicle suivant cependant, les
faux.
catholiques eux-mmes, sous l'influence surtout de
saint Maxime le Confesseur qui les commenta, en
admirent l'authenticit, et cette acceptation persvra
TROISIME PERIODE. LES GRECS.
383
pendant tout le moyen ge. Peu d'ouvrages ont joui,
parmi les thologiens de cette poque, d'autant de
prestige et d'autorit.
Il n'est
pas douteux cependant qu'ils ne soient
l'uvre d'un faussaire. L'auteur n'est srement pas,
comme il le prtend, un contemporain des aptres, de
Tite. de Tiraothe, de Polycarpe
il n'a connu ni la
Sainte Vierge ni saint Jean. Ses livres supposent le
monacliisme florissant et organis il a lu et il exploite
les crits du noplatonicien Proclus (411-485), et cite
;
notamment son
trait
De malorum
subsistentia;
il
parle de l'usage de chanter le Credo la messe, usage
qui n'a t introduit par les monophysites Antioche
qu'en 476 et que les catholiques n'adoptrent qu'aprs
eux.
Comme,
Svre
qu'il
d'autre part, ses ouvrages sont cits par
d' Antioche et,
au plus tard, en 533, il s'ensuit
fin du v* ou dans les premires
On ne saurait le faire remonter
a d crire vers la
annes du
vi^ sicle.
plus haut.
Qui est, en ralit, cet auteur? On n'a pu, jusqu'
prsent, le dterminer. Seulement, le fait qu'il a t
mis en avant d'abord par les monophysites, et le soin
qu'il a pris lui-mme, en parlant de Jsus-Christ, d'viter les termes une ou deux natures, tout en enseignant l'existence d' une nouvelle opration thandrique , font souponner que cet auteur tait un
partisan de Vhnotlque promulgu en 482, c'est--dire
un monophysite politique, s'intressant peut-tre assez
peu aux controverses de son temps. 11 semble qu'il ait
en Syrie plutt qu'en Egypte.
srement un philosophe et un esprit qui ne
manquait ni d'originalit ni de puissance. L'intrt de
son uvre est dans la tentative qu'il a faite, d'une
part, pour introduire dans la thologie chrtienne les
conceptions et les procds noplatoniciens et, de
crit
C'tait
PRCIS DE PATROLOGIE.
384
l'autre, pour donner un expos rigoureux de la thologie mystique et la souder troitement la thologie
ecclsiastique, dont elle ne parat tre, dans son sys-
tme, qu'une interprtation plus haute . Son style est
gnralement manir et obscur, rempli de mots
forgs exprs et de termes emprunts la langue des
anciens mystres paens. Il lui a paru que cette obscurit voulue convenait bien la hauteur des enseigne-
ments qu'il voulait donner.
Le pseudo-Aropagite fait plusieurs
fois mention,
dans ses uvres, d'un certain Hirothe qui aurait t
son matre, et qui il attribue des ouvrages. On ne
sait ce qu'il en faut croire. Il existe bien, en syriaque,
un Livre d' Hirothe sur les mystres cachs de la
Divinit, que l'on croit compos par le moine panthiste Bar Sudali (vers 500)
mais Bar Sudali a pu
prendre lui-mme ce nom aux ouvrages de Denys.
;
3.
Les adversaires du taonophysisme. Lonce
de Byzauce.
Le premier paragraphe de ce chapitre a brivement
numr les crivains grecs qui attaqurent les dcisions du concile de Chalcdoine ^ Nous parlerons ici
de ceux qui les ont dfendues.
surtout au
tre eux,
il
commencement du
On
les voit apparatre
vi* sicle.
Plusieurs d'en-
est vrai, font leurs adversaires des conces-
sions excessives
dans l'ensemble cependant ils leur
opposent des rponses victorieuses, et fournissent sur
le problme dogmatique des explications que la tho:
logie ultrieure a ratifies.
Voici les principaux
1.
le
moine palestinien Nepha-
Pour avoir une ide plus complte de l'arnia des attaquants, il
aux grecs les monophysites syriens dont il sera question
faut joindre
au chapitre suivant,
S l>
TROISIEME PRIODE. LES GRECS.
385
composa, avant l'an 508, un discours contre
et une apologie du concile de Chalcdoine^; le patriarche de Constantinople, MacedoLius, qui
Svre d'Antioche
Nius (496-511), auteur d'un florilge patristique contre
monophysisme^ ;
Jean le Grammairien, donn
le
comme vque de Csare (en Palestine), qui
une critique du Philalte de Svre (vers 510)
une Apologie du concile de Ghalcdoine (vers 515-
parfois
crivit
et
520) laquelle Svre rpondit par le
6'o/ii{/a
Gramma-
ticum^;
Jean de Scythopolis, auteur lui aussi, vers
515-520, d'une longue apologie du concile de Ghalcdoine et, plus tard, d'un ouvrage contre Svre cit
par le sixime concile gnral de 680'' le moine Jean
Maxence, le porte-parole des moines scythes, adversaire la fois du nestorianisme, du monophysisme et
du plagianisme on a de lui un mmoire aux lgats
d'Hormisdas (519), une rponse la lettre du pape
(520), des Dialogues contre les nestoriens, un Livre
contre les acphales (monophysites) et quelques autres
menus crits^;
un autre moine nomm Jobius (premire moiti du vi sicle), dont Photius [cod. 222) a
signal un ouvrage contre Svre et analys longuement un Commentaire sur l'Incarnation^
un troisime moine, nomm Eustathe, auteur d'une lettre remarquable contre Svre Sur les deux natures '
puis ceux que l'on peut considrer comme les trois prcurseurs et matres de Lonce de Byzance, de leur
temps aussi apprcis que lui l'vque de Ghalcdoine,
Heraclien (commencement du vi sicle), auteur d'un
;
l.Voir Leeon, Le monoph. svrien, p. 119 et suiv.
Lebon, ibid., p. -126.
3. Lebon, ibid., p. 128-163.
4. Lebon, ibid., p. 149 et suiv. Cf. F. ^Loofs, Leontius
p. 269 et suiv., note.
5. P. G., LXXSVI, 1, 73-1.S8.
6. Voir P. G., Lxxxvi, 2, 3313-332^.
7. P. G., Lxxxvi, 1, 901-912.
2.
von Byzanz,
22
Vous aimerez peut-être aussi
- Doctrine Catholique Abbé A. BoulengerDocument213 pagesDoctrine Catholique Abbé A. Boulengerynot45100% (2)
- Vladimir Lossky, Essai Sur La Theologie MystiqueDocument145 pagesVladimir Lossky, Essai Sur La Theologie MystiqueAnonymous 52asQOUcy100% (3)
- Misa Melódica - Alejandro MejíaDocument6 pagesMisa Melódica - Alejandro MejíaLeonardo D Amador100% (1)
- Othmān Yahya - Sceau Saintete-TirmiditDocument7 pagesOthmān Yahya - Sceau Saintete-Tirmiditlestylobate100% (1)
- Histoire Des Rites Orientaux PDFDocument35 pagesHistoire Des Rites Orientaux PDF3am100% (2)
- Le Trésor TraitéDocument12 pagesLe Trésor TraitéPère elie AssaadPas encore d'évaluation
- Tixeront. Histoire Des Dogmes. 1906. Volume II.Document554 pagesTixeront. Histoire Des Dogmes. 1906. Volume II.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (2)
- Histoire - ReformeDocument2 pagesHistoire - ReformeMahdi MoghaddamfarPas encore d'évaluation
- Van Deundeacuteveloppements Reacutecents Des Recherches Sur Maxime Le Confesseur Sacris Erudiri 48 2009pdf PDFDocument71 pagesVan Deundeacuteveloppements Reacutecents Des Recherches Sur Maxime Le Confesseur Sacris Erudiri 48 2009pdf PDFBogdan VladutPas encore d'évaluation
- Bulle Pontificale Émise Par Clément XII Contre La Franc-Maçonnerie. (1738)Document3 pagesBulle Pontificale Émise Par Clément XII Contre La Franc-Maçonnerie. (1738)lorelianeGTQPas encore d'évaluation
- Ead 2013-2014Document39 pagesEad 2013-2014Paul BrownPas encore d'évaluation
- Battifol L'abbaye de RossanoDocument238 pagesBattifol L'abbaye de RossanoalextheologPas encore d'évaluation
- Notes Dissidentes Sur La Notion de Tradition PrimordialeDocument10 pagesNotes Dissidentes Sur La Notion de Tradition PrimordialeBelhamissiPas encore d'évaluation
- Les Crises Religieuses À Byzance: Le Schisme Antiarsénite Du Métropolite de Philadelphie Théolepte ( C. 1324)Document11 pagesLes Crises Religieuses À Byzance: Le Schisme Antiarsénite Du Métropolite de Philadelphie Théolepte ( C. 1324)Bozo Seljakot100% (1)
- Histoire de Conciles T.9Document636 pagesHistoire de Conciles T.9Waheed Hassab AllaPas encore d'évaluation
- Aaron Kayayan - L'Organisation de L'église Catholique RomaineDocument10 pagesAaron Kayayan - L'Organisation de L'église Catholique Romainemoulay abdallahPas encore d'évaluation
- Symbolisme Et Théologie Négative Chez Le Pseudo-Denys - PerséeDocument18 pagesSymbolisme Et Théologie Négative Chez Le Pseudo-Denys - PerséenicolasPas encore d'évaluation
- Uiyhgf 5Document480 pagesUiyhgf 5reluPas encore d'évaluation
- Mourret. Histoire Générale de L'église. 1921. Volume 2.Document540 pagesMourret. Histoire Générale de L'église. 1921. Volume 2.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (2)
- Lumière Du Thabor # 25, Décembre 2005Document30 pagesLumière Du Thabor # 25, Décembre 2005Paul LadouceurPas encore d'évaluation
- Rohrbacher. Dufour. Histoire Universelle de L'église Catholique. (1842-1849) - T26. Histoireuniverse26rohrDocument676 pagesRohrbacher. Dufour. Histoire Universelle de L'église Catholique. (1842-1849) - T26. Histoireuniverse26rohrPatrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Richard - Anastase Le SinaiteDocument15 pagesRichard - Anastase Le SinaiteIlias MalevitisPas encore d'évaluation
- L'Albanie OttomaneDocument3 pagesL'Albanie OttomaneismetjakuPas encore d'évaluation
- Le Comportement Humain Et Chrétien Guerre Sainte Reconciliation ArgentDocument13 pagesLe Comportement Humain Et Chrétien Guerre Sainte Reconciliation ArgentPère elie AssaadPas encore d'évaluation
- Table de La ProscomédieDocument36 pagesTable de La ProscomédieaurelmoPas encore d'évaluation
- Httpwwwneotrouvecom Morlier Laurent Le Troisieme Secret de Fatima Publie Par Le Vatican Est Un FauxDocument116 pagesHttpwwwneotrouvecom Morlier Laurent Le Troisieme Secret de Fatima Publie Par Le Vatican Est Un FauxNe1am100% (1)