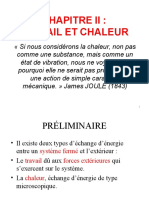Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Complétion ENSPM PDF
Complétion ENSPM PDF
Transféré par
Fa TehTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Complétion ENSPM PDF
Complétion ENSPM PDF
Transféré par
Fa TehDroits d'auteur :
Formats disponibles
Information-Gisement-Forage-Production-Raffinage
FORMATION
INDUSTRIE PRODUCTION, FOND ET SURFACE
Ingénieurs INITIATION À LA PRODUCTION DE FOND
en sécurité
Industrielle
Chapitre 1 : DÉFINITION DE L'ACTIVITÉ "PRODUCTION FOND". ............... .......................... ....... .... ......1
Chapitre 2 : FACTEURS PRINCIPAUX INFLUENÇANT LA CONCEPTION D'UNE COMPLÉTION......... 2
2.1 TYPE DE PUITS..... ..... .. .. .. .. ........... .. ..... ............ .. .. .. .. ...... ... .. .. .. .. .. ... . . .. .. .. ...... .. ....... .. .. .. ..... .. .. ... .. .. .. . . . .2
2.2 OBJET DU PUITS.. ........ .. .. ....... .. .. .. .. ....... .. .... ... . . . .. .. . . .. ..... .... .. .... ....... .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. .... ........... . .. .. .. ... 2
2.3 MODE DE PRODUCTION . ... .. .... .. ......... ............ .. .. .. .. ......... .. .. .. ......... .. .. .. ...... .. . .. .. .. . . .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. . . . .2
2.4 PRÉSENCE D'UNE INTERFACE ENTRE FLUIDES.. .. .. .. . .. .... .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. ........ . .. .. .. ..... .. .. ... .... .. 2
2.5 NOMBRE DE COUCHES À EXPLOITER.. .... ...... .. .. ... ...... .. ..... ...... .. .. .. .. ....... . ... . . .. . . .. . . .. ............ .. .. ... .. 3
2.6 OPÉRATIONS PROBABLES D'ENTRETIEN OU DE REPRISE DE PUITS. .. ........... .. .. .. . . ... .. .. ..... .. .. 3
Chapitre 3 : CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU FORAGE DE LA COUCHE À
EXPLOITER... ...... ..... ... . .. .. ..................................................... .. ...................................... .......... 4
3.1 LE RISQUE D'ÉRUPTION .. .. .... .. ....... .. .. .. .... .... .. .. .. ..... .. .. ........ .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. ...... .. ......... .. ....... ...4
3.2 INFLUENCE DU COLMATAGE SUR LA PRODUCTIVITÉ OU L'INJECTIVITE .. . .. ........ ....... .. .. ... .. .. . 4
3.3 CONSIDÉRATIONS À PROPOS DU DIAMÈTRE DE FORAGE...... .. .. .. .. . ...... ......... . .. .. ... .. .. ..... .. ..... . .4
Chapitre 4 : ÉTABLISSEMENT DE LA LIAISON COUCHE-TROU.......... .. ................................................ 6
4.1 CONFIGURATIONS DE BASE . . ...... .. . .... . .... . . ..... . .. . . .. .. . .. .. . . .. ....... .. .. .. .. .. ... .... ........ .. .. ... .. . ... .......6
4.2 CAS PARTICULIER DES FORMATIONS GRENEUSES INSUFFISAMMENT CONSOLIDEES .......8
Chapitre 5 : OPÉRATIONS SPÉCIALES SUR LA COUCHE......... ........... ...... .. ........... ............. .. ............. .11
5 .1 CONTRÔLE DES SABLES.. .. ..... .. .... .. .. . . .. .... .. .. .. . . ..... .... .. ....... .... .. ... .. .. .. .... ....... .. .. .. .. .... .. ..... .. .... . .. .. .11
5.2 A,CIDIFICATION.. ... ........ .. . . .. .. ........ ... .. .. .. ...... .. .. .. .. ......... .. ....... .. .. .. .. . .. .. .. ............ . I. .. .. ... . .. ..... .. . . .. . .. .. .11
5 .3 FRACTURATION HYDRAULIQUE 11
Chapitre 6 : ÉQUIPEMENT DES PUITS ÉRUPTIFS.......... .. .. .. ..... .... .................. ........................... ........... .14
6 .1 LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ET LEURS FONCTIONS. .. .. ... .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .. .. ....... .. .. .. ... .14
6.2 LES CONFIGURATIONS DE BASE . .. .. .. ..... ..... .... .. ... ... . .. .. .. . .. .. .. .. ... .. . . . . .. .. ..... .. .. .. .. .... .. .. ... .... .. .. ... .. ..22
Chapitre 7 : MISE EN SERVICE ET ÉVALUATION DU PUITS..... .. .......:... .................................. ......... .. ..26
Chapitre 8 : MÉTHODES D'ACTIVATION DES PUITS............................................................................. 27
8.1 LE POMPAGE.... ....... .. ... . . .. . .. .... .. .. ............. ........ .. .. .... . . . .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ........... .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .......27
8.2 LE GAS-LIFT.. ........... .. .. .. .. .. ...... .. . ...... ...... .. ........ .. .. ..... .. .. .. ..... .. .. . .. .. .. .. ......... . . .. .. .. .. .... .. . . . . . .. .. .. ......... 27
Chapitr+e 9 : OPÉRATIONS SUR LES PUITS.......... ............. .............. . . .. .. ................................ .. ...... ....... ..31
9 .1 LE TRAVAIL AU CÂBLE. ..... ...... .. .. .. .. .......... .. .. ..... ... . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. ..... ...... .. ...... ... ....... ... .. .. ....... .. .. ...31
9.2 INTERVENTIONS LOURDES SUR PUITS EN PRESSION .......... ....... .. .. .. .. ........... .... .... ........... .. .. . 32
9.3 INTERVENTIONS SUR LES PUITS TUES . .. .. ....... .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. ....... .. .. .... ... ............ .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .36
Ce document comporte 38 pages
12/12/1994 I Révision O
J
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
CHAPITRE 1
DÉFINITION DE L'ACTIVITÉ
"PRODUCTION FOND"
La production fond, communément appelée aussi complétion, couvre l'ensemble des
opérations qui permettent la mise en service des puits et leur entretien.
Pour mettre le puits en service dans de bonnes conditions il faut, en particulier, concevoir en
conséquence les phases opératoires suivantes
traversée (forage ou carottage) de la ou des couches à exploiter,
établissement d'une liaison couche-trou adaptée,
éventuellement, opérations spéciales sur les couches, telles que
- contrôle des sables,
- stimulation (acidification, fracturation hydraulique, ...)
(on peut être amené à réaliser ces opérations après la mise en service du puits ou plus
tard dans la vie du puits)
équipement proprement dit du puits,
mise en service du puits et évaluation de ses performances .
Si, de fait, les deux premières phases sont généralement réalisées par le foreur, il ne faut pas
perdre de vue que la qualité future du puits (productivité ou injectivité en particulier) dépend
essentiellement des conditions dans lesquelles elles sont effectuées . Le foreur et le compléteur
sont donc amenés à travailler ensemble pour essayer de concilier les contraintes propres au
forage et celles liées à une bonne exploitation de la formation. Par boutade, on pourrait dire que
la complétion commence dès le premier tour de trépan.
Le compléteur intervient en outre durant la vie du puits afin d'effectuer les mesures,
l'entretien et les reprises de puits qui pourraient se révéler nécessaires.
C 1994 ENSPM-Formation Industrie
CHAPITRE 2
FACTEURS PRINCIPAUX INFLUENÇANT
LA CONCEPTION D'UNE COMPLÉTION
2.1 Type de puits
On peut. distinguer principalement les puits d'exploration et les puits de développement .
Nous nous intéresserons plus particulièrement aux puits de développement .
2.2 Objet du puits
Un puits est généralement réalisé pour faire produire un réservoir, mais il peut aussi être
destiné à injecter un fluide dans le réservoir (maintien de pression, balayage) ou à observer lé
comportement du gisement.
2.3 Mode de production
Un puits peut être éruptif, c'est-à-dire que la pression dans le gisement est suffisante pour
compenser les consommations de pression dans le gisement et le puits lorsqu'on produit (pertes
de charge) ainsi que la pression hydrostatique exercée par la colonne de fluide jusqu'en surface
et pour arriver en surface à la pression nécessaire . Si ce n'est pas le cas, on peut, au niveau du
puits, aider le fluide à remonter en surface en utilisant une technique de production activée
adéquate (pompage, gas lift) (cf. chapitre 8).
2.4 Présence d'une interface entre fluides
Dans un gisement d'huile, il peut exister une interface entre l'huile et du gaz où(et) entre
l'huile et de, l'eau. En fonction des caractéristiques relatives à ces différents fluides, et en
particulier la viscosité, on constate que, dans le gisement, la mobilité de l'eau est de l'ordre de
celle de l'huile, alors que celle du gaz leur est bien supérieure. Dans la mesure ou, pour limiter
la diminution de la pression de gisement associée à la production, on désire ne produire que le
fluide souhaité (ici l'huile), il faut essayer de ne réaliser la communication entre le réservoir et le
puits qu'au niveau de la zone à huile.
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
Dans le cas d'un gisement de gaz, ce problème d'interface entre le gaz et un liquide est
beaucoup moins important du fait de la mobilité beaucoup plus grande du gaz.
2.5 Nombre de couches à exploiter
Un même puits peut rencontrer plusieurs niveaux à exploiter (production, injection, ...). On
peut, selon le cas, vouloir en exploiter un seul ou plusieurs, mais séparément. Il faut donc que
la liaison couche-trou (et l'équipement du puits) permette d'isoler ces différents niveaux l'un de
l'autre.
2 .6 Opérations probables d'entretien ou de reprise de puits
En fonction de la nature du gisement et de son évolution dans le temps, un certain nombre
d'opérations peuvent se révéler nécessaires . Parmi celles-ci, on peut citer en particulier
décolmatage ou stimulation de la couche,
contrôle des sables,
changement de zone à exploiter,
changement du mode de production.
Il est nécessaire de penser aussi aux opérations d'entretien et de réparation du matériel en
place dans le puits .
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
CHAPITRE 3
CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU
FORAGE DE LA COUCHE À EXPLOITER
Bien entendu, tout ce qui est dit de manière générale pour le forage reste vrai. Mais il est
nécessaire de bien être conscient d'un certain nombre de points particulièrement importants
lorsqu'il s'agit de la couche à exploiter.
3.1 Le risque d'éruption
La couche à exploiter est, par nature, une zone poreuse, perméable et contenant un fluide
sous pression . Les conditions favorables à une éruption sont réunies. Il faut donc être
particulièrement vigilant .
3.2 Influence du colmatage sur la productivité ou l'injectivité
Une partie du fluide de forage a tendance à filtrer dans la formation, les particules solides
étant retenues au niveau de la paroi et y formant un dépôt appelé "cake" . Il en résulte une
diminution :non négligeable de la productivité ou de finjectivité.
Un endommagement, même très peu profond, peut générer une réduction de productivité
considérable. En conséquence, il faut éviter, lors du forage de la couche, de créer un dommage
permanent. Par contre, il est peut-être acceptable, en fonction de critères techniques et
économiques, d'admettre pendant le forage de la formation à exploiter un colmatage, dans la
mesure où il est techniquement possible de restaurer la productivité ou l'injectivité par la suite.
3.3 Considérations à propos du diamètre de forage
L'indice de productivité augmente peu quand on augmente le diamètre de forage, à moins de
(augmenter de manière considérable, ce qui n'est pas techniquement possible en forage.
© 1994 ENSPIVI-Formation Industrie
En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir disposer de suffisamment de place pour
l'équipement nécessaire dans le puits, c'est-à-dire en particulier pour
une colonne de production (tubing) de diamètre suffisant pour que les pertes de charge
soient acceptables,
plusieurs colonnes de production dans le cas de plusieurs couches à exploiter séparément,
des equipements spécifiques tels que packer, vanne de sécurité de subsurface, poche
latérale pour vanne de gas-lift, ...
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
CHAPITRE 4
ÉTABLISSEMENT DE LA LIAISON
COUCHE-TROU
4.1 Configurations de base
4 .1 .1 Trou ouvert (figure 1)
Cette configuration, appelée aussi trou cuvelé au
toit de la couche ou "open hole", consiste
(après avoir foré, cuvelé et cimenté les terrains
susjacents) à se contenter de la liaison directe
établie par le forage de la couche. Cette solution
simple ne permet malheureusement pas
d'assurer la sélectivité du fluide produit dans le
cas où ii y a présence d'une interface . En
conséquence, et même dans les cas où la tenue des
parois est satisfaisante, cette solution est
assez rarement retenue, surtout pour les puits à huile
.
4 .1 .2 Trou cuvelé (figure 2)
Dans cette configuration, appelée aussi trou cuvelé
au mur de la couche ou "cased hole",
après forage de la couche à exploiter on habillera celle-ci
d'un cuvelage (ou d'un "liner") qui
sera cimenté puis perforé . Du fait que l'on est capable de
placer les perforations de manière tris
précise par rapport à la formation et aux interfaces, cette
méthode aide à assurer une meilleure
sélectivité des fluides produits, à condition toutefois que la cimentation
soit bien étanche . (formation-cuvelage)
La technique actuelle de perforation par charges creuses
permet de rétablir une
communication satisfaisante entre la formation et le puits. On
constate qu'il suffit généralement
de réaliser de 4 à 13 perforations par mètre de couche
pour retrouver la productivité en trou
ouvert, à condition toutefois que ces perforations soient
bien ouvertes et libres de tout débris . . .
Les perforations obtenues ont un diamètre de l'ordre du
centimètre et une pénétration dans la
formation au-delà de la gaine de ciment de l'ordre de 10 à
20 cm.
© 1994 ENSPM-Formation industrie
CUVELAGE DE
PRODUCTION
SUSPENSION
DU LINER
Trou ouvert ,. Liner perforé
FIG . 1
PACKER DE
SUSPENSION
DU LINER
Cuvelage cimenté Liner Cimenté
FIG . 2
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
4.2 Cas particulier des formations gréseuses insuffisamment
consolidées
Dans ce cas, des grains du sable constituant le grès sont arrachés à la formation et entraînés
par le débit. Ce sable est à l'origine de nombreux problèmes pouvant conduire à une diminution
notable de la productivité et de la sécurité, et amener à réaliser des reprises de puits coûteuses.
Parmi ces problèmes, on peut citer en particulier
" l'accumulation de sable en fond de puits, diminuant d'autant la hauteur utile du puits
;
" l'accumulation de sable dans le tubing, bouchant le puits ;
" l'érosion du matériel, et en particulier de la tête de puits, des coudes ;
" les dépôts dans la collecte, les équipements du centre de traitement ;
Si, de manière évidente, la liaison simple en trou ouvert ne permet pas de contrôler
les
venues de sable, il en est de même en trou cuvelé, où la taille des perforations est bien
trop
importante par rapport à celle du sable pour empêcher la production de celui-ci. Il faudra donc
adjoindre à ces liaisons couche-trou un procédé de contrôle des sables satisfaisant.
4 .2 .1 En trou ouvert (figure 3)
On cherche à réaliser un filtre qui retient le sable . Ce filtre peut être réalisé
par une crépine seule. Cette technique, si elle donne de bons résultats dans le cas des
sables grossiers et relativement homogènes en taille, conduit par contre à une réduction
importante de la productivité quand le sable est fin ou qu'il existe des passées argileuses,
en particulier à cause du colmatage de la crépine ;
par gravillonnage : un massif filtrant de "gravier" est mis en place au contact de la
formation . Il est maintenu par une crépine . En général, on choisit un gravier qui est en
moyenne six fois plus gros que le sable à contrôler, le diamètre moyen du gravier utilisé
est de l'ordre du millimètre . La crépine ne sert qu'à maintenir le gravier en place, on peut
donc utiliser une crépine avec des fentes plus importantes que dans le cas du procédé par
crépine seule. Cette méthode offre donc au fluide une section de passage plus importante
et permet d'éviter la détérioration de perméabilité qui se produit dans le cas des crépines
seules, où ce sont principalement les particules fines qui sont entraînées par le fluide et qui
comblent l'espace vide entre la formation et la
1994 ENSPM-Formation Industrie
4 .2 .2 En trou cuvelé (figure 3)
par crépines seules : le point critique est le passage à travers la section réduite que
présentent les perforations . Le sable retenu par les crépines comble peu à peu l'espace
entre les crépines et le cuvelage, puis remplir les perforations . Dans le cas d'un liquide
(huile) les pertes de charge dues simplement au passage à travers les perforations remplies
de sable sont prohibitives. Cette méthode n'est donc pas acceptable . Par contre, du fait de
la très faible viscosité du gaz, ce problème est beaucoup moins critique pour les puits à
gaz
par gravillonnage : le point critique reste le même . Il est donc essentiel que la technique de
mise; en place du gravier permette de remplir effectivement les perforations avec ce gravier
tout en lui gardant au mieux sa haute perméabilité (de l'ordre de 120 Darcys en condition
de surface) ;
par consolidation : dans ce cas, on ne cherche plus à créer un filtre retenant le sable
produit, mais à renforcer la liaison entre les grains de sable. On utilise généralement une
résine thermodurcissable que l'on injecte dans la formation. La difficulté majeure de ce
procédé est d'injecter sur toute la hauteur de la zone à traiter suffisamment de résine pour
consolider de manière acceptable la formation mais pas trop, ce qui pourrait réduire de
manière conséquente la perméabilité . On n'utilise guère ce procédé que sur des zones
homogènes, de faible hauteur, et de préférence en trou cuvelé perforé, pour avoir une
surface faible à traiter et un maximum de chances de la traiter dans son ensemble .
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
Trou ouvert
Trou cuvelé
FIG. 3 Solutions en cas dc contrôle des sables
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
CHAPITRE 5
OPÉRATIONS SPÉCIALES SUR LA COUCHE
5.1 Contrôle des sables
Se référer au paragraphe 4.2 précédent .
5.2 Acidification
Une acidification est un traitement au cours duquel de l'acide est injecté dans la formation
pour améliorer la productivité ou figjectivité du puits. Ce traitement est principalement utilisé
pour restaurer la perméabilité aux abords du trou au-delà de la perméabilité naturelle de 1a
formation alors qu'il n'y a pas de colmatage .
Le type d'acide utilisé dépend de la nature de la formation . Dans les formations carbonatées,
on utilise ;principalement l'acide chlorhydrique qui réagit très bien sur la matrice. Les formations
gréseuses sont beaucoup plus difficiles à traiter.
En pratique, il est nécessaire d'ajouter de nombreux additifs à l'acide pour obtenir de bons
résultats. Il faut en outre vérifier qu'ils sont tous compatibles entre eux et avec les fluides de
formation.
5.3 Fracturation hydraulique
Dans le cas où les débits sont faibles, non pas à cause d'un problème de colmatage mais
parce que la perméabilité naturelle de la matrice est faible, par exemple de l'ordre de 10 mD, il
ne s'agit plus de faciliter l'écoulement uniquement aux abords du puits mais, au contraire, le
plus loin possible dans la formation. Si la formation et les problèmes techniques le permettent,
on peut alors avoir recours à la fracturation hydraulique.
En pompant dans le puits un fluide à un débit plus rapide que ce qui peut filtrer dans la
formation, on va monter en pression et générer ainsi des forces qui vont initier une fracture de
la roche. On développe cette fracture en continuant à pomper, puis des agents de soutènement
(sable, billes...) sont mélangés au fluide (généralement un fluide haute viscosité) et entraînés
dans la fracture par le fluide : ils empêchent la fracture de se refermer lorsque l'on arrête le
pompage en fin de traitement.
1994 ENSPM-Formation Industrie _11
Selon les caractéristiques de la formation et sa profondeur, la fracture se développe
horizontalement (H < 500 m, figure 4) ou verticalement (H > 1 500 m, figure 5). (fin peut citer
les ordres, de grandeur suivants
a) Fracture horizontale (gradient defracturation = 0,23 bar/in)
" épaisseur : 1,5 à 3 mm
" rayon : 20 à 100 m
b) Fracture verticale (gradient de fracturation !-- 0,15 à 0,2 bar/m)
" épaisseur : 5 à 15 mm
" longueur : 100 à 300 m
" hauteur : dépend essentiellement du faciès de la formation
c) Gain de productivité ou, d'injectivité
de l'ordre de 3 dans les cas favorables (effet de colmatage mis a part).
e 1994 ENSPM-Formation Industrie
vue de dessus
FIG. 4 Fracturation horizontale
FIG. 5 Fracturation verticale
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
CHAPITRE 6
ÉQUIPEMENT DES PUITS ÉRUPTIFS
6.1 Les principaux équipements et leurs fonctions
6.1 .1 La tête de puits (figure 6)
C'est l'élément de base assurant la sécurité du puits (vannes maîtresses)
. Elle doit pouvoir
supporter la pression maximum puits fermé. De plus, elle permet
" le réglage du débit en agissant sur la duse latérale,
" l'accès dans la colonne de production ("tubing") pour le travail
sous pression, en
particulier pour les opérations de mesure et d'entretien réalisées par la
technique du travail
au câble ("wire line", Figures 7 et 8) (vannes dite de curage, de pistonnage
ou de sas
raccord de sas) ;
" la suspension de la colonne de production, la réalisation de l'étanchéité entre le
cuvelage et
la colonne de production, l'accès à l'annulaire ainsi créé (tête de tubing ou "tubing head
spool"', figure 9).
6 .1 .2 La colonne de production ("tubing")
C'est un tubulaire récupérable et entièrement contenu dans la partie cuvelée du puits, qui
permet d'acheminer l'effluent du fond du puits jusqu'en surface (ou inversement sur les puits
injecteurs) à une vitesse suffisante pour assurer une remontée convenable de l'ensemble des
phases, mais non excessive, de manière à limiter les pertes de charge.
La colonne de production permet aussi de changer les fluides dans le puits par circulation
colonne-annulaire et, si elle est utilisée avec un packer, de protéger le cuvelage de la corrosion
et des fortes pressions.
6 .1 .3 Les "packers" de production (figure 10)
La fonction principale d'un packer est de réaliser une étanchéité en fond de puits entre la
colonne de ;production et le cuvelage . Ceci permet non seulement de protéger le cuvelage de
l'action du fluide produit ou injecté (corrosion, surpression), mais aussi d'exploiter plusieurs
couches séparément par le même puits .
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
15
VANNE
LATERALE
DE PRODUCTION
VANNE MAITRESSE
SUPERIEURE
PORTE DUSE
VANNE MAITRESSE
INFERIEURE
OLIVE DE SUSPENSION DU TUBING
VANNE LATERALE
SORTIE ESPACE ANNULAIRE
TUBING-CASING
FIG'. 6 Tête de puits
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
FIG. 7 Installation de travail au câble FIG. 8 Train de travail
au câble
© 1994 ENSPM-Formation Industrie J
FIG. 9 Suspension
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
FIG . 1() Packer
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
6.1 .4 Les sièges (figure 11)
Les sièges ou "landing nipples", partie intégrante de la colonne de production, procurent une
gorge d'ancrage et une portée polie permettant d'y laisser en place - et avec étanchéité si
nécessaire - des outils de production descendus au câble dans le puits.
Les principaux outils de production sont les suivants : enregistreurs de pression, bouchon,
vanne de sécurité de subsurface, . .. On équipe en général la colonne de production d'un ou
deux, voire trois sièges .
6 .1 .5 :Les vannes de circulation (figure 12)
Ces équipements, appelés aussi "sliding sleeve" (SS) ou "sliding slide door" (SSD), sont,
comme les sièges, vissés entre deux tubes de la colonne de production et permettent de réaliser
en fond de puits une communication contrôlée entre la colonne de production et l'annulaire
colonne-cuvelage dans le cas où le puits est équipé avec un packer. Ils sont manoeuvrés au
câble.
La présence d'un de ces équipements au-dessus du packer procure un moyen simple de
changer le fluide dans le puits en fin d'équipement : le fluide de complétion, de densité
suffisamment élevée pour contrebalancer la pression de gisement, est remplacé par circulation,
dans l'annulaire, par un fluide dit d'annulaire ou de packer, si possible non corrosif et stable
dans le temps, et dans la colonne de production par un fluide suffisamment léger pour que le
puits soit éruptif (fluide de dégorgement) .
Lorsqu'il sera nécessaire de "tuer" le puits pour intervenir sur celui-ci, il est aussi intéressant
de pouvoir circuler en fond de puits. On peut ainsi remettre facilement dans le puits un fluide de
densité adaptée et vérifier que ce fluide n'a pas été allégé par de l'huile ou du gaz lors de sa mise
en place.
6 .1 .6 Les vannes de sécurité de subsurface
Leur but est de fermer la colonne de production dans le cas d'un problème grave (fuite,
incendie) au niveau de la tête de puits ou, en mer, d'une détérioration de la partie immergée du
puits . Elles sont généralement placées à une profondeur de 30 à 50 m par rapport au sol ou au
fond de la. mer.
Le dispositif le plus fréquent est 1a vanne de sécurité de subsurface pilotée depuis la surface
("Surface Controlled Subsurface Safety Valve : SCSSV") (figure 13) . Elle est maintenue
ouverte grâce à une pression hydraulique importante exercée depuis la surface et transmise par
une ligne de contrôle . La purge, automatique ou manuelle, de cette ligne en surface permet à un
ressort de fermer la vanne. Bien entendu, il existe encore d'autres équipements qui permettent
de résoudre au mieux les différents problèmes qui peuvent se poser.
Q 1994 ENSPM-Formation Industrie
Full bore simple Sélectif Top No Go Bottom No Go
FIG. 11 Sièges
FIG. 12 Vanne de circulation
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
FIG. 13 Vanne pilotée
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
6.2 Les configurations de base
6 .2 .1 ]Les complétions conventionnelles
Une complétion conventionnelle est une complétion dans laquelle on a recours a une (ou
plusieurs) colonnes de production, le reste de l'équipement n'étant pas précisé (existence ou
non d'un packer,...) .
a) Coinplétion simple (figure 14)
L'ensemble de la production est acheminé par une seule colonne de production .
b) Complétion rnultiple (figure 15)
On exploite simultanément et séparément plusieurs couches par des conduits séparés . Les
complétions doubles sont les plus courantes ; dans certains cas, il est réalisé des complétions
triples, voire plus, mais cela complique beaucoup les équipements à mettre en place et surtout
les opérations éventuelles de reprise du puits.
c) Completion sélective (figure 16)
Plusieurs zones isolées entre elles sont produites successivement par la même colonne de
production, la sélection de la zone produite se faisant par la technique du travail au câble.
6 .2 .2 ]Les complétions "tubingless"
Dans ce type de complétion, il n'y a plus de colonne de production récupérable, la
production se faisant directement à travers un tubulaire cimenté .
a) Completion "tubingless" simple (figure 17)
Elle est typique des puits très gros producteurs et se trouve principalement au Moyen-Orient.
b) Completion "tubingless "multiple (figure 18)
Elle est typique des puits très faibles producteurs à horizons multiples ; elle est
particulièrement utilisée aux États-Unis .
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
ü
a
AVEC TUBING ET PACKER AVEC TUBING SEUL
FIG. 14 Complétion simple FIG. 15 Complétion multiple
COLONNE DE PRODUCTION UNIQUE
(TUBING)
DISPOSITIF DE CIRCULATION
FERME OUVERT
FIG. 16 Complétion sélective
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
PLUSIEURS PETITS
CUVELAGES DE
PRODUCTION CIMENTES
FIG . 17 Complétion FIG. 18 Complétion
"Tubingless" simple "Tubingless" multiple
e 1994 ENSPM-Formation Industrie
6 .2 .3 Les complétions miniaturisées
On équipe une complétion de type "tubingless" multiple avec des macaronis de manière à
obtenir, pour chaque tubulaire cimenté, une complétion conventionnelle simple ou multiple .
6.3 Procédure de mise en place de l'équipement
Cette procédure dépend bien entendu des données propres au gisement à exploiter et surtout
de l'équipement qui a été choisi. On peut cependant donner les grandes lignes opératoires
suivantes (cas d'un équipement comprenant une colonne de production équipée en particulier
d'un packer hydraulique récupérable et d'une vanne de circulation)
vérification du B.O.P. ("Blow Out PreventeC ou Bloc d'Obturateurs Préventifs),
assemblage, test et descente de la colonne de production équipée,
suspension de la colonne de production au niveau de la tête de tubing ("tubing head
spool"), .
ancrage du packer par montée en pression dans la colonne de production (pour cela ;
mettre en place un bouchon),
démontage du B.O.P. et remplacement par la tête de production (arbre de noël) après avoir
pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du puits,
changement du fluide dans le puits par circulation pour mettre en place le fluide
d'annulaire et le fluide de dégorgement,
dégorgement du puits et évaluation de ses performances .
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
CHAPITRE 7
MISE EN SERVICE ET ÉVALUATION DU PUITS
Dans la mesure où il a été possible de mettre en place dans la colonne de production un fluide
suffisamrrient léger pour que la pression hydrostatique soit inférieure à la pression de gisement,
la mise en production du puits se fait très simplement en ouvrant les vannes de la tête de puits .
Sinon, on peut, par pistonnage, réduire la pression hydrostatique en fond de puits en diminuant
la hauteur de liquide dans la colonne de production.
On procède alors à une phase de dégorgement pour nettoyer les abords du puits ; cette phase
est très importante pour les caractéristiques futures du puits et en particulier pour les puits
d'injection. On met alors le puits en exploitation, le débit étant contrôlé en agissant sur la duse
en tête de :puits.
On peut évaluer le puits en mesurant le débit en fonction de la pression en tête ou, mieux, en
fonction de la différence de pression entre le gisement et le fond du puits. Pour les puits
producteurs (huile), on peut mesurer d'autres paramètres tels que la teneur en solides, la
proportion de gaz, celle d'eau, ...
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
27
CHAPITRE 8
MÉTHODES D'ACTIVATION DES PUITS
On recourt à l'activation des puits, pour produire des puits non éruptifs ou insuffisamment
éruptifs. E existe principalement deux familles de procédés d'activation : le pompage et le gas-
lift.
8.1 Le pompage
Dans le tubing, et au moins à une profondeur telle que le fluide puisse y arriver de lui-même,
on place une pompe qui fournit au fluide refoulé l'énergie nécessaire à la poursuite de son
chemin vers la tête de puits et le centre de traitement . On distingue plusieurs techniques de
pompage
le pompage par tige (figure 19) : une pompe de fond à piston est actionnée depuis la
surface par l'intermédiaire de tiges et d'un système de va et vient. Ce procédé, bien adapté
aux très faibles débits (quelques mètres cubes par jour), est le plus répandu dans le
monde. Par contre, il est mal adapté aux débits supérieurs à 200 ou 300 m3/j et à des
profondeurs de pompe supérieures à 1 000 à 1 500 m ;
le pompage par pompe centrifuge électrique immergée (figure 20) : en fond de puits un
moteur électrique, alimenté depuis la surface par un câble électrique, entraîne une pompe
centrifuge multiétagée (d'une dizaine à plus de 300 étages) . Ce procédé est adapté à des
débits de 50 à plus de 2 000 m3/j et, de préférence, pour une huile à température modérée
(< 100 - 120°C) ;
le pompage hydraulique (figure 21) : la pompe de fond à piston est accouplée à un moteur
hydraulique à piston actionné depuis la surface par circulation d'huile sous pression. Ce
procédé convient à des débits inférieurs à quelques centaines de mètres cubes par jour,
éventuellement à très forte profondeur (plus de 3 000 m) .
8.2 Le gas-lift
Cette méthode consiste à amplifier le mécanisme naturel d'allégement de l'huile produite par
le gaz associé (libre ou dissous dans le gisement) en injectant du gaz, généralement dans lé
tubing et par l'annulaire . La profondeur du point d'injection et le débit d'injection sont
déterminés de manière à alléger suffisamment la colonne d'effluent et obtenir ainsi une pression
en fond de puits suffisamment basse en fonction du débit désiré . Ce procédé permet de produire
jusqu'à plusieurs milliers de mètres cubes parjour.
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
COUCIIE
PRODUCTRICE
FIG. 19 Installation de pompage par tige
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
CLAPET ANTI-RETOUR
CABLE ELECTRIQUE
PONWE CENTRIFUGE
AIULTI-ETAGEE
SEPARATEUR DE GAZ
(FACULTATIF)
MOTEUR ELECTRIQUE
FIG. 20 Pompage par pompe centrifuge électrique
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
DISTRIBUTEUR
AXE DE LIAISON
CLAPET DE
REFOULEMENT
`CLAPET RESERVOIR
D'ASPIRATION FLUIDE DE PUISSANCE
- PISTON POMPE
CHAMBRE
D'EGALISATION
EQUIPEMENT SURFACE
FIG . 21 Pompage par pompe hydraulique
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
31
CHAPITRE 9
OPÉRATIONS SUR LES PUITS
En dehors des caractéristiques intrinsèques du gisement, la longévité et la performance des
puits dépendent de la maintenance des équipements et de l'adaptabilité des puits aux conditions
de gisement et de production qui évoluent en permanence en cours d'exploitation .
Les opérations que l'on peut être amené à réaliser sur un puits vont de la prise de mesure au
rééquiperrient complet de la colonne de production ou du puits et les moyens utilisés seront
adaptés à l'intervention envisagée.
Les opérations de mesures sont réalisées à la demande du service exploitation et concernent
principalement le suivi du gisement_ Les opérations d'entretien ou de reprise s'intéressent plus à
la liaison hydraulique couche-trou ou à l'équipement du puits.
La plupart des opérations de mesures et quelques opérations de simple entretien sont
effectuées dans le puits en pression avec des unités légères de travail au câble (le wire-line) .
D'autres opérations plus conséquentes sous pression demandent l'emploi d'unités
d'interventions lourdes - de work-over hydraulique - qui permettent la manoeuvre dans le puits
sous pression d'un petit tube concentrique d'un seul tenant comme le coiled tubing ou constitué
de longueurs vissées bout à bout comme le snubbing . Enfin les opérations nécessitant de tuer le
puits et un déséquipement partiel ou total du puits sont réalisées avec des appareils dits de
servicing" qui sont en fait des appareils de forage légers et qui permettent de remonter
if
l'équipement après avoir contrôlé le puits.
9.1 Le; travail au câble
C'est le procédé de base d'intervention sur les puits.
Le travail au câble ou wire-fine est une technique qui permet d'intervenir dans les puits en
exploitation en utilisant une ligne en fil d'acier pour introduire, descendre, placer et repêcher
dans le tubing les outils et instruments de mesure nécessaires à une exploitation rationnelle .
L'équipement de base nécessaire est simple
un treuil constitué d'un tambour sur lequel est enroulé le câble,
un sais avec à un bout un presse étoupe à étanchéité sur le câble et à l'autre un raccord
rapide pour rentrer ou sortir les outils du puits,
un indicateur de profondeur et de tension sur le câble,
un train de travail au câble constitué d'un raccord d'accrochage, de barres de charge et de
différents outillages .
C 1994 ENSPM-Formation Industrie
32
Grâce à cette technique simple, on peut travailler dans le puits, sans le
tuer, sous pression,
sans arrêter la production même. L'équipement étant très léger, il est donc
très mobile, rapide
d'exécution et seulement mis en oeuvre par 2 ou 3 personnes, d'où des économies
d'argent.
Toutefois, il faut souligner que les possibilités offertes par le câble sont limitées et
que le
personnel requis doit être très qualifié.
Le travail au câble permet de réaliser principalement
" le contrôle et nettoyage du tubing ou du fond du puits,
" la prise de mesure et d'échantillons de fluide,
" la mise en place d'outils liés aux opérations de complétion . Certains outils font appel
à un
câble électrique , dans ce ces on utilise un câble conducteur toronné, au lieu du câble
lisse
classique .
9.2 Interventions lourdes sur puits en pression
Les opérations réalisables au câble sont limitées par
" l'impossibilité de circuler un fluide,
" l'impossibilité de faire tourner l'outil descendu dans le puits,
" la faible résistance à la traction du câble.
Les deux, techniques qui suivent permettent de compenser ces lacunes .
9 .2 .1 Le Coiled Tubing
L'unité de coiled tubing (figure 22) est constitué d'un tube métallique continu de 3/4" à 1
1/2" de diamètre (environ 19 à 38 mm) enroulé sur une bobine ("coil") ou tambour qui peut être
descendu ou remonté dans un puits en pression. Pour ce faire, le tube, muni en son extrémité
d'un clapet anti-retour est manoeuvre par un injecteur au travers d'un système d'étanchéité type
B .O.P . (Blow Out Preventer) . Sa mise en oeuvre nécessite une équipe spécialisée d'au moins
trois personnes .
Outre le tube proprement dit constituant le coiled tubing, l'équipement comporte
principalement
un tambour,
un injecteur,
des équipements complémentaires de surface : cabine, centrale d'énergie, grue...,
des accessoires de fond.
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
FIG. 22 Unité de coiled tubing
Le coiled tubing qui permet de réaliser rapidement (appareil léger, pas de vissage de
tube, . ..) et sous pression certaines interventions sur le puits, est avant tout un appareil qui
permet de circuler dans le puits. Il est donc utilisé en particulier pour
" alléger la colonne hydrostatique préalablement à la perforation (perforation en dépression
après équipement),
" démarrer (après stimulation par exemple) un puits éruptif par circulation d'un liquide
"léger" ou par injection d'azote,
" réaliser un "gas-lift" temporaire (lors d'un essai en cours de forage, en attendant une
reprise de puits, ...),
" réduire et optimiser ainsi la section de passage à travers le tubing (puits ayant des
problèmes de ségrégation des phases lourdes suite à une réduction de débit),
" nettoyer le tubing (sable, sel, paraffines, hydrates, . . .) par circulation d'un fluide adapté
(eau, saumure, huile chaude, alcool, ...),
" nettoyer le fond du puits par circulation (dépôt de sable, . ..),
" mettre en place au droit de la ou des zones à traiter de l'acide, des solvants, ...,
" mettre en place par circulation un fluide de neutralisation (en vue d'une reprise de
puits, . . . ).
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
Citons aussi le cas particulier des puits horizontaux où le coiled tubing peut être utilisé
pour
amener des outils dans un drain horizontal, en particulier pour réaliser des diagraphies (dans ce
cas un câble électrique aura été mis en place dans le tube avant son enroulement sur le tambour) .
9 .2 .2 Le Snubbing
Comme, pour le coiled tubing, le "snubbing" (figure 23) permet de descendre dans un puits
en pression un tubulaire muni à son extrémité d'un clapet anti-retour en utilisant un dispositif de
manoeuvre et un système d'étanchéité appropriés .
Mais au lieu d'utiliser un tube enroulé sur un tambour, on utilise des tubes de type "tubing"
que l'on raccorde classiquement par vissage les uns aux autres au fur et à mesure que l'on
descend dans le puits.
Ceci permet d'utiliser des tubes présentant un diamètre plus important que celui du "tube
enroulé" utilisé en coiled tubing. Bien entendu, on reste limité par le tubing qui équipe le puits à
travers lequel il faut pouvoir passer.
Une unité de snubbing se compose essentiellement
" d'un dispositif de manoeuvre des tubes,
" d'un dispositif de sécurité en tête de puits,
" d'une centrale hydraulique .
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
FIG. 23 Unité de snubbing
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
36
A cela il faut ajouter les accessoires de fond quc l'on veut incorporer au tubing manipulé .
L'unité de snubbing offre une meilleure capacité de débit, une meilleure résistance à la
traction et une meilleure capacité de rotation ainsi que la possibilité de mettre du poids sur
l'outil .
Par contre la manoeuvre est plus longue qu'au coiled tubing du fait de la nécessité de visser
les tubes et de faire passer les raccords des tubes à travers le système d'étanchéité en tête de
puits .
La mise; en oeuvre d'une telle unité requiert du personnel spécialisé comprenant en général,
un chef d'unité et trois ou quatre personnes par équipe.
L'unité de snubbing permet bien entendu d'effectuer, mais avec une mise en oeuvre plus
longue, l'ensemble des opérations réalisables au coiled tubing.
Elle permet en outre
" des circulations à débit plus élevé (ce qui peut compenser les manoeuvres plus longues),
" des nettoyages de dépôts durs nécessitant du poids sur l'outil et de la rotation,
" de mettre en place un tubing concentrique "permanent" pour l'injection d'inhibiteur, pour
gas-lift, . . .,
" la pose de bouchon de ciment,
" des reforages "légers" (bouchon de ciment, . . . ),
" certaines instrumentations (repêchage de poisson wire-line ou coiled tubing, ...).
Notons enfin que le snubbing est une technique plus ancienne (apparition en 1928 en
Louisiane),que le coiled tubing (apparition vers 1960) ; toutefois son développement, même aux
États-Unis, a été modeste pendant de nombreuses années .
9.3 Interventions sur les puits tués
Pour certaines interventions sur puits, en particulier quand il est nécessaire de remonter le
tubing et son équipement, il faut "tuer" le puits préalablement, c'est-à-dire, remettre en place
dans le puits un fluide de contrôle exerçant une pression hydrostatique supérieure à la pression
de gisement . On peut alors travailler puits "ouvert" et sans pression en tête.
D'une façon générale, il s'agit de modifier le dispositif de complétion, et les techniques
employées sont exactement les mêmes que celles utilisées lors des complétions initiales .
Pour réaliser les opérations lourdes, les moyens utilisés sont fonction entre autres : de la
profondeur du puits, de l'équipement à remonter, de ce qu'il y a à faire .
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
On peut: utiliser des unités légères dites unités de servicing ou des unités de pulling. Ce sont
des appareils mobiles, légers, de mise en place rapide sur la tête de puits et principalement
à des
destinés à manipuler (monter ou descendre) des tiges de pompage ou des tubings, et ce
limite ce peut être de simples
profondeurs n'excédant généralement pas 2 00(1 ou 2 5()t) m. A la
grues .
forage et
On utilise aussi des unités plus importantes, "comparables" à des appareils de
type léger, moyen ou
appelées classiquement appareils de "work-over" ; ils peuvent être de
lourd.
L'unité d'intervention doit être choisie par rapport à l'opération à réaliser, et ce en fonction
de pompage,
de ses capacités techniques (capacité de levage, possibilité de rotation, capacité
des disponibilités
équipements de sécurité, équipements annexes, . . .), de son coût journalier et
locales . En pratique, malheureusement, le choix privilégie souvent d'abord les disponibilités
sur le coût
locales, puis le coût journalier . Cela ne se révèle pas forcément le plus économique
global de l'opération (durée, résultat, .. .) .
Quelle qu'elle soit, l'unité doit être dotée d'un équipement approprié et spécialisé permettant
et en
de réaliser des interventions dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité,
particulier
du matériel de sécurité (B.O.P., ...),
de pompes haute pression, de bacs de stockage, .. .,
du matériel de levage, vissage et instrumentation adapté aux tubings et aux tiges de forage
de "petit" diamètre utilisé en reprise de puits,
du matériel de travail au câble (y compris de matériel d'instrumentation correspondant),
voire du matériel de diagraphie électrique, . . .
© 1994 ENSPM-Formation Industrie
Vous aimerez peut-être aussi
- Musculation Des BradsDocument20 pagesMusculation Des Bradsderdouri67% (9)
- Enduits Superficiels D'usureDocument31 pagesEnduits Superficiels D'usureAy ChPas encore d'évaluation
- Chapitre I (Potentiel Chimique) 2015Document37 pagesChapitre I (Potentiel Chimique) 2015Chaouki100% (1)
- Aide Memoire Electronique de BaseDocument21 pagesAide Memoire Electronique de Basesamy.j9023100% (3)
- Chromatographie Sur Couche MinceDocument7 pagesChromatographie Sur Couche MinceAmirazePas encore d'évaluation
- MMC Art Et Métier Paris-Tech PDFDocument88 pagesMMC Art Et Métier Paris-Tech PDFTaoufik Ben Hadid100% (3)
- Redondant - Equations - Second Degré - Calcul Du Discriminant DeltaDocument3 pagesRedondant - Equations - Second Degré - Calcul Du Discriminant Deltamy_Scribd_pseudoPas encore d'évaluation
- FiabilitéDocument32 pagesFiabilitéAhmed Souissi75% (8)
- TD Fiche 1: Ensembles Et Relations (2 Séances)Document5 pagesTD Fiche 1: Ensembles Et Relations (2 Séances)wsdhPas encore d'évaluation
- Cables Et ConduitsDocument26 pagesCables Et ConduitsHadja SavanéPas encore d'évaluation
- Chapitre III Caractéristiques de DispersionDocument9 pagesChapitre III Caractéristiques de DispersionIrie Fabrice ZROPas encore d'évaluation
- Cycle de Krebs - Biochimie Métabolique - Hader HaidousDocument13 pagesCycle de Krebs - Biochimie Métabolique - Hader Haidousrobbihad100% (3)
- Examen Avec Solution en Électricité Industrielle-2015Document5 pagesExamen Avec Solution en Électricité Industrielle-2015HØu ÇîNe100% (2)
- Résumé Chapitre03Document20 pagesRésumé Chapitre03maîgaPas encore d'évaluation
- Fonction RéciproqueDocument2 pagesFonction RéciproquePrincicø Law leungPas encore d'évaluation
- Carnet D'aide A L Interpretation Des Ecg-criticalday-VolpeDocument32 pagesCarnet D'aide A L Interpretation Des Ecg-criticalday-VolpeShana LeePas encore d'évaluation
- TD 4Document3 pagesTD 4Abdelhaq DAHMANE100% (1)
- Flexion Transversale ExerciceDocument19 pagesFlexion Transversale ExerciceKais ChromePas encore d'évaluation
- BTS Constructions MétalliquesDocument2 pagesBTS Constructions Métalliquesmehdi_marzougPas encore d'évaluation
- Primitives D'une Fonction en Terminale ES PDFDocument4 pagesPrimitives D'une Fonction en Terminale ES PDFMourad MouradbensalemPas encore d'évaluation
- CCP 2003 MP M1 Corrige PDFDocument8 pagesCCP 2003 MP M1 Corrige PDFYoussef El FahimePas encore d'évaluation
- Topologie Faible Et Meta StabiliteDocument20 pagesTopologie Faible Et Meta Stabiliteamermen007Pas encore d'évaluation
- Laurent GornetDocument58 pagesLaurent GornetPHAM Duong HungPas encore d'évaluation
- Cotes Sur Piges PrerequisDocument3 pagesCotes Sur Piges PrerequisMakrem CherifPas encore d'évaluation
- Cours Méthodes NumériquesDocument44 pagesCours Méthodes NumériquesAymen100% (1)
- Thermo A2Document29 pagesThermo A2Toufik SamPas encore d'évaluation
- Alluv MadagDocument454 pagesAlluv MadagAnonymous kNyVDtnx100% (2)
- Controle 2 GastliDocument2 pagesControle 2 GastlitorkitaherPas encore d'évaluation
- Exercices - 1 - Nombres ComplexesDocument7 pagesExercices - 1 - Nombres ComplexesHassen Limam50% (2)