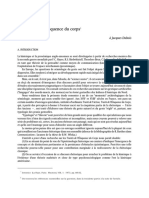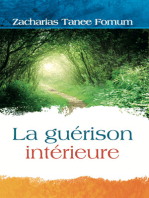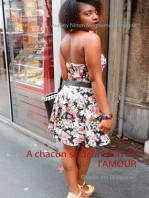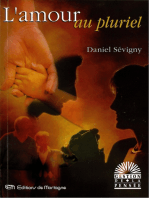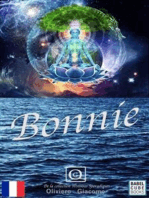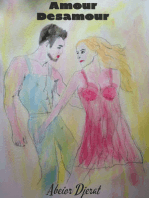Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Susan Madison Tout L'or Du Monde
Transféré par
Sa MeniTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Susan Madison Tout L'or Du Monde
Transféré par
Sa MeniDroits d'auteur :
Formats disponibles
Tout l’or du ciel
Susan MADISON
ISBN : 978-2-266-15535-9
N° 12635
Prix : 7,10
Prologue
J’attends le grand amour… écrivit Melissa Hart sur la page un de son journal intime. C’était le
premier janvier de l’année de ses quinze ans.
Relié en cuir et doré sur tranche, le volume de parchemin ivoire était son cadeau de Noël. Un
présent de grande valeur : nul besoin d’être spécialiste en papeterie de luxe pour voir que sa
grand-mère ne s’était pas moquée d’elle. La petite merveille qu’elle tenait entre ses mains était
d’une qualité exceptionnelle. Naturellement, à cette époque, Melissa n’appréciait peut-être pas à
sa juste valeur le raffinement du papier marbré décoré à la cuve. Cependant, ce présent revêtait
pour elle une signification particulière. Mais laquelle ? Avec application, elle tourna et retourna
la question dans sa tête.
Je voudrais tant être aimée… Voilà ce qu’elle avait envie d’écrire – mais l’idée que son père
puisse ouvrir ce cahier et tomber sur une telle confidence la paralysait. Finalement – et tant pis si
elle se sentait à la fois solennelle et prétentieuse –, Melissa rejeta en arrière ses cheveux blond
cendré et se pencha sur la page pour calligraphier avec soin : J’attends l’amour avec un grand A.
L’amour de ma vie, l’amour qui durera toujours.
Oh, elle ne s’imaginait pas qu’un beau jour son prince charmant paraîtrait sur le seuil de sa
chambre de jeune fille, une pantoufle de vair à la main. Il ne franchirait pas non plus la barrière
de ronces de son « bois dormant » pour affronter le dragon paternel et venir la réveiller d’un
baiser. Mais, tandis que la voix cassante de son père montait du rez-de-chaussée, contrastant avec
les intonations soumises de sa mère, Melissa éprouva la conviction, mieux : l’absolue certitude
qu’il lui serait donné, à elle, de vivre un conte de fées.
Oui, quelque chose de magique, quelque part, lui était réservé. Ailleurs qu’ici. Cet endroit n’était
pas la maison du bonheur. Dès son plus jeune âge, elle avait deviné des zones d’ombre dans le
couple que formaient ses parents.
« Dis, papa…
— Quoi encore ? »
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
Il avait levé le nez de son journal et elle s’entendait encore lui poser, du haut de ses quatre ans,
toute pâle et tremblante, la question qui lui brûlait les lèvres :
« Est-ce que tu m’aimes ? »
Son père avait fixé sans l’ombre d’un sourire la menotte abandonnée sur son genou. Il avait pris
le temps de vider son verre avant de lui rendre son regard, et la réponse – le verdict – était
tombée, si froide qu’elle ne l’avait jamais oubliée :
« Si tu crois que je n’ai que ça à faire ! »
Sa mère avait laissé échapper un cri de reproche ; ses joues avaient rougi brusquement.
« David ! Comment peux-tu être si cruel ? »
Et elle avait pris Melissa dans ses bras, caressant d’une main ses longs cheveux blonds.
« Maman t’aime, mon cœur. »
Mais c’était l’amour de son papa que désirait la petite fille.
Des années plus tard, alors qu’elle voyageait en Europe après avoir décroché son diplôme des
beaux-arts, Melissa en était encore à se demander à quoi pouvait ressembler l’amour véritable.
Elle en avait bien un aperçu de temps à autre… ici, à la terrasse ensoleillée d’un café parisien ; là,
sur une plage portugaise baignée par le clair de lune ; à Venise, près du pont des Soupirs ; ou
encore près d’une des fontaines de la Ville éternelle… À dire vrai, ce n’étaient que des images de
couples on ne peut plus banales, mais ces visions fugitives pétillaient dans son imagination
romantique comme une gorgée de champagne dérobée au verre d’une autre…
Après de brillantes études, Melissa avait décroché un emploi dans une prestigieuse galerie new-
yorkaise. Elle avait découvert assez tôt qu’elle préférait exposer les tableaux des autres plutôt que
de les peindre elle-même. Tant qu’on n’y touche pas de trop près, l’art peut vous remuer l’âme
sans causer de dommages irréparables. Il interpelle, il fascine, mais, qu’il séduise ou qu’il
dérange, il ne blesse pas. Et Melissa tenait à se préserver pour le grand amour qu’elle attendait.
Le jour où il se présenterait, le reste suivrait naturellement – c’était ce qu’elle avait toujours
espéré. Le chemin était tout tracé, jalonné d’étapes incontournables : se marier, avoir beaucoup
d’enfants, vivre heureux ensemble longtemps, longtemps…
Hélas, à un moment donné, son existence allait bifurquer sur une route chaotique, semée de
zigzags, et plus rien ne se passerait comme prévu.
À la seconde où il avait franchi le seuil de la galerie dans laquelle étaient exposées ses œuvres,
Melissa avait su que c’était lui. Elle assurait une visite guidée pour un groupe d’admirateurs de
sculpture contemporaine quand celui dont elle évoquait le génie s’était matérialisé devant ses
yeux. Elle en était restée bouche bée, clouée sur place, saisie par le magnétisme qui émanait de
lui. C’était bien simple, elle voyait crépiter des étincelles autour de sa tête. Signe évident qu’il ne
pouvait être que l’élu.
Bien plus tard – trop tard –, Melissa avait compris qu’elle était tombée éperdument amoureuse
d’un homme qui ne partageait pas ses rêves, qui n’avait que faire de ses étapes-clefs du bonheur.
Croyait-il même au bonheur ? Il avait la détresse chevillée à l’âme.
Sa misanthropie galopante, ses doutes existentiels, sa paranoïa d’artiste torturé, ses crises de
fureur contre lui-même, ses brusques sautes d’humeur, les scènes qui émaillaient leurs relations
de couple sapèrent lentement les illusions de Melissa. Peu à peu, elle avait reconstitué la triste
histoire de son compagnon : la déportation et la mort de ses parents à Auschwitz, une enfance
ballottée entre les foyers de la Croix-Rouge et ce qui lui restait de famille, de vagues cousins au
cœur sec… Mais si cela lui permettait de mieux le comprendre, cela ne facilitait pas la vie
commune. Et, malgré leur amour profond – car il l’aimait lui aussi ardemment, passionnément,
avec le même excès qu’il mettait en toute chose –, elle se sentait parfois étouffée par les
angoisses de ce créateur de génie pour qui tout était objet de souffrance.
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
Un soir où elle l’avait traîné au théâtre pour lui changer les idées – quand il sculptait, il pouvait
rester des jours entiers sans sortir de son atelier, sans parler, boire ni manger, sans s’habiller
même, car il préférait travailler nu comme un ver –, Melissa se demanda pourquoi on n’expliquait
jamais aux jeunes filles que le plus difficile n’était pas de dénicher l’élu de leur cœur, mais
d’endurer ce qui se passait après…
Au sortir du spectacle, tandis qu’ils regagnaient à pied leur appartement de Soho, elle lui prit le
bras.
« As-tu aimé la pièce ?
— Tu plaisantes ? C’était lamentable.
— Tu dis toujours ça.
— Parce que c’est toujours vrai, riposta-t-il en s’arrêtant. Quatre heures de pseudo-théâtre et de
mondanités prétentieuses, c’est autant de temps perdu pour mon travail. Charmante soirée ! Je ne
déteste rien plus que ces auteurs superficiels.
— Tu exagères.
— Tous des poseurs, je te dis, trancha-t-il avec un mépris souverain. Chacun essaie d’épater le
bourgeois avec son nouveau roman, son nouveau film, quand ce n’est pas avec sa nouvelle
voiture ou sa dernière épouse en date. Ouf, j’ai cru que je ne tiendrais jamais jusqu’au bout. »
Elle rit.
« Dis donc, tu es remonté à bloc ! »
Ils reprirent leur promenade nocturne – lui les poings dans les poches, elle lui tenant tendrement
le bras. Au bout d’un moment, Melissa glissa la main dans sa poche pour prendre la sienne.
« Tu as entendu la nouvelle, pour Rachel ? Elle va avoir un bébé. C’est merveilleux, non ?
— Je ne vois pas ce qu’il y a de merveilleux là-dedans, grommela-t-il.
— Eh bien… Ça fait si longtemps qu’elle et son mari attendaient ce bonheur…
— Moi qui les prenais pour des gens intelligents ! Ils sont complètement idiots. Irrécupérables. »
Le ton montait. Il retira les mains de ses poches et allongea le pas au point qu’elle eut du mal à le
suivre.
« Irrécupérables ? Parce qu’ils veulent un enfant ?
— Comme s’il n’y avait pas déjà assez de petits malheureux sur terre ! De pauvres innocents qui
crèvent de faim, des gosses battus, violés, torturés… C’est lamentable. On ne peut pas ouvrir un
journal sans tomber sur de nouvelles horreurs.
— Je sais bien, mais…
— Moi, je ne m’y ferai jamais. Tu n’en as pas assez de voir des bébés mourir de faim, avec leur
ventre énorme et leur regard insoutenable ? Et ces mioches à qui on a volé leurs yeux ? Et ces
gamins estropiés à vie pour avoir posé le pied sur une mine ? Lamentable ! Lamentable… répéta-
t-il en secouant la tête.
— Mais pourquoi veux-tu que cela arrive aux enfants des Friedkin ?
— Et voilà, tu l’as dit ! C’est avec ce genre de réflexion stupide que l’on provoque les
catastrophes. Ça n’arrive qu’aux autres, n’est-ce pas ? »
Il se retourna brusquement, et pointa sur elle un index accusateur.
« Qu’est-ce que tu en sais, d’abord ? Comment peux-tu en être sûre ? C’est ton enfance qui te
rend si confiante ? Tu as la garantie que le bébé de Rachel sera heureux ?
— Non, mais…
— Lui ou n’importe quel autre, d’ailleurs. Le tien, si tu étais assez folle pour en vouloir un !
— Personne ne peut rien garantir de tel, évidemment, répliqua Melissa qui avait pâli. Je voulais
juste dire qu’en ayant des parents comme Rachel et Zeke il partait dans la vie avec les meilleures
chances.
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
— Tu crois ça ? Et si nos tourtereaux se tuent en voiture ? Si Rachel plaque son mari pour un
autre homme ? Si Zeke abandonne femme et enfant ? Si le bébé vient au monde avec une
infirmité ? S’il est enlevé par un dingue ?
— Si… si… si… Au nom du ciel, il n’y a aucune raison pour que cela se produise.
— Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Lis les journaux. Ça se produit tout le temps, partout.
— Tu vois tout en noir. Comme d’habitude. Heureusement qu’il y a aussi de belles choses en ce
monde.
— Ah oui. Il y a toi. »
Troquant en un éclair sa mine renfrognée contre un sourire irrésistible, il la prit par les épaules et
lui piqua un baiser sur le bout du nez.
« Heureusement que je t’ai, ma chérie d’amour à moi. Je ne suis peut-être pas drôle, mais
personne ne t’aimera jamais autant que moi. »
Il l’enveloppa de ses bras et elle s’y blottit, comme chaque fois. Il sentait bon. Aimer, être aimée :
il n’existait pas de plus grand bonheur sur terre.
« Moi aussi, je t’aime », chuchota-t-elle en levant les yeux vers lui.
La lumière orangée d’un réverbère dessinait une aura autour de ses cheveux ondulés plus
sombres que la nuit. Ocre et noir, il était beau comme une peinture grecque, songea-t-elle en
fondant de tendresse.
« Melissa, ma perle de lune…»
Il s’écarta un peu pour planter dans le sien son regard redevenu sérieux, grave même.
« Si tu devais un jour m’annoncer que tu es enceinte, je crois que je serais l’homme le plus
malheureux du monde.
— Mais… pourquoi ? balbutia-t-elle, se sentant couler à pic.
— Pour rien au monde je ne voudrais que mon enfant risque de connaître ce que j’ai vécu dans
ma jeunesse.
— Voyons, nous serions là pour veiller sur lui et faire son bonheur. »
Et, avec tout l’amour que nous lui donnerions, nous y réussirions ! se jura-t-elle alors même
qu’elle voyait son univers s’effriter. Oui, son bébé sentirait vite combien il était désiré. Et aimé.
Par dessus tout aimé.
Pivotant sur ses talons, il reprit sa marche à grandes enjambées – sa fuite en avant ?
« Je suis sûr que mes parents s’étaient tenu les mêmes propos lamentables. Je suis bien placé pour
savoir que la suite ne leur a pas donné raison…
— Pourquoi faut-il toujours que tu te montres cynique ? protesta Melissa, les yeux embués de
larmes, en trottant derrière lui.
— J’ai simplement l’honnêteté de te prévenir que je ne veux pas entendre parler d’un enfant.
Point final.
— Tu ne penserais pas cela si c’était le tien.
— C’est là que tu te trompes. Et pas la peine d’essayer de me convaincre du contraire ! Voyons,
Melissa, tu nous vois avec un marmot dans les pattes ? Il faudrait commencer par déménager
dans un appartement plus grand, trouver surtout un autre atelier… C’est une source de problèmes
à n’en plus finir. Merci bien, la vie est déjà assez compliquée comme ça ! Tu as pensé au
dérangement ?
— Au… dérangement ?
— Ben tiens ! Un môme, ça pleure tout le temps, ça fait un boucan d’enfer, ça empêche de
dormir, ça laisse ses jouets traîner partout, et j’en passe ! Comment veux-tu que je crée dans ces
conditions ? Alors que je dois me dépasser constamment ! »
Il secoua la tête et sourit tristement.
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
« Je te dis ça parce que je préfère que tu saches à quoi t’en tenir.
— Rassure-toi, j’ai saisi le message, répondit-elle sur un ton glacial. C’est même limpide : en
fait, ton noble refus de procréer dans un monde hostile cache un égoïsme monstrueux ! Je te
trouve… lamentable ! »
Cynique, égoïste et maintenant lamentable. Elle crut qu’il allait exploser, mais il parut surtout
choqué, comme victime d’une injustice. À vrai dire, il tombait des nues.
« Au nom de quoi faudrait-il que je danse de joie à l’idée d’avoir un rejeton si je n’en veux pas ?
Où est-il stipulé que je doive absolument être père ? »
Il renfonça ses mains dans les poches de sa veste et esquissa une moue contrite qui dessina
quelques rides autour de ses yeux pâles.
« Entre nous, ne me raconte pas que tu me vois dans le rôle du papa gâteau ! »
Désarçonnée par ce coup bas, Melissa ne trouva à balbutier que :
« Et moi… tu y as pensé ? Tu t’es demandé si j’avais envie d’être maman ?
— Ne compte pas sur moi. Trouve-toi un autre géniteur. »
La réplique avait fusé sans qu’il se départît de son sourire, aussi pitoyable que ses arguments.
Melissa avait voulu savoir, elle savait. Elle le dévisagea – et comprit qu’il ne lui laissait pas
d’autre choix que celui devant lequel elle reculait depuis déjà plusieurs semaines.
Ils s’étaient remis à marcher côte à côte, en silence. Par acquit de conscience, ou plutôt pour
s’assurer de n’avoir aucun tort dans cette histoire, elle opéra une ultime tentative.
« Qu’est-ce que tu dirais si je t’annonçais, là, que j’attends un enfant ?
— Oh, la barbe avec ces questions !
— Réponds-moi.
— Puisque tu y tiens, s’énerva-t-il, je te conseillerais de t’en débarrasser au plus vite – ou de
mettre le maximum de kilomètres entre nous. Là, tu es contente ? »
Au moins, cela avait le mérite d’être clair, songea-t-elle alors qu’elle encaissait cette fois sans
broncher.
Il se radoucit par un de ces revirements dont il avait le secret et lui saisit la main pour la porter à
ses lèvres.
« Ma perle d’amour… L’air du soir est doux, tes cheveux brillent comme une faucille d’or dans
le champ des étoiles… Ne gâche pas tout avec ce sujet pénible. J’ai trop vu d’innocents meurtris
dans ma vie, tu comprends. Trop d’yeux noyés de détresse qui me hantent jour et nuit. »
Elle resta muette.
« Est-ce que ce monde est assez beau pour mériter un enfant de plus ?
— Mais… »
Il captura le visage de Melissa entre ses paumes et le maintint fermement.
« Je t’ai dit que je n’avais pas envie d’entendre pleurer ou crier des gosses, ce n’est pas cela : je
ne peux pas supporter l’expression de leur souffrance. Ne serait-ce que pour un petit bobo ou un
jouet perdu. Je m’en sens totalement incapable – irrémédiablement incapable. »
La mort dans l’âme, elle sut qu’il pensait vraiment chacun de ces mots.
Deux semaines plus tard, après avoir pris le temps de régler ce qui devait l’être, Melissa attendit
un après-midi où il devait s’absenter, et le quitta pour toujours.
Pas de cris ni de larmes – elle détestait cela autant que lui. Elle ne lui laissait même pas une lettre
d’explication. À quoi bon ? Elle emportait en tout et pour tout un simple sac de voyage dans
lequel elle avait entassé des vêtements, quelques livres et des photos. Et les trois objets auxquels
elle tenait le plus : le collier en améthyste qui lui venait de sa mère, une icône qu’il lui avait
offerte au début de leur liaison et le merveilleux buste de femme sculpté dans le bois qu’il avait
intitulé en son honneur Premier amour.
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
Une dernière fois, elle embrassa du regard ces lieux où elle avait connu le bonheur pendant trois
années. Avant d’y être si malheureuse. Aujourd’hui, elle avait vingt-deux ans ; cette page de sa
vie se tournait à jamais. Elle n’attendrait plus le grand amour – il était venu, elle l’avait connu, et
il lui fallait désormais renoncer à tous ses rêves.
Les yeux secs d’avoir trop pleuré, elle attrapa son sac et s’en alla pour toujours, en refermant la
porte derrière elle.
Maple Street. Mel Sherman remonta la petite allée qui conduisait à sa maison, coupa le contact et
ouvrit la portière. Mais, avant de sortir de sa voiture, elle resta immobile un moment, prêtant
l’oreille aux bruits des premiers beaux jours. Les cris joyeux montant de la cour de récréation de
l’école toute proche, le roucoulement des pigeons ramiers dans les arbres, les jets d’eau des
arroseurs automatiques tournant à toute vitesse sur les pelouses…
Perché sur son échelle, sur le trottoir d’en face, le colonel à la retraite Brian Stiller réparait sa
gouttière en sifflotant un air militaire. Le regard de Mel revint à sa propre maison, dorée sous le
soleil de cette radieuse fin de matinée.
Une pimpante façade blanc et rouge, avec des volets noirs. Sur la véranda, une paire de vieux
fauteuils à bascule en rotin clair invitait au farniente ou à une petite pause dans l’écrin rouge que
formait la haie de cognassiers du Japon en fleur. L’air embaumait la rose, le lilas et la lavande.
Mel rentrait rarement chez elle sans se remémorer la première fois qu’elle avait vu cette maison,
qui allait devenir la sienne. Le jour où elle s’était engagée dans Butterfield en voiture, elle n’avait
rien d’autre en tête que d’y faire halte le temps d’avaler un café et un sandwich. Et puis, au lieu
de reprendre sa route, elle s’était mise à flâner sans but dans les rues de la petite cité. Souvent,
par la suite, elle s’était demandé ce qui l’avait retenue ici. Pourquoi ce lieu précis ? Elle avait
pourtant visité d’autres étapes pittoresques au cours des jours précédents sans éprouver le besoin
de s’y attarder, a fortiori d’y rester.
Quelle qu’en soit la raison, le fait est qu’elle avait brusquement suspendu son voyage pour
s’installer ici. Comme si le destin lui avait soufflé à l’oreille : Butterfield… terminus, tout le
monde descend ! Et c’est ainsi qu’elle avait descendu la grand-rue, dépassé le portique de la
mairie et le vieux cimetière dont les pierres tombales en ardoise étaient gravées à la main, passé
les bâtiments de l’école communale et la librairie vieillotte, passé la petite église méthodiste, pour
se retrouver dans un quartier résidentiel.
Là, elle avait découvert le havre de paix, le sanctuaire presque, auquel elle aspirait. Elle avait
longé de belles demeures avant de tomber en arrêt, dans Maple Street, sur une maison – celle-ci –
qui portait une pancarte « À vendre » à moitié dissimulée par une haie en fleur. Moins d’une
heure plus tard, Mel faisait le tour du propriétaire.
La responsable de l’agence immobilière, une grosse dame patronnesse, avait été quelque peu
troublée par sa jeunesse et son évidente inexpérience.
« Avez-vous déjà investi dans l’immobilier, mademoiselle ?
— Non. C’est mon premier coup de foudre.
— Je comprends, mais il est de mon devoir d’attirer votre attention sur le fait que vous ne pourrez
vivre sous ce toit sans procéder à de conséquentes modernisations…
— Oh, mais la maison me plaît comme ça », avait répondu Mel qui n’avait d’yeux que pour les
corniches des plafonds, les cheminées, les boiseries et les lambris des murs.
« Je voulais parler de travaux de rénovation. Toute la plomberie est à refaire, de même que
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
l’installation électrique. La moitié des volets doivent être remplacés, il manque des tuiles et il
pleut dans certaines pièces…
— J’ai remarqué. Mais, comme je vous l’ai dit, je suis tombée amoureuse de cette vieille
demeure, et quand on aime… on ne compte pas. J’achète. »
Depuis deux ans, l’argent laissé par sa grand-mère dormait sur son compte en banque. Jamais
héritage n’aurait pu être mieux utilisé, avait-elle estimé en signant le chèque – et elle le pensait
encore aujourd’hui, vingt-trois ans plus tard, en poussant la porte d’entrée de son foyer.
Mel déposa ses courses sur la table de la cuisine, ouvrit la large fenêtre donnant sur son pommier
et huma l’air qui lui sembla fleurer bon le miel et le cidre. Un délicieux mariage. Elle rangea
méthodiquement ses achats dans le réfrigérateur, puis se prépara un café. Pendant que l’eau
chauffait dans la bouilloire, elle écouta son répondeur. Trois messages : Lisa Andersen ; Sarah
Mahoney, du comité de lecture ; le garagiste. Rien d’urgent. Tant mieux, elle rappellerait plus
tard. Pour le moment, elle avait bien mérité de souffler un peu. Sa tasse de café à la main, elle
monta dans sa chambre, se mit à l’aise et s’allongea le temps que la caféine fasse son effet. Elle
ferma les yeux.
Si elle avait pu se douter que les préparatifs de l’expo Koslowski exigeraient autant de travail,
elle ne se serait pas embarquée dans une telle aventure ! Mais non, pourquoi se mentait-elle ?
Cette exposition, elle l’avait voulue de toutes ses forces. Elle, et personne d’autre, était à l’origine
du projet le plus excitant de sa carrière professionnelle. Galen Koslowski, l’un des chefs de file
de la sculpture moderne, à l’affiche de la galerie Vernon ? Sa galerie à elle ? Quand on y
songeait, c’était à peine croyable.
Tout avait commencé huit mois plus tôt, alors qu’elle feuilletait un numéro d’Art contemporain.
Elle était tombée sur une critique de la rétrospective de l’œuvre de « l’imprévisible Koslowski »
récemment présentée à San Francisco. L’article comportait une photographie du sculpteur, qui lui
avait paru très vieilli par rapport à l’image qu’elle avait gardée de lui. Il faisait plus artiste établi
dans cette veste claire en lin portée sur un tee-shirt noir, tellement moins bohème avec son air
respectable et ses cheveux fous désormais disciplinés.
Il y avait longtemps qu’elle était venue chercher la sérénité et l’oubli à Butterfield ; un quart de
siècle s’était écoulé… Pourtant, la simple lecture de ces quelques pages aurait suffi à lui prouver
que le temps ne peut cicatriser toutes les plaies, si elle l’avait oublié. La paix de l’âme est un
concept très relatif, qui s’accompagne souvent d’un lourd tribut à payer.
Ce jour-là, perdue dans la contemplation de la photo de Galen, Mel avait payé le prix de la
nostalgie. Et, tout à coup, elle s’était dit : pourquoi pas ? Cela paraissait impossible, mais qui ne
tente rien n’a rien, non ?
Battant le fer tant qu’il était chaud, elle avait décroché son téléphone pour soumettre son idée à
qui de droit.
Au début, l’agent de Koslowski avait cru à une blague.
« À… comment ça, déjà ? Butterfield ? Dans le Vermont ? Je suis navré, madame… euh…
Sherman, mais c’est non. Absolument hors de question.
— Pourquoi ?
— Voyons, vous n’êtes pas sérieuse ? Une exposition Koslowski dans un coin paumé de
Nouvelle-Angleterre ? »
Elle n’imaginait que trop bien sa mine mi-amusée, mi-méprisante, et avait répliqué sans se
démonter :
« Il ne s’agit pas d’organiser une nouvelle rétrospective comme celle de Frisco, mais de présenter
une sélection d’œuvres caractéristiques de son art.
— Son art… – parlons-en, justement – est un art difficile. Qui n’est pas à la portée de tout le
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
monde. Je ne vois pas du tout ce que cette exposition pourrait bien apporter aux habitants de…
pardonnez-moi, d’un patelin comme le vôtre.
— Ça, c’est mon problème, avait rectifié Mel sans perdre son aplomb. Demandez-vous plutôt ce
que mon patelin, comme vous dites, peut apporter à Koslowski.
— Je me le demande aussi, oui !
— Eh bien, il peut combler son déficit de notoriété en dehors des hautes sphères élitistes. Gal…
Koslowski souffre d’être catalogué comme “artiste inaccessible au grand public”. Il n’y a pas tant
de créateurs contemporains qui se voient offrir l’opportunité d’être promus à l’écart des sentiers
battus et reconnus ailleurs que dans les cercles consacrés. »
Elle venait de marquer un point, elle l’avait deviné au temps qu’il mettait à répondre :
« Ce n’est pas faux, mais votre galerie Vernon…
— Une petite galerie comme la mienne peut se révéler un excellent détonateur, à moyen et à long
terme. Vous n’en avez pas assez conscience, à New York, où les rétrospectives tournent en rond
depuis vingt ans avec les mêmes initiés…
— Ah, permettez ! Vous y allez un peu f…
— Tandis que l’exposition que j’ai en tête, avait-elle poursuivi en lui coupant délibérément la
parole, ouvre à Koslowski la possibilité d’atteindre – et de gagner – un public neuf. Avec les
retombées financières appréciables que peut entraîner la conquête d’un marché nouveau… Mais
je suis sûre que cet aspect-là ne vous a pas échappé.
— Rien ne m’échappe, mais enfin… Butterfield… Je ne sais pas trop…»
Son ton était déjà moins hautain. C’était le moment de lui montrer qu’elle pouvait jouer dans la
cour des grands.
« Cher monsieur, mes deux expositions précédentes se sont avérées un franc succès en matière de
ventes, tant pour Arthur Herbert, le miniaturiste, que pour l’aquarelliste Keno Wasaki.
— Mmm…»
Il faiblissait encore. Elle avait alors porté l’estocade :
« Quant à notre exposition Mirja Kopler…
— Hein ? Quoi ? Vous avez eu Kopler à Butterfield ?
— Comment, vous l’ignoriez ? Soit dit sans me vanter, Mirja est ma découverte personnelle. J’ai
déniché une de ses œuvres presque par hasard, chez un marchand de tableaux, et j’ai
immédiatement cru en elle. Mirja était complètement inconnue chez elle, dans le Maine, avant
que sa toute première exposition, ici même, ne lance sa carrière. Nous avons eu des critiques
dithyrambiques. Depuis, ça marche très fort pour elle, son agent à New York pourra vous le
confirmer. Dommage que ce ne soit pas vous ! »
À l’autre bout du fil, il avait émis une sorte de râle qui signait sa reddition.
« Oui, bon… Je vais en parler à Koslowski, mais j’aime autant vous avertir que ce n’est pas
gagné d’avance.
— Vous faites allusion à sa réputation d’étrangeté ? »
C’était une élégante façon de dire que Galen Koslowski passait généralement pour un ours mal
léché, aussi imprévisible qu’intraitable. « Le caractériel misanthrope », comme le qualifiaient ses
détracteurs.
« S’il n’y avait que ça ! Vous avez idée des garanties qu’il exige ?
— Je m’en doute un peu, mais cela peut aussi jouer en notre faveur, glissa-t-elle en appuyant sur
le possessif pour mieux l’impliquer : les galeristes ne doivent pas se bousculer au portillon pour
présenter les œuvres d’un homme aussi intransigeant ! »
L’agent ne s’était même pas donné la peine de nier.
« C’est un type génial, dans tous les sens du terme, avec en prime tous les défauts des génies. Il
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
peut se montrer très affable, courtois, charmant, le cœur sur la main… et la seconde d’après, se
comporter comme un tyran autoritaire et intolérant. Quant à son art, n’espérez pas obtenir la
moindre concession : Koslowski est l’exigence incarnée, vis-à-vis de lui-même pour commencer.
— Peut-être parce qu’il est conscient qu’on peut toujours faire mieux et qu’il n’a pas encore
donné sa pleine mesure.
— Oui… eh bien, gardez-vous de lui adresser ce genre de remarque si vous ne voulez pas faire
connaissance avec son côté obscur ! D’ailleurs, c’est simple : évitez de le contrarier en quoi que
ce soit et tout ira – peut-être – bien.
— Il est si fragile que ça ? avait demandé Mel, qui ne savait que trop à quoi s’en tenir.
— Galen est un écorché vif. Il n’en parle pas, mais je sais qu’il ne s’est jamais remis de son
enfance. Sa famille a été victime de l’Holocauste, enfin, vous voyez le tableau… »
Oui, elle voyait. Elle revivait encore les nuits affreuses où Galen la réveillait en criant et
gémissant dans ses cauchemars. Trop jeune alors, le cœur trop tendre, et désarmée, elle n’avait
pas réussi à chasser ses démons.
« Je suis certaine que M. Koslowski sera sensible à ma proposition, avait-elle enchaîné. La
réputation de ma galerie ne cesse de croître et, entre nous, le Vermont est assez éloigné de New
York pour que notre génie n’aille pas faire irruption en pleine nuit chez un couple de
“collectionneurs indignes” pour récupérer une de ses œuvres, comme il l’aurait fait l’année
dernière…
— Mon Dieu, quel scandale ! avait confirmé l’agent en poussant un soupir. Il faut dire à sa
décharge que les clients en question avaient “maltraité” cette sculpture en l’exposant je ne sais
plus comment. Mais les kilomètres ne font rien à l’affaire : vous connaîtrez le même sort si vous
ne respectez pas les consignes strictes de notre ami ! »
Ils avaient ri ensemble, et elle avait compris que la partie était gagnée. Son interlocuteur venait de
parler au futur, et voici qu’il se lançait dans les confidences :
« Ce pauvre Galen gagne beaucoup à être connu. Je n’ai pas seulement de l’admiration pour lui,
mais aussi une affection sincère. Au fond, c’est un être adorable. Tordu, torturé, tout ce que vous
voudrez, mais a-do-rable. Lorsqu’il accepte de venir dîner à la maison, il passe les trois quarts de
la soirée à jouer avec mes gosses sur le tapis. Vous le verriez dessiner avec eux en leur racontant
un tas d’histoires ! C’est fou comme il aime les enfants, et ils le lui rendent bien…»
Mel rouvrit les yeux et remua la tête, pour revenir au plus vite à la réalité présente. Elle ne
risquait pas d’imaginer le sculpteur torturé à quatre pattes sur le tapis, en train de partager les
jeux des enfants d’une autre… Non, certaines choses étaient vraiment trop dures à avaler.
Elle termina son café refroidi. Sa galerie inaugurerait l’expo Koslowski en octobre. Depuis que
« l’imprévisible » avait donné son accord, son assistante Carla Payne et elle travaillaient
d’arrache-pied pour que tout soit prêt en temps et en heure. Ce n’était pas une mince affaire,
surtout avec les garanties que demandait l’artiste par la voix de son agent ou, pis, par des
messages griffonnés avec autant de hâte que d’exigence. Elle cédait à toutes ses conditions, trop
heureuse d’avoir décroché le contrat.
Mel ne détachait pas son regard de l’icône jadis offerte par Galen qui trônait à la place d’honneur,
sur le mur faisant face au lit. Avec les deux bouquets de fleurs des champs posés de part et
d’autre de la commode, c’était la seule note de couleur dans cette pièce austère et nue. Eric avait
voulu une chambre dépouillée au maximum, pour ne pas dire monacale. Rien que du blanc et du
vide. Mel ne s’y était jamais plu, mais depuis trois ans que son mari était mort elle n’avait pas osé
toucher au décor qu’il aimait. Blanc et vide. Vide.
Elle se leva pour prendre une douche avant de repartir au travail. Dans la salle de bains, son
miroir pourtant peu complaisant lui renvoya l’image d’une très belle femme au corps superbe –
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
de longues jambes fuselées, des hanches pleines et une taille mince, une poitrine haute et ronde.
Mel passa un doigt sur la cicatrice qui courait sous son sein gauche. Pour le moment, c’était le
seul signe visible des stigmates de la vie, mais les outrages du temps ne tarderaient pas à
apparaître. Ce reflet trompeur masquait le fait qu’elle avait passé la quarantaine. Ma jeunesse
s’est envolée et ne reviendra jamais. Le temps d’aimer est-il passé ?
Un jour, au cours de son voyage en Europe avec Eric, elle était entrée dans un établissement
thermal réputé de Budapest et s’était retrouvée entourée de femmes nues. La plupart étaient plus
âgées qu’elle aujourd’hui, mais même les plus jeunes étaient fortes et lourdes, avaient du ventre,
des cuisses molles, la poitrine tombante. Elles surveillaient moins leur ligne qu’elle, faisaient
sûrement moins de sport, se souciaient sans doute moins de leur apparence, mais… mais c’étaient
simplement de vraies femmes qui menaient une vraie vie d’épouse et de mère. Oui, elles avaient
aimé, porté des enfants, accouché, allaité, élevé leurs petits, elles. Pour qui Mel entretenait-elle ce
corps que d’autres, plus heureuses, lui enviaient ?
Le vieil aiguillon de la solitude transperça son cœur. Le temps d’aimer est-il passé ?
© Susan Madison 2002. Tous droits réservés.
© Belfond 2004 pour la traduction française.
Vous aimerez peut-être aussi
- PostmodernDocument2 pagesPostmodernSa MeniPas encore d'évaluation
- Bases Scientifiques Philosophie HistoireDocument225 pagesBases Scientifiques Philosophie HistoirelecaracalPas encore d'évaluation
- Le Bon - Psychologie Du SocialismeDocument418 pagesLe Bon - Psychologie Du SocialismekosmoxPas encore d'évaluation
- Vonne Van Der Meer Les Invités de L'îleDocument12 pagesVonne Van Der Meer Les Invités de L'îleSa MeniPas encore d'évaluation
- La Théogonie D'hésiode Traduction Nouvelle Par M. Patin, PDFDocument41 pagesLa Théogonie D'hésiode Traduction Nouvelle Par M. Patin, PDFhassan_hamoPas encore d'évaluation
- Guide Redaction ScientifiqueDocument15 pagesGuide Redaction ScientifiquesolidairesPas encore d'évaluation
- L'éloquence Du Corps1Document17 pagesL'éloquence Du Corps1María Gabriela Cuevas PratelliPas encore d'évaluation
- Enseigner Oui, Mais Dans Quel EspaceDocument8 pagesEnseigner Oui, Mais Dans Quel EspaceSa MeniPas encore d'évaluation
- Ecrire Un Article Scientifique en AngDocument20 pagesEcrire Un Article Scientifique en AngSa MeniPas encore d'évaluation
- Edgarpoe Le Corbeau MallarmeDocument6 pagesEdgarpoe Le Corbeau MallarmeSa MeniPas encore d'évaluation
- Eternel RetourDocument21 pagesEternel RetourSa MeniPas encore d'évaluation
- Écrire Avec Des ImagesDocument6 pagesÉcrire Avec Des ImagesSa MeniPas encore d'évaluation
- Etat Policier-2015Document20 pagesEtat Policier-2015Sa MeniPas encore d'évaluation
- Ebook Pierre NAHOA Les 5 Top Methodes Pour Combattre La Paresse Et Etre Productif Au TravailDocument25 pagesEbook Pierre NAHOA Les 5 Top Methodes Pour Combattre La Paresse Et Etre Productif Au TravailSa MeniPas encore d'évaluation
- Dossier Pédagogique Q BlakeDocument15 pagesDossier Pédagogique Q BlakeSa MeniPas encore d'évaluation
- 7 Fiches de Syntaxe Et Dorthographe en Un Seul FichierDocument8 pages7 Fiches de Syntaxe Et Dorthographe en Un Seul FichierBaudouin YoussoufPas encore d'évaluation
- Comment Rediger 10 Livres en 30 Jours PDFDocument58 pagesComment Rediger 10 Livres en 30 Jours PDFArt Fang Arif100% (2)
- 50 Petits Jeux Enfants PDFDocument58 pages50 Petits Jeux Enfants PDFMeftah HichamPas encore d'évaluation
- H - Aspiré Et Muet, Liste Alphabétique-Grammaire AIDENETDocument2 pagesH - Aspiré Et Muet, Liste Alphabétique-Grammaire AIDENETSa MeniPas encore d'évaluation
- 101 Conseils Et Astuces Pour Écrire Un LivreDocument37 pages101 Conseils Et Astuces Pour Écrire Un LivreMarcLepagePas encore d'évaluation
- 1831 Ouverture Et Imaginaire Dans Les Albums Pour Enfants Des EditionsDocument181 pages1831 Ouverture Et Imaginaire Dans Les Albums Pour Enfants Des EditionsSa MeniPas encore d'évaluation
- 40 Débuts D'œuvres Qui Pourraient Vous Inspirer - Scribay, Le BlogDocument10 pages40 Débuts D'œuvres Qui Pourraient Vous Inspirer - Scribay, Le BlogSa MeniPas encore d'évaluation
- 1erschoix BioBiblio Illustrateurs 12102010Document47 pages1erschoix BioBiblio Illustrateurs 12102010Sa MeniPas encore d'évaluation
- HIRAK EN ALGERIE - ENTRE REALITE ET MANIPULATIONS ! - Proche&Moyen-Orient - CHDocument11 pagesHIRAK EN ALGERIE - ENTRE REALITE ET MANIPULATIONS ! - Proche&Moyen-Orient - CHSa MeniPas encore d'évaluation
- H - Aspiré Et Muet, Liste Alphabétique-Grammaire AIDENETDocument2 pagesH - Aspiré Et Muet, Liste Alphabétique-Grammaire AIDENETSa MeniPas encore d'évaluation
- 01 Bases DessinDocument4 pages01 Bases Dessinsunflowerr1976Pas encore d'évaluation
- Elliot Perlman 3dollarsDocument3 pagesElliot Perlman 3dollarsSa MeniPas encore d'évaluation
- Jacques Neirynck La Mort de Pierre CurieDocument7 pagesJacques Neirynck La Mort de Pierre CurieSa MeniPas encore d'évaluation
- Art Et Litterature de JeunesseDocument21 pagesArt Et Litterature de JeunesseSa MeniPas encore d'évaluation
- Khaled Hosseini Les Cerfs Volants de KaboulDocument2 pagesKhaled Hosseini Les Cerfs Volants de KaboulSa MeniPas encore d'évaluation
- Lexium SD3 - LU9GC3Document2 pagesLexium SD3 - LU9GC3Mohamed Amine LABIDIPas encore d'évaluation
- Cours Pao 08.11Document30 pagesCours Pao 08.11tifenn.fleckPas encore d'évaluation
- Texte 2Document7 pagesTexte 2Ashema Tshokama100% (1)
- Fe 50 Fiche Explicative Des Fiches Cee Sme v17 VFDocument19 pagesFe 50 Fiche Explicative Des Fiches Cee Sme v17 VFhassankchPas encore d'évaluation
- Adaptation de La Tension À L'utilisationDocument7 pagesAdaptation de La Tension À L'utilisationfatima zohraPas encore d'évaluation
- SketchUp Pour Le Dessin Des MeublesDocument118 pagesSketchUp Pour Le Dessin Des MeublesSamantha Erickson100% (1)
- Reussir Vos Fraisages CNC3018 Pro CncFraises V1.0Document37 pagesReussir Vos Fraisages CNC3018 Pro CncFraises V1.0franck giorgi100% (1)
- Banque CCP Sup ProbaDocument2 pagesBanque CCP Sup ProbaAziz ChafikPas encore d'évaluation
- Carlos CASTANEDA - Histoires de PouvoirDocument188 pagesCarlos CASTANEDA - Histoires de Pouvoiralphaorio100% (1)
- Guide Du Projet Professionnel Et Personnel de L'étudiantDocument32 pagesGuide Du Projet Professionnel Et Personnel de L'étudiantTik Tok Galsen Fun OfficielPas encore d'évaluation
- Pfe GC 0047 PDFDocument105 pagesPfe GC 0047 PDFHervé JabeaPas encore d'évaluation
- Serie2TLAIng2013 2014Document2 pagesSerie2TLAIng2013 2014Ghazouani HaythemPas encore d'évaluation
- Langage Et AnthropologieDocument20 pagesLangage Et AnthropologieEl Marjani MokhtarPas encore d'évaluation
- Soupe Choux Fleur CheddarDocument3 pagesSoupe Choux Fleur CheddarLoren ZoPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Redressement Triphasé CommandéDocument11 pagesChapitre 4 Redressement Triphasé CommandéYahia Nino100% (1)
- Cours #7 - La Loupe - 10 - 01Document11 pagesCours #7 - La Loupe - 10 - 01Said MessaoudPas encore d'évaluation
- (Aritech) Cd3402s3Plus PDFDocument83 pages(Aritech) Cd3402s3Plus PDFhenryPas encore d'évaluation
- Cours1 MasterDocument13 pagesCours1 Mastermahfoud1254Pas encore d'évaluation
- AccumulateurDocument28 pagesAccumulateurdarcisPas encore d'évaluation
- 1 13 Imprimer Documents RecapitulatifsDocument14 pages1 13 Imprimer Documents RecapitulatifsAzsrtyPas encore d'évaluation
- V120i 25324 5 PM FrenchDocument450 pagesV120i 25324 5 PM FrenchFodilsbsPas encore d'évaluation
- 2022 DEPREZ-AudreyDocument38 pages2022 DEPREZ-Audreywb5510078Pas encore d'évaluation
- TCF CanadaDocument7 pagesTCF CanadaAmira BenhammouPas encore d'évaluation
- DAF Comite Audit CAadmin IFA DFCGDocument8 pagesDAF Comite Audit CAadmin IFA DFCGToah Bi Marc DidiaPas encore d'évaluation
- Ob 2a860b Hs Trois Mariages Chez Les FortunesDocument215 pagesOb 2a860b Hs Trois Mariages Chez Les FortunesMentor MCconell RamsèsPas encore d'évaluation
- TD 3 Capteur Et Instrumentation 2021 CorrigéDocument4 pagesTD 3 Capteur Et Instrumentation 2021 CorrigéRabah Hadjar100% (5)
- Synthèse CinématiqDocument1 pageSynthèse CinématiqmasteratsiiPas encore d'évaluation
- OranunevillealgriennereconquiseuncentrehistoriqueenmutationDocument16 pagesOranunevillealgriennereconquiseuncentrehistoriqueenmutationsidoPas encore d'évaluation
- Amour, Amour, Amour: La Puissance De L'acceptationD'EverandAmour, Amour, Amour: La Puissance De L'acceptationÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Cesser de souffrir à cause de quelque chose qui n’existe pas !: De l'illusion de l'Ego à la Paix dans le monde : la Révolution commence à l'intérieur de nous-mêmeD'EverandCesser de souffrir à cause de quelque chose qui n’existe pas !: De l'illusion de l'Ego à la Paix dans le monde : la Révolution commence à l'intérieur de nous-mêmeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- A chacun sa définition de l'amour: Quelle est la tienne?D'EverandA chacun sa définition de l'amour: Quelle est la tienne?Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Comment trouver l'amour en 28 jours: Guide pratique et conseils quotidiensD'EverandComment trouver l'amour en 28 jours: Guide pratique et conseils quotidiensPas encore d'évaluation
- Qui sont ces hommes heureux?: L'homme, l'amour et le coupleD'EverandQui sont ces hommes heureux?: L'homme, l'amour et le couplePas encore d'évaluation
- La somme existentielle I/III Le mystère de Dieu: une histoire d'amourD'EverandLa somme existentielle I/III Le mystère de Dieu: une histoire d'amourPas encore d'évaluation
- La symétrie cachée de votre date de naissance: La date de votre naissance révèle le plan de votre vieD'EverandLa symétrie cachée de votre date de naissance: La date de votre naissance révèle le plan de votre vieÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- La somme existentielle II/III Le mystère de l'homme: Un mystère d'amourD'EverandLa somme existentielle II/III Le mystère de l'homme: Un mystère d'amourPas encore d'évaluation
- Elvis et Ginger: L’histoire de la fiancée et le dernier amour d’Elvis PresleyD'EverandElvis et Ginger: L’histoire de la fiancée et le dernier amour d’Elvis PresleyPas encore d'évaluation
- Raviver la flamme: Le guide infaillible pour retrouver votre ex - Même si tout espoir semble perduD'EverandRaviver la flamme: Le guide infaillible pour retrouver votre ex - Même si tout espoir semble perduPas encore d'évaluation
- Comment s’aimer soi-même (et parfois les autres): Conseils spirituels pour les relations modernesD'EverandComment s’aimer soi-même (et parfois les autres): Conseils spirituels pour les relations modernesPas encore d'évaluation