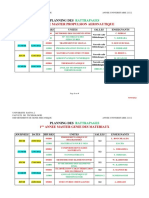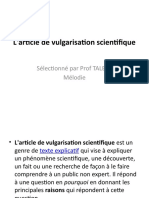Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
PP Chap 5 OMC
PP Chap 5 OMC
Transféré par
Ayman Amari0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues44 pagesTitre original
pp chap 5 OMC
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues44 pagesPP Chap 5 OMC
PP Chap 5 OMC
Transféré par
Ayman AmariDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 44
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales, Fès.
6ème semestre : 2019 – 2020
Parcours : Economie & Gestion
Matière : Relations Economiques Internationales
Enseignante : Mme. Nada Moufdi
Contexte
Au XIX siècle, la G.B domine largement le commerce
mondial qui ne cesse d’augmenter en volume (il
décuple entre 1850 et 1913).
En 1913, elle assure avec la France, l’Allemagne et les
Etats-Unis 45 % du commerce mondial (50 % si l’on
ajoute le Japon).
La grande crise de 1929 a vu le commerce mondial
baisser en volume et en valeur.
En 1933, la valeur du Cce mondial était inférieur de
60% par rapport à celle de 1929.
Contexte
Le recul de la production industrielle;
Le renouveau du protectionnisme dans un grand
nombre de pays notamment aux Etats-Unis à partir de
1930, avec l'imposition de tarifs douaniers élevés
"Hawlay Smoot tariffs" qui ont accéléré l'exportation
de la crise des Etats-Unis vers l'Europe. Les Européens
ont à leur tour pris des mesures de représailles à
l'égard des exportations américaines.
L'expérience du libre-échang qui a débuté en 1846
prend ainsi fin. Les mesures protectionnistes ont été
perfectionnées pendant la période de l'entre deux
guerres.
Contexte
Les tentatives de renaissance du commerce
international dans les années 30 n'ont eu que des effets
limités et n'ont pas pu mettre fin au développement du
bilatéralisme dans les échanges internationaux et de
l'autarcie dans plusieurs grands pays.
Après la deuxième guerre mondiale, ce sont les Etats-
Unis qui ont pris l'initiative en matière de commerce
mondial. Ils sont à l'origine de la rédaction d'un
document destiné à poser les bases de l'organisation
des échanges de l'après guerre, connu sous le nom de
la charte de la Havane.
Contexte
Elle devait donner naissance à une organisation
internationale du commerce (OIC). Or, le sénat des Etats-
Unis refuse alors de ratifier un tel projet.
Parallèlement, des négociations ont été menées par les 23
pays qui assurent 80% du Commerce mondial en vue de
mettre en place une organisation beaucoup moins
contraignante que l'OIC et s'inspirant nettement du libre
échange
L'ordre commercial international a été régi pendant près
d'un demi-siècle par un accord et une organisation à
vocation provisoire et aux pouvoirs très limités : l'Accord
Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT).
Section 1 : Le GATT
Le GATT (Général Agreement on Tariffs and Trade) a
été Conclu à Genève en 1947 par 23 pays.
Le GATT marqua un tournant important dans les
relations commerciales internationales. Pour la
Première fois, les principaux pays participants au
Commerce Mondial abandonnèrent la méthode des
traités bilatéraux en vigueur depuis un siècle pour
adopter une formule de négociations multilatérales.
Avec le GATT s'ouvre la première grande période
durable de libéralisation des échanges.
Origine du GATT
Après la fin de la seconde guerre mondiale, américains
et britanniques ont recherché le moyen de réorganiser
le commerce mondial de façon à empêcher à l'avenir
tout retour à la situation des années 1930. Période dans
laquelle les réactions protectionnistes avaient entraîné
l'effondrement du commerce mondial et
l'approfondissement de la crise économique.
La méthode choisie fut la mise en place d'un système
de négociations multilatérales et transparentes, fondé
sur un code de règles de bonne conduite, l‘Accord
Général sur les Tarifs et le Commerce, ou GATT.
Les grands principes du GATT
La méthode inaugurée avec le GATT est celle du
cycle de négociations, pouvant s'étaler sur
plusieurs années, et donnant lieu à un accord.
Ces négociations sont fondées sur trois grandes
règles :
- la clause de la nation la plus favorisée,
- la réciprocité des concessions tarifaires,
- la transparence des politiques commerciales.
La clause de la nation la plus
favorisée
Elle fait l'objet de l'Article I du GATT (dite " clause
NPF"). Cette règle, la plus importante de l'accord,
stipule que tout avantage commercial accordé par
un pays à un autre (même si celui-ci n'est pas
signataire de l'accord), doit être immédiatement
accordé à la totalité des membres signataires.
" Ce qui est accordé à l'un est accordé à tous " sans
discrimination. Cependant, certaines exceptions à la
règle sont prévues : Lorsque les importations causent
des dommages sérieux à la production locale ; en cas
de danger sanitaire; ou dans le cas des accords
d'intégration économique régionale (zone de libre
échange (ALENA), union douanière (UE).
Le principe de réciprocité
La règle de la réciprocité stipule qu'un pays qui accepte
une concession tarifaire doit également offrir une
concession en retour. L'objectif est d'éviter que
certains pays profitent des réductions tarifaires de
leurs partenaires commerciaux sans eux-mêmes
abaisser leurs tarifs.
L'exception la plus importante à cette deuxième règle
concerne les pays en développement, que l'on peut
autoriser à profiter de la clause de la nation la plus
favorisée sans obligation de réciprocité pour favoriser
leur croissance économique.
La transparence des politiques
commerciales
Les barrières quantitatives et généralement toutes les
barrières non tarifaires sont interdites, en raison de
l'opacité et du caractère discriminatoire de ces
instruments.
Seuls les tarifs douaniers, aisément quantifiables, sont
acceptés comme moyen de protection
Le traitement national
Au titre de ce principe, les produits importés
sur le territoire d'un membre ne doivent pas
subir un traitement moins favorable que
celui réservé aux produits nationaux. En
d'autres termes « le produit importé est
traité comme le produit domestique", au
regard des taxes, des réglementations
sanitaires et techniques,...etc.
Les cycles de négociations
commerciales multilatérales
Huit cycles de négociation ont ainsi été conduits
sous l'égide du GATT, jusqu'à ce que l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) succède au GATT
en 1994.
De 1947 à 1960, la remise en route du commerce
mondial s'effectue à vive allure. Près de la moitié
du commerce mondial a été libérée des protections
douanières. Il s'agit surtout des matières premières
non agricoles et des produits finis.
Les cycles de négociations
commerciales multilatérales
Ces négociations ont eu lieu au cours des cycles de
négociation de Genève (1947), d'Annecy (1949),
Torquay (1950 - 1951) et Genève (1955 -1956). Par la
suite le Dillon Round organisé entre 1961 et 1962 a
abouti à une baisse moyenne des tarifs douaniers de
près de 6 %.
La Communauté Economique Européenne est déjà au
centre des débats. Le tarif extérieur commun (TEC), et
la Politique Agricole Commune (PAC) de la
Communauté Européenne sont contestés par un grand
nombre de pays participants notamment les Etats -
Unis.
Le Kennedy round (1964-1967)
Le Kennedy Round marque la volonté des Etats
- Unis de désarmer le TEC avant l'élargissement
de la CEE. Une réduction moyenne de 37 % des
droits portant sur 1400 produits manufacturés
est obtenue.
Les produits agricoles ne sont pas concernés,
mais il est vrai que les Etats-Unis sont encore
sans vrai rival dans le domaine des
exportations.
Le cycle de Tokyo (1973-1979)
Avec le cycle de Tokyo, pour la première fois depuis 1947,
la négociation commerciale multilatérale dépasse le champ
des questions douanières, pour traiter les obstacles non
tarifaires.
Six accords seront conclus sur les matières non tarifaires :
marchés publics, subventions, obstacles techniques,
antidumping, évaluation en douane, licences
d'importation.
Les secteurs de l'aéronautique civile, des produits laitiers et
de la viande bovine feront l'objet d'accords spécifiques, qui
ne seront toutefois conclus et ratifiés que par une partie
seulement des pays signataires du GATT.
L’Uruguay round (1986-1991)
Ce round de négociations commerciales
multilatérales s'est ouvert en 1986 à Punta Del
Este, en Uruguay. Il avait pour objectifs de régler le
problème des échanges de services et des produits
agricoles qui constituent la terre privilégiée des
protections nationales.
Le cycle d'Uruguay a permis de rendre plus efficace
le mécanisme de règlement des différends et de
créer l'OMC, pivot et garant tout à la fois de l'unité
et de l'équilibre du système commercial
international.
L’organisation Mondiale du
Commerce: l’OMC
Créée en 1994 par les accords de Marrakech concluant
le cycle d'Uruguay, l'OMC est venue tardivement
compléter l'architecture économique du système de
Nations-Unies mis en place au lendemain de la
seconde guerre mondiale.
L'instauration de l'OMC, le premier janvier 1995,
marque un nouveau tournant dans la négociation
commerciale internationale. Pour la première fois,
l'économie mondiale se dotait d'un moyen de
gestion des échanges internationaux, équivalent du
FMI pour les relations monétaires et financières.
La raison d’être de l’OMC
L‘Organisation Mondiale du Commerce (OMC, ou
World Trade Organization, WTO, en anglais) est
une organisation internationale qui s'occupe des
règles régissant le commerce international
entre les pays.
Au cœur de l'organisation se trouvent les accords
de l'OMC, négociés et signés en avril 1994 à
Marrakech par la majeure partie des puissances
commerciales du monde et ratifiés par leurs
assemblées parlementaires.
Le but de l’OMC
L'OMC a pour but principal de favoriser
l'ouverture commerciale.
Elle tâche de réduire les obstacles au libre-
échange.
Aider les gouvernements à régler leurs
différends commerciaux.
Assister les exportateurs, les importateurs,
et les producteurs de marchandises et de
services dans leurs activités.
Les caractéristiques de l’OMC
Par rapport au système antérieur des accords du
GATT, l'OMC présente deux améliorations majeures:
L'OMC est une structure permanente dotée
d'une direction et d'une administration.
Elle est également dotée d'un organe de
règlement des différends qui lui confère un
pouvoir disciplinaire sur ses membres.
L’organisation de l’OMC
L’organisation est basée à Genève et dispose d’un
budget et d’un secrétariat de plusieurs centaines de
personnes.
L'OMC prend ses décisions par "consensus", c'est-à-
dire à l'unanimité de ses membres. Les disciplines
qu'elle institue doivent ainsi être préalablement
acceptées par tous les Etats.
L'OMC n'est donc pas une source autonome de droit,
hors la loi contractuelle des parties, qui donne
naissance aux accords "multilatéraux".
Le fonctionnement de l’OMC
Un Etat membre dispose toujours de l'option de se
soustraire à l'application d'un engagement qu'il a
préalablement souscrit à l'OMC.
Comme dans tout contrat, chaque partie conserve
l'intégralité de sa liberté individuelle. Mais comme
dans toute relation contractuelle, le dédit a un prix
: c'est ce qu'exprime le principe de compensation,
qui trouve dans l'OMC plusieurs grands cas
d'application.
Le principe de compensation
Si un Etat décide de revenir sur un engagement
d'ouverture de son marché (retrait de concession) ou
refuse de se soumettre à une décision de l'organisme
de règlement des différends, il doit octroyer aux
partenaires lésés une compensation d'importance
commerciale équivalente.
A défaut, il encourt le risque de voir l'OMC autoriser
ses partenaires lésés à lui retirer une concession de
même ampleur. A défaut de compensation,
s'appliquent alors des rétorsions.
Structure de l’OMC
Les Etats sont représentés dans tous les organes
dirigeants de l’OMC.
Au sommet, il s'agit de la Conférence Ministérielle
qui donne les grandes orientations.
La gestion courante est assurée par le Conseil
Général qui réunit les hauts fonctionnaires des Etats.
Les Etats sont également représentés dans les
Conseils et Comités spécialisés qui se rapportent au
Conseil général.
Structure de l’OMC
3 autres organes principaux agissent sous la
conduite du conseil général:
Le conseil du commerce des
marchandises;
Le conseil du commerce des services;
Le conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle.
Aucune discipline inscrite dans un accord de
l'OMC ne peut entrer en vigueur sans avoir
été préalablement ratifiée suivant les
procédures domestiques prévues au sein de
chaque Etat membre.
Au Maroc, les accords négociés à l'OMC
font donc l'objet d'une ratification par le
parlement pour acquérir force de traité.
Comme dans les domaines politiques et militaires, les
Etats disposent d'une force inégale dans le commerce
international. Le fondement souverain de la
participation à l'OMC offre donc un avantage
important aux Etats les plus petits ou les faibles
économiquement, car l'organisation leur permet de
faire entendre leur voix, face aux grandes
puissances, dans le processus d'élaboration des règles.
Cet avantage se retrouve au niveau des garanties
d'application des règles, puisque chaque Etat peut
recourir au système de règlement des différends.
L’organe de règlement des
différends
La grande nouveauté de l'OMC réside dans la création
d'une procédure destinée à régler les différends
commerciaux, et à autoriser en dernier recours et sous
certaines conditions, l'usage de sanctions contre des pays
qui manqueraient à leurs engagements.
L'OMC s'est dotée d'un "pouvoir judiciaire", l'organe de
règlement des différends (ORD), auprès duquel les pays qui
s'estiment lésés peuvent porter plainte.
Une procédure permet de régler les conflits entre les Etats
membres. Elle est avant tout fondée sur la négociation,
mais l'organe d'appel présente la particularité d'avoir un
fonctionnement proche de celui d'une juridiction, statuant
sur une conciliation par nature non- juridictionnelle.
Règlement des différends
En cas de différend entre deux Etats membres, la partie
plaignante peut demander à entamer des consultations
avec l'autre partie, dans le but de trouver un règlement
amiable au conflit.
Cette demande doit être notifiée à l'ORD.
Les autres Etats membres, qui témoignent d'un
intérêt commercial substantiel à suivre ces
consultations, peuvent obtenir l'autorisation d'y
participer en qualité de tierce partie (près d'un quart
des conflits sont réglés par le mécanisme des
consultations).
La première étape
Au premier niveau est nommé un groupe d'experts
indépendants choisis sur une liste constituée par les
Etats - membres (diplomates, fonctionnaires,
universitaires) ou parmi leurs représentants à Genève.
Sur la base d'un mandat, ce panel (ou "groupe
spécial") est chargé de rédiger un rapport incluant des
recommandations de solutions pour l'ORD, qui
statue ensuite sur son adoption. Le rapport ne peut
être rejeté que par consensus (décision au " consensus
négatif").
La deuxième étape
Au deuxième niveau existe une instance d'appel à
laquelle peuvent recourir les Etats - membres en cas de
désaccord avec les conclusions du panel.
L'instance d'appel est permanente et composée de
juristes professionnels.
L'instance d'appel peut infirmer, confirmer ou
modifier les conclusions du panel, dans un rapport
qu'elle remet à l'ORD, et dont l'adoption ne peut être
rejetée que par consensus.
La troisième étape
L’aboutissement de la procédure
permet l’adoption automatique du
rapport de l’organe d’appel.
L'ORD ne dispose d'aucun pouvoir
autonome et ses conditions
d'intervention demeurent soumises à la
volonté des membres de l'OMC, qui
déterminent par ailleurs les règles qu'il
doit appliquer pour résoudre les
conflits.
La résolution des contentieux
Pour résoudre les contentieux commerciaux, l'ORD ne peut
se fonder que sur le droit résultant des accords de l'OMC,
c'est-à-dire fondamentalement en déterminant si les
réglementations en cause comportent des éléments
discriminatoires, ou si les justifications apportées par les
Etats dérogent aux exigences de bonne foi.
En aucun cas, l'ORD ne peut créer de nouvelles règles. La
compatibilité de sa "jurisprudence" avec les accords
souscrits par les Etats membres de l'OMC est garantie par
l'organe d'appel.
Critiques de la part des
mouvements altermondialistes
Les mouvements altermondialistes reprochent à l'OMC de
promouvoir la mondialisation de l'économie et la
libéralisation du commerce. Les traités signés sont
accusés de plus favoriser les entrepreneurs des pays riches
que les salariés ou les pays pauvres.
Comme l’a reconnu Pascal Lamy, ex directeur général de
l'OMC (2005), au sujet de l'AGCS (Accord Général sur la
Commercialisation des Services) que promeut l'OMC : "
l'AGCS est avant tout un instrument au bénéfice des
milieux d'affaires"
Critiques de la part des
mouvements altermondialistes
Les altermondialistes considèrent que les
représentants des grandes puissances, des
firmes transnationales, de la finance
mondiale, imposent à l'OMC leurs
conceptions néolibérales. Il s'agit d'assimiler
à des marchandises des secteurs comme
l’agriculture, l'eau, l'éducation, la santé, les
services sociaux et notamment les services
publics.
Critiques de la part des
altermondialistes
D'après les altermondialistes, l'OMC impose aux Etats
de modifier leurs lois, règlements, procédures
administratives pour les mettre en conformité avec les
règles qu'elle édicte. Mais ces règles édictées par
l'OMC, loin de résulter d'un processus démocratique,
sont prises dans l'opacité par une minorité de
"puissants" (représentants des Etats les plus riches, des
grandes entreprises, des grandes Banques), alors que la
majorité des Etats et des populations du monde ne
sont même pas consultés ni même réellement
informés.
Primauté de l’OMC sur les autres
organisations internationales
L'OMC semble être devenue peu à peu, à l'insu de la
majorité des populations, l'organisation internationale la
plus puissante du monde. Son pouvoir réside en particulier
dans l'organe de règlement des différends (ORD). En effet,
par cet instrument, l'OMC est la seule organisation
internationale à disposer d'une capacité de sanctionner les
Etats qui ne respectent pas les accords qu'elle a adoptés.
L'ORD est un mécanisme réservé de fait aux pays
industrialisés : appliquer des mesures de rétorsion est
inenvisageable pour un Etat du sud, dépendant d'un Etat
du nord. La perte de souveraineté des Etats par rapport à
l'OMC apparaît très préoccupante.
Primauté de l’OMC sur les autres
organisations internationales
Actuellement, les règles de l'OMC s'imposent de facto sur
celles de toutes les autres organisations internationales.
Par exemple, dans le domaine du travail et des droits
sociaux, logiquement ce devrait être l'Organisation
Internationale du Travail (OIT), organisme des Nations
Unies, qui impose le respect des droits sociaux
fondamentaux à l'échelle internationale.
En cas de conflit d'intérêts entre un droit fondamental des
travailleurs reconnu par l'OIT et un intérêt commercial
garanti par l'OMC, c'est de facto l'OMC qui obtient gain de
cause, puisque l'OIT n'a aucun pouvoir de sanction,
contrairement à l'OMC.
Primauté de l’OMC sur les autres
organisations internationales
L'OMC ferait du commerce une valeur suprême qui serait
la source d'un conflit de droits avec des normes
internationales en matière de droits de l'homme, de
protection sociale et environnementale, de protection de la
santé, de protection sanitaire, bien que les accords du
GATT précisent explicitement des exceptions à ces fins.
Les altermondialistes se fondent sur ces aspects pour
accuser l'OMC de promouvoir le néolibéralisme et une
mondialisation discriminatoire. Ils mettent au débat la
nécessité de remettre le commerce à ce qu'ils considèrent à
sa juste place, en obligeant l'OMC à mieux coordonner ses
décisions à d'autres aspects du droit international via son
rattachement à l'ONU.
Critique de la part des libéraux
L'OMC est critiquée également par les
libéraux qui lui reprochent d'organiser
non pas le libre échange, mais la
régulation des échanges, et d'être ainsi
le reflet des points de vue
mercantilistes des hommes politiques
Critique de la procédure de
règlement des différends
Le système de règlement des différends de l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) est devenu le pilier du
système commercial multilatéral et un outil privilégié pour
mettre en place des "règles" de libéralisation des échanges.
Dans le cas des relations commerciales entre Etats régies
par l’OMC, ce sont les intérêts de grands opérateurs privés
qui sont directement en cause. De grandes entreprises
nationales qui s'estiment lésées par la législation d'un autre
Etat peuvent ainsi entreprendre des pressions pour que des
actions soient intentées. Le système en devient donc
pervers et ressuscite une "loi du plus fort" en favorisant les
lobbies les plus puissants, seuls capables d'initier cette
protection.
Critique de la procédure de
règlement des différends
V. Pace considère que les grandes multinationales
sont tentées de se servir de l'OMC, via les Etats,
pour faire valoir leurs intérêts privés. Il y a là un
danger qui ne doit pas être sous-estimé. Les Etats,
sous la pression des lobbies, peuvent être amenés à
utiliser le mécanisme de règlement des différends
de l'OMC pour s'attaquer à des législations
étrangères qui ne servent pas les intérêts des
grands groupes privés.
Vous aimerez peut-être aussi
- Cosmopolite 4 B2 Livre de L'ÉlèveDocument256 pagesCosmopolite 4 B2 Livre de L'ÉlèveMateo Martinez95% (22)
- Audit Des Plateformes LogistiquesDocument48 pagesAudit Des Plateformes LogistiquesKhalid Benarib50% (4)
- Plan Qhse 2021 Somad ConvertiDocument41 pagesPlan Qhse 2021 Somad ConvertiMustapa stophe100% (1)
- TEF Compréhension Ecrite Section B Exemple 1Document8 pagesTEF Compréhension Ecrite Section B Exemple 1Ruchini Peiris100% (1)
- 0 Région, Régionalisation Et Développement Régional - Cas Du MarocDocument22 pages0 Région, Régionalisation Et Développement Régional - Cas Du MarocSimou El alamiPas encore d'évaluation
- Le Controle de Gestion Dans Les Universités Cas Des Universités MarocainesDocument31 pagesLe Controle de Gestion Dans Les Universités Cas Des Universités MarocainesSimou El alamiPas encore d'évaluation
- 13 - Module Gestion Axée Sur Les Résultats Sensibles Au GenreDocument29 pages13 - Module Gestion Axée Sur Les Résultats Sensibles Au GenreSimou El alami100% (1)
- GFCF 2020-2021 QCM VFDocument18 pagesGFCF 2020-2021 QCM VFSimou El alamiPas encore d'évaluation
- Corrigé TD 1 S2 Comptabilité Générale II 19-20 - AHMED AFTISSDocument3 pagesCorrigé TD 1 S2 Comptabilité Générale II 19-20 - AHMED AFTISSSimou El alami0% (1)
- Rapport Eep 2013 Synthese 2Document10 pagesRapport Eep 2013 Synthese 2Simou El alamiPas encore d'évaluation
- Seance 1Document107 pagesSeance 1Simou El alamiPas encore d'évaluation
- Culteur D'entrepriseDocument23 pagesCulteur D'entrepriseSimou El alamiPas encore d'évaluation
- Méthodes Économétriques Série 2Document2 pagesMéthodes Économétriques Série 2Simou El alamiPas encore d'évaluation
- Convention Collective NationaleDocument109 pagesConvention Collective NationalenicolasPas encore d'évaluation
- 2019 SUPINFO Nouveau-ProgrammeDocument71 pages2019 SUPINFO Nouveau-ProgrammeCamillePas encore d'évaluation
- Rattrapage Master 1 21.22 1 1Document9 pagesRattrapage Master 1 21.22 1 1Salah ChPas encore d'évaluation
- Fiche Projet La CUBDocument4 pagesFiche Projet La CUBurbalab2010Pas encore d'évaluation
- Les Nouveautés Digitales Hachette FLEDocument2 pagesLes Nouveautés Digitales Hachette FLEȚuțu ElenaPas encore d'évaluation
- EXAMEN Final Intro Au Management - LCS - 2022Document4 pagesEXAMEN Final Intro Au Management - LCS - 2022ASSOGBADJO Septime OlympePas encore d'évaluation
- La Vulgarisation Scientifique Mélodie - PPTX Version 1Document11 pagesLa Vulgarisation Scientifique Mélodie - PPTX Version 1Belabes TarayadPas encore d'évaluation
- L'intelligence Humaine ADocument14 pagesL'intelligence Humaine AOumelaid BouhadachPas encore d'évaluation
- Lettre Pour Un Stage RH Système UDocument1 pageLettre Pour Un Stage RH Système UVincent Quélard0% (1)
- Recensement Economique 2001 - 2002, Rapport N°1 - Résultats Relatifs Aux Établissements Économiques, Fascicule N°1 - Résultats Agrégés Décembre 2004Document103 pagesRecensement Economique 2001 - 2002, Rapport N°1 - Résultats Relatifs Aux Établissements Économiques, Fascicule N°1 - Résultats Agrégés Décembre 2004pfePas encore d'évaluation
- Démons Et Merveilles de L'internet Université BayardDocument19 pagesDémons Et Merveilles de L'internet Université BayardYann LerouxPas encore d'évaluation
- Dossierb Cpge091Document3 pagesDossierb Cpge091simo2192@hotmail.comPas encore d'évaluation
- Annexe Technique Air Algerie 1 1 002 Rev04 11 04 2021 SWDocument7 pagesAnnexe Technique Air Algerie 1 1 002 Rev04 11 04 2021 SWZaoui NouriPas encore d'évaluation
- Préparer Et Diffuser Sa CandidatureDocument6 pagesPréparer Et Diffuser Sa CandidatureAnouar RjjPas encore d'évaluation
- Projet Avis de Recrutement Consortium OkDocument14 pagesProjet Avis de Recrutement Consortium OkNFA BENINPas encore d'évaluation