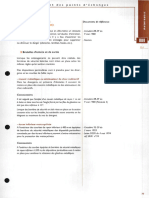Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
GG TR 37
GG TR 37
Transféré par
Sanjay SwamiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
GG TR 37
GG TR 37
Transféré par
Sanjay SwamiDroits d'auteur :
Formats disponibles
de la retenue permanente).
Tel que le montre la figure dé de 75 mm) qui nécessitera une protection adéquation
11-83, un bassin ayant une retenue permanente impor- contre le colmatage.
tante mais pas de retenue prolongée présenterait une per-
formance d’enlèvement des MES différente de celle d’un Cellule à l’entrée
autre bassin qui aurait une retenue permanente faible mais Une cellule de prétraitement à l’entrée facilitera l’entretien
une retenue prolongée de longue durée. Le volume de la et augmentera la capacité pour l’enlèvement des polluants
retenue permanente devrait minimalement correspondre en retenant les particules de plus grandes dimensions à
au volume calculé pour le contrôle qualitatif (tel que pré- cet endroit. La cellule devrait comprendre une zone plus
senté au chapitre 8) pour atteindre une performance de profonde (1 m) pour minimiser l’érosion et la remise en
80 % d’enlèvement des MES. suspension des particules.
Un contrôle pour la qualité impliquera l’utilisation La cellule devrait être séparée du reste du bassin
d’un orifice de plus petit diamètre (minimum recomman- par une berme en matériau granulaire, qui devra être
Tableau 11.18
Résumé des critères de conception – bassin avec retenue permanente
(adapté de MOE, 2003, UDFCD, 2005; Vermont, 2002; MPCA, 2005), Calgary, 2011.
Paramètre ou élément Objectif pour la conception Critère minimal Critère recommandé
de conception
Superficie du bassin versant Dimensions minimales des ouvra- 5 ha ≥ 10 ha
tributaire ges de contrôle à la sortie
Volume de la retenue Fournir un certain pourcentage Une fois le volume calculé pour le contrôle qualitatif Une fois le volume calculé pour le
variable d’enlèvement des polluants contrôle qualitatif
Volume de la retenue Fournir un certain pourcentage Une fois le volume calculé pour le contrôle qualitatif Volume de la retenue permanente aug-
permanente d’enlèvement des polluants menté pour tenir compte de l’épaisseur
de glace anticipée et de l’espace occupé
par l’accumulation de sédiments
Durée de la retenue pro- Décantation des matières en 24 h (12 h si en conflit avec le critère d’orifice minimum) 48 h
longée suspension
Cellule à l’entrée Prétraitement Profondeur min. : 1 m Profondeur min. : 1,5 m
Conçue pour ne pas produire des vitesses favorisant Volume maximum : 20 % de la retenue
l’érosion à la sortie de la cellule permanente
Surface maximale : 33 % de la retenue permanente
Ratio longueur/largeur Maximiser le parcours de l’écoule- 3 :1 (peut être accompli par des bermes ou autres De 4 :1 à 5 :1
ment et minimiser le potentiel de moyens)
court-circuitage Pour la cellule de prétraitement : minimum 2 :1
Profondeur de la retenue Minimiser la remise en suspension, Profondeur max. : 3 m Profondeur max. : 2,5 m
permanente mauvaises conditions pour l’eau Profondeur moy. : 1 - 2 m Profondeur moy. : 1 - 2 m
Sécurité
Profondeur de la retenue Contrôle des débits Qualité et érosion : max. 1,5 m Qualité et érosion : max. 1 m
variable Total (incluant les débits plus rares) 2 m Profondeur moy. : 1 - 2 m
Pentes latérales Sécurité 5 :1 pour 3 m de chaque côté de la retenue permanente 7 :1 près du niveau d’eau normal avec
Maximiser la fonctionnalité Maximum 3 :1 ailleurs l’utilisation de marches de 0,3 m
du bassin 4 :1 ailleurs
Entrée Éviter blocage ou gel Minimum : 450 mm Pente de la conduite > 1 %
Pente > 1 %
Si submergée, le dessus de la conduite devrait être
150 mm sous le niveau maximal de la glace
Sortie Éviter blocage ou gel Minimum : 450 mm pour conduite de sortie Pente de la conduite > 1 %
Conduite à pente inversée comme ouvrage Diamètre minimal d’un orifice de
de sortie devrait avoir un diamètre minimum contrôle : 100 mm
de 150 mm
Pente > 1 %
Si un contrôle par orifice est utilisé, diam.
Minimum de 75 mm (à moins d’être protégé)
Accès pour la maintenance Accès pour camion ou petite Soumis à l’approbation des Travaux Publics Prévoir un mécanisme pour vider au
rétrocaveuse besoin les cellules à l’entrée ou à la sortie
LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES DES EAUX PLUVIALES CHAPITRE 11-81
protégée contre l’érosion par de l’enrochement. Cer- par ailleurs avoir leur radier au moins 0,6 m au-dessus
tains calculs peuvent permettre de configurer la cellule du fond de la cellule (MOE, 2003). Si la berme est sub-
(figure 11.84). mergée (ce qui est recommandé pour ne pas inciter les
La longueur de la cellule devrait être la plus grande personnes à y accéder), le dessus devrait être de 150 à
valeur entre les 2 équations suivantes (MOE, 2003) : 300 mm sous le niveau de la retenue permanente (MOE,
r Qp 8Q 2003).
Dist = ou Dist =
Vs d Vr
Où Dist = la longueur de la cellule (m) Ratio longueur/largeur
r = ratio longueur/largeur
€
Idéalement, le ratio longueur/largeur devrait être le plus
€
Qp = Débit de pointe à la sortie du bassin pour la long possible et l’entrée du bassin devrait être en principe
pluie de conception pour le contrôle qualitatif le plus loin possible de la sortie. L’utilisation de bermes,
Q = Débit de pointe correspondant à la capacité de produisant un parcours sinueux, peut aider à allonger le
la conduite d’entrée temps de parcours.
Vs = vitesse de décantation (qui dépend de la
dimension des particules – une vitesse de Profondeur
0,0003 m/s est recommandée (MOE, 2003) La profondeur d’eau moyenne pour la retenue permanen-
d = profondeur de la retenue permanente dans la te devrait être de 1 à 2 m (MOE, 2003), avec un maximum
cellule (dans la partie la plus profonde) de 3 m incluant tous les volumes de stockage. La hauteur
Vf = vitesse désirée dans la cellule (m/s) – objectif : maximale pour la tranche au-dessus de la retenue perma-
inférieure à 0,5 m/s nente devrait par ailleurs être limitée à 2 m.
La première équation tient compte du mécanisme
de décantation alors que la deuxième établit la longueur Pentes latérales
nécessaire pour ralentir un jet arrivant dans la cellule. Le Les pentes latérales d’un bassin sec sont en général moins
débit pour le contrôle de la qualité devrait être établi avec critiques que pour un bassin avec retenue permanente
la pluie de conception appropriée, ou encore avec la mé- mais, comme l’eau pourra rester pour une période de 24 à
thode rationnelle en utilisant l’intensité de pluie établie 48 h avant une vidange complète, les pentes devraient être
avec l’équation suivante (MOE, 2003) : idéalement de 4 :1 ou plus douces si possible.
I = 43 C + 5,9
Où I est l’intensité de pluie (mm/h) et C est le coefficient Entrée
de ruissellement de la méthode rationnelle. On devra de façon générale limiter le nombre d’entrées
La largeur de la cellule dans la partie la plus profonde au bassin pour minimiser surtout l’entretien. Une protec-
devrait être établie avec l’équation suivante (MOE, 2003) : tion adéquate devra toujours être prévue pour minimiser
Largeur = Dist/8 l’érosion (voir section sur les éléments communs aux dif-
Généralement, la largeur devrait faire en sorte que le férents types de bassins).
ratio longueur/largeur soit supérieur à 2 :1 (MOE, 2003).
Le volume d’eau retenue en permanence devrait Sortie
également correspondre à un certain pourcentage du Il y a plusieurs types de mécanismes de contrôle et d’amé-
volume pour le contrôle de la qualité (3-5 %; UDFCD, nagement possibles à la sortie d’un bassin avec retenue
2005)) ou encore, être établi en fonction de la superficie permanente. Généralement, les ouvrages devraient être
imperméable du bassin tributaire (environ 6,25 mm par localisés dans la digue et dans une chambre pour faci-
ha; Georgia, 2000). liter l’accès et les activités d’entretien. Un système avec
Le fond de la cellule devrait être en béton ou avec conduite à pente inversée peut être utilisé pour achemi-
un autre type de matériau relativement lisse et résistant, ner l’eau dans une chambre, où les différents mécanismes
de façon à faciliter l’enlèvement des sédiments (UDFCD, de contrôle pour comprendre une conduite perforée ins-
2005). tallée verticalement ou un petit orifice dans un mur pour
Les conduites installées dans la berme devraient le contrôle des plus petits débits (qualité et érosion) et
LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES DES EAUX PLUVIALES CHAPITRE 11-82
Figure 11.85 Configuration typique d’un bassin d’infiltration (adapté de MOE, 2003).
d’autres orifices et déversoir pour le contrôle des débits Plantations
plus importants (10 ans et 100 ans). Un déversoir d’urgen- Une stratégie de plantations relativement élaborée est né-
ce devrait toujours être prévu au cas où il y aurait colma- cessaire pour un bassin avec retenue permanente pour
tage des autres orifices. La conduite de sortie de la cham- fournir des bénéfices pour l’ombrage, l’esthétisme, la sécu-
bre devrait par ailleurs être de dimensions suffisantes rité, les habitats et l’enlèvement des polluants.
pour accepter les débits maximaux (typiquement 1 dans La section 11.7.2 donne des suggestions et recom-
100 ans en tenant compte du laminage dans le bassin). mandations pour les plantations les plus appropriées pour
ces différentes zones.
Revanche
Une revanche minimale de 300 mm devrait être pré- Opération en conditions hivernales
vue entre le niveau maximal de conception et le niveau Pour tenir compte de la glace, il est recommandé que le vo-
de débordement du bassin. Un déversoir d’urgence doit lume de la retenue permanente soit augmenté par une va-
également être prévu et on devra évaluer au besoin les leur équivalente au volume occupé par le couvert de glace
conséquences d’un débordement pour les secteurs envi- (MOE, 2003). Le diamètre de la conduite d’entrée devrait
ronnants. être au minimum de 450 mm, avec une pente minimum
de 1 % si possible. L’entrée ne devrait pas être submergée
Protection pour l’érosion ou, si c’est impossible, le dessus de la conduite devrait être
Cette protection est importante à prévoir, tant à l’entrée au moins 150 mm plus bas que le dessous de la glace. Le
qu’à la sortie du bassin de rétention. Des mécanismes diamètre minimum de la conduite de sortie (à pente inver-
de diffusion pour diminuer l’énergie du courant, comme sée) devrait être de 150 mm, en tenant compte également
des bassins ou des bermes particulières, peuvent être em- d’un dégagement minimum de 150 mm pour la glace.
ployés. La grosseur de l’enrochement à prévoir dépend Pour les volumes printaniers avec une charge plus éle-
des vitesses attendues pour les conditions de design. vée de polluants, certains guides ont suggéré l’utilisation
d’une approche de gestion adaptée aux différentes saisons
Étanchéisation du fond (MPCA, 2005; Vermont, 2002), en ajustant les degrés de
Si les analyses géotechniques indiquent que c’est né- contrôle à la sortie (en évitant par exemple la relâche des
cessaire, le fond devra être rendu imperméable à l’aide débits printaniers et en la faisant graduellement pour mieux
d’une couche d’argile ou avec une membrane spécifique diluer les rejets). Le guide du Minnesota (MPCA, 2005)
(MPCA, 2005; Washington, 2005). fournit une discussion approfondie de ce type de gestion.
LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES DES EAUX PLUVIALES CHAPITRE 11-83
11.7.5 Bassin d’infiltration sible (zones sensibles). Les sols en place doivent avoir un
Description très bon taux de percolation (> 60 mm/h; MOE, 2003),
Un bassin d’infiltration est conçu pour stocker le volume avec les conditions usuelles pour des pratiques fonction-
de ruissellement et l’infiltrer sur une période de plusieurs nant par infiltration (nappe phréatique ou roc à au moins
heures. Ce type de système, qui doit être construit dans 1 m sous le lit du bassin d’infiltration).
des sols hautement perméables, a été très peu utilisé au
Québec ou ailleurs au Canada jusqu’à maintenant (MOE, Avantages
2003). Certains pays (Barraud et al., 2006) ou états améri- Réduit le volume de ruissellement ;
cains (Washington, 2005; Maryland, 2000) ont toutefois eu Peut être très efficace pour enlever les sédiments fins,
l’occasion d’utiliser ce système et de proposer certaines re- les métaux, les nutriments, les bactéries et les subs-
commandations quant à leur conception. Le prétraitement, tances organiques ;
en utilisant des séparateurs, des fossés, des bassins de sédi- Réduit les surcharge en aval et contribue à contrôler
mentation ou des bandes filtrantes, est un élément essentiel l’érosion dans les cours d’eau ;
de la conception pour assurer une durée de vie acceptable. Réduit les dimensions et les coûts des infrastructures
en aval ;
Applicabilité Contribue à la recharge de la nappe ;
Ce type de système n’est pas applicable à des secteurs Approprié pour de petits sites (superficie inférieure
pouvant apporter une grande quantité de sédiments et à 1 ha).
lorsqu’une contamination de la nappe phréatique est pos-
Limitations
Tableau 11.19 Peut mal fonctionner à cause d’une conception, d’une
Résumé des critères de conception – bassin d’infiltration construction ou d’un entretien déficient, en particu-
(adapté de MOE, 2003). lier si un prétraitement approprié n’est pas incorporé
à la conception ;
Paramètre Objectif pour Critère minimal
Dépendant des conditions de sols, de l’occupation du
ou élément la conception
de conception sol dans le bassin versant et de la profondeur de la
Superficie du bassin Infiltration 5 ha nappe phréatique, un risque de contamination peut
versant tributaire exister ;
Volume pour le Fournir un certain pour- Événement de conception Non approprié pour des sites industriels ou commer-
contrôle de la qualité centage d’enlèvement pour la qualité
des polluants ciaux où la relâche de quantités importantes de sédi-
Taux de percolation Infiltration > 60 mm/h ments ou de polluants est possible ;
Profondeur de la Infiltration >1m
Susceptible au colmatage, ce qui implique un suivi
nappe phréatique plus rigoureux et un entretien fréquent ;
Profondeur du roc Infiltration >1m Requiert une surface plane relativement grande ;
Ratio longueur/ Disperser le débit 3 :1 recommandé Requiert des inspections fréquentes et un bon en-
largeur tretien.
Profondeur de Prévenir la compaction < 600 mm
stockage
Principes et critères de conception
Prétraitement Longévité Requis
Protection de la nappe Prévoir une redondance Certaines références fournissent une discussion détaillée
phréatique des mécanismes de pré- des éléments de conception pour ce type de système
traitement
(MOE, 2003; Barr, 2001; Washington, 2005, Barraud et al.,
Bypass Opération hiver/prin- Requis 2006; CIRIA, 1996) et on pourra les consulter au besoin.
temps
Le tableau 11.19 donne les principales recommandations
Accès pour la main- Accès pour équipement Soumis à l’approbation
tenance léger des Travaux Publics tirées du guide de l’Ontario (MOE, 2003).
Plan d’aménagement Favoriser l’infiltration Gazon, herbes,
paysager Augmenter la porosité légumes avec des racines
profondes
LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES DES EAUX PLUVIALES CHAPITRE 11-84
Figure 11.86 Configuration typique d’un marais artificiel Figure 11.87 Aménagement d’un marais artificiel.
(adapté de MOE, 2003).
Figure 11.88 Éléments de conception d’un marais artificiel (adapté de Vermont, 2002).
LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES DES EAUX PLUVIALES CHAPITRE 11-85
Vous aimerez peut-être aussi
- PV Cisai Direct CD - Pk27+880-02-Er02-LateriteDocument1 pagePV Cisai Direct CD - Pk27+880-02-Er02-LateriteSanjay SwamiPas encore d'évaluation
- 3.4.4 - Calcul Du Facteur de Portance K: Courbe K A B C K Argiles Et LimonsDocument50 pages3.4.4 - Calcul Du Facteur de Portance K: Courbe K A B C K Argiles Et LimonsSanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Eurocode 7: Application Aux Murs (NF P94-281)Document50 pagesEurocode 7: Application Aux Murs (NF P94-281)Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Annexe A - LogigrammeDocument26 pagesAnnexe A - LogigrammeSanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Road Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 2Document60 pagesRoad Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 2Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Road Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 6Document50 pagesRoad Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 6Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- DT6969 NF P 94 281 Ul 2Document50 pagesDT6969 NF P 94 281 Ul 2Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Road Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 3Document60 pagesRoad Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 3Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Road Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 5Document60 pagesRoad Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 5Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Road Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 4Document60 pagesRoad Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 4Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Road Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 1Document60 pagesRoad Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 1Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- rf18014216 Plan Mob Rural Nov2016Document109 pagesrf18014216 Plan Mob Rural Nov2016Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- GG TR 34Document5 pagesGG TR 34Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Road Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 8Document71 pagesRoad Restraints - Frequently Asked Questions (FAQ) UL 8Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Rapport BeynacDocument89 pagesRapport BeynacSanjay SwamiPas encore d'évaluation
- GG TR 41Document5 pagesGG TR 41Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Bordures p2Document1 pageBordures p2Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- GG TR 45Document5 pagesGG TR 45Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- CTD Signe 22-06-15Document185 pagesCTD Signe 22-06-15Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- P09-01errata Fevrier 2016 0Document15 pagesP09-01errata Fevrier 2016 0Sanjay SwamiPas encore d'évaluation
- 274 Amenagement Traversee Agglomeration Demarche ProjetDocument145 pages274 Amenagement Traversee Agglomeration Demarche ProjetSanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Marshy Loctaions Seg2 TPMCDocument6 pagesMarshy Loctaions Seg2 TPMCSanjay SwamiPas encore d'évaluation
- Export IrDocument26 pagesExport IrSanjay SwamiPas encore d'évaluation