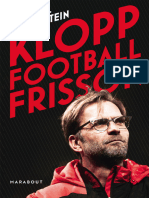Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Article Medit 0025-8296 2002 Num 99 3 3270
Article Medit 0025-8296 2002 Num 99 3 3270
Transféré par
Van Der CenereTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Article Medit 0025-8296 2002 Num 99 3 3270
Article Medit 0025-8296 2002 Num 99 3 3270
Transféré par
Van Der CenereDroits d'auteur :
Formats disponibles
Marc Cte
Une ville remplit sa valle : Ghardaa (Note)
In: Mditerrane, Tome 99, 3-4-2002. Le sahara, cette autre Mditerrane (Fernand Braudel) pp. 107-110.
Citer ce document / Cite this document : Cte Marc. Une ville remplit sa valle : Ghardaa (Note). In: Mditerrane, Tome 99, 3-4-2002. Le sahara, cette autre Mditerrane (Fernand Braudel) pp. 107-110. doi : 10.3406/medit.2002.3270 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medit_0025-8296_2002_num_99_3_3270
Mditerrane N 3.4 - 2002
107 NOTE
Une ville remplit sa valle : Ghardaa A city fills its valley : Ghardaa
Marc COTE
Le M'Zab est connu, dans tout le Sahara et audel, pour la qualit admirable de son architecture, pour la symbiose de son urbanisme avec le cadre environnemental. De Le Corbusier F. Pouillon et M. Ravereau, il a inspir bien des architectes. Mais les formes de l'urbanisation et leur rapport au cadre topographique ont t moins analyss. Or elles sont passionnantes galement tudier, par suite de la double spcificit du M'Zab. Spcificit de ce site de valle taille comme au couteau dans le plateau grseux et rocheux de la Chebka. Spcificit de cette socit mozabite, ibadite et berbrophone, trs cohrente, et structure de faon originale. Dans ce contexte, le M'Zab a connu au xxe sicle une volution puissante. D'une valle rurale une valle urbaine. De la Pentapole une mtropole. C'est cette volution que nous voudrions retracer ici grands traits. 1. La structuration initiale : la Pentapole Sur le plan spatial, l'implantation humaine dans le M'Zab peut tre dfinie en terme de module reproductible plusieurs exemplaires sur courte distance (fig. 1). Le module est simple, et comprend d'une part le ksar-cit, trs group et enferm dans ses remparts, d'autre part un amnagement agricole, c'est--dire une palmeraie alimente sur nappe alluviale, par un systme complexe de barrage d'infro-flux et de puits traction animale. Donc, dans un cas comme dans l'autre, une unit de base (habitat et
exploitation) individuelle, un amnagement spatial collectif, fruit d'une forte collectivit. Or, la valle du M'Zab se prsentait comme la rptition par 5 fois de ce module au long de l'oued, sur une distance limite (20 km). Rsultat de l'histoire duxie sicle, s'est constitue la Pentapole, comprenant 5 cits (d'amont l'aval Ghardaa, Melika, Bni Isguen, Bounoura, El Atteuf), 6 barra ges, 5 palmeraies (situes dans le lit de l'oued principal, et galement dans 2 valles affluentes). Le site urbain privilgi a t dans 2 cas une butte intra-valle, dans 3 cas le rebord de valle, au premier tiers du versant. Les cits se sont cres d'aval en amont, par essaimage chaque fois qu'une cit avait rempli son site. Au total, si l'on comprend le village (non ibadite) de Daa plus loin encore l'amont, l'occupation de la valle est quasi continue sur 25 km de longueur. noter un secteur peu occup par les palmeraies, entre El Atteuf et Bounoura, parce que le fond de valle, plus troit , est occup entirement par le lit de l'oued et ses divagations. Le ksar de Ghardaa s'est progressivement affirm comme le plus important. Il comportait, en contrebas de la vieille cit, un quartier juif. Au total, cette valle du M'Zab prsentait un amnagement relativement classique au Sahara, de villages sur le versant d'une valle contrlant les palmeraies tablies en contrebas sur les deux terrasses de part et d'autre du lit de l'oued. Paysage encore trs actuel par exemple dans les valles du Draa et du Ziz (Maroc). Mais qui ici a t fortement boulevers.
* Professeur mrite, Universit de Provence, Aix-en-Provence.
108 Ksar Barrage Palmeraie
PHASE 1 La cit et son terroir
PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 L'espace des particuliers L'espace des pouvoirs publics Une rupture radicale - L'urbanisation des hautes terrasses - Amnagement de l'oued et du versant - Les extensions sur le plateau FIG. 1 - VOLUTION DANS LA VALLE DU M'ZAB - rduction des palmeraies la portion congrue. Le palmier est toujours l, entourant l'habitat, ou enferm dans la cour ; il donne toujours sa note au paysage urbain. Mais la contraction de la palmeraie, paralllement la croissance de la population, traduit le changement fondamental de revenus de la communaut mozabite (orientation vers le commerce et les services). Les palmeraies se trouvent limites aujourd'hui aux basses terrasses. On peut noter galement que cette volution s'est traduite par une hirarchisation progressive au sein de la Pentapole, Ghardaa tendant asseoir sa prminence : elle reprsentait 44% de la population de la Pentapole en 1896, elle en reprsente 68% en 1998. 3. L'accompagnement de cette urbanisation par les pouvoirs publics : tape 3 Ralisation complmentaire, et indispensable, du point de vue fonctionnel. Mais qui s'est ralise avec un net dcalage dans le temps. Elle est pour l'essentiel le fait des dcennies 1970-90, et corres pond l're du volontarisme de l'tat sur l'espace et sur les villes. Au M'Zab, parce que l'agglomration tait devenue importante, les pouvoirs publics ont voulu intervenir. Ils l'ont fait de faon identique leurs interventions sur d'autres villes, aux adaptations prs. Ils ont essay de penser la Valle comme un ensemble, bien qu'administrativement elle soit divise en 3 communes (4 avec celle de Daa). Cela s'est traduit en particulier par les lments suivants : -forages au continental intercalaire (une cinquant aine au total pour la valle), et ralisation de chteaux d'eau sur les versants, alimentant les diffrentes cits ; -canalisation de l'oued (digues, parapet), et ralisa tion d'une conduite d'gout dans le lit de l'oued (1987) ;
2. L'urbanisation du fond de valle : tape 2 Elle est l'uvre du xxe sicle. Et le fruit de la croissance dmographique. La Pentapole comptait 18 000 habitants en 1896, elle en compte 135 000 aujourd'hui. Elle y a abouti par un mouvement d'urbanisation spontan, progressif, aux mains de la population autochtone. Celui-ci s'est fait logiquement sur les terrains en contrebas de la cit initiale : terrains plans, et sur lesquels les citadins disposaient chacun de droits fonciers. L'attachement des Mozabites leur palmeraie a tendu concilier droit coutumier rural (respect des palmiers) et droit coutumier urbain (limitation de la taille et de la hauteur des maisons). Il a vit ainsi de dfigurer les paysages urbains. La pression sur les terres a t variable suivant les catgories sociales et les territoires. Pour les familles aises, la maison au sein de la palmeraie a un temps t conue comme une rsidence d't, plus frache l'poque o la cit est surchauffe. Toutes tendent aujourd'hui devenir des rsidences permanentes. proximit des cits, de Ghardaa principalement, o la pression tait la plus forte, l'urbanisation s'est faite de faon dense, ailleurs par mitage de la palmeraie. Ces extensions ont pour origine, pour partie un glissement des populations ibadites partir des ksour, pour partie l'insertion de populations malkites venues de l'extrieur. Le paysage urbain juxtapose aujourd'hui les deux types de minarets. Le rsultat de cette volution a t double (fig. 2) : - d'une part, forte extension du bti hors des cits, l'espace urbanis au xxe sicle tant schmatiquement 8 fois plus tendu que celui des cits (logements plus nombreux et plus spacieux). Il couvre essentiellement les hautes terrasses.
Vers Alger Bouraqua
109 Ii3 T ^ j^| v ^ * Cit histonque Bti rcent Palmeraie Mise en valeur agricole Chteau d'eau Grand htel Relai de tlcomumcations Cimetire Barrage Grand collecteur Limite Plateau de la Chebka
Oued Nlissa
Vers Aroport FIG. 2 - L'AGGLOMRATION DE GHARDAA EN 2001 - ralisation de 6 ponts et 2 passerelles le long de la la rputation de ville touristique. Il se rvle plus valle, cration d'une voie routire le long de l'oued, difficile aujourd'hui d'assurer cette valle son avec amnagements urbains (arcades, kiosques, assainissement que son approvisionnement en eau. clairage public) de Ghardaa Bounoura ; - cration d'un certain nombre d'quipements publics classiques, les plus consommateurs d'espace tant 4. La monte sur les plateaux : tape 4 implants dans le fond de la valle (gare routire, lyce, htel 500 lits,....). Identifies leur ksour et leur palmeraies, les En outre, ont t ralises par les pouvoirs populations ont toujours manifest une forte publics quelques cits d'habitat, soit en logements rticence psychologique sortir de leur Valle. collectifs ( l'amont de Ghardaa), soit en individuel Mais l'agglomration se trouve aujourd'hui (cit Bni Abbas). Leur petite taille, et une certaine devant une situation nouvelle : la saturation (ou recherche architecturale, font qu'elles ne dnotent quasi-saturation) du fond de valle. Il n'est pas pas dans le tissu urbain gnral. possible de tirer plus l'urbanisation en longueur le Par contre, l'tat a eu plus de peine faire long de la valle. Or il faut tenir compte des besoins face certains problmes spcifiques cette nouveaux, souvent encombrants (quipements), ainsi urbanisation de fond de valle. C'est le cas pour la que de la volont des pouvoirs publics de sauvegarder protection contre les risques de crues (telles celles ce qui reste des palmeraies (d'autant que leur statut de 1991 Ghardaa, de l'anne 2000 dans l'oued priv y entrave l'intervention de l'tat). Le site du N'Tissa), considres comme bnfiques l'poque bras de mandre recoup, l'aval, aprs avoir fait o la valle tait agricole, mais qui se rvlent l'objet de projets urbains, est rserv dsormais catastrophiques l're de la valle urbaine. Deux pour la mise en valeur agricole (dans le cadre de barrages d'crtage de crue sont en cours de cons l'accession la proprit foncire agricole). truction, sous l'gide des communauts locales ( La solution est donc la sortie hors de la valle, l'amont des oueds El Abiod et N'Tissa). souvent prsente comme hypothse, entre dans C'est le cas galement pour l'assainissement les faits durant la dcennie 1990-2000. de cette agglomration nouvelle : chaque crue Elle a t prcde par la cration d'une zone dgage la conduite enterre, les fuites sont industrielle, par l'tat, dans les annes 1975-85, sur nombreuses, les vacuations illicites aussi. L'oued le plateau sud, le long de la route de Ouargla, entre apparat aujourd'hui relativement pollu tout au long la ville et l'aroport situ 20 km au sud-est. S'y de son cours, ce qui nuit la fois la vie des gens et
110 trouvent une grosse tuberie tatique, et une centaine de petites units prives (units textiles pour les 2/3). Mais au cours de la dcennie coule, c'est l'habitat lui-mme qui a gagn les plateaux. Cela a t le cas petite chelle prs de Bni Isguen et d'El Atteuf, travers 3 cits nouvelles, marques par une recher che architecturale et une volont de raliser de nouveaux ksour, les initiateurs tant, dans un cas un particulier, dans l'autre une collect ivit, dans le troisime un organisme d'tat. Cela a t galement le cas, plus grande chelle, Bouaroua (sur la route d'Alger), pour la commune de Ghardaa, la plus grosse et celle qui manque le plus de terrains. Y ont t raliss 500 logements (collect ifs), une zone d'activit comprenant gare routire, station-service, march aux voitures, poste Sonelgaz). Un programme de 2 000 logements est prvu ; la difficult actuelle est de raccorder cet ensemb le l'assainissement de la Valle.
^ Vers lW Bernane I Laghouat Ourighnou i \1CD ,a | o M '.-a .3. ^*
Vers Hassi R'Mel
-7
Danoua Jf 6\ BenDaa \ ( \ \^ C <w^A Bouhraoua ^v. C^GHARDAA *\o nBounoura Melika^Tf /-v PK Isguene f(Beni -^ 0 El Atteuf N I ^iillli Zone ^"industrielle
Aroport s^ Ghardaa^j^Noumerate I Site en cours d'urbanisation o Site nouveau d'urbanisation 0 5 km X
^^Noumerate V Vers >| Ouargla HG. 3 - GHARDAA, SITES NOUVEAUX D'URBANISATION Source : ANAT, 1996 Conclusion La question pose aujourd'hui Ghardaa est la suivante : comment faire vivre 135 000 habitants dans un fond de valle ? Cette mtropole linaire est magnifique, vue au sol comme d'avion! Mais elle est aussi fort mal commode! La sortie de la valle parat inluctable. Elle ne se fait pas de gaiet de cur, car l'attachement des Mozabites est grand pour leur valle, son bioclimat, sa verdure, son cadre paysager. Les phnomnes de centralit continueront de faire de Ghardaa le ple de cette agglomration de plus en plus clate.
Y aura-t-il urbanisation plus longue distance (fig. 3) ? En fait, depuis une ou deux d cennies, les dcideurs marquent une hsitation permanente entre deux types d'exurbanisation : celle de proximit, telle que dessine ci-dessus, celle moyenne distance, telle que envisage par certains. C'est en particulier le cas du projet de ville nouvelle de Oued Nchou (Ounighou), 15 km au nord sur la route d'Alger, tudie depuis 2 dcennies. Elle est amorce par la ralisation par l'OPGI de 400 logements, qui, faute d'assainisse ment, ne sont pas habits.
QUELQUES REFERENCES ANAT (1992-99), Plans d'amnagement de Wilaya, Plans directeurs et d'urbanisme, tude de matrise de la croissance urbaine, Alger. Benyoucef B., (1992), Le M'Zab, espace et socit, Aboudaoud, Alger, 290 p. Donnadieu C. et P., Didillon H. et J.M., (1986), Habiter le dsert, les maisons mozabites, Mardaga, Bruxell es, 254 p. Josse R., (1970), Croissance urbaine au Sahara, Ghardaa, Les Cahiers d'Outre-Mer, Bordeaux, n89, p.4672. Ravereau A., (1981), Le M'Zab, une leon d'architecture, Sindbad, Paris, 282 p.
Vous aimerez peut-être aussi
- Guide Pratique. Maçonneries. en Application Des Normes NF DTU 20.1 Et 20.13 PDFDocument8 pagesGuide Pratique. Maçonneries. en Application Des Normes NF DTU 20.1 Et 20.13 PDFabdelhaouariPas encore d'évaluation
- RDM TP Ndeg01 Essai de Traction 1Document18 pagesRDM TP Ndeg01 Essai de Traction 1Mãrÿ ŌûmåPas encore d'évaluation
- TD Biochimie FEVDocument52 pagesTD Biochimie FEVAbdou SaiPas encore d'évaluation
- Le Fantôme de Lécole 4Document2 pagesLe Fantôme de Lécole 4tilamoPas encore d'évaluation
- UntitledDocument2 pagesUntitledHamed N’DiayePas encore d'évaluation
- GGI Technologies Electriques1 B1Document178 pagesGGI Technologies Electriques1 B1thebastienproductionPas encore d'évaluation
- IMPUISSANCE Traitement de L'impuissance Et Pannes de L'érectionDocument2 pagesIMPUISSANCE Traitement de L'impuissance Et Pannes de L'érectionmenheathcarePas encore d'évaluation
- L'Énergie Éolie-WPS OfficeDocument9 pagesL'Énergie Éolie-WPS OfficeNissi Jul'harPas encore d'évaluation
- Klopp (Raphael Honigstein) @lechatDocument337 pagesKlopp (Raphael Honigstein) @lechatgaetanngonoPas encore d'évaluation
- Les Structures PoreusesDocument9 pagesLes Structures PoreusesSeddik hPas encore d'évaluation
- Cours de Gestion Financiï¿ Re Master2-1Document104 pagesCours de Gestion Financiï¿ Re Master2-1Eldaa Ragnimwendé KoamaPas encore d'évaluation
- Document PDFDocument17 pagesDocument PDFGloria ShulunguPas encore d'évaluation
- SequenceDocument7 pagesSequencevirginie MoulinsPas encore d'évaluation
- Croissants Au BeurreDocument16 pagesCroissants Au BeurreammourmPas encore d'évaluation
- Grandeurs Physiques Liees A La Quantite de Matiere Cours 4 4Document4 pagesGrandeurs Physiques Liees A La Quantite de Matiere Cours 4 4Zouhair TajePas encore d'évaluation
- RandrianarisoaJeanR PC MAST 19Document63 pagesRandrianarisoaJeanR PC MAST 19OULAKBIR IlhamPas encore d'évaluation
- Folio Poutres 2eme Étage G S A - 2017 B0UKNADELDocument10 pagesFolio Poutres 2eme Étage G S A - 2017 B0UKNADELboudoualPas encore d'évaluation
- Gestion D'une Unite de SoinDocument48 pagesGestion D'une Unite de SoinSaid Oujjaa67% (6)
- Qu'est-Ce Qu'un Harami Haussier Ou BaissierDocument6 pagesQu'est-Ce Qu'un Harami Haussier Ou BaissierGérard SEMONDJIPas encore d'évaluation
- Bio Ani Polycopie 3Document33 pagesBio Ani Polycopie 3maomaochongPas encore d'évaluation
- Programme 12 SemaineDocument83 pagesProgramme 12 SemaineZehr LaetitiaPas encore d'évaluation
- CR1 M1 Ieep PTRDocument36 pagesCR1 M1 Ieep PTRmanelPas encore d'évaluation
- In Stal Paies QLDocument90 pagesIn Stal Paies QLTRAORE ISMAELPas encore d'évaluation
- Apicil - Autisme Des Enfants Bien Dansleur Assiette 2Document72 pagesApicil - Autisme Des Enfants Bien Dansleur Assiette 2deschampsPas encore d'évaluation
- Arrete 23 Juin 2014 Normes Du Contenu Des Rapports Cac PDFDocument28 pagesArrete 23 Juin 2014 Normes Du Contenu Des Rapports Cac PDFImèneBabaPas encore d'évaluation
- DS1 - Compression Perpendiculaire Aux Fibres 2013-01 PDFDocument16 pagesDS1 - Compression Perpendiculaire Aux Fibres 2013-01 PDFPatrick Saint-LouisPas encore d'évaluation
- Projet VRDDocument25 pagesProjet VRDsokhna diop diengPas encore d'évaluation
- Patron Treboul A3 1 QfykwoDocument3 pagesPatron Treboul A3 1 QfykwoSoniaPas encore d'évaluation
- Grille Dvaluation Systme Qualit ISO 9001 2015.xlsmDocument16 pagesGrille Dvaluation Systme Qualit ISO 9001 2015.xlsmZouhayra LaajiliPas encore d'évaluation
- Exercice Corrigé ComptabilitéDocument5 pagesExercice Corrigé ComptabilitéJoyce GamasPas encore d'évaluation