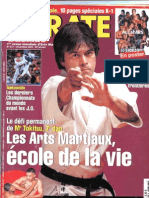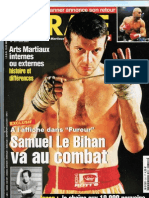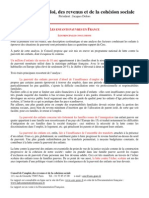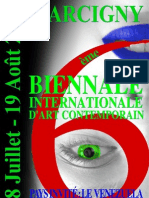Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
r04-3341 Mieux Concilier Équité Et Reprise D'activité
r04-3341 Mieux Concilier Équité Et Reprise D'activité
Transféré par
Alpha1201Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
r04-3341 Mieux Concilier Équité Et Reprise D'activité
r04-3341 Mieux Concilier Équité Et Reprise D'activité
Transféré par
Alpha1201Droits d'auteur :
Formats disponibles
N 334
SNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procs-verbal de la sance du 11 mai 2005
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur les minima sociaux,
Par Mme Valrie LTARD,
Snateur.
(1) Cette commission est compose de : M. Nicolas About, prsident ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Grard Driot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valrie Ltard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-prsidents ; MM. Franois Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisle Printz, secrtaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debr, Christiane Demontes, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude tienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Mmes Franoise Henneron, Marie-Thrse Hermange, Glita Hoarau, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, Andr Lardeux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Jackie Pierre, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michle San Vicente, Patricia Schillinger, M. Jacques Siffre, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, Andr Vzinhet.
Sant
-2-
SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS ......................................................................................................................... 5 I. LES MINIMA SOCIAUX EN FRANCE : UNE ARCHITECTURE COMPLEXE ET PARFOIS PEU COHRENTE .......................................................................................... 7 A. UNE STRATIFICATION DE DISPOSITIFS NON COORDONNS ......................................... 1. Les neuf minima sociaux franais : un produit de lhistoire .................................................... a) La cration de filets de scurit successifs tmoigne de lvolution du phnomne de la pauvret dans notre pays ......................................................................... b) Le systme de protection sociale franais privilgie laide en fonction du statut plutt quen fonction des besoins........................................................................................ 2. Des minima sociaux dune grande diversit ............................................................................ a) Des montants variables ....................................................................................................... b) Des modalits diffrentes dapprciation du plafond de ressources et des revenus permettant louverture des droits ........................................................................................ c) Une prise en compte plus ou moins accentue de la composition du foyer.......................... B. UN ASPECT SOUVENT LUD DU SYSTME DES MINIMA SOCIAUX : LA QUESTION DES DROITS CONNEXES ................................................................................... 1. Les droits connexes lgaux : un dispositif plus ou moins dvelopp selon les minima sociaux.................................................................................................................................... a) Un accs privilgi aux aides au logement.......................................................................... b) Des avantages fiscaux non ngligeables ............................................................................. c) Une couverture encore imparfaite en matire de frais de sant............................................ d) Un dispositif peu dvelopp : la constitution de droits lassurance vieillesse ................... e) La place des prestations familiales pour les mnages pauvres avec enfants......................... 2. Les mesures spcifiques : un impact difficile chiffrer mais rel sur les conditions de vie des bnficiaires de minima sociaux.................................................................................. a) La prime de Nol ................................................................................................................ b) La tarification sociale tlphone et lectricit ..................................................................... c) Le ciblage des emplois aids sur les bnficiaires de minima sociaux ................................ 3. Les fruits de laccompagnement social : un accs facilit aux dispositifs de lutte contre les exclusions ............................................................................................................... a) Le soutien la dmarche dinsertion : un dispositif essentiel mais limit aux bnficiaires du RMI .......................................................................................................... b) Les fonds de solidarit logement et les fonds impays nergie : des instruments souvent mobiliss par les bnficiaires de minima sociaux ................................................. c) Une meilleure prvention du surendettement ...................................................................... 4. Une grande inconnue : les transferts sociaux locaux .............................................................. a) Le recensement exhaustif des aides locales en faveur des personnes en difficult sociale est impossible ......................................................................................................... b) Leur impact est vraisemblablement important sur le niveau de vie des bnficiaires de minima sociaux .............................................................................................................. 7 7 8 11 12 12 15 18 20 22 22 23 24 25 26 26 26 27 28 29 29 31 32 33 33 37
-3-
II. BILAN : UN SYSTME DE MINIMA SOCIAUX OPAQUE POUR LES BNFICIAIRES ET PROBABLEMENT DSINCITATIF LEMPLOI ........................ 39 A. DE MULTIPLES EFFETS DE SEUIL........................................................................................ 1. Une source deffets de seuil en voie de rsorption : les aides lies au statut ........................... a) Des effets pervers particulirement importants au niveau du RMI ...................................... b) Une prise de conscience rcente des pouvoirs publics ........................................................ 2. Les effets de seuil lis la combinaison des prestations entre elles ........................................ a) Le passage dun minimum lautre .................................................................................... b) Limpact des allocations familiales..................................................................................... c) Lanalyse des taux marginaux dimposition : une approche synthtique de leffet combin des diffrentes prestations.......................................................................... 3. Les effets de calendrier dans le versement des prestations ...................................................... B. LA PROBLMATIQUE DU RETOUR LEMPLOI ............................................................... 1. Depuis 2000, une volont forte daccrotre lincitation financire la reprise dactivit ................................................................................................................................. a) Une forme ancienne dincitation la reprise dactivit : les mcanismes dintressement................................................................................................................... b) La situation en 2000 : reprendre un emploi entranait souvent des pertes de revenus ............................................................................................................................... c) Les rformes engages ont permis une rduction sensible des trappes inactivit .............. d) Des situations de pertes de revenus demeurent pour les emplois temps trs partiel .......... 2. Des rformes encore contrecarres par labsence de prise en compte des transferts sociaux locaux ........................................................................................................................ 3. Les limites de la thorie des trappes ....................................................................................... 39 39 39 40 41 41 42 43 45 47 48 48 51 52 57 58 60
III. UNE AMLIORATION DU DISPOSITIF DES MINIMA SOCIAUX NCESSAIRE ET RALISABLE .......................................................................................... 61 A. RENFORCER LA CONNAISSANCE DU PHNOMNE ......................................................... 1. Disposer dun vritable recensement des minima sociaux et de leurs droits connexes ............ a) Disposer dtudes transversales .......................................................................................... b) Amliorer les moyens dtude des trajectoires des bnficiaires de minima sociaux........... 2. Un impratif de remonte dinformations des collectivits locales dans le cadre de la dcentralisation ............................................................................................................. a) Disposer dun panorama fiable des aides locales en faveur des personnes en difficult sociale ................................................................................................................. b) Un pralable : la constitution dun vritable systme dinformation partag entre ltat et les collectivits locales.......................................................................................... 3. Une ncessit : assurer la mise jour rgulire des donnes disponibles ............................... B. AMLIORER LA COHRENCE INTERNE DU SYSTME DES MINIMA SOCIAUX........... 1. Des marges de progrs exploitables court terme .................................................................. a) Mettre fin aux effets pervers de calendrier .......................................................................... b) Poursuivre la coordination entre les droits connexes........................................................... 2. Promouvoir les bonnes pratiques des collectivits locales en matire de transferts sociaux locaux ........................................................................................................................ a) Supprimer les aides lies au statut et assurer la neutralit des aides par rapport lorigine des revenus........................................................................................................... b) Gnraliser le recours un systme de quotient familial et daides dgressives.................. 3. Une question ouverte : faut-il fusionner certains minima sociaux ? ........................................ a) La question de lharmonisation des montants des minima sociaux ...................................... b) Fusionner certains minima : une possibilit, certainement pas un impratif ........................ 61 61 61 64 65 65 66 68 69 69 69 71 73 73 74 75 75 76
-4-
C. ACCENTUER LEFFORT EN FAVEUR DU RETOUR LEMPLOI...................................... 1. Les amliorations possibles droit constant ..................................................................... a) Lever les obstacles matriels la reprise dactivit : la question de laccs aux modes de garde des enfants ................................................................................................ b) Gnraliser laccompagnement au retour lemploi lensemble des bnficiaires de minima sociaux .............................................................................................................. 2. A plus long terme : rechercher une meilleure articulation entre minima sociaux et revenus dactivit .................................................................................................................... a) Lallocation universelle : une solution peu conforme la philosophie de notre systme social..................................................................................................................... b) Une piste prometteuse : les diffrents modles dallocation dgressive ..............................
77 77 77 79 80 80 81
TRAVAUX DE LA COMMISSION ............................................................................................. 87 ANNEXE - AUDITIONS DU RAPPORTEUR ............................................................................. 96
-5-
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Depuis le dbut de la prsente lgislature, le Parlement a t amen, plusieurs reprises, amender le rgime des minima sociaux : il a, en effet, successivement examin la dcentralisation du revenu minimum dinsertion (RMI), la modification des conditions de versement de lallocation spcifique de solidarit (ASS) et, plus rcemment, les critres du droit lallocation aux adultes handicaps (AAH) et ses diffrents complments. Plusieurs textes de loi se sont galement proccups du retour lemploi des bnficiaires de certains minima sociaux : ainsi, la loi du 18 dcembre 2003 a cr, au profit des allocataires du RMI, un contrat dinsertion - revenu minimum dactivit (CI-RMA) ; la loi de programmation pour la cohsion sociale du 18 janvier 2005 en a tendu le bnfice aux titulaires de lallocation de parent isol (API) et de lASS et a cr, dans le secteur non marchand, un contrat spcifiquement destin aux bnficiaires de minima sociaux, le contrat davenir. Enfin, dautres rformes ont abord des questions intressant, au premier chef, les bnficiaires de minima sociaux : cest le cas de la rforme du traitement du surendettement, de la cration de laide lacquisition dune complmentaire sant, des modifications apportes au dispositif des aides au logement. Dans une moindre mesure, la rforme des retraites et la cration de la prestation daccueil du jeune enfant (PAJE) ont galement eu un impact. Toutes ces mesures, sans aucun doute utiles, prsentent un mme dfaut : lorsquelles abordent, travers une prestation particulire, la question du revenu minimum garanti, jamais elles ne la remettent en perspective avec lensemble du dispositif franais des minima sociaux et de leurs droits connexes ; quand elles modifient dune faon plus gnrale notre systme de protection sociale, elles omettent den mesurer limpact sur les personnes pour lesquelles les transferts sociaux constituent lessentiel des ressources, savoir les bnficiaires de minima sociaux.
-6-
Prenant le contre-pied de ces approches fragmentaires, le prsent rapport se propose de prsenter un panorama synthtique de notre dispositif, riche mais complexe, de minima sociaux. Il sattache mettre en lumire ses grands principes mais aussi ses incohrences, dceler les ventuels effets pervers ns de la combinaison des diffrentes allocations existantes, de leurs droits connexes et des prestations sociales de droit commun. Il vise surtout montrer comment, du fait de ces incohrences et de ces effets pervers, certains bnficiaires peuvent se trouver pris au pige de leur statut, le retour lactivit prsentant alors toutes les caractristiques dun parcours du combattant ou dun pari la mise trs - trop - leve. A diverses occasions, au cours de lexamen de ces textes, nous avons regrett de ne pas disposer dun tat des lieux dtaill. Comment, en effet, conduire un vritable dbat sur le niveau du RMI ou celui de lAAH, sil est impossible de mesurer le pouvoir dachat rel de ces prestations, compte tenu des avantages qui y sont lis ? Comment se prononcer sur lefficacit des mesures dencouragement la reprise dactivit sans avoir, au pralable, identifi les ventuels effets de seuil causs par une augmentation des ressources ? Cest ces interrogations que le prsent rapport cherche modestement rpondre. Sil propose des pistes de rformes, ce nest pas son objectif premier : sa vritable raison dtre est, avant tout, de constituer un mmento lusage des parlementaires, et plus largement de nos concitoyens, afin qu loccasion de toute rforme touchant les minima sociaux, ils puissent en apprcier les consquences sur lquilibre de notre dispositif de protection sociale et rpondre, de faon argumente, aux revendications portant sur le montant des diverses prestations. Parfois, votre rapporteur a malgr tout souhait faire des recommandations : des marges de progrs, exploitables court terme, existent pour rduire certains effets pervers des minima sociaux sans en bouleverser la structure. La plupart du temps, cependant, ces prconisations sont essentiellement une invitation poursuivre la rflexion en vue datteindre les deux objectifs de tout systme de revenu minimum garanti : assurer une redistribution quitable des ressources au profit des mnages aux plus faibles revenus, tout en favorisant leur autonomie, travers le retour lemploi.
-7-
I. LES MINIMA SOCIAUX EN FRANCE : UNE ARCHITECTURE COMPLEXE ET PARFOIS PEU COHRENTE
A. UNE STRATIFICATION DE DISPOSITIFS NON COORDONNS
1. Les neuf minima sociaux franais : un produit de lhistoire A ct des revenus de remplacement contributifs que sont les allocations chmage ou les pensions de retraite et dinvalidit, la France prsente la particularit davoir neuf minima nationaux, cest--dire neuf prestations non contributives, verses sous condition de ressources et visant assurer un revenu minimum certaines catgories de personnes : - lallocation supplmentaire vieillesse, rserve aux personnes ges de plus de soixante-cinq ans (soixante ans en cas dinaptitude au travail) disposant de droits trs faibles ou ne disposant daucun droit lassurance vieillesse ; - lallocation supplmentaire dinvalidit qui sadresse aux personnes de moins de soixante ans, titulaires dune pension dinvalidit de trs faible montant, servie par la scurit sociale au titre dune incapacit permanente ; - lallocation aux adultes handicaps (AAH), verse aux personnes handicapes qui ne peuvent prtendre ni un avantage invalidit, ni une rente daccident du travail ; - lallocation de parent isol (API), qui concerne les personnes isoles assumant seules la charge dun ou plusieurs enfants ; - lallocation veuvage, qui sadresse aux conjoints survivants dassurs sociaux dcds ; - lallocation de solidarit spcifique (ASS), qui est alloue aux chmeurs ayant puis leurs droits lassurance chmage et justifiant dau moins cinq annes dactivit salarie au cours des dix dernires annes prcdant la rupture de leur contrat de travail ; - lallocation dinsertion (AI), rserve aux dtenus librs, aux personnes en attente de rinsertion, aux rapatris, aux rfugis et aux demandeurs dasile ;
-8-
- le revenu minimum dinsertion (RMI), qui garantit des ressources minimales toute personne de vingt-cinq ans et plus ; - lallocation quivalent retraite (AER), qui bnficie aux chmeurs de moins de 60 ans totalisant dj 160 trimestres de cotisation lassurance vieillesse. Au total, au 31 dcembre 2003, le nombre dallocataires de minima sociaux tait de 3,3 millions de personnes. Environ six millions de personnes (allocataires mais aussi conjoints, enfants et autres personnes charge) taient couvertes par ces mmes minima sociaux.
Nombre dallocataires au 31 dcembre 2003 Allocation dinsertion (AI) Allocation veuvage Allocation supplmentaire dinvalidit Allocation de parent isol (API) Allocation aux adultes handicaps (AAH) Allocation supplmentaire vieillesse Revenu minimum dinsertion (RMI) Allocation de solidarit spcifique (ASS) Allocation quivalent retraite (AER) Ensemble des minima sociaux en mtropole DOM France entire
Source : DREES, Etudes et Rsultats, n 354, novembre 2004
46.700 12.300 111.200 170.052 741.354 557.600 998.645 348.600 26.700 3.013.151 301.042 3.314.193
a) La cration de filets de scurit successifs tmoigne de lvolution du phnomne de la pauvret dans notre pays La cration des neuf minima sociaux franais sest chelonne de laprs-guerre 2002, tmoignant de ladaptation progressive de notre systme de protection sociale, lorigine entirement fond sur les solidarits professionnelles, lvolution dune pauvret qui concerne dsormais autant les actifs que les inactifs. Premire tape : garantir un revenu minimum aux inactifs, pour combler les lacunes du systme assurantiel Les premiers minima, crs au sortir de la guerre, ont t les minima destins aux inactifs, retraits et invalides. Ceux-ci constituaient en effet cette poque, compte tenu de la faible maturit des rgimes assurantiels obligatoires, les grands bataillons de la pauvret car ils nont pu sassurer, par leur travail, un revenu de remplacement suffisant : ainsi, en 1970, 30 % des
-9-
retraits vivaient en dessous du seuil de pauvret1. La cration, en 1956, du minimum vieillesse et, en 1957, du minimum invalidit vise donc combler les lacunes du rgime assurantiel : leur objectif nest pas dassurer un revenu minimum eux seuls mais de complter un revenu de remplacement existant trop faible jusqu hauteur dun minimum garanti. La cration de lAAH, par la loi dorientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapes, constitue laboutissement de la rflexion sur le revenu minimum devant tre garanti aux personnes considres comme durablement ou dfinitivement inactives, en prvoyant un revenu minimum pour des personnes nayant pour la plupart jamais travaill2. Cest la raison pour laquelle le montant de lAAH est accroch celui du minimum vieillesse. Il convient de souligner une volution importante par rapport aux minima antrieurement crs : son versement nest plus subordonn la perception dun revenu de remplacement, mme si lon peut, dans certaines configurations familiales, percevoir une AAH diffrentielle en plus dune rente daccident du travail ou dune pension dinvalidit. Ainsi, pour la premire fois, une allocation est suppose pouvoir constituer lintgralit des ressources de son bnficiaire. Deuxime tape : tirer les consquences de la fragilisation des solidarits familiales A partir de 1975, une nouvelle forme de pauvret apparat : celle lie la remise en cause du modle familial traditionnel et la multiplication des situations disolement des femmes ayant la charge denfants. La cration de lAPI, en 1976, et celle de lallocation veuvage, en 1980, tmoignent de cette considration nouvelle. Contrairement aux premiers minima crs et pour la premire fois, ces allocations ne concernent donc pas uniquement des inactifs. A linverse de ceux-l, elles ont en revanche une dure de versement limite dans le temps car elles sont supposes correspondre des situations de perte de ressources provisoires, lies la rupture des solidarits familiales traditionnelles : ainsi, lAPI nest verse que pendant un an compter de la date de lvnement conduisant lisolement (API dite courte ) ou jusquaux trois ans de lenfant le plus jeune (API longue ). Lallocation veuvage ne lest, pour sa part, que pendant deux ans au maximum, trois ans lorsque le conjoint survivant a plus de 50 ans.
En 2001, seuls 4 % des retraits vivent encore en dessous du seuil de pauvret (Cf. rapport 2003-2004 de lObservatoire national de la pauvret et de lexclusion sociale). 2 A cette poque, en effet, le phnomne des travailleurs handicaps reste marginal et le retour lemploi de ces personnes nest pas apprhend comme une priorit.
- 10 -
Troisime tape : crer un dernier filet de scurit pour les exclus du march du travail Consquence de la forte dgradation du march du travail et du dveloppement dun chmage massif et souvent durable, la pauvret des mnages actifs1 sest aggrave au cours des annes 1980 puis 1990 et dpasse, en proportion, celle des mnages de retraits : ainsi, en 2001, 5,4 % des mnages actifs avaient un niveau de vie infrieur au seuil de pauvret, contre 3,8 % des mnages de retraits. La cration de lASS, en 1984, concide avec cette apparition du chmage de longue dure qui conduit les bnficiaires de lassurance chmage puiser leurs droits un revenu de remplacement. Elle constitue donc le volet solidarit du rgime dindemnisation du chmage, prenant le relais de lallocation unique dgressive (AUD) ou, depuis 2001, lallocation daide au retour lemploi (ARE). LASS a t complte, la mme date, par la cration de lallocation dinsertion, afin de rpondre certains cas particuliers de personnes exclues du march de lemploi (dtenus librs, personnes en attente de rinsertion, rapatris, rfugis et demandeurs dasile) et pour lesquelles le systme dindemnisation du chmage restait impuissant. Bien que plus tardive, linstauration de lallocation quivalent retraite (AER), en 2002, relve de la mme logique de couverture pour les chmeurs de longue dure, assurant une transition entre chmage et retraite, pour des personnes ayant commenc travailler trs tt mais ne pouvant pas encore liquider leur pension. Dernire tape : la cration dun minimum garanti universel Malgr la cration de ces dispositifs en faveur des chmeurs de longue dure, force a t de constater quun certain nombre de personnes demeuraient exclues de toute protection. Cest ce qui a conduit, en 1988, la cration du RMI, qui vise garantir toute personne ge de 25 ans ou plus un minimum de ressources. Il sagit dun tournant dans lhistoire de notre protection sociale, puisque, pour la premire fois, une allocation tait conue pour garantir toute personne, quelle ait ou non dj travaill, un revenu minimum la fois en dehors de toute rfrence lexistence dune activit professionnelle antrieure et pour une dure potentiellement illimite.
Il sagit des mnages dont lun des membres au moins est dge actif (entre 18 et 59 ans) et se trouve en situation dactivit professionnelle ou de chmage.
- 11 -
Depuis sa mise en place en 1988, le RMI a largement rpondu sa vocation de minimum universel . Il ne fait dailleurs aucun doute que cette porte quasi universelle a indirectement concouru linstauration de rgles plus strictes tant en matire dassurance chmage, le RMI jouant alors le rle de troisime composante de lindemnisation du chmage, quen matire daccs dautres minima sociaux (allocation dinsertion, AAH). b) Le systme de protection sociale franais privilgie laide en fonction du statut plutt quen fonction des besoins Lexistence de neuf minima sociaux diffrents tmoigne dune approche de la pauvret par catgorie de population, chacune bnficiant finalement dun statut sur mesure. Une autre attitude aurait pu consister ne sattacher quaux besoins de lintress, quel que soit son statut, pour dfinir un revenu minimum universel, ventuellement modul en fonction de besoins spcifiques. La comparaison avec les systmes de minima sociaux de nos voisins europens est, cet gard, difiante, puisquelle met en lumire une spcificit franaise dans cette approche par statut qui se traduit par un nombre de dispositifs de minima sociaux nettement plus important quailleurs.
Comparaison des systmes de minima sociaux dans lUnion europenne Allemagne LAllemagne combine deux dispositifs : - un dispositif fdral dassistance chmage, destin aux chmeurs en fin de droits, qui permet de garantir aux intresss, en fonction de leur situation familiale, entre 53 et 57 % de leur salaire net antrieur, sous condition de ressources mais sans condition de dure ; - un dispositif de revenu minimum garanti, gr par les Lnder, qui prvoit une allocation diffrentielle, verse sous condition de ressources, toute personne en fonction de ses besoins. Son montant est fix par rfrence un panier de biens et de services jugs indispensables et slve, en moyenne, 270 euros. Danemark Il existe au Danemark un seul dispositif assimilable aux minima sociaux franais : il sagit dun systme de revenu minimum, de caractre diffrentiel, garantissant des ressources quivalentes 60 % du maximum des indemnits chmage. Il subsiste toutefois, ct de ce revenu minimum universel, un dispositif de pension de retraite de base, forfaitaire et financ par limpt, qui assure toutes les personnes rsidant au Danemark un revenu garanti de lordre de 500 euros par mois. Pour les personnes qui ne peuvent prtendre une retraite complmentaire, cette pension de base constitue donc lquivalent du minimum vieillesse.
- 12 -
Espagne LEspagne compte quatre dispositifs de minima sociaux : - un dispositif dassistance chmage, ddi aux personnes ayant puis leurs droits dans le systme assurantiel. gal 75 % du salaire minimum interprofessionnel, son versement est limit 18 mois ; - un dispositif de pension de retraite et dinvalidit non contributif, assurant ces deux catgories un revenu de remplacement minimum ; - un dispositif de revenu minimum garanti, gr par les communauts autonomes et destin aux personnes de 25 65 ans sans ressources. Vers sous condition de ressources, ce revenu minimum est compris, selon les rgions, entre 180 et 225 euros. Pays-Bas Comme au Danemark, les rsidents aux Pays-Bas peroivent tout dabord automatiquement une pension de retraite forfaitaire de base, gale 70 % du salaire minimum, une majoration tant applique en fonction de la situation familiale. Son montant varie donc entre 690 et 915 euros par mois. Il existe galement une allocation de fin de droits pour les chmeurs, verse pendant un an et qui peut tre complte par laide sociale afin datteindre le niveau du revenu minimum garanti. Celui-ci est en ralit compos de plusieurs allocations, spcifiques certains publics et toutes diffrentielles, mais assurant le mme montant de ressources : en fonction de la situation familiales, ce montant slve entre 70 % et 100 % du salaire minimum, soit entre 690 et 980 euros. Royaume-Uni Conformment son modle de scurit sociale universel et financ par limpt, le Royaume-Uni verse tout dabord tous ses rsidents une pension de retraite forfaitaire de base, qui, en labsence de retraite complmentaire, joue le rle de minimum vieillesse. Cette pension slve 375 euros par mois pour une personne seule, ce montant tant major en fonction de la composition du foyer et de lge du bnficiaire. Un revenu minimum universel est par ailleurs garanti par le dispositif de lIncome support. Celui-ci est compos dune allocation personnelle de base de 295 euros par mois et dune majoration pour besoins spcifiques (handicap, prsence dun conjoint ou denfants charge...). Il convient de noter que la situation de parent isol nest pas prise en compte dans cette allocation mais relve dune majoration spcifique des allocations familiales.
Sources : La protection sociale , tude de lgislation compare Snat, dcembre 1995.
2. Des minima sociaux dune grande diversit a) Des montants variables Lexamen du montant des neuf minima sociaux existants montre que ceux-ci peuvent tre classs en deux catgories :
- 13 -
- les minima servis aux personnes dont on nattend pas quelles retournent rapidement au travail ont les montants les plus levs et sont toujours au moins quivalents aux deux tiers du SMIC net : cest le cas pour lallocation supplmentaire vieillesse et pour lallocation quivalent retraite, verses aux personnes ges et qui sont respectivement gales 66 % et 101 % du SMIC net. On retrouve le mme rapport de 66 % du SMIC net pour les minima servis aux personnes handicapes. Il convient enfin de noter que les minima servis aux parents isols (API et allocation veuvage) entrent galement dans cette catgorie, ce qui tend confrer ces allocations le caractre de salaire maternel ; - les minima servis aux personnes en ge et en tat - suppos - de travailler restent, en revanche, infrieurs la moiti du SMIC net : il en est ainsi pour lallocation dinsertion (33 % du SMIC net), le RMI et lASS (47 % du SMIC net). Ces montants, volontairement faibles, attestent que ces allocations sont conues comme des revenus de solidarit temporaire ne devant pas remplacer durablement un revenu dactivit. La faiblesse des montants verss doit ainsi conduire les bnficiaires reprendre rapidement une activit professionnelle.
- 14 -
Comparaison des montants des divers minima sociaux
(en euros, au 1er janvier 2005)
Pour une personne seule... clibataire Allocation dinsertion (AI) Revenu minimum dinsertion (RMI) Allocation de solidarit spcifique (ASS) Allocation veuvage Allocation de parent isol (API) Allocation supplmentaire dinvalidit Allocation aux adultes handicaps (AAH) Allocation supplmentaire vieillesse Allocation quivalent retraite (AER) 299,9 425,40 avec un ou plusieurs enfants Idem 638,10 (1 enfant) 765,72 (2 enfants) 935,88 (3 enfants) Idem Idem 722,75 (1 enfant) 903,44 (2 enfants) 1.084,13 (3 enfants) Idem
Pour un couple... sans enfants Idem 638,1 avec un ou plusieurs enfants Idem 765,72 (1 enfant) 893,34 (2 enfants) 1.063,50 (3 enfants) Idem Idem -
425,83 529,84 542,06 (femme enceinte) 599,5
Idem Idem -
1075,42
Idem
599,5
Idem
Idem
Idem
599,5
1075,42
Idem
919
Idem
Idem
Idem
Il reste quau sein dune mme catgorie, rien ne semble expliquer de faon rationnelle les diffrences de montant entre les prestations : si une certaine cohrence est assure entre lAAH, lallocation supplmentaire invalidit et le minimum vieillesse, des diffrences, de lordre de quelques centimes (entre le RMI et lASS) ou de plusieurs dizaines deuros (entre lallocation veuvage et lAPI) subsistent. Ces diffrences tmoignent dabord de la diversit des modes dindexation des diffrents minima sociaux. Ainsi, lAPI est indexe sur lvolution de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF)1, alors que
La BMAF volue en fonction de lindice des prix hors tabac, avec rgularisation au titre dun ventuel cart entre la hausse des prix constate au cours de lanne n-1 et le taux prvisionnel retenu en loi de financement de la scurit sociale pour la mme anne.
- 15 -
le RMI lest directement sur les prix. Pour certaines prestations, comme lASS, il nexiste aucune rgle prtablie. Elles mettent galement en lumire les revalorisations ponctuelles et sans vue densemble des diverses prestations. En effet, lexistence de rgles nexclut pas les dcisions de coups de pouce ou de gel. Tel est dailleurs le constat effectu par lObservatoire national de la pauvret et de lexclusion sociale dans son rapport 2003-2004 : La BMAF a ainsi t gele en 1997. La perte de pouvoir dachat des prestations concerne na pas t rattrape au cours des annes suivantes. Ce gel explique que le niveau de lAPI ait t rduit de deux points en euros constants par rapport son niveau de 1990. A contrario, le RMI est trois points au-dessus de son niveau de 1990 grce aux coups de pouce des annes 1999 et 2001. Il reste que la diversit des montants bruts servis aux bnficiaires ne peut pas, en tant que telle, servir de base une revendication dalignement des prestations sur le mieux disant. Cette diversit est, en effet, peu significative, compte tenu de la complexe combinaison des minima sociaux avec dautres prestations et du poids de lensemble de ces transferts dans le revenu des bnficiaires. b) Des modalits diffrentes dapprciation du plafond de ressources et des revenus permettant louverture des droits Lexamen des modalits de fonctionnement des plafonds de ressources des diffrentes prestation fait une nouvelle fois apparatre deux catgories de minima sociaux, catgories qui ne recoupent dailleurs pas la premire classification en fonction des montants servis : - pour le RMI et lAPI, le montant du plafond de ressources est identique au niveau maximal de la prestation : lallocation est alors purement diffrentielle et complte simplement les ressources du mnage hauteur du minimum garanti ; - dans tous les autres cas, le plafond de ressources est plus lev que la prestation servie : lallocation est alors forfaitaire tant que le total des ressources de lintress et de lallocation reste infrieur au plafond. Cest seulement lorsque ce total dpasse le plafond que lallocation devient diffrentielle. Par ailleurs, si tous les minima sociaux sont des prestations sous conditions de ressources, celles-ci ne sont pas values de la mme faon dune prestation lautre. Ainsi, les prestations familiales sont exclues des ressources pour lAAH et lASS mais incluses pour le RMI et lAPI. De mme, les allocations logement sont totalement exclues pour tous les minima sociaux sauf pour le
- 16 -
RMI et lAPI, pour lesquels un forfait est retenu, et pour lallocation dinsertion. Egalement, les pensions alimentaires ou les prestations compensatoires verses par lallocataire sont dduites du calcul des ressources pour lallocation dinsertion ou lASS, mais pas pour le RMI ou lAAH. Les revenus dactivits sont aussi traits de faon diffrencie : ainsi, alors quil existe un abattement permanent sur les revenus dactivit pour lAAH, ou temporaire en cas de reprise dactivit pour lAPI, le RMI et lASS, les autres minima sociaux nen connaissent aucun. La priode de rfrence des revenus pris en compte varie par ailleurs entre trois et douze mois. LAAH connat un traitement particulier, puisque les revenus sont apprcis en rfrence la dernire anne fiscale connue. Il convient enfin de noter que certains minima prvoient un mcanisme de neutralisation des ressources, et notamment des revenus dactivit, lorsquil est prouv que leur versement est dfinitivement interrompu : cest le cas pour lallocation dinsertion, lASS et lAER. Ce mcanisme est particulirement important lorsque la priode de rfrence des revenus pris en compte est longue, car il permet de ne pas faire rfrence une situation financire du demandeur totalement prime et, ce faisant, dviter les effets pervers de calendrier.
- 17 -
Modalits dapprciation des ressources applicables aux diffrents minima sociaux
Priode de rfrence Allocation dinsertion (AI) Allocation veuvage 12 derniers mois 12 derniers mois Revenu de rfrence Revenus du foyer fiscal, avant abattements Revenus professionnels, de remplacement et du capital de lintress et du conjoint, y compris les donations de moins de 10 ans Tous les revenus de lintress et du conjoint, y compris les donations de moins de 10 ans Ressources personnelles de lintress, y compris les pensions alimentaires, prestations familiales et allocations logement (dans la limite dun forfait) Revenus du foyer fiscal aprs abattements et dductions diverses Ressources exclues - prestations familiales - autres revenus si leur versement est dfinitivement interrompu - prestations familiales - allocations logement - ACTP, MTP - capital dcs, retraite du combattant, rentes viagres - prestations familiales - allocations logement - ACTP, MTP, retraite du combattant, rentes viagres - AES, PAJE, ARS - capital dcs - avantages en nature de lassurance maladie - mcanisme dintressement la reprise dactivit pendant 12 mois - prestations familiales - allocations logement - ACTP, MTP, retraite du combattant, rentes viagres - une partie des revenus dactivit - prestations familiales - allocations logement - ACTP, MTP, retraite du combattant, rentes viagres - PAJE (en partie), ARS, AES, majorations pour ge des allocations familiales, bourses scolaires - avantages en nature de lassurance maladie, capital dcs - mcanisme dintressement la reprise dactivit pendant 12 mois - prestations familiales - allocations logement - pensions alimentaires et prestation compensatoire - autres revenus si leur versement est dfinitivement interrompu - mcanisme dactivit rduite pendant 12 mois - prestations familiales - allocations logement - autres revenus si leur versement est dfinitivement interrompu - abattement de 30 % sur les revenus du conjoint si celui-ci a pris sa retraite ou sest trouv au chmage en cours danne
Allocation supplmentaire dinvalidit Allocation de parent isol (API)
3 derniers mois
3 derniers mois
Allocation aux adultes handicaps (AAH)
Anne n-1
Allocation supplmentaire vieillesse Revenu minimum dinsertion (RMI)
3 derniers mois
Tous les revenus de lintress et du conjoint, y compris les donations de moins de 10 ans Ressources du foyer fiscal, y compris les indemnits de scurit sociale, allocations chmage, prestations familiales, AAH et allocations logement (dans la limite dun forfait) Revenus du foyer fiscal, avant abattements
3 derniers mois
Allocation de solidarit spcifique (ASS)
12 derniers mois
Allocation quivalent retraite (AER)
12 derniers mois
Revenus du foyer fiscal, avant abattements
- 18 -
Ces diffrences dans les bases ressources des diffrents minima sociaux mettent en lumire les philosophies diffrentes qui sous-tendent chacune des prestations. Ainsi, la rfrence lensemble des revenus de la personne, y compris les donations de moins de dix ans, pour le bnfice de lallocation supplmentaire invalidit ou vieillesse ou celui de lallocation veuvage est la marque dune prestation encore inspire par le droit de laide sociale qui prvoit effectivement la mise en oeuvre de lobligation alimentaire et la rcupration sur les successions. A linverse, la rfrence au simple revenu fiscal dclar, quil sagisse du revenu avant ou aprs abattement, tmoigne dun glissement des minima sociaux du domaine de laide sociale vers celui de la protection sociale. c) Une prise en compte plus ou moins accentue de la composition du foyer Le systme franais des minima sociaux a fait trs largement le choix dune prise en compte de lexistence de charges de famille pour apprcier les besoins des bnficiaires de minima sociaux. Cette prise en compte est toutefois plus ou moins pousse selon les prestations : ainsi, la composition du foyer entre toujours en ligne de compte pour la dfinition du droit la prestation mais avec des consquences plus ou moins sensibles Il existe en effet deux modalits de prise en compte des charges de famille : la modulation de la base ressources de la prestation et lapplication de majorations pour conjoints et pour enfants au montant mme de lallocation. Or, notre systme de minima sociaux combine ces deux modalits. Cinq prestations sont simplement conjugalises : il sagit de lallocation dinsertion, de lallocation supplmentaire vieillesse, de lallocation supplmentaire invalidit, de lASS et de lAER. Leur plafond de ressources tient en effet compte de la prsence dun conjoint mais pas de celle denfants et le montant de la prestation ne varie pas en fonction de ces paramtres. Ces prestations concident avec celles qui ne tiennent pas compte des prestations familiales dans leur base ressources : elles reposent donc sur le principe que les besoins des enfants sont couverts par ailleurs, par le biais des prestations familiales.
- 19 -
Dautres prestations sont familialises , cest--dire tiennent compte de la prsence denfants au sein du foyer. Parmi elles, on trouve deux catgories dallocations : - celles dont le montant et le plafond varient en fonction de la prsence et du nombre denfants, comme le RMI et lAPI : en contrepartie, les prestations familiales sont incluses dans leur assiette ; - une allocation mixte, lAAH, dont seul le plafond varie en fonction de la prsence denfants charge, sans que les prestations familiales soient pour autant incluses dans la base ressources.
Minima sociaux et prise en compte des configurations familiales
La dfinition du droit La situation familiale dfinit le droit lui-mme Les ressources familiales dfinissent le droit Ressources du conjoint et des enfants Ressources du conjoint Ressources du conjoint Ressources du conjoint Ressources du conjoint La base ressources Les prestations familiales sont intgres dans la base ressources Non Le plafond de ressources varie selon la composition familiale La prestation Le montant de la prestation varie selon la composition familiale
AAH
Non
Oui
Non
AI ASS Minimum vieillesse Minimum invalidit
Non Non Non Non
Non Non Non Non Oui, sauf majoration pour ge des allocations familiales, AES, ARS et forfait logement Oui, sauf AES, ARS et forfait logement Non Non
Oui Oui Oui Oui
Non Non Oui Oui
RMI
Non
Ressources du conjoint et de toute personne charge
Oui
Oui
API Allocation veuvage AER
Oui
Ressources de toute personne charge Ressources personnelles Ressources du conjoint
Oui
Oui
Oui Non
Non Oui
Non Non
Source : Minima sociaux, revenus dactivit, prcarit , rapport du commissariat gnral du plan, mai 2000
- 20 -
Cependant, comme en matire de montant des prestations, il convient de remarquer que le poids accord au conjoint et aux enfants charge varie, au sein dune mme catgorie de prestation : ainsi, la majoration pour enfant de lAPI est plus leve de 53 euros que celle du RMI et cette diffrence, substantielle pour un tel niveau de revenu, ne semble pas justifie par des besoins plus importants que pourraient avoir les enfants charge dune personne isole.
B. UN ASPECT SOUVENT LUD DU SYSTME DES MINIMA SOCIAUX : LA QUESTION DES DROITS CONNEXES
Les minima sociaux ne constituent que trs rarement, voire jamais, lintgralit des revenus de leurs titulaires. Ceux-ci ont en effet droit, comme tous les Franais et ds lors quils en remplissent les conditions dattribution, au bnfice des prestations prvues pour toute la population, comme les allocations familiales. Par ailleurs, la qualit dallocataire dun minimum social ouvre droit, de faon plus ou moins automatique et dans des proportions variables en fonction de la prestation considre, au bnfice dun nombre important de droits connexes, spcifiques certaines catgories de la population. Comme en tmoigne le tableau suivant, les minima sociaux ne constituent ds lors quun tiers des transferts sociaux bnficiant aux mnages les plus pauvres et moins de 20 % de leur revenu disponible. En comparaison, les allocations logement et les prestations familiales sans condition de ressources reprsentent respectivement 29 % et 23 % des transferts sociaux en leur faveur.
- 21 -
Poids des transferts sociaux dans le revenu disponible des mnages du premier dcile 1
Montants moyens mensuels (en euros) Prestations famille sans condition de ressources (2) Prestations famille sous condition de ressources (3) Aides la scolarit (4) Aides la garde onreuse d'enfants (5) Allocation logement (locataires) Minima sociaux (6) Total des prestations Revenu disponible par unit de consommation et par mois
(1)
Poids au sein des transferts sociaux 23 %
Poids au sein de l'ensemble du revenu 12 %
79
28 15 2 98 119 341 634
8% 4% 1% 29 % 35 % -
4% 2% 1% 16 % 19 % 54 % -
Le premier dcile ne recoupe pas exactement la population des bnficiaires de minima sociaux : il sagit des 10 % des mnages franais ayant les revenus initiaux les plus faibles. Le revenu disponible est ici divis par le nombre dunits de consommation composant le mnage. (2) Allocations familiales, allocation parentale dducation (APE), allocation dducation spciale (AES), allocation de soutien familial (ASF). (3) Complment familial, allocation parentale pour jeune enfant (APJE), API. (4) Allocation de rentre scolaire, bourses du secondaire. (5) Allocation de garde denfant domicile (AGED), aide la famille pour lemploi dune assistante maternelle agre (AFEAMA), complment dAFEAMA, subventions crches. (6) AAH, complment dAAH, minimum invalidit, RMI, minimum vieillesse. NB : il convient de noter que ces proportions sont sensiblement identiques depuis la mise en place de la prestation daccueil du jeune enfant (p. au 1er janvier 2004). Source : INSEE-DGI, enqute revenus fiscaux 1999 (actualise en 2002), calculs DREES.
Pour obtenir une image fidle du niveau de vie des bnficiaires de minima sociaux et de leur famille, il est donc indispensable dvaluer le poids de ces droits connexes dans le revenu des intresss. De la mme manire, pour comparer le pouvoir dachat des bnficiaires des diffrents minima et pour identifier les distorsions les plus criantes, une prise en compte de ces prestations complmentaires est ncessaire.
- 22 -
1. Les droits connexes lgaux : un dispositif plus ou moins dvelopp selon les minima sociaux a) Un accs privilgi aux aides au logement Bien quelles ne soient pas, et de trs loin, rserves aux bnficiaires de minima sociaux, les aides personnelles au logement verses par les caisses dallocations familiales contribuent, de faon trs importante, au niveau de vie de leurs allocataires. Les aides au logement sont en effet relativement concentres sur les mnages les plus pauvres : ainsi, les 10 % des mnages les plus pauvres, qui dtiennent seulement 2,3 % du revenu initial, concentrent prs de 32,8 % de la masse des allocations logement1. Cette concentration des aides au logement sur les mnages les plus pauvres est en partie due la rgle selon laquelle les bnficiaires du RMI et de lAPI ont automatiquement droit, du seul fait de statut de bnficiaires de ces prestations, aux allocations logement (allocation de logement caractre social ALS - et allocation de logement caractre familial - ALF) taux plein. Par ailleurs, depuis la rforme du barme des aides au logement, intervenue en deux tapes entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002, les conditions de ressources prvues pour lattribution de ces allocations ont t sensiblement amliores et permettent dsormais aux bnficiaires des autres minima sociaux dy avoir trs largement accs. Cette rforme a en effet permis une revalorisation importante du barme de lALS et de lALF, aboutissant un alignement avec celui de laide personnalise au logement (APL) et a rtabli une certaine neutralit de la condition de ressources applicable ces allocations vis--vis de lorigine des revenus du demandeur, permettant dlargir le bnfice de laide taux plein dautres catgories de personnes que les seuls bnficiaires du statut de RMIste ou d APIste . Il convient enfin de noter que pour les bnficiaires de lAAH, la perception dune aide au logement entranait automatiquement, jusqu aujourdhui, la perception du complment dAAH, dun montant forfaitaire de 95,92 euros par mois. La loi 11 fvrier 2005 pour lgalit des droits et des chances des personnes handicapes instaure le mme lien automatique entre la perception dune aide au logement et le bnfice de la nouvelle majoration pour vie autonome , verse en remplacement de lactuel complment. Son montant devrait slever environ 100 euros.
Cf. Rforme des allocations logement : quels impacts sur les mnages bas revenus ? , Lisa Fratacci (direction de la prvision), Les travaux de lObservatoire 2003-2004.
- 23 -
b) Des avantages fiscaux non ngligeables Au-del du fait que leur niveau de ressources les classe en pratique dans la catgorie des mnages non imposables, les titulaires de minima sociaux bnficient dun certain nombre de privilges fiscaux, le plus souvent lis non pas leur niveau de ressources mais leur statut dallocataire. Une exclusion de certains minima sociaux du champ de la CSG et de la CRDS Tous les minima sociaux sont exonrs de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Une exonration identique a galement t prvue en matire de contribution sociale gnralise (CSG), sauf pour les titulaires de lAI et de lASS. Rien ne semble pourtant justifier un traitement particulier, et moins favorable, de ces deux allocations, ce qui tmoigne encore une fois dune absence de politique globale en matire de minima sociaux. Un traitement de faveur dans le cadre de limpt sur le revenu
Certains minima sociaux bnficient dun rgime fiscal favorable limpt sur le revenu et nont pas tre dclars : cest le cas des allocations supplmentaires vieillesse et invalidit, de lAAH et du RMI. Une suspension des dettes fiscales est enfin prvue en faveur des bnficiaires du RMI et de lAPI. Lexclusion des autres minima sociaux de ces dispositions ne semble toutefois pas dcouler dune volont dlibre. Elle est plutt le rsultat dun traitement au cas par cas de chaque allocation, sans vue densemble. Une exonration plus ou moins automatique de taxe dhabitation Les titulaires du RMI bnficient dune exonration automatique de la taxe dhabitation, ds lors quils peuvent justifier du statut de RMIste pour tout ou partie de la priode scoulant entre le 1er janvier de lanne n-2 et la date de paiement de limpt. Une fois de plus, cette disposition, lie au statut de bnficiaire du RMI, ne sapplique pas aux titulaires dautres minima sociaux. Cependant, une amlioration du mcanisme de prise en compte des ressources dans le calcul de cet impt, introduite par la loi de finances pour 2000, a permis de rduire le poids de cet impt pour dautres catgories de contribuables faibles revenus. Elle a conduit, dans les faits, une exonration pour les titulaires de lAPI, de lAAH et de lallocation veuvage.
- 24 -
Un rgime favorable en matire de redevance audiovisuelle Une exonration de la redevance audiovisuelle tait jusquici traditionnellement prvue en faveur des personnes ges de plus de 65 ans et non imposables, ainsi que, sous certaines conditions de ressources, en faveur des personnes dont le taux dinvalidit tait suprieur 80 %. Ces rgles conduisaient en pratique une exonration des titulaires de lAAH, du minimum vieillesse et du minimum invalidit. Les allocataires du RMI pouvaient galement en bnficier, leur demande expresse. Larticle 41 de la loi de finances pour 2005, qui rforme le rgime de la redevance audiovisuelle pour en adosser le recouvrement sur celui de la taxe dhabitation, refond les exonrations applicables la redevance audiovisuelle. Lobjectif de cette rforme est de rapprocher les exonrations applicables la redevance de celles existant pour la taxe dhabitation, afin de faciliter la gestion de ces deux impts pour les agents chargs de leur recouvrement. Lexonration de la redevance audiovisuelle stend donc dsormais aux personnes indigentes reconnues comme telles par la commission communale des impts directs, aux titulaires de lAAH, du minimum vieillesse et du minimum invalidit s qualit, aux infirmes et aux personnes ges de plus de 60 ans remplissant certaines conditions de ressources et aux bnficiaires du RMI. Un rgime transitoire est prvu jusquen 2007 pour les contribuables pour lesquels le nouveau rgime serait moins favorable. En sattachant une fois de plus aux statuts des personnes et non leur niveau de revenu, le nouveau rgime dexonration de la redevance audiovisuelle ne permet pas une unification du rgime applicable lensemble des bnficiaires de minima sociaux : ainsi, bien que leur niveau de ressources soit comparable, les titulaires de lASS et de lAPI restent soumis la redevance audiovisuelle. c) Une couverture encore imparfaite en matire de frais de sant La cration de la couverture maladie universelle a permis tous les bnficiaires de minima sociaux davoir accs une couverture de base, sils ne bnficiaient pas dune affiliation un autre titre. Cependant, seuls les titulaires du RMI et les bnficiaires de la CMU complmentaire ont t automatiquement exonrs du paiement de la cotisation correspondante, les autres ayant t soumis une condition de ressources. De la mme manire, laccs la CMU complmentaire nest automatique que pour les bnficiaires du RMI. Pour les autres demandeurs, un plafond de ressources est applicable, qui varie en fonction de la composition du foyer.
- 25 -
Plafond de ressources pour la CMU complmentaire au 1er juillet 2004
Composition du foyer Personne seule 2 personnes 3 personnes 4 personnes Par personne supplmentaire Ressources mensuelles (en euros) 576,13 824,20 1.037,04 1.209,88 230,45
Compte tenu de ces plafonds, les titulaires de lAPI, ds lors quils ne sont pas en situation dintressement1, y ont en pratique accs quelle que soit la configuration de leur foyer. Pour les bnficiaires dautres minima sociaux, le droit la protection complmentaire dpend tout la fois de la configuration familiale et de lexistence ou non dautres ressources sajoutant au minimum considr. En revanche, les titulaires de certaines prestations en sont exclus doffice, compte tenu du niveau de celle-ci : cest le cas pour les personnes seules bnficiaires de lAAH, des allocations supplmentaires invalidit et vieillesse et de lAER. d) Un dispositif peu dvelopp : la constitution de droits lassurance vieillesse Seules les priodes passes sous le bnfice de minima sociaux lis lexercice antrieur dun emploi, cest dire de lASS, de lAER et de lallocation supplmentaire dinvalidit, ouvrent droit une validation au titre de lassurance vieillesse. Depuis la cration du RMI, un dbat existe sur lopportunit de valider les priodes de versement de cette allocation au titre de la retraite2. Outre le fait quil est extrmement difficile de mesurer le cot dune telle mesure, on ignore si ce type de validation pourrait conduire une retraite bien suprieure celle servie au titre du minimum vieillesse, prestation laquelle les anciens bnficiaires du RMI accdent dfaut de pension plus avantageuse. Le niveau de la retraite servie aprs validation serait en effet fonction la fois de la dure de prsence au sein du dispositif RMI et du niveau de la validation envisage : celle-ci pourrait tre effectue soit au niveau du salaire annuel moyen de lintress - qui serait trs faible, voire nul, pour une
Cest--dire de cumul entre un revenu dactivit et lallocation verse. Cf. infra p. 45. Cette question se pose avec moins dacuit pour les bnficiaires de lAPI car son versement est temporaire (trois ans au maximum).
2
- 26 -
personne reste bnficiaire du RMI pendant une longue priode -, soit au niveau du SMIC, soit encore celui du RMI. En raison de ces incertitudes, louverture de droits la retraite pour les bnficiaires du RMI a toujours t repousse. e) La place des prestations familiales pour les mnages pauvres avec enfants Si aucune prestation familiale nest directement lie au bnfice de tel ou tel minimum social, les conditions de ressources applicables aussi bien la prestation daccueil du jeune enfant qu lallocation de rentre scolaire ou au complment familial, font quune proportion importante des titulaires de minima sociaux en bnficie. Si ces aides ne reprsentent en moyenne que 4 % du revenu des mnages pauvres, leur poids est nettement plus important pour les familles nombreuses et les familles monoparentales. Il convient galement de souligner que les allocations familiales de droit commun, verses sans condition de ressources, contribuent, pour une part importante, au niveau de vie des foyers dallocataires de minima sociaux : elles reprsentent ainsi 23 % des transferts sociaux en faveur des mnages les plus pauvres, soit 12 % de leur revenu global. 2. Les mesures spcifiques : un impact difficile chiffrer mais rel sur les conditions de vie des bnficiaires de minima sociaux Au-del des droits connexes au sens strict, cest dire des prestations automatiquement lis au bnfice des minima sociaux et qui, relevant de laide sociale lgale, constituent des droits objectifs pour les demandeurs, les titulaires de minima sociaux ont un accs privilgi diffrents dispositifs daction sociale, dont limpact, en termes de niveau de vie, est rel mme sil est parfois difficile chiffrer. a) La prime de Nol Bien quelle ne soit normalement pas automatiquement reconductible, une prime de Nol est traditionnellement verse, depuis plusieurs annes, aux bnficiaires du RMI, de lASS, de lAER et de lallocation dinsertion. Cest la gense de cette allocation exceptionnelle qui explique quelle soit encore aujourdhui rserve aux bnficiaires de ces prestations particulires et quelle nait pas t tendue lensemble des minima sociaux : la suite des mouvements de chmeurs du mois de dcembre 1997, un fonds durgence sociale avait t mis en place et charg dattribuer des aides aux
- 27 -
chmeurs en grande difficult et une aide exceptionnelle avait t dbloque en faveur de ces derniers, qui revendiquaient une forme de treizime mois . Lactuelle prime de Nol a pris la relve de ce dispositif. Elle sest leve ces quatre dernires annes 152,45 euros pour une personne seule et 274,41 euros pour un couple avec enfant ou une personne seule avec deux enfants. Elle est verse aux personnes bnficiaires des allocations prcites au mois de novembre ou de dcembre de lanne considre. b) La tarification sociale tlphone et lectricit Parmi les obligations de service public imposes France Tlcom figure la garantie daccs au service du tlphone pour tous, y compris les personnes disposant de faibles ressources. Cest la raison pour laquelle une rduction sociale tlphonique a t mise en place. Elle consiste en une rduction de labonnement mensuel de lordre de six euros. Peuvent en bnficier, leur demande et sur prsentation de lorganisme gestionnaire de leur prestation, les titulaires d'une ligne fixe tlphonique bnficiaires du RMI, de lAAH et de lASS. On peut encore une fois sinterroger sur la liste limitative des minima sociaux susceptibles douvrir droit cette rduction tarifaire : ainsi, il est singulier que les titulaires du minimum vieillesse et invalidit, dont lallocation est pourtant de mme montant que lAAH, en soient exclus. De ce point de vue, le mcanisme prvu dans le cadre de la tarification sociale de llectricit, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, constitue un progrs, puisque le bnfice de cette mesure est fonction des ressources du foyer et non du statut de bnficiaire de telle ou telle allocation. Le dcret du 8 avril 2004 relatif la tarification sociale de llectricit comme produit de premire ncessit prvoit en effet que les usagers disposant de faibles ressources bnficient dune tarification spciale de llectricit consistant en une rduction de labonnement et du prix des cent premiers kilowattheures consomms dans le mois, le pourcentage de rduction dpendant du nombre de personnes que compte le foyer1.
Le tarif social de l'lectricit est ouvert, pour leur rsidence principale, aux mnages dont les ressources annuelles sont infrieures ou gales 5.520 euros pour une personne isole, ce plafond tant major de 50 % sil y a deux personnes au foyer, de 30 % pour la troisime et la quatrime personne, puis de 40 % pour chaque personne au-del de la quatrime.
- 28 -
c) Le ciblage des emplois aids sur les bnficiaires de minima sociaux La complmentarit des politiques de transferts de revenus et des politiques de lemploi sest accrue ces dernires annes, grce notamment au ciblage des instruments de la politique de lemploi sur les personnes les plus loignes du march du travail prvu par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Ainsi, les titulaires du RMI, de lASS et de lAPI figuraient, jusquici, s qualit au sein des publics prioritaires pour laccs un contrat emploi solidarit (CES). Sagissant du contrat initiative emploi, le code du travail visait plus largement les bnficiaires de minima sociaux . En pratique, les bnficiaires du RMI reprsentent environ 30 % des entres en emplois aids en 2003 et cette proportion est stable depuis 1998. Ils constituent galement 41 % des personnes employes dans le cadre dune entreprise dinsertion. Les chiffres concernant les bnficiaires dautres minima sociaux sont moins prcis, soit parce quaucune tude systmatique na t entreprise leur sujet, soit parce quils ne figurent pas en tant que tels parmi les publics prioritaires1.
Part des bnficiaires de minima sociaux dans les entres en emploi aid en 2003
Type de mesure CES CEC CIE SIFE collectif SIFE individuel Total Part des bnficiaires du RMI 37,2 % 24,6 % 19,5 % 31 % 15 % 30 % Part des bnficiaires de lASS 8,2 % 8,6 % 9% n.c n.c n.c Part des bnficiaires de lAPI 1,8 % 1,2 % 0,5 % n.c n.c n.c Part totale des bnficiaires de minima sociaux 47,2 % 34,4 % 29 % n.c n.c n.c
Source : DARES
SIFE : stage dinsertion et de formation lemploi
Ainsi, on sait que les personnes handicapes reprsentent 11,4 % des entres en CES, 14,3 % des entres en CEC et 21,3 % des entres en CIE mais il est impossible de distinguer, en leur sein, la proportion de celles qui sont bnficiaires de lAAH ou du minimum invalidit.
- 29 -
La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohsion sociale a prvu une simplification du dispositif des emplois aids. Les CIE rnovs et les contrats daccompagnement dans lemploi1 seront ainsi ouverts toute personne sans emploi rencontrant des difficults sociales et professionnelles particulires d'accs l'emploi , tandis que deux instruments seront plus spcifiquement rservs aux titulaires de minima sociaux : le contrat dinsertion-RMA et le contrat davenir. Au total, limpact de cette rforme en termes de ciblage des instruments sur les bnficiaires de minima sociaux est difficile mesurer : il dpendra de la dfinition des publics prioritaires laccs aux nouveaux CIE et CAE au niveau de chaque rgion. 3. Les fruits de laccompagnement social : un accs facilit aux dispositifs de lutte contre les exclusions a) Le soutien la dmarche dinsertion : un dispositif essentiel mais limit aux bnficiaires du RMI La conception mme du RMI, ds lorigine, comporte lide dun accompagnement des bnficiaires, signe de lengagement rciproque de la socit aux cts de lindividu en vue de sa rinsertion sociale et professionnelle. Ainsi, le dispositif du RMI allie le versement dune allocation et la signature dun contrat dinsertion. Lengagement rciproque de la socit sest galement traduit, jusqu prsent, par lobligation, pour tout dpartement, de consacrer chaque anne linsertion des titulaires du RMI une somme correspondant 17 % des sommes verses par ltat au titre de lallocation lanne prcdente. Mme si le taux de signature des contrats dinsertion et la consommation des crdits obligatoires dinsertion sont rests largement infrieurs aux prvisions, ces instruments ont permis le dveloppement dun rseau important de structures daccompagnement social ddies aux bnficiaires du RMI. Or, au-del de lassistance quil procure au bnficiaire dans sa dmarche de retour lemploi, cet accompagnement savre particulirement important en termes de mobilisation des aides de toutes natures susceptibles de venir amliorer la situation du bnficiaire. Lexistence dun dispositif dinsertion en faveur des titulaires du RMI se traduit en effet par une meilleure information des intresss sur les droits, notamment sur les droits connexes,
Le CIE rnov a vocation remplacer lactuel CIE, le SIFE et le SAE pour aboutir un contrat aid unique pour le secteur marchand ; le contrat daccompagnement dans demploi fusionne les actuels CES et CEC du secteur non marchand.
- 30 -
auxquels ils peuvent prtendre et par une limitation des situations de non recours. La disparition de cet accompagnement, en cas de sortie du dispositif et de reprise dactivit, ne se traduit certes pas par une diminution des ressources mais elle laisse la personne livre elle-mme dans le ddale des dmarches entreprendre pour faire valoir ses droits. En ce sens, laccompagnement procur aux bnficiaires du RMI dans le cadre de leur contrat dinsertion est bien un droit connexe essentiel. Pour cette raison, il est dommage que le RMI soit encore le seul minimum social pour lequel un tel dispositif contractuel daide linsertion soit prvu. Les bnficiaires de lAAH et du minimum invalidit ont certes accs un dispositif spcialis daide linsertion professionnelle, travers le rseau Cap Emploi, mais cette aide linsertion na jamais t formalise de faon aussi pousse que dans le cadre du RMI et ne dpasse pas le strict cadre de laccs lemploi1. Les bnficiaires dautres minima sociaux relvent donc, condition dtre inscrits comme demandeurs demploi, du dispositif de droit commun daccompagnement vers lemploi, dans le cadre du plan daide au retour lemploi (PARE). Or, linspection gnrale des affaires sociales souligne les insuffisances du PARE, concernant le ciblage des publics en difficult et la qualit mdiocre de laccompagnement qui pouvait tre propos dans ce cadre des personnes trs loignes de lemploi. Par ailleurs, compte tenu de conditions extrmement restrictives dengagement des crdits dpartementaux dinsertion, il na jamais t possible dutiliser ces crdits pour financer une extension de la dmarche dinsertion aux titulaires dautres minima sociaux. Cette question sest pourtant pose pour les bnficiaires de lASS ou de lAPI pour lesquels la problmatique de linsertion se posait dans des termes trs proches et qui avaient vocation, si leur situation se prolongeait, rejoindre les rangs des bnficiaires du RMI. Si la dcentralisation du RMI ne rsout pas la question de lexistence dun contrat dinsertion pour dautres minima sociaux, elle lve malgr tout lobstacle juridique qui empchait les dpartements de financer linsertion des bnficiaires dautres minima sociaux sur leurs crdits dinsertion.
Il convient toutefois de souligner que, parmi les missions des maisons dpartementales des personnes handicapes cres par la loi du 11 fvrier 2005, figure dsormais laccompagnement et le conseil en direction des personnes handicapes dans tous les domaines de la vie quotidienne.
- 31 -
b) Les fonds de solidarit logement et les fonds impays nergie : des instruments souvent mobiliss par les bnficiaires de minima sociaux Les fonds de solidarit pour le logement (FSL), institus dans chaque dpartement par la loi du 31 mai 1990 visant la mise en uvre du droit au logement et confis ces dpartements par la loi du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales, accordent des aides financires aux mnages dfavoriss, sous forme de prts ou de subventions, pour permettre leur accession un logement ou leur maintien dans celui-ci. Par ailleurs, depuis la loi du 13 aot 2004 prcite, les FSL ont vu leurs comptences tendues aux aides pour le paiement des factures deau, dnergie et de tlphone1.
Nature des aides apportes par les fonds de solidarit logement Les aides accordes par les FSL dpendent des orientations et des priorits dfinies au niveau de chaque dpartement. Parmi ces aides, on retrouve gnralement : - le cautionnement du paiement du loyer et des charges locatives ; - les prts, avances remboursables et subventions en vue du paiement du dpt de garantie, du premier loyer, des frais d'agence ou d'autres dpenses lies l'entre dans les lieux (frais de dmnagement, assurance etc.) ; - les prts, avances remboursables et subventions en vue du rglement des dettes locatives dont lapurement conditionne l'accs un nouveau logement ; - les prts, avances remboursables et subventions en vue du rglement des dettes de loyers et de charges locatives et en vue du rglement des frais de procdure supports par la personne ou la famille pour se maintenir dans le logement locatif : depuis la loi du 13 aot 2004, laide peut galement intervenir si lintress ne peut pas assumer ses frais d'assurance locative ou ses obligations relatives au paiement des factures d'eau, d'nergie et de tlphone. Deux dispositifs nationaux sont galement grs par les FSL : - lavance Loca-Pass, qui finance le dpt de garantie : cest une avance gratuite, consentie pour la dure de la location et verse au bailleur l'entre dans le logement. Elle est remboursable en 36 mensualits maximum aprs un diffr de paiement de trois mois, et avec des mensualits de 15 euros minimum. - la garantie Loca-Pass : il sagit dune garantie de paiement du loyer et des charges (caution), gratuite, valable pour trois ans et couvrant un nombre maximal de dixhuit mensualits de loyers et charges (trente six mensualits dans certains cas). Cette garantie est matrialise par un acte de cautionnement annex au bail.
Ces aides relevaient jusquici de dispositifs conventionnels nationaux.
- 32 -
Les aides des FSL ne sont pas rserves aux titulaires de minima sociaux, mais ces derniers y ont un accs privilgi, grce laccompagnement social dont ils bnficient par ailleurs, notamment de la part des centres communaux daction sociale et des associations de lutte contre les exclusions. Grce cet accompagnement social, qui est dailleurs en partie financ par les FSL dans sa composante lie au logement1, les bnficiaires de minima sociaux accdent plus facilement que le reste de la population linformation sur les aides distribues par les fonds. Les travailleurs sociaux, qui les suivent rgulirement, ont galement plus spontanment tendance leur proposer ce type daide et dfendre leur dossier devant les commissions dattribution. Ainsi, les mnages bnficiaires de minima sociaux reprsentaient, en 2003, 56 % des mnages aids financirement par les FSL.
Mnages aids par les FSL en 2003
Mnages bnficiaires dun minimum social RMI API ASS AAH Total Proportion au sein de lensemble des mnages aids 30 % 12 % 8% 6% 56 %
Source : Ministre dlgu au logement
c) Une meilleure prvention du surendettement Les procdures de prvention et de traitement du surendettement ne comportent pas de dispositions spcifiques aux bnficiaires de minima sociaux. Pourtant, on constate une sous reprsentation de ces derniers parmi les mnages victimes de surendettement : ainsi, une tude de la DREES montre que les mnages appartenant au premier dcile de la distribution des revenus (ce qui correspond, sans la recouper totalement, la population des bnficiaires de minima sociaux) ne reprsentent que 6 % de lensemble des mnages surendetts. Cela semble dautant plus paradoxal que la mme tude
Les FSL consacraient, en 2002, 60,5 millions deuros (sur un total de 276,2 millions deuros) aux subventions aux organismes uvrant dans laccompagnement social lis au logement.
- 33 -
rapporte que la faiblesse des revenus est lun des principaux facteurs aggravants du surendettement1. Ces bons rsultats en matire de surendettement rsultent en fait du meilleur suivi de cette population par les travailleurs sociaux : les foyers allocataires de minima sociaux bnficient en effet plus frquemment que les autres mnages de lintervention de conseillers en conomie sociale et familiale ou de dispositifs daide la gestion du budget. Pour les foyers qui chappent ce travail social, le seul dispositif lgal de prvention du surendettement consiste en effet en une inscription de leurs incidents de paiement au fichier national des incidents de remboursement des crdits aux particuliers (FICP), celui-ci pouvant tre consult par les organismes prteurs afin quils vitent daccorder un crdit une personne dont la situation financire est dj fragilise. Encore une fois, bien quil ne sagisse pas dun droit connexe au sens strict, ni mme dun dispositif prvoyant un accs privilgi pour les titulaires de minima sociaux, laccompagnement social dont bnficient ces derniers constitue un filet de scurit dune importance capitale et qui, bien souvent, disparat lors du retour lemploi. 4. Une grande inconnue : les transferts sociaux locaux a) Le recensement exhaustif des aides locales en faveur des personnes en difficult sociale est impossible Relevant de linitiative propre des diffrents niveaux de collectivits ou des organismes locaux de scurit sociale, ces transferts restent mal connus et il est pratiquement impossible den tablir un recensement exhaustif. Laction sociale dpartementale Au niveau des dpartements, une tude de la DREES2 met en lumire limportance des aides destines aux personnes ges ou handicapes : il peut sagit daides lamnagement du logement, daides aux dplacements, de portages de repas domicile ou encore dheures complmentaires daide mnagre. Cependant, si ces aides sont attribues en fonction des revenus, elles ne sont gnralement pas directement lies au statut de bnficiaire dun minimum social (AAH, minimum vieillesse ou invalidit).
Endettement et surendettement : des mnages aux caractristiques diffrentes , DREES, Etudes et Rsultats, n 251, aot 2003. 2 Laide sociale extralgale ou facultative des dpartements , DREES, tudes et Rsultats, n 317, juin 2004.
- 34 -
Les dpartements dveloppent galement des aides extralgales en faveur des personnes en difficult sociale : ces aides, qui peuvent tre en nature ou en espce, prennent - selon les dpartements - la forme de distributions de repas ou de colis alimentaires, daides complmentaires au rglement des factures dnergie ou de tlphone, daides spcifiques pour les personnes surendettes, daides individuelles au transport ou encore de prise en charge de ladhsion une mutuelle pour les personnes non bnficiaires de la CMUC.
Les aides dpartementales destines favoriser laccs aux soins de personnes non admises la CMU La loi du 27 juillet 1999 portant cration dune couverture maladie universelle (CMU) a substitu celle-ci laide mdicale gratuite auparavant gre par les conseils gnraux. Pour autant, certains dpartements ont, ds lanne 2000, mis en place des dispositifs facultatifs pour limiter les effets de seuil ou pour maintenir leur niveau de prise en charge tel quil existait avant la mise en place de la CMU. En 2002, vingt-sept dpartements sur les soixante treize ayant rpondu lenqute annuelle de la DREES sur ce sujet (soit 37 %) ont indiqu avoir mis en place une aide en faveur des personnes ne bnficiant pas de la CMU. Cette aide est destine financer tout ou partie dune couverture complmentaire mutualiste ou, dans une moindre mesure, prendre en charge des dpenses ponctuelles de soins ou des frais mdicaux de type prothses ou soins dentaires. Ainsi, parmi les rpondants, dix-huit dpartements financent exclusivement ladhsion une mutuelle, six dpartements prennent en charge la fois cette adhsion et des dpenses ponctuelles de soins, enfin trois dpartements remboursent exclusivement des dpenses de soins ou de frais mdicaux. Les actions des dpartements sont centres autour de trois publics prioritaires : - les personnes ges et les personnes handicapes hberges au titre de laide sociale en tablissement ; - les anciens bnficiaires de laide mdicale ; - les personnes ne bnficiant plus de la CMU, les personnes isoles et les bnficiaires du RMI dont le niveau de ressources est infrieur un barme de ressources fix par les conseils gnraux. En 2002, deux dpartements ont galement orient leur aide vers les jeunes pris en charge par le service de laide sociale lenfance. Il convient enfin de signaler que 12 dpartements dclarent avoir ngoci en 2002 des tarifs prfrentiels avec les mutuelles pour des cotisations ou des remboursements de frais mdicaux tels que dfinis dans le panier de soins de la CMU complmentaire.
Source : Laide sociale extralgale ou facultative des dpartements , DREES, tudes et Rsultats, n 317, juin 2004
- 35 -
Laction sociale communale Pour ce qui concerne les communes, ltablissement dune typologie est un exercice encore plus dlicat. En 2004, la DREES a tent un recensement des aides extralgales mise en place par les communes comportant de 5.000 moins de 200.000 habitants1 : laction sociale en faveur des personnes en difficult sociale reprsenterait en moyenne 21 % du budget daction sociale de celles-ci, que ces dpenses relvent de la commune elle-mme ou de son centre communal daction sociale (CCAS). Le recensement tabli par la DREES illustre la diversit des aides labores par les communes en faveur des personnes en difficult sociale : aide lapurement des impays (eau, gaz, lectricit, loyers, tlphone), attribution de prts ou davances remboursables, aide au logement sous la forme de sous-location, soutien des boutiques de solidarit ou des dispositifs de banque alimentaire. Une proportion importante de communes participe galement des dispositifs daction sociale coordonns, comme les FSL ou les fonds daide aux jeunes (FAJ). Une dernire modalit dintervention des communes en faveur des mnages bas revenus consiste prvoir des dgrvements spcifiques de taxe dhabitation, en complment des mesures dexonrations dj prvues par la lgislation en vigueur. Les communes dveloppent galement trs frquemment des aides spcifiques destines aux familles faibles revenus : ces dernires bnficient ainsi de tarifs rduits pour laccs un certain nombre dquipements communaux, quil sagisse de la restauration scolaire, de la piscine ou encore des crches.
Laction sociale des communes de 5000 moins de 200.000 habitants , DREES, tudes et Rsultats, n 307, avril 2004.
- 36 -
Communes concernes par chacune des principales actions destination des personnes en difficult sociale
Ensemble des communes de 5.000 moins de 200.000 habitants % de communes 64 52 49 42 39 38 35 34 32 27 26 22 18 16 9 13 13 34 6 % de population 58 58 51 51 33 42 39 43 40 25 27 34 26 24 16 14 16 51 -
5.000 moins de 10.000 habitants Apurement des impays deau Prts ou avances remboursables Apurement des impays de loyer Fonds solidarit logement (FSL) Distribution de nourriture Fonds dimpays Apurement des impays de tlphone Fonds daide aux jeunes (FAJ) Service de logements ordinaires durgence Banque alimentaire Aire de stationnement des nomades Service daccueil durgence Service de sous-location immobilire tablissements pour personnes en difficult sociale Dont CHRS Distribution de vtements picerie solidaire Commission daide sociale durgence Nombre moyen dactions 57 48 45 34 41 33 31 28 23 26 26 15 11 12 8 12 9 22 4,7
10.000 moins de 25.000 habitants 61 53 53 47 39 42 36 33 36 30 27 25 22 17 4 14 17 39 6,9
25.000 moins de 200.000 habitants 59 62 53 57 31 43 46 51 50 23 35 40 31 29 19 15 20 61 8,2
Champ : France entire, communes de 5.000 moins de 200.000 habitants. Source : DREES, enqute action sociale des communes 2002 .
Des avantages trs variables : lexemple des rductions tarifaires dans les transports publics La loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 avait affirm le principe dun droit au transport pour tous, spcifiant que ce droit devait notamment sadresser aux chmeurs de longue dure et aux demandeurs demploi de mois de 26 ans. La loi solidarit et renouvellement urbain (SRU) du 13 dcembre 2000 a complt la mise en oeuvre de ce droit en prcisant quil devait sappliquer toutes les personnes dont les ressources sont infrieures au
- 37 -
plafond de la CMU et que la rduction tarifaire devait tre dau moins 50 % et sappliquer quel que soit le lieu de rsidence de lusager. Malgr ce cadre lgislatif, les rductions tarifaires mises en place par les autorits organisatrices de transport sont variables : - en rgion Ile-de-France, le syndicat des transports (STIF) a cr un systme de chque mobilit pour les chmeurs et pour les bnficiaires du RMI et une carte Transition pour les jeunes issus du programme TRACE : les rductions prvues dans ce cadre vont plus loin que la semi gratuit impose par la loi ; - la SNCF a mis en place destination des chmeurs, sur la base dune convention avec lANPE, des rductions pouvant aller jusqu la gratuit ; - en province, trois agglomrations appliquent stricto sensu les critres de la loi SRU (Pau, Dijon et vreux). Les autres ont mis en place des tarifs sociaux variables, qui peuvent se situer soit en de, soit au-del de la semi-gratuit prvue par la loi : 36,5 % des agglomrations de province ont prvu des tarifs rduits pour les demandeurs demploi (30 % pour les bnficiaires du RMI) et 36,5 % dentre elles vont jusqu la gratuit (31 % pour les bnficiaires du RMI). On peut toutefois dplorer labsence presque totale dinteroprabilit entre les diffrents rseaux de transports, car il nexiste pas de modalits fiables de reconnaissance mutuelle des bnficiaires des rductions tarifaires entre les diffrentes autorits organisatrices de transport. b) Leur impact est vraisemblablement important sur le niveau de vie des bnficiaires de minima sociaux Compte tenu de la grande diversit des aides attribues par les collectivits locales et de leur caractre extralgal, il est extrmement difficile de mesurer leur impact sur le niveau de vie des bnficiaires de minima sociaux. Ni la DREES, ni lobservatoire de laction sociale dcentralise (ODAS) nont, ce jour, men une analyse approfondie concernant lattribution de ces aides aux titulaires de minima sociaux. Une seule tude, ralise par des chercheurs indpendants et publie par lINSEE, est actuellement disponible ce sujet. Elle recense, dans dix villes et pour six configurations familiales, lensemble des prestations locales dont les conditions dattribution sont explicites, lexclusion des aides sans barme prcis et de celles rserves certaines catgories (jeunes, personnes
- 38 -
ges ou handicapes...). Elle met en lumire les caractristiques suivantes des transferts sociaux locaux1 : - les aides locales ont un poids important dans le revenu des bnficiaires de minima sociaux : pour un mnage sans revenu qui percevrait la totalit des prestations auxquelles il a droit, ces transferts reprsentent en moyenne un cinquime des ressources, soit un accroissement de prs dun quart des ressources tires des seuls transferts nationaux. Les disparits locales sont cependant trs importantes (de lordre de un dix, selon les communes) ; - ces transferts locaux favorisent globalement les mnages avec enfants : la diffrence des transferts nationaux, et notamment des allocations familiales, limpact des enfants charge sur le montant des aides se fait sentir ds le premier enfant. Ainsi, le montant des transferts est, en moyenne, deux fois plus lev pour les familles (ou les parents isols) levant un enfant ; - lattribution des aides locales est, plus souvent que pour les prestations nationales, lie au statut (de chmeur, de bnficiaire du RMI). Par ailleurs, cest le plafond du RMI qui sert le plus souvent de rfrence pour les aides locales (do un effet de seuil trs important la sortie de cette allocation).
Transferts sociaux locaux et retour lemploi , Denis Anne et Yannick LHorty, INSEE, Economie et Statistiques, n 357-358, 2002.
- 39 -
II. BILAN : UN SYSTME DE MINIMA SOCIAUX OPAQUE POUR LES BNFICIAIRES ET PROBABLEMENT DSINCITATIF LEMPLOI La complexit du systme des minima sociaux en France et de leurs droits connexes, ainsi que les modalits de leur insertion dans lensemble de notre systme de protection sociale entrane dinvitables effets pervers : des effets de seuil conduisant des pertes brutales de revenu, des dcalages dans le calendrier de versement des prestations qui fragilisent la gestion de budgets dj trs serrs... Au total, le systme des minima sociaux apparat bien opaque pour les bnficiaires qui, ne comprenant pas la mcanique des diffrentes prestations, ont parfois limpression de dcisions arbitraires et se sentent pris au pige de leur statut. Dans ces conditions, se dveloppent ncessairement des trappes inactivit , sans quil faille voir dans cette expression un jugement de valeur sur le comportement des intresss : cette expression signifie simplement que le retour lemploi nest pas rmunrateur, ce qui na rien voir avoir la volont des personnes considres de retrouver ou non un emploi.
A. DE MULTIPLES EFFETS DE SEUIL
1. Une source deffets de seuil en voie de rsorption : les aides lies au statut a) Des effets pervers particulirement importants au niveau du RMI La premire source deffets de seuil rside dans lexistence daides lies au statut : elles engendrent automatiquement des effets pervers car toute augmentation des revenus, de quelque origine quelle soit, entrane non seulement la perte du bnfice de lallocation de base mais aussi de ces avantages lis au statut. Or, elles sont particulirement nombreuses pour les bnficiaires du RMI et, dans une moindre mesure, de lASS, de lAAH et de lAPI. Pour ne citer que le cas du RMI, la sortie du dispositif entrane la perte immdiate du bnfice de lallocation logement taux plein automatique, de lexonration de taxe dhabitation et de redevance audiovisuelle, la fin du droit la CMU et la CMUC gratuites, la suppression de la prime de Nol et lobligation de payer nouveau un abonnement
- 40 -
tlphonique plein tarif. Par ailleurs, les dettes fiscales, qui taient jusqualors suspendues, sont nouveau exigibles.
Les aides lies au statut de bnficiaire dun minimum social
Minimum social RMI Droits connexes lis au statut Allocation logement taux plein automatique, suspension des dettes fiscales, exonration automatique de taxe dhabitation, exonration de redevance audiovisuelle, exonration de cotisation CMU, accs automatique et gratuit la CMUC, tarification sociale tlphone, prime de Nol Majoration pour vie autonome, exonration de redevance audiovisuelle, tarification sociale tlphone Prime de Nol, tarification sociale tlphone Allocation logement taux plein automatique, suspension des dettes fiscales Prime de Nol Exonration de redevance audiovisuelle Exonration de redevance audiovisuelle Prime de Nol -
AAH ASS API Allocation dinsertion Minimum vieillesse Minimum invalidit AER Allocation veuvage
A la perte de ces aides nationales, il convient dajouter la suppression de nombreuses aides locales : compte tenu de la difficult vrifier les ressources des demandeurs, les collectivits locales ont en effet trs souvent recours au critre du bnfice de telle ou telle allocation - et notamment du RMI - pour attribuer leurs aides extralgales. Dans la mesure o elles sont lies au statut de bnficiaire dune prestation donne, la perte de revenu ou de droits se concentre au mme moment, ce qui fragilise encore plus la situation de lintress qui souvent na pas anticip - ou de faon seulement partielle - les consquences de son changement de statut. b) Une prise de conscience rcente des pouvoirs publics Depuis le constat tabli en 2000 par le commissariat gnral du plan1, les pouvoirs publics ont pris conscience des effets pervers lis aux aides accordes en fonction du statut et ont tent dy remdier.
1
Minima sociaux, revenus dactivit, prcarit , Jean-Michel Belorgey, Commissariat gnral du plan, mai 2000.
- 41 -
Ainsi, la rforme des allocations logement, entirement applicable depuis 2001, a prvu de complter le critre du statut pour lattribution dune aide taux plein par un critre plus gnral, li aux ressources cette fois. En consquence, une personne qui ne peroit plus le RMI peut continuer de bnficier de lallocation logement taux plein, si ses ressources totales, provenant dautres prestations ou dune activit rmunre, sont en ralit inchanges. De la mme manire, le rgime des exonrations de taxe dhabitation a t modifi par la loi de finances pour 2000, de faon prvoir, en plus de lexonration lie au bnfice du RMI, une exonration accorde en fonction des ressources. Par ailleurs, les pouvoirs publics vitent dsormais de crer de nouveaux droits lis au statut, en leur prfrant une simple condition de ressource, plus neutre : tel est par exemple le cas de la nouvelle tarification sociale de llectricit. Ce constat doit toutefois tre nuanc : lors de la rforme de la redevance audiovisuelle mise en uvre par la loi de finances pour 2005, les aides lies au statut ont t reconduites. Cette erreur sexplique par le fait que lobjectif poursuivi par le Gouvernement tait alors une simplification du systme de la redevance, grce un adossement la taxe dhabitation, et non le lissage des effets de seuil pour les bnficiaires de minima sociaux. En ralit, cette question na pas t aborde. Dans cette perspective, il a simplement paru plus rapide de fusionner la liste des exonrations applicables ces deux taxes, plutt que dentrer dans une rforme plus profonde du rgime mme des exonrations. 2. Les effets de seuil lis la combinaison des prestations entre elles a) Le passage dun minimum lautre La simple multiplicit des minima sociaux en France peut conduire des effets pervers, car le passage dun statut lautre conduit des ruptures, plus ou moins brutales, de ressources. Ces ruptures peuvent tre dues : - une simple diffrence de montant des prestations : ainsi, les bnficiaires de lAPI qui, du fait de lavance en ge de leur enfant, basculent dans le dispositif du RMI voient leurs ressources reculer, du simple fait de ce changement de statut, cause du montant diffrent des majorations pour enfants applicables. Ce recul peut aller de 85 euros pour les parents isols ayant un seul enfant charge prs de 150 euros pour ceux qui lvent seuls trois enfants ;
- 42 -
- des plafonds de ressources non coordonns : le passage de lASS au RMI peut tre tout fait neutre pour une personne isole sans autres ressources que ces allocations. En revanche, si elle dispose dautres revenus quelle pouvait jusqualors cumuler avec une ASS taux plein, le caractre strictement diffrentiel du RMI entranera une dduction de ces revenus du montant effectivement vers. De mme, alors que le bnficiaire de lASS pouvait, dans une certaine limite, cumuler son allocation avec les revenus de son conjoint, ce cumul sera beaucoup plus limit, voire impossible dans le cadre du RMI. Une autre difficult mrite dtre signale, concernant la transition ASS-RMI : le mode de calcul du RMI prvoit de neutraliser les revenus dASS uniquement en cas dabsence dactivit. Lorsque le bnficiaire de lASS termine une priode dintressement, une transition de trois mois est ncessaire pour que le RMI vers retrouve son niveau maximum ; - des revenus de rfrence htrognes : bien que les montants de lAAH et du minimum vieillesse soient identiques, certains bnficiaires de lAAH peuvent voir leurs ressources reculer du fait de la rintgration, dans le revenu de rfrence retenu pour le calcul du minimum vieillesse, de ressources dont il ntait pas tenu compte pour lattribution de lAAH ; - des pertes de droits connexes : le passage de lAAH au minimum vieillesse entrane, pour la personne handicape, la perte des majorations pour vie autonome automatiquement lies la perception de lAAH. De la mme manire, il peut tre paradoxalement plus avantageux, pour un parent isol, de demander le RMI en lieu et place de lAPI, malgr les diffrences dj signales dans le montant des majorations pour enfants, du fait de droits connexes attachs au RMI beaucoup plus importants. La mise en lumire de ces effets de seuil, lis la seule complexit de notre systme de protection sociale, plaide lvidence pour une simplification de notre dispositif de minima sociaux. b) Limpact des allocations familiales Les effets de seuil sont galement majors par la combinaison des prestations entre elles : par exemple, les allocations familiales sont majores pour les enfants de moins de trois ans et de plus de seize ans, entranant des variations de ressources de plus de 150 euros, ce qui est loin dtre ngligeable pour des budgets restreints.
- 43 -
En effet, la prsence dun enfant de moins de trois ans se traduit par la perception dune prime la naissance de 826 euros et de lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant (PAJE), dun montant de 165 euros1. Ces prestations disparaissent brutalement au troisime anniversaire de lenfant. A linverse, la majoration pour ge des allocations familiales, verse au titre des enfants de plus de seize ans, permet une augmentation temporaire du revenu, avant une disparition brutale de toute prestation, lorsque lenfant cesse dtre charge. c) Lanalyse des taux marginaux dimposition : une approche synthtique de leffet combin des diffrentes prestations En additionnant lensemble des pertes de revenu (lies au passage dun minimum social un autre, la perte de droits connexes ou encore la mise en oeuvre de conditions de ressources diffrentes) conscutives un accroissement donn des revenus dun mnage, il est possible de mesurer son taux marginal dimposition , cest dire leffet rel dune augmentation marginale des revenus sur son revenu disponible net2. Si lon dessine la courbe des taux marginaux dimposition en fonction du revenu, on constate que celle-ci a une forme de U aplati, les taux apparaissant globalement plus levs chaque extrmit de la distribution des revenus : ainsi, le taux marginal dimposition atteint presque 100 % pour les revenus dactivit les plus faibles, puis il diminue et se stabilise en de de 20 % pour une fourchette de revenus dactivit comprise entre trois et huit SMIC, avant de remonter sensiblement, pour atteindre 50 % pour les revenus les plus levs. Pour autant, cette courbe en U nest pas anormale : elle met simplement en lumire le caractre redistributif de notre systme social et fiscal, qui sappuie sur des prlvements progressifs avec le revenu et des transferts cibls sur les mnages les plus modestes. Mais son analyse est surtout intressante en ce quelle montre que la courbe des taux marginaux dimposition nest pas continue : comme en tmoigne le graphique suivant, ses nombreux pics sont la preuve de lexistence deffets de seuil.
Ces prestations sont verses sous condition de ressources, mais elles concernent en ralit 90 % des familles franaises. Elles sont donc, a fortiori, perues par lensemble des bnficiaires de minima sociaux, ds lors que leurs enfants y ouvrent droit. 2 Le revenu disponible net dun mnage est la somme de tous les revenus et de toutes les aides que peroit le mnage laquelle on soustrait le loyer, les charges, limpt sur le revenu et la taxe dhabitation. Il correspond donc au revenu dont dispose rellement le mnage pour vivre, une fois rgls ses frais fixes.
- 44 -
Taux marginal dimposition apparent pour un couple monoactif ayant deux enfants
Sortie du RMI Barme de la PPE (fin de la part variable)
PPE
Fin des allocations logement Seuil de recouvrement de lIR
Fin de lallocation de rentre scolaire
PPE : prime pour lemploi Source : Ministre de lconomie et des finances, direction de la prvision
La prsence dun taux marginal dimposition de 100 % au dbut de la distribution des revenus est lie au caractre purement diffrentiel du RMI : ce stade, en effet, toute augmentation des revenus du bnficiaire se traduit automatiquement par une baisse due concurrence de lallocation. Dans la configuration familiale retenue dans cet exemple, la sortie du RMI se produit pour un revenu dactivit gal 0,7 SMIC. Pourtant, on constate quand mme une diminution du taux marginal dimposition, qui semble contredire le caractre diffrentiel du RMI. Cette amlioration est en ralit due la monte en puissance de la prime pour lemploi (PPE), qui entre en jeu compter dun revenu dactivit de 0,3 SMIC et compense - insuffisamment au dpart puis de plus en plus - limportance du prlvement. On constate ensuite une succession de pics, correspondant autant de seuils pour les bnficiaires qui reprennent une activit professionnelle, de faon durable ou non : un premier ressaut intervient quand leffet de la PPE diminue, compter dun SMIC, un deuxime se produit quand les revenus de lintress dpassent le plafond des allocations logement, un troisime quand il atteint le seuil de recouvrement de limpt sur le revenu, un dernier loccasion du dpassement du plafond de versement de lallocation de rentre scolaire. Les paliers suivant correspondent ensuite simplement aux diffrentes tranches de limpt sur les revenus.
- 45 -
Ces pics sont en partie invitables : ils sont la contrepartie de la volont des pouvoirs publics de concentrer laide apporte sur les mnages les plus modestes. Or, ds lors que notre systme de prestations sociales est en partie fond sur des allocations sous condition de ressources, il est invitable que des effets de seuil se produisent lorsque les plafonds de ressources sont dpasss. Ils sont toutefois accentus aujourdhui par des conditions de ressources qui fonctionnent sur le mode du tout ou rien . Ils pourraient donc certainement tre attnus par des aides plus dgressives, permettant une sortie en sifflet de chaque dispositif. Les enseignements apports par les analyses de la direction de la prvision doivent toutefois tre nuancs, car le modle statistique utilis comporte des biais importants : ainsi, il ne prend en compte ni la prime de Nol, ni les aides locales, ni les avantages fiscaux que constituent lexonration de taxe dhabitation ou de redevance audiovisuelle, ni la CMU. Or, ces aides fonctionnent souvent sur le mme modle de couperet que celles qui, dans le cas tudi, conduisent des pics de taux marginal dimposition. Il existe donc vraisemblablement dautres effets de seuil. Compte tenu notamment de limportance des droits connexes au RMI, notamment au niveau des aides locales, il est possible, voire probable, que des taux marginaux dimposition suprieurs 100 % subsistent dans certains cas. On peut enfin dplorer que de telles tudes nexistent, encore une fois, que pour le RMI. Interroges par votre rapporteur, lensemble des directions statistiques concernes (INSEE, DREES, DARES, direction de la prvision) a indiqu ne pas tre en mesure de fournir des informations de cet ordre concernant les autres minima sociaux. Dailleurs, les modles statistiques utiliss par ces services (le modle INES pour la DREES, PRIS pour la direction de la prvision) sont incomplets concernant les minima sociaux : ainsi, le modle PRIS nintgre que les donnes relatives au RMI et pas aux autres minima. 3. Les effets de calendrier dans le versement des prestations Les diffrences de priode de rfrence pour le calcul des prestations et les dlais de carence entre louverture des droits et la perception de laide donnent enfin un caractre heurt aux diffrents versements perus par les bnficiaires et constituent une autre source deffet de seuil. Ainsi, lapprciation trimestrielle des ressources pour lattribution du RMI entrane un effet retard dans la prise en compte des changements de situation du foyer : en cas dactivit rmunre au cours du trimestre prcdent, lallocation est revue la baisse et demeure donc plus faible
- 46 -
pendant trois mois, mme si lactivit a cess. Dans certains cas limites, les bnficiaires peuvent tre privs de toute ressource pendant un trimestre, si la rmunration perue au cours des trois mois couls a dpass le seuil de versement du RMI. Cette situation se rvle particulirement dcourageante pour les bnficiaires qui tentent de reprendre le chemin de lemploi, en acceptant des emplois en intrim ou dure dtermine. Leffet retard li au caractre trimestriel de lapprciation des ressources dans le cadre du RMI est accentu par le fait que lallocation est toujours verse terme chu, ce qui accrot encore dun mois les dlais de carence dans le versement de lallocation.
volution du revenu (hors aide au logement) dun allocataire du RMI, isol, reprenant un emploi mi-temps
900 800 700
Neutralisation 50 % des revenus si mi-temps Cumul intgral les deux premiers mois
600 500 400 300 200 100 0
Neutralisation de 125 euros si CES
Travaille 3 semaines en dcembre, 8 jours de diffr dindemnisation Indemnisation en AUD (15 mois), cumul avec le RMI
RM I RM I - CES RM I -M i-temps
RMI = 0 Effets du dcalage calcul de la diffrentielle RMI et dgressivit de lAUD
Fin de lAUD, RMI seul
Note de lecture Situation de dpart : RMI (dclaration trimestrielle de ressources en dcembre) Changements de situation : prend un emploi soit en CES, soit mi-temps ayant la mme rmunration pendant 12 mois (11 mois et 3 semaines). Peroit lAUD la fin du contrat jusquen mars 2003 puis rebascule au RMI. Les aides au logement restent stables sur toute la priode. Source : Minima sociaux, revenus dactivit prcarit , rapport de Jean-Michel Belorgey pour le Commissariat gnral du plan, mai 2000. Donnes : DSS, lgislation en vigueur au 1er juillet 1999
Des problmes identiques existent pour les bnficiaires dautres minima sociaux : ainsi, la rfrence au revenu imposable de lanne prcdente pour lAAH peut entraner un diffr dans la perception de lallocation de prs dun an.
d c f -00 vr av 01 r-0 ju 1 in ao -01 t oc 01 t -0 d 1 c f -01 vr av 02 r-0 ju 2 in ao -02 t oc 02 t -0 d 2 c f -02 vr av 03 r-0 ju 3 in ao -03 t oc 03 t -0 d 3 c f -03 vr av 04 r-0 ju 4 in ao -04 t oc 04 t -0 d 4 c04
- 47 -
Il existe bien des systmes davance sur droits supposs, qui permettent normalement de remdier ces dlais de carence : ils ont mme t systmatiss pour les dcisions de renouvellement de lAAH et du RMI. Mais les gestionnaires de ces allocations, et notamment les caisses dallocations familiales charges de leur versement, sont rticentes recourir ces dispositifs, compte tenu des cots levs lis aux rcuprations dindus en cas derreur. Le mode de calcul des allocations logement comporte, lui aussi, des effets pervers de calendrier, du fait dun dispositif de rvision asymtrique : en effet, alors que ces allocations sont normalement rvises annuellement, elles sadaptent immdiatement la baisse en cas de reprise dune activit pour les bnficiaires du RMI. En revanche, lorsque cesse cette activit, les bnficiaires doivent attendre la rvision annuelle, pour bnficier dune mise jour de leurs droits. Dans la mesure o la stabilit et la prvisibilit des revenus est une donne primordiale pour les mnages les plus modestes, on comprend que ces multiples effets de seuil, qui se manifestent loccasion dun accroissement marginal des revenus, li ou non lactivit, constituent un frein la reprise dun emploi.
B. LA PROBLMATIQUE DU RETOUR LEMPLOI
La complexit de notre systme de minima sociaux et les effets de seuil quelle engendre contribuent-ils enfermer les personnes qui en bnficient dans leur situation de non emploi et de prcarit ? Peut-on mettre en lumire des phnomnes de trappes inactivit ?
Trappes chmage, trappes inactivit et trappes pauvret La notion de trappe fait rfrence la thorie de loffre de travail, pour laquelle lindividu doit arbitrer de faon rationnelle entre travail et loisir. Dans ce contexte, tout revenu que lindividu peut se procurer sans travail biaise son choix en faveur des loisirs. Si ce revenu est trop important par rapport au salaire auquel il pourrait prtendre, il se trouve pris dans une trappe , cest dire un pige, qui le condamne linactivit. On distingue gnralement la notion de trappe inactivit qui voque la dsincitation financire entrer sur le march du travail pour les inactifs, celle de trappe chmage qui renvoie plus prcisment la question de lincitation financire pour les chmeurs accepter un emploi compte tenu de lexistence dune indemnisation et celle, plus large, de trappe pauvret qui fait rfrence la situation des personnes, exerant ou non un emploi, pour lesquelles laugmentation du revenu dactivit se heurte des effets de seuil qui les maintiennent sous le seuil de pauvret.
- 48 -
On parle de trappe inactivit pour dcrire une situation o la reprise dun emploi faiblement rmunr par un allocataire de minimum social conduit une stagnation, voire une baisse du niveau de vie, de telle sorte que celui-ci pourrait prfrer demeurer dans le dispositif dassistance. Lutilisation du terme de prfrence ne doit en aucun cas tre interprte comme un jugement moral port sur le comportement des individus concerns. Il sagit dun terme employ par les conomistes pour caractriser des situations o le travail nest pas suffisamment rmunrateur et o les bnficiaires de minima sociaux se trouvent, en quelque sorte, pris au pige dun systme o les allocations perues deviennent des maxima indpassables , selon lexpression utilise par Martin Hirsch dans son rapport sur la pauvret des familles1. Lexpression de trappe inactivit elle-mme vient dailleurs de langlais to trap , cest dire piger . Lexprience de terrain et les multiples enqutes effectues auprs de bnficiaires de minima sociaux montrent en effet que les personnes confrontes ces situations ne choisissent pas dlibrment de rester dans lassistance : elles nont pas une prfrence explicite pour linactivit ; simplement, lensemble des contraintes et des frais engager pour retrouver le chemin de lemploi constituent parfois des obstacles insurmontables. 1. Depuis 2000, une volont forte daccrotre lincitation financire la reprise dactivit a) Une forme ancienne dincitation la reprise dactivit : les mcanismes dintressement Ds 1988, le lgislateur a souhait encourager les bnficiaires du RMI rejoindre le monde du travail : conu comme un revenu de transition temporaire, le montant du RMI demeure volontairement faible et un mcanisme dintressement la reprise dactivit est prvu, permettant de cumuler - dans une certaine mesure et pour un temps limit - lallocation avec un revenu du travail : il sagissait donc dinciter la reprise demploi et, une fois passe une priode dessai , initialement fixe trois et dsormais tablie six mois, de retirer progressivement lallocataire le support de l'tat. Un tel mcanisme existe dsormais pour six minima sociaux : le RMI, lAAH, lAPI et lASS, lallocation dinsertion et lallocation veuvage, mme si leur fonctionnement reste diffrent.
Au possible, nous sommes tenus : la nouvelle quation sociale, 15 rsolutions pour combattre la pauvret des enfants , rapport de la commission Famille, vulnrabilit, pauvret prside par Martin Hirsch, avril 2005.
- 49 -
Le dispositif dintressement prvu pour le RMI et tendu, par la loi dorientation du 29 juillet 1998 relative la lutte contre les exclusions, lAPI permet au bnficiaire qui reprend un emploi de cumuler son revenu dactivit avec lallocation intgralement pendant les deux premiers trimestres, puis en appliquant un abattement de 50 % sur la moyenne des revenus dactivit pour les trois trimestres suivants. Le prolongement de lintressement peut, en outre, tre autoris si la dure totale de travail des quatre derniers trimestres est reste infrieure 750 heures et que le parcours dinsertion du bnficiaire le justifie. Deux cas particuliers sont prvus : - celui de la cration dentreprise : pour les crateurs dentreprise bnficiaires de laide aux chmeurs crateurs ou repreneurs dentreprise (ACCRE), la loi prvoit la possibilit de conserver le bnfice intgral du RMI ou de lAPI pendant deux trimestres, un abattement de 50 % sur les revenus dactivit tant encore possible pendant les deux trimestres suivants ; - celui du cumul avec un CES : les allocataires se voient alors appliquer un abattement de 33 % du montant de base du RMI (de 37,5 % sur celui de lAPI), pendant toute la dure du contrat, ds le deuxime trimestre de la reprise dactivit. Ce dispositif, assurment moins favorable court terme autorise toutefois une dure dintressement plus longue, puisque celle-ci peut aller jusqu vingt-quatre mois. La loi de lutte contre les exclusions a galement tendu le bnfice dun dispositif dintressement aux allocataires de lASS et de lallocation dinsertion1. Celui-ci autorise un cumul de ces allocations avec un revenu dactivit pendant douze mois, sauf pour les allocataires de cinquante-cinq ans et plus pour lesquels aucune limitation de dure nest prvue. Un allongement de la priode dintressement est possible, si le nombre total dheures travailles pendant les douze mois rglementaires est infrieur 750 heures. Le cumul est dabord intgral pendant les six premiers mois, condition que le salaire brut mensuel soit infrieur un demi-SMIC brut, soit 607,56 euros2. Les six mois suivants, lASS est rduite, dans une proportion de 40 % de la rmunration perue divise par le montant journalier de lindemnit. On pourrait stonner de la diffrence de taux entre lASS dune part et le RMI et l'API dautre part, mais le premier sapplique sur des revenus bruts, alors que les seconds sappliquent sur des revenus nets. Les deux types dintressement sont alors proches, si lon retient un taux de cotisations sociales de lordre de 17 %.
1 2
Il existait auparavant, pour lASS, un rgime dactivit rduite, mais il tait trs marginal. Si le salaire est suprieur un demi-SMIC brut, une dduction de 40 % de la partie du revenu suprieur au seuil est applique.
- 50 -
En cas de cumul avec un CES, lallocation est rduite proportion de 60 % de la rmunration brute divis par le montant journalier de lindemnit. Enfin, depuis la loi du 1er aot 2003 relative linitiative conomique, les bnficiaires de lASS et de lallocation dinsertion crateurs dentreprise, et qui bnficient pour cela dune aide de ltat, ont droit au maintien de leur allocation pendant un an. Le mcanisme prvu pour lAAH est sensiblement diffrent, puisquil autorise un cumul permanent de lallocation avec un revenu dactivit : un abattement est en effet appliqu aux revenus dactivit de la personne, lui permettant de les cumuler sans limitation de dure avec la prestation, sous rserve que le total de ces ressources reste infrieur au plafond de lallocation. Au total, un cumul permanent - total ou partiel selon le niveau de rmunration - est donc possible jusqu un SMIC environ pour une personne seule temps plein et jusqu 1,8 SMIC pour un couple. En cas de cumul avec une rmunration de centre daide par le travail (CAT), le cumul est plafonn 100 ou 110 % du SMIC net, selon le montant de rmunration directe vers par le CAT. Si ces mcanismes permettent, la plupart du temps, leurs bnficiaires de voir leurs revenus dpasser le seuil de pauvret1, de nombreuses critiques leur ont t adresses, dnonant notamment leur complexit et leur opacit pour les usagers : ainsi, parmi les allocataires de lASS, quatre bnficiaires potentiels de lintressement sur dix en ignoraient lexistence. Au total, la part des allocataires en intressement stagne, voire recule. Limpact du dispositif savre particulirement faible pour les bnficiaires de lAPI, car la reprise dactivit se heurte pour ces derniers la question cruciale de la garde des enfants.
Proportion de personnes en intressement lors dune reprise dactivit
Dcembre 1998 RMI API ASS 12,3 % n.c 16 % Dcembre 1999 14,1 % n.c 16 % Dcembre 2000 13,6 % 5,1 % 13,8 % Dcembre 2001 12,2 % 5,1 % 12,8 % Dcembre 2002 13,3 % 5,6 % 13,2 %
Source : Synthse des bilans de la loi dorientation du 29 juillet 1998 relative la lutte contre les exclusions , IGAS, rapport n 2004-054 de mai 2004 - Calculs DREES (France mtropolitaine, dcembre 2003)
Le seuil de pauvret est mesur par lINSEE 50 % du revenu mdian, soit en 2001, 602 euros par unit de consommation.
- 51 -
La faible attractivit des mcanismes de cumul dune activit rmunre et dun minima social tient galement aux taux marginaux effectifs dimposition trs dissuasifs long terme et la chronologie des revenus particulirement heurte court terme quils imposent. Or, limprvisibilit des ressources dun trimestre lautre fragilise ces mnages qui ont dj des budgets trs serrs, linstabilit de leur situation tant accrue par le fait que lintressement concerne essentiellement des emplois temps trs partiel, dure dtermine et faiblement rmunrs. b) La situation en 2000 : reprendre un emploi entranait souvent des pertes de revenus Une tude de lINSEE1 sur les minima sociaux et leur insertion dans le systme socialo-fiscal franais en 2000 met en lumire trois spcificits de ces dispositifs : A cette date, le revenu disponible naugmente pas de faon continue en fonction de la dure du travail Pour des dures du travail bien prcises, accepter une heure de rmunration en plus provoque une baisse de revenu disponible de plusieurs centaines deuros. Ces ruptures de ressources brutales tiennent notamment au fait que la perte du RMI ou la perte du statut de RMIste a des rpercussions sur le montant des allocations logement perues ou sur celui de la taxe dhabitation acquitter. LOFCE comparait ainsi, en 2001, les revenus tirs du RMI et les revenus tirs dun emploi rmunr au SMIC, avec les rsultats suivants :
Gains mensuels la reprise dactivit
(en francs) du RMI SMIC Clibataire sans enfant Couple 2 enfants, conjoint inactif Couple 2 enfants, conjoint rmunr au SMIC - 149 - 1.479 + 2.097 du RMI 1 SMIC + 1.782 + 779 + 4.088
Limpact conjugu de trois ans de rforme sur les trappes inactivit , Cyrille Hagner et Alain Trannoy, INSEE, conomie et Statistiques, n 346-347, 2001.
- 52 -
Lencouragement la reprise du travail, lorsquil existe, nest que temporaire Les effets financiers du mcanisme de lintressement ne dpassent gure en effet lhorizon de la deuxime anne. Au-del dun an, les taux marginaux dimposition deviennent franchement dissuasifs : ainsi, en reprenant un emploi temps plein au SMIC, reprsentant normalement un revenu annuel denviron 10.800 euros, lallocataire ne conserve 5.600 euros la premire anne et peine 3.400 la deuxime et au-del, soit un taux moyen dimposition de 69 %. Sil reprend un travail mi-temps, il perd de largent ds la deuxime anne, puisquen ne travaillant pas, son revenu disponible aurait t suprieur de 500 euros. Le dispositif encourage paradoxalement le mi-temps court terme A court terme (soit lhorizon dun an, durant le temps de lintressement), le taux moyen dimposition est plus faible pour le mi-temps que pour le plein temps (37,5 % contre 47 %). La tendance sinverse en revanche long terme, puisqu chance de deux et trois ans, le taux moyen dimposition stablit 103 % pour le mi-temps, quand il nest que de 69 % pour le plein temps. Cet tat de fait semble rsulter dun a priori selon lequel il serait trop difficile pour un allocataire du RMI de retrouver demble un travail temps plein et quil faudrait donc plutt lencourager, dans un premier temps, retrouver un travail temps partiel. c) Les rformes engages ont permis une rduction sensible des trappes inactivit A la suite des mouvements de chmeurs de lhiver 1997, le Gouvernement avait missionn Marie-Thrse Join-Lambert pour examiner la cohrence du systme franais dindemnisation du chmage et des minima sociaux. Son rapport, prsent en fvrier 1998 et suivi en 2000 dun rapport sur le mme sujet du Commissariat gnral du plan, a permis une premire prise de conscience de lexistence deffets de seuil et de trappes inactivit importantes, imposant aux bnficiaires de minima sociaux souhaitant retravailler des taux dimposition confiscatoires. Les pouvoirs publics ont alors engag, par petites touches, un toilettage du systme des minima sociaux et, plus largement, des aides aux travailleurs pauvres.
- 53 -
Les rformes engages depuis 2000 pour rduire les trappes inactivit La rforme de la taxe dhabitation Jusquen 2000, les titulaires du RMI bnficiaient dune exonration de la taxe dhabitation partir du moment o ils pouvaient justifier de leur statut de RMIste pour tout ou partie dune priode scoulant entre le 1er janvier de lanne fiscale de rfrence et la date de paiement de limpt. La loi de finances pour 2000 a prolong la priode pour laquelle cette exemption est valable, puisquil sagit dsormais de prouver sa qualit de RMIste un moment quelconque des deux dernires annes. Cet allongement de la priode de rfrence permet donc de lisser dans le temps les effets des variations de revenu des allocataires du RMI. Il est vrai que cette exemption automatique ne stend pas aux bnficiaires dautres minima sociaux. Cependant, le mcanisme de prise en compte des ressources dans le calcul de la taxe dhabitation a t revu, afin dtendre en pratique le bnfice des dgrvements ces derniers. La modification du barme des aides au logement Avant la rforme dcide en 2000, les revenus dactivit ntaient pas pris en compte pour lattribution et le calcul des aides au logement lorsque la personne percevait le RMI, ce qui lui permettait de continuer bnficier du droit une allocation logement taux plein. En revanche, lorsque celle-ci quittait le dispositif du RMI, ses revenus d'activit taient rintgrs dans le calcul des ressources et il sen suivait une rvision brutale de lallocation logement verse et, par consquent, une diminution du revenu disponible. La rforme des aides au logement, applique partir de 2001, prvoit dsormais une neutralit du barme dattribution par rapport lorigine des ressources. Ainsi, laide est maintenue un niveau constant jusqu un seuil de revenu, dactivit ou non, correspondant au montant du RMI de base puis elle dcrot rgulirement en vitant tout effet de seuil. La modification de la dcote et du barme de limpt sur le revenu Auparavant, la dcote avait pour effet de doubler le taux marginal de limpt sur le revenu en entre de barme. Maintenant, elle ne le multiplie plus que par 1,5 et lensemble des taux marginaux a galement fait lobjet dun ajustement la baisse. La cration de la prime pour lemploi Ce dispositif fiscal fonctionne comme un crdit dimpt en faveur des contribuables qui ont exerc une activit professionnelle dont la rmunration est comprise - pour un clibataire sans enfant - entre 0,3 et 1,4 SMIC temps plein. Il a deux objectifs : renforcer les incitations financires la reprise dactivit et distribuer du pouvoir dachat aux salaris bas revenus.
- 54 -
Lensemble des analyses conduites la suite de ces rformes converge pour montrer une nette diminution des phnomnes de trappes inactivit en France. LINSEE a chiffr, en 2002, les consquences de ces rformes pour les personnes qui reprennent un emploi1 : ainsi, un clibataire au RMI qui accde un emploi mi-temps au SMIC voit son revenu saccrotre de 72 euros par mois par rapport la situation avant rforme et ce revenu est dsormais suprieur de 64 euros celui un clibataire au RMI simple. Avant rforme, son revenu aurait en effet dcru. Pour un couple sans emploi avec deux enfants, le gain est de 226 euros par mois si lun des membres du foyer est embauch temps plein au SMIC. En labsence de toute rforme, son revenu se serait accru de moins de 120 euros. Dans le cadre des travaux de lObservatoire national de pauvret et de lexclusion sociale pour 2003-2004, la DREES a galement analys lvolution des carts de ressources entre RMI et bas salaires. Cette tude permet de confirmer labsence, dsormais, de situation de perte financire pour les bnficiaires du RMI qui reprennent un emploi, et ce quelle que soit la configuration familiale. Il convient toutefois de souligner que lamlioration ne sest pas effectue dans les mmes proportions dans tous les cas de figure et que sil ny a plus proprement parler de dsincitation financire au travail, les carts restent parfois trs faible, surtout si on tient compte des frais lis la reprise dactivit (transport, habillement, garde denfants).
volution entre 1989 et 2003 de lcart de ressources entre RMIstes et bas salaires
cart en 1989 Personnes seules Parents isols avec 2 enfants Couples avec 2 enfants Couples avec 4 enfants
Calculs : INSEE Note de lecture : en 1989, les couples avec quatre enfants et un seul actif rmunr temps plein au SMIC disposaient dun revenu suprieur de 34 % celui des mmes couples sans revenu dactivit. Source : rapport 2003-2004 de lObservatoire national de la pauvret et de lexclusion sociale.
cart en 1993 -1% + 50 % +7% + 45 % -2% + 13 % -1% + 25 %
cart en 2003 +10 % + 53 % +11 % + 36 % +3% + 15 % +2% + 18 %
0,5 SMIC 1 SMIC 0,5 SMIC 1 SMIC 0,5 SMIC 1 SMIC 0,5 SMIC 1 SMIC
- 32 % + 41 % +8% + 49 % -3% + 14 % +5% + 34 %
INSEE, LEconomie franaise, dition 2002-2003.
- 55 -
Une tude de lINSEE, montre que les rformes conduites depuis 2000 en matire de lutte contre les trappes inactivit ont fait voluer de manire sensible les caractristiques de notre systme socialo-fiscal : - le revenu disponible est maintenant une fonction croissante de la dure du travail, quelle que soit lallocation considre (RMI, API ou ASS), mme sil reste quelques situations de seuil pour des dures dactivit en de du mi-temps dans le cadre du systme de lintressement ; - les phnomnes de trappes ont disparu court terme et les taux marginaux dimposition ont rgress plus long terme : lhorizon dun an, les taux ne dpassent jamais 25 % (contre 47 % auparavant). Concernant la deuxime anne, leffort de correction est galement impressionnant : 69 % mi-temps et 45 % temps plein (contre respectivement 103 % et 69 % auparavant).
- 56 -
volution du revenu disponible dun bnficiaire du RMI avant et aprs rformes
Source : Limpact conjugu de trois ans de rforme sur les trappes inactivit , Cyrille Hagner et Alain Trannoy, Economie et Statistique, n 346-347, 2001
- 57 -
Au total, les rformes ont permis un lissage et une augmentation trs substantielle des incitations reprendre un emploi, incitations qui sont dautant plus fortes que lon progresse vers le plein temps. Il convient de souligner le rle primordial de la rforme des allocations logement dans cette correction des trappes inactivit : ces aides correspondent au minimum au tiers du gain de pouvoir dachat enregistr par les bnficiaires. en ce qui concerne plus particulirement la prime pour lemploi, lOFCE1 note quelle nintroduit aucun bonus la reprise d'activit temps trs partiel, puisquil faut travailler un tiers de lanne au SMIC horaire pour en bnficier et quelle nentrane une augmentation du revenu disponible que si l'individu travaille plus de cinquante et une heures par mois. Cet instrument savre donc assez faiblement cibl sur les travailleurs les plus modestes, car ceux-ci connaissent frquemment des parcours demploi marqus par le temps partiel ou discontinu tout au long de lanne : ainsi, 14 % seulement de la masse verse au titre de la PPE revient aux mnages du premier dcile, contre 16 % en moyenne pour les deuxime et troisime dciles. Sa distribution annuelle minore galement ses effets incitatifs la reprise dactivit car un tel mcanisme semble ne pas convenir des mnages trs modestes qui ne parviennent pas raisonner avec un budget annuel. Deux lments viennent toutefois nuancer ce constat : une premire rforme de la PPE en 2003, en introduisant une majoration de la prime en faveur des temps partiels a en partie permis un meilleurs ciblage sur les plus modestes. Sur le plan des trajectoires individuelles, le bnfice de la PPE prend le relais du RMI et des allocations logements, ce qui permet dviter des effets de seuil brutaux dans le profil des revenus. d) Des situations de pertes de revenus demeurent pour les emplois temps trs partiel Si la situation sest nettement amliore pour toutes les configurations demploi partir du mi-temps, force est de constater que des phnomnes de dsincitation financire subsistent pour les personnes qui reprennent une activit temps trs partiel. Une tude de la direction de la scurit sociale, pour 2004, ralise la demande de la commission Familles, vulnrabilit, pauvret , prside par Martin Hirsch, montre ainsi quune reprise dactivit quart temps au SMIC nengendre que de trs faibles gains nets, jamais suprieurs 150 euros par mois pendant lintressement et que ces gains sannulent le plus souvent une fois la priode dintressement termine. Il parat vident que ces montants sont insuffisants pour couvrir les frais associs toute reprise
1
Un bilan des tudes sur la prime pour lemploi , Elena Stancanelli et Henri Sterdyniak, Revue de lOFCE, janvier 2004.
- 58 -
dactivit. Par ailleurs, compte tenu dun seuil de perception fix 0,3 SMIC, la prime pour lemploi ne joue pas ou seulement trs marginalement pour une aussi faible dure du travail. Mme mi-temps, les gains restent encore faibles, de lordre de 100 et 200 euros par mois pendant la priode dintressement et 20 50 euros lissue de cette priode. Ramens un niveau mensuel, les montants de PPE perus sont toujours trs peu significatifs, se situant entre 20 et 30 euros. 2. Des rformes encore contrecarres par labsence de prise en compte des transferts sociaux locaux Sil est incontestable que les rformes entreprises depuis 2000 ont permis de rduire significativement les dsincitations financires la reprise dactivit, les gains montaires du retour lemploi pour les bnficiaires de minima sociaux mesurs par lensemble des analyses prcites demeurent imprcis, dans la mesure o il nest jamais tenu compte des consquences de la reprise dactivit en matire de transferts sociaux locaux. A ce jour, une seule tude aborde la question de limpact des transferts sociaux locaux sur le retour lemploi1. Il convient dailleurs de souligner quelle ne sappuie pas sur la notion de gains montaires lemploi mais sur celle de dure de rservation , cest dire la dure de travail minimale, sur la base du SMIC horaire, pour que lemploi apporte un gain montaire celui qui loccupe par rapport aux ressources dont il bnficierait en tant quinactif. Selon cette approche, les transferts nationaux entranent, pour un couple bnficiaire du RMI avec deux enfants, une dure de rservation de 26 h 30. Dune faon gnrale, pour compenser la perte de transferts nationaux, un travail mi-temps nest suffisant que pour les seuls clibataires, la dure de rservation restant toutefois infrieure au temps complet pour toutes les autres configurations familiales. Si lon ajoute aux transferts nationaux lensemble des aides locales, la dure de rservation est sensiblement allonge : elle devient suprieure au mitemps pour tous et elle est mme suprieure au temps complet pour tous les mnages avec enfants. Au total, sur la base dun emploi rmunr au SMIC, il est ncessaire de travailler en moyenne treize heures de plus par semaine pour compenser la perte des aides locales lies la sortie du minimum social.
Transferts sociaux locaux et retour lemploi , Denis Anne et Yannick LHorty, conomie et Statistique n 357-358, 2002.
- 59 -
Dure de rservation, en fonction de la configuration familiale
Source : Denis Anne et Yannick LHorty, conomie et Statistique, article prcit
Il convient de prciser que la gnrosit des prestations locales nest pas ncessairement la cause de cet effet dsincitatif lemploi : sil sagit de prestations uniformes et sans condition de ressources, elles nont aucun impact sur la dure de rservation, quand bien mme elles seraient dun montant trs important. Cest donc plus leurs conditions dattribution que leur gnrosit qui sont en cause. En effet, bien quelles ne reprsentent, en moyenne, que 26,4 % des transferts nationaux pour les mnages sans revenu dactivit, elles conduisent une hausse de 53 % de la dure de rservation : elles ont ainsi deux fois plus deffets sur la dure de rservation que sur le montant des transferts perus. Les rsultats de cette tude unique en son genre doivent toutefois tre nuancs : tablissant un recensement de lensemble des aides locales ouvertes aux bnficiaires de minima sociaux, elle semble supposer que chaque demandeur peut cumuler lensemble des aides disponibles. Sagissant de prestations facultatives dactions sociales et non dallocations daide sociale constituant un droit, il est permis den douter. Il serait en fait utile de complter cette analyse par une mesure de la frquence de la distribution effective des diffrentes aides, ainsi que par une tude des cas de non-recours.
- 60 -
3. Les limites de la thorie des trappes Mettre en vidence des phnomnes de dsincitation financire ne vaut cependant pas prvision du comportement des personnes concernes. Dautres lments quun calcul financier interviennent dans la dcision doccuper un emploi (recherche de lien social, meilleure estime de soi). En tmoigne cette enqute ralise en 1998 par le ministre de lemploi et de la solidarit qui rvle quun tiers des titulaires du RMI ayant retrouv un emploi dans lanne affirment ny avoir rien gagn financirement. Par ailleurs, pour effectuer un arbitrage rellement rationnel entre emploi et inactivit, il faudrait que les intresss bnficient dune information complte, ce qui est loin dtre le cas, compte tenu de la complexit des dispositifs. Au-del de la dcision de reprendre ou non une activit professionnelle, il convient galement de sattacher aux possibilits des bnficiaires de retrouver un emploi. La dure de lloignement du march de lemploi, le niveau de qualification, les diffrents handicaps sociaux auxquels les allocataires sont susceptibles dtre confronts sont en effet des facteurs au moins aussi dterminants que la question de lincitation financire. Enfin, cette approche par loffre de travail ne tient pas compte de la demande de travail adresse par les entreprises et donc de limportance dun chmage involontaire, lie la faiblesse de la conjoncture conomique. En effet, si le chmage rsulte dune insuffisance de la demande de travail, la question des trappes est de second ordre. Dans une conomie fort taux de chmage, inciter la reprise dactivit peut avoir des effets relativement limits sur le taux demploi agrg et entraner essentiellement une modification des positions relatives dans les files dattentes . Au total, si lon peut conclure que lexistence de trappes constitue un frein la reprise demploi au niveau individuel, il nest pas formellement prouv, ce jour, que la leve de ces contraintes a un effet significatif sur lemploi global. En ralit, lever les trappes inactivit est davantage une question de justice et dquit vis vis des salaris modestes quune question dincitation la reprise dune activit.
- 61 -
III. UNE AMLIORATION DU DISPOSITIF DES MINIMA SOCIAUX NCESSAIRE ET RALISABLE
A. RENFORCER LA CONNAISSANCE DU PHNOMNE
Sil est un constat effectu par votre rapporteur loccasion des recherches et des auditions menes pour la prparation de ce rapport, cest bien la pauvret des connaissances sur le sujet des minima sociaux ou, plus prcisment, labsence totale de connaissances coordonnes. Or, compte tenu de la complexit de notre systme de protection sociale, une telle connaissance est indispensable : le dispositif des minima sociaux sapparente en effet un vritable jeu de dominos o toucher une prestation peut avoir des consquences importantes, aussi bien pour la cohrence de celle-ci par rapport aux autres minima et pour son insertion dans le systme global des prestations sociales de droit commun . Il parat donc indispensable de disposer dun panorama, rgulirement mis jour, qui permette aux pouvoirs publics - et tout particulirement au Parlement lorsquil examine des projets de rforme - de ne pas naviguer vue mais, au contraire, de pouvoir aborder la rforme de ces prestations sans provoquer des dsquilibres majeurs ou des iniquits. Cest la raison pour laquelle la premire recommandation de votre rapporteur sattache lamlioration de la connaissance des minima sociaux et au maintien, dans le temps, du niveau de cette connaissance. 1. Disposer dun vritable recensement des minima sociaux et de leurs droits connexes a) Disposer dtudes transversales Si linformation permettant de dcrire les grandes caractristiques de la situation des bnficiaires de minima sociaux nest pas nulle, force est de reconnatre que de nombreux progrs restent faire pour aller plus loin dans lobservation et lanalyse. Il est tout dabord frappant de constater qu lheure actuelle, quel que soit le domaine envisag (effets de seuil, trappes inactivit, trappes pauvret...), il nexiste aucune tude intgrant lensemble des neuf minima sociaux. Lexamen des tudes ralises par les diffrents services statistiques, comme celui des articles publis par les instituts de recherche ou les
- 62 -
organismes de prospective de ltat, montre en effet une abondance danalyses concernant le RMI, ce qui donne limpression que le dispositif franais des minima sociaux se limite cette seule prestation. En ce qui concerne les autres minima, on dispose uniquement de quelques tudes sur lASS ou lAPI, alors que certaines allocations sont entirement ignores : cest le cas de lallocation dinsertion, de lallocation veuvage, du minimum vieillesse ou encore du minimum invalidit. Dans dautres cas, des pans entiers danalyse sont sous tudis : notamment, la question du retour lemploi des bnficiaires de lAAH ou du minimum invalidit est totalement passe sous silence, les organismes de recherche classant dfinitivement les bnficiaires de ces allocations dans la catgorie des inactifs1. Linformation concernant les neuf minima sociaux dpend, ce jour, dune multitude de directions, voire de ministres diffrents : - au sein des administrations centrales, la direction gnrale des affaires sociales (DGAS) est uniquement responsable du RMI, de lAPI et de lAAH, les prestations dlivres aux chmeurs en fin de droits (ASS, AER et allocation dinsertion) relevant de la direction gnrale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DGTEFP). La direction de la scurit sociale (DSS) soccupe, pour sa part, des prestations de solidarit du rgime gnral de scurit sociale (allocation veuvage, minimum vieillesse et minimum invalidit) ; - au-del du rle gnral de collecte dvolu lINSEE, lexploitation statistique des informations concernant les minima sociaux relvent dau moins deux directions diffrentes, la direction de la recherche, des tudes, de lvaluation et des statistiques (DREES) et la direction de lanimation, de la recherche, des tudes et des statistiques (DARES). Des travaux ont galement t mens la direction de la prvision, concernant les effets de seuils crs par le systme de minima sociaux ; - les droits connexes aux minima sociaux relvent de ministres extrieurs aux deux ministres sociaux : tel est notamment le cas pour les aides au logement qui sont sous la responsabilit du ministre du logement ou encore de la prime pour lemploi qui est administre par le ministre des finances. Votre rapporteur a t stupfaite par le manque de coordination entre ces diffrents services et par les dfaillances de la circulation de linformation entre eux. Ltablissement du prsent rapport a rendu ncessaire la
1
Voir par exemple ltude de la DREES sur les trajectoires professionnelles des bnficiaires de minima sociaux (tudes et Rsultats, n 320, juin 2004), qui carte doffice les bnficiaires de lAAH de son champ dinvestigation, en arguant des caractristiques trs particulires de leur situation vis vis de lemploi.
- 63 -
reconstitution du panorama des minima sociaux travers des informations fragmentaires, issues dchantillons statistiques htrognes et datant de diffrentes annes et de calculs tablis selon des modles aux hypothses variables. Or, le Parlement na pas, en lui mme, les moyens dune direction oprationnelle ou dune direction statistique. Il na dailleurs pas vocation se substituer ladministration pour la ralisation de ce simple travail de collecte et de mise en forme de linformation. Votre rapporteur estime donc quil est indispensable de dsigner une direction unique pour le pilotage du systme dinformation sur les minima sociaux. Cela ne signifie pas ncessairement de confier celle-ci la responsabilit des politiques elles-mmes, mais de lui confier simplement celle dassurer la coordination de linformation, lgislative, rglementaire et statistique en la matire. Le caractre dispers de linformation sur les minima sociaux explique galement le fait quaucune diffusion des donnes denqute et des rsultats dtudes et de recherches ne soit rellement possible. On constate galement que peu dtudes externes sont commandites par les pouvoirs publics des quipes de recherche. La mission de la direction pilote du systme dinformation sur les minima sociaux devrait donc stendre lanimation de la recherche sur ces prestations. Elle devrait sattacher amliorer la diffusion des tudes existantes et des bonnes pratiques et faire merger de nouveaux thmes de recherche, en ayant lesprit larticulation entre analyse statistique et analyse sociologique, qui reste encore insuffisante ce jour en France. Enfin, il semble ncessaire de rviser lappareil statistique lui-mme : le bon sens voudrait en effet que les chantillons statistiques mis disposition des chercheurs permettent didentifier les bnficiaires de lensemble des minima et que les modles de calcul utiliss par les directions statistiques comprennent des informations sur ces mmes minima, et non pas - comme cest le cas aujourdhui - sur le seul RMI. En effet, les enqutes gnrales auprs des mnages, comme lenqute Emploi, reprent insuffisamment la population des allocataires qui chappe dailleurs en partie au champ mme des enqutes statistiques auprs des mnages, celles-ci ne portant que sur les mnages habitant dans des logements ordinaires. De ce point de vue, votre rapporteur rejoint lanalyse de la commission prside par Martin Hirsch, selon laquelle ces sujets pourraient tre approfondis par le Conseil national de linformation statistique (CNIS), afin de donner lieu des propositions plus structures.
- 64 -
b) Amliorer les moyens dtude des trajectoires des bnficiaires de minima sociaux Lanalyse du dispositif des minima sociaux met en lumire le caractre indispensable dune tude et dun suivi des effets de seuil et des phnomnes de dsincitation la reprise dactivit. Or, ce type dtude ncessite de pouvoir suivre les mmes personnes pendant plusieurs annes, pour analyser leurs trajectoires. Pourtant, aujourdhui, les chantillons statistiques raliss par les diffrentes directions statistiques et mises la disposition des chercheurs sont totalement dconnects dune anne sur lautre : il sagit en effet dchantillons mis en place pour la ralisation denqutes annuelles. De ce fait, les donnes recueillies ne sont pas entirement comparables dune anne sur lautre et elles ne sont, dans tous les cas, pas exploitables pour assurer une tude des parcours individuels. Les seules enqutes de trajectoires disponibles sappuient donc sur des chantillons trs ponctuels : on peut ainsi citer lenqute sortie du RMI ralise par lINSEE sur un chantillon dallocataires dfini en dcembre 1996 et uniquement suivie de deux tapes en janvier et septembre 19981 ou encore ltude sur la trajectoire des bnficiaires de minima sociaux tablie par la DREES en 20042, sur la base du fichier tenu par la CNAF des allocataires de RMI au 1er janvier 2001. Au total, la faiblesse des observations longitudinales cre une zone dombre sur les consquences des politiques dincitation la reprise dactivit et sur les trajectoires de leurs bnficiaires. Pour y remdier, il parat ncessaire de demander lINSEE de travailler la constitution de panels, sur le modle du panel europen des mnages3, permettant de suivre des groupes dindividus dune anne sur lautre. A lheure actuelle, en effet, seul ce panel europen est susceptible dapporter des lments concernant lvolution du pouvoir dachat des mnages pauvres, mais sur une priode dobservation qui reste assez courte (sept ans) et avec une relative imprcision lie la fois au phnomne dattrition (perte progressive dindividus suivis dans le panel) et au fait que les revenus suivis sont ceux dclars par les mnages, ce qui conduit parfois des variations aberrantes dune anne lautre. Daprs les informations recueillies par votre rapporteur, lINSEE travaillerait sur la constitution dun nouveau panel, coordonn au niveau europen, qui inclurait cette fois une enqute sur les prestations locales
INSEE, conomie et Statistiques, n 2001 6/7. DREES, tudes et Rsultats, n 320, juin 2004. 3 Le panel europen de mnages, cr par linstitut europen Eurostat, a permis de suivre un chantillon de mnages de 1994 2001.
2 1
- 65 -
perues par les mnages interrogs. Votre rapporteur ne peut quencourager lINSEE poursuivre dans cette voie, tout en insistant sur la ncessit dengager une dmarche identique au niveau national. Il parat notamment indispensable damliorer lexploitation des fichiers tenus par la CNAF et de lui donner enfin - dans des conditions satisfaisantes de respect de la vie prive - une dimension historique, de faon pouvoir analyser les ventuels allers-retours des bnficiaires au sein des dispositifs de minima sociaux. A cet effet, un dialogue avec la CNIL doit imprativement tre nou, pour lever les obstacles jusquici soulevs par cet organisme la constitution dun fichier permettant le suivi dans le temps des allocataires du RMI. 2. Un impratif de remonte dinformations des collectivits locales dans le cadre de la dcentralisation a) Disposer dun panorama fiable des aides locales en faveur des personnes en difficult sociale Mme si ses rsultats mritent dtre nuancs, lunique tude actuellement disponible en matire dimpact des aides locales sur le niveau de vie des bnficiaires de minima sociaux montre limportance dun recensement des transferts sociaux locaux et de leur prise en compte pour dterminer lexistence deffets de seuil ou de dsincitation financire la reprise dactivit. Il est vident quun tel recensement ne saurait tre exhaustif, compte tenu notamment de la place de laction sociale communale dans le domaine de laide aux mnages les plus pauvres. Lanalyse de ces transferts locaux ne peut donc reposer que sur un chantillonnage des aides. Il est ds lors indispensable de travailler sur la reprsentativit de cet chantillon, afin de tenir compte de la multiplicit des collectivits concernes et de la diversit des politiques menes1. Une meilleure analyse des transferts locaux ncessite galement un travail de mthode sur la valorisation des aides, notamment quand celles-ci sont en nature ou ne reposent pas sur un barme explicite. Votre rapporteur estime quil revient la DREES de dvelopper ce type dtudes, avec lappui des enqutes de lINSEE. Un partenariat pourrait galement tre nou avec lobservatoire de laction sociale dcentralise (ODAS) qui suit dj annuellement les dpenses daction sociale dpartementales.
A ce titre, il convient de rappeler que ltude de D. Anne et Y. LHorty prcite sur les transferts sociaux locaux reposait sur une enqute mene dans dix villes seulement.
1
- 66 -
Il convient dailleurs de souligner que ce champ dtude nest pas entirement neuf pour la DREES : en tmoignent les tudes ralises ces dernires annes sur laide sociale extralgale des dpartements et des communes. Il serait simplement ncessaire daffiner les enqutes existantes, en les compltant par un volet consacr aux rgles dattribution des diffrentes aides, aux possibilits de cumul de celles-ci et aux sommes verses en moyenne chaque bnficiaire. b) Un pralable : la constitution dun vritable systme dinformation partag entre ltat et les collectivits locales Dans le contexte de la relance de la dcentralisation, qui consacre notamment - travers la responsabilit qui leur est confie au titre du RMI - le rle des dpartements en matire daide sociale, la mise en place des outils de suivi et de diagnostic partags entre ltat et les collectivits locales savre de plus en plus indispensable. Il devient en effet impratif pour le lgislateur, au moment daborder toute rforme touchant au domaine de laide sociale, de pouvoir tenir compte de limpact de ses dcisions sur des politiques locales ncessairement diverses. Si la mise en place du RMI navait pas conduit, lorigine, la cration dun dispositif statistique spcifique, la loi du 18 dcembre 2003 portant dcentralisation en matire de RMI et crant un revenu minimum dactivit (RMA) a, semble-t-il, rpar cette omission : - les prsidents de conseils gnraux doivent dsormais transmettre aux prfets des informations statistiques agrges, dans les domaines comptables mais aussi sur les caractristiques des demandeurs et les entres et sorties du dispositif ; - de la mme manire, la CNAF et la MSA sont tenues de transmettre les informations de mme nature leur disposition au ministre charg des affaires sociales ; - la transmission aux services statistiques du ministre des affaires sociales de donnes rendues anonymes relatives aux personnes physiques bnficiaires du RMI est galement prvue, afin de constituer - dans le respect des rgles relatives la vie prive - des chantillons statistiques permettant des analyses plus fines et des tudes sur les trajectoires des allocataires ; - en contrepartie de ces contraintes dinformation imposes aux dpartements, ltat a dsormais lobligation de diffuser en retour les analyses et les tudes ralises sur la base des donnes statistiques collectes. Il reste que le dispositif ainsi prvu nest applicable quau RMI qui relve de laide sociale lgale. Il parat donc indispensable de mettre en place un systme dinformation partag plus large, incluant notamment les transferts
- 67 -
sociaux facultatifs. Il pourrait revenir aux dpartements dassurer la collecte des informations ncessaires auprs des communes et des intercommunalits et dassurer la transmission de celles-ci au niveau national. A ce titre, votre rapporteur considre que la France gagnerait sinspirer du dispositif statistique mis en place aux tats-unis loccasion du transfert de laide sociale aux tats fdrs.
Lobligation de reporting des tats fdrs dans le cadre de la loi PRWORA aux tats-unis La loi du 22 aot 1996, intitule Personal Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA), qui transfre aux tats amricains fdrs la responsabilit de lensemble de laide sociale, tablit leur gard une obligation de reporting trs forte avec des sanctions financires. Paralllement, la loi dfinit un budget pour le dveloppement dtudes dvaluation menes, la fois au niveau fdral et au niveau des tats, sur des aspects trs dtaills concernant les impacts de la rforme. Certains de ces rapports dvaluation sont obligatoires et peuvent conduire ce que les tats soient amens modifier leurs programmes (par exemple si le taux de pauvret des enfants saccrot). Par ailleurs, la loi PRWORA prvoit une obligation pour linstitut fdral de statistiques, le Census Bureau, de dvelopper un dispositif denqute permettant de suivre le devenir des allocataires et dtermine son financement. La loi elle-mme dtermine les diffrents types dinformation ncessaires aux valuations. Elle prvoit ainsi : - une information descriptive sur les programmes locaux daide, issue du reporting par les tats : pour lexploitation de ces donnes, deux projets importants ont t mis en place, avec des financements mixtes provenant du dpartement dtat la sant et de fondations prives ; - la constitution de panels longitudinaux, les survey of income and program participation, permettant de suivre les personnes sur deux ans et demi quatre ans, et les survey of program dynamics, dune dure plus longue. La grande majorit des donnes denqutes est mise la disposition de lensemble des utilisateurs - le plus souvent gratuitement - et en ligne, quil sagisse denqutes instantanes ou de panels longitudinaux et quils soient raliss par des organismes publics ou privs.
Source : Processus de dveloppement de politiques publiques : les enseignements de la rforme du Welfare amricain , Michel Doll, Les Papiers du CERC, n 2002-2.
- 68 -
3. Une ncessit : assurer la mise jour rgulire des donnes disponibles Dans le contexte de croissance conomique des annes 1997 2000, la dcrue du chmage est vite apparue nettement moins dynamique que ne le laissait esprer la vigueur de la reprise de lactivit. Force tait notamment de constater quelle ne permettait pas de mordre sur le noyau dur du chmage de longue dure et quelle ne concernait que marginalement les bnficiaires de minima sociaux. Cest la lumire de ce constat quune rflexion sur la question des trappes inactivit et, plus largement, de larticulation des minima sociaux avec des revenus dactivit a vu le jour. De nombreux rapports, tmoignant non seulement de lintrt des conomistes pour cette question mais aussi de la prise de conscience des pouvoirs publics, ont t publis au cours de cette priode : on citera notamment un premier rapport du CERC en 19971, suivi dun rapport de Marie-Thrse Join-Lambert en 19982, puis dun rapport du commissariat gnral du plan en 20003 et enfin un second rapport du CERC en 20014. Ces diffrents rapports ont permis de dresser un bilan trs complet de la situation des minima sociaux et de leur insertion dans notre systme socialo-fiscal : il convient notamment de souligner lapport du rapport du commissariat du plan qui, le premier, a tent de recenser lensemble des droits connexes attachs aux diffrents minima sociaux et de lister les effets de seuil rsultant de leurs incohrences. Depuis cette poque, de multiples rformes sont intervenues, toutes sous-tendues par une volont plus ou moins explicite de rduction des dsincitations financires la reprise dactivit ou, plus largement, de rduction des effets de seuil et autres effets pervers lis linsertion des minima sociaux dans notre systme global de protection sociale. Or, aucune mise jour des constats dresss par les diffrents rapports de la priode 1998-2000 na t effectue au fur et mesure de leur entre en vigueur, si bien que lensemble des donnes et des tudes ralises lpoque sont aujourdhui primes. La simple actualisation de ces donnes, quil sagisse du cadre juridique ou des statistiques, et la compilation des tudes dimpact ralises, de faon alatoire, pour chaque rforme, reprsente un travail considrable, dune grande mticulosit. Cest quoi sest
Minima sociaux, entre protection et insertion CERC, 1997, La Documentation franaise. Chmage : mesures durgence et minima sociaux. Problmes soulevs par les mouvements de chmeurs en France fin 1997 - dbut 1998 , Marie-Thrse Join-Lambert, 1998, La Documentation franaise. 3 Minima sociaux, revenus dactivit prcarit , rapport de Jean-Michel Belorgey pour le commissariat gnral du plan, mai 2000. 4 Accs lemploi et protection sociale , CERC, 2001, La Documentation franaise.
2 1
- 69 -
modestement attach le prsent rapport, avec les moyens limits dont dispose le Parlement, notamment du point de vue de la statistique. Votre rapporteur ne peut donc que regretter quaucune instance nait jamais t charge de ce travail de simple maintenance . Lors de son audition par votre rapporteur, le commissariat gnral du plan a reconnu que ce rle pourrait relever de sa comptence, condition quune demande explicite lui soit adresse par le Premier ministre. Votre rapporteur engage le Gouvernement suivre cette voie, qui ne semble pas incompatible avec la mission de prospective de l tat stratge dsormais dvolue cette instance.
B. AMLIORER LA COHRENCE INTERNE DU SYSTME DES MINIMA SOCIAUX
1. Des marges de progrs exploitables court terme a) Mettre fin aux effets pervers de calendrier Le calendrier de versement des diffrentes prestations et les diffrences de priode de rfrence en matire de ressources peuvent perturber, de manire importante, lchancier des revenus des bnficiaires de minima sociaux, avec des effets parfois dramatiques pour des budgets aussi restreints. Votre rapporteur estime quil est important dattnuer, voire, dans toute la mesure du possible, de mettre fin ces effets pervers, difficult qui lui parat relativement simple rsoudre car elle ne demande pas un bouleversement du dispositif densemble des minima sociaux. Plusieurs pistes peuvent tre explores pour lisser dans le temps la chronologie des revenus des bnficiaires de minima sociaux : y Prvoir la possibilit davances sur droits supposs Pour viter les priodes de carence dans le versement des prestations, il est possible de dvelopper la pratique des avances sur droits supposs. A lheure actuelle, un tel dispositif nexiste que pour lAAH et uniquement dans le cas du renouvellement de lallocation. Autoriser de telles avances suppose, il est vrai, de faire confiance lallocataire et de mettre en place un contrle a posteriori efficace de ses dclarations. Votre rapporteur remarque toutefois que le systme actuel est
- 70 -
dj largement dclaratif et que la rforme quelle propose ne fait quaccentuer cet aspect. La principale objection souleve par le dveloppement des avances sur droits supposs reste le risque accru dindus pour les organismes chargs du versement de lallocation. Encore une fois, votre rapporteur souligne que ce risque nest pas nouveau : malgr un dispositif de droits rels, les indus sont aujourdhui frquents. Mais leur rcupration est difficilement tolrable quand les organismes chargs du versement sont censs avoir eu le temps de vrifier les dclarations des demandeurs. Dans le cadre davances sur droits supposs, cette rcupration serait en ralit davantage acceptable, puisquelle est la contrepartie dun systme plus ractif face aux besoins des demandeurs. Votre rapporteur estime donc que la question des indus ne doit pas faire obstacle au dveloppement de cette pratique. y Permettre la neutralisation des ressources devenues inexistantes Le mcanisme de la priode de rfrence, ncessaire pour apprcier la les ressources du demandeur, comporte un effet pervers en cas de changement de situation important : ainsi, le fait davoir travaill, mme une courte priode, se rvle pnalisant pour lallocataire, si au terme de son contrat, les revenus de son travail continuent dtre pris en compte pour le calcul de son allocation. Certaines allocations, comme lASS, lAER ou lallocation dinsertion, prvoient dj un mcanisme de neutralisation des ressources perues pendant la priode de rfrence dont il est prouv que le versement est dfinitivement interrompu. Votre rapporteur considre que ce mcanisme pourrait utilement tre tendu lensemble des minima sociaux. Dans lattente dune telle rforme, il convient de rappeler que la neutralisation est possible aujourdhui, dans le cadre du RMI, sur dcision des prsidents de conseils gnraux. Si ces dcisions sont en gnral prises au cas par cas, les dpartements ont toujours la possibilit, sur la base de leur rglement daide sociale, de prvoir des rgles plus favorables que celles prvues au niveau national et donc de donner un caractre systmatique ces dcisions de neutralisation. y Assurer la cohrence des dlais de prise en compte des changements de situation des bnficiaires Malgr la rforme des allocations logement entreprise en 2000 et 2001, il subsiste une disposition qui pnalise les bnficiaires de minima sociaux qui reprennent une activit professionnelle : laugmentation des revenus provoque par le retour lactivit est intgre en temps rel par les caisses dallocations familiales pour le calcul de lallocation logement, alors
- 71 -
quen cas de cessation dactivit, le demandeur devra patienter jusqu la rvision annuelle de lallocation, au 1er juillet, pour voir sa nouvelle situation prise en compte et son allocation majore. Votre rapporteur propose donc dassurer une symtrie dans les dlais de prise en compte des changements de situation, ce qui suppose, dans ce cas prcis, de tenir compte galement en temps rel des cessations dactivit, afin que la reprise dun emploi, mme de courte dure, ne pnalise pas indment les allocataires. En revanche, votre rapporteur estime quune adaptation systmatique en temps rel de lensemble des minima sociaux nest pas forcment souhaitable. Deux raisons la conduisent en effet une attitude rserve cet gard : - dabord, les effets de calendrier jouent parfois galement en faveur des intresss : ainsi, le mcanisme de la dclaration trimestrielle prolonge, dans les faits, dun trimestre le cumul intgral avec un revenu dactivit prvu dans le cadre du dispositif de lintressement ; - ensuite, ladaptation des prestations en temps rel prsente des inconvnients et pourrait se retourner contre les bnficiaires eux-mmes : pour quune telle adaptation soit ralisable, il faudrait en effet que la remonte de linformation se fasse galement en temps rel, ce qui est impossible notamment parce que les bnficiaires ne renvoient pas en temps rel leur dclaration de ressources. b) Poursuivre la coordination entre les droits connexes Plus qu un alignement des montants des minima sociaux entre eux, votre rapporteur est attache la cohrence des droits connexes ouverts chacun deux, estimant que ces derniers doivent correspondre un niveau de ressources donn et non un statut. De ce point de vue, le systme des minima sociaux est encore largement perfectible. Parmi les aides nationales, deux dispositifs mritent dtre amends : - le rgime dexonration de la redevance audiovisuelle pourrait tout dabord tre align sur celui prvu pour la taxe dhabitation : comme pour celle-ci, un mcanisme de condition de ressources pourrait complter lexonration automatique lie la perception de telle ou telle prestation, afin de neutraliser les effets pervers lis cette rfrence aux statuts. Une telle rforme permettrait, en pratique, douvrir lexonration aux titulaires de lAPI et de lASS.
- 72 -
Votre rapporteur plaide dailleurs pour un barme align sur celui de la taxe dhabitation : dans la mesure o la loi de finances pour 2005 a clairement pris le parti dun adossement du recouvrement de la redevance sur celui de la taxe dhabitation, cet alignement des barmes irait dans le sens dune simplification tant pour les bnficiaires que pour les services gestionnaires ; - la tarification sociale du tlphone pourrait galement prendre modle sur le dispositif prvu pour laccs llectricit : ceci conduirait abandonner la rfrence un statut pour passer une simple condition de ressources. Dune faon gnrale, votre rapporteur est favorable au versement de droits connexes sous condition de ressources et non sous condition de statut, car ce genre de critre assure une plus grande neutralit vis vis de lorigine des revenus et ne pnalise donc pas indment les travailleurs les plus modestes. Mais elle met en garde contre des critres de ressources qui fonctionneraient comme des couperets , car ce type de mcanisme est finalement autant source deffets de seuil que les aides lies au statut. Il lui semble donc prfrable de prvoir, autant que possible, des aides fondes sur un barme dgressif en fonction du revenu, sur le modle mis en place pour les allocations logement ou pour la taxe dhabitation. Parmi les aides lies au statut, votre rapporteur souhaite toutefois prvoir une exception relative au bnfice de la CMU complmentaire. Il lui semblerait en effet quitable dtendre, sur le modle prvu pour les allocataires du RMI, le bnfice automatique de la couverture complmentaire aux titulaires de lAPI et de lASS : en effet, du fait du plafond de ressources applicable, ces derniers sont exclus du bnfice de la couverture complmentaire gratuite lorsquils sont en situation dintressement, alors que lallocataire du RMI, protg par son statut, continue den bnficier, mme si ses ressources dpassent le plafond. Votre rapporteur considre quil est paradoxal de les priver de cette protection pendant cette priode dlicate de transition et de rinsertion professionnelle. Il lui semble prfrable de maintenir le bnfice de la CMU complmentaire durant lintressement et de les faire basculer vers le dispositif fiscal daide lacquisition dune complmentaire sant quand linsertion professionnelle savre rellement durable.
- 73 -
2. Promouvoir les bonnes pratiques des collectivits locales en matire de transferts sociaux locaux Mme si leur impact en termes de niveau de vie est encore difficile apprhender du fait du manque dtudes conomtriques ce sujet, il est vident que les effets de seuil provoqus par les aides sociales locales constituent des obstacles importants la reprise dactivit et sont une source diniquit entre bnficiaires de minima sociaux et salaris trs faible niveau de vie. Les collectivits territoriales ont donc une responsabilit dans la cohrence du dispositif daide en faveur des personnes en difficult sociale. Tout en gardant une totale libert pour ce qui concerne le niveau et la nature des aides quelles attribuent, conformment dailleurs au principe de libre administration prvu par la Constitution, elles doivent tre conscientes des effets pervers potentiels des secours quelles distribuent et sassurer de la bonne insertion de ceux-ci dans lensemble du dispositif de transferts sociaux en faveur des mnages bas revenus. Cest la raison pour laquelle votre rapporteur considre comme tant de la responsabilit du Snat, en tant que reprsentant des collectivits locales, de promouvoir les bonnes pratiques en matire de transferts sociaux locaux. a) Supprimer les aides lies au statut et assurer la neutralit des aides par rapport lorigine des revenus Les recommandations adresses par votre rapporteur aux collectivits locales ne diffrent gure de celles mises lgard des aides nationales. La premire dentre elles consiste liminer, autant que possible, les aides lies un statut, quand ce critre ne constitue en ralit quun moyen commode dapprcier une condition de ressources. Il nest pas question, en effet, dinterdire le versement daides lies certaines caractristiques des mnages et pour lesquelles la rfrence une prestation nationale perue par le demandeur constitue un critre cohrent : nengendre pas deffet de seuil une prestation destine aux familles qui serait verse sans condition de ressources aux mnages touchant des allocations familiales. Mais, la plupart du temps, la rfrence une prestation donne ou un statut cache en ralit une condition de ressources : cest le cas des aides verses aux chmeurs ou aux bnficiaires du RMI. Il est vrai que pour des collectivits de petite taille, la vrification dune condition de ressources soulve de nombreuses difficults de gestion : mettre en place un barme de ressources et vrifier les dclarations des demandeurs suppose une expertise quune petite commune na pas forcment les moyens de dvelopper. Votre rapporteur estime toutefois que ces
- 74 -
difficults pourraient tre rsolues, en encourageant les communes intresses utiliser des barmes existant, tels ceux mis en place par les caisses dallocation familiale, et utiliser simplement les dclarations de revenus et avis dimposition pour apprcier la ralit des ressources des demandeurs. Si votre rapporteur insiste autant sur la ncessit de supprimer les aides lies au statut, cest parce que ce sont elles qui engendrent le plus deffets pervers en cas de reprise dactivit : sappuyer sur une simple condition de ressources permet au contraire dassurer une neutralit de laide distribue par rapport lorigine des revenus et donc de ne pas pnaliser ceux qui reprennent une activit professionnelle. b) Gnraliser le recours un systme de quotient familial et daides dgressives La seconde recommandation de votre rapporteur sadresse davantage aux dpartements et aux organismes locaux de scurit sociale susceptibles dattribuer des aides extralgales. Compte tenu de leur taille et du type de prestations lgales quils attribuent, les dpartements comme les organismes locaux de scurit sociale nont aucune difficult mettre en place des aides sous condition de ressources et non de statut. Ils peuvent donc aller plus loin pour amliorer lquit du systme redistributif en faveur des mnages bas revenus. A cet effet, il parat dabord souhaitable de gnraliser un systme de quotient familial, permettant de moduler de faon quitable le barme des aides en fonction non seulement des ressources du mnage mais galement de ses charges. Lutilisation dun barme de ressources unifi pourrait dailleurs tre encourag par les caisses nationales de scurit sociale, afin dviter de trop grandes distorsions dune caisse primaire ou dune caisse dallocation familiale lautre. Il convient de prciser que lutilisation dun tel barme ne signifie pas pour autant luniformisation des montants accords, qui doivent rester fonction des priorits de chaque financeur et des dotations disponibles, mais uniquement lharmonisation des conditions daccs aux aides. Enfin, comme en matire de prestations nationales, votre rapporteur encourage ensuite les dpartements et les caisses favoriser des aides dgressives en fonction des revenus, plutt que des aides cdant brutalement devant un seuil de ressources.
- 75 -
3. Une question ouverte : faut-il fusionner certains minima sociaux ? a) La question de lharmonisation des montants des minima sociaux Le nombre important de minima sociaux en France et la comparaison avec dautres pays europens alimentent depuis longtemps une rflexion sur la ncessit de simplifier notre systme de minima sociaux, en fusionnant certaines prestations entre elles : ainsi, ds 1992, le commissariat gnral du plan avait mis en place un groupe de travail intitul Unifier les minima sociaux ? 1. Cette ide de fusion concerne en premier lieu le RMI et lAPI, dans une moindre mesure lallocation veuvage et lASS. Pourtant, votre rapporteur considre que la rduction du nombre des minima sociaux nest pas, en elle-mme, une priorit, pas plus que luniformisation de leurs montants car ils rpondent, en ralit, une certaine logique. Sagissant de lAAH, du minimum vieillesse et du minimum invalidit, il est clairement impossible de diminuer leur montant pour les aligner sur celui du RMI ou de lASS. Outre quelle serait politiquement intenable, une telle mesure ne se justifie pas sur le plan conomique car, dans la mesure o ces prestations concernent, dans leur grande majorit, des inactifs, le niveau des minima en question ne cre pas de relles perturbations sur le march du travail. Quant augmenter le niveau des autres minima pour les aligner sur ces prestations plus favorables, elle se heurterait, au-del de la contrainte budgtaire, la question des trappes inactivit, en rduisant de faon drastique le gain la reprise dactivit, et la question de leur quit par rapport aux actifs faible revenu. Votre rapporteur rappelle enfin, la lumire de lanalyse de lensemble du dispositif des minima sociaux quelle a mene, que comparer les montants bruts des diffrentes prestations na pas grand sens, compte tenu du poids des droits connexes dans le revenu final des allocataires. Elle se refuse donc alimenter une polmique sur le montant des diverses prestations, prfrant sattacher rendre plus quitables ces droits connexes.
Unifier les minima sociaux ? , groupe de travail interadministratif du commissariat gnral du plan, prsid par Bertrand Fragonard, 1992.
- 76 -
b) Fusionner certains minima : une possibilit, certainement pas un impratif Si lon passe en revue les neuf minima sociaux franais, il est incontestable que plusieurs dentre eux, soit parce quils visent des publics trs proches, soit parce que leur mode fonctionnement est similaire, pourraient tre fusionns. Ainsi, il est incontestable quune fusion du RMI et de lAPI ne soulve pas dobstacle technique majeur, dans la mesure o ces deux prestations strictement diffrentielles sont construites sur le mme modle. Il sagit donc surtout dune question politique relative au niveau de la nouvelle allocation issue de cette fusion. Une solution envisageable pourrait tre daligner les deux minima sur le RMI, en renvoyant la prise en charge des surcots lis lisolement du parent au dispositif des prestations familiales : il sagirait alors de crer, sous condition de ressources, une majoration dallocations familiales en faveur des parents isols ou encore de rformer, pour la rendre plus favorable, lallocation de soutien familial. Le principal obstacle cette fusion reste la stigmatisation dont les actuels bnficiaires de lAPI craignent dtre lobjet en basculant dans le dispositif du RMI. Bien quelle concerne des publics aux caractristiques trs proches, la fusion de lASS avec le RMI se heurte, en revanche, des difficults plus importantes : contrairement au RMI, lASS nest pas familiarise et le niveau de salaire du conjoint compatible avec lallocation est nettement plus lev. Les avantages lis lASS traduisent la volont des pouvoirs publics davantager ceux qui ont dj travaill et qui ont relev du systme dindemnisation du chmage de droit commun. Dans ces conditions, votre rapporteur estime que le rapprochement du RMI et de lASS passe davantage par une harmonisation de leurs droits lis et par un mode dindexation qui permettent une volution comparable de leur pouvoir dachat que par une fusion complte des deux allocations. De la mme manire, votre rapporteur nest pas favorable une fusion pure et simple de lAAH et du minimum invalidit, combien mme les bnficiaires de ces deux prestations prsentent les mmes caractristiques et les mmes besoins. Il lui semble en effet important de prserver une prestation spcifique en faveur des personnes handicapes qui ont pu se constituer des droits, mme trs faibles, dans le systme contributif. Il est en revanche indispensable dharmoniser leurs droits lis, de faon ce que les bnficiaires du minimum invalidit ne soient plus systmatiquement dsavantags par rapport aux titulaires de lAAH.
- 77 -
Pour ce qui concerne enfin lallocation veuvage, votre rapporteur ne peut que se fliciter de la solution apporte par la loi du 21 aot 2003 portant rforme des retraites : elle programme en effet lextinction de cette allocation, au profit dune amlioration du dispositif des pensions de rversion, dsormais ouvertes sans conditions dge ni de ressources.
C. ACCENTUER LEFFORT EN FAVEUR DU RETOUR LEMPLOI
1. Les amliorations possibles droit constant a) Lever les obstacles matriels la reprise dactivit : la question de laccs aux modes de garde des enfants Lorsque les tudes relatives aux trappes inactivit concluent la rduction des dsincitations financires la reprise dactivit pour les bnficiaires de minima sociaux, elles ignorent les obstacles pratiques au retour lemploi et, notamment, la question de laccs des modes de garde pour les mnages revenus modestes avec enfants. Le rapport du CERC sur la pauvret des enfants1 souligne en effet quen 2000, seuls 3 % des enfants issus de familles bnficiaires dun minimum social taient gards en crche et que 80 % ntaient confis aucun mode daccueil et restaient la garde de leurs parents. Plusieurs facteurs permettent dexpliquer la faiblesse du nombre denfants issus de ces familles ayant accs un mode de garde : - dans un contexte de pnurie de places en crche, le rglement de la plupart des tablissements donne la priorit aux enfants de couples biactifs. Il est donc trs difficile, pour les parents en recherche demploi, davoir accs ce mode garde, alors mme que celui-ci reste le moins onreux ; - le cot daccs aux autres modes de garde payants (assistants maternels, employs domicile) reste trop lev car le systme daide aux parents est inadapt aux bnficiaires de minima sociaux. Par ailleurs, il existe un effet de slection lentre de ces modes de garde car les bnficiaires de minima sociaux et les mnages trs faibles revenus dactivit ne prsentent pas suffisamment de garanties ; - sur le plan psychologique, enfin, les modes de garde individuels sont peu adapts aux bnficiaires de minima sociaux : il est en effet difficile
Les enfants pauvres en France , CERC, 2004, La Documentation franaise.
- 78 -
dtre soi-mme employeur quand on dj du mal redevenir salari et reprendre une activit professionnelle. La cration de la PAJE a cependant permis de rduire le taux deffort des mnages les plus pauvres qui recourent une assistante maternelle : en thorie, laide est effectivement plus ou moins suffisante pour rmunrer une assistante maternelle pour les vingt-huit heures de garde hebdomadaires correspondant au minimum de revenu dactivit pour percevoir la prestation, condition toutefois que celle-ci soit rmunre au salaire minimum, ce qui est en ralit trs rare. Dans les faits, le taux deffort slve encore environ 15 % du salaire pour un couple de deux actifs mi-temps (157 euros par mois) et mme 33 % en rgion parisienne. En consquence, un grand nombre de bnficiaires de minima sociaux choisissent de demander le complment de libre choix dactivit de la PAJE, cette prestation leur permettant de compenser leur inactivit mais, ce faisant, ils se privent de la possibilit de rechercher un emploi. Encore convient-il de souligner que, pour accder au complment de libre choix dactivit, il faut avoir travaill au cours des cinq dernires annes, ce qui nest pas toujours le cas des bnficiaires de minima sociaux. Votre rapporteur estime donc quun effort important doit tre engag en matire de dveloppement des modes de garde, afin notamment dviter daccentuer la pauvret des familles monoparentales. De ce point de vue, certains modles trangers offrent des expriences intressantes : ainsi, au Danemark, les collectivits locales ont lobligation doffrir un mode de garde toute personne qui en fait la demande, les parents participant au financement de laccueil proportion de leurs ressources. En finanant loffre de garde au lieu de subventionner, comme en France, les utilisateurs, le Danemark parvient un taux de couverture des besoins de 70 %, contre peine 32 % en France aujourdhui. Le rapport de la commission Famille, vulnrabilit, pauvret , prside par Martin Hirsch, publi en avril 2005, aboutit au mme constat. Pour remdier cette situation, il propose de crer un vritable service public de la petite enfance, affirmant le caractre obligatoire de cette comptence pour les collectivits locales, celles-ci pouvant lexercer en rgie ou par dlgation. Il demande galement au Gouvernement de dfinir des rgles minimales dattribution des places en crche au niveau national, afin de garantir une priorit daccs aux modes de garde collectifs pour les mnages les plus modestes, notamment pour les allocataires de minima sociaux en transition vers lemploi. Votre rapporteur considre que ces propositions constituent des pistes de rflexion utiles, mme si de nombreuses questions subsistent quant leur mise en oeuvre : reste en effet dterminer quel devrait tre le niveau le
- 79 -
mieux adapt en matire de politique de la petite enfance, ainsi que les modalits de financement de cette rforme. Le taux de couverture des besoins propos, savoir 50 % dici cinq ans, suppose en effet la mobilisation denviron 2,6 milliards deuros supplmentaires. b) Gnraliser laccompagnement au retour lemploi lensemble des bnficiaires de minima sociaux Votre rapporteur regrette que seuls les bnficiaires du RMI bnficient, ce jour, dun accompagnement professionnel et social formalis et obligatoire. Elle considre en effet que ce dispositif pourrait tre, avec profit, tendu lensemble des bnficiaires de minima sociaux ou, tout le moins, ceux qui ont vocation retourner vers lemploi. A ce titre, la dcentralisation du RMI constitue une opportunit, mme si des risques de dsengagement restent craindre : dans la mesure o ils sont dsormais libres de fixer les contours de leur politique dinsertion, les dpartements ont la possibilit den largir le bnfice aux titulaires dautres minima sociaux, ce qui tait exclu dans le cadre rigide des crdits dinsertion. Cependant, compte de la charge financire reprsente par la dcentralisation du RMI et des autres transferts de comptence dvolus aux dpartements - notamment dans le domaine du handicap -, certains conseils gnraux pourraient tre tents davoir une vision minimaliste de leur rle et refuser de supporter le cot du dveloppement des supports la dmarche dinsertion pour dautres catgories de publics que les bnficiaires du RMI. Votre rapporteur estime pourtant que les dpartements auraient intrt sengager dans cette voie car cela leur permettrait de dvelopper des synergies et de prvenir laugmentation du nombre de bnficiaires du RMI : terme, les allocataires de lAPI et de lASS basculent en effet dans le dispositif du RMI, dans une situation demployabilit dgrade car ils sont dj au chmage depuis longtemps. Il est toutefois vident que les dpartements ne pourront pas mettre seuls en place les dispositifs daccompagnement vers lemploi pour lensemble des bnficiaires de minima sociaux et quils devront sappuyer sur dautres acteurs, notamment le service public de lemploi. Votre rapporteur souligne cet gard lopportunit que reprsente la cration des maisons de lemploi, prvues par la loi de cohsion sociale. Elles devraient permettre aux dpartements de bnficier dune mutualisation des moyens existants pour mettre en oeuvre le volet emploi des contrats dinsertion. En change, ces dpartements pourraient assurer un service daccompagnement social complmentaire pour dautres publics que pour les allocataires du RMI.
- 80 -
Votre rapporteur insiste enfin sur la ncessit dinclure, dans laccompagnement propos aux bnficiaires de minima sociaux, une information sur leurs droits et la modulation prvisible de leurs revenus, dans le cadre dune reprise dactivit. Il est en effet indispensable, pour des personnes aux ressources trs modestes, de ntre pas prises au dpourvu par une rupture brutale de lvolution de leurs revenus. Cette information, qui permet lallocataire de reprendre une activit en toute connaissance de cause, est au moins aussi importante pour lever les obstacles au retour lemploi que la suppression des effets de seuil. Cette mission dinformation pourrait, comme cest le cas au Royaume-Uni, relever de la comptence des maisons de lemploi. 2. A plus long terme : rechercher une meilleure articulation entre minima sociaux et revenus dactivit Malgr les amliorations apportes notre systme de protection sociale afin de lever les obstacles majeurs au retour lemploi, votre rapporteur estime que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire lconomie, plus long terme, dune rflexion sur la forme que doit prendre la garantie de revenu minimum et sur son articulation avec les revenus dactivit. a) Lallocation universelle : une solution peu conforme la philosophie de notre systme social Tranchant avec la complexit de notre systme de minima sociaux, plusieurs rapports rcents ont plaid pour la mise en place dune allocation universelle, parfois galement appele revenu minimum dexistence ou dividende universel 1 : il sagirait de mettre en place une allocation forfaitaire, perue par tout individu, indpendamment de son niveau de revenu. Les avantages mis en avant dune telle allocation rsident dans son caractre non stigmatisant - dans la mesure o elle est verse tous les citoyens - et dans labsence deffet de seuil quelle permet. Elle est galement neutre, en principe, sur le comportement dactivit des personnes, sauf si elle devait tre fixe un niveau suffisamment lev pour permettre de vivre sans travailler. Votre rapporteur reste nanmoins circonspecte lgard de cette proposition : sous couvert dune simplification radicale des prestations sociales - il est gnralement propos de fusionner non seulement tous les minima sociaux mais galement dy intgrer une grande partie des prestations familiales, voire des allocations logement -, le risque est grand dassister un affaiblissement de notre systme de protection sociale, une allocation
Voir notamment le rapport au Premier ministre fait par Christine Boutin, dput, Pour sortir de lisolement, un nouveau projet de socit , publi en 2002.
1
- 81 -
forfaitaire et universelle ne pouvant, par dfinition, sadapter aux situations particulires. Par ailleurs, outre un cot important pour les finances publiques, une telle allocation parat contradictoire avec la philosophie mme de notre systme social, qui sappuie sur la progressivit de limpt sur le revenu et la concentration de laide publique sur ceux qui en ont le plus besoin. Au total, il semble peu pertinent, aussi bien sur le plan de lefficacit de la dpense publique quen termes de redistribution, dassurer une aide dun niveau quivalent aux plus aiss comme aux plus pauvres. b) Une piste prometteuse : les diffrents modles dallocation dgressive Votre rapporteur considre que le systme des minima sociaux doit avant tout concilier deux objectifs : permettre une redistribution quitable en faveur des mnages les plus pauvres, tout en vitant les situations de dcouragement la reprise dactivit. De ce point de vue, deux types daides paraissent particulirement appropries : les dispositifs de crdit dimpt, comme ceux existant aux tats-Unis ou au Royaume-Uni, et les systmes dallocation dgressive.
Les dispositifs de crdits dimpt en faveur des bas revenus : les leons des modles trangers LEarned Income Tax Credit (EITC) amricain Cr en 1975, lEITC est un crdit dimpt accord, sous condition de ressources, tous les foyers dans lesquels au moins une personne travaille. Le barme de la prestation dpend galement du nombre denfants charge : en 1999, le crdit maximum pour un foyer sans enfants slevait 347 dollars, tandis quil valait 2.312 dollars pour un foyer avec au moins deux enfants. Les valuations du dispositif montrent un effet incitatif la reprise dactivit pour les personnes seules passant du non-emploi lemploi mais une incitation en sens contraire pour les seconds salaires des couples biactifs, leffet sur le nombre dheures travailles tant positif dans la phase dentre puis ngatif dans les phases de plateau et de sortie du dispositif. Au total, les effets directs de lEITC sur loffre de travail apparaissent positifs, mais modestes au niveau agrg. Si ses effets directs sur lemploi restent peu sensibles, lEITC joue en revanche un rle redistributif important : il permet 4,3 millions de personnes de passer audessus du seuil de pauvret.
- 82 -
Le Working Families Tax Credit (WFTC) britannique Instaur en 1999, le WFTC rpond une double proccupation : relever le niveau de vie des familles faibles revenus et les inciter lactivit. Il sagit dun crdit dimpt en faveur des familles avec enfants. Deux conditions principales dligibilit sont requises : - dune part, lun des adultes du foyer doit exercer une activit, salarie ou indpendante, dune dure hebdomadaire de seize heures minimum ; - dautre part, le foyer ne doit pas disposer dun patrimoine (hors logement principal) dune valeur suprieure 8.000 livres. Aucune allocation nest verse lorsque la dure du travail hebdomadaire est infrieure seize heures. Elle est constante pour une dure de travail comprise entre seize et vingt-cinq heures. Puis, lallocation dcrot, avec un taux de dgressivit de 55 %. Les valuations du WFTC mettent en lumire un fort effet incitatif la prise dun emploi dune dure suprieure seize heures par semaine et laugmentation du nombre dheures travailles pour les personnes dont la dure du travail hebdomadaire est infrieure seize heures. Pour les autres mnages, leffet du crdit dimpt reste incertain, il pourrait tre ngatif pour les couples biactifs. Globalement, le nombre dentres sur le march du travail engendres par le WFTC est estim 44.000 : limpact sur lemploi est donc modeste. En revanche, le WFTC apporte un soutien significatif aux familles aux revenus les plus modestes, notamment pour les deux premiers dciles de la distribution des revenus.
La prime pour lemploi, mise en place en France depuis 2001, sinspire de ces mcanismes de crdit dimpt, sans toutefois atteindre la mme ampleur, que ce soit en termes de masse financire totale ou dimpact sur le taux de pauvret. Mais il est vrai que cette prime vient sajouter un dispositif dallocation dj trs dvelopp, ce qui nest pas le cas au Royaume-Uni et aux tats-Unis. Cest la raison pour laquelle, en France, les propositions les plus nombreuses visent rformer le systme des minima sociaux, en conservant loutil des allocations mais en leur donnant un caractre dgressif en fonction des revenus dactivit. y Lallocation compensatrice de revenu Modlise en 1999 par lconomiste Roger Godinot, lallocation compensatrice de revenu (ACR) vise lisser le profil des revenus entre le RMI et le SMIC. Elle poursuit ainsi deux objectifs : renforcer lincitation lemploi, tout en tenant compte et en compensant partiellement la faiblesse des revenus de ceux qui ne peuvent accder un emploi de dure suffisante. LACR remplacerait le RMI pour un mnage sans revenu dactivit ni autre revenu. Elle conserverait un caractre diffrentiel lgard de tout
- 83 -
revenu de remplacement ou revenu du patrimoine. Elle ne serait en revanche diminue que dune fraction des revenus dactivit : il sagirait donc en quelque sorte dun mcanisme permanent dintressement au retour lemploi du RMI. LACR serait dgressive : elle diminuerait donc jusqu steindre un niveau de revenu salarial jug suffisant, savoir le SMIC temps plein pour une personne seule et 1,5 SMIC dans le cas dun couple.
Source : Accs lemploi et protection sociale , CERC, 2001.
Les performances redistributives de lACR sont nettement suprieures celles dun dispositif comme la prime pour lemploi : le nombre de mnages concerns reprsenterait le tiers de celui vis par la prime pour lemploi et son effet se concentrerait sur les deux premiers dciles de niveau de vie. En ce qui concerne enfin les incitations lemploi, lACR lverait sans aucun doute de manire sensible les obstacles financiers au retour lactivit pour tous les allocataires du RMI. Elle permettrait doccuper, sans perte financire, tout emploi dune dure infrieure celle qui conduit sortir du RMI et accrotrait galement les incitations occuper un emploi de toute dure suprieure jusquau temps plein. En revanche, pour les personnes dj en situation demploi, leffet de lACR pourrait tre ngatif ou nul, compte tenu dun effet revenu jouant en sens inverse. y Le revenu de solidarit active Propos par la commission Famille, vulnrabilit, pauvret prside par Martin Hirsch, le revenu de solidarit active (RSA) vise faire en sorte que le produit de chaque heure travaille puisse amliorer le revenu final de la famille en supprimant les effets de seuil. Il revient donc, comme
- 84 -
lallocation compensatrice de revenu, crer une forme dintressement permanent la reprise dactivit. Sinspirant du dispositif de lACR, le revenu de solidarit active va plus loin, en intgrant toutes les sources de revenu qui pourraient avoir un effet sur le lien entre revenus du travail et revenus de la solidarit, savoir non seulement les minima sociaux (RMI, ASS et API), mais aussi les aides fiscales, telle que la prime pour lemploi, et les aides au logement. De cette manire, les revenus des familles seraient constitus de trois composantes : les revenus du travail, le RSA - dont le montant varierait en fonction du revenu mensuel travaill, selon la configuration familiale - et les prestations familiales qui, comme actuellement, dpendraient du nombre denfants du foyer. Tout comme lACR, le RSA serait dgressif : tout revenu tir du travail dclencherait une diminution de celui-ci, mais sans que le taux marginal dimposition puisse jamais dpasser 50 % des gains provenant du travail. Pour les salaires les plus faibles (jusqu 0,7 SMIC), le taux marginal serait encore plus rduit ; il serait en revanche accru au-del de ce seuil. Leffet du RSA steindrait pour un revenu dactivit quivalant 1,4 SMIC pour une personne seule et deux SMIC pour un couple.
Comparaison du RSA et de la situation actuelle dans le cas dun couple avec deux enfants
Source : Au possible, nous sommes tenus : la nouvelle quation sociale , rapport de la commission Famille, vulnrabilit, pauvret , prside par Martin Hirsch, avril 2005.
- 85 -
Les simulations effectues par la DREES pour la commission Hirsch situent la cration du RSA dans une fourchette de cot ex ante allant de 6 8 milliards deuros. A ce cot brut, il conviendrait toutefois de retrancher les conomies ralises au titre de la suppression de lintressement (400 millions deuros) et de la prime pour lemploi (2,4 milliards deuros). Si elle ne saurait, ce stade, apporter son soutien lune ou lautre de ces propositions, celles-ci demandant encore tre affines et values tant du point de vue de leur faisabilit pratique que de leur impact budgtaire, votre rapporteur ne peut que constater quelles constituent des pistes constructives en vue dune rforme plus profonde de notre systme de minima sociaux. La comparaison de ces dispositifs avec la prime pour lemploi met en outre en lumire un dfaut majeur de celle-ci : la courroie de transmission fiscale semble peu adapte pour des bnficiaires de minima sociaux car son effet sur le revenu se fait sentir avec plus dun an de retard, ce qui attnue considrablement son impact en termes dincitation la reprise dactivit. Votre rapporteur ne serait donc pas hostile la transformation de ce dispositif fiscal en une allocation, qui sapparenterait alors lACR. Une telle rforme pourrait dailleurs tre loccasion de recentrer le bnfice de ce dispositif sur les mnages bas revenus car lactuelle prime pour lemploi diffuse aujourdhui ses effets trop haut dans lchelle des revenus pour tre rellement efficace en termes de redistribution. Le principal dfaut, tant de lACR que du RSA, rside dans lencouragement implicite au temps trs partiel que ces mesures prodiguent. Le soutien trs important apport par ces dispositifs ds les premires heures dactivit fait en effet craindre des pressions la baisse sur les salaires et un renforcement du recours par les entreprises des emplois temps partiel ou des emplois temporaires. Si ces formes demploi atypiques constituaient de faon habituelle une premire tape vers des emplois stables et temps complet, il pourrait tre souhaitable dencourager les bnficiaires de minima sociaux les occuper. Mais les tudes disponibles montrent quen ralit, les chances, pour un travailleur temps partiel, de retrouver un emploi temps plein sont faibles. Un intressement permanent occuper de tels emplois comporterait donc des effets pervers pour les intresss eux-mmes, en les faisant passer dun pige dans un autre. Dans ces conditions, votre rapporteur estime quil conviendrait de corriger les travers des dispositifs dACR ou de RSA. Il serait par exemple envisageable de retenir un seuil dligibilit lallocation compter dune dure minimum de travail (0,3 SMIC, comme pour la prime pour lemploi).
- 86 -
On pourrait galement maintenir constante lallocation entre le mi-temps et le temps plein, de faon viter les situations o le temps partiel reste prfrable. Il serait galement possible de jouer sur les taux dintressement, en les rduisant pour les premires heures de travail. * * *
La complexit du dispositif franais des minima sociaux est un produit de lhistoire de notre systme de protection sociale. Si cette complexit engendre certains effets pervers, elle est aussi le signe dune volont dadaptation aux besoins particuliers de chaque catgorie de la population. Dans ces conditions, il convient de rejeter lide de la simplification pour la simplification, qui risquerait de conduire davantage linjustice qu un rel allgement des contraintes pour les bnficiaires. Il est en revanche ncessaire de mettre fin, chaque fois que possible, aux trappes inactivit : au-del de la question de lincitation la reprise dactivit, il sagit surtout de faire preuve dquit vis--vis des travailleurs les plus modestes. De mme, il est indispensable de supprimer les incohrences et les effets pervers provoqus par linsertion des minima sociaux dans notre systme socialo-fiscal. Dans cette perspective, plus que dune rvolution, cest dun toilettage systmatique dont notre protection sociale a besoin. Pour avancer dans cette tche, les pouvoirs publics doivent pouvoir se rfrer un tat des lieux complet et fiable de la situation, afin de confronter les rformes - souvent ncessairement partielles - quils envisagent de conduire la complexit de lensemble du dispositif des minima sociaux et son fragile quilibre. En adoptant le prsent rapport, votre commission espre que celui-ci pourra constituer un tel outil. Si tel est le cas, elle engage le Gouvernement tenir jour le panorama quil a tent de dessiner, afin que les donnes ainsi rassembles soient rgulirement actualises et valorises.
- 87 -
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Runie le mercredi 11 mai 2005, sous la prsidence de M. Nicolas About, prsident, la commission a entendu une communication de Mme Valrie Ltard sur les minima sociaux. La commission a dabord entendu Mme Valrie Ltard sur les minima sociaux. une communication de
Mme Valrie Ltard, rapporteur, a indiqu que la rputation du systme franais dassistance aux plus dfavoriss, souvent souponn de dcourager la reprise dactivit, lavait conduite sintresser au fonctionnement et larticulation des diffrents minima sociaux et prsenter un rapport dinformation faisant le point sur ce sujet. Elle a rappel que neuf minima sociaux coexistent et constituent des prestations non contributives verses, sous conditions de ressources, aux catgories les plus fragiles de la population : les personnes ges, avec lallocation supplmentaire vieillesse et, plus rcemment, lallocation quivalent retraite (AER) ; les personnes handicapes, avec lallocation supplmentaire dinvalidit et surtout lallocation aux adultes handicaps (AAH) ; les personnes familialement isoles, avec lallocation de parent isol (API) et lallocation veuvage ; enfin, les personnes exclues du march du travail avec lallocation de solidarit spcifique (ASS), lallocation dinsertion et le revenu minimum dinsertion (RMI). On compte aujourdhui 3,3 millions dallocataires de minima sociaux, soit 6 millions de personnes en ajoutant les membres de la famille charge des bnficiaires. Mme Valrie Ltard, rapporteur, a soulign que les strates successives dallocations, bien plus nombreuses que dans les autres pays conomiquement comparables, tmoignent de lvolution du phnomne de la pauvret dans notre pays. Elles ont dabord concern les retraits et les invalides de laprs-guerre puis, partir de la crise des annes 70, les personnes handicapes dans lincapacit doccuper un emploi et les victimes des dstructurations familiales, enfin, plus rcemment, les personnes prives demploi. Le RMI a t instaur in fine en 1988, comme le moyen de procurer le minimum de ressources aux adultes dmunis de tout autre moyen de subsistance.
- 88 -
A cette diversit de statuts sajoute une grande disparit dans le montant des allocations verses, le calcul des plafonds de ressources et les conditions dattribution des aides. Elle a soulign que les prestations sont dautant plus leves quelles sont destines des personnes durablement ou dfinitivement exclues du march du travail et plus faibles lorsquelles sont considres comme le moyen de passer une priode de transition avant une reprise dactivit. Des carts inexplicables existent malgr tout au sein dune mme catgorie de destinataires, par exemple entre lallocation veuvage et lAPI. La mme observation simpose pour la dfinition des plafonds de ressources : selon le cas, on ajoute ou non les prestations familiales aux autres revenus du mnage, la priode de rfrence pour le calcul des revenus est variable et la composition du foyer est prise en compte de manire diverse. Puis Mme Valrie Ltard, rapporteur, a insist sur limportance des droits connexes , cest--dire les prestations lies de faon plus ou moins automatique au bnfice des minima sociaux, dans les revenus des bnficiaires de minima. Elle a cit les allocations familiales et les allocations logement ; certains avantages fiscaux comme la non-imposition quasi gnrale des minima sociaux la contribution sociale gnralise (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; le caractre fiscalement non dclaratoire de certaines allocations ; la suspension des dettes fiscales au profit des bnficiaires du RMI et de lAPI ; lexonration de taxe dhabitation ou de redevance audiovisuelle ; le bnfice de la couverture maladie universelle (CMU) et, pour les seuls RMIstes, de la CMU complmentaire ; la constitution de droits la retraite, pour lASS, lAER et lallocation invalidit ; enfin, certains dispositifs ponctuels tels que la prime de Nol, la tarification sociale du tlphone et de llectricit et la priorit loctroi demplois aids. Elle a, en revanche, dplor que seuls les allocataires du RMI bnficient vritablement dun dispositif daide linsertion. Elle a ajout que cette mosaque dlments disparates constituant les revenus des mnages les plus dfavoriss doit en outre tre complte par les diffrentes aides servies par les collectivits territoriales, dont le tableau exhaustif est impossible dresser : banque alimentaire, fourniture de logement durgence, aides aux impays deau ou de tlphone, distribution de vtements, rductions tarifaires dans les transports publics, etc. Face ce tableau complexe, Mme Valrie Ltard, rapporteur, a dplor lopacit du systme pour ses bnficiaires. Or, ce manque de lisibilit cre de grandes insatisfactions en donnant une impression darbitraire et dinjustice aux demandeurs daide, et il produit dinvitables effets pervers, au premier rang desquels de nombreux effets de seuil, ainsi quune probable dsincitation lemploi.
- 89 -
Concernant les effets de seuil, elle a distingu ceux lis au statut de bnficiaire de telle ou telle prestation et ceux crs par la combinaison des diffrentes prestations. La premire source deffets de seuil rside dans le fait que certaines aides sont lies au statut mme dallocataire : en consquence, toute augmentation des revenus implique non seulement la perte du bnfice de lallocation de base mais aussi celle des avantages lis. Ainsi, dans le cas du RMI, la sortie du dispositif entrane la perte immdiate du bnfice de lallocation logement taux plein automatique, de lexonration de taxe dhabitation et de redevance audiovisuelle, du droit la CMU et la CMUC gratuites, de la prime de Nol, ainsi que lobligation de payer nouveau un abonnement tlphonique plein tarif, lexigibilit des dettes fiscales jusqualors suspendues et la suppression de nombreuses aides locales. Ce changement de statut fragilise donc les intresss un moment crucial de lvolution de leur situation personnelle, alors quils en ont rarement anticip lampleur. Toutefois, depuis lanne 2000, les pouvoirs publics ont tent de remdier cette situation en ajoutant au critre du statut un critre plus gnral li aux ressources du bnficiaire, mme si la dernire rforme de la redevance audiovisuelle, intervenue dans la loi de finances pour 2005, na pas pris en compte cette nouvelle approche. Mme Valrie Ltard, rapporteur, a ajout que les effets de seuil lis la combinaison des prestations entre elles sont galement pernicieux. Ainsi, le passage dun statut lautre peut conduire des ruptures plus ou moins brutales de ressources, du fait dune diffrence de montant des prestations par exemple entre lAPI et le RMI -, de plafonds de ressources non coordonns - comme entre lASS et le RMI -, de revenus de rfrence htrognes - comme pour le calcul de lAAH et du minimum vieillesse - ou de pertes de droits connexes. Une approche synthtique de leffet combin de ces diffrentes prestations, mesurant la courbe des taux marginaux dimposition, montre, dans le cas du RMI, lexistence de nombreux ressauts lis au passage des diffrents plafonds de revenus : plafond du RMI, plafond des allocations logement, seuil de recouvrement de limpt sur le revenu, plafond de lallocation de rentre scolaire, etc. Mme Valrie Ltard, rapporteur, a ensuite fait valoir que les diffrences de priodes de rfrence pour le calcul des prestations et les dlais de carence entre louverture des droits et la perception de laide donnent un caractre heurt aux diffrents versements. Ils constituent une autre source deffets de seuil : cest le cas notamment du systme dapprciation trimestrielle des ressources pour lattribution du RMI, qui tend dcourager la reprise de travail temps partiel ou pour une dure dtermine, ainsi que
- 90 -
de lattribution de lAAH par rfrence au revenu imposable de lanne prcdente. En rapprochant ces effets pervers, la complexit du systme et les nombreux effets de seuil identifis, la question se pose donc de savoir si le dispositif des minima sociaux aurait pour effet denfermer les allocataires dans une position de non-emploi et de prcarit en crant des phnomnes de trappes inactivit . Mme Valrie Ltard, rapporteur, a constat cet gard que, mme si plusieurs enqutes et lexprience de terrain montrent que, le plus souvent, les personnes confrontes ces situations ne choisissent pas dlibrment de rester dans lassistance et linactivit, il est incontestable que lensemble des contraintes et des frais engager pour retrouver le chemin de lemploi peuvent constituer pour elles des obstacles insurmontables. Elle a rappel que, ds 1988, le lgislateur avait souhait encourager les bnficiaires du RMI rejoindre le monde du travail en prvoyant un mcanisme temporaire dintressement la reprise dactivit, tendu par la suite cinq minima sociaux RMI, API, ASS, allocation dinsertion et allocation veuvage par la loi de lutte contre les exclusions. Elle a ajout que, sagissant de lAAH, un abattement permanent sur les revenus dactivit permet aux allocataires de cumuler, sans limitation de dure, revenus du travail et allocation. Ces mcanismes font toutefois lobjet de nombreuses critiques, en raison de leur complexit et de leur opacit pour les usagers, ce dont tmoigne dailleurs le fait que le nombre des bnficiaires potentiels de lintressement stagne. Elle a fait valoir que ces mcanismes de cumul dune activit rmunre avec un minimum social entranent des taux marginaux dimposition trs dissuasifs lorsque lintressement steint. Ils provoquent aussi une grande variabilit des revenus court terme, source de fragilit pour des mnages au budget restreint, linstabilit de leur situation tant en outre accrue par le fait que lintressement concerne essentiellement des emplois temps trs partiel, dure dtermine et faiblement rmunrs. Mme Valrie Ltard, rapporteur, a indiqu que, en 2000, lInstitut national de la statistique et des tudes conomiques (INSEE) a men une tude qui avait permis de mettre en vidence trois spcificits de ces dispositifs : labsence daugmentation continue du revenu disponible en fonction de la dure du travail, le caractre temporaire de lincitation la reprise du travail et lencouragement qui se limite aux activits mi-temps. Rappelant que dautres rapports et tudes ont depuis lors confirm cette analyse, elle sest rjouie de ce que les pouvoirs publics aient engag un toilettage du systme portant sur la rforme de la taxe dhabitation, la modification du barme des aides au logement, la modification de la dcote et du barme de limpt sur le revenu et la cration de la prime pour lemploi.
- 91 -
Les analyses conduites la suite de ces rformes rvlent de faon convergente une nette diminution des phnomnes de trappes inactivit : dsormais, un bnficiaire du RMI ne peut se trouver confront une situation de perte financire en retrouvant un emploi, le revenu disponible est maintenant une fonction croissante de la dure du travail et les taux marginaux dimposition ont rgress de faon sensible. Toutefois, Mme Valrie Ltard, rapporteur, a convenu que deux incertitudes demeurent : la premire lie la mesure des effets des transferts sociaux locaux sur la reprise dun emploi, une seule tude ayant conclu une aggravation sensible de leffet dsincitatif ; la seconde tenant la thorie des trappes elle-mme qui ne prend pas en compte les lments non financiers qui motivent le souhait de reprendre une activit. Elle a ajout que se pose galement le problme de la qualification des personnes concernes, de lexistence dun certain nombre de handicaps sociaux, dun manque dinformation sur des dispositifs complexes, enfin de la situation de lemploi en gnral. Mme Valrie Ltard, rapporteur, a estim que rsorber les trappes inactivit se justifie surtout au nom de la justice et de lquit promouvoir vis--vis des salaris modestes, plus encore quen vertu du principe dincitation la reprise dune activit. Or, une amlioration du dispositif des minima sociaux est ralisable, et dabord en renforant la connaissance des minima sociaux par la conduite dtudes transversales sur lensemble des allocations et de leurs droits connexes. Labsence de coordination entre les diffrents services gestionnaires de ces prestations doit tre corrige par une centralisation de linformation et par une rvision de lappareil statistique lui-mme afin de ne plus rduire les chantillons statistiques aux seuls allocataires du RMI. De mme, le manque de remontes dinformations de la part des collectivits locales appelle un partenariat entre lObservatoire de laction sociale dcentralise, lINSEE et la direction de la recherche, des tudes, de lvaluation et des statistiques (DREES) pour mener des tudes fiables sur les aides locales en faveur des personnes en difficult sociale. Une deuxime piste serait damliorer la cohrence interne du systme des minima sociaux : on peut envisager la mise en place dun calendrier de versement unique des diffrentes prestations et une harmonisation des priodes de rfrence en matire de calcul des ressources en prvoyant la possibilit davances sur droits supposs, en permettant la neutralisation des ressources devenues inexistantes et en assurant la cohrence des dlais de prise en compte des changements de situation des bnficiaires. De mme, il convient de poursuivre la mise en cohrence des droits connexes ouverts chaque minimum social, par exemple celle du rgime dexonration de la redevance audiovisuelle, qui pourrait tre align sur celui de la taxe dhabitation, ou celle du systme de tarification sociale du
- 92 -
tlphone, qui pourrait sinspirer du dispositif daccs llectricit. Enfin, il est indispensable dinstaurer des rgles de bonnes pratiques pour les transferts sociaux locaux afin de limiter les effets de seuil en supprimant les aides lies au statut et en assurant la neutralit des aides quelle que soit lorigine des revenus, ce qui suppose de gnraliser le recours un systme de quotient familial et le caractre dgressif des aides. Une troisime piste consisterait accentuer leffort en faveur du retour lemploi. Mme Valrie Ltard, rapporteur, sest prononce pour la leve des obstacles matriels la reprise dactivit, en favorisant laccs aux modes de garde des enfants pour les allocataires de minima sociaux et pour la gnralisation de laccompagnement vers lemploi applicable au RMI lensemble des bnficiaires de minima sociaux, ce qui suppose de mobiliser les dpartements, mme si cela doit reprsenter pour eux une charge supplmentaire. Elle a considr, plus gnralement, quil conviendra de rechercher une meilleure articulation entre minima sociaux et revenus dactivit en rflchissant la forme que devrait prendre lavenir la garantie dun revenu minimum et aux modalits de son articulation avec les revenus dactivit. Elle a estim cet gard que, si lallocation universelle nest pas une solution en phase avec la philosophie gnrale du systme franais, un rgime dallocations dgressives pourrait reprsenter une piste de dveloppement intressante. Les propositions dallocation compensatrice de revenu ou de revenu de solidarit active avances par la commission Hirsch prsentent un rel intrt malgr le risque dencouragement au temps trs partiel quelles pourraient engendrer. Mme Janine Rozier a convenu que le systme des minima sociaux est complexe et peut savrer pernicieux lorsque certains bnficiaires en utilisent les failles pour rester inactifs. Elle a souhait la mise en place rapide des solutions prconises tout en craignant que leur application ne soit trs difficile. M. Guy Fischer a estim que les conclusions du rapporteur tmoignent de lexplosion de la prcarit et de laugmentation des ingalits depuis dix ans, malgr la mise en uvre de la loi de lutte contre les exclusions en 1998 et le travail ralis par les parlementaires lors de son adoption. Il a considr que la loi de programmation sur la cohsion sociale sera tout aussi difficile appliquer. Il a indiqu que les bnficiaires des minima sociaux ne doivent pas pour autant tre stigmatiss, rappelant quune infime partie dentre eux seulement profite des effets pervers du systme. Il a regrett que le rapport ne traite pas des consquences de la rforme rcente de lassurance chmage sur le nombre de bnficiaires des minima sociaux et a souhait connatre le dispositif des minima sociaux en vigueur dans les autres pays europens. Il sest galement interrog sur les possibilits dapplication des
- 93 -
propositions du rapport Hirsch. Il a fait valoir que la question essentielle est bien celle de lquit entre minimum social et revenu dactivit. Il a enfin reconnu que la question des minima sociaux sinscrit dans le champ plus large du problme de la pauvret, de la ghettosation croissante de la socit, de la monte des communautarismes, de la faible croissance conomique et de laugmentation des dlocalisations. M. Alain Vasselle a regrett que le texte ntablisse pas plus prcisment le rapport de revenus entre minima sociaux et salaire minimum de croissance (SMIC), ce qui aurait permis de mesurer lintrt ou non dune reprise dactivit pour les allocataires. Il a ajout que le retour lemploi remplit bien dautres objectifs que la seule production de revenus rguliers. M. Nicolas About, prsident, a rappel quil est galement dlicat dvaluer les consquences des aides sociales locales et de leur diversit sur le territoire. M. Bernard Cazeau a confirm lintrt quil trouve au fait de disposer dun rapport qui fasse le point sur les minima sociaux. Il a partag le point de vue du rapporteur, sagissant de la ncessaire gnralisation du systme dincitation au retour lemploi dont bnficient dj les allocataires du RMI, mais a nuanc son propos en indiquant quune telle gnralisation nest pas toujours possible : par exemple les bnficiaires de lAPI choisissent galement ce statut pour lever leur enfant. Il a ajout que le cot dj important de la dcentralisation du RMI pour les dpartements ne plaide pas en faveur dun renforcement de leur rle en matire de politique dinsertion pour lensemble des bnficiaires de minima sociaux et a rappel cet gard que lemploi demeure une comptence de ltat. Sur la question dune plus grande quit entre les minima sociaux et les revenus dactivit, il a considr que la moindre progression de ces derniers depuis de nombreuses annes a aggrav le problme. Il sest donc prononc pour une augmentation sensible du SMIC plutt que pour une diminution du montant des minima sociaux. Mme Sylvie Desmarescaux a dplor que les nombreux rapports sur la question des minima sociaux naient pas suffisamment permis damliorer le dispositif densemble. Elle a fait part de plusieurs expriences vcues dans sa commune o elle a pu constater le faible intrt dun contrat emploisolidarit pour des allocataires du RMI qui perdaient alors le bnfice de plusieurs droits connexes. Elle a galement cit le cas dun employ communal expriment dont la rmunration slevait peu de chose prs celle de lemploi-jeune qui travaillait auprs de lui. Elle a mis en exergue cette occasion le problme de la faiblesse des minima salariaux dans la fonction publique. Elle a enfin insist sur la complexit des calendriers de versement des diffrentes aides et sur les diffrences inexplicables des plafonds de ressources.
- 94 -
M. Jean-Marie Vanlerenberghe a estim que la comparaison entre le SMIC dune part et le RMI et lAPI dautre part devrait tre davantage taye. Il a estim que, si les allocataires du RMI ne pourront certes pas tous retrouver une activit, il nen demeure pas moins anormal que le revenu dactivit ne soit pas nettement suprieur un minimum social. Il a enfin demand connatre les effets du nouveau contrat davenir sur les revenus des allocataires du RMI et sur leur incitation la reprise dune activit. M. Paul Blanc a partag lanalyse gnrale sur la ncessaire amlioration du SMIC. Il a constat que, depuis 1998, les politiques des diffrents gouvernements navaient donn aucun rsultat probant et quune rvolution des mentalits simpose pour sortir de la logique du dsintrt pour lemploi. Il a estim quune socit ne peut pas distribuer de richesse sans lavoir produite par le travail. Il a enfin fait valoir quil est plus opportun de permettre le cumul du RMI et dun revenu dactivit plutt que de voir se dvelopper le travail au noir. Rappelant le fort taux de chmage la Runion, Mme Anne-Marie Payet a affirm quil ne faut pas stigmatiser les bnficiaires des minima sociaux mais mieux les contrler et renforcer laccompagnement vers lemploi pour inciter les travailleurs non dclars revenir vers la lgalit. Mme Isabelle Debr a dplor le dveloppement dune culture de lassistanat dans notre pays, rappelant qu tout droit correspond un devoir. Elle a galement indiqu que louverture administrative des droits aux minima sociaux est trop longue et trop complexe pour les familles en grande difficult financire qui remplissent les conditions pour y prtendre et a souhait que les effets de calendrier soient supprims et les dlais de versement des aides raccourcis. Mme Bernadette Dupont a soulign que de nombreux candidats des mtiers de services la personne ne souhaitent pas tre dclars, souvent par mconnaissance de leur droit au cumul. Elle a estim que la frontire entre travail au noir et travail lgal doit tre assouplie pour permettre des personnes trs loignes de lemploi de retrouver progressivement une activit dans le respect de la rglementation. Mme Christiane Kammermann a indiqu que de nombreux minima sociaux ne sont pas applicables aux Franais de ltranger et a demand comment ces aides pourraient leur tre verses. M. Guy Fischer a rappel la prcarisation croissante des salaris bas revenus et des chmeurs dont peine la moiti est actuellement indemnise.
- 95 -
En rponse aux diffrents intervenants, Mme Valrie Ltard, rapporteur, a indiqu que la lgislation sociale sest progressivement complique et spcialise, rendant le sujet des minima sociaux extrmement complexe. Elle a soutenu que de nombreuses difficults rencontres par les bnficiaires des minima sociaux sont lies la suppression des droits connexes affrents leur statut au moment de la reprise dun emploi. Elle a estim que ces droits devraient correspondre un niveau de ressources, quelle que soit leur provenance afin de placer dans une situation identique les personnes qui ont des revenus quivalents. Le sentiment dinjustice sociale que provoquent les disparits actuelles est, en effet, un facteur lourd de mcontentement pour nos concitoyens. Par ailleurs, les diffrents droits devraient tre organiss selon un mode dgressif, ce qui pallierait les effets pervers du systme sans pour autant aller vers la cration dune allocation universelle. Elle a galement plaid pour la mise en uvre dune rflexion sur la revalorisation des minima salariaux et sur la suppression des effets pervers de calendrier de leur versement. M. Nicolas About, prsident, a prcis que lAAH ne doit pas tre considre comme un minima social classique puisquil sagit dune prestation spcifique qui rpond des situations trs particulires dincapacit permanente occuper un emploi. Par ailleurs, compte tenu du vif intrt soulev par la prsentation de ce rapport, il a propos la cration dun groupe de travail sur les minima sociaux au sein de la commission charg dlaborer une proposition de loi susceptible damliorer le dispositif. La commission sest dclare favorable linstauration de cette structure et a autoris la publication de cette communication sous la forme dun rapport dinformation.
- 96 -
ANNEXE AUDITIONS DU RAPPORTEUR
Mme Agns Claret de Fleurieu, prsidente, M. Philippe Laffon, membre de droit de lObservatoire national de la pauvret et de lexclusion sociale ; M. Jacques Freville, directeur du service de la politique de la ville de Valenciennes ; Mme Dany Lary, assistante sociale Valenciennes ; M. Serge Louchaert, directeur du centre communal daction sociale de Valenciennes ; Mme Fabienne Rigaut, charge de mission au service social rgional de la caisse rgionale dassurance maladie du Nord Pas-de-Calais ; Mme Ccile Rogez, prsidente, M. Bernard Beaufort, directeur, et Mme Franoise Chantre, responsable de laction sociale la caisse dallocations familiales de Valenciennes ; Mme Franoise Maurel, chef du dpartement des prix la consommation, des ressources et des conditions de vie des mnages, Direction des statistiques dmographiques et sociales lINSEE ; M. Yves Chassard, chef du service des affaires sociales, Commissariat gnral au Plan ; M. Michel Doll, rapporteur gnral du Conseil de lemploi, des revenus et de la cohsion sociale (CERC) ; Mme Emmanuelle Nauze-Fichet, chef du bureau de la lutte contre les exclusions, Mme Anne Pla, charge dtudes, M. Laurent Caussat, sous-directeur charg des synthses, des tudes conomiques et de lvaluation et Mme Sylvie Le Minez, chef du bureau des tudes structurelles et de lvaluation la DREES ; M. Bertrand Fragonard, ancien prsident de lObservatoire national de la pauvret et de lexclusion, prsident de la 2e chambre de la Cour des comptes ; M. Bernard Seillier, prsident, Mme Annick Garonne, secrtaire gnrale et M. Bruno Groues, reprsentant de lUNIOPSS, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvret et lexclusion sociale (CNLE) ; M. Francis Vennat, sous-directeur la sous-direction de lemploi et du march du travail (DARES) ; M. Antoine Saint-Denis, bureau des minima sociaux et de laide sociale la sousdirection des politiques dinsertion et de lutte contre les exclusions (DGAS).
- 97 -
MINIMA SOCIAUX : CONCILIER QUIT ET REPRISE DACTIVIT
La complexit du dispositif franais des minima sociaux est un produit de lhistoire de notre systme de protection sociale. Elle rsulte de la volont maintes fois affirme de rpondre aux besoins particuliers des diffrentes catgories de la population. Elle se traduit nanmoins aujourdhui par une grande opacit. Elle est aussi lorigine de multiples effets pervers tenant notamment aux divers droits et avantages qui leur sont lis. Dans ces conditions, sil convient de rejeter la simplification pour la simplification, qui risquerait de conduire davantage linjustice qu un rel allgement des contraintes pour les bnficiaires, il apparat en revanche ncessaire de supprimer les incohrences et les effets pervers provoqus par linsertion des minima sociaux dans notre systme socialo-fiscal et de mettre fin aux trappes inactivit. Au-del de la question de la reprise dactivit, il sagit en effet surtout de faire preuve dquit vis--vis des travailleurs les plus modestes. Dans cette perspective, plus que dune rvolution, cest dun toilettage systmatique dont notre protection sociale a besoin. Pour avancer dans cette tche, les pouvoirs publics doivent pouvoir se rfrer un tat des lieux complet et fiable de la situation, afin de confronter les rformes - souvent ncessairement partielles quils envisagent de conduire la complexit de lensemble du dispositif des minima sociaux et son fragile quilibre. Constituer un tel outil est lambition de ce rapport.
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Chevalier Bouclier Vert PDFDocument21 pagesLe Chevalier Bouclier Vert PDFAlpha1201100% (1)
- Le Dérèglement Du Monde Par Amin MaaloufDocument7 pagesLe Dérèglement Du Monde Par Amin MaaloufAlpha1201100% (1)
- Rapport ImmigrationDocument437 pagesRapport ImmigrationAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Genoux Et Arts MartiauxDocument16 pagesGenoux Et Arts MartiauxAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Bushido MudrasDocument5 pagesBushido MudrasAlpha120150% (2)
- 2000 Sept KBn°282 TOGASHIDocument7 pages2000 Sept KBn°282 TOGASHIAlpha1201100% (1)
- Maître PléeDocument2 pagesMaître PléeAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Dossier SAMURAIDocument8 pagesDossier SAMURAIAlpha1201Pas encore d'évaluation
- N°317 SOOSAIDocument7 pagesN°317 SOOSAIAlpha1201Pas encore d'évaluation
- N° Spécial KarateDocument6 pagesN° Spécial KarateAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Plaquette Contre Le BruitDocument2 pagesPlaquette Contre Le BruitAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Synthèse Rapport Enfants PauvresDocument6 pagesSynthèse Rapport Enfants PauvresAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Catalogue 19 JuinDocument44 pagesCatalogue 19 JuinAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Section 19 SociologieDocument185 pagesSection 19 SociologieAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Maître Cheng Man ChingDocument8 pagesMaître Cheng Man ChingAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Le Jardin de Lumiere Amin MaaloufDocument1 pageLe Jardin de Lumiere Amin MaaloufAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Rapport Soutenance ChavinierDocument8 pagesRapport Soutenance ChavinierAlpha1201Pas encore d'évaluation
- OurtiraneDocument6 pagesOurtiranebeebac2009100% (1)
- Ecrits Sur Amin MaaloufDocument20 pagesEcrits Sur Amin MaaloufAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Idee Classe MaaloufDocument2 pagesIdee Classe MaaloufAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Maalouf, InterviewDocument6 pagesMaalouf, InterviewAlpha1201Pas encore d'évaluation
- PauvretéDocument28 pagesPauvretéAlpha1201Pas encore d'évaluation
- Rapport DPM 2003Document69 pagesRapport DPM 2003Alpha1201Pas encore d'évaluation