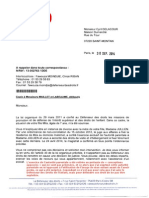Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Article Xxs 0294-1759 1992 Num 35 1 2567
Article Xxs 0294-1759 1992 Num 35 1 2567
Transféré par
Fagner Dos SantosTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Article Xxs 0294-1759 1992 Num 35 1 2567
Article Xxs 0294-1759 1992 Num 35 1 2567
Transféré par
Fagner Dos SantosDroits d'auteur :
Formats disponibles
Serge Berstein
L'historien et la culture politique
In: Vingtime Sicle. Revue d'histoire. N35, juillet-septembre 1992. pp. 67-77.
Abstract The historian and political culture, Serge Berstein. Beyond the criticism against the inconsiderate use of the concept of political culture, the author proposes to justify its use by the political historian. Using the French example, he suggests a definition of the concept (political culture and dominant culture) before outlining distinctions (plural families of political cultures) and emphasizing its dynamic aspect.
Citer ce document / Cite this document : Berstein Serge. L'historien et la culture politique. In: Vingtime Sicle. Revue d'histoire. N35, juillet-septembre 1992. pp. 67-77. doi : 10.3406/xxs.1992.2567 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1992_num_35_1_2567
ENJEUX L'HISTORIEN ET LA CULTURE POLITIQUE Serge Berstein
La culture politique est une cl. Elle introduit de la diversit, du social, des rites, des symboles, l o rgne, croiton, le parti, l'institution, l'immobile. Elle permet de sonder les reins et les curs des acteurs politiques. Son tude est donc plus qu'enrichissante : indispensable, pour peu qu'on s'entende sur sa dfinition et ses limites.
tation voques ci-dessus. Par exemple, comment rendre compte de la relative pe rmanence des comportements lectoraux en France, qui rvle, au-del de la modification des tiquettes, de stupfiantes continuits dont certaines remontent au 19e sicle ? Comment expliquer que l'Allemagne de la premire moiti du 20e sicle, industrialise et forte d'une bourgeoisie et d'une classe moyenne nombreuse, puissante et cultive, soit irrsistiblement attire vers des formes O LA RECHERCHE DE L'EXPLICATION d'autoritarisme politique que rejettent la DES COMPORTEMENTS POLITIQUES France et le Royaume-Uni ? Pourquoi le Qu'est-ce qui motive l'homme lorsqu'il fascisme qui trouve ses modles en Italie ou agit dans le champ du politique ? Si la en Allemagne ne parvient-il pas se concrt question s'impose l'vidence, la rponse iser en France alors que tant d'lments ne va pas de soi, et une multiplicit d'hy rapprochent ce pays de ses deux voisines ? pothses peuvent tre avances, avec des A ces questions, les historiens, depuis exemples l'appui qui en prouvent la per quelques annes, ont tendance rpondre tinence. On peut ainsi valablement invoquer en voquant le concept de culture poli l'intrt, la recherche de la scurit, la haine, tique1. Or, si celui-ci est d'utilisation rcente le sens du devoir, le dvouement civique, en histoire et parat fournir sur un certain l'irritation, la fidlit envers un groupe, etc. nombre de problmes des cls d'interpr Toutefois, chacune de ces rponses peut, tation satisfaisantes, il a fait l'objet, ds les tout aussi valablement, tre dmentie par annes 1960, d'une large utilisation par les des exemples contraires qui conduisent en politologues amricains qui y ont vu l'in relativiser la validit. C'est que le compor strument privilgi d'une possible comparai tementpolitique est un phnomne complexe son entre des systmes politiques diffrents 2. qui fait intervenir des motivations varies Plus spcifiquement, il a t utilis par l'cole et qu'il serait puril de ramener un facteur d'explication unique. Il reste qu'il existe une 1. C'est, par exemple, l'explication propose dans Serge riche collection de faits politiques qui de Berstein, La France des annes trente allergique au fascime , Vingtime sicle. Revue d'histoire, 5, avril 1985. meurent parfaitement inexplicables si on se 2. Gabriel A. Almond, Comparative political systems , contente du recours aux grilles Journal of Politics, 18, 1956. 67
ENJEUX politologue dveloppementaliste la recherche des voies de la modernisation politique, c'est--dire, ses yeux, de l'a lignement sur les comportements, les normes et les valeurs des dmocraties librales d'Occ ident. Or, pour elle, cette modernisation devait rsulter de la mise en corrlation des cultures politiques des diverses nations avec les exigences, rputes seules rpondre aux problmes du prsent, des Etats marqus par la modernit1. Cette utilisation (et la notion de culture politique elle-mme) a fait l'objet de vives critiques portant sur l'aff irmation de l'autonomie de la culture politique par rapport la culture globale des socits, sur la thorisation de comportements prag matiques, sur le postulat d'une culture qui serait premire par rapport aux actions qu'elle inspirerait, sur la survaluation des normes et des valeurs dans les motivations de l'acte politique, sur le caractre syst matique l'excs de l'utilisation du concept de culture politique, enfin et peut-tre sur tout, sur le caractre quasi-tlologique de l'hypothse dveloppementaliste qui postule, comme une vidence absolue, que chaque culture porte en elle, ct de freins lis la tradition, une propension naturelle mar cher vers la dmocratie2. Pour autant, faut-il que l'histoire, l'image de la science politique, grande consommatrice de concepts phmres, abandonne toute vellit d'utiliser, comme l'un des lments d'explication de l'histoire politique, une approche qui s'avre fconde ? Je le pense d'autant moins qu'il n'est pas vident qu'en parlant de culture politique les historiens donnent l'expression un sens identique celui si fortement critiqu par les politologues, et que, par ailleurs, ceuxci rintroduisent par d'autres voies (celle de la culture prise globalement, par exemple) 1. Lucian W. Pye, Sydney Verba (eds), Political culture and political development, Princeton, Princeton University Press, 1969 (Studies in Political Development, 5). 2. Le dbat et la critique du concept de culture politique ont t exposs par Bertrand Badie, Culture et politique, Paris, Economica, 1986, en particulier dans le chapitre 3, L'chec d'une science politique de la culture . 68 la notion frappe d'anathme3. Qu'enten dent donc les historiens lorsqu'ils parlent de culture politique ? O QU'EST CE QUE LA CULTURE POLITIQUE ? Il est vident qu'il serait absurde de prtendre sparer artificiellement la culture politique de la culture globale d'une socit donne un moment de son histoire. Mais se rfrer au terme mme de culture implique un problme de dfinition. Du mme coup, l'hi storien se trouve confront un problme s mantique d'une invraisemblable complexit, tant les acceptions du mot culture ont t nombreuses depuis le 18e sicle, suscitant, en raison des arrires-plans qu'il suggre, de vigoureuses polmiques partir du 19e sicle4. Disons, pour simplifier, que l'hi storien retient gnralement la dfinition de caractre anthropologique, qui voit dans la culture l'ensemble des comportements col lectifs, des systmes de reprsentation, des valeurs d'une socit donne. Quant la culture politique, elle serait l'ensemble des composantes de cette culture s'appliquant au politique, ce qui implique que son extension peut varier d'une priode l'autre de l'his toire et d'un systme politique un autre. En d'autres termes, des lments comme les structures de sociabilit, les rgles thiques, les canons de l'esthtique, les pratiques de la vie prive, peuvent ou non, en fonction de ces variables, faire partie de la culture politique. C'est aussi reconnatre que, la solidarit tant profonde entre les divers paramtres qui constituent une culture, la culture politique se trouve plus ou moins directement colore par les autres lments constitutifs de la culture globale. Cette observation faite, et mme si l'on ne retient que les facteurs qui concourent 3. On en prendra pour exemple Bertrand Badie, ibid., dont toute la troisime partie, intitule L'analyse culturelle des systmes politiques , propose une tude de l'Etat dans la culture islamique d'une part, dans la culture chrtienne de l'autre, qui ne diffre gure de ce que les historiens dnomment culture politique . 4. On en prendra la mesure en lisant l'excellent livre de Philippe Bnton, Histoire de mots : culture et civilisation, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1975.
ENJEUX l'explication du politique, la culture politique apparat comme un ensemble complexe, form de strates htrognes, mais solidaires entre elles1. On y dcouvre, en soubasse ment, des racines philosophiques qui tr aduisent une conception globale du monde et de son volution, de l'homme et de la socit. Bien entendu, ces racines ne sont clairement connues qu'au niveau d'une mince lite intellectuelle et, mme au sein de celleci, elles font rarement l'objet d'un discours explicite. Mais elles pntrent dans la masse du groupe qui se rclame de cette culture politique sous la forme d'une vulgate et surtout de l'affirmation des consquences pratiques tirer des prmisses philoso phiques ou doctrinales. Peu de marxistes ont lu Marx, mais les rfrences la lutte des classes ou la socit future dans laquelle chacun recevra selon ses besoins renvoient implicitement au marxisme. La pense ratio naliste hrite de la philosophie du 18e sicle ou le positivisme du 19e sicle s'expriment le plus souvent par la rfrence une hu manit en marche vers le progrs ou par l'aspiration une socit laque claire par les lumires de la science. Et si le solidarisme de Lon Bourgeois est peu connu des Fran ais, le frquent appel la mise en uvre des moyens de la solidarit au sein de la socit franaise alimente un inpuisable dis cours qui le rend largement prsent au niveau des pratiques2. En remontant les strates de la culture politique, on met ensuite au jour la riche palette des rfrences historiques. L'histoire procure la culture politique une rserve quasi illimite de dates cls et de grands hommes, de textes fondateurs et d'vne ments symboliques qui, avec le recul du temps et la dformation instrumentale du pass, prennent valeur normative. Sans doute 1. On trouvera un exemple dans un ouvrage collectif largement bti autour de la rflexion sur la culture politique rpublicaine, S. Berstein, O. Rudelle (dir.), Le modle rpublicain, Pans, PUF, 1992. 2. S. Berstein, Histoire du Parti radical, tome 1, ha recherche de l'ge d'or, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1980, p. 35-37. 69 entre la ralit historique telle qu'on peut la reconstituer et l'image qu'en donne une mmoire slective existe-t-il un profond foss. La culture rpublicaine telle qu'elle est exprime au dbut du 20e sicle se rclame ple-mle de la dmocratie athnienne, de la citoyennet romaine, de la Rvolution franaise, de la Seconde Rpublique, initia trice du suffrage universel, tout en prsentant de chacun de ces lments une vision ida lise et loigne du rel pour les besoins de la dmonstration3. Le Parti radical, plutt rserv, voire hostile dans un premier temps toute rvision du procs Dreyfus, et qui a accueilli sans sympathie aucune le ministre de Dfense rpublicaine de Waldeck-Rousseau, considrera ensuite, durant toute la premire moiti du 20e sicle, la cause drey fusarde comme l'vnement fondateur de sa culture politique, et le ministre WaldeckRousseau comme la solution miracle toutes les crises subies par le pays 4. Dformation dlibre du rel ? Sans doute. Il reste que, dans l'ordre de la culture politique, c'est la lgende qui est ralit puisque c'est elle qui est mobilisatrice et dtermine l'action poli tique concrte, la lumire de la reprsen tation qu'elle propose. Fondements philosophiques et historiques de la culture politique dbouchent sur la dfinition d'un rgime idal qui leur est adquat. Le systme politique conu dans cette perspective n'est jamais vu comme un simple agencement de pouvoirs, mais comme la traduction au plan tatique des principes thoriques poss et des exemples historiques normatifs retenus. Nulle surprise dans ces conditions constater, par exemple, que la culture rpublicaine fonde sur l'idal de la nation souveraine puis dans l'hritage de la philosophie des droits naturels et sur le prcdent historique de la Rvolution fran3. Ce problme est voqu dans la premire partie du Modle rpublicain, op. cit., L'laboration du modle . 4. J. Kayser, Les grandes batailles du radicalisme, Paris, M. Rivire, 1960 et S. Berstein, Histoire du Parti radical, 2 vol. Paris, Presses de la Fondation Nationale des sciences politiques, 1980-1982. Pour le rle fondateur de l'affaire Dreyfus, voir Michel Winock, Le mythe fondateur l'affaire Dreyfus , -Le modle rpublicain, op. cit. :
ENJEUX aise, pose en principe que la loi de toute construction institutionnelle est la ncessit de prserver la libert du citoyen des in vitables abus de tout pouvoir fort, qu'il soit celui d'un monarque ou d'un dictateur pl biscitaire, et dbouche sur une conception qui confie la ralit du pouvoir l'assemble des dputs lus au suffrage universel par la nation souveraine1. Et cette conviction conduit considrer comme suspecte toute tentative de renforcer le pouvoir excutif dans un but d'efficacit (qu'il s'agisse, par exemple, des tentatives de Millerand en 1923, de Doumergue en 1934, ou des ides ex primes par Tardieu). A chaque pisode, les tenants de la culture rpublicaine y verront la preuve d'une hassable volont csarienne, voquant le spectre du Deux-Dcembre ou des relents du boulangisme. On retrouvera ce rflexe en 1946 dans la raction de Lon Blum aprs le discours de Bayeux par lequel le gnral de Gaulle propose des institutions dont le prsident de la Rpublique serait la cl de vote2. Il faudra la crise de 1958, survenant aprs de multiples difficults, et la constatation de la tragique impuissance de la Quatrime Rpublique, pour que l'ide que la Rpublique peut s'accommoder d'un excutif fort finisse par s'imposer, non sans peine, et efface en ce domaine la longue tradition contraire de la culture politique rpublicaine. Parmi les lments qui composent une culture politique, on trouve encore une vision de la socit, adquate, elle aussi, aux conceptions philosophiques et aux rfrences historiques retenues. Il n'est point de culture politique qui n'implique une reprsentation de la socit idale et des moyens d'y par venir. Y compris la culture politique librale 1. S. Berstein, Les institutions rpublicaines, .Le modle rpublicain, op. cit. 2. Voir l'article de Lon Blum au moment du discours de Bayeux, dans Uauvre de Lon Blum, Paris, Albin Michel, 1958. On trouve une raction du mme ordre dans la constitution par Edouard Herriot d'un dossier contenant les proclamations de Louis-Napolon Bonaparte le 2 dcembre 1851, au moment o il s'apprte combattre la tentative de Doumergue pour renforcer l'excutif en 1934 (Serge Berstein, Edouard Herriot ou la Rpublique en personne, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985). 70 qui voit la socit constitue d'une collection d'individus affronts dans une concurrence sauvage pour remporter la victoire dans la lutte pour la russite qui les oppose les uns aux autres, avec comme seule rgle du jeu la loi du march, impitoyable aux faibles, mal arms pour livrer ce combat. Il va de soi qu'une reprsentation de la socit est encore plus indispensable la culture poli tique marxiste qui fonde sur la lutte des classes l'ensemble de ses analyses sociopolitiques et qui place ses espoirs dans l'avnement d'une socit sans classe o la proprit collective des moyens de product ion mettrait dfinitivement fin aux armes d'exploitation des opprims places aux mains de la classe dominante. Mais on trouve aussi une vision de la socit dans la culture politique rpublicaine ou dans la culture dmocrate-chrtienne avec, curieusement, la mme conception d'une socit o la pro prit prive et l'initiative individuelle main tiendraient les principes cls du libralisme, mais corrigs par une intervention extrieure, celle de l'Etat dans le premier cas, celle de la collaboration des classes dans le second, les deux se rclamant de la solidarit des individus au sein du corps social. A ces rubriques fondamentales constitu tives de la culture politique, il faudrait encore ajouter l'ensemble du systme de reprsent ations des divers groupes concerns ayant un rapport avec le politique et pouvant, par consquent, englober de manire trs large selon les poques et les rgimes bien d'autres lments de la culture globale d'une socit, qui peuvent prendre un sens politique, par exemple, les croyances religieuses, l'organi sation du systme scolaire, la cration artis tique, les rgles morales... A la limite, on peut considrer que, dans certains cas, c'est toute la culture dominante d'une socit qui constitue sa culture politique3. 3. Ce cas limite est atteint dans les situations o la culture politique est trs fortement imprgne des principes spirituels qui sont ceux de la socit globale. Voir, par exemple, le cas de l'islam dans B. Badie, Culture et politique, op. cit. Il joue aussi pour les totalitarismes modernes (voir S. Berstein, Dmocraties,
ENJEUX Enfin, la culture politique s'exprime par un certain nombre de moyens qui sont les formes principales par lesquelles elle se man ifeste ordinairement et est le plus souvent perue. Avant tout, par un discours spci fique chacune des cultures politiques, dis cours qui renvoie tout un univers implicite et qui permet d'emble tous ceux qui sont partie prenante de cette culture de se r econ atre. Vocabulaire propre, mots cls indispensables constituent ainsi une forme de langage cod qui renseigne d'emble sur l'appartenance de ceux qui les emploient et voquent, sans qu'il soit besoin d'expliciter davantage tous les autres lments de la culture politique concerne. A cet gard, les travaux sur le discours politique fournissent de prcieux renseignements sur les non-dits qui recouvrent en ralit de riches arrireplans1. Le simple fait qu'un discours commence par mesdames et messieurs ou par chers amis plutt que par citoyens ou camarades permet coup sr de situer la culture politique (et la famille politique) dont se rclame l'orateur. Il en va de mme des multiples symboles ou rites politiques qui sont comme l'expression rsume, mais parfaitement parlante, d'une culture politique sous-jacente : le bonnet phrygien, la croix de Lorraine, la faucille et le marteau, la rose sont autant de manifestes fort explicites. Nul n'ignore ce que signifie en Europe dans l'entre-deux-guerres le poing lev ou le bras tendu. Et la scnographie des grandes man ifestations politiques en dit long sur la volont d'voquer toute une culture poli tique en s'adressant au sentiment plutt qu' la raison2. Ce qui ne signifie nullement (et nous y reviendrons) que l'utilisation des symboles et des rites implique tout rejet du raisonnement. Elle signifie seulement que, celui-ci ayant dj t frquemment effectu, rgimes autoritaires et totalitarismes au XXe sicle, Paris, Hachette, 1992). 1. Voir A. Prost, Les mots , dans Ren Rmond et al. Pour une histoire politique, Paris, Le Seuil, 1988. 2. Philippe Burrin, Poings levs et bras tendus, la contagion des symboles au temps du Front populaire , Ving time sicle. Revue d'histoire, 11, juillet-septembre 1986. 71 il suffit en quelque sorte de l'voquer som mairement, sous la forme rsume du symb ole, pour retrouver la substance de la culture politique qu'il reprsente. En d'autres termes, la culture politique telle qu'elle apparat l'historien est un systme de reprsentations fond sur une certaine vision du monde, sur une lecture signifiante, sinon exacte, du pass historique, sur le choix d'un systme institutionnel et d'une socit idale, conformes aux modles retenus, et qui s'exprime par un discours cod, des symboles, des rites qui l'voquent sans qu'une autre mdiation soit ncessaire. Mais ce systme est porteur de normes et de valeurs positives pour celui qui adhre cette culture, et constitue ainsi l'aune laquelle il mesure la validit de toute action et de toute position politique. O CULTURE POLITIQUE DOMINANTE ET FAMILLES DE CULTURES POLITIQUES On ne s'est intress jusqu'ici qu'au contenu de la culture politique sans voquer un problme cl, celui du groupe concern. A cet gard, les politologues comparatistes de l'cole dveloppementaliste considrent, de manire plus ou moins explicite, qu'il existe des cultures politiques nationales issues des traditions historiques propres chaque nation, et leur comparaison porte d'ailleurs sur une dizaine de pays pour lesquels ils confrontent cette culture nationale au pro cessus de modernisation3. Tout au plus admettent-ils qu'il existe une dichotomie l'intrieur de chaque nation entre culture des lites et culture de masse. On voit bien les raisons qui conduisent une telle analyse et qui rsultent de l'existence d'une langue commune, d'expriences vcues en commun, de problmes poss dans le pass ou dans le prsent et qui concernent l'ensemble du groupe national, de pratiques sociales que tous mettent en uvre... Mais cette concept ion conduit peu ou prou considrer que, op. 3. Lucian W. Pye, Sydney Verba (eds), Political culture...,
ENJEUX du mme coup, il existe des dterminants qui conduiraient accorder une homognit quasi totale et un caractre immuable la culture politique des nations considres, que le caractre national des peuples (que l'on a jamais dfini autrement que par l'ob servation de ses pratiques) perdurerait travers l'histoire et dboucherait ainsi sur quelque moderne thorie des climats . Sans nier qu'il existe un dnominateur commun aux diverses cultures politiques d'une nation, li aux facteurs voqus cidessus, l'observation conduit plutt, semblet-il, considrer que ces cultures sont plu rielles. A partir de l, ce qu'on dnomme culture politique nationale parat plutt re lever de l'existence d'une culture dominante un moment donn de l'histoire. En d'autres termes, il s'agirait d'un ensemble de repr sentations correspondant si exactement aux aspirations des groupes mergents de la population que la plus grande partie des citoyens d'un pays donn en partagerait les fondements, quand bien mme ils se rcl ameraient de cultures politiques diffrentes. Plongeant ses racines dans un pass histo rique relativement loign, mais positiv ement connot pour une grande partie de la nation, cette culture politique dominante apparat alors quasi consensuelle, d'autant que sa lente laboration lui a donn valeur d'une tradition. Tel est le cas, par exemple, de la culture rpublicaine au dbut du 20e sicle. Elle parle d'autant plus aux Fran aisqu'elle incorpore un certain nombre des traits communs de la culture globale dans lesquels ils se reconnaissent : la rfrence au cartsianisme, la conception d'un Etat uni taire et centralis vers lequel tendait la France d'Ancien Rgime et qui s'est concrtis l'poque consulaire, une thique directement issue du no-kantisme mais dans laquelle se reconnaissent les croyants qui, pour leur part, rapportent ses principes leur foi. A ces lments communs d'autres cultures politiques au sein de la nation, la culture politique rpublicaine ajoute ses lments spcifiques qui rendent compte de son 72 ractre dominant. Se prsentant comme ayant vocation accomplir les promesses de la Rvolution franaise, comme le vecteur du progrs annonc par les philosophes des Lumires et les disciples d'Auguste Comte, brandissant ses Tables de la loi, la Dcla ration des droits de l'homme et du citoyen, elle apparat aux Franais comme un modle pour l'humanit tout entire, ayant su raliser la synthse de la dmocratie et du libralisme et se prparant instaurer dans la libert du citoyen, garantie par le rgime parle mentaire, une socit o chacun pourra esprer raliser une promotion sociale grce l'ducation pour tous et l'accession gnralise la proprit1. Idal suffisam ment mobilisateur pour rassembler autour de lui une large majorit de Franais et fonder une tradition qui perdurera jusqu'au milieu du 20e sicle, avec cependant une critique de plus en plus nette de ses limites et de ses insuffisances ds les annes 19302. Pour autant, cette culture politique do minante n'est pas, tant s'en faut, en situation de monopole. Il existe au mme moment des cultures issues de traditions antagonistes, qui ne se satisfont ni des reprsentations, ni des objectifs qu'elle propose. C'est le cas de la culture politique contre-rvolutionnaire qui rejette tous les fondements de la culture politique rpublicaine, commencer par l'exaltation de la priode fondatrice de la Rvolution franaise, et qui, pour sa part, se rclame de la socit d'Ancien Rgime, opposant l'organicisme la philosophie du droit naturel, les communauts au triomphe de l'individu, l'hrdit l'lection, les l iberts des groupes constitus la dmocratie, les hirarchies l'galitarisme. A l'autre extrmit de l'chiquier politique, la culture politique marxiste n'est pas moins antith tique de la culture politique dominante en France. Elle ne voit dans la Rvolution publicain, 1. S. Berstein, La culture rpublicaine, Le modle r op. cit. 2. N. Roussellier, La contestation du modle rpublicain dans les annes trente la rforme de l'Etat , Le modle rpublicain, op. cit. :
ENJEUX franaise qu'un mouvement bourgeois qui s'est impos en crasant le proltariat, et son idal se situe du ct des vaincus de la priode dmocratique 1792-1794 et plus en core de ceux de la Commune de Paris de 1871. Pour elle, les liberts politiques prnes par les Rpublicains ne sont que des liberts formelles, la Dclaration des droits de l'homme, un habile paravent dissimulant les intrts de classe de la bourgeoisie, le r formisme dont se targue la Rpublique, un discours rhtorique permettant la classe dominante d'affermir sa prpondrance en berant le proltariat de bonnes paroles. En se prsentant aprs 1920 comme le seul porteparole lgitime de la culture politique marx iste, le Parti communiste, ses origines, durcira encore le caractre antagoniste de celle-ci par rapport la culture rpublicaine en choisissant d'adopter une attitude dl ibrment provocante son gard1. C'est dire qu'il existe, du moins en France, une pluralit de cultures politiques (avec des variantes introduites par l'histoire, comme le nationalisme la fin du 20e sicle qui concerne la famille rpublicaine et la famille contre-rvolutionnaire). Pour autant, rp tons-le, les divergences entre elles sont r arement totales, puisque les unes et les autres s'inscrivent dans la mme culture globale et, agissant au sein de la mme socit, s'influencent rciproquement. d'abord par les conditions de son laborat ion. Celle-ci est le fruit d'un processus historique qui combine, dans un ensemble solidaire, des ides, des vnements qui prennent valeur de mythes fondateurs avec les aspirations de la population, pour consti tuercet ensemble de reprsentations por teuses de valeurs et de normes, qui fait figure d'idal mobilisateur d'un groupe un moment donn de l'histoire. Cette labora tion est lente car elle se nourrit d'un devenir historique qui prend valeur signifiante. Ainsi la culture politique rpublicaine, qui se fixe dans les trente dernires annes du 19e sicle, rincorpore dans son contenu une Rvolut ion franaise revue et corrige dont elle va faire le tournant de l'histoire du monde en fonction des valeurs qu'elle entend privil gier, et la geste rvolutionnaire du 19e sicle avec la lutte des libraux contre la monarchie, celle des Rpublicains contre le rgime de Juillet, celle des adversaires de gauche du Second Empire. Par haine de ce dernier rgime, elle prnera un pouvoir excutif contrl et limit. Elle finira par inclure dans son systme normatif les institutions de 1875 (vis--vis desquelles la majorit des Rpublicains a cependant manifest les plus vives rserves) parce qu'il a fallu les dfendre contre le retour offensif des monarchistes ou des partisans d'une rpublique consulaire. Elle trouvera enfin le point d'orgue lui permettant de rassembler ces lments pars O LA CULTURE POLITIQUE : avec l'affaire Dreyfus qui rigera dfinit UN PHNOMNE VOLUTIF ivement en valeurs rpublicaines le primat de la libert et des droits de l'individu, Une des raisons qui conduit mettre en doute l'existence de cultures issues du ca l'anticlricalisme militant, la mfiance envers ractre national des peuples est le fait les pouvoirs tablis et, tout particulirement, la caste des militaires de carrire2. Le mme qu'une telle notion conduirait une fixit processus d'laboration vaut pour toutes les de la culture politique qui perdurerait autres cultures politiques, le traditionalisme travers toutes les priodes de l'histoire. Or exaltant un Ancien Rgime reconstruit par l'observation parat dmentir cette vision des choses et mettre en vidence le caractre une mmoire slective, et le marxisme en rlant sous sa bannire Gracchus Babeuf et volutif du phnomne. les Egaux , les canuts de Lyon et les Evolutive, la culture politique l'est 1. Voir j.-j. Becker, S. Berstein, Histoire de l'anticommunisme en France, tome 1, 1917-1940, Pans, O. Orban, 1987. 73 2. Miche] Winock, Le mythe fondateur l'affaire Dreyf us , Le modle rpublicain, op. cit. :
ENJEUX fdrs de la Commune. La culture politique apparat ainsi comme le produit d'une his toire revue et corrige, fondatrice de tra ditions. Construction de la mmoire collective, l'importance de la culture politique rside dans l'adhsion des individus qui l'intrio risent et en font ainsi un des moteurs (mais non le seul) de leurs comportements poli tiques. Ce passage essentiel du collectif l'individuel motivant les actes politiques s'opre par les canaux habituels de la socia lisation. En premier lieu, par la famille, cellule de base de l'ducation o se fait l'acquisition des normes et des valeurs, o s'acquiert une conception du monde que l'adulte ne conservera pas ncessairement sa vie durant, ne serait-ce que parce que les conceptions ou l'environnement se modif ient, mais qui a toutes chances de le marquer durablement. Ensuite, par le systme scolaire et universitaire qui, mme s'il se veut apo litique, n'est jamais neutre en termes de choix culturels. Les livres de lecture, les leons de morale et d'instruction civique, les cours d'histoire et de gographie de l'cole de Jules Ferry ont jou un rle majeur dans la diffusion de la culture rpublicaine comme forme de culture dominante de la France de la fin du 19e et du dbut du 20e sicle, mme si l'auteur de la Lettre aux instituteurs recommandait ces der niers de dispenser un enseignement qui soit susceptible de ne choquer aucune famille politique. La socialisation se fait ensuite l'arme, au travail, dans les groupes poli tiques ou les associations. Ajoutons-y le poids du discours officiel et l'influence de la presse, puis, au 20e sicle, celle de la radio et de la tlvision. Le climat culturel ainsi instaur diffuse des thmes et des modles qui, de manire indirecte, voire insidieuse, prparent la rception d'un message po litique dtermin. C'est bien cette prpon drance du culturel par rapport au politique dont avait pris conscience la Nouvelle droite en fondant le GRECE dont l'objet tait de conqurir le terrain culturel par une action 74
baptise mtapolitique 1. Cette diffusion de la culture politique par les vecteurs de la socialisation implique cependant que son implantation et ses modifications cheminent lentement, soit pratiquement l'chelle de la gnration. Le processus d'laboration d'une culture politique et les canaux par lesquels elle se diffuse impliquent l'vidence qu'on n'est nullement en prsence d'un phnomne im mobile. En fait, une culture politique est vivante et ne cesse d'voluer sous l'effet de diverses influences. Et, en premier lieu, de l'volution de la conjoncture gnrale. Mme si le poids des traditions lgues par le pass ou l'cole est important dans les comport ements politiques, il va de soi qu'une culture politique ne se nourrit pas que de l'histoire. Elle doit composer avec les problmes du prsent, et ceux-ci contribuent inflchir de manire dcisive les donnes antrieures. On a vu, par exemple, que la culture politique rpublicaine plaait son idal social dans la constitution d'une dmocratie de petits pro pritaires gaux. Or l'volution du 20e sicle rend cet idal de plus en plus obsolte. L'inflation hrite de la premire guerre mondiale et la dcouverte du modle amr icain de production et de consommation de masse lui portent un coup ds les annes 1920. Ebranl par la crise conomique, il est, aprs le sursis de la seconde guerre mondiale et de l'immdiat aprs-guerre, to talement dpass avec le phnomne de la croissance qui privilgie des notions nouv elles comme celles d'investissement ou de rentabilit, qui lui sont totalement tran gres. Du coup, et pour tenir compte de cette volution (et de bien d'autres), le modle rpublicain subit une mutation totale qui lui fait revtir un nouveau visage, lequel s'inscrit toutefois dans le cadre gnral de la tradition rpublicaine2. Il est donc clair 1. A. -M. Duranton-Crabol, Visages de la Nouvelle droite, le GRECE et son histoire, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1988. 2. S. Berstein, La Ve Rpublique un nouveau modle rpublicain ? Le modle rpublicain, op. cit. :
ENJEUX qu'une culture politique, si elle survit, ne peut le faire qu'en s'adaptant aux problmes nouveaux poss par l'volution. A dfaut, elle se trouve condamne la disparition plus ou moins court terme. Mais la culture politique volue galement sous l'effet de l'influence des autres cultures, car, pas plus qu'elle ne constitue un systme fixe, elle n'apparat comme un ensemble clos. La coexistence cte cte, au sein d'une mme socit, d'une pluralit de cultures a pour effet de provoquer entre elles un jeu d'influences rciproques dont aucune ne sort indemne. Il est clair, par exemple, que le poids de la culture rpublicaine dans la France de la fin du 19e et du dbut du 20e sicle a eu pour rsultat la ncessit pour les autres cultures politiques de s'adapter aux raisons qui faisaient son audience, sous peine de marginalisation. C'est ainsi que la culture politique du catholicisme, radical ement trangre la culture rpublicaine par ses fondements philosophiques, subit suff isamment l'attraction de la dmocratie librale pour qu'en dpit des condamnations pont ificales et des rticences de nombreux fidles finisse par natre un courant dmocratechrtien qui tente de raliser une synthse entre les principes rpublicains et ceux du catholicisme1. De la mme manire, on a vu l'altrit quasi totale qui marque la culture marxiste par rapport la culture rpublicaine. Or la prise de conscience par les dirigeants socialistes de l'impossibilit de faire triom pher leurs ides dans de larges secteurs de l'opinion en s'opposant une culture r publicaine si profondment enracine dans la conscience collective, les conduit raliser une synthse entre rpublique et socialisme, qui donne naissance une nouvelle variante dans laquelle la rpublique est considre comme la premire tape, politique, d'une volution progressiste dont le socialisme sera 1. J.-M. Mayeur, Des partis catholiques la dmocratie chr tienne (XIX '-XXe sicles), Paris, A.Colin, 1980; J.-C. Delbreil, Centrisme et dmocratie-chrtienne en France. Le Parti dmocratepopulaire des origines au MRP, 1919-1944, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990. 75 le couronnement social2. Ce qui, au-del des formules rhtoriques, peut se traduire par une vritable conqute par la culture politique rpublicaine d'une importante frac tion de la famille marxiste, ouvrant ainsi une re de dchirements et de crises au sein de celle-ci, autour du problme central du pouvoir3. Du moins pourrait-on penser que, dans sa version communiste, la culture po litique marxiste (-lniniste, dans ce cas) d emeure totalement prserve de toute contagion de ce type. La volont affirme du Parti communiste jusqu'en 1934 d'ap paratre en rupture complte avec le modle dominant incline en juger ainsi. Et cepen dant, en s'appuyant sur des archives inex ploites jusque-l, Serge Wolikow a montr dans sa thse (malheureusement indite ce jour) que les dirigeants communistes fran ais, conscients de leur difficult pntrer l'ensemble social en raison de la situation de corps tranger dans la nation de leur parti, ont tent, diverses reprises, durant les annes 1920, de trouver eux aussi un compromis avec la culture rpublicaine do minante. Si celui-ci n'est pas mis en uvre avant 1934, c'est seulement en raison de l'opposition dtermine de l'Internationale4. A l'inverse, il ne fait aucun doute que le poids grandissant de la culture politique marxiste (ou socialiste) dans la France de la fin du 19e ou du dbut du 20e sicle a jou un rle majeur dans l'inclusion, au sein de toutes les autres cultures politiques, de d imensions sociales rformistes. O LES FONCTIONS DE LA CULTURE POLITIQUE Quel est l'intrt, pour l'historien, de l'tude de la culture politique ? Il est d'ap porter une rponse au problme essentiel des motivations de l'action et des compor2. A. Bergounioux, Socialisme et Rpublique avant 1914 , Le modle rpublicain, op. cit. 3. A. Bergounioux, G. Grunberg, Le long remords du pouvoir, le Parti socialiste franais 1905-1992, Paris, Fayard, 1992. 4. Serge Wolikow, Le Parti communiste franais et l'Inter nationale communiste (1926-1933), thse d'Etat, Universit ParisVIII, 1990.
ENJEUX tements politiques. La prise en compte de la culture politique n'offre pas, cela va de soi, une cl universelle et unique de compr hension du politique, mais un lment parmi d'autres, qui entre en composition avec les divers paramtres voqus au dbut de cet article. Toutefois, par rapport ceux-ci, on peut se demander si la culture politique ne constitue pas le noyau dur de la motivation. Rsultat d'une longue laboration, acquise par l'individu l'poque de sa formation intellectuelle, renforce au feu des vne ments et des engagements politiques, elle est tout le contraire d'un engouement pas sager ou d'un phnomne contingent. Mme si, l'origine, elle est le rsultat d'un ap prentis age et d'une rflexion approfondie, elle tire sa force du fait que, une fois acquise, elle est largement intriorise et structure dsormais le comportement politique pour une longue priode, voire pour toute une existence. Est-ce dire qu'elle relve du seul domaine de l'motionnel et de l'instinctif ? Ce serait oublier qu'elle a fait l'objet, l'origine, d'une laboration rflchie et que les actes politiques qui ont contribu la faonner ont ncessit une dcision qui ne s'est faite ni sans motivations clairement perues, ni sans volont lucide. Militer pour une cause, s'engager dans une action poli tique, voter pour un candidat plutt que pour un autre, ne relve pas de l'instinctif. Simplement, les expriences initiales ont t assez marquantes pour qu'il ne soit pas ncessaire chaque acte politique nouveau de reprendre les dbats qui ont conduit la dcision, de refaire les tapes du raiso nnement, de remettre en balance les argu ments. Mais les consquences sont import antes. L'intriorisation de la culture poli tique rend celle-ci si prgnante qu'elle fait dsormais partie de l'tre, qu'elle relve non plus du raisonnement, mais de l'adhsion profonde et que, du mme coup, elle devient trs malaise remettre en cause par un raisonnement contraire. Il faut une crise aigu, un grave traumatisme pour y parvenir. Encore n'est-on pas sr du caractre durable 76 de cette remise en question. Le traumatisme de la dfaite de 1940 parat avoir port un coup mortel la culture politique rpubli caine. Et cependant, lorsque la rvolution nationale voudra faire triompher en France un rgime fond sur de tout autres bases, elle chouera dans une large mesure, et les lendemains de la Libration verront revenir en force cette culture rpublicaine nagure vilipende1. L'intrt de l'tude historique de la culture politique est d'autant plus grand que si, en dmocratie, l'acte politique est individuel, la culture politique, elle, est collective et concerne des groupes entiers, appartenant la mme gnration, c'est--dire ayant vcu en mme temps des expriences identiques 2. C'est ainsi qu'on peut voquer toute une gnration d'hommes de gauche, ns vers 1870-1880, et dont l'exprience dterminante sera la lutte pour la rvision du procs Dreyfus, qui la marquera durablement et l'imprgnera d'une culture politique faite de la dfense des droits et des liberts de l'individu, de la fidlit absolue la Rpub lique parlementaire et de la dfiance envers tout pouvoir autoritaire, de l'attachement la lacit de l'Etat et de la socit, de la croyance absolue au magistre de la raison, de la priorit donne aux problmes d'du cation, garantie d'une socit de progrs o triompheront les Lumires et o des chances gales seront offertes tous de raliser une promotion sociale. Or cette culture politique, profondment intriorise, deviendra le guide de l'action politique de toute cette gnration qui est celle de Blum, d'Herriot, de Violette, de Paul-Boncour et de bien d'autres... Pour eux, et jusqu' la fin de leurs jours, la validit de toute action politique se mesure l'aune des principes qui ont inspir leur action l'poque de l'affaire 1. J.-P. Azma, Vichy face au modle rpublicain, et S. Berstein La IVe Rpublique : rpublique nouvelle ou res tauration du modle de la IIIe Rpublique ? , Le modle rpub licain, op. cit. 2. Pour la notion de gnration, on consultera le numro spcial Les gnrations de Vingtime sicle. Revue d'histoire, dirig par J.-P. Azma et M. Winock (n 22, avril 1989) et J.F. Sirinelli, Gnration intellectuelle, Paris, Fayard, 1988.
ENJEUX Dreyfus. Ce qui les conduira rejeter tout ce qui paratrait s'en carter, qu'il s'agisse de dlgations de pouvoir qui dessaisiraient le Parlement, de toute concession aux doc trines qui battraient en brche le primat de la raison, de toute tentation autoritaire ou des tentatives qui, au nom de la raison d'Etat, aboutiraient limiter la libert du citoyen ou la souverainet des lus de la nation \ Si la culture politique a ainsi pour fonction premire de rendre compte des motivations de l'action politique, ce n'est pas, tant s'en faut, son seul rle. Il faut aussi prendre en compte celui qu'elle joue comme facteur d'identification du groupe qui se rclame d'elle, l'extrieur et l'intrieur. A l'ex trieur du groupe, la prise en compte de la culture politique dont il est porteur permet de le caractriser, de mieux le connatre, de prvoir, dans une trs large mesure, les ractions de ses membres et, du mme coup, de le rendre intelligible aux autres. A l'i ntrieur du groupe, cette fonction d'identi fication de la culture politique est encore plus dterminante. C'est l'adhsion aux prin cipes qu'elle affirme qui forme la base la plus solide de l'appartenance politique (beau coup plus que l'inscription officielle ou le paiement d'une cotisation). Mme s'il n'y a pas formellement entre dans une formation politique, l'acceptation des thmes fonda mentaux de la culture qu'elle diffuse conduit le citoyen s'identifier un groupe, en 1. C'est une tentative de relecture de la carrire d'Edouard Herriot la lumire de la culture politique dont il tait porteur que nous avons tente dans Edouard Herriot ou la Rpublique en personne, op. cit. partager les buts et les espoirs et, bien entendu, se prononcer pour lui dans un ventuel scrutin. Cette dimension sentiment ale, voire motionnelle de la culture poli tique explique que, pour les membres du groupe concern, elle soit le lieu d'une vritable communion dans laquelle se retrouvent, avec un fort sentiment de soli darit, tous ceux qui participent des mmes rfrences, du mme systme de reprsen tationset pour qui symboles et discours revtent les mmes significations. Nous sommes donc en prsence, avec la notion de culture politique, d'un concept qui a dj largement prouv sa fcondit par les quelques travaux qui ont utilis ce moyen d'analyse. Sans doute faudrait-il se garder d'en faire le facteur unique et pri vilgi de l'explication des comportements politiques, et il importe de conserver pr sentes l'esprit les critiques adresses par les politologues ceux d'entre eux qui ont entendu en faire un usage systmatique et la cl d'une approche comparatiste des r gimes politiques. Il reste que, utilise avec discernement, elle ouvre aux historiens un champ de recherches encore presque inex plor et susceptible d'enrichir singulirement l'approche historique des phnomnes po litiques. D
Membre du comit de rdaction de Vingtime sicle. Revue d'histoire, Serge Berstein a dirig avec Odile Rude/ie Le modle rpublicain, Paris, PUF, 1992.
11
Vous aimerez peut-être aussi
- Dissertation ObligationDocument3 pagesDissertation ObligationyassinedoPas encore d'évaluation
- Themes FormationDocument8 pagesThemes FormationBLEYPas encore d'évaluation
- Chefs de Tribus Et Murabitun. Des ElitesDocument8 pagesChefs de Tribus Et Murabitun. Des ElitesbenPas encore d'évaluation
- Collaborateur Triade NoireDocument2 pagesCollaborateur Triade NoireChersonPas encore d'évaluation
- EEG Et Pathologies Infectieuses, Métaboliques, Toxiques, Vasculaires, Tumorales Et Dégénératives DIUdécembre09Document96 pagesEEG Et Pathologies Infectieuses, Métaboliques, Toxiques, Vasculaires, Tumorales Et Dégénératives DIUdécembre09aandreiiPas encore d'évaluation
- Haulotte Compact 10Document176 pagesHaulotte Compact 10Krum Kashavarov100% (2)
- Dossier Standard de Demande de Prix Pour La Passation Des Marches de Fournitures Et D'equipements 1Document87 pagesDossier Standard de Demande de Prix Pour La Passation Des Marches de Fournitures Et D'equipements 1Narcisse TuinaPas encore d'évaluation
- BIMBENET. L'homme Est Infiniment Plus Qu'un AnimalDocument8 pagesBIMBENET. L'homme Est Infiniment Plus Qu'un AnimaljffweberPas encore d'évaluation
- CCHST - Politique en Matière de Santé Et Sécurité Au Travail - Élaboration Et Mise en ŒuvreDocument10 pagesCCHST - Politique en Matière de Santé Et Sécurité Au Travail - Élaboration Et Mise en ŒuvreBeka BogveradzePas encore d'évaluation
- Fichier Produit 389Document2 pagesFichier Produit 389Ahmed GuettafPas encore d'évaluation
- Lecon 1 PapierDocument13 pagesLecon 1 PapierRoland YvesPas encore d'évaluation
- Fiche4 Muller DoligezDocument3 pagesFiche4 Muller DoligezHappy ManPas encore d'évaluation
- Baccalaureat Session 2022 Textes Definitif g7Document17 pagesBaccalaureat Session 2022 Textes Definitif g7mamaPas encore d'évaluation
- Ueeso-Ci: Le PrésidentDocument1 pageUeeso-Ci: Le PrésidentFulgence ToboPas encore d'évaluation
- La Voie Du DoctorantDocument19 pagesLa Voie Du DoctorantsindaPas encore d'évaluation
- Droit ComparéDocument52 pagesDroit ComparéH-Janne JuangPas encore d'évaluation
- Ong OigDocument11 pagesOng OigwikilikPas encore d'évaluation
- La Symphonie RougeDocument12 pagesLa Symphonie Rougejuliusevola1100% (2)
- Philosophie Commentaire de Texte Methodo-3 PDFDocument4 pagesPhilosophie Commentaire de Texte Methodo-3 PDFNoraMatouPas encore d'évaluation
- Les Théories de La Motivation Approches ClassiquesDocument16 pagesLes Théories de La Motivation Approches ClassiquesZakaria Essalihi100% (2)
- These AFLDocument431 pagesThese AFLAbdellah ChaffaurPas encore d'évaluation
- GageDocument3 pagesGageHoussam El garniPas encore d'évaluation
- Julien MisopogonDocument26 pagesJulien Misopogongustavog1956Pas encore d'évaluation
- Textes Modele Métiers 2019Document1 pageTextes Modele Métiers 2019anapiaPas encore d'évaluation
- RC Model 3 Decl Succursales Ou AgencesDocument2 pagesRC Model 3 Decl Succursales Ou AgencesdahouzmPas encore d'évaluation
- Défenseur Des Droits PDFDocument2 pagesDéfenseur Des Droits PDFCyril DELACOURPas encore d'évaluation
- Annales AkashiqueDocument9 pagesAnnales Akashiquesiklon67% (3)
- Bluebossa-Intro-Michel CamiloDocument1 pageBluebossa-Intro-Michel CamiloMario Gabriele100% (1)
- Securite Immeuble IghDocument2 pagesSecurite Immeuble IghDaouda NDOYEPas encore d'évaluation