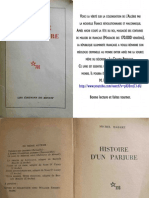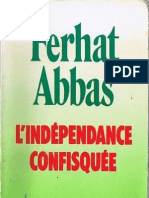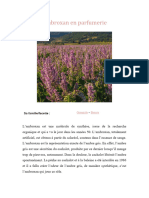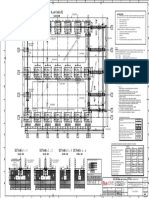Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ecologie La Grande Arnaque
Ecologie La Grande Arnaque
Transféré par
giobdCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ecologie La Grande Arnaque
Ecologie La Grande Arnaque
Transféré par
giobdDroits d'auteur :
Formats disponibles
Christian Gerondeau
cologie,
la grande arnaque
Albin Michel
Table
I. Tout va mal............................................................................................................ 8
II. Le flux et le stock............................................................................................... 13
III. Bons et mauvais lves ..................................................................................... 22
IV. Gaspillages tous les tages ............................................................................. 35
V. Le pch originel............................................................................................... 63
VI. Les voitures et les vaches .................................................................................. 72
VII. Le rapport Stern.............................................................................................. 83
VIII. Alors, que faire ? ............................................................................................ 93
IX. L'air que nous respirons................................................................................ 107
X. La danseuse de la Rpublique ........................................................................ 122
XI. Nos villes paralyses ....................................................................................... 143
XII. Tout ne va pas mal !...................................................................................... 161
3
INTRODUCTION
Soyons clair.
L'arnaque, ce n'est pas d'affirmer la ralit du rchauffement climatique. Mme si
le mouvement n'est pas uniforme le mois de juin 2007 a t dans notre pays le plus
froid depuis un demi-sicle , qui pourrait srieusement nier que nous connaissons
depuis deux dcennies des hivers, des printemps, des ts et des automnes tonnam-
ment chauds ? Les cologistes ont raison quand ils proclament la gravit des dangers
qui peuvent menacer la plante.
L'arnaque, ce n'est pas non plus de rpter que l'homme est sans doute responsa-
ble de ces changements. Mme s'il n'y a pas l de certitude absolue, la grande majori-
t des spcialistes jugent qu'il existe de fortes chances que le rchauffement actuel soit
li aux activits humaines, et il est probable qu'ils ne se trompent pas.
La grande arnaque, ce sont les centaines de milliards d'euros ou de dollars prlevs
sur les contribuables du monde entier au bnfice d'intrts particuliers et gaspills
chaque anne sans aucun rsultat, au nom d'hypothtiques remdes aux risques qui
nous menacent.
Car si les cologistes ont raison quand ils dnoncent la ralit des dangers, ils s'op-
posent avec la plus grande vigueur aux mesures qui permettraient de les loigner. La
rationalit cde alors la place l'idologie.
Parce qu'ils refusent le nuclaire, qui est la seule manire de produire massivement
de l'lectricit sans rejeter de gaz carbonique, le fameux CO
2
, ils ont invent le mythe
des nergies renouvelables , or celles-ci ne peuvent jouer au mieux qu'un rle mar-
ginal, quand elles n'aggravent pas les choses. En s'opposant au tout nuclaire , ils
ont engendr le tout CO
2
.
Parce qu'ils refusent l'automobile, le camion et l'avion, qui rpondent aux neuf
diximes des besoins de transport de l'humanit et sont indispensables son dvelop-
pement, ils ont invent le mythe du transfert modal . Il faudrait que nous nous d-
placions en vlo, en navette fluviale ou dans des transports en commun qui ne peu-
vent gure exister que dans les centres-villes, et que les entreprises aient recours des
moyens d'acheminement de leurs marchandises qui ncessitent des jours ou des se-
maines, alors qu'un camion peut les livrer en quelques heures.
C'est alors en vain que des centaines de milliards d'euros sont dpenss chaque an-
ne dans le monde pour construire des oliennes qui ne fonctionnent qu'un quart
du temps, pour subventionner des biocarburants aux rendements drisoires,
pour faire circuler des trains presque vides ou construire des infrastructures inu-
4
tiles, le tout au prtexte de sauver la plante , qui justifie dsormais tout et
n'importe quoi.
Au dbut de juillet 2007, les ministres franais et italien en charge des trans-
ports adressaient l'Union europenne une demande de subvention de 725
millions d'euros pour participer au financement de la liaison ferroviaire Lyon-
Turin qui figure parmi les priorits de la Commission. D'un montant total
voisin de 15 milliards d'euros entirement la charge des contribuables, ce gi-
gantesque ensemble de travaux devrait tre achev en 2020.
cette occasion, Jean-Louis Borloo se situait dans la droite ligne de ses pr-
dcesseurs et du commissaire europen aux transports en dclarant : Derrire
cet accord, il y a la volont affirme, absolue, de nos deux pays de rentrer rso-
lument dans le dveloppement durable. Ce projet est crucial... pour la rduc-
tion des missions de gaz carbonique et pour le sauvetage de notre plante.
Or, dans la meilleure des hypothses, la future liaison transalpine vitera cha-
que anne le rejet dans l'atmosphre de 125 000 tonnes de ce gaz, ce qui cor-
respond trs exactement onze minutes des missions chinoises actuelles. Au-
trement dit, rien. Pour s'en convaincre, il suffit de savoir que chaque tranche
nuclaire moderne qui se substitue une centrale charbon de mme puissan-
ce vite le rejet dans l'atmosphre de huit millions de tonnes de CO
2
par an et
quivaut de ce point de vue plus de soixante Lyon-Turin , pour un investis-
sement de trois milliards d'euros qui ne coteront rien au contribuable. Et le
projet du Lyon-Turin est malheureusement la rgle et non l'exception. S'il est
construit, le grand canal Seine-Nord pargnera au mieux chaque anne le rejet
de 68 000 tonnes de CO
2
, ce qui correspond trs exactement 41 secondes des
missions mondiales de l'ensemble des gaz effet de serre de la plante, qui se
chiffrent 100 000 tonnes par minute.
Pendant ce temps, les choses s'aggravent. La Chine construit une centrale
charbon chaque semaine, et jamais le rythme d'accroissement des rejets dans
l'atmosphre n'a t aussi lev qu'aujourd'hui, nous menaant terme d'une
catastrophe annonce. Alors que le taux de progression des missions mondia-
les s'tablissait 1,1 % dans les annes 1990, il est pass 3,1 % depuis 2000.
Quant nous, nous gaspillons sans fin l'argent du contribuable national. Une
dizaine de milliards d'euros au moins pourrait tre pargne chaque anne
pour le budget de l'tat sans qu'il en rsulte la moindre diffrence perceptible
sur nos rejets, ni le moindre inconvnient pour notre conomie, bien au
contraire. C'est autant que le budget de nos universits.
Comme tout le monde, j'aime les arbres, la verdure, les oiseaux et l'air pur, et
l'avenir de la plante me proccupe.
5
Ce livre n'est pas dirig contre les dfenseurs de l'environnement, mais
contre une drive qui se sert de l'cologie pour imposer une vision tragique de
notre monde et mettre en cause le fonctionnement mme de notre socit.
Dans ce but, ceux qui ont fait de cette perversion de l'cologie leur raison
d'tre ont recours deux procds.
Lorsque des problmes viennent tre rgls, comme c'est le cas pour la pol-
lution locale de l'air et pour bien d'autres, ils font tout leur possible pour que
nos contemporains n'en sachent rien et pour entretenir des peurs injustifies. Il
en est ainsi du sort des dchets nuclaires qui constitue un autre mythe fonda-
teur de l'cologisme. On sait en effet traiter ceux-ci pour qu'ils ne prsentent
aucun risque pendant des sicles sinon des millnaires, contrairement ce dont
les cologistes ont russi convaincre l'opinion plantaire. Il s'agit l du type
mme du faux problme, et qu'importe si la Banque mondiale estime 500 000
le nombre des Chinois qui meurent chaque anne de la pollution de l'air impu-
table au charbon !
S'agissant du changement climatique, les cologistes ne mettent l'accent que
sur la face noire des choses et passent sous silence les volutions positives que
connat l'humanit et qui lui sont lies. Mais, surtout, ils jettent l'anathme sur
les technologies qui permettraient d'y remdier, et se rvlent les ennemis de la
cause qu'ils affirment dfendre. Ils nous culpabilisent et nous engagent sur des
voies sans issue.
Ils projettent ainsi sur la socit tout entire leur propre perception du mon-
de et contribuent puissamment la morosit qui est l'une des caractristiques
de notre pays, au point de nous distinguer de l'ensemble de la plante.
Au dbut de 2006, l'institut canadien de sondage Globescan rendit publics les
rsultats d'une enqute internationale dsormais clbre. La question pose
tait la suivante : Certains disent que la libre entreprise et l'conomie de mar-
ch constituent le meilleur systme sur lequel fonder l'avenir de la plante.
Qu'en pensez-vous ? Une approbation massive se dgagea des rponses obte-
nues, avec parfois des scores inattendus. Ce n'est pas aux tats-Unis, mais en
Chine populaire que les rponses positives furent les plus nombreuses. 74 %
des habitants de l'Empire du Milieu se dclarrent en faveur de la libre entre-
prise et du march, alors que 20 % seulement manifestrent un avis contraire.
La proportion des rponses positives atteignit ensuite 71 % aux Etats-Unis, 70 %
en Inde, 68 % en Indonsie, 66 % en Grande-Bretagne, 65 % en Allema-
gne, 63 % en Espagne et en Pologne, 59 % en Italie, etc. Bref, un vritable pl-
biscite mondial. Dans aucun pays les adversaires de la proposition formule ne
furent plus nombreux que ses partisans.
Dans aucun pays, sauf en France : seuls 36 % de nos compatriotes dclarrent
avoir une opinion positive de la libre entreprise et du march, c'est--dire du
6
monde dans lequel nous vivons en ce dbut de XXI
e
sicle, que nous le voulions
ou non. La moiti s'y dclara mme oppose.
En juillet 2007, un sondage du Pew Research Center, bas Washington, met-
tait en vidence que 80 % des Franais pensaient que leurs enfants vivraient
moins bien qu'eux, ce qui constituait un triste record mondial.
Ces exceptions franaises mritent qu'on s'y arrte. Comment se fait-il que,
seuls au monde ou presque, nous manifestions un tel pessimisme ? Bien enten-
du, l'cologie n'est pas seule en cause, mais elle y contribue, et c'est pour ap-
porter un lment de rponse cette question que ce livre a t crit.
Ingnieur franais de longue tradition familiale, j'ai l'habitude de m'en tenir
aux faits et aux chiffres. Funeste erreur dans la France de ce dbut de sicle o
seules comptent les ides reues : l'avenir que l'on nous promet n'est-il pas lu-
gubre ? Sacrifi sur l'autel de la mondialisation, le tiers-monde, c'est--dire l'es-
sentiel de l'humanit, ne s'enfonce-t-il pas inexorablement dans la pauvret ?
Les pays anglo-saxons, et d'abord l'Amrique qu'on voudrait nous donner
comme rfrence, ne sacrifient-ils pas l'homme, l'oppos de notre modle so-
cial ? Nos entreprises prives ne sont-elles pas motives par le seul profit au d-
triment de l'intrt gnral, et gure plus efficaces que les entreprises publi-
ques ? Notre pays n'est-il pas de plus en plus pollu, mettant en danger la sant
de nos enfants ? N'allons-nous pas manquer bientt d'eau, de ptrole, de tout ?
N'est-il pas grand temps enfin de faire pnitence et de changer nos modes de
vie ?
De nombreux sondages montrent que telle est bien la perception du monde
qu'ont les Franais en ce dbut de XXI
e
sicle, alors mme que la ralit n'a le
plus souvent aucun rapport avec cette image des choses. Et il n'est pas de do-
maine o le gouffre entre la ralit et les ides reues soit encore aussi bant
que celui de l'cologie.
Si ce livre se veut nanmoins un message d'espoir, c'est parce que nos nou-
veaux dirigeants ont montr dans d'autres domaines qu'ils savaient rsister au
politiquement correct qui nous a trop longtemps impos sa loi. Il leur reste le
faire pour l'cologie.
Une approche nouvelle pourrait alors comporter deux volets, dont le premier
aurait pour but de supprimer les multiples et gigantesques gaspillages que d-
noncent les pages qui suivent.
Mais il pourrait aussi revenir notre pays, parce qu'il est dj exemplaire pour
ses missions, de prendre l'initiative d'une refondation de la politique mondiale
de l'environnement. Inspire par le dogmatisme cologique, celle-ci fait fausse
route et apporte chaque jour un peu plus la preuve de son inefficacit.
7
CHAPITRE PREMIER
Tout va mal
Il faut avoir l'esprit singulirement aiguis et anticonformiste pour rsister au
flot continu d'informations catastrophistes dont nous sommes quotidiennement
abreuvs et que rsume bien dans un de ses livres l'un de ceux qui, dans notre
pays, ont fait de l'cologie leur principale raison d'tre, leur cause personnelle,
et largement forg l'opinion nationale.
Les jours du monde tel que nous le connaissons sont compts. Comme les
passagers du Titanic, nous fonons dans la nuit noire en dansant et en riant,
avec l'gosme et l'arrogance de ceux qui sont convaincus d'tre matres d'eux-
mmes comme de l'univers.
Et pourtant, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent : drgle-
ments climatiques en srie, pollution omniprsente, extinction exponentielle
d'espces animales et vgtales, pillage anarchique des ressources, multiplica-
tion des crises sanitaires. Nous nous comportons comme si nous tions seuls au
monde et la dernire gnration d'hommes occuper cette Terre : aprs nous,
le dluge...
J'ai parcouru notre plante sous toutes les latitudes. Nul ne le sait mieux que
moi : c'est un espace exigu, aux quilibres prcaires. C'est un ultime cri d'alerte
que je lance plutt que de cder au dsespoir : si nous tous, riches comme pau-
vres, ne modifions pas immdiatement notre comportement pour faire mieux
avec moins et mettre l'cologie au centre de nos dcisions individuelles et col-
lectives, nous sombrerons inluctablement...
Il ne faudrait pas croire que l'auteur de ces lignes, Nicolas Hulot puisqu'il
s'agit de lui, soit isol
1
. Comme le titrait en septembre 2006 un Journal du di-
manche en parlant des candidats l'lection prsidentielle de 2007 : Ils veulent
tous sauver la plante. Chaque jour, d'innombrables articles, interviews, mis-
sions nous transmettent le mme message d'un pessimisme absolu. C'est la
survie de l'espce humaine qui est en jeu , entend-on partout.
Il n'est pas un journal, pas un magazine, pas une revue qui n'en rajoute et ne
publie des sries d'articles plus alarmistes les uns que les autres, dont les au-
1
Nicolas Hulot, Le Syndrome du Titanic, Le livre de poche, 2004.
8
teurs, le plus souvent de bonne foi, mettent directement en cause notre socit
et notre mode de vie. L' cologisme constitue dsormais l'un des modes d'at-
taque les plus manifestes de la manire dont fonctionne notre socit, jouant
un rle certain dans le rejet de celle-ci par la majorit de nos compatriotes que
rvlent les sondages.
Les manuels scolaires vhiculent aussi la mme vision des choses, forgeant la
perception des gnrations futures. Celles-ci peroivent notre monde comme
vou au pire, sous l'influence conjugue des gosmes individuels et de l'intrt
aveugle des entreprises et des lobbies qui gouvernent la plante .
On conoit que, dans de telles conditions, il soit difficile de prendre du recul
et d'avoir une vision sereine et quilibre des choses. Comment serait-il possible
d'tre optimiste ? Le chef de l'tat de ce dbut de sicle lui-mme n'a pas rsis-
t la grande vague culpabilisatrice, comme en tmoigne le discours qu'il pro-
nona Johannesburg le 2 septembre 2002, l'occasion de la sance plnire
du Sommet mondial sur le dveloppement durable.
D'entre de jeu, Jacques Chirac donna le ton : Notre maison brle et nous
regardons ailleurs. La nature, mutile, surexploite, ne parvient plus se re-
constituer et nous refusons de l'admettre. L'humanit souffre. Elle souffre de
mal-dveloppement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indiffrents. La
Terre et l'humanit sont en pril et nous en sommes tous responsables [...].
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ! Prenons garde que le
XXI
e
sicle ne devienne, pour les gnrations futures, celui d'un crime de l'hu-
manit contre la vie. Si l'humanit entire se comportait comme les pays du
Nord, il faudrait deux plantes supplmentaires pour faire face nos besoins
[...].
Tous coupables !
Autrement dit, tout ce que nous faisons est mal. Devant une reprise aussi clai-
re des thses de ceux qui dnigrent en permanence le fonctionnement du
monde tel que nous le connaissons, on comprend sans peine la stupfaction de
beaucoup des chefs d'tat prsents, dont certains n'hsitrent pas qualifier
Jacques Chirac de pessimiste cosmique .
On retrouve en effet dans ce discours toutes les thses de l'extrme gauche,
de l'altermondialisme et des cologistes les plus hostiles la fois au mode de vie
qui est le ntre et au systme conomique qui est aujourd'hui celui de la plan-
te.
Il n'y aurait rien critiquer cette vision des choses si elle partait d'une ap-
prciation quilibre du monde dans lequel nous vivons, mettant en balance ses
9
aspects ngatifs qu'il serait absurde de nier, et notamment les risques lis au
changement climatique, mais n'occultant pas ses cts positifs alors que ceux-ci
sont systmatiquement passs sous silence.
Cette apprciation prendrait tout d'abord et avant tout en compte le sort ac-
tuel de l'espce humaine. C'est en effet une trange inversion des valeurs que
nous assistons. Dans toutes les religions, l'homme est au-dessus de la nature. Les
visiteurs du temple du Ciel Pkin y voient une esplanade circulaire trois ni-
veaux. Le plus lev symbolise le ciel, l'intermdiaire l'homme, et le troisime la
Terre. C'est l l'ordre normal des choses, et les religions monothistes ne disent
rien d'autre lorsqu'elles mettent la nature la disposition de l'homme.
L'amlioration trs rapide de la situation de l'humanit est donc mettre en
priorit dans la balance lorsqu'on parle de l'volution de la plante, au lieu
qu'elle ne soit mme pas mentionne. Car, contrairement l'opinion rpandue
dans notre pays, l'essentiel de l'humanit est engag dans une phase de progrs sans pr-
cdent dans l'histoire.
Au cours du sicle coul, l'esprance de vie dans les pays du tiers-monde est ainsi
passe de 27 65 ans. La proportion d'enfants vaccins a cr de 5 % 80 % de-
puis cinq dcennies. Le nombre moyen d'enfants par femme a t divis par
deux, rgressant de 5,6 2,8. Le niveau de vie de la majorit des habitants des
pays pauvres a doubl. L'alphabtisation a progress de 25 % 85 %. Le nom-
bre d'tres humains correctement nourris s'est accru de plus de deux milliards
en trente ans. Le nombre de foyers raccords un systme d'assainissement
correct augmente de 100 000 par semaine. La plante compte aujourd'hui un
milliard d'internautes. Prs de la moiti des habitants du globe ont un tlphone
portable. Jamais les progrs de l'humanit n'ont t aussi rapides, sinon fulgurants.
Certes, ce qui reste faire est immense. Mais l'volution continue un rythme
acclr, tire par les gants que sont la Chine et l'Inde dont l'conomie crot
aujourd'hui de 10 % par an. Et cette marche vers le progrs n'est aujourd'hui
possible que parce que le tiers-monde, comme nous-mmes, a dsormais re-
cours l'nergie et que des centaines de millions de vies d'enfants, de femmes
et d'hommes s'en trouvent incomparablement amliores.
Qui pourrait imaginer qu'il en est ainsi en lisant les citations qui ont ouvert ce
chapitre et dont le pessimisme est total ?
Certes, il est regrettable que, parmi les dizaines de millions d'espces animales
et vgtales qui peuplent la plante, des milliers disparaissent chaque anne.
Mais j'avoue que, personnellement, leur sort m'meut moins que celui d'un
seul enfant du Bangladesh ou d'ailleurs qui pourrait tre sauv grce un vac-
cin un ou deux euros et qui ne l'est pas encore.
10
La mare verte
Dsormais, tout est balay par la mare verte qui a conquis notre pays et notre
continent. Chacun veut apporter sa contribution. Autrefois, il fallait laver plus
blanc que blanc , comme nous l'a appris Coluche. Aujourd'hui, il n'y a plus
une entreprise qui ne se vante de faire plus d'efforts que les autres, et d'tre
plus verte que verte. Les publicits font partout rfrence aux conomies relles
ou supposes des missions de gaz carbonique, qu'il s'agisse de vendre de la les-
sive, des yaourts, des voitures, des rfrigrateurs, de l'essence ou de l'lectricit.
L'argument cologique est devenu l'alpha et l'omga de tout discours, l'ultima
ratio de toute dcision.
L'Union europenne n'a-t-elle pas dclar en mars 2007, sous la prsidence
d'Angela Merkel, que la sauvegarde de l'environnement tait dornavant sa
priorit absolue, et n'a-t-elle pas adopt pour 2020 un triple objectif : rduire
son utilisation d'nergie de 20 % ; diminuer d'autant ses rejets de gaz effet de
serre ; porter 20 % galement la part des nergies renouvelables au sein de sa
consommation ?
A priori, chacun ne peut qu'applaudir. La sauvegarde de la plante ne mrite-
t-elle pas des efforts de la part de tous ? L'avenir de nos enfants n'est-il pas en
jeu ?
Pourtant, lorsqu'on voit certaines initiatives, le doute s'installe. Est-il vraiment
ncessaire de dvelopper tout prix l'nergie solaire en Allemagne o il n'y a
gure de soleil, ou d'ouvrir en France un rseau entier de pompes thanol
alors que nous sommes incapables d'en produire pour l'alimenter et qu'il n'y a
d'ailleurs pas de vhicules pour l'utiliser ? Faut-il vraiment paralyser la circula-
tion dans nos villes, commencer par Paris, pour contribuer sauver la plan-
te ? Que penser des oliennes qui couvrent progressivement le globe en pro-
duisant de l'lectricit plus chre que celle que nous pouvons obtenir autre-
ment, et aux moments o nous n'en avons pas besoin et o elle ne vaut rien ?
Comment expliquer que de nombreux pays veuillent fermer leurs centrales nu-
claires alors qu'il s'agit de la manire la plus efficace de lutter contre l'effet de
serre ? Est-il justifi d'accorder, toujours au nom de la lutte contre l'effet de ser-
re, plus d'argent nos chemins de fer qui assurent moins de 5 % de nos trans-
ports qu' nos universits ? Est-il vraiment ncessaire que nos rgions placent au
premier rang de leur budget les TER (transports express rgionaux), rguli-
rement utiliss par 1 % seulement de leur population, et leur consacrent autant
d'argent qu'aux lyces dont elles ont la charge ? Est-il vraiment opportun que le
prsident Bush subventionne coup de milliards de dollars les agriculteurs
amricains pour qu'eux aussi fabriquent de l'thanol, avec pour rsultat de
11
doubler les cours du mas et de provoquer au Mexique une rvolte de la tortil-
la , les plus pauvres n'ayant plus de moyens de se nourrir ?
Si ces diverses initiatives s'insraient dans un plan cohrent et raisonn, cha-
cun ne pourrait que s'en rjouir. Mais encore et-il fallu que les responsables
aient compris la nature trs particulire et surprenante de l'effet de serre contre
lequel ils dclarent vouloir lutter. Manifestement, ce n'est pas le cas.
12
CHAPITRE II
Le flux et le stock
Tout a commenc la fin du XVIII
e
sicle avec le remplacement du travail
humain et animal par celui des machines. Pour faire fonctionner celles-ci, il a
fallu recourir une nergie fournie par les ressources fossiles que les res pr-
cdentes avaient accumules dans le sous-sol du globe. Il s'est agi tout au long
du XIX
e
sicle du charbon, auquel se sont ensuite ajouts le ptrole puis le gaz
naturel. L're industrielle aurait pu tout aussi bien s'appeler l're de l'nergie.
Aujourd'hui encore, le fonctionnement des pays dvelopps et la marche vers
le progrs du reste du monde seraient impossibles sans le recours aux nergies
fossiles qui sont l'origine de 8,5 milliards de tonnes quivalent ptrole (tep)
sur les 10,5 que la plante consomme annuellement
1
. Autrement dit, les sources
fossiles (ptrole, charbon, gaz naturel) procurent l'humanit les quatre cin-
quimes de l'nergie qu'elle consomme chaque anne. Sans elles, tout s'arrte-
rait. Les usines ne pourraient plus produire, les transports seraient paralyss, les
immeubles ne seraient plus clairs ni chauffs, la production agricole elle-
mme dans beaucoup de pays serait rduite nant ou presque faute de trac-
teurs, et la famine et la mort rgneraient.
Mais il a fallu prs de deux sicles pour que l'on prenne conscience d'une
consquence imprvue du recours au charbon, au ptrole ou au gaz naturel.
Ces hydrocarbures dgagent en brlant du gaz carbonique qui, mme s'il ne
prsente pas de danger pour notre sant, est le plus important des produits qui
concourent l'effet de serre dont bnficie notre plante. Il faut parler de b-
nfice car, sans celui-ci, la temprature moyenne de notre globe serait plus bas-
se d'environ 30 degrs que ce qu'elle est aujourd'hui, avec toutes les cons-
quences que l'on peut imaginer. Et nous ne serions pas ici pour en parler.
Il n'en demeure pas moins qu'un bien peut devenir un mal, et que l'accumu-
lation excessive dans l'atmosphre de gaz carbonique, ainsi que d'autres pro-
duits qui contribuent pour plus d'un tiers l'effet de serre tels que le mthane,
peut lgitimement susciter de grandes inquitudes. Face la gravit potentielle
1
Afin de les comparer entre elles, toutes les nergies sont traditionnellement ramenes une mme
unit, la tonne quivalent ptrole, qui quivaut la quantit d'nergie contenue dans une tonne de
ptrole.
13
du sujet, une approche rigoureuse s'impose, qui fasse la part de ce que l'on
connat avec certitude et de ce qui ne constitue encore que des hypothses.
Toujours plus
L'accroissement de la consommation d'nergie du globe constitue un pre-
mier constat indiscutable. Les choses ont dmarr lentement tout au long du
XIX
e
sicle, et ce n'est qu'au cours de la deuxime moiti du XX
e
qu'elles se sont
brutalement acclres avec le recours massif au ptrole et au gaz naturel, sans
que la consommation de charbon cesse d'tre massive pour autant. De 1973
2003, d'aprs les dcomptes de l'Agence internationale de l'nergie dont le
sige est Paris, la consommation nergtique annuelle de la plante a aug-
ment des trois quarts. Certes, la production de biens et de services du globe,
celle que traduit son PIB (produit intrieur brut), s'est accrue plus vite encore
pendant cette priode. Il n'en demeure pas moins que les besoins en nergie
n'ont cess de crotre. Il ne faut donc pas s'tonner que les rejets de gaz carbo-
nique d'origine nergtique dans l'atmosphre aient suivi une volution paral-
lle, et soient passs de 15 milliards de tonnes par an en 1973 prs de 30 mil-
liards de nos jours, l'Agence internationale de l'nergie prvoyant que si rien ne
change, ils continueront augmenter inluctablement ensuite pour avoisi-
ner 60 milliards de tonnes en 2050. Certes, la moiti de ces missions est absor-
be naturellement par la vgtation et les ocans, mais cela ne suffit pas.
Il ne faut pas s'tonner que, dans ces conditions, la concentration de gaz car-
bonique dans l'atmosphre n'ait cess d'augmenter, car sa dure de vie y est
extrmement longue, de l'ordre de cent ans ! Durant le dernier ge glaciaire,
cette concentration ne dpassait pas 180 ppm (parts par million), ce qui avait
plong de grandes parties de la plante dans un froid polaire. Ensuite, et jus-
qu' la veille de l're industrielle, elle a avoisin 280 ppm. Mais la teneur en gaz
carbonique de l'atmosphre, mesure depuis plus d'un demi-sicle au sommet
des les Hawaii, excde aujourd'hui 380 ppm et continue s'accrotre anne
aprs anne. Or chaque ppm correspond un peu plus de 7 milliards de tonnes
de gaz carbonique de sorte qu'il y avait dans l'atmosphre terrestre envi-
ron 2 000 milliards de tonnes de gaz carbonique avant l're industrielle et qu'il
y en a aujourd'hui 2 800 milliards, soit 800 de plus, essentiellement du fait de
l'utilisation par l'homme, depuis deux sicles, des nergies fossiles.
14
Une inertie insouponne
Ce qu'il faut retenir aussi, c'est la disproportion des chiffres entre ce stock gi-
gantesque (2 800 milliards de tonnes) et nos missions annuelles d'origine
nergtique (30 milliards de tonnes). Le stock est cent fois plus important que
le flux, et les consquences de ce constat remettent en cause les ides que nous
avons quant nos possibilits d'action sur l'effet de serre. Ce que nous pouvons
faire pour modifier nos missions n'a aucun effet significatif immdiat sur la
quantit prsente dans l'atmosphre. Il s'agit d'un phnomne d'une inertie
considrable, et mme si nos missions cessaient d'augmenter, il faudrait prs
d'un sicle pour que les choses se stabilisent.
Si rien ne change, le stock du gaz carbonique atmosphrique atteindra au mi-
lieu de ce sicle 4 000 milliards de tonnes contre 2 800 aujourd'hui. Or si nous
arrivons diminuer nos missions de 10 % sur l'ensemble de cette priode, la
quantit prsente dans l'atmosphre en 2050 sera rduite d'une centaine de
milliards de tonnes, et s'lvera donc 3 900 milliards de tonnes au lieu
de 4 000. Autrement dit, rien ne sera vraiment chang.
Mais ce n'est pas tout. L'hypothse d'une rduction de 10 % des missions
plantaires par rapport aux tendances actuelles peut paratre trs modeste, mais
il n'en est rien. La vrit, c'est qu'un tel objectif n'a pour l'instant rien d'vi-
dent, ni techniquement ni financirement. Bien au contraire, le rythme d'ac-
croissement des rejets ne cesse de s'acclrer.
Beaucoup des solutions aujourd'hui disponibles pour rduire nos missions
sont en effet trs coteuses si on veut les appliquer grande chelle. supposer
que leur cot s'tablisse en moyenne 25 euros par tonne de CO
2
pargne, ce
qui est sans doute trs optimiste, une diminution des missions de 10 %, c'est--
dire de 200 milliards de tonnes sur l'ensemble de la priode, ncessiterait de
dpenser 5 000 milliards d'euros, soit 100 milliards d'euros par an en moyenne.
Et le rsultat sur les concentrations dans l'atmosphre serait pourtant insigni-
fiant.
Tout ou rien
Il s'agit l d'un constat surprenant dont les consquences remettent en cause
les ides qui viennent spontanment l'esprit. Nous avons affaire un phno-
mne de type tout ou rien . Si nous arrivons rduire massivement nos mis-
sions par rapport aux tendances actuelles, nous serons efficaces. Mais si nous
agissons sur elles de manire limite, ce que nous ferons n'aura pour effet que
15
de dcaler un peu les phnomnes dans le temps et nous aurons dpens beau-
coup d'argent pour rien.
C'est pourquoi les cologistes disent juste titre que seule une rduction trs
massive des missions par rapport aux tendances actuelles aurait un sens. Le
protocole de Kyoto lui-mme, dans sa forme actuelle, ne permettrait que de ga-
gner six ans sur l'volution des concentrations de gaz effet de serre la fin du
XXI
e
sicle, mme s'il tait intgralement respect, y compris par les tats-Unis
qui ne l'ont pas sign. Le niveau qui aurait t atteint en son absence en 2100 le
serait en 2106, et ce serait tout !
On comprend pourquoi l'hypothse d'une trs forte rduction des missions
figure en bonne place parmi les nombreux scnarios tudis par les experts des
Nations unies Genve du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'volution du climat en anglais IPCC). Ces scnarios vont de la poursuite des
tendances actuelles telle que la prvoit l'Agence internationale de l'nergie, ce
qui conduirait donc 60 milliards de tonnes de rejets annuels d'origine nerg-
tique en 2050, jusqu' une rduction drastique des missions mondiales qui se-
raient divises par deux et retrouveraient en 2050 leur niveau actuel de 30 mil-
liards de tonnes. Il est assez facile de calculer alors quelle serait l'volution de la
concentration du gaz carbonique dans l'atmosphre. Dans le premier cas, elle
ne cesserait videmment d'augmenter, passant selon les prvisions actuelles
de 380 parts par millions plus de 800 la fin du prsent sicle et plus encore
au-del. Dans l'hypothse oppose, la concentration se stabiliserait partir
de 2050 et pour une longue priode aux alentours de 450 ppm
1
, ce qui corres-
pond 3 500 milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphre. Selon
toute probabilit, les consquences sur le climat ne seraient alors pas les mmes.
Le changement climatique
S'il est un sujet qui dfraye presque tous les jours la chronique, c'est juste-
ment le climat, premire source de conversation des tres humains depuis la
nuit des temps. Les variations climatiques ont toujours exist, comme en tmoi-
gnent les parois de nos grottes o coexistent lions et mammouths. La grotte
Cosquer situe prs de notre cte mditerranenne tait accessible pied aux
temps prhistoriques. Son entre se trouve aujourd'hui plusieurs dizaines de
mtres sous le niveau des eaux, la mer ayant donc mont d'autant ! Plus prs de
nous, les priodes chaudes et froides se sont succd au cours des sicles. Les
lgions de Jules Csar ont travers pied le Rhin gel, alors que les Vikings ont
1
Source : Rapports de la mission de l'Assemble nationale sur l'effet de serre et du groupe de travail
Facteur 4 .
16
habit aux alentours de l'an mil pendant plusieurs sicles le Groenland, dont le
nom mme est rvlateur (green land).
Le changement peut aller plus vite encore. Enfant, j'allais patiner chaque hi-
ver ou presque sur les tangs du bois de Boulogne ou sur le lac d'Enghien prs
de Paris, et je voyais la Seine charrier d'pais blocs de glace, toutes choses dispa-
rues de nos jours. Il faudrait donc tre de bien mauvaise foi pour nier que nous
vivons un pisode de rchauffement climatique trs rapide.
Celui-ci est trs rcent, et les spcialistes affirmaient encore il y a vingt ou
trente ans que nous tions engags sur la voie d'un nouveau refroidissement de
la plante. Mais la dernire dcennie a t la plus chaude du sicle coul, et les
rcentes canicules de 2003 et 2006 ont sembl confirmer la tendance, tout
comme le dbut de 2007. Sur les vingt annes les plus chaudes recenses depuis
qu'existent des enregistrements, dix-neuf sont survenues aprs 1980.
Il faut reconnatre galement que les experts, longtemps partags entre ceux
qui affirmaient que l'accroissement des gaz effet de serre n'tait pour rien
dans les variations climatiques actuelles, et ceux qui y voyaient une relation di-
recte de cause effet, ont pour la plupart rejoint le camp des seconds. Il existe
encore quelques voix pour affirmer qu'il n'en est rien et que les volutions r-
centes ne se distinguent pas de celles qui ont toujours exist dans le pass, mais
elles sont de plus en plus isoles. Dans un article retentissant publi en octo-
bre 2006, puis dans un livre paru quelques mois plus tard, Claude Allgre a ainsi
mis en doute que les fluctuations climatiques actuelles soient lies aux activits
humaines. Mais il est isol, mme si ses mises en cause du mouvement cologis-
te sont le plus souvent percutantes.
Les experts des Nations unies runis au sein du GIEC ne sont certes pas enco-
re totalement affirmatifs sur ce point, puisqu'ils estiment 90 % la probabilit
que le rchauffement climatique soit li aux activits humaines, ce qui laisse
place 10 % d'incertitude. Mais ceux qui ne sont pas spcialistes de la question
ne peuvent que se ranger aux cts de la grande majorit des spcialistes et,
mme s'il ne s'agit pas d'une certitude absolue, prendre comme hypothse qu'il
existe un lien direct entre les concentrations de gaz effet de serre dans l'at-
mosphre et le climat, et que nous nous dirigeons trs probablement vers une
poursuite sinon une acclration du rchauffement de la plante.
Un large ventail de prvisions
L'ampleur de celui-ci fait encore l'objet de multiples discussions entre spcia-
listes, et le fera encore trs longtemps. Pour l'valuer, il faut en effet avoir re-
cours des modles informatiques de simulation de l'atmosphre et des ocans
17
qui sont empreints de multiples inconnues. Les marges d'incertitude sont
considrables, et les prvisions d'volution de la temprature moyenne du glo-
be varient en consquence dans des fourchettes trs larges.
Alors qu'il est gnralement admis que la temprature moyenne de notre
plante s'est accrue de 0,6 degr, ce qui est modeste, au cours du XX
e
sicle, les
pronostics des Nations unies font tat d'une lvation possible au cours du XXI
e
sicle allant de 2 6 degrs. La fourchette de variation est donc trs large, et
chacun conoit aisment que les consquences sur le climat ne seraient pas les
mmes si c'est l'hypothse la plus basse qui se vrifie, ou bien la plus haute.
On peut imaginer qu'elles restent relativement minimes dans le premier cas,
et mme que, contrairement d'autres, certains pays puissent bnficier d'un
accroissement de la temprature terrestre, la situation gographique mdiane
de la France tant cet gard relativement favorable. Le Canada, la Grande-
Bretagne ou les pays scandinaves ne bouderaient pas ncessairement quelques
degrs de plus. Mme dans notre pays, la morsure de l'hiver peut faire trs mal.
Mais, dans l'hypothse d'un relvement trs fort des tempratures du globe
au cours du sicle venir, personne ne peut dire ce qui se passerait. Certains
estiment que l'humanit en a vu d'autres et saura s'adapter comme elle l'a tou-
jours fait. N'y a-t-il pas des hommes qui vivent Stockholm (temprature
moyenne : 6 degrs) et d'autres Dakar (temprature moyenne : 30 degrs) ?
D'autres experts font tat de pronostics catastrophiques : fonte des glaciers,
multiplication des cyclones, lvation marque du niveau de la mer, vagues de
scheresse ou inondations, et prdisent l'enfer pour les pays chauds.
Le pire n'est pas sr, mais chacun pensera qu'il vaudrait mieux ne pas tou-
cher la nature. Une question s'impose alors : est-il possible de rduire drasti-
quement nos missions de gaz effet de serre, ou ne peut-on agir sur elles qu'
la marge ? Dans le premier cas, les concentrations dans l'atmosphre seraient
progressivement matrises. Dans l'autre, elles continueraient s'accrotre sans
cesse. Quelles sont donc nos marges de manuvre ?
Le tournant de 2003
Un premier constat s'impose et il est majeur. Il s'est pass en 2003 un vne-
ment inaperu et lourd de consquences. Pour la premire fois depuis le dbut
de l're industrielle, les pays dvelopps sont devenus minoritaires au sein de la
production de gaz carbonique d'origine humaine. Alors que les pays riches reje-
taient les deux tiers des gaz effet de serre il y a trente ans, c'est dsormais le reste du
monde qui en met la majeure partie. Au premier rang des pays concerns, nul ne
sera surpris d'apprendre que l'on trouve dsormais la Chine avec plus de 20 %
18
du total mondial et l'Inde avec 7 %, et que les pourcentages correspondants
s'accroissent trs vive allure d'anne en anne. La seule Chine met 6 mil-
liards de tonnes de CO
2
par an, soit 16 500 000 tonnes par jour, 680 000 par
heure et 11 500 par minute !
Or le tiers-monde se dveloppe actuellement en consommant du charbon, du
ptrole et du gaz naturel, et donc en produisant massivement du gaz carboni-
que, dans l'tat actuel des techniques. Certes, il cherche utiliser le moins
d'nergie possible en regard de la richesse produite. Depuis 1990, la Chine a
ainsi doubl son efficacit nergtique, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque des
pays connaissent des taux de progression de leur conomie de l'ordre de 8
10 % par an, il serait illusoire d'imaginer qu'ils puissent le faire sans accrotre
anne aprs anne leur consommation d'nergie, quels que soient les efforts
qu'ils dploient.
Pour leur part, les missions de gaz effet de serre des pays riches n'augmen-
tent plus que modrment depuis quelques annes et l'on peut esprer que les
conomies faites en Europe compenseront un jour, au moins partiellement, la
drive actuelle de l'Amrique du Nord et de l'Australie.
Il nous faut donc nous rendre l'vidence. L'accroissement de la production
de gaz effet de serre de la plante est aujourd'hui avant tout la contrepartie du
progrs conomique des pays du tiers-monde, c'est--dire de leur sortie de la
misre et de la pauvret. Selon l'Agence internationale de l'nergie, elles seu-
les, la Chine et l'Inde seront l'origine des quatre cinquimes de l'augmenta-
tion de la consommation de charbon de la plante au cours des annes venir.
Nous avons eu besoin pour notre dveloppement de disposer de grandes quan-
tits d'nergie et les pays mergents connaissent la mme contrainte. Leur int-
rt leur dicte videmment d'tre aussi conomes que possible, ne serait-ce que
pour limiter la facture qu'ils doivent acquitter lorsqu'ils importent les hydrocar-
bures ncessaires leur progrs. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions. Sauf
vouloir remettre en cause le dveloppement du tiers-monde avec les cons-
quences dramatiques que cela impliquerait pour ses habitants, on ne voit pas
comment faire en sorte que sa production de gaz effet de serre, dsormais ma-
joritaire au sein du total mondial, ne cesse pendant longtemps encore d'aug-
menter. De toute manire, les pays concerns ne nous demandent pas notre
avis.
Comme le dclara en janvier 2007 Qin Dahe, directeur de l'administration
mtorologique chinoise et reprsentant de son pays aux dbats du GIEC :
Nous n'avons ni la technologie ni les moyens financiers qui seraient ncessai-
res. Nous convertir des sources d'nergie moins polluantes ncessiterait des
sommes prohibitives que nous n'avons pas. Nous avons besoin du charbon pour
19
nous dvelopper. Nous sommes conscients du problme et proccups par les
risques pour notre pays, mais nous n'avons pas le choix
1
.
L'Inde ne dit pas autre chose. En dcembre 2006, aprs la publication du
rapport Stern dont il sera question au chapitre VI, elle fit rpondre par un grou-
pe officiel d'conomistes qu'il n'tait pas possible pour l'Inde de s'engager sur
un plafond d'missions respecter, et que sa priorit devait tre accorde des
objectifs nationaux au premier rang desquels figurait l'radication de la pauvre-
t
2
. De mme que la Chine, l'Inde se lance en consquence dans un pro-
gramme massif de travaux publics et de construction de centrales lectriques
charbon. Malgr des rserves nationales abondantes, elle a prvu d'en importer
par surcrot 50 millions de tonnes annuellement.
C'est d'ailleurs pour cette raison que George Bush a refus de signer le proto-
cole de Kyoto, faisant valoir, entre autres motifs, qu'il ne servirait rien que
l'Amrique restreigne sa consommation d'nergie puisque ce qu'elle aurait
pargn serait immdiatement utilis par la Chine ou par l'Inde, qui ne sont
pas parties prenantes ce protocole, pas plus que les autres pays du tiers-
monde. La croissance boulimique des besoins chinois a jusqu' prsent donn
raison au prsident amricain sur ce point.
Un bilan pourtant positif
Il existe pourtant une manire positive de voir les choses, et nous ne devons
pas la passer sous silence. Chaque tonne de gaz carbonique supplmentaire
mise par les pays du tiers-monde leur permet de progresser, et ce sont au total
des centaines de millions de vies qui sont amliores et mme tout simplement
sauves chaque anne grce l'utilisation des nergies fossiles que les res pas-
ses ont accumules dans le sous-sol de notre plante. Si nous avions le choix,
ce qui n'est videmment pas le cas, aurions-nous le droit de leur interdire d'y
avoir recours comme nous le faisons nous-mmes ? Poser la question est y r-
pondre. L'augmentation des missions de gaz effet de serre d'origine humai-
ne est, pour longtemps encore, la contrepartie inluctable de la sortie de la mi-
sre de l'essentiel de l'humanit. C'est le prix payer. Il ne faut donc pas nous
en lamenter, mais l'accepter sinon nous en rjouir.
Ceux qui rclament cor et cri une rduction drastique des missions de
gaz effet de serre de la plante savent-ils que la seule manire d'atteindre ra-
pidement cet objectif serait, pour l'instant, non pas que nous rduisions nous-
mmes nos missions qui sont dj minoritaires l'chelle de la plante, mais
1
International Herald Tribune, 7 fvrier 2007.
2
The Indian Express, 3 fvrier 2007.
20
que le monde en dveloppement cesse de se dvelopper, et que des milliards
d'tres humains restent plongs dans la misre ?
C'est pourquoi il faut donner du temps au temps. C'est ce qu'a dclar l'oc-
casion du Forum mondial de Davos de 2007 Edmund Phelps, professeur d'co-
nomie de renomme mondiale et prix Nobel 2006 : Il est illusoire de penser
que nous puissions dgager aujourd'hui pour rduire nos missions les centai-
nes de milliards de dollars que certains suggrent, ce qui freinerait de surcrot
le dveloppement mondial. Il y a bien d'autres urgences. Faisons donc tout no-
tre possible pour favoriser l'expansion conomique de la plante. Plus elle sera
riche, plus il lui sera possible de s'attaquer plus tard grande chelle aux mis-
sions de gaz effet de serre. Dans dix ans ou vingt ans, cela deviendra peut-tre
possible, mais pas avant. D'ici l, prparons-nous, mettons au point les techni-
ques, mais ne dpensons pas d'argent inutilement, d'autant plus qu'il s'agit
d'un phnomne de trs long terme et que dcaler de quelques annes l'enga-
gement d'une action massive ne changera rien au rsultat.
Edmund Phelps pensait avoir dvelopp un point de vue de bon sens, mais
mme dans le contexte feutr du sommet de Davos, ses propos furent accueillis,
selon ses propres termes, with fury . Comme il le dclara ultrieurement lors
d'un passage Paris : J'ai constat alors que le changement climatique tait
sorti du domaine de la rationalit pour entrer dans celui de la religion.
Si un milliard trois cents millions de Chinois se dclarent en faveur de l'co-
nomie de march, c'est bien parce que leur sort s'amliore. Arrtons de ne voir
que la face noire des choses. Contrairement aux apparences, le bilan de l'utilisa-
tion de l'nergie par l'humanit est aujourd'hui positif. Il y a ce qui se voit, mais
aussi ce qui ne se voit pas. La certitude de l'amlioration immdiate du sort de
milliards d'tres humains doit tre mise en balance dans nos esprits avec l'in-
quitude que peut lgitimement susciter un possible changement du climat de
la plante.
Mais ceci n'interdit pas de nous demander s'il n'est vraiment pas possible
d'agir sur les missions du monde dj dvelopp, et d'abord sur celles de notre
propre pays, car il serait inacceptable de rester passif devant la ralit des ris-
ques qui menacent la plante.
21
CHAPITRE III
Bons et mauvais lves
Le bon lve franais
En tant que franais, que pouvons-nous faire ? Avant de rpondre cette
question, il faut faire connatre une ralit cache : nous sommes dj de trs loin
les meilleurs au sein des grands pays industriels. Chaque Franais met 6 tonnes
de gaz carbonique par an d'origine nergtique, contre 9 en moyenne pour les
autres Europens, 10 pour les Allemands, 20 pour les Amricains et 12 en
moyenne pour l'ensemble du monde industriel. Il en dcoule que notre pays ne
produit que 1,4 % des missions de gaz effet de serre de la plante
1
, propor-
tion marginale s'il en est pour un pays dvelopp. Notre contribution aux rejets
n'est gure suprieure notre poids dans la population mondiale qui avoisi-
ne 1 %. Pour donner une ide de notre exceptionnelle performance, il suffit
d'indiquer que chaque Chinois rejette aujourd'hui 4,5 tonnes de gaz carboni-
que d'origine nergtique dans l'atmosphre, c'est--dire gure moins que cha-
que Franais, alors mme que son niveau de vie est en moyenne cinq fois plus
faible que le ntre. D'ici peu, si les tendances se poursuivent, il nous aura d-
passs ! Si l'on considre de surcrot que la consommation d'nergie n'est gu-
re le fait que des quelque 300 millions de Chinois des zones ctires, il apparat
que chacun d'entre eux met de l'ordre de 20 tonnes par an, c'est--dire autant
que les Amricains !
Notre pays fait mieux encore. Les manations d'origine nergtique ne sont
pas les seules. Il s'y ajoute par exemple celles qui sont dues la dforestation
des zones tropicales, qui ne nous concerne pas. Or celles-ci sont considrables
puisqu'on les value 18 % de l'ensemble des rejets de gaz effet de serre. Il
faut tenir compte aussi des rejets de mthane et d'autres produits en provenan-
ce de l'agriculture et de l'levage, de telle sorte qu'au total, l'ensemble des
missions de gaz effet de serre imputables l'homme quivaut un peu plus
de 50 milliards de tonnes de gaz carbonique et non de 30. Un tel volume repr-
sente trs prcisment 100 000 tonnes par minute, et c'est ce chiffre, vritable
1
Commission europenne, EU Energy and Transport in Figures.
22
talon du phnomne, qu'il faut avoir prsent l'esprit quand on cherche
mesurer l'impact des actions envisages pour rduire les missions.
S'agissant de notre pays, avec l'quivalent de neuf tonnes de gaz carbonique
mises par habitant, nous sommes dj dans la moyenne mondiale, tiers-monde
compris, lorsqu'on prend en compte l'ensemble des gaz effet de serre. On lit
souvent que, si l'ensemble de la population du globe mettait autant de gaz
effet de serre que nous, cela reprsenterait deux ou trois plantes. C'est faux,
mais les lgendes ont la vie dure. On a pu ainsi lire dans le Journal du dimanche
du 3 juin 2007 que, calcule par WWF, l'empreinte cologique d'un Chinois
est de 1,5 ha, celle d'un habitant du Mozambique de 0,5 ha, et celle d'un Fran-
ais de 5,2 ha. En matire de gaz effet de serre, ce n'est pas le cas. Nous som-
mes dans la moyenne mondiale.
Nous y sommes tellement que, seuls nouveau au sein du monde dvelopp,
nous sommes en mesure de respecter l'objectif ambitieux que le G8 a voqu
en juin 2007, qui vise ramener le niveau global des missions de gaz carboni-
que de la plante une trentaine de milliards de tonnes en 2050, toutes sources
confondues, alors que le prolongement des tendances naturelles aboutirait 60
milliards.
Une performance occulte
Un tel rsultat est tout simplement remarquable, et notre exceptionnelle sin-
gularit mriterait mieux que d'tre presque toujours passe sous silence. On
n'en trouve en effet mention ni dans les dclarations de ceux qui font profes-
sion d'cologisme, ni dans les innombrables articles et ouvrages publis sur le
sujet. Il parat s'agir d'un tabou. Aucun des rapports officiels rcents ne men-
tionne que nous sommes, de trs loin, les meilleurs et dit encore moins pour-
quoi, qu'il s'agisse par exemple de celui d'avril 2006 de la mission d'informa-
tion de l'Assemble nationale sur l'effet de serre ou de celui, plus rcent enco-
re, du groupe de travail intitul Facteur 4 dont l'objet est d'tudier la possi-
bilit de diviser encore par quatre nos missions nationales de gaz effet de ser-
re. Autrement dit, ces documents cachent l'essentiel. En lisant les rapports offi-
ciels, on a l'impression que les Franais sont responsables de la totalit des mis-
sions de la plante, alors que nous n'en reprsentons gure plus d'un centime et que
cette proportion ne cesse de diminuer encore.
Notre exceptionnelle performance est due tout d'abord l'existence de nos
centrales nuclaires. Celles-ci ne dgagent pas de gaz carbonique, contraire-
ment ce qui se passe presque partout sur la plante o l'lectricit provient en
grande majorit de centrales thermiques classiques fonctionnant au fuel, au gaz
23
naturel, ou plus souvent encore au charbon, source par ailleurs de multiples
pollutions toxiques locales.
Nos rsultats sont galement imputables, un moindre titre, un parc auto-
mobile trs performant, ayant plus que les autres recours aux motorisations die-
sel et compos en majorit de vhicules de catgorie modeste ou moyenne.
Parmi les grands constructeurs mondiaux, les deux groupes franais figurent
aux premiers rangs de ceux dont la production est la plus conome en carbu-
rant, et les automobilistes franais sont en consquence parmi les moins
consommateurs du monde.
C'est l tout le contraire de ce que conduit penser une abondante littrature
nationale qui cite constamment en exemple les rfrences trangres les plus
diverses, ne manquant jamais d'accuser nos industriels et de nous culpabiliser.
Au total, nous n'avons pas de leon recevoir mais donner. Si les autres pays
industriels prenaient modle sur nous, les missions annuelles de gaz carbonique du mon-
de dvelopp passeraient de douze milliards de tonnes six. Elles seraient divises par
deux, et le total des rejets de la plante baisserait de prs d'un quart, ce qui d-
passerait tous les espoirs de ceux qui militent pour leur rduction.
Mais notre performance nationale a une autre consquence. Dans la mesure
o nous figurons dj parmi les plus petits metteurs, nous sommes videm-
ment les plus mal placs pour rduire les missions de la plante car nous avons
dj fait largement le travail. Nous tenons de plus nos engagements. Puisque
nous sommes de loin les meilleurs parmi les grands pays dvelopps, le protoco-
le de Kyoto nous a seulement demand de stabiliser nos missions au niveau qui
tait le leur en 1990. Or nous faisons nettement mieux. En 2005, et compte te-
nu des quantits absorbes par la nature, nous avons mis au total 7 % de gaz
effet de serre de moins (CO
2
et autres composants) que quinze ans plus tt,
avec 498 millions de tonnes contre 538
1
.
C'est ainsi par exemple que notre circulation routire, tous vhicules runis,
met seulement 130 millions de tonnes de gaz carbonique chaque anne, soit
moins de 0,5 % du total mondial des missions, toutes sources confondues.
Mme si les rejets de notre trafic routier taient soudainement rduits de moiti
voire plus, l'impact serait imperceptible au niveau mondial. Il faut dire ce sujet
que, contrairement ce qui est constamment rpt nos compatriotes au
point de les avoir convaincus, les transports par route ne sont l'origine que
d'une proportion minoritaire de la production de gaz effet de serre de la pla-
nte. Selon le rapport de la mission d'information sur l'effet de serre de l'As-
semble nationale dj cit, celle-ci n'excde pas au niveau mondial 12 %, dont
probablement 6 % pour les voitures individuelles et 6 % pour les camions et les
camionnettes.
1
CITEPA, Programme Coralie , mai 2006.
24
En tant que franais, notre influence potentielle sur les missions mondiales
relve donc du symbolique. Elle est marginale, incomparablement plus limite
que celle des autres pays industriels, et ce sont d'abord eux qui devraient agir au
sein du monde dvelopp. Ceux qui laissent croire que nous pourrions avoir
une influence significative sur la production de gaz effet de serre de la plante
se trompent et nous trompent. Ils font penser ceux qui, ayant perdu une pice
dans une rue mal claire, vont la chercher sous un lampadaire parce que c'est
le seul endroit o ils voient clair. La vrit, c'est que, du fait de notre excep-
tionnelle performance, nous ne pouvons pratiquement rien faire en tant que
franais pour avoir un impact significatif sur l'volution climatique de la plan-
te. C'est ailleurs qu'est la solution.
Et qu'on ne vienne pas dire que les petits ruisseaux font les grandes rivires
quand ils ctoient les fleuves que sont les tats-Unis, la Chine, l'Inde et le reste
du tiers-monde. Ce qu'met la France reprsente moins que l'accroissement des
rejets de la Chine tous les ans !
Certes, nul ne peut affirmer que le risque de changement climatique soit
imaginaire. Mais les remdes que l'on demande aux Franais de mettre en u-
vre le sont coup sr. Pourtant, du fait des messages qu'ils reoivent sans ces-
se, 83 % des Franais se dclarent convaincus que s'ils restreignaient eux-mmes
leur consommation d'nergie, ils pourraient amliorer le climat du globe
1
!
Quel dommage que Nicolas Hulot ne soit pas amricain ou chinois !
Lorsque ceux qui ont en main les cls du problme auront dcid d'agir,
nous devrons videmment joindre nos efforts aux leurs. Mais en attendant, no-
tre frugalit nous interdit d'tre efficaces.
Certains avancent alors un dernier argument, de nature quasi messianique.
Certes, nous ne pouvons avoir par nous-mmes pratiquement aucune influence
sur le volume des missions de la plante, mais nous devons donner l'exemple
au reste du monde. Ceux qui tiennent ce langage n'oublient qu'une chose :
nous le donnons dj.
Nous donnons l'exemple en particulier dans les deux domaines essentiels que
sont la production d'lectricit et la circulation routire. Faut-il ajouter que cela
ne sert pour l'instant rien, puisque les autres pays continuent fabriquer leur
courant lectrique avec des centrales charbon ou gaz, et ont pour la plupart
des parcs automobiles moins conomes que le ntre. Avant de nous culpabili-
ser, demandons donc d'abord aux autres de nous imiter ! C'est, de loin, le meilleur
service que nous puissions rendre la plante.
1
Sondage Ipsos-FFAC, octobre 2006. La majorit des sondages cits dans cet ouvrage peut tre
consulte sur le site de l'institut Ipsos (taper Ipsos puis FFAC).
25
Des Europens stabiliss
Mme s'ils sont pour la plupart beaucoup moins conomes que nous, les au-
tres membres de l'Union europenne matrisent eux aussi, dans l'ensemble,
leurs missions de gaz effet de serre. De 1990 2005, une rduction moyenne
de 1 % a t observe, avec toutefois des situations trs diverses. L'Allemagne a
ainsi diminu ses rejets de 18,5 %, alors que l'Espagne, en pleine expansion
conomique, a accru les siens de 40 % !
Au total, c'est une quasi-stabilit qui a t enregistre, ce qui n'est nanmoins
pas conforme au protocole de Kyoto qui a fix au vieux continent un objectif de
rduction de 8 % de ses missions en 2010 par rapport 1990, objectif qu'il ne
pourra pas tenir. Mais, mme si c'est un degr moindre que pour la France,
l'Europe tout entire ne peut dsormais avoir qu'une influence trs limite sur les missions
de la plante dont elle ne reprsente gure qu'un septime avec quatre milliards de ton-
nes de gaz carbonique d'origine nergtique mises sur une trentaine.
Or l'Europe regroupe l'essentiel des pays qui ont ratifi l'accord de Kyoto,
alors que les grands pays metteurs de la plante ne l'ont pas accept. Il est vi-
demment regrettable que ceux qui sont dcids lutter contre les missions de
gaz effet de serre soient prcisment ceux qui n'y peuvent rien. Les cologistes
sont au Nord, et les pollueurs au Sud.
Le mauvais lve amricain
Une mention particulire doit cependant tre faite des tats-Unis. Ceux-ci
sont en effet pour l'instant les plus grands consommateurs d'nergie de la pla-
nte. Les chiffres laissent en effet pantois. Alors qu'ils ne reprsentent que 5 %
de la population du globe, ils utilisent chaque anne 22 % de l'nergie utilise
dans le monde et mettent une proportion voisine du gaz carbonique d'origine
humaine. Plus prcisment, ils consomment chaque anne 25 % de l'lectrici-
t, 20 % du charbon, 19 % du gaz naturel et 25 % du ptrole mondial
1
. Peut-
tre la prise de conscience qui se fait jour actuellement outre-Atlantique
conduira-t-elle une stabilisation des missions des Etats-Unis, mais gure
mieux.
son chelle, le Canada n'est pas trs diffrent et s'est rvl incapable, mal-
gr la bonne volont affiche et de lourdes dpenses, de tenir les engagements
qu'il avait pris Kyoto. Alors que l'objectif qu'il avait accept tait de rduire
de 6 % ses missions en 2012 par rapport 1990, celles-ci le dpassent aujour-
d'hui de 33 % et ne cessent de s'accrotre tel point que certains n'excluent pas
1
Source : Key World Energy Statistics, IEA.
26
qu'elles s'lvent en 2012 au double de l'engagement initial ! Le gouvernement
conservateur lu au dbut de 2006 a donc dnonc l'accord de Kyoto comme
tant impossible respecter, tout en promettant de dfinir une nouvelle politi-
que qui s'est fait largement attendre tant la tche tait difficile. Rendue publi-
que au printemps de 2007, celle-ci fixe des objectifs de rduction de l'intensit
nergtique des diffrentes activits du pays, et non de la valeur absolue des
missions. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction, mais il a t immdiate-
ment dclar insuffisant par les cologistes, et au premier rang d'entre eux par
Al Gore, ce qui lui a valu d'tre vertement repris par le Premier ministre cana-
dien pour des raisons dcrites plus loin dans cet ouvrage.
C'est que les Amricains du Nord ont t habitus disposer d'une nergie
abondante et bon march et ont adapt leurs comportements en consquence,
qu'il s'agisse de leurs logements, de leurs bureaux, de leurs industries ou de
leurs transports. Les villes se sont tales sur de grandes distances, permettant
l'Amricain moyen d'habiter des logements trs vastes et agrables dans des
quartiers faible densit, ce qui implique des besoins de chauffage et de clima-
tisation lourds, ainsi que de grandes distances parcourir chaque jour. Alors
que le Franais et plus gnralement l'Europen parcourent en moyen-
ne 13 000 kilomtres par an, la distance correspondante atteint 26 000 kilom-
tres outre-Atlantique. L'essentiel de ces trajets s'effectue de surcrot dans des
vhicules routiers qui consomment beaucoup plus que leurs homologues fran-
ais, avec prs de 10 litres aux 100 kilomtres. Il en rsulte que, pour une popu-
lation cinq fois plus leve que la ntre, les habitants des Etats-Unis consom-
ment seize fois plus de carburant sans avoir gure plus recours l'automobile
que nous !
Rve et ralisme
Dans ce contexte, le dbut de 2007 a vu la parution de deux documents aussi
diffrents que possible.
Le premier est l'engagement pris par l'Union europenne de rduire for-
tement ses missions de gaz effet de serre au cours des annes qui viennent.
D'ici 2020, elle s'est fix comme objectif de diminuer ses rejets de gaz carboni-
que dans l'atmosphre de 20 %, et mme de 30 % si d'autres continents se joi-
gnent elle.
Simultanment, de l'autre ct de l'Atlantique, les tats-Unis ont rendu pu-
blic un rapport officiel rdig par leurs soins pour les Nations unies. Celui-ci
prvoit un accroissement de leurs rejets de 11 % au cours de la dcennie venir,
c'est--dire un rythme identique celui enregistr au cours des dix ans passs.
27
Le contraste est saisissant. Face deux approches aussi opposes, la raction
est unanime. Chacun pense qu'il y a d'un ct les bons (l'Europe) et de l'autre
les mauvais sinon les mchants (les Etats-Unis).
Mais est-ce si sr ? Certes, l'Europe s'est fix un objectif ambitieux, mais l'ex-
prience des annes passes incite la prudence. Car il est peu probable que
l'Union europenne puisse tenir les engagements qu'elle avait pris Kyoto de
rduire de 8 % ses rejets entre 1990 et 2010. Elle les a pour l'instant tout juste
stabiliss, malgr des circonstances favorables puisque de nombreuses industries
d'Allemagne de l'Est, massivement mettrices de gaz effet de serre, ont cess
leur activit aprs la runification de 1989. Sinon, les rejets europens se se-
raient accrus au cours des dernires annes de quelques pour cent, c'est--dire
un rythme gure diffrent de celui qu'ont connu les tats-Unis pendant la m-
me priode malgr une croissance conomique plus vigoureuse.
L'engagement europen pour l'avenir est donc surtout un effet d'annonce
usage politique, qui ne fait qu'illustrer un mode de fonctionnement malheu-
reusement trop courant. Personne ne sait d'ailleurs comment il faudra rpartir
cette rduction de 20 % entre les 27 pays membres, car il est exclu que le taux
soit le mme pour tous. Personne ne sait non plus comment il faudra partager
les conomies entre les diffrentes sources d'missions : transport, btiment,
industrie, agriculture, etc. Il y a plus d'interprtations que d'toiles sur le dra-
peau de l'Union ! Il est donc probable que cet engagement ne sera pas tenu.
Mais il n'y a pas lieu de s'en dsoler : cela n'aura aucune importance pour le
climat futur de la plante, compte tenu de l'inertie des phnomnes et du faible
poids du vieux continent dans les missions mondiales !
Certes, les Amricains pourraient consommer moins d'nergie. Le gaspillage
que reprsente un parc automobile o rgnent les vhicules de six huit cylin-
dres reprsente un gisement d'conomies important auquel commencent s'at-
taquer divers tats qui, tels que la Californie, ont fix des objectifs ambitieux de
rduction de la consommation unitaire des vhicules qui seront mis sur le mar-
ch sur leur territoire au cours des annes venir.
Mais il ne faut pas se nourrir d'illusions. Partout ailleurs, les marges de man-
uvre sont rduites. Il en est ainsi par exemple des logements. Leur superficie
est en moyenne double outre-Atlantique de celle que nous connaissons en
France, avec 80 mtres carrs par personne contre 40, et il est difficile de de-
mander aux Amricains de ne chauffer et de n'clairer que la moiti de leurs
pices !
Al Gore lui-mme a bien involontairement montr les limites de l'exercice. Le
lendemain du jour o il reut Hollywood sous les acclamations deux Oscars
pour son film La Vrit qui drange consacr l'effet de serre, la presse amricai-
ne rvlait qu'il habitait une maison digne de Scarlett O'Hara, dont le budget
28
annuel d'lectricit s'levait 25 000 dollars, soit vingt fois celui de l'Amricain
moyen ! Sa seule piscine consomme plus d'lectricit qu'un pavillon amricain
standard. Son film se concluait pourtant par un vibrant appel chaque Amri-
cain pour qu'il fasse tout ce qui tait en son pouvoir pour conomiser l'nergie.
Al Gore aurait voulu dmontrer l'irralisme de ses demandes qu'il n'aurait pas
fait mieux.
Al Gore n'est pas le seul. Tous ceux ou presque qui plaident pour la dfense
de la plante, en Amrique ou ailleurs, prennent allgrement la voiture, l'avion
voire l'hlicoptre pour leurs propres dplacements en expliquant qu'ils en ont
imprativement besoin. Ils se gardent bien d'appliquer eux-mmes ce qu'ils
demandent aux autres, comme si leur engagement en faveur de la sauvegarde
de la plante les exonrait des contraintes qu'ils veulent imposer leurs
contemporains.
Ils leur demandent de prendre les transports en commun et continuent rou-
ler en voiture. Combien de fois, dans un pays comme le ntre, ceux qui affir-
ment qu'il faut utiliser le vlo n'ont-ils pas t pris en flagrant dlit de trompe-
rie, leur bicyclette pliante figurant dans le coffre de leur voiture... l'usage ex-
clusif des mdias ?
Le prince Charles lui-mme fait partie de la grande cohorte de ceux qui ont
fait de la lutte contre le rchauffement climatique leur cause personnelle, et il a
rcemment ajout son nom la liste de ceux qui se sont couverts de ridicule.
Le 24 mars 2007, il prenait le train de banlieue la gare de Waterloo pour
donner l'exemple du recours aux transports en commun, jusqu' ce que la
presse dcouvre que sa Jaguar, venue spcialement du centre de Londres avec
son chauffeur, l'attendait l'arrive pour le conduire sa destination finale.
Comment d'ailleurs aurait-il pu en tre autrement ? Pour rejoindre la rsidence
loigne o il se rendait, il lui fallait bien prendre une voiture comme tout le
monde ! Comment se fait-il que tous ceux qui nous donnent des leons ne se
rendent pas compte qu'elles sont pour la plupart inapplicables ? Faites ce que je
dis, ne faites pas ce que je fais !
L'Amrique ne se distingue pas uniquement par la dimension de ses maisons.
Le climat y est continental, avec des hivers bien plus froids que les ntres et des
ts bien plus chauds. Il faut donc, superficie gale, beaucoup plus d'nergie
pour chauffer ou plus encore pour climatiser, car les dernires dcennies ont
t marques par de trs fortes migrations de population vers le sud, en des
lieux o il fait prs de 40 degrs pendant plusieurs mois par an avec des taux
d'humidit qui avoisinent parfois 100 %, et o la vie serait intenable sans une
climatisation massive.
Si l'on ajoute que les distances parcourir sont plus grandes outre-Atlantique
que celles que nous connaissons, tant dans la vie quotidienne que pour se ren-
29
dre d'une ville l'autre, il ne faut pas s'tonner que les besoins d'nergie par
habitant y soient beaucoup plus importants que sur le vieux continent, et les
marges de rduction en consquence limites avant trs longtemps, ce que tra-
duit la prvision amricaine prcdemment cite qui, dfaut d'tre sduisan-
te, est raliste, pour ne pas dire honnte. Malgr son caractre choquant, il faut
d'ailleurs reconnatre qu'elle suppose une amlioration importante de l'effica-
cit nergtique car, pendant la mme priode, l'conomie amricaine pro-
gressera sans doute d'un tiers, et non de 11 %.
Quant l'Europe, elle s'est pour l'essentiel donn bonne conscience. C'est
que l'Europe ne jure aujourd'hui que par la sauvegarde de la plante, sans avoir
jamais procd une analyse rationnelle des faits, ni mesur les consquences
de ses actes dans ce domaine.
Elle est victime de trois sophismes qui s'insrent dans un raisonnement dont
les bases sont fondes, mais dont les conclusions sont errones.
Le constat du rchauffement de l'atmosphre en constitue le point de dpart.
Il serait absurde de nier son existence, et rares sont ceux qui le font encore.
Jusque-l, le raisonnement est sain. Mais c'est ensuite qu'interviennent trois
erreurs fondamentales de jugement.
Responsables, donc coupables ?
L'instinct conduit tout d'abord penser que, si l'homme est responsable,
c'est qu'il est coupable. C'est oublier que, pour tre coupable, il faut faire quel-
que chose de mal.
Or les missions de gaz effet de serre d'origine humaine sont la fois la
condition et le fruit de la lutte sculaire de l'humanit contre la misre, la pau-
vret, la faim, et du combat pour la vie elle-mme, et il n'y a l videmment rien
de coupable.
Il serait infiniment plus coupable, supposer que ce soit en notre pouvoir, de
laisser une grande partie de l'humanit dans l'extrme misre qui est encore
trop souvent la sienne et dont elle cherche s'chapper, ce qui implique la
consommation d'nergie.
Il existe encore sur terre plus d'un milliard d'tres humains qui n'influent en
rien sur la composition de notre atmosphre, comme c'tait le cas pour nos an-
ctres. Ce sont les plus misrables d'entre nous. Ils habitent en Afrique, en Asie
ou en Amrique latine dans des contres loignes, dpourvues de routes et
bien entendu d'accs l'lectricit. Ils ne consomment pas de ptrole, de gaz
naturel ou de charbon. Ils n'utilisent ni engrais ni produits industriels. La seule
nergie laquelle ils ont accs est durable. C'est celle du bois, indispensable
30
pour cuire les aliments, et qu'il faut gnralement aller chercher des kilom-
tres. Les femmes qui incombe cette corve font ensuite le plus souvent la cui-
sine dans une pice unique dpourvue de ventilation, enfume et insalubre.
L'Organisation mondiale de la sant estime 1 300 000 le nombre d'tres hu-
mains qui meurent prmaturment chaque anne d'un cancer des voies respira-
toires contract de ce fait, dont 500 000 en Inde seulement
1
. Ce bilan dramati-
que, qui concerne pour moiti des enfants de moins de cinq ans, est voisin de
celui de la tuberculose et atteint la moiti de celui du sida !
D'une manire plus gnrale, la pauvret, la faim, les maladies et l'extrme
prcarit sont leur lot. Sur l'chelle du dveloppement des Nations unies, ceux
qui partagent ce sort figurent constamment au dernier rang de tous les classe-
ments. On est bien loin du bon sauvage de Rousseau, suppos vivre heureux
au sein d'une nature gnreuse et protectrice. Il ne faut pas alors s'tonner que,
ds qu'elles le peuvent, ces populations se dirigent vers les bidonvilles des gran-
des agglomrations qui, quoi que nous puissions en penser, leur procurent une
vie moins dure.
Elles rejoignent alors d'autres milliards d'tres humains qui chappent pro-
gressivement la misre, en Chine, en Inde et ailleurs, ce qui implique qu'ils
aient recours aux nergies industrielles : ptrole, charbon, gaz naturel ou
lectricit... et qu'ils engendrent ainsi presque toujours des rejets dans l'atmos-
phre. En quoi seraient-ils coupables ?
La notion de culpabilit ne s'applique pas davantage aux pays dvelopps.
Ceux-ci sont devenus minoritaires au sein des missions plantaires et le seront
de plus en plus, de sorte qu'ils ne peuvent directement avoir au mieux qu'une
influence limite sur leur volume d'ensemble.
Mais surtout, leurs habitants ont atteint un niveau de vie qui ne peut se
concevoir sans recours important l'nergie. Pour qu'ils en consomment
moins, faudrait-il leur interdire d'habiter des logements spacieux, de se dpla-
cer, de manger de la viande, d'aller au restaurant, d'avoir des rsidences se-
condaires, de disposer d'appareils lectromnagers ?
Nous sommes certes responsables des missions qu'engendre le plus souvent
l'nergie que nous consommons. Responsables, mais pas coupables.
L'imaginaire baguette magique
La deuxime de nos ides errones concerne les possibilits de rduction de
nos rejets. Nous avons tendance penser qu'il devrait tre possible de les rdui-
re rapidement sans trop de difficults.
1
World Energy Outlook 2006.
31
L'ide est sduisante, mais pour longtemps inexacte pour l'essentiel. Les
missions proviennent en majeure partie de la combustion du charbon, du p-
trole ou du gaz naturel. Or nous ne pouvons nous passer de ceux-ci par un coup
de baguette magique. Presque partout, l'inertie est considrable. Cela ne signi-
fie pas que certains progrs ponctuels ne puissent tre accomplis, par exemple
pour la consommation unitaire des automobiles. Mais celles-ci ne reprsentent
que 6 % des missions de gaz effet de serre de la plante, et le nombre de voi-
tures continuera s'accrotre rapidement au sein des pays en voie de dvelop-
pement.
Il existe galement des possibilits d'action dans d'autres domaines, mais leur
mise en uvre ne pourra dboucher sur des rsultats significatifs avant long-
temps. Pendant ce temps, la demande du tiers-monde ne va cesser de s'accrotre
un rythme soutenu.
Il faut nous rendre l'vidence. L'humanit ne peut renoncer pour l'instant
utiliser le ptrole, le charbon et le gaz naturel que les res passes ont accumu-
ls dans le sous-sol du globe, et ce sont les limites de l'offre disponible qui d-
termineront pour longtemps encore le rythme de leur consommation et par
consquent, pour l'essentiel, celui des missions de gaz effet de serre. Qui
pourrait raisonnablement imaginer que nous laisserons dormir dans le sous-sol
de la plante les hydrocarbures et en particulier le ptrole qu'il recle ? Les
quantits que n'utiliseront pas les pays dvelopps le seront par ceux qui ne le
sont pas encore.
La perspective d'une rduction massive des missions au niveau du globe
n'est raliste avant longtemps ni sur le plan technique ni d'un point de vue fi-
nancier. Bien que l'humanit soit responsable des missions de gaz effet de
serre, ses marges de manuvre court et moyen terme sont hors d'chelle avec
le problme. Ce n'est que sur le long terme qu'elles pourront porter leurs
fruits.
Des sacrifices sans effet
Enfin, nous pensons instinctivement que, mme si nous ne pouvons pas
grand-chose, nos efforts seront tout de mme utiles.
Il s'agit l d'un des aspects les plus paradoxaux, sinon des plus choquants, du
dossier. Il nous est trs difficile d'admettre que, mme si nous voulons bien faire
et si nous agissons en consquence, nos efforts seront inutiles. Pourtant, l'exa-
men des faits montre que c'est le cas et que, dans l'tat actuel des choses, ce que
nous pouvons faire en limitant nos missions ne sert rien.
32
Ce constat est vrai non seulement au niveau de chaque individu, mais mme
celui d'un continent tout entier.
Il a t rappel que l'Europe s'tait fix pour objectif, dans l'enthousiasme
gnral, de rduire ses missions de gaz effet de serre de 20 % d'ici 2020. Se-
lon toute probabilit, il s'agit l d'un taux qu'elle ne pourra pas atteindre. Mais,
supposer qu'elle le puisse, quel serait l'impact d'un tel effort ? Chacun pense-
ra instinctivement qu'une rduction d'un cinquime du volume annuel des mis-
sions d'un continent tout entier ne pourrait manquer d'apporter une contribu-
tion notable, sinon majeure, la lutte contre la concentration plantaire du gaz
carbonique et contre le rchauffement climatique.
C'est certainement ce que se sont dit les associations, les fonctionnaires et les
hommes politiques qui ont milit de bonne foi pour la mesure et l'ont fait
adopter.
Un quatre millime
Malheureusement, un examen rationnel des choses aboutit un rsultat tout
diffrent. La quantit de gaz carbonique prsente dans l'atmosphre de la pla-
nte s'lve aujourd'hui 2 800 milliards de tonnes comme on l'a vu, et elle at-
teindra environ 3 000 milliards en l'an 2 020 selon les prvisions des experts de
l'Agence internationale de l'nergie et des Nations unies.
Or l'Union europenne met aujourd'hui annuellement 4 milliards de ton-
nes du mme gaz. Si elle arrivait vraiment rduire, au prix d'efforts massifs et
ncessairement extrmement coteux, ses missions de 20 % en 2020, ce
sont 800 millions de tonnes de moins qui seraient mises chaque anne, sup-
poser que le tiers-monde n'utilise pas les ressources nergtiques pargnes. Le
chiffre peut paratre impressionnant, mais chacun peut voir que cela n'aurait
rigoureusement aucun effet, puisque la quantit de gaz carbonique prsente
dans l'atmosphre de la plante ne serait rduite chaque anne que de 800 mil-
lions de tonnes, c'est--dire de moins de 1 milliard sur 3 000. Le chiffre significatif
n'est donc pas de 20 %, mais de l'ordre un quatre millime (1/4000) ! Mme au
bout de dix ans, l'impact ne serait toujours, au mieux, que de un sur 400, c'est-
-dire tout aussi nul. Il le serait d'autant plus que, du fait des autres continents,
le stock de gaz carbonique dans l'atmosphre continuera de toute manire
s'accrotre au rythme d'une vingtaine de milliards de tonnes par an si ceux-ci ne
font rien. Le flux est confondu avec le stock.
Faute d'avoir procd ce calcul lmentaire, l'Union europenne est prte
se mobiliser tout entire et faire de la lutte contre les missions de gaz effet
de serre sa priorit absolue au prix de contraintes, de rglements et surtout de
33
dpenses massives qui obreront son avenir compar au reste du monde, et ne
serviront pourtant rien dans l'tat actuel des choses.
Elle s'est ainsi fix arbitrairement de porter 20 % au lieu de 6 % la part des
nergies renouvelables au sein de son approvisionnement, ce qui est hors
d'atteinte et cotera en tout tat de cause des sommes considrables, sans qu'il
en rsulte quoi que ce soit de perceptible pour l'effet de serre.
Le bon sens n'a manifestement plus cours. Comment est-il possible que per-
sonne n'ait pos quelques questions simples ? Tout ceci sert-il vraiment quel-
que chose ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? Que pourrions-nous faire avec les
mmes sommes, par exemple pour lutter contre la pauvret ou pour combattre
ailleurs ou autrement l'effet de serre ?
Quant l'efficacit des efforts de chaque individu pris isolment, on imagine
combien elle est inexistante. Si l'action massive d'un continent tout entier ne
peut avoir la moindre influence, que dire de celle de chacun d'entre nous ?
C'est ce qu'exprime Dominique Voynet lorsque, s'adressant Nicolas Hulot,
elle dclare : Il faut cesser de faire croire qu'en coupant l'eau du robinet
quand on se lave les dents on sauvera la plante.
Les cologistes savent ce qu'il en est, et ils ont raison quand ils affirment que,
pour agir vritablement sur le phnomne du rchauffement climatique, il fau-
drait diviser par deux les missions de gaz effet de serre de l'ensemble de la
plante en regard des prvisions.
L'objectif est louable. Mais, en attendant, la lutte contre l'effet de serre sert de
prtexte d'innombrables gaspillages.
34
CHAPITRE IV
Gaspillages tous les tages
Les Grnen
Pour comprendre comment nous avons pu en arriver l o nous en sommes,
il faut savoir que notre politique cologique, comme celle de l'Europe sinon du
monde, est directement inspire des Verts allemands, les Grnen. Or ceux-ci ont
une obsession : un refus pathologique de l'nergie nuclaire.
Ayant t membres de plusieurs gouvernements successifs dans le cadre d'une
alliance avec le parti social-dmocrate SPD, ils ont russi non seulement arr-
ter la construction de toute centrale nuclaire en Allemagne, mais galement
faire adopter le principe de la fermeture progressive de celles qui existent. Lie
par ses accords avec le SPD dans le cadre de la grande coalition actuellement au
pouvoir, Angela Merkel n'a pu remettre en cause cette dcision qui fait d'ail-
leurs outre-Rhin l'objet d'un vaste consensus de l'opinion, nos voisins n'tant
pas spcialement connus pour tre cartsiens.
Mais, comme les autres pays, l'Allemagne ne peut se passer d'lectricit, de
telle sorte qu'elle a adopt une politique nergtique deux faces, dont l'une
est relle et l'autre optique.
D'un ct, elle construit pour satisfaire ses besoins des centrales thermiques
classiques au gaz naturel ou au charbon qui dgagent de grandes quantits de
gaz carbonique dans l'atmosphre et revtent cet gard un caractre catastro-
phique, puisque les missions d'origine nergtique des Allemands par habitant
sont suprieures des deux tiers celles des Franais, avec plus de 10 tonnes par
an contre 6, ce qui ne se produirait videmment pas si nos voisins avaient adop-
t l'nergie nuclaire comme nous l'avons fait nous-mmes.
De l'autre ct, l'Allemagne a mis en uvre une srie de politiques aussi co-
teuses qu'inefficaces qui gravitent autour du mythe des nergies dites renouve-
lables , dans le double but de se donner bonne conscience et de masquer aux
yeux de tous le fait qu'elle reste un pollueur massif. Nos voisins ont russi im-
poser progressivement leurs vues en trompe-l'oeil au reste de l'Europe, puis au
monde.
35
Quant nous, le plus tonnant, c'est que nous disposons d'une lectricit
abondante, bon march et non polluante, et que nous n'avons aucun besoin de
nous livrer aux gesticulations de nos voisins, ce que nous faisons cependant
grande chelle en cdant au politiquement correct ambiant impos par les co-
logistes.
La rgle d'or
Il faut bien comprendre que la lutte contre l'aggravation de l'effet de serre ne
peut justifier n'importe quoi. Face un phnomne potentiellement aussi gra-
ve, les ressources financires de notre pays et celles de la plante sont limites,
et il faut les utiliser l o elles sont les plus utiles, ce qui a conduit l'Agence in-
ternationale de l'nergie noncer dans son rapport Perspectives des technologies
de l'nergie, destin aux membres du G8 qui regroupe les grands pays de la pla-
nte, ce que l'on pourrait qualifier de rgle d'or et qui s'nonce ainsi : Au-
cune des technologies ncessaires pour diminuer les missions ne devrait, au
stade industriel, entraner une majoration des cots suprieure 25 dollars par
tonne d'mission vite de CO
2
dans tous les pays, y compris les pays en voie de
dveloppement.
Sauf s'il s'agit de recherches, il ne faut donc utiliser les ressources dont nous
disposons, qu'elles soient publiques ou prives, que si elles permettent d'par-
gner plus d'une tonne de gaz carbonique chaque fois que nous dpensons 25
dollars, c'est--dire au plus 20 euros.
On peut mettre en cause ce montant, mais pas le principe d'une telle rgle. Il
faut bien comprendre que le phnomne qui nous proccupe, c'est--dire
l'mission de gaz effet de serre, est mondial et non pas local. Une tonne de
gaz carbonique mise en Chine, en Inde, ou aux tats-Unis, a exactement le
mme effet potentiel qu'une tonne rejete en France ou en Allemagne. Autre-
ment dit, si l'on peut viter le rejet d'une tonne pour 20 euros quelque part
dans le monde, il serait absurde de dpenser ailleurs 40 euros pour le mme
rsultat. Il est encore plus absurde de dpenser plusieurs centaines ou plusieurs
milliers d'euros par tonne pargne, et c'est pourtant ce que nous faisons cou-
ramment.
La remarque est tout aussi valable au sein d'un mme pays : il ne faut mettre
en uvre que les mesures qui, pour une mme dpense, permettent d'obtenir
le meilleur rsultat.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes trs loin du compte,
lorsqu'on voit l'incohrence complte des politiques que nous suivons.
36
Certes, parmi les mesures prises au nom de la lutte contre l'effet de serre, il
en existe dont le bien-fond ne saurait tre discut et qui sont d'autant plus jus-
tifies qu'elles procurent des conomies plus ou moins substantielles ceux qui
les mettent en uvre sans que cela ncessite une intervention de l'autorit pu-
blique.
Lorsqu'un automobiliste choisit une voiture de cylindre rduite au lieu d'un
modle puissant, il est doublement gagnant puisqu'il dpense moins d'argent
l'achat et rduit ensuite ses missions. Les conomistes diront alors que le cot
du gaz carbonique pargn est ngatif !
Lorsqu'un particulier ou une entreprise remplace une ampoule lectrique
classique par un modle qui consomme peu et dure plus longtemps, il peut ar-
river que l'opration soit financirement justifie. Tout dpend du prix d'achat
de l'ampoule, du nombre d'heures d'utilisation et du tarif du courant.
Lorsqu'on construit une maison, il ne viendrait plus l'ide de personne de
ne pas isoler les murs et le toit. Pour une dpense mineure, les conomies de
chauffage seront trs importantes et les missions de gaz carboniques rduites
en consquence.
Mais des dcisions de cette nature, qui sont justifies par elles-mmes sans
qu'il soit ncessaire d'intervenir, sont en nombre limit.
Si l'on veut aller plus loin, il faut que la puissance publique intervienne, soit
par la voie de subventions, soit par celle de rglementations de nature diverse.
Et c'est alors que les choses drapent, comme en tmoigne ce que nous faisons
dans des domaines aussi diffrents que l'nergie olienne ou solaire, les biocar-
burants, l'isolation des logements, ou les transports.
Les oliennes
A priori, quoi de plus logique que de fabriquer de l'lectricit avec du vent ?
Voil bien une nergie qui parat gratuite et inpuisable, et qui n'affecte pas les
cycles de la nature. On comprend donc qu'elle figure en tte de celles dont la
plupart des cologistes rclament cor et cri le dveloppement, et qu'elle
jouisse dans l'opinion et parmi les dcideurs d'un prjug largement favorable.
Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes si un examen
quelque peu approfondi des choses ne mettait en vidence un bilan catastro-
phique. Qu'on en juge plutt : l'lectricit qu'elles produisent est tout d'abord
trs chre. Mais surtout, et contrairement aux apparences, les oliennes accroissent
le volume des rejets de gaz carbonique dans l'atmosphre au lieu de les rduire, aussi
surprenant que cela puisse paratre !
37
Les oliennes possdent en effet une caractristique qui rduit nant tous
les avantages qu'on est instinctivement port leur attribuer : comme aurait pu
le dclarer monsieur de la Palice, elles ne fonctionnent que lorsqu'il y a du
vent, et non pas lorsqu'il est trop faible, ou trop fort pour qu'elles puissent
tourner sans danger.
Or, la majeure partie du temps, le vent ne souffle pas, ou trop peu pour qu'el-
les soient productives. Certes, la situation varie d'un endroit l'autre, mais dans
notre pays, le nombre heures o les oliennes sont utilisables varie entre 1 700
et 2 000 par an, soit de 20 % 25 % du total annuel. On conoit que, dans de
telles conditions, leur rendement soit faible et que le cot de l'lectricit pro-
duite soit important, car l'investissement est peu utilis, contrairement par
exemple celui de nombreuses chutes d'eau au fil du courant.
Source : ASSOCIATION VENT DE COLRE (Internet).
Cette courbe montre les variations de la puissance dlivre par une olienne en un mois.
Elle se passe de commentaires. Il est videmment impossible de compter sur une nergie aussi
fantasque, utilisable au mieux un quart du temps, et qu'il faut complter par un rseau de
centrales charbon ou gaz prtes s'y substituer tout moment, c'est--dire les trois quarts
du temps.
Le prix de revient du kilowatt-heure produit est alors nettement plus lev
que celui qui peut tre obtenu partir de centrales thermiques classiques ou
nuclaires, de telle sorte que si EDF ne s'tait pas vu imposer par les gouverne-
ments successifs de racheter l'lectricit d'origine olienne un tarif prohibitif,
il n'y aurait pas en France un seul de ces moulins vent des temps modernes.
38
Mais l n'est pas l'essentiel. Du point de vue de l'effet de serre, il y a pire, et
les oliennes sont un dsastre. partir du moment o le vent ne souffle qu'une
partie trs minoritaire de l'anne et peut s'arrter d'un moment l'autre, il faut
que le parc des oliennes soit doubl de centrales classiques de puissance qui-
valente afin de prendre instantanment le relais en cas de ncessit, c'est--dire
les trois quarts du temps au moins. On imagine mal une ville qui ne serait clai-
re et dont les usines ne fonctionneraient que lorsqu'il y a du vent !
Or ce parc de centrales prtes se substituer tout moment aux oliennes ne
peut gure tre constitu que d'units fonctionnant au charbon ou au gaz, les
usines nuclaires n'ayant pas la souplesse voulue pour s'adapter des fluctua-
tions qui peuvent tre d'une grande brutalit lorsque le vent se met d'un seul
coup souffler, ou s'arrter.
Autrement dit, plus le parc des oliennes se dveloppe, plus il faut accrotre celui des
centrales classiques charbon ou gaz, et donc augmenter les rejets de gaz carbonique !
Les perspectives sont d'autant plus sombres que, pour cder la mode colo-
gique, EDF s'est lanc dans un trs vaste programme de construction d'olien-
nes. En inaugurant dans l'Hrault l'une d'entre elles, son prsident a dclar
le 7 juillet 2006 : D'ici 2010, nous allons investir 3 milliards d'euros dans
l'nergie olienne, soit autant que pour construire notre prochaine centrale
nuclaire EPR. Autrement dit, le cot de celle-ci va tre doubl pour tenter,
en pure perte, d'obtenir le silence des cologistes.
Il sera mme trs probablement tripl puisque la construction durera au
moins six ans. Il faut dire que la politique suivie par EDF mrite d'tre dcryp-
te. Les responsables de l'entreprise savent pertinemment que la seule manire
de produire massivement de l'lectricit sans mettre de gaz effet de serre est
aujourd'hui de recourir aux centrales nuclaires et que les nergies renouvela-
bles sont des leurres l'exception de l'hydrolectricit dont les potentialits
sont dj exploites dans notre pays. Mais, face la dferlante cologique, ils
ont choisi de faire croire le contraire.
Ils mettent ainsi en exergue dans toute leur communication leurs efforts en
faveur des nergies renouvelables pour tenter de se faire pardonner le fait
qu'ils continuent de miser sur le nuclaire. Un rcent fascicule intitul E =
moins de CO
2
, largement diffus en juillet 2007 grand renfort de publicit
dans tous les kiosques de l'hexagone, est cet gard un remarquable exemple
de dsinformation politiquement correcte.
Il accorde plus de place l'nergie olienne (deux millimes de la produc-
tion nationale d'lectricit) et l'lectricit d'origine solaire (un dix millime
de celle-ci) qu' l'lectricit nuclaire qui rpond 80 % de nos besoins. On y
lit aussi au hasard des pages qu'il faut construire des centrales thermiques qui
compensent galement les baisses de production difficiles prvoir des ner-
39
gies renouvelables et en particulier de l'olien . C'est le moins que l'on puisse
dire puisque le mme document reconnat par ailleurs que, dans notre pays,
une olienne produit de l'lectricit environ un quart de temps . Les bais-
ses concernent alors les trois quarts de celui-ci ! Autrement dit, EDF reconnat
que, plus en dveloppe les oliennes, plus il faut construire des centrales ther-
miques classiques polluantes.
Bien entendu, il n'est pas un cadre d'EDF qui croit un seul instant aux
nergies renouvelables . Mais le terrorisme intellectuel cologique est tel que
les responsables de l'entreprises ont estim qu'ils n'avaient d'autres choix, pour
faire passer leurs projets nuclaires, que de mentir dlibrment et aux frais du
consommateur.
Quant aux quelques lecteurs qui ont achet cette plaquette, ils ont eu la satis-
faction d'apprendre que, dans l'inimitable jargon cologique, sa vente, qui ne
couvrira sans doute pas le dixime des frais encourus, servira financer des
produits d' coefficacit nergtique . cologisme, quand tu nous tiens...
L'chec danois
Si c'est possible, il y a plus ridicule encore, comme en tmoigne le Danemark,
cit comme rfrence par les cologistes du monde entier, car c'est le pays
d'Europe qui a le plus mis sur l'lectricit produite par le vent, au point
d'avoir couvert d'oliennes de grandes parties de son territoire et mme de ses
mers, ce qui a permis qu'une partie notable de son lectricit leur soit dsor-
mais redevable.
Pourtant, le Danemark vient de dcider de tout arrter, car il est dsormais
confront des problmes insolubles. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent,
c'est--dire, l aussi, les trois quarts du temps, les milliers d'oliennes installes
ne servent rien, et il faut produire l'lectricit ncessaire la vie quotidienne
et aux industries par des centrales classiques au fuel, au charbon ou au gaz. Cel-
les-ci rejettent alors allgrement du gaz carbonique dans l'atmosphre par mil-
lions de tonnes.
Et c'est lorsque le vent se lve que les choses se compliquent. Face de brus-
ques arrives supplmentaires d'lectricit, les ingnieurs danois sont confron-
ts des choix cornliens. Ils ne peuvent stopper compltement les units
thermiques qui fonctionnaient jusqu'alors, d'autant plus qu'il faut tre capable
de les faire repartir sans dlai en cas de besoin, le vent s'arrtant parfois aussi
rapidement qu'il se lve.
Ils ont donc soudainement trop d'lectricit. Ils se retournent alors vers leurs
voisins germaniques pour tenter de leur vendre celle-ci, les rseaux tant inter-
40
connects. Mais, pour le malheur des Danois, les Allemands se sont galement
dots de multiples oliennes, plus grande chelle encore puisqu'ils dtiennent
le record du monde, et ils sont soumis aux mmes fluctuations climatiques. Au-
trement dit, quand le Danemark a trop d'lectricit, la situation est la mme de
l'autre ct de la frontire. Leurs voisins leur rpondent donc : Surtout pas !
Mme si vous nous donniez votre courant, nous n'en voudrions aucun prix.
En revanche, nous pouvons vous en fournir, gratuitement de surcrot...
En conclusion, pour peu que le vent souffle un peu fort, les Danois disposent
systmatiquement d'lectricit excdentaire. Ils n'ont alors d'autre solution que
d'arrter une partie de leur parc olien. Et quand ils ne le font pas parce que les
producteurs qui sont pays en fonction du nombre de kilowatt-heures fournis
refusent de le faire, les cbles risquent de fondre !
Le plus grave n'est enfin pas l. Il tient au fait que le Danemark le pays eu-
ropen qui a, toutes proportions gardes, le plus multipli les oliennes sous la
pression des cologistes est corrlativement l'un de ceux dont le bilan en ter-
mes d'missions de gaz effet de serre est le plus dsastreux, avec prs de 10
tonnes de gaz carbonique mises par habitant contre 6 en France ! Comme l'a
dclar devant l'Institut des hautes tudes de la Dfense nationale Anne Lau-
vergeon, la prsidente d'Areva dont les mdias ont laiss entendre l'poque
qu'elle avait t sollicite pour faire partie du premier gouvernement Sarkozy :
L'hydraulique et le nuclaire sont des nergies qui fonctionnent en base,
c'est--dire par tous les temps. L'olien et le solaire sont des nergies d'appoint.
Elles ne produisent que quand il y a du vent et du soleil. Elles ncessitent donc
la mise en place de back-up. Le pays qui a le plus dvelopp l'olien est le Da-
nemark avec 13 % d'olien dans son bilan nergtique. Il y a ainsi 13 % de cen-
trales au fuel qui dmarrent quand le vent ne souffle pas. Ce n'est pas une faon
efficace d'viter la pollution de l'atmosphre
1
.
Les cadeaux
On comprend donc pourquoi Copenhague a dsormais dcid d'arrter cette
politique catastrophique tout point de vue. Les Hollandais en ont fait autant.
Mais manifestement, nos responsables politiques ne savent pas ce qui se passe
moins de mille kilomtres de nos frontires, puisqu'ils ont cd leur tour la
mode olienne, pour ne pas dire du politiquement correct. C'est ainsi que le 27
juillet 2006, le ministre de l'Industrie Franois Loos a publi un arrt fixant
82 euros le prix d'achat par EDF du mgawatt-heure (1 000 kilowattheures)
produit par des oliennes.
1
Revue Dfense, n 117, septembre-octobre 2005.
41
Il faut savoir que l'Agence internationale de l'nergie estime dans son rapport
annuel de 2006 que le prix de revient d'un kilowatt-heure produit par des o-
liennes varie entre 5,2 et 7,6 centimes de dollars, soit entre 41 et 60 euros
pour 1 000 kilowatt-heures en supposant qu'un euro vaille seulement 1,25 dol-
lar. Pourquoi alors avoir garanti aux promoteurs des oliennes des tarifs si ma-
nifestement suprieurs aux cots de revient, si ce n'est pour cder la mode
ambiante ?
Ce n'est pas tout. Les oliennes ne produisent du courant que lorsque nous
n'en avons pas ou peu besoin. Les pointes de la demande surviennent en effet
lorsqu'il fait trs froid car il faut se chauffer, ou trs chaud car il faut climatiser.
Or ces priodes concident toujours avec la prsence d'anticyclones, c'est--dire
avec l'absence de vent. Les oliennes ne tournent donc que lorsque nous avons
dj trop de courant, car notre parc nuclaire est trs largement dimensionn.
Ne sommes-nous pas, de trs loin, le premier exportateur net d'lectricit du
monde, avec 69 terawatt-heures, c'est--dire 69 milliards de kilowatt-heures ?
Lorsque les oliennes peuvent tourner, elles sont donc en concurrence avec
une lectricit nuclaire surabondante dont le prix de revient est de l'ordre
de 5 (cinq) euros pour 1 000 kilowatt-heures, toujours d'aprs l'Agence interna-
tionale de l'nergie, puisque les centrales sont amorties depuis longtemps. Cinq
euros, c'est seize fois moins que le prix d'achat garanti aux firmes qui investis-
sent dans les oliennes.
Et l'on ne peut pas compter sur le march international pour absorber la
production. Dans les priodes o le vent souffle, les cours internationaux s'ef-
fondrent le plus souvent, car nos voisins disposent galement d'excdents. Au-
trement dit, les 82 euros pour 1 000 kilowatt-heures garantis aux producteurs
d'lectricit d'origine olienne sont pour l'essentiel un cadeau pur et simple
qui leur est consenti sur le dos de notre facture d'lectricit.
Compte tenu de la diffrence entre ce prix garanti et le cot de revient estim
par les experts internationaux, on conoit que la cration de fermes olien-
nes soit une excellente affaire pour leurs promoteurs, et que ceux-ci se prcipi-
tent pour en couvrir nos paysages, en les dfigurant bien plus gravement et s-
rement que ne le font les lignes haute tension qui suscitent des oppositions
farouches de la part des mmes cologistes qui prnent le dveloppement des
oliennes.
Dans ces conditions, la rentabilit financire des installations oliennes est
donc excellente. Selon un dicton bien connu dans la profession, elles s'instal-
lent l o il y a des subventions nationales, plutt que l o il y a du vent. La
Commission de rgulation de l'lectricit, organisme officiel charg de donner
un avis objectif, avait pourtant expressment affirm que : Le tarif de 82 euros
occasionne une rentabilit des capitaux propres trop importante au regard de
42
ce qui serait ncessaire pour susciter l'investissement, mme dans l'hypothse
des cots la plus dfavorable, ceci conduisant des taux de rendement de 20
40 % par an aprs impt, garantis sur quinze ans, pour des sites moyennement
vents.
Le rve pour tout investisseur ! Le surcot pour le service public, c'est--dire le
consommateur, a t estim par le mme organisme entre 1 et 2,5 milliards
d'euros par an, chiffre disproportionn au service attendu .
Il faut savoir que les sept membres de la Commission de rgulation de l'lec-
tricit sont nomms par le gouvernement, l'Assemble et le Snat, et que leur
comptence et leur indpendance ne font gure de doute. Malheureusement,
leur avis n'est que consultatif.
On demeure donc stupfait et surtout dsol devant un tel gchis. Car il faut
bien que quelqu'un paye la diffrence entre le prix d'achat garanti ceux qui
implantent des oliennes, et le prix de vente du courant ainsi produit. Et celui
qui paye, c'est le consommateur qui achte son courant EDF un tarif qui in-
clut un supplment pudiquement appel contribution au service public de
l'lectricit , comme chacun peut le constater en consultant sa facture.
L'une des autorits les plus respectes de notre pays en la matire, Marcel
Boiteux, ancien prsident d'EDF et membre de l'Institut, n'a pas manqu de
faire part de son opposition en dclarant notamment : court terme, le soleil
et le vent restent des nergies trs coteuses et capricieuses. Je ne crois pas que
l'olienne ait un grand avenir [...]. Quand on dit, quand on crit, que telle bat-
terie d'oliennes pourrait couvrir la consommation d'une ville comme Bor-
deaux, on oublie de prciser que les Bordelais devraient alors se priver totale-
ment de courant quand il n'y a pas ou pas assez de vent, quitte se rattraper aux
heures bnies o les oliennes tournent. Mais s'clairer deux fois plus quand il y
a du vent ne compense pas les heures o il faut vivre dans le noir ! Remettons
les pieds sur terre : avec ou sans oliennes, il faut construire tout autant de cen-
trales classiques ou nuclaires [...]. Le problme serait tout diffrent si l'on sa-
vait stocker conomiquement l'lectricit. Mais il faudrait pour chaque olienne
d'normes batteries d'accumulateurs dont le cot serait encore plus prohibitif
[...]. Il ne sert rien non plus de dpenser beaucoup d'argent sous prtexte de
profiter d'un effet de srie : on n'engendre que des sries de dficits ou de sub-
ventions.
Au-del de nos frontires, d'autres sont encore plus directs. Comme l'a dcla-
r le 27 juin 2006 Peter Mac Gauran, ministre de l'Agriculture d'Australie :
Les oliennes dvaluent nos paysages et nos proprits [...]. Elles diminuent si
peu nos missions de gaz effet de serre que c'est un leurre. Elles sont seule-
ment une excuse pour des entrepreneurs pour gagner de l'argent au dtriment
des contribuables et des consommateurs...
43
Quant ceux qui s'tonneraient que la prsidente d'Areva, tout en tant par-
faitement consciente de l'inutilit des oliennes, ait cherch se dvelopper
dans ce secteur, il faut qu'ils comprennent que lorsqu'il y a un march gigan-
tesque et hautement rmunrateur, ft-il artificiel et entirement pay par le
consommateur ou le contribuable, il est du devoir de chaque chef d'entreprise
d'essayer d'en prendre sa part.
Le comble a toutefois t atteint en Allemagne, lorsque des journalistes se
sont aperus que des oliennes tournaient en l'absence de vent. Selon les m-
dias, c'tait la socit productrice, qui disposait par ailleurs d'excdents, qui les
faisait tourner pour faire croire qu'elles produisaient du courant...
L'lectricit solaire
La fabrication d'lectricit par des oliennes se rvle donc une opration ca-
tastrophique. S'il est possible, le rsultat est pire encore lorsqu'on essaie de
produire du courant avec des panneaux solaires. Ceux-ci n'ont de justification
que lorsqu'il s'agit d'alimenter des quipements non relis un rseau, tels que
des bornes autoroutires, ou des villages situs dans des pays trs pauvres et en-
soleills, pour des usages ponctuels tels que la sauvegarde de mdicaments qui
doivent tre conservs dans des rfrigrateurs qu'il faut alimenter en lectricit.
Mais vouloir fabriquer du courant grande chelle pour alimenter les rseaux
lectriques des pays dvelopps ne rsiste pas l'analyse, du fait de deux in-
convnients majeurs qui sont les mmes que ceux auxquels est confronte
l'lectricit olienne.
Les panneaux solaires ne fournissent tout d'abord du courant que le jour, et
avec une puissance qui varie en fonction de l'clairement. Il faut donc, comme
les oliennes, les suppler avec des centrales classiques.
En outre, le prix de revient du kilowatt-heure ainsi produit est pour l'instant
prohibitif. C'est ainsi que l'Allemagne construit une centrale de 550 000 pan-
neaux solaires prs de Leipzig, qui couvrira l'quivalent de 200 terrains de foot-
ball. Le montant prvisionnel de l'opration est estim 130 millions d'euros,
et le cot de revient prvisionnel du kilowatt-heure prs de dix fois plus cher
encore que lorsqu'il s'agit d'lectricit d'origine olienne
1
, celle-ci tant dj
deux trois fois plus chre que lorsqu'elle est produite par d'autres sources !
C'est ce que confirme Anne Lauvergeon lorsqu'elle dclare : Toutes les sour-
ces d'nergie ne produisent pas au mme prix. L'ide qui consiste croire que
le prix du kilowatt-heure dpend de l'argent investi dans chaque source est une
ide rpandue. Hlas, ce n'est pas le cas. Les deux sources les moins chres
1
Le Figaro, 28 avril 2007.
44
pour faire de l'lectricit sont l'hydraulique et le nuclaire. Le prix mondial
moyen est de l'ordre de 3 centimes d'euro le kilowatt-heure, alors qu'il est de 6
pour l'olien et qu'il est dix fois plus cher pour le solaire.
Quant l'impact sur les missions de CO
2
, qui est cens tre le but poursuivi,
le bilan est tout aussi dsastreux. Les conomies annuelles de la centrale solaire
allemande sont estimes 25 000 tonnes de gaz carbonique, ce qui porte le cot
de la tonne pargne 500 euros environ, soit vingt-cinq fois le plafond re-
command par l'Agence internationale de l'nergie ! Autrement dit, pour une
mme somme, il serait possible d'tre vingt-cinq fois plus efficace ailleurs pour
lutter contre l'effet de serre...
Quant aux 10 000 foyers de la ville de Leipzig que cette centrale est cense
alimenter, il faudrait qu'ils renoncent s'clairer la nuit s'ils ne pouvaient
compter que sur cette installation solaire qui ne fonctionnera videmment que
le jour !
En dfinitive, l'ide d'alimenter des rseaux lectriques l'aide de l'nergie
solaire ne rsiste pas une analyse un tant soit peu srieuse et il ne faut pas
s'tonner que l'lectricit d'origine solaire ne reprsente que 0,05 % de la pro-
duction mondiale de courant.
Il faut se rendre l'vidence. Les dpenses considrables et injustifies de la
plupart des pays europens en faveur des nergies olienne et solaire ont pour
seul objet de leur donner bonne conscience face leur refus de construire des
centrales nuclaires, et pour seule consquence de multiplier les centrales clas-
siques gaz ou charbon, premires causes de gaz effet de serre.
C'est l le mythe des nergies renouvelables .
L'isolation des constructions : un puits sans fond
Pour rduire les missions de gaz effet de serre d'origine nergtique, il
n'existe que deux mthodes. La premire vise rduire ou supprimer ces mis-
sions la source. C'est le cas par exemple lorsque de l'lectricit est produite
par des centrales nuclaires qui n'mettent aucun rejet de cette nature, ou par
des centrales hydrauliques.
La seconde mthode consiste rduire la consommation finale en procdant
des conomies d'nergie. C'est ce qui se passe lorsque les constructeurs d'au-
tomobile ou d'avion mettent au point des moteurs plus performants, ou lorsque
l'isolation de btiments est amliore.
L'amlioration de l'isolation des immeubles peut rduire les besoins dans de
fortes proportions, et c'est pourquoi la plupart des pays encouragent leurs pro-
pritaires le faire. La France n'chappe pas la rgle, ce qui serait louable si,
45
faute d'avoir pris conscience de l'ampleur de la question, elle ne s'tait engage
dans une politique en grande partie ruineuse, sans issue et injustifie.
Nous avons aujourd'hui des exigences que ne connaissaient pas nos prdces-
seurs. De grandes quantits d'nergie sont ncessaires pour chauffer ou climati-
ser les logements ou les bureaux, ainsi que pour y faire fonctionner les multi-
ples appareils et quipements qui rendent la vie moderne, et particulirement
celle des femmes, plus efficace et plus agrable. Cette consommation d'nergie
a le plus souvent comme consquence des missions de gaz effet de serre, soit
l'occasion du chauffage des immeubles, soit tout au long de l'anne du fait de
la consommation d'lectricit lorsque cette dernire provient de centrales
thermiques gaz ou charbon.
Les seules exceptions concernent les pays o l'lectricit est d'origine nu-
claire ou hydraulique. Mais au total, d'aprs le World Research Institute qui
fait autorit, le secteur rsidentiel et tertiaire est l'origine directe ou indirecte
de prs de 20 % des missions de gaz effet de serre de la plante. En France,
les rejets correspondant au secteur rsidentiel reprsentent 95 millions de ton-
nes de gaz carbonique annuellement.
Or il serait possible de faire beaucoup mieux. La consommation d'nergie
ncessaire pour le chauffage peut notamment varier trs fortement en fonction
de la qualit de l'isolation. Dans certains pays nordiques, les triples vitrages sont
frquents et les murs et les toits parfaitement isols, de telle sorte que les dper-
ditions de chaleur sont faibles mme si elles restent beaucoup plus importantes
par les fentres que par les murs. Il est galement possible d'installer sur le toit
des maisons individuelles des panneaux solaires destins, non pas produire de
l'lectricit, mais fournir une partie de l'eau chaude ncessaire la vie quoti-
dienne des habitants.
Un cot hors d'chelle
Toutefois, une distinction majeure doit tre faite entre les constructions futu-
res et le parc existant. La mise en uvre de normes strictes peut tre envisage
pour les constructions nouvelles au prix d'un surcot dj trs substantiel et
qu'il faut contenir dans des limites raisonnables, ce qui n'est pas toujours le cas.
Mais l'essentiel des logements qui existeront dans notre pays dans vingt ou
trente ans est dj construit, et les adapter pour rduire trs fortement leur
consommation nergtique ncessiterait des travaux d'un montant insupporta-
ble. Selon l'Ademe (Agence de dveloppement et de matrise de l'nergie), une
division par trois de l'nergie requise pour leur chauffage serait possible, mais la
dpense correspondante atteindrait pour notre seul pays le montant de 400
46
600 milliards d'euros dont les pouvoirs publics devraient sans doute payer lar-
gement plus de la moiti, c'est--dire plus de 300 milliards, pour aider les pro-
pritaires procder aux travaux ncessaires ! Face une telle somme, le re-
tour sur investissement serait ngligeable, puisque la rduction correspondan-
te des missions de gaz carbonique n'excderait pas 60 millions de tonnes par
an, soit deux millimes des missions mondiales actuelles. La dpense annuali-
se serait de l'ordre de 800 euros par tonne de CO
2
pargne. Et si l'on voulait
gnraliser la mesure l'ensemble du globe, la dpense mondiale dpasserait all-
grement 10 000 milliards d'euros !
Tableau 1
Isolation des logements
Cot budgtaire
(millions d'euros)
octobre 2006
Subvention par ton-
ne de CO
2
vite
Dpense totale par
tonne de CO
2
vite
Isolation thermique
des murs
2,2 2 6
Chaudires indivi-
duelles basse tem-
prature
88 15 45
Chaudires
condensation indi-
viduelles
39,3 34 102
Chaudires bois 118,5 43 129
Pompes chaleur 89,3 97 291
Solaire thermique 33,9 290 870
Isolation thermique
des fentres
460,8 137 411
Source : Ministre des Finances pour les colonnes 1 et 2.
L'ampleur des dpenses ncessaires pour amliorer l'isolation des logements est confirme par une rcen-
te tude du ministre des Finances. D'aprs celle-ci, les subventions verses en faveur de l'amlioration de
l'habitat pour pargner le rejet dans l'atmosphre d'une tonne de CO
2
n'ont pas la moindre cohrence.
Ramene la tonne pargne, la subvention varie de 2 euros lorsqu'il s'agit d'isoler les murs, ce qui est
particulirement efficace, 290 euros pour l'installation de panneaux solaires, en passant par 137 euros
pour l'isolation thermique des fentres. Encore les subventions sont-elles loin de reprsenter la totalit de la
dpense, qui est sans doute trois fois plus leve en moyenne compte tenu de l'apport des propritaires.
47
Si l'on se souvient qu'aucune dpense suprieure 20 euros par tonne de
CO
2
vite n'est justifie selon les experts internationaux, la conclusion est clai-
re. l'exception de l'isolation des murs, aucune des oprations numres dans
le tableau 1 ne devrait tre mise en uvre. Au total, les subventions verses ap-
prochent pourtant dj un milliard d'euros par an et ne cessent de crotre. C'est
juste titre que le journal La Tribune a pu titrer : Quand Bercy jette un mil-
liard par les fentres... (19 avril 2007). Aux subventions s'ajoute la quote-part
des dpenses directement prises en charge par les propritaires des logements,
soit 2 autres milliards environ, ce qui porte le total des dpenses effectues 3
milliards par an pour un rsultat insignifiant.
Ceux qui prconisent le traitement systmatique de notre parc immobilier af-
firment que de telles dpenses creraient dans notre pays 200 000 emplois.
On mesure l toute l'ampleur de l'inculture conomique qui est l'une de nos
caractristiques nationales. Cela fait pourtant prs de deux sicles que Frdric
Bastiat, conomiste franais qui fait rfrence l'tranger, dfaut d'tre
connu en France, a dmontr que des travaux non justifis ne craient pas
d'emplois mais en dtruisaient. Sinon, il suffirait pour rgler le problme du
chmage de creuser des trous et de les reboucher, ce qui ne manquerait pas
d'utiliser une main-d'uvre nombreuse et de crer des emplois ...
Il suffit de le citer : L'tat ouvre un chemin, btit un palais, redresse une
rue, perce un canal ; par-l, il donne du travail certains ouvriers, c'est ce qu'on
voit ; mais il prive de travail certains autres ouvriers, c'est ce qu'on ne voit pas.
Mille ouvriers arrivent tous les matins, se retirent tous les soirs, emportent leur
salaire, cela est certain. Mais est-ce tout ? Les millions descendent-ils miraculeu-
sement sur un rayon de lune dans les coffres du ministre des Finances ? Ne faut-
il pas que l'tat organise la recette aussi bien que la dpense ?
tudiez donc la question dans ses deux lments. Tout en constatant la des-
tination que l'tat donne aux millions vots, ne ngligez pas de constater aussi
la destination que les contribuables auraient donne et ne peuvent plus don-
ner ces mmes millions. Alors, vous comprendrez qu'une entreprise publi-
que est une mdaille deux revers. Sur l'une figurent des ouvriers occups,
avec cette devise : Ce qu'on voit ; sur l'autre, d'autres ouvriers inoccups, en plus
grand nombre, avec cette devise : Ce qu'on ne voit pas
1
.
Prs de deux sicles plus tard, le mythe de la cration d'emplois par la d-
pense inutile est encore clairement l'un des plus rpandus dans notre pays.
L'nergie ncessaire pour chauffer les immeubles et leur procurer de l'eau
chaude n'est enfin pas la seule dont ils ont besoin. Ceux-ci sont galement des
consommateurs importants d'lectricit pour d'autres usages et contribuent in-
1
Frdric Bastiat, Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas ! , dans Harmonies conomiques, Genve, Slat-
kine, rd. 1982.
48
directement de cette manire aux missions de gaz effet de serre lorsque le
courant provient de centrales charbon ou gaz, ce qui est le plus souvent le
cas au niveau mondial. Or les besoins ne cessent de crotre avec la diffusion des
rfrigrateurs, des machines laver, des tlviseurs, des appareils lectroniques
et des clairages de plus en plus puissants qui rendent sans cesse la vie plus faci-
le et plus agrable.
Une course est alors engage entre la multiplication des quipements et les
efforts des fabricants pour rendre ceux-ci de plus en plus conomes, comme en
tmoignent les labels de couleur dont ils sont heureusement de plus en plus
souvent dots, et qui s'chelonnent du vert au rouge. L'exprience passe a tou-
tefois montr que la consommation lectrique unitaire des logements et des bu-
reaux avait plutt tendance s'accrotre qu' se rduire et il reste voir si le
mouvement peut s'inverser, mme s'il faut bien videmment mettre systmati-
quement en uvre les techniques susceptibles de rduire les consommations
lorsque c'est conomiquement justifi.
Des sacrifices utopiques
Certes, il existerait enfin une manire de consommer moins, que ce soit pour
nous chauffer, nous laver ou nous clairer. Il suffirait de modifier nos com-
portements. La quantit d'nergie ncessaire pour chauffer un immeuble varie
trs fortement en fonction de la temprature choisie. Si, au lieu des 21 degrs,
voire plus, qui nous paraissent normaux en plein hiver, nous acceptions de
vivre avec 15 degrs par exemple, les besoins lis au chauffage seraient diviss
par bien plus de deux. Louis XIV lui-mme acceptait bien des tempratures trs
infrieures Versailles, mais il n'avait pas le choix.
Nous pourrions de mme nous laver moins souvent et moins longtemps, et
avoir uniquement recours aux douches et non aux bains. Nous pourrions enco-
re laver notre vaisselle ou notre linge avec moins d'eau, et teindre systmati-
quement les lumires dont nous n'avons pas besoin. Nous pourrions faire bien
d'autres choses encore pour conomiser l'nergie, mais nous ne le faisons pas,
ou si peu. Car, pour que de tels changements de comportement aient un sens, il
faudrait qu'ils soient mis en uvre par tous ou presque, sur l'ensemble de la
plante.
Or les habitudes de masse ne se changent pas facilement. Contrairement ce
que pense la grande majorit de nos contemporains qui estiment que la rduc-
tion des consommations peut plus facilement provenir de la modification des
comportements que des volutions techniques
1
, il est beaucoup plus facile d'ob-
1
Rapport Facteur 4 cit.
49
tenir des rsultats significatifs par la diffusion du progrs qu'en cherchant, le
plus souvent en vain, modifier les comportements. La mise sur le march
d'appareils d'clairage qui consomment trois fois moins est beaucoup plus por-
teuse de rsultats qu'un appel demandant chacun de s'clairer trois fois moins
souvent. Faut-il rappeler que ceux qui nous demandent de rduire nos
consommations parcourent en gnral le monde et figurent parmi les plus
grands... consommateurs ?
L'analyse de la consommation d'nergie des btiments confirme en dfinitive
qu'il n'existe pas de solutions indolores. Il serait certes possible de rduire mas-
sivement celle-ci. Mais il faudrait accepter un bouleversement de nos compor-
tements et une rgression de notre qualit de vie auxquels nos contemporains
ne sont nullement prts dans leur trs grande majorit, ou dpenser des som-
mes qui sont hors de porte pour amliorer l'isolation des constructions exis-
tantes, et avec lesquelles il y aurait infiniment mieux faire ailleurs pour com-
battre les missions.
Les biocarburants lectoraux
Les biocarburants constituent, dans un autre domaine, une solution appa-
remment sduisante, la fois pour dpendre moins du ptrole import et ne
pas influer sur l'effet de serre puisque le gaz carbonique qu'ils mettent au
moment de leur emploi ne contribue pas augmenter celui-ci, car il provient
dj de l'atmosphre. Les plantes dont ils sont issus y ont puis pendant leur
croissance le carbone qu'elles contiennent et c'est ce dernier qui est restitu au
moment de leur combustion. C'est pourquoi les biocarburants suscitent aujour-
d'hui tant d'intrt. Mais tout n'est pas si simple.
Les biocarburants relvent pour l'essentiel de deux catgories. Les crales, la
canne sucre ou la betterave peuvent tre transformes en alcool. Le colza,
l'huile de palme ou les arachides peuvent donner naissance des carburants
plus lourds, susceptibles d'tre utiliss par les moteurs diesel.
Le pays qui a pouss le plus loin l'usage des biocarburants est aujourd'hui le
Brsil, o plus de la moiti de la flotte automobile peut rouler avec de l'alcool
de canne sucre, les moteurs les plus rcents tant mme capables de fonction-
ner aussi bien avec celui-ci qu'avec de l'essence classique, ou avec un mlange
des deux (moteurs Flexfuel). Toutefois, dans l'tat actuel des choses, l'exp-
rience brsilienne ne peut pas tre gnralise au reste de la plante, car plu-
sieurs facteurs spcifiques ne sont pas reproductibles ailleurs.
Le premier est d'ordre climatique et se passe de commentaires : le soleil est
plus chaud sous les tropiques, et les rendements plus levs grce la canne
50
sucre. La remarque vaut aussi pour l'huile de palme, plus productive que le col-
za.
Le deuxime tient la superficie agricole disponible, sans limite dans ce pays-
continent. Les 10 millions de tonnes d'alcool produites chaque anne le sont
sur une superficie de 25 000 kilomtres carrs, l'quivalent de cinq dparte-
ments franais, et elles n'assurent pourtant qu'une part mineure de la consom-
mation de carburant du pays !
Il reste enfin un obstacle majeur l'exportation de la solution brsilienne.
La culture de la canne sucre y est essentiellement manuelle, et la rcolte effec-
tue avec une main-d'uvre peu paye qui accepte des conditions de travail ex-
cessivement dures qui ne seraient pas admises dans les pays dvelopps. Au sein
de ces derniers, la culture des produits susceptibles d'tre transforms en bio-
carburants ne peut tre envisage qu'avec le recours la mcanisation de l'en-
semencement et des rcoltes, ce qui est la fois coteux, consommateur
d'nergie et par l mme gnrateur d'missions de gaz carbonique.
Un espoir du
Cette triple considration explique pourquoi, dans l'tat actuel des choses, la
production de biocarburants ne peut contribuer dans notre pays que de mani-
re symbolique notre approvisionnement en nergie. Le rendement net, c'est-
-dire aprs dduction de l'nergie ncessaire pour labourer, semer, rcolter et
transformer le produit agricole en carburant, est au mieux de l'ordre d'une
tonne quivalent ptrole par hectare. Or notre consommation annuelle de car-
burants routiers s'lve une quarantaine de millions de tonnes. Si l'on consi-
dre que notre pays possde 300 000 kilomtres carrs de terres cultivables, un
rapide calcul montre qu'en les consacrant intgralement la production de
biocarburants, ce qui est videmment hors de question, elles ne pourraient
mme pas rpondre nos besoins.
Dans les conditions actuelles, la contribution des biocarburants la consom-
mation de produits ptroliers ne peut donc tre en France, et plus gnrale-
ment en Europe, que marginale, ce que traduit le fait qu'il sera impossible d'at-
teindre l'objectif fix par le gouvernement de porter la proportion de biocarbu-
rants dans nos carburants routiers 5,75 % en 2008 contre peine 1 % l'heu-
re actuelle. De surcrot, la qute de cet objectif inaccessible cotera trs cher
aux finances publiques, car le prix de revient des biocarburants produits en
France est trs suprieur celui du ptrole import, malgr la hausse massive
des cours internationaux des annes rcentes. Il faudra donc que le gouverne-
ment renonce percevoir tout ou partie des taxes intrieures sur les produits
51
ptroliers (TIPP) sur ceux-ci, et augmente d'autres impts pour compenser le
manque gagner qui en rsultera.
Puisqu'elle ne peut avoir aucun effet significatif sur nos importations de pro-
duits ptroliers, ni sur les missions de gaz effet de serre de la plante, l'obli-
gation d'incorporer des biocarburants dans les carburants routiers constitue
avant tout une forme de subvention dguise et particulirement coteuse
l'agriculture, aux frais du contribuable.
Il est facile d'en calculer le cot. Les seules taxes sur les carburants rapportent
chaque anne 30 milliards d'euros aux finances publiques. Si la proportion de
biocarburants atteignait environ 5 % au sein du produit vendu la pompe
comme il est prvu, et qu'il faille pour cela les dtaxer entirement comme
l'ont propos les candidats l'lection prsidentielle, c'est 1,5 milliard d'euros
par an de manque gagner auxquels il faut s'attendre... moins que l'on im-
porte des biocarburants en provenance de l'tranger au nom de notre ind-
pendance nergtique, ce qui porterait l'absurde de nouveaux sommets.
Quant elles, les missions de gaz carbonique seraient rduites au mieux de 5
millions de tonnes, ce qui mettrait le cot de la tonne pargne aux alentours
de 300 euros, soit quinze fois le plafond recommand par les experts interna-
tionaux.
Des dcisions stupides
La rcente dcision de crer ds 2007 un rseau de 500 pompes vertes des-
tines couler du carburant compos 85 % d'thanol, alors que nous ne
pouvons mme pas en produire suffisamment pour porter 5 % sa teneur dans
l'essence, se situe dans la mme ligne et a pu tre qualifie de stupide par le
prcdent prsident du groupe PSA. Un usage rationnel des deniers publics au-
rait consist se contenter pour l'instant de subventionner les recherches sus-
ceptibles d'accrotre terme les rendements de la production de biocarburants
dans les conditions gographiques de notre pays.
Car il n'est pas possible d'exclure qu'un jour de nouveaux procds de fabri-
cation puissent permettre des rendements plus levs qu' l'heure actuelle en
transformant la totalit de la masse vgtale en carburant. S'il tait par exemple
possible d'obtenir l'avenir des rendements de 4 tonnes quivalent ptrole par
hectare, il suffirait de 30 000 kilomtres carrs, c'est--dire de 3 millions d'hec-
tares, pour produire 12 millions de tonnes de carburants par an, sans mme
parler des potentialits de la Guyane. Comme, par ailleurs, nos vhicules rou-
tiers consommeront unitairement de moins en moins, une large part de nos be-
soins serait ainsi satisfaite. Mais il n'y a l, faut-il le rpter, aucune certitude, et
52
seules les recherches futures permettront de savoir si, un jour, nous pourrons
faire aussi bien ou presque que les Brsiliens, ce qui est exclu pour l'instant.
En attendant, chacun se souvient d'avoir vu un ministre de la Rpublique se
donner le ridicule d'inaugurer en grande pompe si l'on ose dire Porte d'Or-
lans Paris une station-service distribuant de l'thanol, qui fut ferme ds le
lendemain pour la double raison qu'il n'y avait pas d'thanol pour remplir ses
rservoirs, et surtout aucun vhicule en France susceptible de fonctionner avec
ce carburant ! Au niveau mondial, l'Agence internationale de l'nergie estime
que les biocarburants pourraient assurer en 2030 au mieux de 4 7 % des be-
soins routiers de la plante, contre moins de 1 % aujourd'hui. Ils resteront donc
marginaux.
Le combat de la nourriture
Une nouvelle concurrence se fait d'ailleurs jour entre les utilisations nerg-
tiques et les usages alimentaires des cultures. Du fait des subventions massives
accordes par le gouvernement amricain pour la production d'thanol base
de mas, les cours de celui-ci se sont envols au point d'engendrer en f-
vrier 2007 des meutes au Mexique, o la tortilla constitue l'alimentation de ba-
se et o les plus pauvres ne pouvaient plus se la payer. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que le bien-fond de cette politique vocation avant tout lectorale
reste dmontrer.
De nombreuses voix commencent d'ailleurs s'lever contre les biocarbu-
rants et la mode pourrait tourner. Ceux-ci sont tout d'abord nfastes la biodi-
versit. Si des superficies considrables devaient tre consacres la canne su-
cre, l'huile de palme, au colza ou la betterave, ce serait videmment son
dtriment. Des forts primaires entires sont en voie de disparition en Indon-
sie et en Malaisie pour laisser la place des plantations de palmiers huile, et le
phnomne est voisin au Brsil au profit de la canne sucre.
De plus, quand il s'agit de cultures mcanises et faisant appel des engrais
chimiques, le bilan positif pour l'effet de serre en est diminu au point de de-
venir parfois douteux. Le comble est atteint avec les crales. Les calculs mens
aux tats-Unis ont montr que, pour produire avec du mas l'quivalent de 100
litres d'essence, il fallait parfois en consommer 80, le solde net s'tablissant
donc 20 seulement. On imagine aisment que, dans de telles conditions, le
cot de la tonne de gaz carbonique pargne atteint des sommets. Ceci n'em-
pche pas la production d'thanol base de mas d'avoir t dclare prioritai-
re par le prsident Bush, au plus grand bnfice des agriculteurs amricains.
53
Mais il y a beaucoup plus grave. La production de biocarburants se trouve en
concurrence directe avec celle des produits agricoles qui sont ncessaires
l'alimentation humaine. Comme le titre Le Monde (5 juin 2007) : Verra-t-on
demain des meutes de la faim en rythre, au Sngal, en Armnie ou en
gypte ? Jamais le prix des crales de base de l'humanit, c'est--dire du bl,
du riz et du mas, n'a t aussi lev qu'aujourd'hui, et ceci tient au fait qu'une
part sans cesse croissante de la rcole de mas amricain est affecte la produc-
tion de biocarburants. La Banque mondiale estime que les tats-Unis, premier
producteur mondial de mas, consacreront en 2007 25 % de leur rcolte leur
fabrication. Il en rsulte que, malgr l'augmentation de 15 % des superficies
cultives, les cours du mas ont fait un bond de 75 % en 2006 et que, par rico-
chet, les autres crales ont t affectes. La Banque mondiale craint une haus-
se gnrale de 40 %, ce qui serait dramatique pour les habitants les plus pauvres
de la plante dont le revenu pourrait tre amput de plus de 6 % avec des
consquences dramatiques. Ayant pris depuis des annes la tte du combat anti-
biocarburant, Fidel Castro n'a peut-tre pas entirement tort quand il dnonce
avec virulence un gnocide alimentaire .
Pour corser le tout, le secrtaire gnral de l'OPEC (Organization of Ptro-
leurs Exporting Countries) a menac enfin, en juin 2007, de rduire la produc-
tion ptrolire si les pays consommateurs continuaient vouloir dvelopper les
biocarburants, leur affirmant qu'ils perdraient alors au change. Dans l'tat ac-
tuel des choses, les biocarburants sont galement classer parmi les mythes des
nergies renouvelables .
Les transports
Qu'il s'agisse des oliennes, des biocarburants ou de l'isolation des btiments,
ce sont donc par milliards d'euros que les dpenses injustifies s'additionnent
chaque anne dans notre pays au nom de la lutte contre l'effet de serre.
Pourtant, c'est dans le domaine des transports que les gaspillages atteignent
de trs loin leurs plus hauts sommets, ainsi que le rvle un remarquable rap-
port du Conseil d'analyse conomique auprs du Premier ministre, la plus hau-
te autorit conomique de notre pays (Infrastructures de transport, mobilit et crois-
sance conomique, Documentation franaise) qui, fait rare pour un document of-
ficiel, ne manie pas la langue de bois. Quelques chiffres extraits de cette publi-
cation suffisent planter le dcor.
C'est ainsi que les dpenses de transport ferroviaire se sont tablies en 2004
20,4 milliards d'euros (hors contributions aux retraites) alors que les paie-
ments des usagers n'ont pas excd 8,8 milliards, laissant un solde ngatif
54
de 11,6 milliards qu'ont d videmment intgralement combler les contribua-
bles. Les usagers payent donc nettement moins de la moiti des dpenses, m-
me s'ils ont tendance trouver que les billets sont chers !
S'agissant des transports publics urbains, le taux de couverture est plus faible
encore, puisque les paiements des usagers se sont levs en 2004 2,1 milliards
d'euros face 8,6 milliards de dpenses, ce qui aboutit un ratio d' peine un
quart, la diffrence de 6,5 milliards d'euros ne pouvant videmment tre cou-
verte nouveau que par les contribuables, et reprsentant en moyenne 1,4 euro
par trajet effectu.
Au total des transports ferrs et publics, ce sont donc plus de 18 milliards
qu'ont d verser les contribuables en 2004, somme qui s'est encore sensible-
ment accrue depuis lors et avoisine 20 milliards en 2007, pratiquement le dou-
ble de ce que nous consacrons nos universits. Il faut vraiment que nous
soyons un pays riche, pour nous le permettre, alors que les transports ferrs et
publics n'assurent pas un dixime de nos besoins ! Pourtant, ceux qui mettent
en doute le bien-fond d'une telle charge pour les finances publiques se voient
immdiatement opposer un argument premire vue irrfutable et unanime-
ment partag : les transports ferrs et publics doivent tre dvelopps au nom
de la lutte contre l'effet de serre, et ceci justifie toutes les dpenses.
Pour montrer les limites de cet argument apparemment imparable, une com-
paraison s'impose. Le total des missions de gaz effet de serre de notre pays
s'est lev en 2004 l'quivalent de 498 millions de tonnes de gaz carbonique
1
.
Si l'on se souvient des conclusions de l'Agence internationale de l'nergie selon
laquelle les dpenses de lutte contre l'effet de serre ne devraient excder nulle
part 20 euros par tonne d'mission vite de CO
2
, il apparat que notre pays ne
devrait pas consacrer plus de 10 milliards d'euros par an la lutte contre l'effet
de serre, et que ceci devrait suffire supprimer entirement les missions ! Or
cette somme est trs infrieure aux seules dpenses publiques consenties dans le
domaine des transports, dont l'efficacit sur ce plan est pratiquement nulle,
comme l'a constat le Conseil d'analyse conomique du Premier ministre.
Quelques exemples, qui seront dvelopps plus en dtail dans les chapitres de
ce livre spcifiquement consacrs aux transports, mritent cet gard d'tre
brivement rsums ici.
Les trains vides
L'exemple des TER est ainsi particulirement probant. Selon les statisti-
ques officielles, les usagers des TER parcourent chaque anne environ 10 mil-
1
CITEPA, Rapport annuel Coralie .
55
liards de kilomtres. Le chiffre peut paratre important, mais il faut le rappro-
cher de l'ensemble des dplacements des Franais, qui s'lvent 900 milliards
de kilomtres environ, tous modes de transport confondus, dont l'essentiel est
assur par la route.
Pour apprcier l'impact sur l'effet de serre des TER, il suffit d'imaginer ce qui
se passerait si tous leurs usagers prenaient la voiture. Sur la base d'une
consommation moyenne actuelle de 7 litres aux 100 kilomtres et d'une oc-
cupation d'une personne et demie par vhicule, ce sont environ 500 millions de
litres de carburant supplmentaires qui seraient consomms annuellement, en-
gendrant des rejets de 1 250 000 tonnes de gaz carbonique, soit douze minutes
et demie des missions mondiales annuelles.
Or les TER figurent au budget des rgions pour un montant annuel de sub-
ventions de 3,4 milliards d'euros. La dpense est donc de 2 720 euros par tonne
de gaz carbonique vite, soit cent trente-six fois le montant fix comme pla-
fond par l'Agence internationale de l'nergie ! Autrement dit encore, subven-
tionner les TER est une des pires manires de vouloir lutter contre l'effet de
serre. Il n'est d'ailleurs pas exclu que les missions lies la construction et
l'exploitation du matriel roulant, des gares et des voies sur lesquelles circulent
les TER excdent les conomies cites plus haut et que le vritable bilan
l'gard de l'effet de serre soit ngatif. La grande majorit des cheminots ne
vient-elle pas travailler chaque jour en voiture ?
La raison de ce bilan dsastreux est simple : la plupart des TER circulent vi-
de ou presque, ce que nous ignorons. Deux sondages sont cet gard rvla-
teurs. Lorsqu'on demande nos compatriotes quelle est, leur avis, la propor-
tion des habitants de province de plus de vingt-cinq ans qui utilisent rgulire-
ment les TER, c'est--dire au moins une fois par semaine, la moyenne des esti-
mations s'tablit 36 %
1
. Nous pensons donc dans notre inconscient collectif
que plus d'un habitant sur trois prend les TER chaque semaine.
Or la proportion relle est de 1 %, comme le rvle un autre sondage du
mme organisme
2
, corrobor par les chiffres des parcours rappels plus haut et
par les statistiques de la SNCF elle-mme, ainsi que le montrera le chapitre X de
ce livre. La vrit, c'est que la trs grande majorit des habitants de province ne
prend jamais les TER, car 98 % d'entre eux ont une voiture leur disposition
quand ils ont se dplacer.
C'est ainsi qu'au nom de la lutte contre l'effet de serre, les rgions dpensent
allgrement autant d'argent (3,4 milliards d'euros) pour transporter 1 % de
1
Sondage Ipsos/FFAC, mai 2007.
2
Sondage Ipsos/FFAC, janvier 2007.
56
leur population que ce qu'elles affectent aux lyces dont elles ont la charge (3,5
milliards d'euros)
1
.
Le mythe du fret ferroviaire et du ferroutage
La situation est peu prs la mme pour les transports de marchandises,
puisque le rail n'en achemine que 3 % environ malgr des subventions abyssa-
les, avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros contre 51,5 pour le trans-
port routier.
Les wagons de marchandises parcourent ainsi 2 milliards de kilomtres cha-
que anne contre 130 pour les camions et les camionnettes, et plus de 500 pour
l'ensemble des vhicules routiers. Mme si leur trafic doublait, l'impact sur le
volume de la circulation routire serait imperceptible. Les ordres de grandeur
ne permettent pas que le rail soulage la route. Quant au ferroutage, qui ne re-
prsente qu'une fraction du fret ferroviaire, son influence serait plus anecdoti-
que encore.
Le prtexte de la lutte contre l'effet de serre est pourtant mis en avant pour
dfendre de multiples projets d'investissement qui ne devraient pas rsister la
moindre analyse srieuse, et qui constituent autant de gabegies.
Dans le mme rapport, le Conseil d'analyse conomique a mis en vidence la
disproportion entre le cot des nombreux projets qui, au prix d'investissements
massifs, visent tenter de reporter une partie du trafic routier vers le rail, et leur
efficacit quasi inexistante.
Le cot d'un seul d'entre eux, le tunnel Lyon-Turin, qui fera plus loin l'objet
d'une description dtaille, s'lve 15 milliards d'euros, ce qui explique la
conclusion des experts du Premier ministre : Les politiques ambitieuses de re-
port modal n'ont que des avantages trs marginaux en termes de cots sociaux
vits , ajoutant : Il est illusoire de croire que la politique de report modal est
adapte pour lutter contre l'effet de serre : elle est trs coteuse et inefficace
[...]. L'argument effet de serre souvent mis en avant sous forme littraire
comme justification pour les grands projets est quantitativement tellement fai-
ble qu'il en est presque fallacieux...
L'absence de toute approche scientifique est d'autant plus surprenante que le
ministre de l'Equipement est essentiellement compos d'ingnieurs. Mais ds
qu'il s'agit d'cologie, il faut bien constater que ceux-ci, soumis au politique-
ment correct, ont jusqu' prsent oubli de raisonner comme leur formation
aurait d les amener le faire. S'ils l'avaient fait, ils se seraient aperus que les
1
Le Monde, 20 mars 2007.
57
grands projets qu'ils proposent conduisent un cot de la tonne de gaz carbo-
nique vite parfois suprieur 10 000 euros !
La disproportion entre le cot des projets et les avantages minimes qui peu-
vent en dcouler sur le plan de l'environnement ne concerne d'ailleurs pas que
le rail.
Le Conseil d'analyse conomique fustige ainsi pour les mmes raisons le pro-
jet de canal grand gabarit Seine-Nord. Il est vrai que celui-ci confine au ridicu-
le, lorsqu'il est affirm qu'il est destin soulager le trafic des poids lourds sur
l'autoroute du Nord, alors que celui-ci s'tablit 15 000 vhicules par jour ou-
vrable et qu'il est constitu pour l'essentiel d'envois qui doivent tre imprati-
vement livrs en 24 ou 48 heures au plus.
Selon les affirmations des promoteurs du projet eux-mmes, par nature opti-
mistes, le projet pargnerait 68 000 tonnes de rejet de CO
2
par an, soit gure
plus d'un millionime des missions mondiales et nettement moins que ce que
la plante rejette chaque minute. Or l'investissement s'lverait 3,7 milliards
d'euros, ce qui mettrait le cot de la tonne annuellement vite plus de 5 000
euros
1
. Mais la thorie du report modal , selon laquelle il serait possible de
substituer un mode de transport un autre, fait partie du dogme cologique au
nom duquel sont gaspills sans aucun effet des milliards d'euros chaque anne.
La paralysie de l'le-de-France
La situation ne se prsente pas mieux en milieu urbain. L aussi, l'argument
de la lutte contre l'effet de serre est utilis pour justifier tout et n'importe quoi,
sans que jamais soient mis dans la balance le cot pour le contribuable et les
avantages ventuels pour l'environnement. S'agissant de l'le-de-France, le
Conseil d'analyse conomique est ainsi arriv une conclusion analogue cel-
les qui viennent d'tre cites. Pour tenter de rduire les missions de la circula-
tion routire de 1,8 million de tonnes de gaz carbonique par an, il faudrait d-
penser selon les plans officiels actuels plus de 12 milliards d'euros pour dve-
lopper les rseaux de transport public, ce qui mettrait nouveau le cot de la
tonne de CO
2
vite prs de 1 000 euros, soit cinquante fois le niveau consid-
r par les experts internationaux comme maximum ne pas dpasser. Plus gra-
ve encore, les pertes conomiques qui dcouleraient des obstacles mis la circu-
lation routire dans ce but se chiffreraient chaque anne plus de 13 milliards
d'euros !
Prtendre lutter contre l'effet de serre et sauver la plante en bloquant la cir-
culation en le-de-France et notamment Paris, ce qui est le programme officiel
1
On suppose qu' un investissement de 100 correspond une dpense annuelle de 10.
58
du maire de la capitale et de son quipe, serait risible si le sujet n'tait srieux.
Les missions de la circulation routire dans Paris intra-muros n'excdent pas
un million de tonnes par an, soit dix minutes des rejets mondiaux... Quant la
possibilit de remplacer les voitures par des vlos, elle tombe d'elle-mme
quand on sait que les premires parcourent en moyenne dix kilomtres par tra-
jet et les seconds deux seulement.
Pour leur part, les subventions accordes aux vhicules hybrides soit 2 000 eu-
ros pour chacun d'entre eux, permettent d'pargner au mieux le rejet de 10
tonnes de CO
2
pendant leur dure de vie, ce qui met le cot de la tonne par-
gne 200 euros, soit dix fois trop.
Il s'agit donc l essentiellement d'une aide accorde leurs fabricants qui
sont pour l'instant tous trangers, ce qui est une curieuse manire d'encourager
l'industrie nationale. Il est vrai qu'on entend mme les ministres franais faire
ouvertement de la publicit pour ces vhicules au nom de la sauvegarde de la
plante.
En fin de compte, il faut nous rendre l'vidence. Dans notre pays, la marge
de manuvre en matire d'effet de serre est trs faible. Il n'y a pas de remde
miracle pour y rduire fortement nos missions, et ceux qu'on nous propose
sont le plus souvent inefficaces et trs coteux, sinon nuisibles la cause qu'ils
sont censs dfendre. Nous dpensons plus de 25 milliards d'euros d'argent
public par an au nom ou au prtexte de la lutte contre l'effet de serre, sans au-
cun rsultat perceptible puisque le cot par tonne de gaz carbonique vite est
systmatiquement prohibitif et qu'il en rsulte que nos missions ne varient pra-
tiquement pas d'une anne sur l'autre.
Ce constat ne doit pas surprendre. Il tient au fait que nous figurons dj par-
mi les plus faibles metteurs de la plante au sein des pays dvelopps et que
nous avons accompli l'essentiel des conomies possibles un cot raisonnable,
c'est--dire pratiquement supprim nos rejets lis la production d'lectricit
grce notre programme nuclaire, et limit les missions de notre circulation
routire.
59
Tableau 2
Des dpenses publiques annuelles consenties
au nom ou au prtexte de la lutte
contre l'effet de serre
oliennes 1 2,5 milliards d'euros
Biocarburants 0,5 1 milliard d'euros
Isolation des btiments 1 milliard d'euros
Transports ferrs 13 milliards d'euros
Autres transports 7 milliards d'euros
Autres 1 milliard d'euros
Total 26 milliards d'euros
Toutes les lignes ci-dessus augmentent anne aprs anne, et, sauf changement de politique, le total
approchera trs rapidement 30 milliards d'euros annuels.
quelques exceptions prs, qu'il faut videmment encourager, ce qu'on nous
propose alors n'est pas justifi. En suivant ce que nous demandent les cologis-
tes, nous sommes engags sur une voie sans issue. Obtenu par compilation de
sources diverses manant de l'Agence internationale de l'nergie, du Conseil
d'analyse conomique auprs du Premier ministre, de la Mission parlementaire
sur l'effet de serre ou du ministre franais de l'conomie et des Finances, le ta-
bleau 3 ci-contre est rvlateur. Il montre l'extrme dispersion des sommes qu'il
faut dpenser pour viter le rejet d'une tonne de gaz carbonique dans l'atmos-
phre. Dans certains cas, le cot est ngatif : il est possible la fois de dpenser
moins d'argent et d'mettre moins de gaz carbonique. Dans d'autres, c'est l'in-
verse. Plus on dpense d'argent en croyant bien faire, plus les missions aug-
mentent : le cot de la tonne pargne est infini, comme c'est le cas en
France avec les oliennes.
60
Tableau 3
Cot de la tonne de CO
2
vite
Subvention par tonne
de CO
2
vite
Cot total par tonne
de CO
2
vite
Remplacement d'une voiture de forte cylindre
par une voiture de faible cylindre
ngatif
manations industrielles de 1 30
Construction de centrales nuclaires au lieu de
centrales classiques
de ngatif 20
Remplacement des ampoules lectriques par des
ampoules basse consommation
de ngatif lev
Isolation thermique des murs 2 6
Chaudires collectives basse temprature 4,1 12,3
Chaudires individuelles basse temprature 15 45
Chaudires condensation collectives 10,4 31,2
Chaudires condensation individuelles 34 102
Chaudires bois 43 129
Pompes chaleur 97 291
Isolation thermique des fentres 137 411
Solaire thermique 290 870
Travaux complets d'isolation (constructions exis-
tantes)
750
Liaison Lyon-Turin > 10 000 > 10 000
Canal Seine-Nord 5 000 5 000
TER 2 720 2 720
Extension des transports publics en le-de- France > 10 000 > 10 000
lectricit solaire 500 500
oliennes 82 cents par kilowatt-
heure
infini
Aide aux vhicules hybrides 200 200
61
Tableau 4
Impact de quelques dpenses
sur les missions de gaz effet de serre
Cot (euros) Subventions Dure des rejets
mondiaux pargns
Tunnels Lyon- Turin 15 milliards
1
15 milliards
1
1 minute 15 secondes
Canal Seine-Nord 3 milliards
1
3 milliards
1
41 secondes
Centrale solaire de
Leipzig
130 milliards
1
120 milliards
1
15 secondes
TER 4,2 milliards
1
3,4 milliards
2
12 minutes 30 se-
condes
Ensemble des trans
ports ferrs et publics
30 milliards
2
20 milliards
2
1 heure 40 minutes
Centrale nuclaire
EPR
3 milliards
1
0 1 heures 20 minutes
1. Dpense d'investissement
2. Dpense annuelle
En regard des rejets mondiaux de gaz effet de serre d'origine humaine qui s'lvent
l'quivalent de 100 000 tonnes de gaz carbonique par minute, les dpenses numres ci-
dessus ne peuvent tre justifies, l'exception de la dernire.
Entre ces deux extrmes, la varit des situations est presque sans limite. Mais
le nombre de celles qui sont justifies parce qu'elles permettent d'viter le rejet
d'une tonne de gaz carbonique pour moins de quelques dizaines d'euros est
trs faible. Dans les autres cas, l'efficacit des dpenses est le plus souvent insi-
gnifiante et l'on peut alors parler de gchis pur et simple.
Une question ne peut toutefois manquer de se poser. Comment expliquer
que les experts de l'Agence internationale de l'nergie affirment qu'aucune
dpense destine supprimer les missions de gaz effet de serre ne devrait
excder 20 euros par tonne pargne et que nous aboutissions des cots in-
comparablement suprieurs ? Se seraient-ils tromps ?
L'explication est plus simple. Ces experts ne pensent pas aux mesures trs
coteuses qui ont t voques dans ce chapitre. Ils se rfrent d'autres
moyens de rduire les missions qui ne concernent pas ou peu notre territoire.
Les domaines auxquels ils pensent sont essentiellement au nombre de trois.
Malheureusement, le plus efficace d'entre eux suscite dans tous les pays l'oppo-
sition dtermine de la plupart des cologistes.
62
CHAPITRE V
Le pch originel
Lorsqu'on regarde l'volution du monde, il apparat que, si rien ne change,
les missions de gaz effet de serre vont continuer s'accrotre trs rapidement
au cours des annes et des dcennies venir.
La question qui se pose alors est de savoir s'il serait possible d'introduire une
rupture dans l'volution des choses. cette fin, plusieurs pays, dont la France,
se sont demand quelles conditions il leur serait possible de rduire drasti-
quement leurs missions.
Les travaux correspondants sont souvent connus sous l'intitul de Fac-
teur 4 , car ils se fixent comme objectif la division par quatre des missions des
pays industriels d'ici 2050, ce qui permettrait peut-tre, si l'on suppose gale-
ment des efforts de la part du reste du monde, de rduire de moiti les mis-
sions plantaires la mme poque et donc d'atteindre l'hypothse la plus am-
bitieuse des experts des Nations unies, c'est--dire de ramener les missions aux
alentours de leur niveau de 1990. vrai dire, l'exercice est injuste pour notre
pays, qui produit dj deux fois moins de gaz effet de serre par habitant que la
moyenne des pays dvelopps. Il faudrait, pour qu'ils s'alignent sur nous, que
les autres pays industrialiss divisent les leurs par huit si nous divisions les ntres
par quatre, ce qui est videmment hors de toute atteinte.
Quoi qu'il en soit, et contrairement ce que l'on pourrait penser, les travaux
de ces diffrents groupes de chercheurs franais, anglais, canadiens, etc., arri-
vent une mme conclusion : dans leur ensemble, les pays dvelopps pour-
raient consommer beaucoup moins d'nergie qu'ils ne le font et donc mettre
beaucoup moins de gaz effet de serre.
Mais la situation ne se prsente pas de la mme faon pour les six principaux
domaines d'activit qui sont l'origine des missions. Pour simplifier, les pers-
pectives sont favorables pour trois d'entre eux, la production d'lectricit, l'in-
dustrie et la dforestation, alors que les possibilits d'action sont bien plus limi-
tes pour les transports, l'agriculture et les btiments.
63
La production d'lectricit, cause premire
Responsables de plus de 40 % des missions de gaz carbonique de la plante
et bientt de prs de la moiti selon l'Agence internationale de l'nergie, les
centrales lectriques thermiques classiques constituent de trs loin la premire
source de gaz effet de serre d'origine humaine, dont elles reprsentent plus
du quart si l'on tient compte des produits autres que le gaz carbonique. Une
question vient alors immdiatement l'esprit. Si le rchauffement de la plante
prsente un tel danger, pourquoi la plupart des pays, y compris ceux qui se d-
clarent les plus sensibiliss, continuent-ils construire un rythme sans prc-
dent des centrales charbon ou gaz naturel ? Pourquoi n'ont-ils pas recours
comme la France aux centrales nuclaires dont chacun sait qu'elles n'induisent
aucun rejet nocif dans l'atmosphre, mme si, historiquement, cette considra-
tion n'a pas t l'origine de la dcision de notre pays de les construire
1
?
L'chec du nuclaire
Si les autres pays ne nous imitent pas, c'est que deux raisons s'y opposent. La
premire, dterminante, tient l'opposition dfinitive au nuclaire de la plu-
part des cologistes de tous les pays, qui affirment pourtant que les gaz effet
de serre constituent la plus grande menace pour l'avenir de la plante et de
l'humanit. C'est l le pch originel.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a l une incohrence impossible
comprendre pour tout esprit quelque peu rationnel. L'opposition aux centrales
nuclaires laisse sans voix lorsqu'elle provient de ceux qui affirment que la
concentration de gaz effet de serre dans l'atmosphre est une catastrophe
pour la plante, alors qu'il s'agirait de trs loin de la manire la plus efficace de
lutter contre elle, comme la France le prouve chaque jour. Entre deux maux, il
faut savoir choisir le moindre, d'autant qu'aucun des arguments qu'on dresse
l'encontre des centrales nuclaires ne rsiste une analyse un tant soit peu s-
rieuse. Les centrales nuclaires occidentales ont prouv depuis longtemps leur
fiabilit dans des pays aussi divers que l'Afrique du Sud ou la Chine et n'ont ja-
mais provoqu une seule mort d'homme contrairement toutes les autres sour-
ces d'nergie, en particulier au charbon qui, dans un pays comme la Chine, est
chaque anne directement responsable de plus d'un millier de morts dans les
mines, et de centaines de milliers par la pollution engendre.
Le recours l'nergie nuclaire pour produire de l'lectricit est d'ailleurs
reconnu par les instances internationales comme tant un droit pour tous les
1
Cf. C. Gerondeau, L'nergie revendre, Latts, 1984.
64
pays, alors que la fabrication d'armes nuclaires est rglemente par les traits
de non-prolifration. Il n'empche : la plupart des cologistes ne veulent pas
admettre cette distinction fondamentale et entretiennent sciemment une peur
irraisonne inspire par les spectres de Nagasaki et d'Hiroshima, comme l'a en-
core fait Daniel Cohn-Bendit en juillet 2007, quand la France a envisag de ven-
dre une centrale nuclaire la Libye. Selon Eurobaromtre, 61 % des Euro-
pens ne souhaitent-ils pas, pour des raisons supposes de scurit, que la part
de l'lectricit d'origine nuclaire diminue ? L'essentiel est l, car les autres ar-
guments avancs l'encontre de l'usage pacifique de l'atome ne sont que des
leurres.
Il en est ainsi du traitement des sous-produits du fonctionnement des centra-
les, pjorativement qualifis de dchets. On sait pourtant traiter ceux-ci en les
vitrifiant et en les rendant inertes pour des millnaires, et il est possible de les
enfouir ensuite grande profondeur o, quoi qu'on en dise, ils ne prsentent
plus aucun risque pour les gnrations futures.
Il en va de mme du dmantlement des centrales aprs leur fin de vie.
L'opration est coteuse, mais elle ne prsente aucune urgence et peut tre ta-
le sur des dcennies en fonction des financements disponibles. La dure de vie
des centrales ne cesse d'ailleurs de s'accrotre. Alors qu'elle tait estime tren-
te ans il y a peu, il est maintenant question de soixante annes. Il n'y a l rien
d'tonnant puisque leur structure est constitue de bton fortement arm et
surdimensionn pour rsister tout incident ventuel.
Enfin, le risque d'puisement des ressources en uranium n'est pas pour de-
main, comme l'a constat l'Agence internationale de l'nergie dans son rapport
annuel de 2006. La seule Australie a identifi 85 gisements, dont 3 seulement
sont en exploitation et de nombreux autres pays en disposent. Face la hausse
rcente des cours, les projets d'ouverture abondent.
En dfinitive, l'nergie nuclaire constitue l'un des symboles de notre poque
et donc du progrs, et c'est peut-tre pour cela que les cologistes combattent
l'une et l'autre, sans craindre d'tre incohrents. Si les arguments qu'ils avan-
cent aujourd'hui son encontre, concernant par exemple le traitement des d-
chets, venaient un jour tomber, soyons sans crainte : ils en trouveraient d'au-
tres. Ce ne sont l que des prtextes car nous sommes dans l'irrationnel le plus
complet. Comment est-il possible d'affirmer sans sourciller que l'effet de serre
constitue la plus grande menace laquelle est confronte l'humanit, et de
s'opposer la solution qui constituerait, de trs loin, le premier remde au ris-
que ? Seuls des esprits parfaitement illogiques peuvent russir ce tour de force,
et la responsabilit des cologistes devant l'Histoire sera sans appel si par mal-
heur l'volution du climat entrane les catastrophes qu'eux-mmes annoncent.
65
Il existe une autre explication au peu de succs de l'lectricit d'origine ato-
mique. Les centrales nuclaires cotent cher construire et demandent des in-
vestissements levs. La mise de fonds ncessaire est quatre fois plus importante
pour une centrale nuclaire que pour une turbine gaz de mme puissance.
Les cots de fonctionnement sont ensuite bien plus faibles, mais les dlais de
ralisation sont de surcrot plus longs. Il faut le plus souvent prs d'une dizaine
d'annes pour mener bien la construction d'une centrale nuclaire, contre
trois ou quatre pour une installation de mme puissance fonctionnant au char-
bon et moins encore s'il s'agit de gaz naturel.
On comprend en dfinitive que, chez les producteurs d'lectricit, la balance,
depuis plusieurs dcennies, ait pench en faveur des centrales gaz ou char-
bon. Mais la forte remonte des cours de ces deux produits depuis quelques
annes change aujourd'hui la donne, et l'Agence internationale de l'nergie est
arrive, dans son rapport annuel de 2006, une conclusion qui revt un carac-
tre fondamental : l'lectricit nuclaire a dsormais un cot de revient voisin
de l'lectricit produite par des centrales thermiques classiques. Tout dpendra
pour le futur de deux donnes, le cours du charbon d'une part, le niveau des
taux d'intrt de l'autre. Si la tonne de charbon vaut l'avenir entre 55 et 70
dollars, et si les taux d'intrt sont faibles, il suffira d'une incitation trs limite,
situe entre 0 et 10 dollars par tonne de gaz carbonique vite, pour que la ba-
lance conomique penche en faveur de la solution nuclaire. Dans certains cas,
celle-ci sera mme plus conomique sans aucune incitation. Mme dans le cas
de taux d'intrt levs, ce qui est videmment dfavorable aux centrales nu-
claires puisqu'elles sont plus chres construire, une incitation comprise en-
tre 10 et 25 dollars par tonne de gaz carbonique vite serait suffisante pour que
l'lectricit nuclaire soit la plus conomique.
On trouve l l'explication principale l'affirmation de l'Agence internationa-
le de l'nergie selon laquelle dans aucun cas il n'est justifi de dpenser plus
de 25 dollars pour viter le rejet d'une tonne de gaz carbonique.
Dans le domaine de la production d'lectricit, il suffirait de dpenser, dans
l'hypothse la plus dfavorable, au plus 25 dollars, soit environ 20 euros par
tonne de gaz carbonique vite pour que la balance conomique penche syst-
matiquement en faveur des centrales nuclaires. C'est donc l que la commu-
naut internationale a intrt dpenser son argent si elle entend vraiment lut-
ter contre les rejets de gaz effet de serre, et non dans les projets inefficaces qui
ont fait l'objet du prcdent chapitre. Or elle ne le fait pas.
Certes, le message commence passer, et de nombreux pays dvelopps cher-
chent aujourd'hui relancer la construction de centrales nuclaires sur leur
territoire. Les tats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Australie ont rcem-
ment affirm leur volont d'agir en ce sens, et tout laisse entendre que l'indus-
66
trie nuclaire va connatre au cours des annes venir un nouveau et rapide es-
sor. Toutefois, l'essentiel des nouveaux besoins n'est pas situ dans les pays d-
velopps, mais au sein du tiers-monde, et d'abord de la Chine et de l'Inde. Or
ceux-ci sont dots de vastes ressources en charbon, et ils ne se convertiront au
nuclaire que s'ils sont financirement et fortement incits par les pays occiden-
taux. C'est l que se trouve, de loin, le plus grand gisement de rduction des
missions de gaz effet de serre de la plante. Mais celui-ci est inexploit. Cha-
cun a pu noter que la Chine avait command la socit Westinghouse quatre
centrales nuclaires en dcembre 2006, et que d'autres suivront au cours des
annes venir. Mais l'objectif est seulement de faire passer la part de l'nergie
nuclaire dans la production d'lectricit chinoise de 1 4 %. C'est tout, car les
autorits du pays ont estim qu'aller plus loin serait trop coteux pour les seules
finances d'un pays encore en voie de dveloppement.
L'ge d'or des centrales polluantes
Ces deux considrations expliquent que, face la demande sans cesse crois-
sante d'lectricit qu'implique le rythme d'expansion acclre de l'conomie
mondiale, les carnets de commande des industriels qui fabriquent des centrales
thermiques classiques soient pleins, et les mises en chantier de centrales nu-
claires encore trs rares. Un pays comme l'Allemagne, qui se dclare pourtant
trs proccup par l'effet de serre, fait ainsi exactement le contraire de ce qu'il
faudrait. Sous la pression de ses cologistes, il s'est engag fermer progressi-
vement ses centrales nuclaires existantes, et il construit marche force des
centrales classiques gaz et mme charbon qui mettent du gaz carbonique
en quantits massives !
Quant la Chine, elle a augment sa consommation de charbon de 70 % au
cours des cinq dernires annes pour faire face aux pnuries d'lectricit qui la
frappaient il y a peu et qui ont maintenant disparu. Selon le directeur gnral
de l'Agence internationale de l'nergie, la Chine met en service chaque semaine
une centrale de 1 000 mgawatts, c'est--dire de la puissance d'une unit nu-
claire. Les grandes villes chinoises sont maintenant illumines a giorno tous les
soirs.
Certes, des recherches sont engages pour tenter de mettre au point des
techniques de captation du gaz carbonique issu des centrales charbon ou
gaz, en vue de l'enfouir ensuite dans le sous-sol. Mais, mme si elles aboutissent
un jour, les centrales thermiques existantes ou en construction continueront
rejeter tout au long de leur vie des masses considrables de gaz carbonique, car
il ne sera pas possible de les doter rtroactivement de tels quipements. De sur-
67
crot, l'Agence internationale de l'nergie elle-mme est trs dubitative leur
gard, y compris pour les centrales neuves. Elle crit ainsi que la possibilit
d'installations de capture dans des centrales lectriques, qui constituerait l'ap-
plication majeure de ces techniques, reste dmontrer, et celles-ci ne sont pas
prises en compte pour cette raison dans les scnarios pour 2030
1
. Elle ajoute
toutefois que ces techniques pourraient jouer un rle significatif en 2050 pour
limiter les missions de gaz carbonique dans les pays en expansion rapide qui
disposent de vastes rserves de charbon, la Chine et l'Inde pour ne pas les
nommer.
En tout tat de cause, ces techniques coteront cher, beaucoup plus que le
diffrentiel ventuel de cot de revient entre les centrales nuclaires et les cen-
trales thermiques classiques. L'Agence internationale de l'nergie ajoute enfin
que l'instauration d'une taxe sur les missions de gaz carbonique constituerait
une mesure trs utile pour ouvrir le march. Mais la vrit oblige dire qu'une
telle taxe, applique aux quantits gigantesques rejetes par les centrales
charbon chinoises ou indiennes, aboutirait des sommes si considrables que
personne n'envisage aujourd'hui srieusement cette ventualit. Qui paierait ?
L'industrie : la bourse d'change
Avec environ 15 % des missions mondiales, le secteur industriel constitue
galement l'une des sources importantes de gaz effet de serre de la plante, et
c'est l le deuxime domaine o il est encore possible d'agir relativement peu
de frais. Malgr des progrs de productivit massifs et continus, et en dpit
d'une rduction de 15 % de la consommation des pays dvelopps en trente
ans, les besoins d'nergie de l'industrie n'ont cess de crotre au niveau mon-
dial au cours des dcennies coules et les missions de gaz effet de serre qui
lui sont imputables ont suivi une volution parallle.
Pour rduire celles-ci, l'Europe a mis en uvre depuis le dbut de 2004 une
bourse d'change du CO
2
dont le principe est simple et qui peut se rvler
efficace.
C'est l, de loin, la meilleure de ses initiatives. Chaque installation industrielle
importante se voit fixer un objectif d'mission annuel. Ceux qui font mieux que
cet objectif bnficient de droits d'mission qu'ils peuvent vendre et que
peuvent acheter ceux qui n'arrivent pas respecter les objectifs qui leur sont
allous. Il s'est cr ainsi un march de la tonne de CO
2
dont le cours a subi de
brutales variations depuis la cration de cette bourse d'change. Il a parfois at-
teint 30 euros. A la date du 1er octobre 2006, il s'tablissait 17 euros par ton-
1
Agence internationale de l'nergie, Rapport annuel 2006.
68
ne, avant de s'effondrer littralement au dbut de 2007 quand il est apparu que
les quotas attribus en 2003 aux industriels europens avaient t calculs trop
largement. Le 20 mars 2007, il s'tablissait moins de 1 euro ! Dans de telles
conditions, il est videmment impossible aux industriels de faire des prvisions
srieuses. Mais, mme s'il est dlicat d'application et que les cours dpendent
directement du niveau des quotas fixs, le mcanisme retenu est sain, et il est
certain que les cours remonteront prochainement.
La fixation des quotas futurs a en effet donn lieu, la fin de 2006, un bras
de fer entre la Commission de Bruxelles et diffrents pays dont la France, celle-
ci ayant finalement accept de ramener le volume d'missions que devront res-
pecter les entreprises franaises concernes de 155 132 millions de tonnes an-
nuelles, soit une rduction de 23 millions de tonnes, c'est--dire de 15 %, mal-
gr les protestations des producteurs de ciment qui ont affirm qu'ils ne pour-
raient supporter les charges qui risquent d'en rsulter s'ils dpassent les quotas
qui leur sont allous. Les marchs ont en consquence d'ores et dj prvu que
le cours de la tonne de CO
2
remonterait plus de 20 euros ds 2008.
Il est donc possible de rduire fortement les missions du secteur industriel
pour un cot par tonne de gaz carbonique pargne qui restera de l'ordre de
grandeur de ce que prconisent les experts internationaux. C'est l la deuxime
explication de la fixation du seuil de 25 dollars par l'Agence internationale de
l'nergie.
On est videmment aux antipodes des dpenses qui sont ncessaires pour ob-
tenir le mme rsultat dans les secteurs de l'habitat, des nergies dites renouve-
lables, ou des transports ferrs et publics, puisqu'ils se chiffrent, quant eux, en
centaines ou en milliers d'euros par tonne pargne.
La dforestation
La lutte contre la dforestation constitue peut-tre le troisime domaine o il
serait possible d'viter des rejets massifs de gaz carbonique pour un cot mod-
r.
La dforestation des espaces tropicaux est l'un des contributeurs majeurs
l'effet de serre, mme si les tudes les plus rcentes ont mis en vidence un
phnomne inattendu : ds que le niveau de vie dpasse le seuil de 4 000 euros
par habitant, les forts recommencent s'tendre au lieu de diminuer. Pouvant
acheter du charbon ou du ptrole et bnficier de l'lectricit, les habitants ces-
sent de s'attaquer aux espaces boiss
1
. C'est ainsi que la fort gagne massive-
ment du terrain dans les pays dvelopps et notamment en France o elle a
1
Pekka Kauppi, Universit de Finlande, dans The Economist, 18 novembre 2006.
69
doubl depuis un sicle. Certes, les pertes au Brsil ou en Indonsie outrepas-
sent encore les gains effectus dans les pays plus riches. Mais la fort regagne
dj du terrain dans les pays comme l'Inde ou la Chine. Elle s'est accrue d'un
million d'hectares en Asie entre 2000 et 2005. Autrement dit, les craintes lies
la fatalit de la dforestation du globe apparaissent excessives, mme si, locale-
ment, des pans entiers continuent disparatre, ce qui ne peut manquer d'in-
quiter car le bilan global pour la plante est encore largement ngatif.
Son ampleur fait l'objet de discussion entre spcialistes, mais l'on estime que
la dforestation concerne au total 6 7 millions d'hectares par an dans des pays
tels que l'Indonsie, le Brsil ou le Congo. Outre son impact souvent irrversi-
ble sur la biodiversit, cette situation engendre des rejets massifs dans l'atmos-
phre lorsque les forts brlent. Certaines sources valuent l'ampleur de ces
rejets 18 % du total des missions de gaz effet de serre d'origine humaine.
Mettre fin la dforestation serait donc l'une des voies les plus efficaces de r-
duction de celles-ci.
Il est possible que ce soit aussi l'une des moins coteuses. Nicholas Stern,
l'occasion d'un entretien priv, m'a dit qu'il valuait quelques euros seule-
ment le cot de la tonne de gaz carbonique vite dans ce domaine. Si c'tait le
cas, aider les pays concerns prserver leurs forts constituerait pour la com-
munaut internationale l'une des manires les plus efficaces de lutter contre
l'aggravation des phnomnes d'effet de serre.
Il resterait trouver un modus operandi avec les gouvernements des pays
concerns, ce qui ne devrait pas tre impossible, car ceux-ci sont de plus en plus
sensibiliss la perte du patrimoine que constituent leurs forts. C'est en ce
sens que s'efforce d'agir la Banque mondiale en cherchant avec beaucoup de
difficult runir un premier fonds d'intervention de 250 millions de dollars
pour commencer s'attaquer ce qui reprsente un cinquime des missions
mondiales
1
. La comparaison avec les sommes qui sont dilapides chez nous et
ailleurs par dizaines de milliards chaque anne sans aucun effet, au nom de la
lutte contre l'effet de serre, n'incite gure conclure une quelconque rationa-
lit de l'action collective.
Combien la tonne ?
Couvrant largement plus de la moiti des missions de gaz carbonique d'ori-
gine humaine de la plante, les trois domaines de la production de l'lectricit,
de l'industrie et de la lutte contre la dforestation prsentent des possibilits
d'action qui, pour un cot voisin d'une vingtaine d'euros par tonne de gaz car-
1
The Economist, 23 juillet 2007.
70
bonique vite, ou mme infrieur, peuvent permettre d'agir avec efficacit
contre les rejets de gaz effet de serre.
En dfinitive, la fixation d'un cours commun de la tonne de CO
2
serait la seu-
le manire de rationaliser au niveau mondial les efforts destins rduire les
missions de gaz effet de serre dans les multiples domaines o il est envisagea-
ble d'agir. S'il en tait ainsi, il deviendrait par exemple possible de comparer
l'utilit pour la collectivit de subventionner des oliennes, de mieux isoler des
logements, de produire des voitures plus conomes, de construire des voies fer-
res ou des tramways, d'adopter l'nergie nuclaire, de rduire les missions
industrielles, etc. Bien des gaspillages de l'argent public ou priv s'en trouve-
raient vits quand il apparatrait que, pour la mme somme dpense, les r-
sultats en termes d'missions pargnes peuvent tre cent fois suprieurs avec
un emploi plutt qu'avec un autre. La lutte contre l'effet de serre ne justifie pas
n'importe quoi, d'autant plus qu'il faut rappeler qu'en l'absence d'un consen-
sus mondial, l'action d'un seul pays ou mme d'un seul continent ne peut avoir
aucun impact significatif sur le cours des choses.
71
CHAPITRE VI
Les voitures et les vaches
Personne ne propose jamais d'assujettir les carburants routiers au mme ni-
veau de taxation que celui qui est voqu pour l'industrie ou la production
d'lectricit. Ce silence se comprend aisment. Les carburants routiers font dj
l'objet en France et en Europe d'une fiscalit dont le montant s'lve en
moyenne 0,65 euro par litre. Or la combustion d'un litre d'essence ou de gas-
oil produit environ 2,5 kilos de gaz carbonique, de telle sorte que la taxation
des carburants routiers s'lve 260 euros par tonne de CO
2
mise (soit 350
dollars au cours en vigueur au milieu de 2007). Ce sont les transports routiers
qui donnent l'exemple, car les taxes qu'ils versent couvrent trs largement les
dpenses qu'ils occasionnent, ce que se gardent bien de dire ceux qui font pro-
fession d'cologisme et qui ont russi faire croire le contraire en proposant
sans aucune logique d'accrotre encore les taxations dont sont l'objet l'essence
et le diesel. Si une taxation supplmentaire du niveau envisag pour les autres
domaines d'activit au titre du CO
2
mis tait applique au transport routier,
elle n'aurait d'ailleurs aucun impact significatif sur l'usage de la voiture et du
camion, et donc sur les missions.
La facult des carburants routiers supporter des taxations bien plus leves
que ce qui est envisag pour tout autre secteur d'activit ne fait que traduire les
avantages que retirent les individus, les entreprises, et au-del la collectivit tout
entire, de l'usage de l'automobile et du camion.
Il faut aussi rappeler que, contrairement l'opinion majoritaire, les transports
de toute nature ne sont l'origine que d'un sixime environ des missions de la
plante. Ils ne viennent qu'au cinquime rang des sources, bien aprs la pro-
duction d'lectricit partir de centrales charbon ou gaz qui ne suscite gu-
re de commentaires ngatifs ou d'attaques.
Or le rle des changes est tellement fondamental pour le fonctionnement de
nos conomies que rduire leur volume aboutirait remettre en cause le dve-
loppement du tiers-monde et le niveau de vie des pays dvelopps. L'volution
des transports et celle de l'conomie sont indissociables, et ce n'est pas par ha-
sard qu'elles suivent des courbes parallles. Sans dveloppement des changes,
72
il ne faudrait pas escompter voir la richesse mondiale progresser et notamment
les plus pauvres sortir de la misre.
L'inluctable progression des flux de personnes et de marchandises ne doit
donc pas tre considre d'une manire ngative, mais tre admise pour ce
qu'elle est : l'une des conditions pour que le monde progresse. Il ne faut pas la
regretter mais s'en rjouir.
Il faut aussi se garder d'une illusion. Contrairement ce que l'instinct conduit
croire, les modes de transport ne sont pas des vases communicants. Si les usa-
gers des pays dvelopps choisissent trs majoritairement l'automobile ou
l'avion pour se dplacer, et les entreprises le camion pour transporter leurs
marchandises, c'est qu'il y a d'excellentes raisons. Et, comme l'a rappel le rap-
port du Conseil d'analyse conomique auprs du Premier ministre, tous les ef-
forts effectus grands frais pour tenter de leur faire modifier leurs choix ont
toujours chou et continueront le faire.
Mais ceci ne signifie pas qu'il n'y ait rien faire pour rendre l'avenir nos
transports plus conomes et moins metteurs de gaz effet de serre. Bien au
contraire.
La voiture moins de 2 litres aux 100 kilomtres
C'est dans le progrs technique que l'espoir rside. l'heure actuelle, le parc
automobile consomme en moyenne en France 7 litres aux 100 kilomtres. Il fal-
lait 8,3 litres pour parcourir la mme distance en 1990, et les automobiles mises
aujourd'hui sur le march ncessitent en moyenne moins de 6 litres, garantis-
sant la poursuite de la baisse de la consommation moyenne au cours des annes
venir. Une bonne partie des vhicules qui sont vendus aujourd'hui consomme
d'ailleurs moins de 5 litres aux 100 kilomtres, car les constructeurs franais
produisent des vhicules qui sont parmi les plus conomes du march. Avec un
plein de 60 litres, il est dsormais courant de pouvoir parcourir 1 200 kilomtres
avec une voiture familiale diesel de dimension moyenne ! Selon la Commission
europenne, les trois marques franaises figurent de ce point de vue parmi les
cinq meilleures du march europen qui en compte vingt.
Mieux encore, le groupe PSA met actuellement au point des voitures diesel-
hybride comportant deux moteurs, l'un lectrique, l'autre classique, qui n'au-
ront besoin de gure plus de 3 litres aux 100 en moyenne, le moteur lectrique
permettant de tirer le meilleur parti du moteur thermique en ville. Les prototy-
pes roulent dj, et si le projet se rvle commercialement viable, ces voitures
apparatront sur le march d'ici trois ou quatre ans. Il n'est pas ncessaire d'tre
un grand expert en mathmatiques pour constater alors que si tout notre parc
73
pouvait par un coup de baguette magique s'aligner sur de telles consomma-
tions, les besoins nationaux de carburant automobile pourraient tre diviss par deux
court terme sans qu'il soit ncessaire de rduire notre mobilit et de changer en
quoi que ce soit notre manire de vivre. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a pr-
vu Nicolas Hulot dans son rcent ouvrage Pour un pacte cologique
1
. Il a certes
prvu de doubler les taxes sur les carburants routiers, mais, prudent, il n'a envi-
sag de le faire que lorsque la consommation unitaire des voitures aura t divi-
se par deux !
Et le progrs ne s'arrtera pas l. partir du moment o les voitures du futur
comporteront un moteur lectrique ct du moteur classique explosion,
rien n'empche d'imaginer qu'elles puissent tre galement dotes de batteries
plus importantes qu' l'heure actuelle. Il deviendrait alors possible de recharger
celles-ci la nuit partir de simples prises lectriques, ce qui permettrait de par-
courir chaque jour trois ou quatre dizaines de kilomtres en fonctionnant uni-
quement l'lectricit. Or la plupart des voitures ne circulent pas plus de quel-
ques kilomtres chaque jour. Les parcours quotidiens pourraient de la sorte
tre effectus sans consommer de carburant liquide, et celui-ci serait rserv aux
seuls trajets longs. La consommation moyenne annuelle pourrait alors s'abaisser
2 litres aux 100 kilomtres ou moins. Les premiers prototypes de ces vhicules
hybrides rechargeables (dits plug-in en anglais) roulent aux Etats-Unis.
General Motors a annonc qu'elle mettrait sur le march un tel vhicule
en 2010. Celui-ci parcourrait 40 miles par gallon en usage moyen, ce qui corres-
pond moins de 2 litres aux 100 kilomtres, performance tonnante quand on
sait que le vhicule amricain moyen en ncessite aujourd'hui plus de 10.
Faisons confiance aux constructeurs franais pour dvelopper de tels vhicu-
les de leur ct. Contrairement ce qu'on leur reproche souvent tort, ce sont
en effet nos firmes nationales qui, dans le pass, ont investi le plus massivement
au monde pour dvelopper les voitures lectriques. Ce sont les seules avoir
modifi leurs chanes pour les fabriquer en srie, mais le march n'a pas suivi.
C'est que, malgr de multiples recherches, il n'a pas t possible jusqu' pr-
sent de mettre au point des batteries d'un cot raisonnable qui permettent de
parcourir plus d'une centaine de kilomtres. Il ne s'agit videmment pas de
mauvaise volont de la part des fabricants de voitures ou de batteries, mais
d'une loi physique : il n'est pas possible de stocker dans un kilo de batterie plus
d'une trs petite fraction de l'nergie contenue dans un kilo d'essence, et tou-
tes les objurgations n'y changent rien. En revanche, la perspective de la voiture
hybride rechargeable parat particulirement sduisante pour conomiser le
ptrole, mme si, du point de vue de l'effet de serre, le rsultat dpendra direc-
tement de l'origine de l'lectricit consomme. Dans le cas o celle-ci provien-
1
Nicolas Hulot, Pour un pacte cologique, Calmann-Lvy, 2006.
74
drait d'une centrale classique gaz ou charbon, les missions ne varieraient
pas vraiment et le seul avantage serait d'conomiser le ptrole, ce qui reste es-
sentiel mais ne concerne pas l'impact sur l'effet de serre.
Lorsqu'on sait que la consommation moyenne actuelle des automobiles se si-
tue prs de 10 litres aux 100 kilomtres dans le monde, on reste fascin par les
consquences possibles d'un abaissement de celle-ci 2 litres. Il serait techni-
quement possible de quintupler, une chance relativement proche, la circu-
lation automobile mondiale sans consommer plus de ptrole qu'aujourd'hui.
Autrement dit encore, tous les habitants de la plante pourraient avoir une voiture
sans que cela ncessite plus de carburant qu'aujourd'hui.
L'volution technique apportera donc sans doute la rponse la question
lancinante que chacun se pose : Que se passera-t-il le jour o tous les Chinois
auront une voiture ? La vrit, c'est qu'il n'y a aucune raison que cela se passe
mal, car la consommation unitaire des voitures peut dcrotre trs fortement.
Une telle ventualit ne relve pas du rve. Mais son aboutissement dpendra
du cot futur des batteries et de leurs performances. Il faut aujourd'hui une
batterie classique de 300 kilos pour couvrir une centaine de kilomtres, vitesse
rduite de surcrot. Neuf dix heures sont ncessaires pour la recharger ensui-
te, et il est videmment inutile de songer partir en vacances avec. Grce un
vhicule hydride rechargeable, une centaine de kilos devrait suffire pour par-
courir les trois ou quatre dizaines de kilomtres quotidiens habituels, le moteur
thermique classique prenant le relais quand il faudra aller plus loin.
Selon toute probabilit, les vhicules hybrides rechargeables verront le jour
bien avant l'hypothtique voiture hydrogne qui pose de multiples problmes
et relve aujourd'hui, et sans doute pour longtemps encore, du domaine du r-
ve.
C'est ensuite le march qui dcidera de leur diffusion, car la consommation
de carburant n'est pas le seul critre prendre en compte, loin de l. Le succs
des voitures hybrides rechargeables sera directement fonction de leur cot de
fabrication et de fonctionnement, et de celui de leurs batteries. Sans doute
n'occuperont-elles d'abord qu'une part rduite du march compte tenu du sur-
cot qu'elles impliquent, mais il est rassurant pour l'esprit de savoir que les voi-
tures du futur pourront consommer beaucoup moins de ptrole que celles d'au-
jourd'hui.
Les hypocrites amricains et allemands
Sans nous projeter ainsi dans un avenir qui ne sera peut-tre pas trs loign,
la construction automobile illustre plus que toute autre industrie l'ambigut et
75
les hypocrisies qui caractrisent le domaine de l'environnement. Car il serait
possible de consommer beaucoup moins de carburant qu'aujourd'hui sans r-
duire pour autant le volume de la circulation et donc les changes, et en bn-
ficiant de surcrot de nombreuses autres retombes positives.
Tous les constructeurs mondiaux savent fabriquer des voitures familiales de
dimension classique qui n'ont besoin que de 5 litres de carburant aux 100 kilo-
mtres. Or la consommation moyenne des vhicules produits dans le monde
avoisine le double, sans que le service rendu soit vraiment diffrent. Bien au
contraire, les vhicules les plus puissants cotent plus cher fabriquer et utili-
ser que ceux qui le sont moins, et ils gnrent plus d'accidents. Le bilan est
perdant-perdant. Il y a donc l un gisement considrable d'conomies possibles
et presque indolores. S'il n'est pas mis en uvre, c'est que deux pays s'y oppo-
sent.
Le consommateur amricain, tout d'abord, est attach aux gros vhicules 4
x 4, les Sport Utility Vehicles (SUV) aux moteurs surpuissants huit cylindres
ou plus qui sont des gouffres carburant. La situation n'est toutefois pas fige.
Les rcentes hausses du cours du ptrole ont commenc restreindre le nom-
bre d'acqureurs de ces vritables monstres et les ont ramens des achats plus
modestes. Mais surtout, un gouvernement amricain prcdent, pourtant rpu-
blicain, avait montr la voie il y a plus de trente ans l'occasion du premier
choc ptrolier, en imposant aux constructeurs de l'poque de rduire massive-
ment la consommation moyenne de leur production (rglementation Cafe).
Avant d'tre plus tard abandonne, cette procdure s'tait rvle tout fait
efficace. Or, la surprise gnrale, le prsident Bush a annonc en mai 2007
qu'il allait la remettre en vigueur, sans prciser pour l'instant d'objectifs chif-
frs. Mme si rien n'est aujourd'hui acquis, il est donc possible d'esprer un re-
tour la raison.
Mais l'obstacle ne se situe pas uniquement outre-Atlantique. L'conomie al-
lemande repose trs largement sur la prosprit de son industrie automobile,
beaucoup plus importante que la ntre. Or les constructeurs automobiles alle-
mands ont jusqu' prsent tenu en leur pouvoir leurs gouvernements successifs,
quelles que soient leurs orientations politiques, y compris lorsqu'ils incluaient
une composante cologique.
C'est ainsi que l'Allemagne est le seul pays au monde maintenir des sections
d'autoroute sans limitation de vitesse malgr les taux d'accidents trs levs que
celles-ci connaissent et qui sont soigneusement cachs, afin de permettre ses
constructeurs d'en faire un argument publicitaire. Ils produisent en consquen-
ce des vhicules de plus en plus puissants et de plus en plus rapides dont ils se
sont fait une spcialit et qu'ils exportent avec succs dans le monde entier alors
que la vitesse est limite partout ailleurs, ce qui y cre une situation l'vidence
76
incohrente. Vritable dfi au bon sens, la moyenne des vitesses maximales de
la production de BMW, de Mercedes et d'Audi n'est-elle pas de 235 kilomtres
l'heure ?
Mais chaque fois qu'un gouvernement franais a cherch convaincre son
homologue allemand de s'aligner sur la pratique mondiale que j'avais fait in-
troduire en France et ailleurs, et qui veut que la vitesse soit partout limite pour
d'videntes raisons de scurit et d'conomie d'nergie, ou qu'il a suggr
d'imposer par construction une vitesse maximale aux voitures mises en vente
comme c'est le cas pour les camions, les visages se sont figs et le message reu a
t toujours le mme et dpourvu de la moindre ambigut : si la France met ce
sujet sur la table, ce sera la fin de l'axe franco-allemand.
La description pourrait paratre outrancire si de nombreux tmoignages,
aux plus hauts niveaux, ne l'avaient confirme plusieurs reprises. Il y a une
dizaine d'annes, la tentative pourtant timide d'un ministre franais des Trans-
ports d'aborder le dossier eut pour seule consquence de provoquer un appel
tlphonique du Chancelier Kohl Jacques Delors, alors prsident de la Com-
mission, pour lui signifier qu'il s'agirait l d'un casus belli.
C'est donc l'opposition inflexible de l'Allemagne qui explique qu'il ait t
impossible jusqu' prsent d'aligner la production europenne d'automobiles
sur celles qui consomment le moins, et que se poursuive une course sans fin la
puissance qui est un dfi au bon sens et se traduit de surcrot par des milliers de
drames et de morts inutiles sur les routes du monde entier. quoi cela rime-t-il
de produire des vhicules qui sont optimiss pour rouler 200 ou 250 kilom-
tres l'heure, quand la vitesse est limite partout ailleurs dans le monde aux
alentours de 120 ou 130 kilomtres l'heure ? Ceci n'a pas empch nos voisins
allemands d'affirmer depuis des annes avec la plus grande hypocrisie combien
ils taient attachs la protection de l'environnement ainsi qu' la cause de la
scurit routire.
Mais un vnement nouveau vient peut-tre de changer la donne. Faute de
convaincre ses partenaires sociaux-dmocrates d'abandonner leur veto l'ner-
gie nuclaire, Angela Merkel a accept d'autres mesures pour tenter de lutter
contre les missions de gaz effet de serre de son pays. Elle ne s'est donc pas
oppose ce que la Commission de Bruxelles fixe 130 grammes de CO
2
par
kilomtre parcouru le niveau des missions moyennes des voitures qui seront
vendues en 2012.
Or il s'agit l d'un objectif extraordinairement contraignant lorsque l'on sait
que les missions moyennes des voitures mises sur le march en Europe se sont
leves en 2006 164 grammes de CO
2
par kilomtre. Il l'est tout particulire-
ment pour les constructeurs allemands, spcialistes des fortes cylindres, dont la
production met en moyenne 180 grammes contre moins de 150 pour les deux
77
groupes franais. La situation est par exemple des plus dlicates pour BMW
dont les missions moyennes atteignent 190 grammes par kilomtre.
Autant tre clair. S'il n'est pas exclu que nos constructeurs nationaux puis-
sent, avec beaucoup de difficults, approcher l'objectif fix par la Commission
de Bruxelles, c'est manifestement totalement hors de propos pour leurs homo-
logues allemands, et il s'agira sans doute l d'une nouvelle rglementation eu-
ropenne bafoue. Mais la question de l'opportunit de la limitation de vitesse
sur les autoroutes allemandes va dsormais tre pose.
Certes, les firmes germaniques n'ont pas tort quand elles font valoir que la
circulation routire europenne n'engendre gure plus de 1 % des missions de
gaz effet de serre d'origine humaine de la plante, toutes sources confondues,
et ne peut donc avoir aucun effet significatif sur leur volume. Elles n'ont pas
tort non plus quand elles rappellent que d'autres rglementations europennes
alourdissent sans cesse les automobiles pour qu'elles offrent, juste titre, une
meilleure scurit leurs occupants et que ceci tend accrotre leur consom-
mation. Il n'empche que ne pas gaspiller le ptrole, denre rare, constitue un
impratif qui ne saurait tre discut, ne serait-ce que pour pargner celui-ci au
bnfice des pays du tiers-monde qui en ont besoin pour sortir leurs popula-
tions de la pauvret.
Camions, bateaux et avions
Dans les autres secteurs des transports, le progrs technique se poursuit anne
aprs anne. Les camions, les avions et les bateaux consomment unitairement
de moins en moins. capacit gale, leurs besoins en carburant ont t diviss
par deux depuis trente ans, en mme temps que leurs performances s'amlio-
raient considrablement. Mais le rythme de croissance des besoins de transport
de la plante est tel qu'il outrepasse les conomies unitaires possibles et que
leur consommation globale de carburant continuera augmenter, car les po-
tentiels de gains sont nettement plus faibles que pour les voitures. On doit ainsi
s'attendre ce que les missions du transport arien passent de 2 3 ou 4 % des
rejets de gaz effet de serre de la plante. Mais, faut-il le rappeler, sans chan-
ges, il n'y a plus de progrs possible et leur dveloppement est l'une des condi-
tions incontournables de la sortie de la misre de l'essentiel de l'humanit.
Quant l'ide souvent mise qu'il serait possible de substituer aux camions
ou aux avions d'autres modes de transport moins consommateurs de ptrole
tels que la voie ferre ou la voie d'eau, elle n'est ni raliste car c'est l'usager qui
choisit les modes de transport, ni justifie car les cots ncessaires seraient pro-
hibitifs en regard des rsultats escomptables.
78
La fin du ptrole ?
Qu'il s'agisse de la production d'lectricit, des constructions, des transports,
de l'industrie, de l'agriculture elle-mme, les prvisions de consommation
d'nergie sont donc partout la hausse pour les dcennies venir.
N'est-ce pas alors l'puisement des rserves du sous-sol qui mettra fin au mou-
vement ? N'allons-nous pas manquer trs bientt de ptrole, comme beaucoup
nous l'annoncent, et comme en sont convaincus la majorit des Franais ?
Il ne faut malheureusement pas, si l'on ose dire, compter sur une pnurie
proche de ptrole pour rduire les missions de gaz effet de serre d'origine
humaine. Le ptrole ne reprsente tout d'abord que le quart environ de celles-
ci et cette proportion a tendance baisser. Mais, de surcrot, ses rserves sont
loin d'tre puises, mme s'il est clair qu'elles le seront un jour. Certains an-
noncent que nous sommes proches de la production maximale possible et que
celle-ci va bientt commencer diminuer. C'est la thorie du peak oil . Mais
ce n'est pas l'avis de la majorit des experts, qui considrent au contraire que
les tensions rcentes du march taient uniquement dues l'insuffisance des
capacits d'extraction et de raffinage, et non l'puisement des rserves dispo-
nibles. Celles qui sont prouves reprsentent plus de quarante ans de
consommation au rythme actuel, et les rserves relles sont trs largement sup-
rieures celles qui sont prouves. On dcouvre maintenant du ptrole sous les
ocans plus de 6 000 mtres de profondeur !
L'Agence internationale de l'nergie prvoit ainsi dans son scnario de base
que la production mondiale du ptrole va passer de 4 milliards de tonnes par an
l'heure actuelle 6 milliards en 2030
1
. Mme s'il s'agit par nature d'une prvi-
sion incertaine que d'autres experts mettent en doute, il est probable que la d-
croissance de la production ptrolire n'est pas pour l'immdiat, le risque dans
ce domaine tant surtout de nature politique, car les rserves majeures se trou-
vent dans des pays dont la dmocratie n'est gure la caractristique.
Mais surtout, le ptrole que nous connaissons n'est pas le seul. Le jour o il
viendra manquer, il sera possible de fabriquer sans difficult majeure des car-
burants de substitution partir de multiples sources diffrentes, commencer
par les autres hydrocarbures que la nature a accumuls dans le sous-sol : sables
bitumineux, gaz naturel, charbon, dont les rserves sont au total bien plus
abondantes encore. C'est dj ce qui se passe aujourd'hui dans les provinces
occidentales du Canada o de gigantesques gisements de sables bitumineux
sont d'ores et dj exploits pour produire de l'essence en quantit importante.
On sait de mme transformer le charbon en carburant, ainsi que les Allemands
1
Key World Energy Statistics 2005.
79
l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire rouler leurs blinds et
voler leurs avions.
Le prix de revient de ces nouveaux ptroles est comptitif ds que le cours
du ptrole brut naturel dpasse une cinquantaine de dollars par baril. La Chine
envisage ainsi de construire dans la province de Ningxia, en partenariat avec la
socit Shell, une usine de transformation du charbon en carburant d'un cot
de 5 6 milliards d'euros. Trente projets de cette nature sont l'tude dans le
mme pays, et certains dj en construction pour le compte de la socit Sino-
pec. terme, 10 % des besoins en carburant de la Chine pourraient tre ainsi
couverts si les premiers projets se rvlent probants.
Mais, du point de vue de l'effet de serre, la vrit oblige dire que les ptro-
les artificiels ainsi fabriqus engendrent et engendreront encore plus de rejets
que ceux que nous connaissons. Pour les produire, il faut en effet dpenser
beaucoup d'nergie et donc mettre dj dans l'atmosphre du gaz carbonique
qui s'ajoute celui rejet au moment de leur utilisation.
Le ptrole 300 dollars le baril
Quoi qu'il en soit, une chose est sre : nous ne manquerons pas durablement
de carburant au cours des dcennies venir, d'autant que les Europens ont
montr qu'ils taient prts payer celui-ci trs cher. Certes, plus le ptrole que
nous connaissons deviendra rare, plus les cours monteront. Le prix du baril de
brut avoisinait il y a peu 10 dollars. En 2006, il a approch par moments 80 dol-
lars, et beaucoup ont considr qu'il s'agissait l d'un niveau difficilement sup-
portable. C'est oublier que l'automobiliste europen est habitu des montants
trs suprieurs lorsqu'il remplit le rservoir de son vhicule. Dans la plupart des
pays du vieux continent, il a d acquitter, du fait des taxes spcifiques, jus-
qu' 1,5 euro par litre en 2006 pour faire le plein. Comme un baril contient 159
litres, et qu'un euro correspondait nettement plus d'un dollar, un calcul rapi-
de montre qu'il a pay alors son carburant l'quivalent de 300 dollars par baril,
dont l'essentiel tait constitu de prlvements au profit des finances publi-
ques !
Autrement dit, le ptrole est d'une telle utilit que les Europens sont prts
le payer beaucoup plus cher encore que ce que les fluctuations du march in-
ternational leur imposent. Il va nanmoins de soi que si, un jour, les cours
mondiaux devaient dpasser largement les niveaux atteints en 2006, il faudrait
que les gouvernements revoient les quilibres de leur fiscalit. Laisser les taxes
ptrolires inchanges porterait le prix du carburant la pompe un niveau
insupportable pour la frange la plus modeste de la population, et celle-ci devrait
80
alors renoncer l'automobile dont la dmocratisation a t l'une des plus
grandes avances des socits modernes au cours de la seconde moiti du XX
e
sicle. Une telle rgression serait socialement dramatique pour la qualit de vie
des intresss et politiquement insupportable. Il faut dire ce sujet que la taxe
ptrolire (TIPP) est beaucoup plus inquitable par exemple que la TVA et
frappe bien davantage les catgories les plus modestes en proportion de leurs
revenus.
Au total, la conjugaison des conomies possibles et de l'exploitation optimale
des ressources naturelles permettra selon toute probabilit de rpondre aux be-
soins des transports pendant des dcennies. Ceux qui affirment que nous man-
querons prochainement de carburant ne font qu'entretenir une inquitude
inutile et seront dmentis par les faits. Mais, contribuant la morosit, ils ont
russi convaincre une majorit de nos concitoyens, dont prs de deux tiers
(65 % contre 35 %) pensent que nous allons bientt manquer de carburant
pour nos voitures
1
.
Il ne faut pas en tout cas compter avant longtemps sur les transports pour
contribuer la rduction des missions de gaz effet de serre. C'est le domaine
o le recours aux hydrocarbures est le plus utile la collectivit, et le plus indis-
pensable car ils n'ont pas d'alternative raliste. Ce n'est pas l qu'il est possible
d'tre efficace. Qui pourrait croire un instant que l'humanit n'utilisera pas le
ptrole que recle le sous-sol de la plante ?
Le tour d'horizon des grandes sources d'mission de gaz effet de serre ne
serait pas complet si l'agriculture tait passe sous silence, puisqu'on estime par-
fois qu'elle est l'origine du quart des missions de la plante imputables
l'homme. Pour nourrir l'humanit, il faut en effet produire des engrais,
consommer des carburants, transporter et transformer le produit des rcoltes,
toutes activits gnratrices d'missions de gaz carbonique.
Tous vgtariens ?
Faudra-t-il arrter un jour de manger de la viande ? La question peut paratre
saugrenue. Mais consommer de la viande nuit gravement l'environnement
pour deux raisons qui s'additionnent. Il faut tout d'abord souvent prs d'une
dizaine de kilos de crales pour produire un seul kilo de viande, et c'est donc
l un trs mauvais usage des ressources de la plante.
Il y a beaucoup plus grave encore. Les ruminants constituent une vritable ca-
tastrophe cologique, comme l'a constat dans un rapport qui a dfray la
chronique en novembre 2006 l'organisme des Nations unies en charge des
1
Ipsos/FFAC, juillet 2006.
81
questions d'alimentation, la FAO. Ce rapport a rvl que l'levage produisait sur
la plante plus de gaz effet de serre que l'ensemble des transports, avec 18 % en
quivalent CO
2
contre 16 % ! De plus, la production mondiale de viande de-
vrait doubler d'ici 2050 selon les tendances actuelles, ce qui a pour consquen-
ce des projections extrmement proccupantes.
Les bovins sont les principaux responsables de cette situation, car ils mettent
notamment de grandes quantits de mthane, gaz qui a un pouvoir de rchauf-
fement vingt-trois fois plus lev que le gaz carbonique. C'est ainsi qu'en Fran-
ce, aussi surprenant que cela paraisse, une vache met en moyenne chaque an-
ne plus de gaz effet de serre qu'une voiture. Plus prcisment, elle produit,
d'aprs les calculs des experts des Nations unies, 106 kilos de mthane en rumi-
nant et en souillant son fumier, ainsi que du protoxyde d'azote, ce qui corres-
pond au total 2,5 tonnes de CO
2
. Pour sa part, une voiture moyenne parcourt
en France 14 000 kilomtres chaque anne, au cours desquels elle met 165
grammes de CO
2
par kilomtre, ce qui aboutit 2,3 tonnes, quantit en dcrois-
sance rgulire anne aprs anne.
Lorsqu'on sait qu'il y a en France 21 millions de bovins et 30 millions de voi-
tures, une question moins saugrenue qu'il n'y parat vient immdiatement
l'esprit. S'il fallait absolument rduire nos missions de gaz effet de serre
comme on nous l'assure, nous serait-il plus facile de nous passer de voiture, ou
de cesser de manger du buf ?
La rponse est vidente, tant la voiture est devenue ncessaire la vie quoti-
dienne. Interrogs par l'Institut Ipsos en janvier 2007, une majorit de Franais
(55 %) ont estim juste titre que la voiture tait plus indispensable la vie
quotidienne que le bifteck, qui est pourtant notre plat national ! S'ils taient
logiques, les cologistes devraient mettre en tte des demandes qu'ils adressent
nos concitoyens de renoncer la viande de buf, dont ils peuvent se passer,
et non de se priver de leur voiture, presque toujours indispensable leur vie
quotidienne. Mais sans doute ont-ils compris que ce ne serait gure populaire.
Si nous devenions tous vgtariens, la contribution de l'agriculture la pro-
duction de gaz effet de serre chuterait donc brutalement. Mais comme cette
hypothse n'est gure probable, c'est un accroissement des missions atmos-
phriques qu'il faut s'attendre au fur et mesure du recul de la faim dans le
monde et plus encore du dveloppement de l'levage qui accompagne l'lva-
tion du niveau de vie. Ces perspectives sont d'autant plus probables que la ten-
dance mondiale est l'accroissement du poids moyen des bovins et donc celui
du volume de leurs missions unitaires, contrairement ce qui se passe pour les
voitures dont la consommation moyenne diminue...
82
CHAPITRE VII
Le rapport Stern
l'issue de ce tour d'horizon, le moment est venu de regarder la ralit en
face, bien diffrente des ides qui ont cours.
Une double inertie
Les missions d'origine humaine des gaz qui concourent l'effet de serre
sont pour l'essentiel figes pour les deux ou trois dcennies qui viennent. Les
centrales thermiques charbon ou gaz qui existent ou sont en construction
par centaines vont rejeter du gaz carbonique en grande quantit tout au long
de leur vie. Le parc immobilier qui sera prsent dans vingt ans est dj construit
pour l'essentiel et il est impossible de le transformer massivement. Sauf catas-
trophe plantaire, les hommes et les marchandises continueront se dplacer,
les habitants de la plante manger plus, et les usines produire. Le tiers-
monde continuera se dvelopper en ayant recours aux techniques actuelles et
donc mettre de plus en plus de rejets.
On ne voit donc pas comment les missions pourraient ne pas poursuivre une
croissance forte pendant au moins la vingtaine d'annes venir, comme le pr-
voit d'ailleurs l'Agence internationale de l'nergie, la marge de manuvre au
niveau mondial n'excdant pas pendant cette priode quelques pour cent au
mieux.
Mais ce n'est pas tout. Puisque le gaz carbonique, qui est le composant majori-
taire parmi les produits qui concourent l'effet de serre, reste prsent dans
l'atmosphre une centaine d'annes, l'impact de tout ventuel changement du
rythme des missions ne pourra se faire sentir qu'avec un dcalage dans le
temps qui se comptera nouveau en dcennies. Mme si le flux diminuait for-
tement, le stock n'en serait que peu modifi avant trs longtemps. Autrement
dit, les conditions atmosphriques qui rgneront en 2050 sont dj figes pour l'essentiel.
Mme si l'humanit dcidait d'agir immdiatement et vigoureusement pour
rduire ses missions, ce n'est au mieux que dans la seconde moiti du prsent
83
sicle que des effets significatifs pourraient se faire sentir. Cette extraordinaire
inertie, que soulignent tous les spcialistes, est peu connue du grand public.
Est-ce dire qu'il n'y a rien faire et qu'il faut se rsigner sans ragir vivre
sur un globe de plus en plus chaud, avec des risques de changement climatique
de plus en plus grands ? La rponse cette question n'tait pas vidente, mais il
fallait la poser, et c'est ce qu'a fait en 2005 le G8 qui runit les chefs d'Etat des
huit pays les plus puissants de la plante. Il a demand l'Agence internationale
de l'nergie d'tudier comment et quelles conditions il serait possible de r-
duire drastiquement l'avenir les missions de gaz carbonique d'origine hu-
maine lies l'nergie.
Un optimisme de faade
Publie au milieu de 2006, la rponse de l'Agence internationale de l'nergie
mrite qu'on s'y arrte
1
. Elle confirme tout d'abord que nous ne pouvons rien
faire pour changer significativement les missions avant longtemps et se fixe
donc comme objectif de les rduire massivement en 2050 seulement. Mais elle
montre qu'il n'est pas exclu, tout au moins sur le papier, que nous puissions
diminuer, cette chance, de moiti nos rejets de gaz carbonique par rapport
aux tendances actuelles et que l'humanit revienne alors son niveau actuel
d'mission. Elle n'mettrait alors plus au milieu du sicle qu'une trentaine de
milliards de tonnes de CO
2
par an au lieu d'une soixantaine si rien n'tait fait
(prvision baseline ). Mais cette affirmation optimiste est immdiatement
tempre par plusieurs considrations.
Les incertitudes techniques sont tout d'abord encore trs grandes dans cer-
tains domaines essentiels, au premier rang desquels figurent les rejets de gaz
carbonique des centrales thermiques classiques qui sont l'origine de plus
de 40 % des missions de celui-ci.
Quels que soient les efforts pour accrotre le nombre des centrales nuclaires,
l'Agence internationale de l'nergie dclare qu'il ne sera pas possible de re-
noncer au charbon ou au gaz naturel pour fabriquer l'essentiel de l'lectricit
dont l'humanit aura besoin au cours des dcennies venir. Les possibilits de
l'hydrolectricit sont limites, et les oliennes et les panneaux solaires ne peu-
vent jouer au mieux qu'un rle marginal. Quant l'nergie nuclaire, l'Agence
internationale adopte l'hypothse que, dans l'tat des choses, son dveloppe-
ment grande chelle serait rendu impossible du fait du contexte actuel.
1
AIE, Energy Technology Perspectives, CO
2
emissions from fuel combustion, 2006.
84
La captation du gaz carbonique
S'il en tait ainsi, la seule solution envisageable pour viter les rejets massifs
de gaz effet de serre consisterait alors capter le gaz carbonique produit par
les centrales thermiques gaz ou charbon et l'enfouir sous terre. Le pro-
blme, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune installation ainsi quipe, et qu'il
subsiste une incertitude majeure sur la possibilit technique et financire d'ap-
pliquer cette technique grande chelle sur la plante.
Il faut en effet mettre au point tout d'abord des techniques de captation du
gaz carbonique au sein des centrales, puis trouver des terrains qui se prtent
un stockage hermtique afin que celui-ci ne s'en chappe pas pour se rpandre
nouveau dans l'atmosphre. De tels sous-sols existent : nappes aquifres sali-
nes, anciens gisements de ptrole puiss, etc. Mais y en aura-t-il suffisamment
et qui soient proches des futures centrales pour ne pas ncessiter la construc-
tion de canalisations de plusieurs centaines de kilomtres de long et d'un cot
prohibitif pour vhiculer le gaz carbonique jusqu' son lieu d'enfouissement ?
Il y a l une trs grande incertitude, ce qui a conduit l'Agence internationale
de l'nergie recommander que soit ralise d'urgence une dizaine de centra-
les exprimentales de grande dimension de ce type. L'une d'entre elles est au-
jourd'hui en chantier en Allemagne. Ce n'est qu'en fonction des rsultats alors
obtenus que l'on pourra se prononcer sur la possibilit de systmatiser cette
mesure, ce qui est loin d'tre vident aujourd'hui.
Un cot massif
En tout tat de cause, cette mesure, comme les autres, cotera trs cher, et
c'est l le deuxime constat du rapport de l'Agence internationale de l'nergie.
Celle-ci fait l'hypothse qu'il serait possible d'obtenir la suppression de 30
milliards de tonnes de rejets annuels en 2050, toutes sources confondues, sur
les 60 auxquelles conduirait le prolongement des tendances actuelles sans d-
penser plus de 25 dollars, soit environ 20 euros, par tonne de gaz carbonique
vite. S'agissant de la production d'lectricit par les centrales charbon, cette
estimation est trs discutable puisque seule l'exprience permettra de savoir
quel en sera le cot. L'Agence internationale de l'nergie elle-mme indique
que les estimations actuelles font tat d'un cot de captation et d'enfouissement
de 50 80 dollars par tonne de CO
2
. Il faudrait donc des progrs de trs grande
ampleur et qu'on ne peroit pas clairement aujourd'hui pour en rduire le
montant 25 dollars. On peut donc penser que l'estimation de l'Agence du
cot par tonne vite est faible.
85
Mais, mme si elle est exacte, l'estimation actuelle n'en reprsente pas moins
terme une dpense de 750 milliards de dollars par an, soit 7 500 milliards par
dcennie. De telles sommes sont gigantesques. Le produit intrieur brut de
l'ensemble des pays de la plante s'lve l'heure actuelle 40 000 milliards de
dollars par an environ, et le surcot ncessaire pserait donc massivement sur
l'conomie mondiale ! Certes, il n'y a pas l d'impossibilit thorique, mais l'ob-
jectif suppose l'existence d'une volont sans faille, ce qui rejoint le troisime
constat de l'Agence internationale de l'nergie.
Une exhaustivit slective
Les mesures prconises par l'Agence internationale de l'nergie ne seront
en effet efficaces que si elles sont gnrales et si elles concernent la fois toutes
les activits et tous les pays, tout en respectant la rgle d'or de ne pas dpasser
un cot de l'ordre de 25 dollars par tonne de CO
2
pargne. Sinon, elles ne fe-
ront que dcaler de quelques annes les phnomnes dans le temps, et ne servi-
ront pratiquement rien.
S'il est un reproche adresser l'Agence internationale de l'nergie c'est
que, dans son souci de ne pas dcourager les bonnes volonts, elle n'ait pas vou-
lu souligner que la plupart des actions entreprises aujourd'hui par les diffrents
gouvernements au nom de la sauvegarde de la plante taient inefficaces tant
leur cot tait disproportionn aux rsultats.
La ncessit de l'exhaustivit n'est pas seulement sectorielle. Elle est surtout
gographique. Il ne servirait rien que certains pays engagent grands frais des
politiques drastiques de rduction de leurs missions si les autres n'en faisaient
pas autant et consommaient leur place le ptrole, le gaz ou le charbon qu'ils
auraient pargns. Lorsque l'on sait que les Nations unies comptent prs de
deux cents pays, on mesure la difficult de la tche.
Le rapport Stern
C'est ce problme que s'est attaqu la fin de 2006 un rapport percutant
sur l'effet de serre, appel faire parler de lui au cours des annes venir. R-
dig la demande du gouvernement britannique par un conomiste de grand
renom, Sir Nicholas Stern, il reprend la fois l'approche d'Al Gore qui dcrit
un avenir apocalyptique si nous ne faisons rien, et les conclusions de l'Agence
internationale de l'nergie sur les moyens de nous en prmunir.
86
Selon le rapport Stern, qui adopte ici les estimations des experts des Nations
unies, la temprature moyenne du globe s'lvera de 2 degrs d'ici 2035, et il y
a plus de 50 % de chances que l'accroissement dpasse long terme 5 degrs en
cas d'inaction, avec des consquences qu'il est difficile de prvoir mais qui
pourraient tre dramatiques la fin du sicle : dplacement de 100 millions de
personnes du fait de l'lvation du niveau de la mer ; disparition de 40 % des
espces vivantes ; fonte des glaciers ; afflux dans les pays riches de centaines de
millions de rfugis climatiques , etc.
Rien de ceci n'est videmment certain, mais l'originalit du rapport Stern est
d'avoir cherch calculer ce que cela coterait, et d'avoir conclu que le cot de
l'inaction serait beaucoup plus lev que ce qu'il serait ncessaire de dpenser
pour supprimer les risques.
Plus prcisment, les cots annuels des dsastres annoncs pourraient repr-
senter d'ici quelques dcennies 5 % du PIB mondial et mme peut-tre 20 %,
alors qu'il serait possible de les viter en consacrant ds prsent de 1 % 3 %
au plus de celui-ci la lutte contre l'effet de serre. En d'autres termes, il faudrait
agir comme l'on fait lorsqu'on s'assure : dpenser immdiatement pour ne pas
avoir payer plus tard beaucoup plus cher. Pour frapper l'opinion, le rapport
Stern a mme prcis que les cots potentiels seraient suprieurs pour l'humanit ceux des
deux conflits mondiaux du XX
e
sicle et celui de la grande dpression des annes trente !
Bien entendu, des critiques se sont leves aussitt pour accuser le rapport de
pessimisme exagr.
Trois fois plus que l'aide au tiers-monde
Mais l'essentiel n'est pas l. Il tient au fait qu'une proportion de 1 % du PIB
reprsente dj des sommes gigantesques, se chiffrant rapidement 500 mil-
liards de dollars par an ou plus, comme l'avait dj suggr l'Agence interna-
tionale de l'nergie ! Les ordres de grandeur ont de quoi effrayer. Car ces 500
milliards annuels devraient tre dpenss en majorit dans les pays en dvelop-
pement puisque ce sont eux qui, de plus en plus, seront l'origine des mis-
sions. Or ils n'ont pas les ressources ncessaires pour le faire, et leur priorit est
d'abord de faire reculer chez eux la misre et la faim. Quant aux pays riches, on
les voit mal dcider soudain d'accorder la Chine, l'Inde et aux autres pays
concerns les centaines de milliards de dollars ncessaires, ce qui reviendrait
plus que tripler l'aide au tiers-monde qui n'excde pas aujourd'hui 150 mil-
liards de dollars par an ! Encore ces sommes ont-elles t estimes sur la base
d'un cot de 25 dollars par tonne d'mission vite. Si l'exprience montrait
que cette valeur tait fortement sous-value, ce qui est possible, les dpenses
87
ncessaires s'accrotraient encore pour atteindre des sommes difficiles imagi-
ner.
Cet aspect des choses est largement pass sous silence. Mais la conclusion est
sans appel. Sans une rupture dans les politiques suivies partout ou presque dans
le monde, les actes ne seront pas la hauteur du problme et l'efficacit ne sera
pas au rendez-vous.
Le rapport Stern appelle deux autres remarques.
La premire concerne l'appel que lance ce document une action mondiale,
en soulignant que les mesures prises par des pays isols ne serviront rien si el-
les ne s'inscrivent pas dans un cadre plantaire. En termes peine dguiss, le
rapport Stern s'adresse en fait aux Etats-Unis, la Chine et l'Inde, et pas la
Grande-Bretagne qui l'a command. C'est bien ce qu'a compris la presse bri-
tannique en remarquant que le Royaume-Uni n'mettait que 2 % des gaz effet
de serre de la plante, ce qui correspondait l'accroissement annuel ou pres-
que des missions de la Chine !
La seconde remarque nous concerne directement. On chercherait en vain
dans les sept cents pages du rapport des appels aux citoyens tels que nous les
affectionnons. Les mesures proposes sont uniquement d'ordre conomique et
technique, et Nick Stern a bien compris qu'il tait inutile de lancer des appels
alarmistes, de culpabiliser les individus, de leur demander de procder des
restrictions volontaires de leur consommation, de renoncer leur voiture ou de
changer leur mode de vie, car cela n'aboutirait rien. C'est en agissant par la
voie de la technique et par celle de l'incitation conomique, notamment en
crant une taxe carbone dont devraient s'acquitter les activits mettrices de gaz
carbonique, qu'il serait possible d'esprer tre un jour efficace, et non en cher-
chant changer les comportements et la nature humaine. Il y a l toute la diff-
rence entre une approche pragmatique et une vision idologique et culpabilisante.
Le rapport Stern appelle toutefois une suite, et celle-ci sera peut-tre crite
par le mme acteur dans le cadre de la mission que lui a confie cette fois-ci le
gouvernement franais (il a pass ses vacances d'enfant Sarlat et parle parfai-
tement notre langue). En effet, le rapport actuel ne fait pas la diffrence entre
les secteurs o une taxe carbone de quelques dizaines de dollars par tonne
de gaz carbonique pourrait tre efficace, tels que la production d'lectricit,
l'industrie ou la dforestation, et ceux o elle serait sans aucune influence signi-
ficative, comme c'est le cas pour les transports ou l'amlioration de l'isolation
des constructions anciennes, car il faudrait alors que cette taxe soit dix ou vingt
fois plus importante pour tre efficace. C'est que l'lasticit l'gard d'une
ventuelle taxation varie trs fortement d'un domaine un autre, ce qui limite
considrablement ses secteurs d'action potentiels. Il reste en dfinitive hirar-
chiser les dpenses possibles en fonction de leur efficacit.
88
Les trois gants
Trois nations, et trois seulement, pourraient en dfinitive influer sur le cours
des choses. Les tats-Unis mettent comme on l'a vu prs du quart du gaz car-
bonique de la plante, et la Chine autant. Sa contribution augmente de surcrot
un rythme insouponn l'aune de son dveloppement massif, tel point
qu'on estime dornavant qu'elle aura dpass les Etats-Unis avant la fin de la
prsente dcennie, si elle ne l'a dj fait ! De 2000 2004, la Chine a reprsent
elle seule 60 % de l'accroissement des missions de la plante ! L'Inde suit
pour sa part avec une quinzaine d'annes de dcalage. A eux trois, ces pays
mettent dj plus de la moiti du gaz carbonique d'origine humaine du globe,
ce qui implique deux consquences.
Sans eux, ce que les autres pourront faire ne servira tout d'abord rien. Il en
est ainsi de l'Union europenne qui ne reprsente qu'un septime des mis-
sions de la plante, proportion appele dcrotre encore dans le temps, et qui
a matris peu ou prou les siennes.
Si les tats-Unis, la Chine et l'Inde engageaient une politique rigoureuse de
rduction de leurs missions, on peut penser au contraire que leur comporte-
ment s'imposerait au reste du monde et que l'objectif de l'Agence internationa-
le de l'nergie de revenir au niveau actuel des missions aux alentours du mi-
lieu du sicle cesserait d'tre ce qu'il est aujourd'hui, c'est--dire irraliste. Les
efforts de l'Europe seraient alors justifis. Mais est-ce possible ?
moins d'un brutal revirement de George Bush, il faudra attendre l'lection
du prochain prsident des tats-Unis pour savoir si celui-ci aura la volont et la
possibilit d'imposer aux Amricains de renoncer leurs voitures dvoreuses
d'essence, de payer leur lectricit beaucoup plus cher pour permettre la s-
questration du gaz carbonique si celle-ci se rvle possible, de rouler avec des
biocarburants nationaux bien plus coteux que l'essence, etc., le tout pour que
le climat de la plante s'amliore dans plusieurs dcennies. Cette simple nu-
mration montre l'ampleur de la tche, mme s'il est vrai que les esprits vo-
luent outre-Atlantique grce notamment la croisade de l'ancien vice-prsident
Al Gore, relaye par des lus influents. Mais le chemin parcourir est immense,
et les possibilits de rduction des missions en dfinitive relativement limites.
L'obstination de Bush et des dirigeants de l'Australie et d'autres pays ne pas
se joindre au concert ambiant tant que la Chine et l'Inde ne seront pas autour
de la table trouve une certaine justification dans l'chec probable de la politi-
que adopte grand renfort de publicit par le gouverneur de Californie, le
trs clbre Arnold Schwarzenegger.
89
Celui-ci a tout d'abord fix son tat des objectifs trs ambitieux pour 2050,
promettant de diviser les missions par cinq cette date par rapport leur ni-
veau de 1990. De telles promesses engagent d'autant moins ceux qui les
formulent que la plupart d'entre eux seront morts avant cette date et que, par-
mi ceux qui les coutent, les survivants les auront oublies depuis longtemps.
Soyons srieux. C'est plus court terme que les choses se compliquent. L'ob-
jectif a ainsi t fix de porter en 2010 la part des nergies renouvelables, hors
nuclaire et hydrolectricit, 20 % de la production d'lectricit californien-
ne.
Trois ans avant cette chance, cette proportion n'a aucune chance d'tre at-
teinte, et les compagnies lectriques viennent de dclarer qu'elle tait inacces-
sible. Il en rsulte que le but affich de ramener les missions lies la produc-
tion d'lectricit leur niveau de 1990 ne sera pas atteint.
Un autre des objectifs du gouverneur est tout aussi mal parti. Celui-ci avait
prvu de subventionner la production d'lectricit d'origine solaire en quipant
de gnrateurs, en dix ans, les toits d'un million de maisons.
Mais ce projet est galement dans l'impasse du fait de l'envole du cot des
panneaux photovoltaques du fait des subventions massives dont bnficient
leurs composants en Allemagne, et surtout parce que les compagnies lectri-
ques sont obliges de desservir pour les heures nocturnes les maisons concer-
nes, et se trouvent alors dans l'obligation de facturer l'lectricit bien plus cher
qu'auparavant, de telle sorte qu'il arrive que la facture globale pour leurs oc-
cupants soit suprieure ce qu'elle tait antrieurement malgr les subventions
verses ! Tant qu'on ne saura pas stocker bon march l'lectricit, on voit
quel point les nergies renouvelables poseront problme, mme dans un pays
inond de soleil.
Si l'on ajoute que la population californienne s'accrot rapidement, et tout
particulirement dans les zones de l'intrieur de l'tat o la chaleur est acca-
blante et la consommation d'lectricit double de ce qu'elle est ailleurs, il faut
malheureusement se rendre l'vidence. Le plan de lutte contre l'effet de serre
d'Arnold Schwarzenegger est certes un grand succs mdiatique. Mais son au-
teur a joint sa voix ceux qui croient qu'en cdant au politiquement correct des
nergies renouvelables, des solutions aises peuvent tre trouves. Il est crain-
dre qu'il apporte seulement la dmonstration que les meilleures intentions ne
suffisent pas elles seules rgler l'un des plus grands problmes de ce sicle
1
.
Est-ce alors la Chine, ou l'Inde, qui prendra l'initiative ? Contrairement ce
que l'on pourrait penser, ces deux pays sont trs conscients des problmes
d'environnement. Aprs l'Inde, la Chine vient d'adopter les normes antipollu-
tion europennes pour les missions caractre locale de ses voitures. Les
1
The Economist, 23 juin 2007.
90
grandes villes chinoises ont entrepris des travaux considrables d'puration de
leurs rivires et de leurs fleuves qui s'apparentaient il y a peu plus des gouts
qu' des cours d'eau, et les premiers rsultats sont spectaculaires. Des espces
d'oiseaux protges sont revenues nicher non loin de Pkin. Guangzhou
(Canton), les habitants ont mme nouveau pu se baigner dans la rivire des
Perles qui traverse la ville, mme s'il est vrai que des Europens hsiteraient trs
certainement le faire ! La Chine est dirige par des scientifiques, et elle est
sensibilise aux risques lis l'effet de serre. Le prsident de la Rpublique Hu
Jin-tao n'est-il pas ingnieur de formation ?
Mais la Chine juge qu'elle ne peut aujourd'hui satisfaire l'essentiel de ses be-
soins d'lectricit qu'avec le charbon dont elle dispose en abondance. Elle a d-
cid de dpenser des sommes considrables (officiellement 125 milliards de
dollars sur cinq ans !) pour lutter contre les pollutions toxiques de proximit,
qu'il s'agisse de l'air ou de l'eau. Mais elle ne s'est pas encore vritablement
avance sur la voie, autrement coteuse et incertaine, de la lutte grande chel-
le contre les missions de gaz carbonique, et a encore refus Nairobi, en no-
vembre 2006, de prendre un quelconque engagement en ce sens.
Quant nous, Franais, avec gure plus de 1 % des missions mondiales, nous
ne pouvons rien faire de significatif compte tenu des ordres de grandeur en
cause. De surcrot, les dpenses considrables que nous consentons aujourd'hui
au nom de la lutte contre l'effet de serre ne peuvent avoir aucun effet notable,
puisqu'elles sont affectes des actions dont l'efficacit en termes de rejet vit
en regard du cot est le plus souvent insignifiante.
C'est pourtant au nom de la sauvegarde de la plante que sont engags des
crdits dont on a vu qu'ils se chiffrent en milliards d'euros.
Quant laisser croire nos compatriotes qu'ils peuvent individuellement
contribuer sauver la plante en changeant leurs comportements quoti-
diens et en rduisant l'infime fraction de l'nergie mondiale qu'ils utilisent, la
chose prterait sourire si le sujet n'tait srieux. Cela peut sans doute cho-
quer, mais toute approche un tant soit peu rationnelle montre que leurs ven-
tuels sacrifices ne sont d'aucune utilit. Que compte l'unique tonne de gaz car-
bonique que chacun d'entre nous pourrait peut-tre pargner chaque anne
avec beaucoup d'efforts, en regard des 2 800 milliards de tonnes qui existent d-
j dans l'atmosphre et qui s'accroissent de plus de 15 milliards chaque anne ?
Autant vouloir niveler l'Everest avec une petite cuillre, ou vider l'ocan avec un
seau, alors que l'ventuelle solution est d'ordre technique et financier, et qu'elle se trouve
seulement entre les mains des dirigeants futurs de la Chine, de l'Inde et de l'Amrique. Ce
constat a certes quelque chose de profondment choquant. Instinctivement,
nous voulons croire que, mme dans une faible mesure, nos efforts personnels
serviraient quelque chose. Force est de constater que ce n'est pas le cas.
91
Bien entendu, nul ne peut dire aujourd'hui comment volueront les choses.
Certains espreront que les responsables de ces trois pays se mettront d'accord
pour btir une politique commune de limitation drastique de leurs rejets de gaz
effet de serre, et qu'ils entraneront dans leur sillage le reste de la plante
malgr les contraintes et les cots considrables ncessairement impliqus. Mais
d'autres, sans doute plus nombreux, estimeront qu'il s'agit l pour longtemps
d'une vision irraliste et qu'il est illusoire d'escompter que, sauf cataclysme im-
prvu, l'humanit renonce utiliser moindres frais le ptrole, le charbon et le
gaz naturel que les res passes ont accumuls dans le sous-sol de la plante.
Qui serait d'ailleurs prt donner la Chine, l'Inde et aux autres pays du
tiers-monde les dizaines ou les centaines de milliards d'euros qu'ils n'ont pas et
qui leur seraient ncessaires chaque anne pour restreindre significativement
leurs rejets ? Faut-il alors baisser les bras ?
92
CHAPITRE VIII
Alors, que faire ?
Face au dfi que reprsentent l'accumulation de gaz effet de serre dans
l'atmosphre de notre globe et le risque climatique qui l'accompagne, que peut
faire un pays comme le ntre ? Que peut faire chacun d'entre nous ?
Rpondre ces deux questions suppose d'abord une prise de conscience d-
pourvue d'ambigut. Oui, le rchauffement climatique est un phnomne gra-
ve ; ce n'est pas parce que son ampleur est entache d'incertitudes qu'il doit
tre considr avec lgret. Il constitue l'un des plus grands dfis auxquels ait
jamais t confronte l'humanit. S'agissant d'un des problmes les plus srieux
qui soient, il doit tre trait avec srieux, ce qui implique un certain nombre de
conclusions qu'il faut regarder en face, mme lorsqu'elles se situent aux anti-
podes des ides rgnantes.
Il ne faut tout d'abord pas se nourrir d'illusions sur l'ampleur des moyens n-
cessaires. Il est de bon ton de minimiser celle-ci et d'affirmer qu'il serait facile-
ment possible d'tre efficace. C'est ainsi qu'aprs avoir procd une descrip-
tion dramatique des consquences de l'inaction, le rapport du groupe des ex-
perts des Nations unies (GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'volution du climat), runis Bangkok en mai 2007, a affirm qu'il suffirait de
rduire le rythme de croissance de l'conomie mondiale 0,12 % par an tout au
plus, c'est--dire de 3 % en vingt-cinq ans, pour matriser l'volution des mis-
sions, stabiliser un niveau acceptable les concentrations dans l'atmosphre, et
limiter le rchauffement climatique 2 ou 3 degrs partir de 2050.
Empreinte d'un optimisme systmatique, cette prsentation des choses est
trompeuse. Elle donne croire que la solution du problme est aise et elle jus-
tifie de multiples dclarations dont la tonalit culpabilisante est toujours la m-
me : Puisque les remdes sont porte de main, et que beaucoup coteraient
mme peu de choses, qu'attendez-vous pour agir ?
Les journaux ont alors titr Le cot de la lutte contre le changement clima-
tique est limit
1
, et le Commissaire l'Environnement de la Commission eu-
1
Le Monde, 5 mai 2007.
93
ropenne, M. Stravos Dimas, a immdiatement dclar : Nous n'avons plus
d'excuse l'inaction.
Pour mieux comprendre les choses, il faut savoir que de nombreux reprsen-
tants des organisations cologiques participent aux travaux des Nations unies, et
qu'ils ont russi les orienter dans le sens de la sous-estimation systmatique de
la difficult des actions et du cot des remdes. A l'issue de la runion de Bang-
kok, l'un des principaux rdacteurs des conclusions du GIEC, M. Bill Hare, par
ailleurs conseiller de Greenpeace, s'est ainsi publiquement rjoui du consensus
obtenu.
Pour sa part, Hans Verlome, membre de WWF international, a affirm : Les
scientifiques ont transmis aux responsables politiques le message fondamental
que des technologies propres taient disponibles pour rgler les problmes, et
ceci un trs faible cot pour nos conomies
1
.
La ralit est malheureusement bien diffrente. Car les voix de ceux des ex-
perts qui estimaient que les conclusions annonces taient exagrment opti-
mistes et qu'une lutte efficace contre les missions coterait beaucoup plus cher
qu'annonc ont t touffes.
Selon ces derniers, les hypothses retenues dans le rapport sont systmati-
quement biaises et irralistes, et visent seulement habiller de la manire la
plus positive possible la transition vers la matrise des missions. Pour tre ralis-
tes, elles ncessiteraient que trois conditions soient runies : l'adoption d'une
politique internationale universelle, l'afflux immdiat et massif de capitaux en
faveur de technologies nouvelles, et l'absence de toute rsistance au change-
ment de la part des consommateurs.
Comme l'a montr cet ouvrage, un examen objectif des faits conduit penser
que ce n'est pas ainsi que les choses se passeront ! Contrairement ce que vou-
draient nous faire croire ceux qui cherchent nous culpabiliser, il n'existe pas
de solutions conomiques et aises mettre en uvre, auxquelles s'oppose-
raient des groupes de pression mus par le seul souci de leurs intrts, indiff-
rents au sort de la plante, et que les gouvernements n'oseraient pas combattre.
Pour se convaincre du caractre exagrment optimiste des conclusions offi-
cielles, il suffit de rappeler comment se prsente la situation pour chacun des
grands domaines qui sont l'origine des missions, en commenant par le plus
important d'entre eux.
1
International Herald Tribune, 5-6 mai 2007.
94
Que faire pour l'lectricit ?
Puisque la production d'lectricit par les centrales thermiques classiques
gaz et surtout charbon engendre plus de 40 % des rejets de gaz carbonique
d'origine nergtique, et que cette proportion ne cesse de crotre rapidement,
le bon sens indique que c'est cette cause qu'il faudrait s'attaquer en premier.
un terme aussi rapproch que possible, il faudrait faire en sorte que les futu-
res centrales lectriques ne rejettent plus rien dans l'atmosphre.
Pourtant, cette ventualit ne figure pas dans les conclusions prconises par
les experts des Nations unies. La raison en est simple : la seule solution qui soit
aujourd'hui disponible un cot raisonnable consisterait gnraliser la voie
franaise, c'est--dire la construction de centrales nuclaires, et d'arrter celle
de centrales thermiques classiques charbon ou gaz. Or cette hypothse est
expressment carte par les experts des Nations unies qui crivent, dans leur
rapport publi Bangkok, que la part de l'lectricit d'origine nuclaire
pourrait au mieux passer au niveau mondial de 16 % en 2005 18 % en 2030,
les problmes de scurit, de risque de prolifration des armes et de traitement
des dchets demeurant des contraintes .
Dans le mme lan, les mmes experts n'hsitent pas affirmer en revanche
que la part de l'lectricit d'origine renouvelable pourrait passer pendant la
mme priode de 18 % 35 %.
Il n'est pas besoin d'tre grand clerc pour voir que cette double affirmation
ne rsiste pas l'analyse. Personne ne peut croire un instant qu'il soit possible
de doubler ou presque la proportion de l'lectricit dite renouvelable ,
quand on connat les problmes quasi insolubles que pose l'nergie olienne
ou solaire, et quand on sait que les potentialits de l'nergie hydraulique sont
limites.
En revanche, il est impossible de comprendre pourquoi la seule vritable solu-
tion de masse pour viter les rejets de gaz carbonique l'occasion de la produc-
tion d'lectricit, c'est--dire la gnration par des centrales nuclaires, est car-
te a priori, car aucun des arguments avancs son encontre ne rsiste vrita-
blement l'analyse, comme l'a montr notre pays.
La situation est donc minemment paradoxale. Alors que la France a dmon-
tr qu'il tait possible grce la technologie nuclaire de produire de l'lectri-
cit sans rien rejeter dans l'atmosphre ou presque, cette solution n'est mme
pas voque srieusement par les instances internationales.
Il faut ajouter que, dans beaucoup de pays, la production lectrique est du
ressort d'organismes privs et indpendants qui ne dpendent pas directement
des tats, comme c'tait le cas en France avec EDF dans les annes soixante-dix
et quatre-vingt.
95
Face l'vidence, un nombre croissant de chefs d'tat, aux premiers rangs
desquels George Bush et Tony Blair, se sont pourtant ouvertement dclars fa-
vorables depuis peu une relance du nuclaire dans leur pays. Mais force est de
constater que leurs dclarations n'ont encore gure t suivies d'effet, mme si,
grce aux garanties financires promises par le gouvernement fdral, une tren-
taine de projets de centrales nuclaires nouvelles, relevant de 22 compagnies
diffrentes, sont annoncs aux tats-Unis. Les socits locales de production
d'lectricit hsitent se lancer dans l'investissement lourd que reprsente la
construction d'une centrale nuclaire, et ne le font pas sans des incitations fi-
nancires, ce qu'a compris George Bush qui s'est engag les mettre en place.
Faut-il ajouter que les opinions publiques trangres, victimes de campagnes
de dsinformation organises, sont le plus souvent hostiles l'implantation de
centrales nuclaires ? C'est particulirement le cas en Allemagne dont la politi-
que nergtique est aberrante alors que, parmi les pays dmocratiques, la Fran-
ce constitue seule ou presque une exception remarquable de ce point de vue.
Combien de temps faudra-t-il encore tolrer que l'Europe produise la majorit
(56 %) de son lectricit dans des centrales polluantes alors que nous avons
prouv qu'il tait possible de faire autrement ? L'Allemagne n'a-t-elle pas en
projet 40 centrales charbon ?
Mais, s'il est valable dans les pays occidentaux, l'argument de l'hostilit de
l'opinion publique ne tient videmment pas en Chine, en Inde et dans la plu-
part des pays mergents, c'est--dire prcisment l o il faudra construire au
cours des dcennies venir la grande majorit des nouvelles units de produc-
tion d'lectricit.
Pour eux, c'est le surcot financier des investissements qui s'oppose ce qu'ils
adoptent grande chelle l'lectricit d'origine nuclaire. Ils se contentent
alors d'actions symboliques, comme c'est le cas pour la Chine qui se propose de
faire passer la part de celle-ci de 1 % 4 % au cours des deux dcennies venir.
Il suffirait pourtant de relativement peu de chose pour que la balance conomi-
que penche en faveur du nuclaire, mais les pays dvelopps ne font rien pour
aider les pays mergents faire le bon choix.
Au total, sous l'influence du mouvement cologiste, l'humanit se prive ainsi
de sa marge de manuvre la plus importante pour lutter avec efficacit contre
le changement climatique.
Si l'on se souvient que seule une action massive peut entraner des effets signi-
ficatifs, il faut bien se rendre l'vidence : tout le reste n'est pour l'instant que
littrature.
96
Que faire pour les btiments ?
Faute d'avoir pris srieusement en considration l'nergie nuclaire, les ex-
perts des Nations unies classent alors au premier rang des possibilits d'action
de l'humanit les conomies d'nergie envisageables dans le secteur rsidentiel
et tertiaire.
Il est vrai que celui-ci est responsable d'une proportion importante des mis-
sions d'origine humaine des gaz effet de serre, et qu'il est donc ncessaire de
chercher rduire celle-ci. Mais les estimations des dpenses ncessaires prc-
demment voques dans ce livre aboutissent des chiffrages proprement gigan-
tesques qui sont hors de porte si l'on veut procder grande chelle pour iso-
ler le parc immobilier existant sur la plante. On comprend alors mal comment
les experts internationaux peuvent affirmer qu'il serait possible de diminuer de
plus de 5 milliards de tonnes par an les rejets de ce secteur pour un cot inf-
rieur 20 dollars, soit 15 euros, par tonne de CO
2
vite.
Faut-il le rappeler, les estimations officielles de l'Ademe aboutissent dans no-
tre pays un cot moyen de 750 euros par tonne pargne, soit cinquante fois
plus. Il y a l un mystre qui mriterait d'tre clairci, car il est difficile d'imagi-
ner que nos entreprises du btiment sont cinquante fois moins performantes
que les autres !
Le plus probable est malheureusement que dans leur souci de dmontrer que
les rductions d'missions taient aises atteindre dans ce domaine et peu
onreuses, les experts ont surestim dans des proportions considrables les pos-
sibilits d'action dans ce secteur essentiel et sous-estim d'autant les cots cor-
respondants.
Que faire pour les transports et l'industrie ?
Ils ne se sont en revanche pas tromps pour les transports en plaant ceux-ci
parmi les sources potentielles les moins importantes de rduction des missions.
Le dveloppement des changes est indispensable l'expansion conomique
du monde et la lutte contre la pauvret. Les transports continueront donc
s'accrotre, et notamment faire appel au ptrole qui est indispensable la
quasi-totalit d'entre eux, car les possibilits de substitution sont marginales.
C'est en fait la disponibilit du ptrole qui dictera l'volution des missions de
gaz carbonique imputables au secteur des transports au cours des dcennies
venir. La rduction unitaire de la consommation des camions, des voitures, des
avions et des bateaux se poursuivra, mais elle sera compense par l'accroisse-
ment continu du nombre des vhicules, et ce n'est pas sur les transports qu'il est
97
raisonnablement possible de compter pour limiter les missions de la plante.
C'est au contraire le secteur le moins compressible de tous, car la prosprit du
globe repose directement sur lui.
S'agissant de l'industrie, les experts internationaux estiment au contraire
juste titre qu'il sera possible, au moins pendant un certain temps, de rduire
encore leurs rejets relativement faible cot, car toutes les solutions techniques
sont loin d'avoir t mises en uvre.
Le secteur industriel serait notamment trs sensible une ventuelle taxa-
tion carbone qui pourrait conduire, selon le rapport de Bangkok, une dimi-
nution des rejets annuels de 4 milliards de tonnes de CO
2
si le niveau en tait
fix 100 dollars, soit 75 euros par tonne.
Mais, au total, un examen des travaux des experts des Nations unies aboutit
un rsultat diamtralement oppos ce que pourraient laisser croire leurs d-
clarations marques d'un optimisme infond. La lutte contre l'accroissement de
l'effet de serre, si elle est vritablement engage un jour, cotera trs cher et
ncessitera des dcisions courageuses.
Il faut d'ailleurs constater que les conclusions des experts runis par l'ONU
sont encore trs floues, ce qui n'a rien d'tonnant tant les incertitudes sont
grandes dans de nombreux domaines. Pour donner une ide de leur ampleur,
il suffit de relever que le rapport rendu public Bangkok ne craint pas de spci-
fier que les tudes de modlisation ont montr que la stabilisation des concen-
trations de gaz effet de serre aux alentours de 550 parts par million (ppm)
en 2100 tait cohrente avec une tarification de la tonne de gaz carbonique au
sein d'une fourchette allant de 30 155 dollars en 2050 ! On conoit aisment
que les dcideurs qui sont censes tre adresses des recommandations
d'une telle imprcision restent pour le moins perplexes. Si le cot moyen de la
tonne vite s'tablit 30 dollars, il suffira de dpenser 900 milliards de dol-
lars par an pour atteindre l'objectif d'une rduction de 30 milliards de tonnes.
Mais si l'on passe 155 dollars, c'est le montant pharaonique et inenvisageable
de prs de 5 000 milliards de dollars annuels qui serait ncessaire.
Et nous ?
Mais ce contexte d'une grande incertitude ne doit pas empcher notre pays
d'agir, d'autant que le nouveau chef de l'tat a fait de la lutte pour l'environ-
nement l'une de ses priorits et que nous avons des atouts que n'ont pas les au-
tres.
Parmi les grands pays, nous sommes les seuls pouvoir parler haut et fort, car
nous donnons l'exemple au monde. Faut-il le rappeler, avec six tonnes de CO
2
98
par habitant, nous mettons chaque anne deux fois moins que la moyenne des
pays dvelopps. Plutt que de chercher, pour l'essentiel en vain et un cot
prohibitif pour nos finances publiques, rduire nos maigres missions sur no-
tre territoire, nous avons vocation prendre la tte d'une croisade mondiale en
nous attaquant aux vraies causes de l'impuissance plantaire actuelle et en pr-
nant les vritables solutions, et non les fausses.
Notre action pourrait tre axe sur nos deux domaines d'excellence : la pro-
duction nuclaire de l'lectricit et la faible consommation de notre parc auto-
mobile.
S'agissant du premier d'entre eux, il nous revient d'expliquer aux autres
comment nous avons procd pour vaincre les obstacles psychologiques qui
s'opposent dans de nombreux pays l'implantation des centrales nuclaires, et
de leur demander de cesser d'urgence toute construction d'units classiques
charbon ou gaz, tant que ne seront pas mis au point des procds technique-
ment et conomiquement viables de capture et de squestration du gaz carbo-
nique, puisque c'est l la cause la plus importante des missions de gaz effet
de serre de la plante.
S'agissant de la Chine, de l'Inde et d'autres pays en dveloppement, pourquoi
ne pas envisager des incitations financires qui les aideraient faire le choix du
nuclaire ? L'argent ainsi dpens serait au moins dix fois plus efficace pour lut-
ter contre les missions que celui que nous consacrons aujourd'hui et en vain
au mme objet sur notre territoire.
Il nous faut aussi dnoncer clairement ceux des pays dvelopps qui s'oppo-
sent sans raison valable l'lectricit nuclaire, au premier rang desquels figure
l'Allemagne, et leur demander de mettre fin l'hypocrisie qui veut qu'ils se d-
clarent favorables la lutte contre l'effet de serre et agissent en contradiction
absolue avec leurs affirmations en menant le monde sur des voies sans issue. Car
ils mettent en danger l'avenir de la plante.
Notre pays a d'autant plus intrt prendre la tte d'une croisade mondiale
en faveur de l'lectricit nuclaire qu'il dispose d'une industrie puissante dans
ce domaine, mme si ce n'est pas l la motivation principale qui doit le condui-
re dans cette voie.
Il lui revient en dfinitive de faire cesser l'incohrence mondiale que consti-
tue la construction chaque anne de centaines centrales au charbon et au gaz
qui rduisent nant tous les efforts qui peuvent tre faits par ailleurs pour s'ef-
forcer de minimiser le changement climatique.
Bien entendu, si la France s'engageait dans cette voie, elle rencontrerait l'op-
position dtermine du mouvement cologiste, aussi bien national que mon-
dial, et en deviendrait la cible privilgie alors mme que son action serait la
plus favorable de toutes la cause de l'environnement.
99
C'est l un risque peser, mais qui ne devrait pas nous interdire de plaider
pour la raison, face un monde qui l'a largement perdue.
Inventer la voiture du futur
La faible consommation moyenne de nos vhicules routiers constitue le
deuxime des domaines dans lequel nous pouvons donner des leons au mon-
de. Pour un mme parcours, nos voitures consomment prs de deux fois moins
que celles qui circulent aux Etats-Unis alors qu'elles rendent des services identi-
ques. Aprs des annes d'inaction et de rsistance, le prsident Bush a dclar
en mai 2007 qu'il envisageait d'imposer aux constructeurs amricains une baisse
de la consommation moyenne des vhicules qu'ils mettent sur le march. Il res-
te souhaiter qu'il persiste dans cette voie, mme si la tche incombera plutt
son successeur.
Il faut aussi demander nos voisins allemands, nouveau marqus du sceau
de l'hypocrisie, de renoncer maintenir la vitesse libre sur certaines sections de
leurs autoroutes, ce qui conduit les constructeurs du monde entier concevoir
des voitures aptes rouler des vitesses interdites partout ailleurs, et donc inuti-
lement puissantes, chres, dangereuses et mettrices de gaz effet de serre. Il
vient un moment o les actes doivent enfin tre mis en accord avec les propos.
De rcents sondages n'indiqueraient-ils pas que l'opinion publique allemande
elle-mme se dclarerait maintenant favorable l'instauration de limitations
gnrales de vitesse sur ses autoroutes ?
Pourquoi ne pas inciter pour leur part nos constructeurs devenir les pion-
niers des voitures hybrides rechargeables, puisque celles-ci pourront fonction-
ner l'essentiel du temps avec leurs batteries, et ne consommer de carburants
fossiles qu' l'occasion d'une minorit des trajets ? Nous sommes le pays le
mieux plac pour donner l'exemple dans ce domaine. Grce la technologie
diesel qu'ils matrisent mieux que d'autres, nos constructeurs produisent dj
les vhicules les moins consommateurs sur l'ensemble de leur gamme. Nos fa-
bricants de batteries sont la pointe de la recherche mondiale. Enfin et surtout,
notre production d'lectricit ne s'accompagne pas de rejets de gaz effet de
serre dans l'atmosphre, contrairement ce qui se passe dans la quasi-totalit
des autres pays du globe o le recours des vhicules fonctionnant essentielle-
ment l'lectricit prsenterait, du point de vue des rejets de gaz carbonique,
un bilan sans intrt, les missions n'tant que dplaces voire accrues.
Nous sommes ainsi les seuls pouvoir mettre sur le march des voitures qui
consommeront en moyenne annuelle moins de 2 litres aux 100 kilomtres tout
en ne procdant aucun autre rejet de gaz effet de serre. C'est sans doute l
100
de surcrot la meilleure rponse l'puisement des gisements ptroliers, mme
si celui-ci n'est pas pour un futur proche. Subventionner nos constructeurs pour
qu'ils mettent au point rapidement des vhicules hybrides rechargeables est ce
que nous pouvons faire de mieux pour apporter une rponse mondiale la fois
la diminution des rserves de carburant et aux rejets de gaz effet de serre.
Enfin, nous pourrions contribuer beaucoup plus que nous ne le faisons la
recherche de solutions nouvelles. Les instances internationales sont en effet
unanimes sur un point : les efforts consacrs mondialement la recherche sont
encore insuffisants dans de multiples domaines, et une contribution massive-
ment accrue de nos laboratoires et de nos entreprises ne pourrait qu'tre la
bienvenue. L'argument financier ne saurait cet gard tre invoqu, car ce
n'est pas l'argent qui manque.
Cesser les gaspillages
Cesser de gaspiller par milliards d'euros l'argent du contribuable au prtexte
de la lutte contre l'effet de serre constitue en effet la plus vidente de nos prio-
rits. Il nous faut mettre fin aux multiples dpenses fantaisistes et ruineuses
auxquelles nous consentons sans compter, qu'il s'agisse de construire des o-
liennes qui gnrent indirectement du gaz carbonique et produisent de l'lec-
tricit au moment o nous n'en avons pas besoin, de subventionner nos agri-
culteurs au nom de la production de biocarburants qui, dans l'tat actuel des
techniques, ne peuvent jouer qu'un rle ngligeable, de subventionner tout et
n'importe quoi sous prtexte d'amliorer l'isolation de nos maisons, de faire
rouler des trains vides au nom de la lutte contre le changement climatique,
d'accrotre encore les sommes consacres sans espoir au ferroutage, de dve-
lopper sans fin des transports en commun qui n'ont jamais persuad les auto-
mobilistes de renoncer leur voiture, de bloquer la circulation dans nos villes
au mme motif et au dtriment de l'activit conomique et de la qualit de vie,
toutes actions dont le bilan est strictement ngatif et dont le cot se chiffre au
total plusieurs dizaines de milliards d'euros dpenss chaque anne par notre
pays sans raison et sans effet sur nos rejets.
Pour des sommes infiniment plus faibles, il nous serait possible de prendre un
rle de leader dans de nombreux secteurs de la recherche et, si le but poursuivi
est vraiment de rduire les rejets plantaires, d'aider financirement les pays
trangers rduire leurs missions.
La plupart des dpenses que nous consentons aujourd'hui sur notre territoire
au nom ou au prtexte de la lutte contre l'effet de serre pourraient tre sup-
primes sans qu'il en rsulte aucune diffrence significative pour le volume de
101
nos missions, et le potentiel des conomies est sans doute de l'ordre d'une di-
zaine de milliards d'euros par an. Au moment o l'quilibre de nos comptes
publics constitue une priorit nationale, il y a l une source d'conomies poten-
tielles insouponne. Il suffit pour s'en convaincre de penser l'ampleur de ce
que nous dpensons en vain au nom de la lutte contre l'effet de serre. Sans
doute un deux milliards par an pour les oliennes, bientt un milliard ou
deux pour les biocarburants, plus d'un milliard pour des subventions inefficaces
l'isolation des logements, etc.
Dans le domaine des transports ferrs et publics, le montant des subventions
publiques atteint vingt milliards, dont une large part pourrait tre vite, com-
me d'autres pays en ont apport la preuve, tel le Canada. On pense aux quatre
milliards d'investissements annuels en faveur des chemins de fer, qui vont bien-
tt doubler si l'on met en uvre les multiples projets labors par le RFF (R-
seau ferr de France) qui vient de recruter 800 collaborateurs cette fin. On
pense aussi aux 3,4 milliards d'euros consacrs par les rgions aux TER dont
bnficie rellement 1 % de leurs habitants, alors qu'un service de qualit sup-
rieure rsulterait d'un transfert sur route et ncessiterait dix fois moins d'argent
public.
Bien d'autres sources d'conomies existent, qui seraient rapidement mises en
vidence si tout ce qui touche l'cologie et aux transports ne faisait aujour-
d'hui l'objet d'un tabou, les seules forces de pression qui se manifestent ayant
toutes intrt accrotre sans fin les dpenses publiques et ponctionner le
contribuable au dtriment du bien commun et au bnfice d'intrts particu-
liers.
Qui osera demander aux services comptents non pas de faire des suggestions
pour accrotre sans cesse les dpenses, ce en quoi ils excellent, mais de se fixer
pour objectif d'pargner l'argent du contribuable ?
Il faut enfin souligner nouveau l'un des aspects essentiels de la lutte contre
les gaz effet de serre. Une tonne de gaz carbonique rejete quelque part en
France dans l'atmosphre a le mme effet pour la plante qu'une tonne mise
en Chine, aux tats-Unis ou en Inde. Il peut paratre choquant de dpenser no-
tre argent en Chine pour aider les Chinois limiter leurs missions plutt que
de le faire en France. Mais c'est l une raction errone. Si, pour un mme
nombre d'euros, nous pouvons viter le rejet dans l'atmosphre de dix ou vingt
fois plus de tonnes de gaz carbonique en Chine ou ailleurs qu'en France, notre
intrt national bien pens doit nous conduire y dpenser notre argent et non
dans l'Hexagone. Une fois en l'air, les molcules des gaz effet de serre ne portent pas de
drapeau.
102
Remettre nos ides l'endroit
Quant nous, en tant que citoyen, quelle conduite devons-nous adopter ?
Aussi dcevant que cela puisse paratre, la vrit conduit dire qu'il nous est
impossible d'avoir par notre action individuelle un impact quelconque sur un
phnomne aux dimensions aussi gigantesques que l'effet de serre.
Comme l'a montr le chapitre prcdent, la disproportion des ordres de
grandeur est telle que seuls les gouvernements des plus grands pays peuvent in-
fluer sur le cours des choses, s'ils en dcident ainsi.
Ceux qui souhaitent, titre individuel, se dvouer pour une cause qui en vail-
le la peine auraient mieux faire pour leur effort et leur argent que de le d-
penser en vain pour ce qu'ils croient tre la dfense de l'environnement. On
comprendrait l'angoisse de ceux qui militent pour sauver la plante s'ils ne
se trompaient pas de combat. Ce que la plupart d'entre eux cherchent bien en-
tendu sauver, ce n'est pas la plante, mais les hommes, les femmes et les en-
fants qui la peuplent et la peupleront. Il faut un grand dvoiement des ides
pour l'avoir oubli. Il y a peut-tre dans l'univers des milliers de plantes analo-
gues la ntre. Peu nous importe qu'elles soient sauves ou non ! quoi cela
sert-il l'enfant malien qui est en train de mourir du paludisme que nous ayons
la plus belle des plantes ?
Il n'est que temps de remettre nos ides l'endroit et de donner la priorit
pour nos actions individuelles, non pas au sort de la plante pour elle-mme,
mais celui des tres humains qui l'habitent, sans oublier ceux qui l'habiteront
plus tard. Fort heureusement, de ce point de vue, ce n'est pas l'inquitude mais
l'espoir qui l'emporte, comme le montrera le dernier chapitre de cet ouvrage.
Ds prsent, le progrs permet de sauver des millions de vies chaque anne.
C'est par milliards que les tres humains ne connaissent dornavant plus la faim
et qu'ils accdent une vie meilleure grce aux avances permises par le pro-
grs technique et l'conomie de march. Et, avec des moyens relativement limi-
ts, c'est galement par dizaines ou centaines de millions que nous pourrions
faire chapper d'autres tres humains la maladie, la malnutrition et la
mort.
Quelques chiffres mritent cet gard d'tre cits. L'Organisation mondiale
de la sant dispose d'un budget annuel de 1,1 milliard d'euros, la Croix-Rouge
internationale de 0,6 milliard, Mdecins sans frontires de 0,4 milliard, et la
Fondation Bill et Melinda Gates elle-mme de 2,5 milliards d'euros
1
. Au total
des organismes publics et privs qui uvrent pour amliorer la sant et la vie
des centaines de millions d'tres humains qui en ont un besoin urgent, ce sont
moins de 10 milliards d'euros qui sont disponibles chaque anne. Et pourtant,
1
L'Expansion, n
o
711, septembre 2006.
103
avec ces sommes l'ampleur relativement limite, des progrs insouponns
sont d'ores et dj enregistrs et des millions de vies supplmentaires sauves.
Les efforts de la communaut internationale portent parfois leurs fruits avec
une tonnante rapidit. De 1999 2005, selon l'Unicef, le nombre annuel des
victimes de la rougeole a rgress de 873 000 345 000 par an sur notre globe,
grce un programme massif de vaccination ! Cette chute peine croyable de
la mortalit a t obtenue au prix d'une dpense de 390 millions de dollars, es-
sentiellement apports par la Croix-Rouge. En six ans, ce furent ainsi plus d'un
million et demi de vies enfantines qui ont t sauves, ce qui met le prix de la
vie d'un tre humain au montant drisoire de 260 dollars, soit 200 euros. Aprs
avoir obtenu cette baisse inespre de 60 % en si peu de temps et mme
de 75 % en Afrique noire , l'Unicef estime qu'il faudra encore dpenser 500
millions de dollars pour ramener le nombre des victimes annuelles 80 000
en 2010, chaque vaccination cotant environ 1 dollar. L'radication complte
de ce flau ne parat ensuite plus impossible pour le tiers-monde, comme elle
l'a t pour les pays dvelopps il n'y a pas si longtemps.
Souvenons-nous maintenant des ordres de grandeur ncessaires pour tenter
de modifier les choses en matire d'effet de serre. Ce sont des centaines de mil-
liards de dollars qui sont ncessaires chaque anne pour esprer tre efficace.
Chacun peut voir que les ordres de grandeur n'ont rien voir, ce qui conduit
se demander o il faut que nous mettions par priorit notre argent.
O dpenser notre argent ?
Telle est la question qui a t pose d'une manire originale en mai 2004 un
panel de trente-huit professeurs d'conomie en provenance des meilleures uni-
versits du monde, dont quatre prix Nobel, par un cologiste danois, Bjorn
Lomborg, que la revue Newsweek a class parmi les cent personnes les plus in-
fluentes de la plante : Si vous disposiez de 50 milliards de dollars pour am-
liorer le sort de l'humanit, quelles fins vaudrait-il mieux les affecter ?
Dix-sept mesures furent proposes, et des experts de chacune d'entre elles
vinrent exposer en dtail et objectivement ce qu'elles impliquaient, ce que se-
rait leur cot et les rsultats qu'il serait possible d'en esprer. Aprs avoir lon-
guement entendu les uns et les autres, les trente-huit conomistes sont arrivs
un consensus dpourvu d'ambigut, intitul depuis lors consensus de Co-
penhague du fait du lieu o ils taient runis. On trouve sans surprise aux
premiers rangs de leurs recommandations la lutte contre le sida, la distribution
de complments nutritionnels pour combattre la faim, le contrle du paludisme
et le dveloppement de nouvelles techniques agricoles, toutes mesures suscepti-
104
bles de sauver des millions d'tres humains. Affecter 27 milliards de dollars la
lutte contre le sida permettrait ainsi d'viter de l'ordre de 28 millions de nou-
veaux cas, et le bnfice en termes conomiques serait alors quarante fois sup-
rieur la dpense !
Ce n'est qu'aux derniers rangs de leur classement que figurent les deux me-
sures de la liste relatives la lutte contre le changement climatique : la cration
d'une taxe sur le carbone et la mise en uvre du protocole de Kyoto. Les cal-
culs montrrent en effet que, pour seulement appliquer correctement ce der-
nier au niveau de la plante, il faudrait dpenser 125 milliards d'euros chaque an-
ne pendant le sicle actuel, avec pour seul effet de dcaler de six ans la concentra-
tion des gaz effet de serre dans l'atmosphre en reportant 2106 le niveau qui
aurait d tre atteint en 2100, ce qui n'aurait bien entendu aucun effet notable
sur le sort de l'humanit. Y affecter 50 milliards d'euros de plus ne servirait
rien
1
.
On peut le regretter, mais c'est ainsi. Les sommes ncessaires pour avoir une in-
fluence significative sur l'volution du climat sont gigantesques, la mesure du rle que
joue l'nergie dans l'conomie mondiale. Il faudra bien qu'un jour l'humanit en
prenne conscience et consente aux efforts ncessaires. Mais ds prsent, et
avec des montants incomparablement plus faibles, il est possible de changer
sans tarder le sort de millions d'tres humains et de les faire chapper la fami-
ne, la maladie et la mort.
Il est d'ailleurs intressant de noter que tous ceux, d'origines trs diverses,
coliers ou chefs d'tat, qui ont t exposes ainsi les donnes du problme
sont arrivs aux mmes conclusions, c'est--dire la priorit donner aux ac-
tions humanitaires. Comment serait-il possible d'hsiter ? C'est bien ce qu'ont
compris Bill Gates et Warren Buffett qui tiennent ce que l'argent de leur fon-
dation soit dpens meilleur escient et donc uniquement affect des causes
humanitaires. C'est galement ce qu'ont compris les Nations unies, comme l'a
rappel la Dclaration du millnaire adopte par les chefs d'tat du monde en-
tier New York en 2000.
Incits par les pouvoirs publics, certains croient pourtant bien faire en dpen-
sant des sommes considrables, par exemple pour mieux isoler leur demeure,
ce qui n'vitera le rejet dans l'atmosphre que d'une ou deux tonnes de gaz
carbonique par an pour un cot prohibitif qui excdera parfois 1 000 euros par
tonne pargne. Au-del de quelques travaux de bon sens et conomiques, ils
gaspillent leur argent.
1
Bjorn Lomborg, How to spend 50 billion to make the world a better place .
105
A titre individuel, le choix ne fait gure de doute. Si nous souhaitons nous d-
vouer pour une cause qui en vaille la peine et sauver sinon la plante, du moins
ceux qui y habitent et l'habiteront demain, c'est en faveur des nombreuses ac-
tions humanitaires qui s'offrent nous qu'il faut le faire.
106
CHAPITRE IX
L'air que nous respirons
Rien n'est plus important pour chacun d'entre nous que l'air que nous respi-
rons. Faire croire que celui-ci est de plus en plus pollu et dangereux pour no-
tre sant constitue donc l'une des voies majeures d'attaque contre une socit
qui engendrerait des morts par milliers du fait de ses industries et de ses vhicu-
les.
L'histoire de la lutte contre la pollution toxique de l'air dans nos villes est la
fois celle d'un succs remarquable et celle d'un chec plus remarquable encore.
Un succs sans prcdent
La pollution toxique de l'air est apparue ds le dbut de l're industrielle avec
l'usage du charbon. Elle a culmin dans les annes cinquante. Les plus anciens
d'entre nous se souviennent que Paris tait alors couvert, pratiquement en
permanence, d'un voile noirtre engendr par des centaines d'usines qui reje-
taient des fumes allant du noir l'orange en passant par toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel, et par des centaines de milliers de chemines d'immeubles chauf-
fs au charbon. Comme en tmoignent les films et les cartes postales de l'po-
que, tous les btiments taient couverts de suie. Un livre clbre sur l'architec-
ture fut publi sous le titre Quand les cathdrales taient blanches, car on ne les
avait jamais connues que noires. Nous savons maintenant qu'elles taient pein-
tes au Moyen ge, mais l'auteur l'ignorait. C'est aujourd'hui qu'elles sont blan-
ches, pour la premire fois de leur histoire.
Le phnomne n'tait pas spcifiquement franais. En 1953, un pisode du
fameux smog, mlange de brouillard et de fume, tua plus de 3 000 Londo-
niens. Les concentrations d'oxydes de soufre et de suie atteignaient alors Paris
comme ailleurs des niveaux dont nous n'avons aucune ide aujourd'hui. Il tait
impossible de poser les mains sur un balcon sans qu'elles soient instantanment
noires.
Des politiques trs vigoureuses de lutte contre la pollution furent alors mises
en uvre dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, avec l'diction de nor-
107
mes svres pour les missions industrielles et celles des immeubles. Parallle-
ment, les usines quittrent les centres-villes et le charbon fut remplac par des
combustibles beaucoup moins polluants (gaz, mazout dpollu) ou par l'lec-
tricit, et il s'ensuivit une chute massive des pollutions correspondantes. Le taux
d'oxydes de soufre dans l'air Paris a t divis par dix entre 1960 et aujour-
d'hui, et il en a t de mme pour les suies. Pour sa part, le smog londonien
cher Charles Dickens a disparu jamais, et avec lui les maladies qui provo-
quaient rgulirement des morts par milliers.
Des voitures quasi propres
La pollution toxique de l'air imputable la circulation routire a connu une
volution plus tardive. L'amlioration des moteurs et des carburants avait com-
menc de longue date, mais tout s'est brutalement acclr au dbut des annes
quatre-vingt-dix, avec d'abord la gnralisation des pots catalytiques en 1993
pour les voitures essence et en 1997 pour les voitures diesel.
Des rsultats inesprs que seule a rendu possible l'irruption de l'lectroni-
que dans les moteurs ont alors t atteints. Selon les produits, une automobile
mise aujourd'hui sur le march met vingt fois dix mille fois moins de polluants
toxiques qu'un vhicule d'il y a quinze ans. S'agissant des voitures essence,
c'est une division par 25 pour le monoxyde de carbone qui a t enregistre,
par 40 pour les oxydes d'azote, et par 20 pour le benzne. Quant au plomb et
au soufre, ils ont entirement disparu des rejets puisque l'essence est dsormais
sans plomb et le gas-oil sans soufre.
Les progrs ont galement concern les vhicules diesel, et les annes rcen-
tes ont t marques par l'apparition de filtres particules qui brlent celles-ci,
y compris les plus fines, et en divisent les missions par un facteur qui peut at-
teindre 10 000. Comme l'ont constat il y a quelques annes les revues alleman-
des spcialises en comparant les voitures Mercedes mises sur le march et non
quipes, et celles du groupe franais PSA qui inventa le premier les filtres
particules, il faut 10 000 voitures quipes de tels filtres pour mettre autant de
particules qu'une seule voiture non quipe ! Un mouchoir blanc plac aujour-
d'hui derrire le pot d'chappement d'un vhicule diesel ainsi dot reste im-
macul ! Ne rejetant pratiquement plus de produits toxiques, les voitures mo-
dernes sont ainsi devenues propres l'gard du facteur qui proccupe le plus
nos compatriotes, notre sant.
Il faut ce sujet lever une ambigut. La confusion est souvent faite entre la
pollution toxique qui est le fait de produits tels que les oxydes de soufre, le
plomb, les hydrocarbures non brls, les oxydes d'azote ou le monoxyde de car-
108
bone (CO), et les gaz effet de serre qui ne prsentent aucun danger pour la
sant et dont le plus important est le dioxyde de carbone ou gaz carbonique
(CO
2
). Or ces deux catgories de produits n'ont rien voir.
Souvent entretenue dessein, cette confusion entrane de nombreux malen-
tendus. S'il est possible de lutter avec une efficacit pratiquement totale contre
les missions toxiques des vhicules, ce n'est pas le cas pour le gaz carbonique
qui est un sous-produit incontournable de la combustion des hydrocarbures. Le
fait que le gaz carbonique continue tre mis quoi qu'on fasse ne devrait pas
entraner de craintes pour notre sant, puisqu'il s'agit d'un produit naturel que
nous rejetons d'ailleurs en permanence en respirant et qui ne reprsente aucun
risque l'air libre. Mais la grande majorit de nos compatriotes et des journalis-
tes eux-mmes confond la pollution toxique et les rejets de CO
2
qui n'ont au-
cun impact sur la qualit de l'air que nous respirons.
Avec le renouvellement progressif du parc automobile et la chute des rejets
toxiques qu'elle implique, les progrs des vhicules se sont logiquement traduits
dans les pays dvelopps par une amlioration de la qualit de l'air d'autant
plus spectaculaire que l'volution de la circulation y est dsormais trs modre
et qu'elle dcrot dans les zones centrales des agglomrations europennes,
comme c'est le cas Paris intra-muros depuis plus de dix ans.
La pollution toxique en chute brutale
En huit ans seulement, de 1997 2005, les rductions suivantes des concen-
trations ont t enregistres par l'observatoire officiel Airparif dans l'air de la
capitale franaise : moins 56 % pour le monoxyde de carbone ; moins 43 %
pour les oxydes d'azote ; moins 56 % pour le dioxyde de soufre ; moins 29 %
pour les particules ; moins 95 % pour le plomb, moins 77 % pour le benzne,
etc. En moyenne, la rduction de la pollution a t de plus de moiti Paris en huit ans
et elle se poursuit de nos jours. Il ne s'agit pas d'une diminution, mais d'une chute
brutale, et les rsultats sont tout aussi spectaculaires en province.
De nombreux indices en tmoignent. Lorsqu'ils sont ravals, nos monuments
et nos immeubles ne se salissent plus que trs lentement, alors qu'il fallait autre-
fois renouveler frquemment l'opration. Sans qu'ils s'en rendent compte, nos
contemporains peuvent admirer nos villes comme jamais ne l'ont fait leurs pr-
dcesseurs. Jamais elles n'ont t aussi belles. Pour leur part, les lichens, trs
sensibles la pollution et qui, sous Napolon III, avaient disparu des arbres
bordant les avenues parisiennes, y sont revenus en masse depuis quelques an-
nes.
109
Le progrs n'est pas uniquement europen. Il devient mondial. Le ciel de Los
Angeles, longtemps pollu par les missions automobiles, est redevenu transpa-
rent. Le mouvement est universel, et la diffusion du progrs technique est par-
tout en train de purifier des manations de la circulation routire l'air que res-
pirent nos contemporains, la rapidit des amliorations dpendant des circons-
tances et des moyens disponibles.
En France et en Europe, le progrs va continuer au fur et mesure du renou-
vellement du parc de vhicules. Comme l'ont montr les tudes conduites par
la Commission de Bruxelles, les concentrations imputables l'automobile vont
tendre vers zro et seules subsisteront alors d'autres sources de pollution.
Certes, il ne faut pas s'attendre ce que les pics d'ozone disparaissent pour
autant, car la circulation automobile n'intervient que de manire trs minoritai-
re dans leur gense qui est principalement due d'autres causes puisqu'ils ap-
paraissent partout en France, y compris, par exemple, en Bretagne. Mais ces
pics d'ozone eux-mmes sont dornavant d'intensit plus modre que par le
pass, leur composante automobile ayant pour l'essentiel disparu.
L'une des confirmations les plus spectaculaires de la rapidit des amliora-
tions en cours est fournie par les changements de la rglementation. labore
en 1997, celle-ci prvoyait que la circulation alterne serait dclenche dans nos
villes lorsque la concentration de dioxyde d'azote y dpasserait 400 micro-
grammes par mtre cube, niveau couramment franchi il y a quelques annes. Le
progrs a t si rapide que le seuil de dclenchement a t abaiss en 2001
200 microgrammes par mtre cube sans que cela ait entran depuis lors la
moindre mise en uvre de la procdure, comme chacun a pu le constater, car
les pics ont encore rgress de plus de moiti depuis lors.
Deux rapports de l'Assemble nationale et du Snat labors en 1999 et 2000
ont fait part de l'tonnement de leurs auteurs lorsqu'ils ont dcouvert la ralit
des choses et constat la rapidit de l'amlioration de la qualit de l'air dans nos
villes, alors qu'ils taient convaincus qu'elle se dgradait. Le titre de celui du
Snat, Un air trompeur ? , est lui seul rvlateur.
Il rsulte de la chute progressive des missions imputables la circulation rou-
tire que leur impact sur la sant est en voie de disparition et que toutes les tu-
des alarmistes qui se rfrent au pass et proclament le contraire ne sont plus
valables. C'est videmment l l'essentiel. Si la cause disparat, il en va de mme
des effets, et nos compatriotes peuvent tre dsormais pleinement rassurs pour
leur sant.
110
Un chec total sur le plan de l'opinion
En quelques annes, le progrs technique a donc russi faire brutalement
chuter la pollution toxique dans l'air de nos villes. Celui-ci est plus pur qu'il ne
l'a jamais t depuis le XIX
e
sicle et le succs est de ce point de vue remarqua-
ble.
Mais, ce qui est plus remarquable encore, c'est l'chec enregistr sur le plan
de la perception du phnomne par nos compatriotes. Cet chec est d'une am-
pleur peine croyable. Alors que l'amlioration a t fulgurante au cours de la
dernire dcennie et qu'elle se poursuit, nos concitoyens, interrogs en
avril 2006 par l'institut Ipsos sur l'volution de la pollution dans nos grandes
villes, ont exprim une opinion bien diffrente : 68 % d'entre eux ont affirm
qu'elle augmentait, 28 % qu'elle stagnait, 3 % qu'elle diminuait un peu, et 1 %
qu'elle chutait beaucoup.
Autrement dit, l'chec est total. Les rsultats ne sont gure diffrents de ceux
du mme sondage, ralis en 1993 avec la mme question, et qui donnait res-
pectivement les pourcentages suivants : 73 %, 25 %, 17 %, 6 % et 1 %.
Autrement dit encore, les progrs fulgurants raliss depuis plus de dix ans
n'ont servi rien sur ce plan. Seuls 1 % des Franais savent aujourd'hui la rali-
t, c'est--dire la chute brutale de la pollution enregistre dans toutes nos vil-
les. 99 % des Franais sont dans l'erreur.
Les jeunes sont tout particulirement marqus. 97 % d'entre eux considrent
que la pollution de l'air est un problme grave et 54 % lui attribuent mme un
caractre trs grave
1
. Ayant eu un jour l'occasion de dire un enfant d'une
dizaine d'annes que j'habitais Paris, celui-ci me rtorqua aussitt : Pouah, la
pollution ! Notre capitale tait autrefois la Ville lumire. Nous avons russi
lui donner auprs de nos enfants l'image de la Ville pollution et de la Ville
congestion . Brillant succs qui procure coup sr aux jeunes gnrations une
vision positive du progrs !
On peut juste titre parler de psychose, quand on sait que les Franais pla-
cent rgulirement dans les sondages la pollution de l'air ambiant au premier
rang des dangers qui menacent leur sant, alors qu'elle est en voie de quasi-
disparition en ce qui concerne sa composante automobile. La ralit commence
seulement percer. C'est l'intrieur des locaux, o nous passons en moyen-
ne 23 heures sur 24, que l'air est souvent pollu. Les mdecins ne recomman-
dent-ils pas d'ouvrir les fentres, preuve s'il en est que le danger n'est pas l'ex-
trieur ?
1
Sondage Sofres/FFAC, septembre 2000.
111
Une dsinformation organise
Un tel sommet dans la dsinformation n'est pas le fruit du hasard. Il est le r-
sultat d'actions conjointes et dtermines de la part de groupes de pression
qu'il n'est pas difficile d'identifier lorsqu'on cherche savoir qui profite le
travestissement des faits.
Le premier d'entre eux est celui des mouvements et des partis cologistes. Un
autre sondage, tout aussi parlant, est cet gard rvlateur
1
. La pollution de
l'air figure en tte des motivations du vote cologiste. 17 % des Franais ont d-
j vot au moins une fois cologiste et 33 % ont t tents de le faire, soit 50 %
de l'lectorat au total. Or, parmi cette moiti de l'lectorat, 45 % citent la pollu-
tion de l'air comme cause premire de leur ventuel vote cologiste, loin devant
la pollution de l'eau ou la crainte du nuclaire, et 85 % la placent parmi leurs
deux premires motivations.
La crainte de la pollution de l'air constitue ainsi le premier fonds de commer-
ce du vote vert, et l'on comprend tous les soins de ceux qui font profession de
l'cologie pour l'entretenir. Ils citent celle-ci dans tous leurs discours ou pres-
que, et dveloppent des efforts considrables et couronns de succs pour que
la vrit soit cache et travestie. Ds qu'il y a le moindre pic de pollution, ft-il
modeste, ils sont omniprsents sur les ondes et les crans. Bien entendu, ils ou-
blient de dire que ce pic correspond souvent aux creux enregistrs il y a quel-
ques dcennies. Le rsultat a t la hauteur de leurs efforts, puisque le vote
cologiste a atteint dans le pass en France des sommets inconnus jusqu'alors.
Les mmes, lorsqu'ils sont au pouvoir dans les municipalits, ne cessent, Pa-
ris et ailleurs, de vilipender la voiture, responsable de dizaines de milliers de
morts du fait d'une pollution qui a pour l'essentiel disparu, et refusent, lors-
qu'on les interroge, de reconnatre l'amlioration de la qualit de l'air de nos
villes qui dcoule des progrs techniques des vhicules et des carburants.
Dans leur action de dsinformation permanente, les cologistes peuvent
compter sur des renforts de poids.
Des services officiels qui dsinforment
Le premier est celui des services officiels en charge de l'Environnement et du
rseau des observatoires de la qualit de l'air qui quadrille dsormais la France.
Rcemment crs, ces observatoires sont au nombre de 40, couvrent 100 ag-
glomrations, et 325 fonctionnaires ont t spcialement recruts pour les g-
rer.
1
Sondage Ipsos/FFAC, octobre 2001.
112
La plupart du temps et sauf exceptions, ces observatoires n'ont plus rien ob-
server. Ils constatent que la pollution est en chute, mais leurs responsables ne le
disent pas, ou le disent de manire ne pas tre entendus. Jamais ils ne parlent
de l'amlioration des choses. Proclamer la vrit reviendrait dire que ces ob-
servatoires ne sont plus ncessaires et qu'il suffirait de quelques appareils enre-
gistreurs pour relever de manire automatique des phnomnes tels que les pics
estivaux d'ozone, d'autant plus que ceux-ci n'ont le plus souvent rien de local
mais sont rgionaux, voire internationaux. Or on ne peut tout de mme pas
demander ceux qui travaillent dans ces organismes de reconnatre que leur
emploi ne rpond aucun besoin ! Chacun a le droit de pouvoir se regarder
dans la glace.
On peut donc compter sur ceux qui uvrent au sein de ces observatoires, ain-
si que sur les centaines de fonctionnaires des services centraux et locaux de
l'Environnement et des tablissements publics spcialiss, pour sonner le tocsin
aux moindres fluctuations de la pollution et pour cacher l'essentiel, c'est--dire
l'amlioration fulgurante de la qualit de l'air que nous respirons.
Le paradoxe veut que la mission premire de tous ces organismes et de ceux
qui y travaillent soit d'informer l'opinion, et que le rsultat le plus clair de leur
action soit une totale dsinformation, puisque 99 % de nos compatriotes sont
dans l'erreur.
Quant l'Ademe, agence officielle en charge de l'environnement, elle traves-
tit tellement la ralit qu'on peut parler de mensonge. On peut lire par exem-
ple en novembre 2006 sur son site Internet, dans la page de prsentation consa-
cre aux transports, que la diminution des consommations et des missions
unitaires des vhicules routiers est compense par l'accroissement trs fort des
trafics routiers, tant toute possibilit la France de respecter ses engagements
internationaux en matire d'effet de serre .
Or tout est faux. La circulation n'augmente plus gure en France (555 mil-
liards de kilomtres parcourus en 2005 contre 523 en 1999, soit 1 % de crois-
sance par an), les missions de gaz carbonique du trafic routier sont stabilises
(124 millions de tonnes en 2006 contre 126 en 1999) et la France fait mieux
que respecter ses engagements en matire d'missions de gaz effet de serre.
Quand l'idologie l'emporte sur la vrit chez ceux qui sont rmunrs par les
deniers publics pour informer, il ne s'agit pas de simples dysfonctionnements. Il
faut dire que le fait de parler tous les jours la tlvision de la pollution de l'air
dans le cadre des journaux rgionaux ne peut qu'accrditer l'ide qu'il y a dan-
ger. Sinon, pourquoi le ferait-on ?
113
Le lobby des transports publics
Le deuxime renfort sur lequel peuvent compter les cologistes est constitu
par les organismes de transport public. Ces derniers sont dans une situation fi-
nancire dramatique, puisque les usagers n'acquittent que 18 % des dpenses
totales des rseaux de province et gure plus en le-de-France, et que la charge
pour les contribuables ne cesse de s'accrotre. La voiture assure en effet en pro-
vince de 80 % 90 % de l'ensemble des dplacements motoriss et les trans-
ports en commun ne sont utiliss pour l'essentiel que par ceux qui n'ont pas
accs une voiture. Leur part du march des dplacements stagne donc le plus
souvent aux alentours de 15 %, quand elle ne dcrot pas. Ceci se vrifie mme
dans les villes qui ont consenti des efforts considrables pour se doter de mtros
ou de tramways, car ceux-ci n'ont jamais rien chang de marquant l'usage de
la voiture dans les agglomrations qu'ils desservent. Il faut se rendre l'viden-
ce : la voiture est le transport de masse et le transport social de notre poque.
Face cette situation qui s'aggrave d'anne en anne, et pour justifier leurs
demandes sans cesse croissantes de crdits publics, les dfenseurs des transports
en commun et du chemin de fer mettent systmatiquement en avant l'argu-
ment de l'accroissement suppos de la pollution de l'air provoque par la circu-
lation routire qui, s'il fut vrai dans le pass, ne l'est plus aujourd'hui. Mais, dis-
posant des moyens humains et financiers illimits que permettent des finance-
ments publics, ils sont omniprsents, organiss, et savent se faire entendre.
Des mdecins dsavous
Il faut ajouter cette liste un petit nombre de mdecins qui ont vu tout l'int-
rt qu'ils pouvaient retirer d'un sujet aussi sensible l'opinion. Ils ne sont pas
plus de quatre ou cinq en France, constamment contredits par l'Acadmie de
mdecine et l'Association franaise de pneumologie dont les membres savent
que les problmes rels de sant publique auxquels ils sont quotidiennement
confronts dans le domaine des maladies respiratoires sont lis l'usage du ta-
bac et la pollution des espaces clos, et non celle de l'air extrieur. Mais les
mdecins srieux sont en gnral discrets et ce sont toujours les mmes qui oc-
cupent les mdias, parfois sous couvert de l'OMS, et mettent des messages
alarmistes qui entretiennent, en parlant de milliers ou de dizaines de milliers de
morts imaginaires, des peurs dornavant infondes. Pourtant, il est clair que si
la pollution de l'air ambiant imputable la circulation automobile est en voie
de disparition, celle-ci ne peut plus avoir d'impact nocif majeur sur la sant !
114
Jamais nous n'avons vcu aussi longtemps, et il y a mme moins de maladies
pulmonaires dans nos grandes villes qu'ailleurs.
Une convergence d'intrts politiques
Outre les cologistes, les deux autres composantes de la gauche plurielle se
retrouvent enfin d'accord avec les cologistes lorsqu'il s'agit d'attaquer la voitu-
re et le camion. Les socialistes prfrent d'instinct les solutions collectives cel-
les qui sont individuelles. Quant au parti communiste, chacun sait que le che-
min de fer et les transports publics ont toujours constitu l'un de ses premiers
viviers de recrutement par le canal de la CGT.
L'alliance objective des cologistes, des autres partis de gauche, des services
officiels de l'Environnement et des promoteurs des transports publics appuys
par un petit noyau de mdecins a cr un vritable rouleau compresseur de d-
sinformation, qui explique la psychose rvle par les sondages puisque 99 %
des Franais ignorent la vrit.
Face cette dsinformation, il n'y a rien.
L'absence de contre-pouvoir
On aurait pu normalement s'attendre ce que les partis situs sur l'autre ver-
sant de l'chiquier politique contestent les arguments qui sont favorables leurs
adversaires, et disent la vrit pour informer les Franais sur un sujet qui leur
tient particulirement cur puisqu'il s'agit de leur sant et de celle de leurs
enfants. Non seulement ils ne l'ont pas fait, mais ils en ont rajout, comme en
tmoigne la description d'actions qui se sont rvles suicidaires pour eux.
La loi sur l'air de 1996, vote par un Parlement de droite, a t ainsi particu-
lirement nfaste. Elle fut l'occasion de grandes dclarations de la part de la
ministre de l'Environnement de l'poque dnonant les lobbys industriels cen-
ss s'opposer l'amlioration de l'environnement, au moment mme o des
milliers d'ingnieurs et techniciens des firmes automobiles et ptrolires travail-
laient en France et ailleurs sans relche et avec succs pour que les vhicules et
les carburants ne polluent pratiquement plus. Chacun savait d'ailleurs au mo-
ment du vote de la loi que la qualit de l'air allait s'amliorer rapidement et
qu'il ne servait rien de sonner le tocsin.
Le discours tenu ne se diffrenciait en rien du langage de ceux qui font m-
tier de dnigrer notre socit. Rpondant aux vux les plus chers des cologis-
tes, le premier article de cette loi stipule d'ailleurs que l'objectif premier des
115
plans de dplacements urbains doit tre la rduction du trafic automobile .
Apparemment sduisant, cet objectif est la fois impraticable et nuisible.
Il est impraticable parce que le parc automobile continue se dvelopper au
fur et mesure que de plus en plus de foyers acquirent une seconde voiture.
Pour que, globalement, la circulation diminue dans nos agglomrations, il fau-
drait soit freiner la vente des voitures, soit doubler ou tripler le prix des carbu-
rants, hypothses fort heureusement aussi irralistes l'une que l'autre. Elles p-
naliseraient lourdement l'conomie avec tout ce que cela reprsente en termes
d'emploi et de chmage et provoqueraient la rvolte de la majorit de nos
concitoyens, car la voiture est un lment essentiel de leur qualit de vie.
Mais l'affichage d'un objectif officiel de rduction de la circulation a eu des
consquences trs graves. Dans toute la France, de multiples municipalits se
sont mises, sous prtexte de dfense de l'environnement, rendre de plus en
plus difficile l'usage de la voiture, oubliant que celle-ci tait le moyen de trans-
port quotidien de la grande majorit des Franais dont elle assure prs de neuf
dplacements motoriss sur dix, toutes catgories sociales confondues. Le rsul-
tat de cette politique idologique initie par la droite a t particulirement n-
faste Paris.
L'intoxication des esprits
On entend de mme des maires de grandes villes de province affirmer que
leur objectif est de dsintoxiquer leurs administrs de la voiture. Manifeste-
ment, ceux qui tiennent ce langage n'ont aucune ide de la manire dont vi-
vent aujourd'hui les Franais et les Franaises. Ils ne savent pas que leur vie est
dornavant organise autour de l'automobile, et que seule une petite minorit
favorise habitant les centres-villes et compose essentiellement de personnes
privilgies ou non actives peut s'en passer.
S'il est possible, ceci est encore plus vrai pour les femmes que pour les hom-
mes. L'arrive dans le foyer d'une deuxime voiture amliore profondment
leur vie en leur ouvrant de multiples potentialits qui leur taient auparavant
fermes. D'aprs un sondage reprsentatif
1
, 69 % de celles qui en ont une leur
disposition l'utilisent tous les jours ou presque, et 14 % trois ou quatre fois par
semaine, pour un total de 83 % d'usage trs frquent. Leur voiture est alors uti-
lise par les femmes pour aller faire des achats (96 %), rendre visite aux parents
et aux amis (95 %), partir en vacances (82 %), sortir le soir (79 %), aller travail-
ler (78 %), partir en week-end (77 %), conduire les enfants chez le mdecin
1
Sofres/FFAC, septembre 1999.
116
(76 %), les accompagner pour les activits extra-scolaires (71 %), faire du sport
(39 %), etc.
Certes, lorsqu'on demande aux mmes Franaises s'il serait souhaitable d'in-
terdire la voiture en ville, 80 % rpondent positivement car elles ne se sentent
pas directement concernes. Mais lorsqu'on pose la question diffremment, en
leur demandant si elles seraient d'accord pour qu'on interdise la voiture dans
leur propre quartier, le pourcentage d'approbation tombe 10 %. 60 % d'entre
elles ajoutent mme qu'elles dmnageraient sans hsiter ! On voit l toute la
diffrence entre une question abstraite, qui n'engage en rien la personne inter-
roge, et une autre qui porte sur une situation concrte, vcue, et qui, quant
elle, a toute sa signification. Lorsqu'on se contente d'interroger nos compatrio-
tes sur leurs souhaits , il ne faut pas s'tonner de trouver ceux-ci dmentis
ensuite par les comportements.
Il n'est pas surprenant que 94 % des femmes qui ont une voiture dclarent
l'aimer, dont 55 % beaucoup. Sans la voiture, il leur serait impossible de mener
de front toutes leurs activits et l'automobile contribue ainsi puissamment leur
qualit de vie. Elle leur permet notamment de concilier l'occupation d'un em-
ploi et le fait d'avoir des enfants, ce qui est un des lments explicatifs de notre
natalit. Qu'y a-t-il l de mal ? Les politiques anti-voitures sont aussi des politi-
ques anti-fminines.
Traiter d'intoxiqus la quasi-totalit de nos compatriotes, c'est--dire compa-
rer la voiture une drogue, montre quel point la perversion des esprits est au-
jourd'hui profonde. La vrit c'est que ce sont les esprits qui sont aujourd'hui
intoxiqus par le politiquement correct ambiant.
Une attitude suicidaire
C'est en vertu de cette manire de voir que le maire de Paris de l'poque,
Jean Tiberi, n'a cess de dnoncer partir de 1995 la gravit de la pollution de
l'air imputable la circulation, au moment mme o celle-ci dbutait sa chute
prvisible, et de dresser les premiers obstacles l'usage de la voiture, notam-
ment en crant des pistes cyclables, y compris dans des endroits o, de mmoire
de Parisien, on n'avait jamais vu de cycliste et o on n'en voit toujours pas. Paris
n'a t en rien une exception. Bien d'autres villes en firent tout autant, s'ing-
niant compliquer la vie des automobilistes, comme s'il ne s'agissait pas de pra-
tiquement tous les citoyens.
En renchrissant sur les cologistes et en agitant le spectre de la pollution, les
reprsentants nationaux et locaux de la majorit de l'poque ont sans doute cru
bien faire. Peut-tre ont-ils voulu attirer eux l'lectorat cologiste. Si telle tait
117
leur intention, le rsultat se passe de commentaires. Les scores des listes colo-
gistes ont atteint des niveaux sans prcdent lors des lections lgislatives
de 1997, des rgionales d'le-de-France en 1998, des municipales de Paris et de
Lyon en 2001, toutes perdues d'extrme justesse par la droite. Paris, le vote
cologiste a largement dpass 10 %.
Loin d'attirer elle les voix cologistes, l'attitude de la majorit de l'poque a
fait voter vert des lecteurs qui auraient vot pour elle. Selon le sondage Ipsos
dj cit, 8 % des lecteurs de droite ont vot au moins une fois cologiste, car il
est une rgle bien connue en matire lectorale : l'original est prfr la co-
pie.
Les consquences de cette attitude de la droite ont t trs lourdes pour elle.
Pour chacune des lections cites ci-dessus, le rsultat s'est jou moins
de 0,5 % des voix. Or cette marge a t trs infrieure au basculement en faveur
des verts et donc de la gauche provoqu par la psychose de la pollution de l'air.
Autrement dit, la majorit actuelle a sans doute perdu ces quatre lections ma-
jeures du fait des scores exceptionnels des Verts, imputables la dsinformation
laquelle elle avait elle-mme contribu au lieu de la contrer.
Le maire actuel de Paris, Bertrand Delano, ne manque d'ailleurs jamais une
occasion de dire qu'il ne fait que poursuivre la politique initie par son prd-
cesseur, qui avait notamment lanc le projet de l'inutile et coteux tramway qui
coupe un peu plus Paris de sa banlieue sud et restreint encore l'espace accessi-
ble la circulation gnrale, y compris celle des taxis qui pouvaient aupara-
vant emprunter les voies rserves aux autobus.
Une entreprise de dnigrement de notre socit
Petites causes, grands effets ? Ceux qui entretiennent la vision d'un monde ir-
respirable au sens strict du terme et qui ont convaincu nos concitoyens, comme
le montrent les sondages, savent ce qu'ils font. Ce sont les mmes qui prnent
les politiques anti-voiture destines rendre de plus en plus difficile la vie quo-
tidienne de nos compatriotes. Leur but affich est de faire en sorte que circuler
et stationner posent des problmes sans cesse croissants dont tous les citadins se
plaignent aujourd'hui puisque, sauf pour le cas particulier de Paris intra-muros,
ils ont ncessairement recours la voiture pour la majorit de leurs dplace-
ments. Il ne s'agit pas l d'un sujet mineur, puisque deux tiers des Franais es-
timent juste titre que les villes o il fait bon vivre sont des villes o l'on peut
circuler et stationner facilement
1
.
1
Sondage Ipsos/FFAC, janvier 2006.
118
C'est ainsi qu'est cre l'image d'une socit inapte matriser le progrs et
ennemie de la qualit de vie.
La poursuite des errements du pass
Mais les leons du pass ne semblent pas avoir t comprises. Il suffit pour
s'en convaincre de constater que les gouvernements successifs ont agi jusqu'
prsent exactement comme leurs prdcesseurs. Au lieu de faire connatre et de
marteler la vrit, c'est--dire l'extraordinaire chute de la pollution de l'air
laquelle nous assistons et les consquences positives qui en rsultent pour la
sant et de s'en tenir cette information, ils se sont cru obligs d'annoncer ou
de prendre des mesures qui ne peuvent qu'accrditer dans l'opinion le senti-
ment que le problme s'aggrave.
C'est ainsi qu'il a t dcid en 2003 qu'en cas de pics de pollution de
moyenne ampleur, la diminution de 20 kilomtres l'heure des vitesses maxi-
males, qui n'tait qu'une recommandation, deviendrait une obligation et serait
strictement contrle et sanctionne. Il faut ainsi rouler 60 kilomtres l'heu-
re sur le boulevard priphrique parisien au lieu de 80 kilomtres l'heure !
Or, de l'avis unanime, cette disposition n'a aucune influence dtectable sur les
missions de polluants. Selon certaines tudes, son impact serait mme ngatif.
Une majorit de l'opinion publique (58 %) estime, d'ailleurs juste titre, la me-
sure inefficace
1
.
L'argument avanc pour justifier la dcision tient au fait que ces dispositions,
mme si elles ne sont pas utiles, sensibilisent les automobilistes. Mais quoi,
puisque le danger a disparu ? Et pourquoi, puisque les automobilistes ont be-
soin de leur voiture, et ne la prennent videmment pas pour se promener ?
Leur seul effet est d'accrditer l'ide que l'automobile pollue de plus en plus, et
de culpabiliser ceux qui doivent se dplacer en voiture, c'est--dire la grande
majorit de nos compatriotes.
C'est exactement ce que souhaitent les cologistes qui ont toujours vilipend
l'automobile, symbole leurs yeux du progrs, et fait de la pollution de l'air
l'un des fondements de leur conqute de l'opinion.
Une attitude diffrente
Il y aurait pourtant une autre attitude possible, radicalement diffrente. Il
s'agirait de se fixer pour objectif de faire connatre la vrit, c'est--dire l'ex-
1
Sondage Ipsos/FFAC, novembre 2003.
119
traordinaire chute de la pollution laquelle nous assistons du fait du progrs
technique, qui rend sans objet les mesures contraignantes dcrites ci-dessus.
Annoncer en quelque sorte la bonne nouvelle pour mettre fin l'inquitude de
nos compatriotes, ce qui suppose de mobiliser les moyens ncessaires pour
contrer la dsinformation.
C'est cette attitude qu'a adopte il y a plus de dix ans le gouvernement alle-
mand du Chancelier Kohl, dont le ministre de l'cologie de l'poque, Angela
Merkel, devenue depuis lors Chancelire, a pris la dfense des industriels en
dclarant qu'il fallait arrter d'accuser l'automobile de tous les maux. Cette pri-
se de position a contribu ce que le problme de la pollution toxique de l'air
ait disparu outre-Rhin des dbats et des proccupations de l'opinion, comme en
tmoignent les rsultats de sondages qui sont en opposition avec les ntres,
ceux des Allemands qui savent que la pollution diminue tant plus nombreux
que ceux qui affirment le contraire. Rigoureusement oppose celle des res-
ponsables politiques franais, cette attitude a contribu depuis de nombreuses
annes un discrdit dans l'opinion des Verts allemands.
Les raisons de l'aversion
On peut se demander enfin pourquoi ceux qui font profession de l'cologie
manifestent pour la voiture une telle aversion. La raison en est simple. C'est
que, comme le montrent tous les sondages, 90 % des Franais, et plus encore
des Franaises, aiment celle-ci. Non par passion, mais par raison. Ce n'est pas
par hasard si, dans tous les pays du monde et ds qu'ils le peuvent, le rve de
nos contemporains est d'acheter une voiture. C'est que celle-ci est un extraor-
dinaire vecteur d'accroissement de libert et d'amlioration de la qualit de vie,
comme en tmoignent toutes les dclarations et tous les constats. La voiture est
le symbole mme du progrs dans ce qu'il a de positif. Et c'est cela que ne peu-
vent supporter ceux qui ont une vision irrductiblement ngative du monde
dans lequel nous vivons.
Il leur faut donc s'efforcer de dtruire l'image de la voiture dans l'opinion, ce
qu'ils font avec succs, soit en l'accablant des plus grands maux mme lorsque
ceux-ci sont en voie de disparition, soit en s'efforant chaque fois qu'ils le peu-
vent de rendre son usage de plus en plus compliqu.
En revanche, ils se dsintressent des vrais problmes que pose l'automobile.
C'est ainsi qu'on n'a jamais vu aucun cologiste se mobiliser pour la scurit
routire. Bien au contraire, de multiples reprises, en s'opposant la cration
d'autoroutes ou de voies rapides, ils ont montr qu'ils donnaient la priorit la
vie des vgtaux ou des animaux sur celle des hommes. La construction de l'au-
120
toroute A 28 a ainsi t bloque pendant cinq ans au prtexte de la protection
d'une espce de scarabes, alors que chacun savait qu'il y avait dix morts cha-
que anne sur la route nationale qu'elle allait doubler...
La politique nationale de scurit routire a d'ailleurs t dramatiquement
nglige par le gouvernement socialiste au pouvoir de 1997 2002 et par sa
composante cologique. Il a fallu, pour que les choses changent, que les cir-
constances permettent au dossier que j'avais prpar de convaincre en juil-
let 2002 Jacques Chirac, depuis longtemps sensibilis aux tragdies de l'inscu-
rit routire, d'en faire la priorit de son quinquennat avec le succs que l'on
sait. Pour la premire fois au monde, un chef d'tat s'engageait dans la lutte
contre les accidents de la route. Avec l'appui de son gouvernement et tout par-
ticulirement de son ministre de l'Intrieur qui acheta un millier de radars, le
nombre des victimes a alors dcru de prs de moiti en cinq ans sur nos routes,
rsultat sans prcdent qui fait dsormais de la France une rfrence mondiale
dans ce domaine, au grand tonnement des pays trangers.
Pour les cologistes, en dfinitive, le problme, ce n'est pas la pollution,
c'est la voiture . C'est pourquoi, si l'opinion apprenait un jour la vrit, c'est--
dire la disparition des risques pour la sant lis la pollution et l'amlioration
de la qualit de l'air de nos villes, il ne faudrait pas se nourrir d'illusions. La voi-
ture continuerait tre attaque sous d'autres angles avec autant de virulence,
sans d'ailleurs que cela change quoi que ce soit au comportement de nos
contemporains qui ne sont nullement disposs s'en passer. Il faut nous rendre
l'vidence. L'cologisme, nouvelle religion des temps modernes, est devenu
l'un des vecteurs privilgis d'attaque de notre socit. Et, pour leur part, les
transports, objet des prochains chapitres, illustrent plus que tout autre secteur
les errements et les gaspillages auxquels peut conduire au nom de l'cologie
une apprciation biaise des choses.
121
CHAPITRE X
La danseuse de la Rpublique
Au total, les transports provoquent un sixime environ des rejets plantaires,
avec 17 % du total dont 7 % pour l'automobile. Mais il en va tout autrement
dans l'opinion publique. Toutes les enqutes montrent que les transports, et
d'abord l'automobile, figurent dans l'imaginaire collectif au premier rang des
responsables des missions de gaz effet de serre et de la pollution en gnral.
S'il est une opinion qui ne souffre gure de dbats dans notre pays, c'est qu'il
faut dvelopper l'usage des transports en commun et de la voie ferre pour sau-
vegarder l'environnement. C'est ce que rptent sans cesse les cologistes. 89 %
de nos compatriotes se dclarent ainsi en faveur de la priorit aux transports en
commun
1
, et 95 % souhaiteraient que les marchandises empruntent la voie fer-
re et non la route ou l'autoroute
2
.
Il se passe pourtant quelque chose d'trange. Ceux qui font ces dclarations
reprennent ensuite aussitt leur voiture quand ils ont se dplacer, et frquen-
tent des magasins ncessairement approvisionns par camion ! Les comporte-
ments se situent l'oppos des dclarations.
Une telle schizophrnie a des consquences trs graves. Elle justifie chez nos
dcideurs une politique des transports qui cote si cher la collectivit qu'on
peut parler de drame national.
Point n'est besoin de faire de sondage. Interrogs pour savoir s'il existerait un
pays dvelopp et rput intelligent qui consacrerait 4 % de l'argent public ses
transports plus qu' ses universits ou sa Justice, nos compatriotes rpon-
draient videmment par la ngative, tant la question leur paratrait saugrenue.
Pourtant, ce pays existe : c'est le ntre. L'tat franais attribue chaque anne 10
milliards d'euros ses universits, 11 sa Justice, et 12 ses chemins de fer, ce
chiffre devant tre port 15 au cours des prochaines annes. Or le rail n'assure
que 4 % de nos transports, puisque nos compatriotes dpensent chaque anne 200
milliards d'euros pour se dplacer ou pour transporter leurs marchandises, et
que le chiffre d'affaires des chemins de fer avoisine 8 milliards seulement au
1
Sondage Ipsos/FFAC, dcembre 2006.
2
Sondage Ipsos/FFAC, juin 2002.
122
sein de ce total, la trs grande majorit de nos besoins tant dsormais assure
par la route.
Mais nos compatriotes surestiment massivement la place des chemins de fer,
puisqu'ils pensent que ceux-ci rpondent 40 % de nos besoins de transport,
soit dix fois la ralit
1
. Intuitivement, ils attribuent au rail un rle presque qui-
valent celui de la route, alors qu'il est plus de vingt fois plus faible.
Comment d'ailleurs pourraient-ils savoir ce qui se passe ? Alors que le contri-
buable a vers en 2006 12 milliards d'euros pour nos chemins de fer et que le
gouffre s'accrot rapidement d'anne en anne le montant correspondant
s'levait 10 milliards quatre ans plus tt seulement , la SNCF affiche des b-
nfices du fait d'incroyables artifices comptables !
Si l'on ajoute enfin les sommes consacres aux autres transports publics Pa-
ris ou en province, le total de la charge des transports ferrs et publics pour les
contribuables avoisine 20 milliards d'euros par an, bien plus que le dficit de la
scurit sociale qui fait tant parler de lui ! Et si rien n'est fait, cette somme dj
gigantesque va encore s'accrotre de 5 milliards au cours des toutes prochaines
annes. Or la dfense de l'environnement constitue aujourd'hui la principale
justification de telles dpenses, dont l'essentiel est pourtant inutile et vitable.
Les deux politiques
C'est que notre pays a deux politiques des transports : celle des usagers et cel-
le des pouvoirs publics. Ces deux politiques n'ont aucun point commun.
Les usagers ont massivement choisi la voiture lorsqu'ils ont se dplacer, et le
camion quand ils ont transporter des marchandises, alors qu'au nom de l'co-
logie, les pouvoirs publics voudraient que nos compatriotes prennent les trans-
ports en commun et que les entreprises aient recours au chemin de fer ou la
voie d'eau. Ils gaspillent dans ce vain espoir des sommes insouponnes sans
effet notable, et nuisent l'environnement au lieu de lui rendre service.
Les choix des usagers s'expliquent par deux vnements essentiels qui ont
marqu les cinquante dernires annes : la dmocratisation de l'automobile et
la diffusion du camion, accompagnes du bouleversement du rseau routier.
Aujourd'hui, plus de 9 Franais sur 10 (91 %) ont facilement une voiture
leur disposition quand ils ont se dplacer, et plus encore en province
2
. Or,
mme si nous n'en avons le plus souvent pas conscience, les temps de parcours
de porte porte sont en moyenne moiti moindres en voiture qu'en transport
en commun pour la trs grande majorit des dplacements. Il ne faut pas alors
1
Sondage Ipsos/FFAC, octobre 2004.
2
Sondage Ipsos/FFAC, fvrier 2005.
123
s'tonner que, sur 130 millions de dplacements quotidiens motoriss recenss
en France, 115 aient recours l'automobile, et 15 seulement aux transports en
commun, dont la moiti en le-de-France.
Paris intra-muros et sa proche banlieue constituent d'ailleurs cet gard une
exception qui fausse le jugement et n'est en rien reprsentative du territoire
national. Quand on parle de transports au niveau du pays, il faut oublier Paris.
Partout ailleurs ou presque, la voiture est sans rivale par le gain de temps et
donc de qualit de vie qu'elle permet en multipliant les activits possibles dans
la journe, quelles que soient les sommes dpenses en faveur des transports
publics. Elle est plbiscite par nos compatriotes qui ne sont nullement prts y
renoncer, car elle est la plus efficace sur la plupart des trajets qu'ils ont effec-
tuer. Mme dans les villes qui se sont dotes trs grands frais de transports pu-
blics performants, l'usage de ceux-ci n'a pratiquement pas vari, et la voiture est
reste de trs loin majoritaire.
Le dveloppement du camion
Mutatis mutandis, la situation est la mme pour les marchandises. Seul le ca-
mion est capable d'assurer les trajets de porte porte, depuis le verger ou l'ate-
lier de dpart jusqu' l'usine ou au commerce de destination, dans des dlais
trs brefs, sans rupture de charge, commodment et conomiquement. Il ne
faut pas s'tonner dans ces conditions que les autres modes de transport terres-
tres aient pratiquement disparu du territoire national. Sur 53 milliards d'euros
consacrs chaque anne en France au transport de marchandises par les entre-
prises et les particuliers, le camion et la camionnette ont un chiffre d'affaires
de 51,5 milliards, contre 1,4 pour le fret ferroviaire et 0,3 pour la voie d'eau.
C'est que nul ne peut s'opposer au choix du march, d'autant plus que celui-
ci concide avec l'intrt gnral tant le camion est un facteur essentiel de pro-
ductivit des conomies modernes. La SNCF vient de se fixer comme objectif de
ramener le dlai d'acheminement des marchandises de deux semaines une.
Mais la France vit dsormais au rythme du 24 heures chrono.
Toutefois, les pouvoirs publics n'admettent pas les choix des usagers. Ils sa-
vent mieux qu'eux ce qu'il leur faut. Au nom notamment de la dfense de l'en-
vironnement, des montants gigantesques sont alors mis en uvre chaque anne
pour tenter en pure perte de leur faire changer leurs comportements, qu'il
s'agisse de leurs propres dplacements ou de l'acheminement des marchandises
dont ont besoin les entreprises.
124
Les TER : plus de 3 milliards jets l'eau chaque anne
Rien n'illustre mieux l'tendue du dsastre que les transports express rgio-
naux, les TER qui sont la fiert de nos conseils rgionaux. A priori, les TER sont
sympathiques et ils bnficient dans l'opinion publique d'une image trs positi-
ve. Quoi de plus naturel que d'offrir la masse de ceux qui n'ont pas de voiture
un moyen commode et conomique de se dplacer ? N'est-ce pas l la vocation
et la raison d'tre d'un service public digne de ce nom ? Pourtant, les TER cons-
tituent un vritable scandale national, et les chiffres sont surralistes.
Les TER cotent chaque anne 4,2 milliards d'euros dont 0,8 sont acquitts
par les usagers, la diffrence (3,4 milliards) provenant de subventions qui figu-
rent au budget des rgions.
Un tel montant serait justifi si les TER taient massivement utiliss, ce que
chacun imagine.
Mais la ralit laisse pantois. Faut-il le rpter, selon un rcent sondage repr-
sentatif, 1 % seulement de la population des plus de vingt-cinq ans utilise rgu-
lirement les TER, c'est--dire les emprunte au moins une fois par semai-
ne, 19 % les utilisent moins d'une fois par mois et 78 % jamais
1
!
Ces chiffres peuvent stupfier. Mais ils sont cohrents avec le nombre quoti-
dien d'usagers recens par la SNCF qui s'tablit moins de 700 000, allers-
retours compris, alors que le nombre des dplacements en voiture des habitants
de province excde largement 100 millions par jour. Une autre enqute
2
a mis
ainsi en vidence que 90 % des habitants de nos rgions utilisaient la voiture chaque
semaine, dont 60 % tous les jours, et que seuls 3 % n'y avaient jamais recours.
Le contraste est total. Au 1 % d'usagers rguliers des TER s'opposent les 90 %
d'usagers rguliers de la voiture ! C'est ainsi qu'au prtexte de la dfense de
l'environnement, les rgions franaises consacrent pratiquement autant d'ar-
gent transporter 1 % de leurs administrs qu'aux lyces (3,5 milliards d'euros)
ou la formation professionnelle (3,8 milliards)
3
. Dans quel monde vivons-
nous ?
Nos lus n'ont pas compris que la voiture tait devenue le moyen de transport
social de notre poque. En province, presque tous les adultes en ont une leur
disposition. Il en rsulte que les TER circulent la plupart du temps pratique-
ment vide, sauf sur quelques lignes de banlieue de mtropoles rgionales aux
heures de pointe, qui sont les seules avoir une vritable raison d'tre. A ces
exceptions prs, l'occupation de ces trains de plusieurs centaines de tonnes cor-
respond le plus souvent celle de quelques voitures ou d'un petit autocar.
1
Sondage Ipsos/FFAC, octobre 2006.
2
Sondage Ipsos/FFAC, novembre 2006.
3
Le Monde, 20 mars 2007.
125
Si tous ou presque ignorent l'existence de ces trains si peu frquents, c'est
pour une raison qui prterait sourire s'il ne s'agissait d'argent public : person-
ne ne le sait, puisque personne ne les prend ! En dehors des inaugurations, la
plupart des responsables eux-mmes ne les empruntent jamais et circulent
comme tout le monde en voiture.
Il faut des vnements fortuits, tels que des accidents, pour que soit lev un
coin du voile. Le 21 novembre 1999, le train Clermont-Ferrand-Bziers a drail-
l. L'vnement est pass inaperu, et pour cause. La presse spcialise a relev
qu' heureusement, aucun des treize passagers n'avait t bless . Pas plus d'ail-
leurs, lors de l'accident du 27 janvier 2003, qu'aucun des cinq passagers du TER
Nice-Cuno pourtant compos de deux automotrices X 2200 et d'une remor-
que d'un poids total de plus de 200 tonnes. Encore ne sait-on pas s'il s'agissait
de passagers payants.
De multiples autres trains sont presque vides en regard de leur capacit et de
leur cot. Le 8 juin 2004, le Paris-Maubeuge, compos de dix voitures, draillait.
Il transportait une quarantaine de voyageurs, quatre par voiture... Plus rcem-
ment, beaucoup se souviennent de la collision qui a malheureusement provo-
qu la mort de six personnes en Lorraine, en octobre 2006. Mais le bilan aurait
t bien plus lourd si le train flambant neuf d'une capacit de 300 places n'avait
t occup par seulement vingt personnes correspondant une dizaine d'au-
tomobiles, alors que l'autoroute parallle en coule 50 000 par jour ! Que ceux
qui doutent de la vracit de ces constats aillent prendre un jour eux-mmes un
TER en dehors des rares priodes de pointe, et ils seront stupfaits de s'y re-
trouver seuls ou presque !
On ne sera donc pas tonn d'apprendre que le cot de ce service public d-
fie toute mesure. Il faut faire fonctionner pour lui, avec le personnel corres-
pondant, 2 660 gares ou points d'arrt, et entretenir 15 000 kilomtres de voies
pour son usage exclusif !
A quoi cela sert-il de dpenser de telles montagnes de ressources publiques
pour 1 % des habitants d'ge actif ? Qui pourrait croire qu'il s'agit l du meil-
leur usage de l'argent du contribuable quand il y a tant de besoins par ailleurs ?
Il y a pire. Se plaignant de l'insuffisance de leurs ressources, la quasi-totalit
des rgions ont dcid en novembre 2006 d'augmenter dans les limites qui leur
taient autorises les taxes sur les carburants qui frappent en proportion surtout
les plus modestes. C'est ainsi la masse, qui utilise la voiture, qui paye pour l'in-
fime minorit de la population qui emprunte les TER, sinon pour les cheminots
qui leur sont affects.
Si l'on estime 250 000 le nombre des usagers habituels, il apparat que cha-
cun d'entre eux bnficie d'une subvention annuelle de l'ordre de 10 000 eu-
ros. Leur offrir chaque anne une voiture neuve ne coterait pas plus cher aux
126
finances rgionales ! Quant aux autres, il serait bien moins coteux de leur
payer le taxi.
S'agissant des agents de la SNCF affects ces lignes, on imagine quel point
ils sont sous-employs. Bien que la SNCF n'en communique pas le nombre, car
l'obscurit rgne quand on cherche obtenir des chiffres significatifs, celui-ci
est sans doute de l'ordre de 50 000, ce qui conduit, compte tenu des allers-
retours, au ratio surraliste d'un agent pour moins de 10 passagers quotidiens.
Beaucoup d'entre eux passent des journes entires attendre derrire leurs
guichets des passagers qui ne viennent jamais. Et si ces agents sont si peu oc-
cups, il ne faut pas s'tonner de leur propension faire grve.
A ce sujet, il faut remarquer que les grves des chemins de fer n'ont plus gu-
re d'impact grave qu'en le-de-France. Ailleurs, leurs consquences sont dor-
navant limites et, pendant un certain temps, le pays peut fonctionner sans
trains.
La solution interdite
S'agissant des TER, le gaspillage des deniers publics est d'autant plus navrant
qu'il existe une alternative qui coterait incomparablement moins cher, pour
un service le plus souvent de qualit suprieure. Le recours la voie ferre est
justifi lorsque les trafics sont trs importants. Mais pour les lignes trafic mo-
deste ou faible, qu'elles soient rgionales ou nationales, la solution logique est
celle de l'autocar qui diviserait par un facteur de l'ordre de dix les dpenses et
accrotrait le plus souvent les recettes, car elle s'accompagnerait d'un trafic su-
prieur du fait de la souplesse des itinraires et de la frquence possible des ar-
rts. L'autocar peut desservir le lyce, l'hpital et la place du march, pas le
train. C'est la solution couramment adopte l'tranger. Elle serait d'autant
plus aise mettre en uvre en France que notre pays dispose d'un excellent
rseau autoroutier et routier, et d'entreprises de transport performantes.
Mais depuis 1934, la loi interdit de crer librement en France des lignes rgu-
lires d'autocar pour protger le monopole du chemin de fer. Ne fallait-il pas,
l'poque, que les rares lignes d'autocar autorises procdent des arrts pour
ne pas aller plus vite que les trains ! Le fait que, trois quarts de sicle plus tard,
cette loi absurde soit toujours en vigueur donne une ide de la force du groupe
de pression que constituent les chemins de fer. Hors rseaux de rabattement
vers les gares, l'autorisation d'ouverture de lignes d'autocars n'est pratiquement
jamais accorde, ce qui permet d'entretenir la confusion entre chemin de fer et
service public des transports.
127
Les rgions pourraient pourtant donner cette autorisation pour leur territoi-
re, mais elles ne le font pas, car ceci conduirait logiquement la fermeture de
milliers de kilomtres de lignes faible trafic dont il apparatrait qu'elles sont
en ralit inutiles. Il faut dire que, dans les circonstances politiques actuelles, les
vice-prsidents en charge des transports sont le plus souvent d'anciens syndica-
listes cheminots issus de la CGT...
C'est pour cette raison que nos autoroutes ne sont pas parcourues de lignes
rgulires d'autocars comme ailleurs, alors que celles-ci constitueraient la solu-
tion lorsque le trafic est faible, sans rien coter ou presque au contribuable et
tout en pratiquant des tarifs accessibles aux plus modestes, car le prix de revient
de la place en autocar est environ dix fois plus faible que dans un vhicule fer-
roviaire.
Le transfert vers la route de l'essentiel du rseau des TER serait donc une
source d'conomies majeures pour les rgions, car la voie sur laquelle elles se
sont engages l'instigation de l'tat est sans issue. Un rcent audit sur l'entre-
tien du rseau ferr exclusivement emprunt par les TER a mis en vidence que
celui-ci tait en trs mauvais tat et qu'il faudrait, pour de simples impratifs de
scurit, accrotre encore massivement l'avenir ses crdits de rparation et de
maintenance. L'Allemagne a fait le mme constat, et le gouvernement fdral
vient de rduire d'un milliard d'euros ses dotations aux Lander, ce qui conduira
ceux-ci transfrer sur la route de nombreuses lignes rgionales, au bnfice du
service rendu aux usagers.
S'agissant de notre pays, la premire chose faire pour allger massivement la
charge pour les contribuables dans le domaine des transports serait donc de
modifier la loi pour rendre libre la cration de lignes d'autocar, comme c'est
dj le cas pour les lignes d'avion qui ne sont soumises aucune autorisation, ce
qui n'est pas le moindre des paradoxes ! Plus de trois milliards d'euros inutile-
ment dpenss chaque anne sont en jeu.
Il est inutile de dire que, lorsqu'on les interroge, une vaste majorit (77 %) de
nos compatriotes serait favorable cette disposition, d'autant plus que tous ou
presque ignorent l'interdiction actuelle de la libre cration de lignes rgulires
d'autocars, survivance d'une poque rvolue. Il ne s'agirait en aucun cas de
supprimer les TER, mais de les transfrer du rail vers la route, ce qui permettrait
de surcrot, si ncessaire, d'en accrotre le rseau et la frquence.
Qui sait que, du fait des rglements internationaux, il est aujourd'hui possible
de prendre Paris des autocars rguliers pour rejoindre Londres, Varsovie, Ma-
drid ou Lisbonne, mais pas pour aller Granville, Guret ou Mcon parce que
la loi franaise interdit de desservir la France en autocar ?
Il ne faudrait pas enfin s'imaginer que le maintien sur voie ferre des TER
contribue en quoi que ce soit la lutte contre l'effet de serre. C'est l'inverse. Le
128
fonctionnement des trains, la construction et l'entretien du matriel roulant, les
rparations des voies et des gares sont sans doute l'occasion de beaucoup plus
d'missions que celles qui proviendraient de la circulation des autocars en cas
de transfert sur route.
Les lignes interrgionales
Il n'y a pas que les TER qui circulent vide. C'est aussi le cas des trains de li-
gnes transversales, dites interrgionales. Plus personne ne prend le train pour
aller de Lyon Bordeaux ou Nantes, et les passagers qui les empruntent de
bout en bout se comptent sur les doigts d'une ou de deux mains, selon les d-
clarations de la SNCF elle-mme. Ces lignes d'une autre poque n'assurent plus
que des trajets locaux pour ceux des habitants de province qui n'ont pas accs
une voiture, c'est--dire presque personne parmi les adultes. C'est pourquoi la
SNCF demande cor et cri leur fermeture, car le dficit de ces trains fantmes
se chiffre en centaines de millions d'euros annuels. Mais les gouvernements
successifs ont toujours rejet cette requte et prfr payer leur maintien aux
frais du contribuable pour ne pas heurter les syndicats de cheminots. La notion
de service public est alors mise en avant, comme si le gaspillage d'argent public
tait un service public !
L aussi, l'autocar serait la solution vidente, comme c'est le cas dans les au-
tres pays. Nous avons d'excellentes autoroutes. Pourquoi ne pas nous en servir ?
D'ailleurs, la premire mission d'un service public, quel qu'il soit, ne devrait-
elle pas tre de ne pas grever de manire indue les finances publiques ? La re-
marque est tout aussi valable pour la plupart des marchandises.
Le fret ferroviaire
Le succs du camion n'est pas d non plus, comme on le dit parfois, aux sub-
ventions qu'il recevrait, alors que le fret ferroviaire devrait payer la totalit de
ses cots. C'est exactement l'inverse. Qui sait par exemple que le fuel utilis par
les locomotives diesel est dtax, contrairement celui des poids lourds ? Enco-
re ne s'agit-il l que d'une goutte d'eau en regard du montant global des sub-
ventions dont bnficie le transport des marchandises par fer.
Deux autres arguments souvent avancs en faveur d'un illusoire rquilibra-
ge du transport par le rail ne tiennent enfin gure la route, si l'on peut dire.
Le premier serait que le fret ferroviaire serait favorable la lutte contre l'effet
de serre en rduisant les missions de gaz carbonique. L'existence mme de
129
cette rduction est tout d'abord trs discutable lorsque l'on tient compte des
transports terminaux qu'implique le plus souvent le recours la voie ferre et
de la ncessit de manuvres de transbordement. Il faut aussi nous souvenir
que nous appartenons l'Europe o plus de la moiti de l'lectricit provient
de centrales thermiques fonctionnant au charbon ou au gaz naturel et donc
lourdement mettrices de gaz effet de serre.
Mais surtout, l'ventuelle diminution des missions de gaz effet de serre se-
rait obtenue un prix prohibitif. Les wagons de marchandises parcourent en
France environ deux milliards de kilomtres par an, c'est--dire qu'ils vitent un
trafic routier quivalent, puisque la charge moyenne d'un wagon est proche de
celle d'une semi-remorque. Comme un poids lourd ncessite en moyenne 30
litres aux 100 kilomtres, la consommation de carburant vite s'lve au plus
750 000 mtres cubes, qui rejetteraient dans l'atmosphre environ 22 millions
de tonnes de gaz carbonique.
Autrement dit, si l'on admet une valeur de 20 euros par tonne de CO
2
par-
gne comme le recommande l'Agence internationale de l'nergie, la somme
maximale qu'il serait justifi de dpenser en faveur du fret ferroviaire serait in-
frieure 50 millions d'euros. Il est inutile de dire que celle-ci est sans aucun
rapport avec les cots subis. Au cours de la seule anne 2006, le dficit du fret
ferroviaire s'est officiellement lev 900 millions d'euros. Ce montant n'a de
surcrot gure de rapport avec la ralit, puisque le contribuable acquitte cha-
que anne 12 milliards d'euros pour les chemins de fer, et que ceux-ci n'ont
que deux activits : les voyageurs et les marchandises...
On peut ce sujet noter que l'argument de la lutte contre l'effet de serre est
tout aussi fallacieux lorsqu'on l'utilise pour justifier la cration de nouvelles li-
gnes grande vitesse. La nouvelle ligne entre Paris et Strasbourg a cot 4 mil-
liards d'euros pour sa premire phase. Or le trafic arien entre les deux villes
atteignait un million de passagers par an et mettait environ 100 000 tonnes de
CO
2
. En estimant nouveau 20 euros le cot de chaque tonne pargne, les
gains attendre de ce point de vue s'lvent donc au plus 2 millions d'euros
par an, soit un deux millime de l'investissement. Encore ceci ne tient-il pas
compte du fait que l'exploitation de la ligne sera dficitaire hauteur de 100
millions par an selon les estimations de la SNCF, alors que les liaisons ariennes
auxquelles Air France a t oblig de renoncer taient bnficiaires et ne co-
taient rien au contribuable. On comprend pourquoi les acteurs du transport
arien parlent de concurrence dloyale.
130
Un incroyable projet
Certains projets atteignent cet gard des sommets dans l'absurdit et sont
d'authentiques injures au contribuable, comme les ouvrages ferroviaires gigan-
tesques projets entre Lyon et Turin.
Il faut savoir que le trafic de marchandises travers nos Alpes du Nord dcrot
depuis une dizaine d'annes du fait de l'ouverture progressive des frontires
suisses aux camions transitant entre l'Italie et l'Allemagne, qui ne sont plus
obligs de traverser la France. Les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Frjus
ont vu ainsi passer en moyenne au total 4 000 poids lourds par jour en 2005
contre 4 300 en 1995. Et il y a toute chance pour que cette dcroissance se
poursuive encore, puisque la Suisse est en train de construire deux tunnels fer-
roviaires pour faciliter la traverse Nord-Sud de son territoire.
Il faut savoir aussi que la capacit cumule des deux tunnels routiers franco-
italiens et du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis atteint 90 millions de tonnes par
an, c'est--dire prs de trois fois le volume actuel des changes de marchandises
entre les deux pays qui ne dpasse pas 35 millions de tonnes.
Il ne faut donc pas s'tonner qu'un rapport conjoint des deux plus hautes au-
torits administratives franaises comptentes, le conseil gnral des Ponts et
Chausses et l'inspection gnrale des Finances, ait conclu qu'il n'y avait aucun
besoin d'un nouvel ouvrage et qu'il fallait mettre le projet de la liaison Lyon-
Turin en veille active , c'est--dire, en langage administratif... tout arrter.
Il le faut d'autant plus qu'on ne voit pas comment, s'il tait un jour construit,
on pourrait obliger les camions utiliser un tel projet ferroviaire avec ce que
ceci suppose de manuvres de transbordement et de pertes de temps et d'ar-
gent, alors qu'il existe deux ouvrages routiers que les rgles europennes emp-
chent fort heureusement d'interdire la circulation. Les Alpes ne sont pas la
Manche que ne traverse aucun tunnel routier.
Il ne faut pas croire non plus que ce tunnel serait justifi par un quelconque
trafic significatif de voyageurs. Ainsi que le dclare Francis Mer dans un rcent
ouvrage : Les premires tudes avaient prvu 6 7 millions de voyageurs par
an, chiffre suprieur celui de l'Eurostar qui relie Paris et Londres ! Mais le tra-
fic est proportionnel au produit des populations concernes, de telle sorte qu'il
devrait tre seize fois moins important qu'entre les capitales franaise et anglai-
se ! Mme en imaginant qu'il ne soit que dix fois plus faible, cela donne un tra-
fic annuel de cinquante mille voyageurs, soit l'quivalent d'un TGV par jour et
par sens. Creuser un tunnel pour l'quivalent d'un TGV par jour relve en p-
riode de contrainte budgtaire forte du plus grand surralisme.
131
Tableau 5
volution du trafic des marchandises
travers les Alpes franaises
Ce projet gigantesque dont le cot est valu 15 milliards d'euros au minimum continue pourtant
tre soutenu par les gouvernements franais et italien au nom de la lutte contre l'effet de serre.
Mais le projet est devenu un problme politique. Lorsque j'tais Bercy, j'ai
tent de l'enterrer, mais l'lyse et Matignon ont protest : Et les relations
franco-italiennes alors ? D'autant que la Commission europenne, intoxique
elle aussi par les cologistes et les cheminots, soutient le projet qu'elle prvoit
de financer 20 %
1
.
Il s'agit donc d'un projet aussi absurde qu'inutile, dont le cot est estim la
somme invraisemblable de 15 milliards d'euros au minimum. Ce constat sans
appel ne nous empche pas de continuer dpenser en pure perte chaque an-
ne des centaines de millions d'euros pour percer des galeries de reconnaissan-
1
Francis Mer, Vous., les candidats, Albin Michel, 2007.
132
ce dont on pourrait dire en plaisantant, s'il ne s'agissait pas de l'argent du
contribuable, que le seul intrt est de continuer amuser la galerie pour ne
pas vouloir reconnatre que le projet de tunnel entre Lyon et Turin est inutile et
n'aurait aucune influence perceptible sur les changes entre la France et l'Italie
qui se droulent trs bien sans lui, ni videmment sur la lutte contre l'accrois-
sement de l'effet de serre. En admettant que la moiti du trafic transalpin l'em-
prunte sur 200 kilomtres, la rduction des missions n'excderait pas 125 000
tonnes de gaz carbonique par an, soit 1 minute 15 secondes de l'ensemble des
rejets mondiaux.
Un transfert impossible
On s'imagine enfin, et c'est peut-tre la raison majeure de la faveur dont jouit
dans l'opinion le transport des marchandises par voie ferre, que le dvelop-
pement du fret ferroviaire diminuerait massivement la circulation des poids
lourds sur les autoroutes, laissant celles-ci l'usage des automobilistes. Plus
de 90 % des Franais souhaitent en effet que les marchandises soient achemi-
nes par le fer et non par la route
1
.
L'ide est sduisante, mais irraliste. Chaque anne, camions et camionnettes
parcourent sur nos routes et autoroutes 130 milliards de kilomtres et les voitu-
res 440, pour un total de la circulation routire de l'ordre de 570 milliards de
kilomtres parcourus. Pour leur part, les parcours des wagons de marchandises
n'excdent pas 2 milliards de kilomtres par an. La conclusion s'impose : mme
si le fret ferroviaire doublait, ce qui est physiquement et financirement impos-
sible puisqu'il ne cesse de diminuer malgr les subventions abyssales dont il b-
nficie, l'impact sur la circulation routire serait imperceptible.
Il est d'ailleurs de plus en plus rare de voir circuler des trains de marchandi-
ses. Leur nombre est trs limit : quelques centaines par jour pour l'ensemble
du territoire national, dont un bon tiers vide. Lorsqu'on voit passer par hasard
un train de 15 ou 20 wagons sur une voie ferre parallle une autoroute, la
raction qui vient l'esprit est spontanment positive, avec la satisfaction de
penser que celle-ci est ainsi soulage d'une part notable de son trafic. Mais cette
raction est trompeuse. Sur les grandes autoroutes qui structurent notre terri-
toire (Al, A6, A7, A9...), le trafic des poids lourds atteint ou excde 15 000 vhi-
cules par jour ouvrable, soit 10 par minute en moyenne, et beaucoup plus par
moments.
Un train complet correspond donc deux ou trois minutes de trafic autorou-
tier tout au plus ! Contrairement aux apparences, c'est l'autoroute qui assure au-
jourd'hui le transport de masse, et non la voie ferre dont la capacit est bien plus faible. Il
1
Sondage Ipsos/FFAC, 1
er
juillet 2002.
133
est en consquence impossible de soulager la route avec le rail, car les ordres de
grandeur ne le permettent pas. Seul le fait que les camions ne soient pas accro-
chs les uns aux autres donne croire le contraire.
Face aux potentialits du transport routier, il ne faut donc pas s'tonner de la
chute constante du fret ferroviaire, encore pass en cinq ans de 55 millions de
tonnes-kilomtres en 2000 41 millions en 2005 ( 25 %), ce qui n'a pas emp-
ch en 2004 la SNCF de commander 400 locomotives spcialises qui ne servi-
ront pratiquement rien, pour un montant de plus d'un milliard d'euros, aux
frais du contribuable. Boucs missaires, les directeurs de fret se succdent la
SNCF sans rien pouvoir y changer.
Qu'on le veuille ou non, le fret ferroviaire a pratiquement disparu du paysage
de nos transports, avec un chiffre d'affaires quarante fois plus faible que celui
du transport routier de marchandises, et ce n'est pas l'ouverture la concur-
rence qui pourra changer quoi que ce soit de significatif la situation. Lorsqu'il
n'y a pas de march, rien ne peut le crer.
Le ferroutage, fausse bonne ide
Pour tenter de sauver le fret ferroviaire, il est enfin souvent suggr de recou-
rir au ferroutage, ou transport combin , c'est--dire de faire monter sur des
trains soit des remorques routires, soit des containers achemins par camion
jusqu' une gare de dpart. Mais les distances sont trop courtes en Europe pour
que ce type d'acheminement des marchandises puisse tre comptitif, d'autant
plus que le gabarit des ponts et des tunnels ferroviaires n'est pas suffisant pour
laisser passer la plupart des trains lorsqu'ils transportent des camions entiers.
Le transport combin est en effet ncessairement coteux et compliqu. Il
faut un premier camion pour accder la gare de dpart, puis un transborde-
ment, puis un train, puis un deuxime transbordement, puis un deuxime ca-
mion pour se rendre la destination finale. Comme l'a dclar il y a quelques
annes le directeur du fret de la SNCF : Dans le cas du transport combin, la
partie ferroviaire s'ajoutent les cots de transbordement et ceux des dessertes
routires : par rapport un prix de concurrence de la route de 100, le montant
revenant la prestation ferroviaire ne peut alors tre que de 40. Les quelques
kilomtres routiers effectuer absorbent en effet entre 20 et 25 % chaque ex-
trmit, auxquels il faut ajouter 5 % pour les manutentions chacune des deux
gares. Autrement dit, ce qui tue le combin, ce n'est pas du tout la prestation ferro-
viaire, mais les dessertes terminales routires, qui sont extrmement coteuses
1
.
1
Assemble nationale, commission d'enqute sur la SNCF, 9 fvrier 1994.
134
Autrement dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqu ? La
SNCF elle-mme reconnat que le ferroutage est par nature vou l'chec dans
les conditions qui rgnent en Europe. Il ne faut donc pas s'tonner que, malgr
toutes les subventions dpenses en vain, le transport combin ait rgress
de 30 % entre 2000 et 2004, passant dans notre pays de 1 000 000 700 000 en-
vois. Il s'agit donc l d'une autre fausse bonne ide , mme si elle est nou-
veau plbiscite par la quasi-totalit de nos concitoyens.
Les ordres de grandeur sont tels qu'un ventuel dveloppement du transport
combin n'aurait d'ailleurs aucun effet visible sur le trafic routier. On vient ainsi
d'annoncer grand renfort de publicit une liaison entre Perpignan et Luxem-
bourg dont le trafic pourrait atteindre 25 000 semi-remorques au prix d'investis-
sements publics substantiels. Mais il s'agit de 25 000 containers par an, alors que
le trafic de l'autoroute A 7 dans la valle du Rhne qu'elle serait cense soula-
ger approche 20 000 poids lourds par jour ouvrable. Pourquoi alors dpenser
l'argent du contribuable qui a d, au travers de RFF, payer plusieurs dizaines de
millions d'euros pour soutenir ce projet ?
Qu'il s'agisse des marchandises ou des personnes, il faut en dfinitive se ren-
dre l'vidence : les modes de transport ne sont pas des vases communicants et
les usagers ont choisi les plus performants, dans leur intrt et dans celui de la
collectivit. L'immense majorit de nos besoins de transports terrestres est au-
jourd'hui satisfaite par les vhicules routiers. Pour les transports longue dis-
tance, avions et bateaux sont irremplaables. Ce rsultat est le fruit des choix
des usagers. Il ne rsulte en rien de la politique des pouvoirs publics qui n'ont
toujours pas compris que l'conomie de march veut que, sauf rares exceptions,
les choix des usagers soient fonds et correspondent l'intrt gnral.
La politique de transport des pouvoirs publics
Avec une constance qui confine l'obstination, les pouvoirs publics cherchent
donc depuis des dcennies et sans le moindre succs s'opposer aux choix des
usagers. Inchange quels que soient les gouvernements, cette politique illusoire
et antilibrale a englouti et continue d'engloutir des montagnes d'argent public
et est ruineuse pour le pays.
Quelques chiffres permettent de mesurer l'ampleur du dsastre. Les recettes
que la SNCF peroit directement auprs de ses clients s'lvent annuellement
moins de 8 milliards d'euros, dont 6,5 pour les voyageurs et 1,4 pour le fret,
auxquels il faut ajouter 1 milliard pour les activits annexes. En regard, les d-
penses consacres chaque anne par la nation aux chemins de fer se montent
plus de 20 milliards d'euros, dont plus de 13 milliards au titre des charges d'ex-
135
ploitation, 4,5 celui des investissements et 2,5 pour les frais financiers qui sub-
sistent malgr les versements considrables effectus chaque anne par l'tat
pour allger la dette abyssale des chemins de fer.
Il n'y a pas besoin de grands calculs pour constater que la charge pour les fi-
nances publiques, c'est--dire pour le contribuable, est de l'ordre de 12 mil-
liards d'euros. De surcrot, elle ne cesse d'augmenter vive allure
1
.
Des effectifs plthoriques
Les seuls salaires et charges de la SNCF excdent dj 8 milliards et sont donc
suprieurs aux recettes du trafic ! Il faut dire que l'volution des effectifs de la
SNCF ne manque pas de surprendre, et que la comparaison avec les autres pays
europens est accablante. Ceux-ci ont compris que la premire action condui-
re pour rduire le gouffre financier de leurs chemins de fer tait d'agir sur la
masse salariale. Au cours des douze dernires annes, l'Allemagne a rduit ses
effectifs ferroviaires de 481 000 214 000 et une nouvelle diminution de 50 000
est en cours ; l'Italie est passe de 200 000 97 000 ; l'Espagne de 49 000
30 000 ; la Grande-Bretagne de 135 000 75 000. En moyenne, la chute des
effectifs ferroviaires europens a t de moiti. Les rseaux trangers ont ajust
autant que faire se pouvait leurs ressources humaines la ralit des tches
accomplir et la dimension du march ferroviaire. Non seulement ils ont prati-
quement cess tout recrutement et mis profit les dparts la retraite, mais ils
ont le plus souvent encourag vigoureusement et avec succs les dparts volon-
taires. Nous avons fait exactement l'inverse.
Nous avons continu recruter massivement, un peu moins lors des an-
nes 1990 1996, hors de toute raison au cours des annes 1997 2002 avec un
rythme annuel moyen de 8 000 embauches qui a permis Jean-Claude Gayssot,
ministre des Transports du gouvernement Jospin, d'annoncer lorsqu'il a quitt
ses fonctions qu'il tait fier d'avoir fait recruter 40 000 cheminots dont 3 000
cadres, que devront payer les contribuables pendant des dcennies. Depuis lors,
les embauches ont continu un rythme soutenu. La simple mise en parallle
avec ce qu'ont fait nos voisins montre que si nous avions procd comme eux, la
SNCF compterait aujourd'hui aux alentours de 100 000 cheminots tout au plus,
soit 70 000 de moins qu' l'heure actuelle.
Tel est le constat de l'incroyable drive qui a t la ntre, et qui est d'autant
plus tonnante qu'elle concerne tout autant l'volution des investissements. En
quatre ans, de 2000 2004, ceux-ci ont presque doubl, passant de 2,54 4,3
milliards d'euros, niveau surraliste quand on le met en parallle avec un chif-
1
URF (Union routire de France), Statistiques du transport en France, 2006 (Internet).
136
fre d'affaires de l'ordre de 8 milliards et qu'on le compare ce que nous d-
pensons pour les autres investissements publics. Et RFF prvoit d'accrotre en-
core fortement ces sommes, pour raliser 10 nouvelles lignes grande vitesse
dont aucune n'est rentable, au prix de dpenses annuelles suprieures 4 mil-
liards d'euros. Au total, 2 800 kilomtres sont annoncs, qui permettront aux
usagers des chemins de fer, qui appartiennent en majorit aux classes aises, de
gagner quelques dizaines de minutes. Il faut ajouter que ces projets n'apporte-
ront aucune recette nouvelle significative. La plupart engendreront mme des
dpenses d'exploitation nouvelles, et des dficits supplmentaires.
Quelle est l'entreprise qui, ne couvrant pas la moiti de ses cots, investirait
allgrement des sommes aussi exorbitantes et acclrerait encore le rythme de
ses investissements sans la moindre perspective de retour et aux frais du seul
contribuable, alors mme que le chemin de fer assure aujourd'hui moins du
vingtime des transports du pays ?
Un gaspillage l'chelle nationale
Pour illustrer les errements en cours dans le domaine des investissements, des
dizaines d'exemples de gaspillage des deniers publics peuvent tre cits. C'est
ainsi que la voie ferre Niort-La Rochelle fait l'objet de travaux d'un cot
de 116 millions d'euros, dont le contribuable national acquitte l'essentiel par le
canal de l'entreprise publique Rseau ferr de France (RFF) qui a dsormais en
charge l'infrastructure ferroviaire. En portant la vitesse maximale de 140 220
kilomtres l'heure, le but est de permettre au TGV Paris-la Rochelle de ga-
gner 7 minutes sur son parcours, ce qui n'amnera pas un touriste de plus dans
la belle cit charentaise, ni un euro de recette supplmentaire la SNCF
1
. Lors-
qu'on connat l'ampleur des besoins qui existent dans de multiples autres do-
maines, on demeure confondu. C'est ainsi que nos universits crient misre.
Certaines n'ont mme pas assez d'argent pour se chauffer dcemment, et la
premire d'entre elles figure au 65
e
rang du classement mondial. Celle de La
Rochelle elle-mme n'a pas le minimum requis pour uvrer correctement. Son
budget de fonctionnement n'excde pas 3 millions d'euros hors charges salaria-
les pour 7 000 tudiants, et les seuls travaux cits ci-dessus permettraient de le
doubler pendant prs de 40 ans
2
. Dans un autre domaine, l'tat de nos prisons
est une honte nationale dnonce par toutes les enqutes et tous les organismes
internationaux, et il n'y a pas eu jusqu' prsent d'argent pour y remdier...
1
Rail et transports, n
o
316, 28 janvier 2004.
2
Le Monde, 24 janvier 2004.
137
116 millions d'euros, c'est aussi le budget annuel de la Direction nationale de
la scurit routire, qui dpend pourtant du mme ministre que la SNCF. Des
milliers de kilomtres de routes nationales sont encore dpourvus des quipe-
ments indispensables que constituent les glissires de scurit, avec pour cons-
quence des dizaines de morts inutiles chaque anne. Neuf millions seulement y
ont t consacrs dans le budget 2005. Manifestement, l'argent public n'a pas la
mme valeur dans le secteur du chemin de fer qu'ailleurs, et ce qu'il faut bien
appeler gaspillage y est considr comme normal.
La liaison avec La Rochelle n'est pas seule en cause. On peut aussi citer
les 135 millions dpenss pour que les voyageurs destination de Saint-Malo
n'aient pas changer de train Rennes et gagnent quelques minutes, les 107
millions en cours de travaux pour lectrifier la ligne Tours-Vierzon dont le trafic
est pratiquement inexistant, qu'il s'agisse des voyageurs ou des marchandises.
Tout se passe comme si, dans le domaine des transports ferrs, l'argent public
n'avait pas la mme valeur qu'ailleurs, et qu'un euro n'y vaille pas un euro.
Lorsqu'un pays dpense de l'argent pour des choses qui ne servent rien, il
ne faut pas s'tonner qu'il n'en ait pas pour ce qui est ncessaire, ce qui conduit
une interrogation d'ordre plus gnral. A la question Qui est en charge de la
cohrence des dpenses publiques au sein du monde politique et administra-
tif ? , il faut malheureusement rpondre jusqu' prsent : Personne. Sinon,
qui pourrait expliquer de telles aberrations ?
Un mensonge d'Etat
Le plus choquant est enfin le maquillage des comptes. Si les dpenses en fa-
veur des chemins de fer taient faites dans la clart, aprs des dbats dmocrati-
ques, il n'y aurait rien dire. Mais tout est fait pour qu'il n'en soit rien et que
personne ne sache ce qui se passe, ce qui conduit poser une simple question :
comment la SNCF, dont l'activit cote chaque anne 12 milliards d'euros au
contribuable, peut-elle afficher des bnfices ?
La rponse est simple et, compte tenu de l'ampleur des sommes en cause, le
terme de mensonge d'Etat est le seul qui convienne. Les chiffres affichs par
l'entreprise sont entirement artificiels et n'ont aucun sens. Ils dcoulent du fait
que l'tat, avec le concours d'autres collectivits publiques qu'il a entranes
dans la dpense, a adopt au cours des ans une srie de dispositions destines
travestir la ralit, faisant preuve en l'occurrence d'une imagination qu'on ai-
merait lui voir utiliser meilleur escient.
Le gouffre qui spare les dpenses en faveur des chemins de fer des recettes
est masqu sous les intituls les plus divers : compensations tarifaires, concours
138
lis aux transports rgionaux, subventions pour le transport combin, service
d'amortissement de la dette, subventions d'investissement, contribution aux
charges d'infrastructures, taxe d'amnagement du territoire, versement trans-
port, participation des rgions, couverture du dficit rsiduel, et beaucoup
d'autres encore.
L'un des avatars les plus rcents et les plus graves de cette longue liste a t la
cration en 1997 d'un deuxime tablissement public aux cts de la SNCF : le
Rseau ferr de France (RFF). RFF a eu pour vocation de prendre en charge
d'une part les infrastructures, d'autre part l'essentiel de l'endettement pass de
la SNCF qui tait notamment d aux investissements raliss en faveur du TGV.
En compensation, il tait cens percevoir une redevance d'exploitation du r-
seau auprs de la SNCF. En fait, le dispositif a t totalement dvoy et RFF ver-
se la SNCF au titre de l'entretien du rseau plus que l'argent qu'il peroit au
titre des redevances d'exploitation !
En 2005, RFF a bien reu de la SNCF 2,29 milliards d'euros, mais lui en a ver-
s 3,52. Non seulement RFF a repris sa charge la majorit de l'endettement de
la SNCF, mais, aussi tonnant que cela puisse paratre, ce propritaire donne de
l'argent son locataire.
En rsum, la SNCF qualifie de recettes les subventions multiples qu'elle reoit
par les canaux les plus divers, ce qui lui permet d'afficher des comptes bnfi-
ciaires alors que le contribuable paye sans le savoir de plus en plus chaque an-
ne. Si l'on s'intresse par exemple aux TER, on constate qu'ils figurent dans
les comptes de la SNCF avec un solde positif de plusieurs dizaines de millions
d'euros par an, alors qu'ils cotent plus de 3 milliards aux finances publiques,
comme en tmoignent les budgets des rgions.
Dans de telles conditions, les comptes de la SNCF n'ont aucun sens, et il est
possible d'afficher n'importe quel rsultat. Ceci n'empche pas toute la presse
franaise d'avoir lou l'entreprise pour le redressement de ses comptes , qui
n'est que la traduction de la capacit de ses dirigeants et de ses ministres de tu-
telle avoir obtenu le plus d'argent possible de nos finances publiques.
La dsinformation atteint des proportions insouponnes quand la SNCF pu-
blie dans toute la presse aux frais du contribuable des placards affirmant par
exemple que pour la troisime annes conscutive, la SNCF obtient des rsul-
tats positifs, signe d'un grand groupe public bien gr et dynamique [sic] .
Certains font d'ailleurs preuve d'une souplesse intellectuelle surprenante.
Aprs avoir recrut sans justification relle 60 000 cheminots aux frais du
contribuable alors qu'il prsidait la SNCF, la premire dcision de Louis Gallois,
nomm la tte d'EADS, fut d'arrter les embauches et de contraindre les en-
treprises du secteur aronautique rduire drastiquement leurs effectifs pour
139
quilibrer leurs comptes. Ce qui tait justifi pour le transport ferr ne l'tait
manifestement pas pour le transport arien...
Travestir autant la vrit ne serait pas tolr dans un pays du tiers-monde, et la
communaut internationale l'obligerait y renoncer, car les consquences de
telles pratiques sont trs graves. Celles-ci conduiraient d'ailleurs des responsa-
bles d'entreprises prives devant les tribunaux. A partir du moment o les
comptes n'ont aucun rapport avec la ralit et o l'tat comble aveuglment les
dficits, rien ne s'oppose l'accroissement indfini des dpenses, qu'il s'agisse
de recruter chaque anne des milliers d'agents que ne viendra jamais payer au-
cune recette ou de procder aux investissements les plus indfendables. Le
comble est atteint lorsque les syndicats demandent logiquement que leur soit
attribue une juste part des bnfices !
Il ne faut pas s'tonner non plus que, dans de telles conditions, l'opinion
franaise ait une vision minemment positive des entreprises publiques et soit
en consquence rticente l'gard de l'entreprise prive.
Cette spcificit nationale est illustre par les tonnants rsultats d'un sonda-
ge ralis en 2004 par l'Institut Ipsos
1
. La question pose tait la suivante :
Certains disent que l'entreprise prive est plus efficace que l'entreprise publi-
que. tes-vous d'accord ? Seules 54 % des personnes interroges ont dclar
tre d'accord avec la proposition, 46 % tant d'un avis contraire. Autrement dit,
les Franais sont partags pour moiti. Encore, parmi les 54 % qui ont exprim
une opinion favorable l'efficacit de l'entreprise prive, seuls 24 % taient-ils
tout fait d'accord . Moins d'un Franais sur quatre est vraiment convaincu
que l'entreprise prive, c'est--dire soumise la concurrence, est plus efficace
que l'entreprise publique, qui ne l'est gnralement pas.
Il s'agit l d'un rsultat qui stupfierait tous les trangers qui savent que, cha-
que fois qu'on ouvre la concurrence une activit exerce par une entit qui en
est abrite, les gains de productivit sont considrables. Si un institut de sonda-
ge avait un jour la curiosit de poser la question au niveau mondial, il constate-
rait sans aucun doute que, dans tous les pays sauf le ntre, la proportion de
ceux qui estiment que l'entreprise prive est plus efficace que l'entreprise pu-
blique est proche de 100 %.
Deux causes se conjuguent pour expliquer la relation d'amour des Franais
avec leurs entreprises publiques.
Techniquement, celles-ci sont d'abord presque toujours mieux gres que
leurs homologues trangres. Dotes par tradition d'ingnieurs de haut niveau
dont beaucoup sont issus des meilleures coles, elles assurent, tout au moins sur
le plan technique, une qualit de service souvent leve. A l'tranger, chacun
1
Sondage Ipsos/FFAC, juin 2004.
140
sait que ce qui est public ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Ce n'est pas tou-
jours le cas en France, loin de l.
Mais il est une autre cause qui explique les tonnants rsultats du sondage cit
ci-dessus. Nos compatriotes ignorent que ces succs techniques sont le plus sou-
vent obtenus au prix de surcots financiers qui tournent au dsastre. Ces der-
niers sont inconnus des Franais, car tout est fait pour les leur cacher. Le men-
songe est la rgle, du fait des efforts conjugus des technostructures de l'tat et
des entreprises publiques d'une part, et des organisations syndicales de l'autre.
Les unes et les autres uvrent pour dsinformer et masquer la ralit, au m-
pris des principes fondamentaux qui devraient tre ceux d'une dmocratie di-
gne de ce nom. La premire dclaration des Droits de l'homme ne stipule-t-elle
pas que les citoyens ont le droit de constater, par eux-mmes ou par leurs re-
prsentants, la ncessit de la contribution publique et d'en suivre l'emploi ?
Rien n'illustre mieux l'tendue de ces mensonges que l'incroyable situation de
nos transports ferrs et publics.
Des trains fantmes
La vrit, c'est que trois des cinq activits de la SNCF ont pratiquement cess
d'exister en regard de ce qu'elles cotent. Alors qu'il mobilise des dizaines de
milliers d'agents, le fret ferroviaire ne joue plus qu'un rle symbolique dans la
satisfaction de nos besoins de transport de marchandises. Sauf sur quelques liai-
sons, son trafic est drisoire et il ne survit que sous perfusion permanente et
massive d'argent public. La situation se prsente de manire similaire pour les
TER qui, l'exception d'un nombre restreint des lignes au voisinage des gran-
des mtropoles, sont manifestement du ressort de l'autocar et non du train. Il
faut ajouter cette numration des marchs disparus les liaisons transversales
du rseau grandes lignes, comme le reconnat elle-mme la SNCF qui en de-
mande la suppression, car elles n'ont pratiquement plus de voyageurs. A elles
trois, ces activits dont les recettes sont marginales en regard des cots occupent
plus de la moiti des cheminots.
Les deux activits indiscutables restantes, que personne ne songe remettre
en cause, c'est--dire les TGV et le rseau ferr de l'le-de-France, pourraient fonctionner
avec moins de la moiti des effectifs actuels de la SNCF.
Il s'agit d'un gigantesque gaspillage, que seul explique le manque de courage
de nos responsables politiques qui, par crainte des syndicats, n'ont jamais dit la
vrit sur les comptes de nos chemins de fer et entretiennent l'opinion publi-
que et les cheminots dans des illusions qui ne peuvent qu'entraner incompr-
hension et accroissement indfini de dpenses inutiles.
141
Comme le concluait dans son ouvrage dj cit Francis Mer, l'issue de son
exprience de ministre des Finances : La SNCF est un des exemples les plus
concrets et les plus parlants des gaspillages effectus en large connaissance de
cause, par pure inconsquence politique... Mais les politiques ne veulent pas
remettre en cause les choix budgtaires fous, car ils ont russi convaincre
l'opinion, en lui cachant la vrit, que ces options taient les bonnes... Cela ar-
range bien les trois catgories qui ont conclu une alliance objective tacite : les
cheminots, les colos et les lus locaux. Il devrait pourtant y avoir plus de gloi-
re pargner l'argent du contribuable qu' multiplier les dpenses injustifies.
142
CHAPITRE XI
Nos villes paralyses
Il n'est gure de visiteur tranger qui ne soit aujourd'hui bloui par la Chine.
Lorsqu'il se trouve Shanghai sur la promenade historique du Bund, il voit en
face de lui, de l'autre ct du fleuve Huangpu, l'un des plus beaux panoramas
du monde. L o il n'y avait rien il y a dix ans, c'est Manhattan, en plus grand et
en plus beau. perte de vue, ce sont des immeubles de plus 200 mtres de
haut, et parfois de prs de 500. On dit qu'il y avait la moiti des grues du monde
Shanghai. On veut bien le croire lorsqu'on dcouvre ce quartier nouveau, du
nom de Pudong, surgi des rizires comme par un coup de baguette magique.
Des architectes franais lui ont d'ailleurs apport une contribution dterminan-
te, puisque c'est le quartier de La Dfense qui l'inspira au dpart et l'avenue des
Champs-lyses qui servit de modle son axe majeur, la Century Avenue .
C'est aussi un architecte franais, Paul Andreu, qui a construit Pkin l'Opra
national destin devenir un symbole de la ville, comme la Tour Eiffel est celui
de Paris. Shanghai n'est donc pas une exception, et la Chine est un immense
chantier, avec une dizaine de villes approchant o excdant dix millions d'habi-
tants, dont nous ignorons jusqu'au nom pour la plupart.
La Chine communiste choisit... la route
Mais cette frnsie ne concerne pas que les immeubles de grande hauteur
que l'on trouve galement par milliers Beijing (Pkin), Guangdoung (Can-
ton), Wuhan, Xian et ailleurs. Ce que l'on ne sait pas en gnral, c'est que la
Chine mne aujourd'hui le plus grand projet de gnie civil de tous les temps
auquel elle consacre chaque anne plus de 2 % de son PIB. En 1988, elle comp-
tait en tout et pour tout 18 kilomtres d'autoroute. En 1993, elle en recensait
un peu plus d'un millier. Aujourd'hui, gure plus de dix ans plus tard, 50 000
kilomtres d'autoroutes sont en service, et le rseau quadrille dsormais l'essen-
tiel du pays du nord au sud et de l'est l'ouest, dsenclavant ainsi les rgions les
plus recules de l'Empire du Milieu. Il suffit pour le constater de faire l'acquisi-
tion des cartes routires rcentes de la Chine dont le seul dfaut est de n'tre
143
jamais jour, car 5 000 nouveaux kilomtres d'autoroutes sont ouverts la cir-
culation chaque anne. Et le programme est loin d'tre termin, puisque l'ob-
jectif officiel est de 85 000 kilomtres avec 9 itinraires nord-sud et 18 est-ouest,
dont on peut parier qu'ils seront raliss d'ici une dizaine d'annes. La Chine
sera alors le premier pays autoroutier du monde, devant les tats-Unis. Faut-il
rappeler que notre pays, dont le produit intrieur brut tait suprieur celui de
la Chine jusqu' une date trs rcente, a mis prs d'un demi-sicle pour se doter
d'environ 12 000 kilomtres d'autoroutes, et qu'il fait trs bonne figure en Eu-
rope ?
La desserte du nouveau port de Shanghai illustre quel point la Chine a mis
sur la route pour son dveloppement. Confronte l'insuffisance de tirant
d'eau de son port traditionnel du fleuve Bleu et l'impossibilit de l'agrandir
sur place, la ville de Shanghai a dcid d'en construire un nouveau au large,
dans plusieurs lots situs en eau profonde. Ralis en deux ans, celui-ci est do-
rnavant reli la cte par un pont de 32 kilomtres de long. L'exploit est vi-
demment tonnant. Mais ce qui est plus tonnant encore pour nous, c'est que
ce pont supporte exclusivement une autoroute. Le nouveau port de Shanghai,
dornavant le plus grand du monde, n'est pas desservi par le fer, l'poque o
nous cherchons coup de centaines de millions d'euros et sans aucun succs
faire en sorte que les marchandises qui arrivent dans nos ports, tels que Le Ha-
vre dont le trafic n'atteint pas le dixime de celui de Shanghai, en repartent en
train.
Les prouesses techniques chinoises laissent d'autant plus sans voix que le pro-
gramme ne concerne pas que les autoroutes interurbaines, les moins difficiles
raliser. Pkin est en train de boucler sa sixime rocade autoroutire. Tout le
territoire de la capitale chinoise est dsormais quadrill d'un gigantesque da-
mier de voies rapides, puisque neuf autoroutes radiales s'ajoutent aux six auto-
routes circulaires et que de gigantesques changeurs quatre niveaux les
connectent partout entre elles, au grand bnfice de l'efficacit conomique de
la capitale chinoise. Les relations entre les diffrents quartiers de la mtropole
ne requirent plus que quelques dizaines de minutes si l'on met part les en-
combrements des heures de pointe dans le quartier central d'o les vlos ont
pratiquement disparu et o ils sont dsormais remplacs par des flots ininter-
rompus de voitures.
A contrario, seules deux lignes de mtro sont aujourd'hui en service Pkin,
mme si d'autres sont en construction. Et la situation est la mme dans toutes
les grandes mtropoles de l'Empire du Milieu o se droulent de gigantesques
chantiers autoroutiers, ce qui ne peut manquer d'interpeller le visiteur franais.
Quelles sont les raisons d'une priorit aussi manifeste en faveur de la route de
la part d'un pays qui avait le libre choix de sa politique de transport ?
144
Il n'y a l aucun mystre. Aprs analyse, les responsables chinois sont arrivs
la conclusion que la route tait le mode de transport le plus performant et le
plus apte favoriser leur dveloppement conomique, en mme temps qu'
propager celui-ci dans les provinces les plus recules. Jamais le rseau ferr,
mme s'il avait bnfici d'investissements aussi massifs, n'aurait pu faire face
au rythme actuel d'expansion des changes de marchandises. C'est leur trans-
port par des millions de camions sur les autoroutes nouvellement construites
qui a permis d'viter au cours des annes rcentes le blocage d'une conomie
chinoise en quasi-surchauffe permanente. Le march chinois des camions est
d'ores et dj le premier du monde, avant celui des tats-Unis et de l'Europe.
Est-il besoin d'ajouter que la construction de lignes de mtro dans les zones ur-
baines, beaucoup plus coteuse de surcrot que celle des autoroutes, n'aurait
gure t d'une grande utilit pour le transport des marchandises indispensa-
bles au fonctionnement d'un pays qui n'est aujourd'hui qu'un vaste chantier ?
Le fait que ces autoroutes ne soient pas seulement interurbaines, mais qua-
drillent aussi le territoire des villes chinoises, appelle une autre rflexion. Mani-
festement, ce n'est pas seulement pour les camions qu'elles sont construites. Ce
gigantesque rseau a t conu avec l'ide sous-jacente que tous les Chinois au-
ront un jour prochain, comme les habitants des pays dj dvelopps, accs la
voiture.
C'est bien ce qui se passe dj dans les trois grandes villes riches, Pkin,
Shanghai ou Canton. Partie de rien, la Chine est devenue le deuxime mar-
ch automobile mondial, devanant en 2005 pour la premire fois le Japon avec
plus de 6 millions de vhicules vendus.
D'ici peu cinq ans, dix ans ? , elle aura dpass les tats-Unis. Et elle com-
mence bien entendu crer une industrie nationale, comme il fallait s'y atten-
dre.
Certes, la Chine va maintenant se doter aussi d'un rseau ferr grande capa-
cit pour relier ses grandes villes. Mais celui-ci ne viendra qu'aprs les autorou-
tes. Ironie du sort, sa longueur n'excdera pas 25 000 kilomtres, ce qui corres-
pond peu de chose prs celle du rseau ferr emprunt par nos TER dont la
plupart circulent pratiquement vide.
Trois ans au lieu de vingt
Qu'il me soit permis, pour conclure sur la Chine, de citer une anecdote per-
sonnelle. Ayant t invit en 2001 par la ville de Shanghai pour une expertise
sur ses projets de transport, j'ai eu l'occasion d'expliquer au directeur gnral
de ses services que la France tait en voie de raliser une premire mondiale.
145
Nous allons en effet d'ici peu boucler l'autoroute A 86 l'ouest de l'le-de-
France par un tunnel routier d'une conception trs innovante puisqu'il com-
portera deux niveaux de circulation au lieu d'un, et que sa capacit sera donc
double de celle d'un ouvrage traditionnel. Propos pour la premire fois
en 1988, l'ouvrage sera partiellement mis en service en 2008, aprs d'innom-
brables pripties juridiques. Mon interlocuteur chinois sembla fascin par une
telle perspective et me dclara qu'il n'en avait jamais entendu parler.
Rentr en France, j'oubliai cette conversation jusqu'au jour o je dcouvris au
hasard de la lecture d'une revue technique que la ville de Shanghai venait
d'inaugurer en novembre 2004 le premier tunnel routier deux niveaux au
monde. L o il nous aura fallu prs de vingt ans, trois avaient suffi. Ceux qui se
rendent dans la capitale conomique chinoise peuvent dsormais traverser le
Huangpu par le Fuxing Road Tunnel deux niveaux, ce qui leur permettra
d'imaginer comment se prsentera le futur souterrain de l'A 86, qui aurait d
tre une premire mondiale et ne le sera pas.
La Chine n'est pas la seule avoir vu que le transport par route tait la base
du fonctionnement des conomies modernes. Les nouveaux membres de
l'Union europenne l'ont galement compris, malgr les objurgations de la
Commission de Bruxelles qui leur demande sans cesse de miser grande chel-
le sur le transport ferr. Lorsqu'elle leur tient ce langage, la rponse des res-
ponsables concerns est toujours la mme : Vous avez bti votre prosprit sur
l'automobile, le camion, et la route. L'Europe de l'Ouest est dsormais quadril-
le de l'un des rseaux autoroutiers les plus denses du monde. Au nom de quoi
voulez-vous nous interdire d'en faire autant ? La Pologne est ainsi qualifie
Bruxelles de mauvais lve . Au lieu de consacrer 50 % des investissements de
transport la voie ferre comme le lui demande avec insistance la Commission,
elle a dcid juste titre de ne lui en accorder que 20 % au plus et de mettre au
premier rang de ses priorits la construction des autoroutes qui lui font aujour-
d'hui cruellement dfaut prs de vingt ans aprs la chute du mur de Berlin !
L'exception europenne
En Europe de l'Ouest, et tout particulirement en France, c'est une autre vi-
sion des choses qui prvaut, notamment pour nos villes. Au nom de la dfense
de l'environnement, les responsables s'efforcent trs grands frais et en vain d'y
susciter l'usage des transports publics. Quelques chiffres suffisent dresser le
tableau pour notre pays. Il faut rappeler tout d'abord que les transports publics
n'assurent gure plus d'un dplacement quotidien sur dix en France, et que
146
c'est dsormais l'automobile qui est le transport de masse, c'est--dire le trans-
port social de notre poque.
La situation financire des transports en commun est fidlement retranscrite
chaque anne dans les rapports parlementaires publis l'occasion du vote du
budget
1
. On y apprend ainsi que, pour 2002 par exemple, le total des dpenses
en leur faveur s'est lev 11 milliards d'euros dont les usagers ont acquitt prcis-
ment 2,7 milliards, soit moins du quart, laissant la charge des contribuables plus
de 8 milliards d'euros ! dont 5 milliards pour l'le-de-France et 3,3 pour la provin-
ce. Nous sommes le pays qui dpense le plus au monde pour ses transports en
commun en regard de notre population.
Aux antipodes de la vrit des cots
La clientle des transports en commun n'est pourtant pas ce qu'on pourrait
imaginer. En province, il s'agit en grande partie de jeunes qui n'ont pas encore
le permis de conduire et qui sont issus de tous les milieux, voire des plus aiss
lorsqu'il s'agit d'tudiants. En le-de-France, le mtro, le RER et beaucoup d'au-
tobus parisiens sont massivement frquents par les membres des catgories so-
ciales moyennes ou suprieures, sans parler de nombreux touristes. Quant aux
plus pauvres, ils se dplacent peu, quels que soient les tarifs pratiqus.
Est-il alors vraiment justifi de subventionner autant les transports en com-
mun ? Avec les sommes en cause, il serait possible de faire tellement plus, si le
but poursuivi tait celui de la redistribution sociale. Le calcul est vite fait. Selon
l'Insee
2
, l'le-de-France recense 250 000 foyers qui disposent de moins de 900
euros par mois pour vivre. Les 5 milliards d'euros de contribution publique an-
nuelle aux transports publics franciliens permettraient de verser chacun de ces
foyers, qui regroupent environ 500 000 personnes, 1 600 euros par mois au-del
des revenus dont ils disposent aujourd'hui, ce qui triplerait leurs ressources. Il
est de bon ton de dnigrer la politique suivie de l'autre ct de la Manche o
les tarifs des transports en commun sont beaucoup plus levs, comme le cons-
tate avec tonnement le Parisien qui compare le prix du billet du Tube lon-
donien au minimum 3 , c'est--dire 4 euros et celui de son ticket de mtro
peine plus d'un euro s'il l'achte en carnet, et moins encore avec une Carte
orange.
Mais sommes-nous certains d'avoir raison ? Certes, le rseau londonien est en
partie vtuste, faute d'investissements suffisants dans le pass, et de ce point de
vue la comparaison nous est incontestablement favorable, mme si une politi-
1
Avis de la commission des Affaires conomiques du Snat sur le projet de loi de Finances.
2
L'le-de-France la page , Insee, n
o
228, octobre 2003.
147
que de modernisation vigoureuse est dsormais engage outre-Manche. Mais la
question n'est pas l. Ce ne sont pas les dpenses d'investissement qui font l'es-
sentiel de la diffrence. Le Tube couvre, et au-del, la totalit de ses frais
d'exploitation, alors que l'usager francilien n'en n'acquitte qu'un tiers environ,
et que la contribution publique doit assurer la majeure partie de la dpense. La
situation est tout aussi dsquilibre en province et parfois plus encore.
Peut-tre y aurait-il un juste milieu trouver entre ce que font nos voisins an-
glais et notre pratique nationale ? Que l'usager, y compris l'habitant des quar-
tiers aiss de Paris et le touriste tranger, ne paye pas tous les cots, peut-tre,
mais le tiers, le quart, voire le cinquime ? Faut-il vraiment subventionner les
riches ?
La fin des tramways : le busway
Ne serait-il pas possible galement de rechercher des solutions techniques
moins coteuses ? Beaucoup de villes se sont dotes rcemment de tramways,
qui ne prsentent pas que des avantages mme s'ils bnficient le plus souvent
de la faveur des habitants. Qu'ils soient sur fer ou sur pneus, les tramways sont
beaucoup plus rigides que les autobus qu'ils remplacent, puisqu'ils ne peuvent
quitter leurs rails, alors que plusieurs lignes d'autobus peuvent emprunter une
mme section de voie. Ils sont en outre trs onreux, qu'il s'agisse de l'infras-
tructure qu'il faut crer pour eux ou de leur matriel roulant de type ferroviai-
re, et il faut compter le plus souvent 300 millions d'euros ou plus pour une seu-
le ligne, ce qui est considrable l'chelle de la plupart des villes de province.
Pourtant, la cration de lignes de tramway n'a jamais chang significativement
la rpartition entre les modes de transport, comme l'a constat la ville qui a fait
le plus d'efforts en leur faveur. Malgr la construction trs grands frais de trois
lignes de tramways, la frquentation des transports en commun n'a pas vari
sensiblement Nantes. Elle a mme rcemment diminu. De 1997 2002, selon
l'enqute officielle la plus rcente, la proportion des dplacements effectus en
transports en commun a rgress de 14,2 % 13,9 %, alors que celle de la voitu-
re augmentait de 58,6 % 61,6 % et plus encore en banlieue. C'est que l'accs
au centre-ville est devenu si difficile pour les automobilistes, du fait des espaces
rservs au tramway et des obstacles mis l'usage de la voiture, que beaucoup
d'habitants n'y vont plus gure. Ils vont faire leurs achats dans les commerces
priphriques dont la politique de la mairie a bien involontairement fait la for-
tune le long de la rocade autoroutire qui ceinture la ville et qui est dsormais
l'axe majeur de transport de l'agglomration avec 400 000 usagers quotidiens
contre moins de 100 000 pour le rseau des tramways qui a mobilis depuis
148
deux dcennies l'argent des contribuables nantais ! Nantes ne fait pas excep-
tion. Partout en France, les maires semblent avoir oubli que l'automobile assu-
re en province plus de huit dplacements sur dix, et qu'il faudrait se fixer
comme objectif gnral et prioritaire, si l'on veut amliorer la vie des habitants,
de faciliter sa circulation plutt que de la compliquer, mme si des exceptions
localises peuvent tre justifies.
Mais Nantes doit tre galement cite pour une innovation particulirement
intressante. Elle a en effet choisi pour sa quatrime ligne, inaugure en no-
vembre 2006, une solution technique qui part d'un constat simple. Puisque le
tramway bnficie d'une image positive dans l'opinion, pourquoi ne pas habil-
ler des autobus articuls en tramways, qui rendraient un service quivalent tout
en cotant beaucoup moins cher puisqu'ils ne ncessiteraient ni la pose de rails
ni celle de catnaires par ailleurs minemment inesthtiques ? Au lieu du tram-
way, ce serait un busway , dont le nombre d'lments et la frquence de pas-
sage seraient ajusts au trafic. L'ide peut paratre saugrenue, mais elle ne l'est
pas. Les usagers qui empruntent aujourd'hui la quatrime ligne de Nantes
croient qu'ils montent dans un tramway, mais il n'en est rien. Ils empruntent un
busway, dont chacun peut retrouver la photo sur Internet. La diffrence la plus
importante est d'ordre financier. parcours gal, un busway cologique fonc-
tionnant au gaz naturel cote trois fois moins cher qu'un tramway classique,
tout en tant beaucoup plus souple puisque ses vhicules peuvent, comme tout
autobus, emprunter n'importe quelle rue parce qu'ils ne sont pas assujettis
des rails.
Il ne faut donc pas s'tonner que le maire de Toulon, Hubert Falco, ait dcla-
r la fin de 2006 qu'il ne voyait pas pourquoi il lui faudrait payer trois plus
cher pour un tramway classique que pour un busway ou BHNS (bus haut ni-
veau de service) qui ferait pargner ses administrs 200 millions d'euros d'in-
vestissement inutile.
On ne peut que regretter que la Ville de Paris n'ait pas retenu cette solution
pour la ligne qu'elle vient de mettre en service et qui a donc cot inutilement
trs cher ses contribuables.
Ceci n'empche pas d'innombrables documents de plaider pour accrotre en-
core les dpenses publiques en faveur des transports en commun parce qu'ils
seraient plus sociaux que la voiture. Ces rapports sont tous convergents par-
ce qu'inspirs par le groupe de pression que constituent les entreprises en
charge des rseaux de transport public dont le poids est la mesure des masses
d'argent qu'elles reoivent. Il suffit d'en lire un pour les connatre tous.
149
Un rapport rvlateur
Une illustration de la propension d'une grande partie de notre classe politi-
que tomber dans les piges qui lui sont tendus est ainsi fournie par le Rapport
sur le financement des dplacements urbains remis au Premier ministre la fin
de 2003 par Christian Philip, dput UMP du Rhne, et qui fait dsormais rf-
rence.
Contrairement ce qu'on aurait pu attendre, ce document ne comporte tout
d'abord, malgr son titre, aucune analyse de ce que sont aujourd'hui les dpla-
cements urbains. Le fait que prs de 90 % de ceux-ci qui sont motoriss soient
assurs par l'automobile, contre 10 % par les transports publics, n'est pas mme
mentionn. Ne sont considrs comme dplacements urbains que ceux qui
ont recours aux transports en commun, comme si les autres, c'est--dire la trs
grande majorit, n'existaient pas.
Le premier chapitre s'intitule Pourquoi faut-il agir ? , mais on y chercherait
en vain une quelconque analyse de l'volution des dplacements urbains, ce qui
aurait amen constater que la clientle des transports publics stagnait presque
partout un niveau trs minoritaire quoi qu'on fasse.
Selon les auteurs du rapport, s'il faut agir d'urgence, c'est tout simplement
parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour satisfaire les besoins d'investissement
exprims par les responsables des transports publics de l'ensemble des agglo-
mrations franaises. Ceux-ci, selon les scnarios, s'tablissent 9,5 ou 12,5 mil-
liards d'euros par an, somme incroyable pour un secteur d'activit o les recet-
tes perues auprs des usagers s'tablissent 2,5. Il faudrait donc investir an-
nuellement quatre fois le chiffre d'affaires ! La charge annuelle pour les contri-
buables, qui s'lve dj 8,3 milliards d'euros par an, exploitation comprise,
passerait plus de 15 milliards !
Dans ces conditions, il ne faut pas s'tonner des conclusions dposes. Celles-
ci ne font que reproduire la litanie des requtes qu'avancent anne aprs anne
les multiples acteurs des transports publics, dans l'espoir toujours du d'en-
rayer la stagnation ou la dcroissance de leur clientle et de porter remde
une situation financire catastrophique.
Au nombre de trente et une, ces requtes s'articulent autour de deux ides :
dissuader l'usage de l'automobile, et dgager des ressources supplmentaires
pour les transports en commun, c'est--dire accrotre encore la charge pour le
contribuable. Ce florilge aussi abondant qu'tonnant suggre notamment :
150
la taxation des parkings des bureaux, des centres commerciaux, et mme des super-
marchs, mesure que la gauche elle-mme n'aurait jamais os envisager !
la mise en place de politiques de stationnement dissuasives par la rduction du nom-
bre de places disponibles ;
l'accroissement des tarifs de stationnement sur la voirie et dans les parkings ;
la cessation de la cration de nouvelles voies routires et de nouveaux parkings ;
l'accroissement gnral de ce que payent les usagers de l'automobile, supposs ne pas
assumer le juste cot de celle-ci malgr les sommes qu'ils rapportent aux finances pu-
bliques ;
l'octroi aux collectivits locales de la possibilit d'instaurer une tarification des d-
placements automobiles ;
la cration d'une taxe la vente des vhicules neufs et d'occasion ;
la cration d'une taxe sur les poids lourds.
Les ressources nouvelles ainsi dgages iraient aux transports en commun,
qui bnficieraient en outre :
d'un accroissement de la contribution des employeurs ;
d'une priorit dans l'attribution des fonds structurels de l'tat ;
de l'affectation en le-de-France du produit de centimes additionnels sur la TIPP, etc.
Face ce rquisitoire qui illustre bien les orientations de nos pouvoirs publics,
on demeure confondu. En somme, il faut dpenser toujours plus, sans que nul-
le part le bien-fond de la dmarche ne fasse l'objet de la moindre interroga-
tion. Il faut pnaliser et taxer ce que choisissent la grande masse de nos compa-
triotes, pour favoriser et financer ce qu'ils ne choisissent pas. Il faut s'opposer
leurs souhaits. Il ne faut surtout pas investir l o se situent les besoins, c'est--
dire dans la route.
Ceux qui ont rdig cette tude, comme beaucoup d'autres, sont coups de la
ralit de la vie quotidienne de leurs concitoyens. Ont-ils dj fait leurs courses
dans un supermarch ? Savent-ils ce que c'est que de ramener dans l'autobus, le
tramway ou le mtro les courses pour la famille, un pack de bouteilles d'eau
minrale ou un baril de lessive, souvent avec des enfants de surcrot ? Ils n'ont
pas compris que l'automobile tait devenue le vrai transport social de notre
poque, et que s'opposer son usage par la plus grande masse, c'tait avoir une
singulire conception de la dmocratie.
151
Le bateau ivre
Les consquences de cette politique officielle des transports sont particuli-
rement catastrophiques pour l'le-de-France.
Le cas de la rgion capitale est pourtant simple comprendre. Son desserre-
ment gographique massif a t l'lment dominant du dernier demi-sicle. La
population de Paris intra-muros a ainsi rgress de 2,8 2,2 millions d'habi-
tants, pendant que celle de la petite couronne passait de 2,7 4,2 et que celle
de la grande couronne explosait de 1,7 5 millions. Fort heureusement, les
emplois ont connu une volution parallle, conformment aux orientations du
remarquable schma directeur de 1965 labor par Paul Delouvrier la de-
mande du gnral de Gaulle. Le nombre de postes de travail a ainsi rgress
de 2 millions 1,6 million Paris, alors que celui de la petite couronne s'levait
de 1,6 1,8 million, et surtout que la grande couronne passait de 1 1,7 million
d'emplois.
Les consquences sur les dplacements quotidiens de ce double desserre-
ment, qui s'est accompagn de celui des commerces, des administrations et des
lieux de loisirs, ont t celles qu'on pouvait attendre : les trajets de banlieue
banlieue sont dsormais massivement majoritaires au sein de la rgion, puis-
qu'ils s'lvent plus de 16 millions par jour, contre moins de 4 pour ceux qui
relient la banlieue et Paris, et 3 pour ceux qui s'effectuent Paris intra-muros,
ces deux dernires catgories tant de surcrot en voie de diminution.
Un autre phnomne s'est galement produit au cours du demi-sicle coul.
Comme partout en France, la prsence d'une ou de plusieurs voitures par foyer
est devenue la rgle. Seuls font partiellement exception ceux qui ont la chance
de pouvoir habiter Paris ou en banlieue trs proche, et de bnficier, aux frais
du contribuable, de l'exceptionnel rseau de mtro et d'autobus qui dessert la
capitale, ce qui permet certains d'entre eux de se passer de voiture. Encore
s'agit-il pour beaucoup de personnes seules. Mais au total, la rgion recense
prs de 5 millions de voitures pour 11 millions d'habitants, et la prsence de
deux voitures ou plus par mnage est devenue la norme en grande couronne.
Il ne faut donc pas s'tonner que l'automobile soit dsormais de trs loin le
mode de transport majoritaire au sein de l'le-de-France, et qu'elle assure 15,5
millions de dplacements quotidiens contre 6,8 pour les transports en commun.
Il ne faut pas non plus s'tonner que le trafic de ces derniers, qui ne sont
vraiment commodes que pour la desserte du centre de l'agglomration et l'ac-
cs celui-ci, stagne, dans l'ensemble, obstinment depuis un demi-sicle, puis-
que leur frquentation s'levait dj 7,2 millions de passagers quotidiens
en 1955, une poque o celle de l'automobile ne dpassait pas 3 millions
contre plus de 15 aujourd'hui.
152
En dfinitive, le choix des usagers en faveur d'un mode de transport ou d'un
autre est avant tout gographique, et n'est en rien li leur appartenance socia-
le ou leurs prfrences personnelles.
Il suffit pour s'en convaincre de comparer deux des plus importantes zones
d'activit de la banlieue francilienne. Sur les 150 000 personnes qui travaillent
La Dfense, 85 % rejoignent leur emploi en transports en commun. l'inverse,
sur les 100 000 personnes qui travaillent sur l'aroport Charles-de-Gaulle ou en
son voisinage, 92 % ont recours la voiture. Faudrait-il en dduire que ces der-
niers sont moins bons citoyens que les premiers parce qu'ils vont travailler en
voiture ?
Pour accder aux parties denses de l'agglomration, les transports en com-
mun sont comptitifs et il faut encourager leur usage. Mais dans les zones
densit moyenne ou faible, seuls les transports individuels peuvent rpondre
aux besoins des habitants en leur permettant des temps de trajets acceptables, et
jamais les transports en commun ne pourront tre comptitifs.
Il en est ainsi surtout pour les dplacements priphriques. Certes, sur une
carte, une voie ferre ressemble une autoroute. Mais c'est l une illusion.
Lorsqu'on habite 3 kilomtres d'une autoroute, on est sur l'autoroute. Il suffit
de quelques minutes pour rejoindre l'un de ses changeurs, et, l'autre extr-
mit du dplacement, de quelques minutes nouveau pour accder au lieu de
destination final. Ceci explique pourquoi les enqutes de l'Insee mettent en
vidence, pour ce type de dplacement, une tonnante dure moyenne de 20
minutes seulement en le-de-France.
En revanche, lorsqu'on habite 3 kilomtres d'une voie ferre, il n'est possi-
ble de rejoindre l'une de ses gares qu'au prix d'un premier trajet qui doit tre
le plus souvent effectu en autobus, ou en voiture. De surcrot, il y a trs peu de
chances pour que la destination finale soit situe sur une gare de la mme ligne
lorsque celle-ci est priphrique. Il faut alors donc envisager un autre trajet
terminal, en autobus par exemple. Le trajet total demande alors beaucoup plus
d'une heure.
Le choix est donc vite fait, et la conclusion s'impose d'elle-mme : en dehors
de la partie centrale de l'agglomration, la frquentation des voies ferres de
rocade est par nature pratiquement inexistante. En d'autres termes, et comme
partout ailleurs, les modes de transport ne sont pas des vases communicants.
C'est ce qu'a constat la Banque mondiale dans un de ses rapports. Aprs
avoir pass en revue toutes les grandes mtropoles mondiales
1
, elle est arrive
la conclusion que nulle part au monde les voies ferres de rocade ne sont per-
formantes, les voyageurs tant trop disperss .
1
Banque mondiale, Les Transports urbains, 1986.
153
L'le-de-France vient d'en faire nouveau la preuve aux frais de ses contri-
buables. Le 14 dcembre 2004, la SNCF mettait en service grand renfort de
publicit le premier lment d'une grande rocade ferroviaire rgionale en
ouvrant la circulation la voie ferre Saint-Germain-en-Laye Noisy-le-Roi pour
un cot de 90 millions d'euros, aprs avoir lectrifi la ligne et refait toutes les
gares. Toutes les dix minutes, un train neuf de 400 places s'branle donc dor-
navant. Mais, mme aux heures de pointe, il est occup par moins de dix passa-
gers ! Il ne saurait tre trop recommand aux lecteurs de cet ouvrage qui le
peuvent d'aller eux-mmes Saint-Germain-en-Laye pour assister au spectacle
surraliste de ces trains fantmes qui partent obstinment vide aux frais du
contribuable, pour un cot annuel d'exploitation suprieur 10 millions d'eu-
ros par an.
On aurait pu croire que cette douloureuse leon ait servi quelque chose. Il
n'en est rien. Le 15 novembre 2006, la Rgion prsentait son projet de schma
directeur, document capital cens tracer son avenir. Celui-ci prvoit express-
ment une grande rocade ferroviaire prolongeant la ligne de Saint-Germain-en-
Laye et destine, si elle est un jour ralise, servir de rfrence mondiale de
gaspillage des deniers publics.
C'est que le schma prconis est d'inspiration strictement idologique et to-
talement dconnect d'une quelconque analyse des besoins qui aurait montr
qu'il tait urgent pour l'avenir de la rgion d'investir l o se situait l'accrois-
sement de la demande, c'est--dire de procder l'achvement de son rseau
autoroutier et l'accroissement de sa capacit partout o c'tait possible.
Mais les cologistes, dont l'appui est ncessaire pour permettre au prsident
rgional de conserver sa majorit, ont russi imposer leurs vues. C'est ainsi
que la rgion capitale de la France se paralyse progressivement, au moment o
les autres mtropoles trangres se dotent vive allure des rseaux de transport
indispensables leur prosprit.
Un projet surraliste
Le schma directeur approuv en fvrier 2007 par le conseil rgional pousse
ainsi l'absurdit son paroxysme. Il ne compte pas moins de 82 projets de
transport en commun dont la plupart sont aussi infinanables que dpourvus de
justification. Certes, il numre aussi des projets routiers, mais seulement pour
indiquer qu'il les refuse, mme si l'tat les finance ! Parmi ceux-ci figurent no-
tamment ceux qui permettraient de boucler, quarante ans aprs qu'elle a t
prvue, l'autoroute de rocade La Francilienne indispensable la vie cono-
mique et sociale de la grande couronne. La rgion s'est ainsi dote d'un schma
154
qui recense... les projets dont elle ne veut pas. Il s'agit l d'une premire mon-
diale, rvlatrice de ce qu'il faut bien appeler une pathologie caractrise.
La vrit, c'est que, dans le domaine des transports publics, peu de projets
sont justifis compte tenu de la stabilit des trafics. A vrai dire, deux d'entre eux
seulement s'imposeraient si l'approche des choses tait rationnelle. Il s'agit en
premier lieu du parachvement du RER (rseau express rgional) par le dsen-
clavement de la gare Montparnasse, l'image de ce qui a t fait il y a trente ans
pour la plupart des autres gares parisiennes. La cration d'un simple tunnel de
quatre kilomtres entre la gare Montparnasse et le terminus actuel de la ligne E
la station souterraine Haussmann-Saint-Lazare bouleverserait les condi-
tions de transport vers Paris de centaines de milliers d'habitants des banlieues
est et ouest. Elle mettrait notamment Versailles un quart d'heure et la ville
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines vingt minutes des Champs-lyses.
Le second projet ferr incontestable est celui de la liaison directe avec l'aro-
port Charles-de-Gaulle qui est le seul au monde de sa dimension ne pas dispo-
ser d'une communication commode avec son centre-ville. Encore faudrait-il que
celle-ci aboutisse au centre des affaires, c'est--dire Haussmann-Saint-Lazare et
non la gare de l'Est comme c'est actuellement prvu.
Mais, en dehors de ces deux projets et de rares exceptions prs, aucun ne
parat pouvoir rsister une analyse srieuse. Il en est ainsi du mythe des liai-
sons de rocade. Avec la ligne qu'elle a mise en service grands frais Saint-
Germain-en-Laye, la SNCF a apport la preuve qu'elles ne peuvent avoir aucun
trafic en grande banlieue.
Quant au projet de la RATP d'une ligne de rocade intermdiaire qui relierait
les terminus de mtro, ses promoteurs eux-mmes estiment qu'elle ne soulage-
rait le trafic routier que de 200 000 dplacements en automobile par jour.
Quand on sait que le nombre de ceux-ci excde 15 millions, il est clair qu'il ne
serait gure judicieux de mobiliser les efforts financiers de la collectivit pen-
dant plus d'une dcennie pour un si pitre enjeu.
Ceci ne signifie pas qu'il n'y ait rien faire en faveur des transports publics de
l'le-de-France, bien au contraire. Seuls ceux qui ne prennent pas quotidienne-
ment les transports franciliens aux heures de pointe ignorent que leurs usagers
voyagent bien souvent dans des conditions scandaleuses en ce dbut de XXI
e
si-
cle, qui s'apparentent celles du btail. Ils ignorent que, ds qu'il fait un peu
chaud, la temprature atteint dans les voitures des sommets insupportables, que
chacun est tremp de sueur, qu'il faut prendre une douche ds qu'on arrive
chez soi, et que tout ceci est indcent. L'absence de matriel roulant climatis
est une vritable honte quand on compare l'le-de-France ce qui se passe dans
les grandes mtropoles asiatiques.
155
Or le renouvellement systmatique du matriel roulant et encore moins sa
climatisation ne figurent pas parmi les priorits des entreprises, qui prfrent
laborer des projets d'infrastructure plus gratifiants leurs yeux. Il devrait tre
interdit aux dirigeants de nos entreprises de transport public de disposer de voi-
tures de fonction et de chauffeurs, et il devrait tre obligatoire pour eux d'em-
prunter leurs rseaux aux heures de pointe. Leurs vues sur les priorits change-
raient alors du tout au tout, et ils donneraient coup sr instruction immdiate
leurs services de procder la climatisation des matriels, quels que soient les
obstacles techniques qui ne manqueraient pas d'tre soulevs et de renouveler
d'urgence si ncessaire celui-ci. C'est l tout simplement affaire de dignit.
Le renouvellement du matriel roulant permettrait incidemment de rsoudre
le problme de la desserte de La Dfense, en accroissant la capacit horaire de
la ligne A de plus de dix mille voyageurs l'heure, alors qu'un ventuel prolon-
gement de la ligne E la soulagerait de la moiti de ce chiffre et ncessiterait
beaucoup plus de temps et d'argent.
La vrit enfin, c'est que prs de trois quarts des dplacements motoriss
d'le-de-France empruntent dsormais la route ainsi que tous les transports de
marchandises, et que c'est l pour l'essentiel qu'il faudrait faire porter les efforts
de cration de capacits nouvelles de transport pour rpondre aux besoins, no-
tamment en accroissant sur place le dimensionnement de beaucoup d'autorou-
tes existantes.
Paris paralys
La situation est malheureusement la mme Paris intra-muros, puisque la
mme doctrine l'inspire.
Paris a eu la chance unique au monde d'hriter de son pass deux rseaux de
transport de grande capacit aussi indispensables l'un que l'autre son activit.
Le premier est compos des boulevards et des avenues cres pour l'essentiel
par Napolon III et Haussmann pour quadriller son territoire. Le second est le
rseau de mtro urbain d'une densit exceptionnelle dont la construction a t
rendue possible par la trame de la voirie haussmanienne, et qui fut ensuite
complt par le RER interconnect selon les plans que j'avais fait adopter au
dbut des annes soixante-dix
1
.
Ces deux systmes de transport jouent des rles quivalents dans la vie de la
capitale. Chaque jour, le mtro urbain et le RER enregistrent 4 millions de d-
placements de personnes, alors que l'automobile en assure 3 millions. Mais la
1
Voir ce sujet C. Gerondeau, La Saga du RER, Presses de l'cole nationale des Ponts et Chausses,
2003.
156
voirie est galement le support de la totalit des mouvements de marchandises,
de telle sorte que son poids conomique est au moins gal celui des transports
en commun.
Jusqu' une date rcente, les choses se passaient plutt bien. Du fait de la d-
croissance de la population de Paris intra-muros et de celle des emplois, la de-
mande de dplacements y tait stabilise depuis plusieurs dcennies, voire en
diminution, et les investissements dont ont bnfici pendant longtemps aussi
bien les rseaux ferrs que la voirie amlioraient progressivement la situation.
Tout a malheureusement chang depuis la mise en uvre d'une politique
doctrinaire de restriction de la circulation automobile dont les effets nfastes ne
sont que trop vidents.
Cette politique vise restreindre l'espace disponible pour les vhicules rou-
tiers dans le vain espoir de favoriser la frquentation des autobus parisiens et
l'usage de la bicyclette, comme si les modes de transport taient des vases com-
municants. Or plus des trois quarts de la circulation automobile parisienne sont
constitus de trajets en provenance ou destination de la banlieue, et seule une
trs petite minorit est le fait de Parisiens qui utilisent leur voiture pour aller
d'un point un autre de la capitale.
Dans de telles conditions, il n'est pas surprenant que la politique de restric-
tion de la circulation actuellement mise en uvre ne se traduise par aucun ac-
croissement de la frquentation des autobus parisiens mais par sa diminution
(moins 5 % de 2005 2006), malgr les couloirs rservs qui se multiplient pro-
gressivement sur l'ensemble du territoire de la capitale et dont le principal r-
sultat, sinon le but rel, est de rendre de plus en plus difficile la circulation g-
nrale ! C'est que les autobus urbains ne sont videmment d'aucune utilit pour
les banlieusards. Leur trafic ne reprsente d'ailleurs qu'une trs faible fraction
de celui du mtro.
Restreindre la circulation Paris, c'est avant tout isoler la capitale de sa ban-
lieue. C'est aussi crer des encombrements dont le cot conomique a pu tre
estim plus d'un milliard d'euros par an.
Il s'agit l d'une politique suicidaire, l'poque o toutes les villes du monde
s'efforcent au contraire de rendre la circulation plus fluide au bnfice de l'ac-
tivit conomique et de la qualit de vie de la population.
Les cologistes qui ont impos la mise en uvre de cette politique affirment
vouloir uvrer pour amliorer la sant publique, mais il n'en est rien. Leur mo-
tivation est tout autre, comme l'a clairement rvl l'un des adjoints au maire,
Bernard Contassot, lorsqu'il a dclar peu aprs son lection que dornavant
les automobilistes allaient connatre l'enfer . Les faits lui ont donn raison, et il
ne s'agit malheureusement pas d'un enfer imaginaire.
157
La lutte contre la pollution constitue le prtexte constamment mis en avant
par le maire actuel pour justifier la politique de restriction de la circulation, au
point de lui imputer l'amlioration de la qualit de l'air enregistre dans la ca-
pitale. Il n'en est bien entendu rien, puisque celle-ci est le seul fait des progrs
techniques des vhicules et des carburants, et qu'elle a dbut plusieurs annes
avant son arrive. Bien au contraire, l'accroissement actuel des encombrements
ne peut que contrecarrer la diminution de la pollution dans la capitale, tant il
est vident qu'un vhicule bloqu pollue plus que celui qui roule.
Il en est ainsi du tramway qui fait la fiert des diles parisiens, et dont le prin-
cipal effet est de rendre inextricable la circulation dans le sud de la capitale.
Cens accueillir des automobilistes qui auraient renonc leur voiture, il n'en
fait rien. La premire enqute ralise sur sa frquentation par une universit
parisienne a mis en vidence que, sur mille passagers, vingt seulement, soit 2 %,
taient d'anciens automobilistes. Comme la capacit des boulevards qu'em-
prunte le tramway a t rduite de 30 %, ceux qui ne peuvent plus y circuler
n'ont d'autre ressource que de passer ailleurs et d'encombrer un peu plus le
boulevard priphrique et les rues parisiennes avoisinantes qui n'en avaient nul
besoin. Le tout se traduit la fois par des pertes de temps considrables et par
des pollutions inutiles accroissant les manations de CO
2
, au prtexte de la lutte
pour l'environnement.
Qu'il s'agisse des transports nationaux, rgionaux ou locaux, ce sont donc la
mconnaissance des faits et l'idologie qui sont au pouvoir aujourd'hui dans
notre pays.
Une schizophrnie nationale
Arrtons de raisonner comme si l'argent public manait d'une source intaris-
sable. Appliquons les principes de saine gestion qui ont cours partout ailleurs.
Dans le seul secteur des transports, le potentiel des conomies est considra-
ble. Au total des transports ferrs et publics, ce sont prs de 20 milliards d'euros
que les contribuables versent chaque anne, dont l'essentiel est injustifi. Il n'y
a aucune raison pour que la charge impose aux finances de notre pays s'lve
des sommes aussi gigantesques, qui reprsentent prs d'un point et demi de no-
tre PIB. Dans un pays comme le Canada, o les transports fonctionnent aussi
bien que chez nous, et o les transports en commun des grandes villes sont
pourtant subventionns 50 %, elle est quatre fois plus faible en proportion.
Parmi d'autres, notre politique des transports est un boulet pour notre cono-
mie, et le premier objectif que devraient se fixer les responsables serait d'en r-
duire les cots pour le contribuable, et non de l'accrotre sans cesse.
158
L'incohrence
Plus que les hommes, c'est le systme qui est en cause. Lorsque les fins de
mois sont assures quoi qu'il arrive par l'argent public apparemment inpuisa-
ble, toutes les drives deviennent possibles. Certes, il est de nombreuses mis-
sions qui relvent de la responsabilit publique, comme la Dfense nationale, la
Justice, la police, l'ducation primaire et secondaire, la solidarit envers les plus
dmunis, et les dpenses correspondantes doivent coup sr tre assures par
la collectivit. Mais le champ de ces missions est circonscrit. Pourquoi la notion
de service public engloberait-elle le transport ferroviaire de marchandises ?
Pourquoi le transport rgional serait-il un service public s'il est assur par auto-
rail et non par autocar ? Pourquoi les liaisons grande distance seraient-elles du
ressort du service public quand le voyageur emprunte le TGV et pas l'avion ?
Nous avons pour l'essentiel en France trois systmes de transport qui reposent
respectivement sur l'air, la route et le rail, qui sont soumis trois rgles du jeu
qui n'ont aucun point commun. Les compagnies ariennes doivent couvrir la
totalit de leurs cots, la route procurer des excdents considrables aux finan-
ces publiques et le rail, qui rpond moins de 4 % des besoins nationaux, tre
subventionn sans limites. O est la cohrence ? O est le bon sens ?
La vrit, c'est que nos ides sur le sujet sont forges par l'arme de ceux qui
vivent des crdits publics dans le secteur des transports. Ils sont plus de 300 000.
Face eux il n'y a pas de contre-pouvoir, et ils ont donc russi nous convain-
cre d'ides fausses, jusqu'aux niveaux les plus levs.
Alors que notre nouveau prsident de la Rpublique est l'un des seuls qui
aient compris quel point notre pays tait victime du politiquement correct
omniprsent, celui-ci subsiste dans le domaine des transports.
Le discours qui fait rfrence en la matire
1
n'hsite pas affirmer que la po-
litique publique a largement favoris la voiture individuelle et le transport rou-
tier de marchandises , alors que c'est l'inverse puisque l'une comme l'autre
sont l'objet de multiples taxes et que ce sont au contraire les transports ferrs et
publics qui sont subventionns au-del de toute mesure.
Il en dduit qu' il y a trop de trafic routier de marchandises , alors qu'il
n'existe aucune alternative raliste au camion qui rpond plus de 95 % de nos
besoins et est la base de notre prosprit conomique.
Le mme discours affirme qu'il faut encourager de manire trs significative
l'achat de vhicules plus propres , impliquant ainsi un nouvel accroissement
des dpenses publiques, alors que la solution aux problmes de pollution vient
1
Convention UMP sur l'cologie, 19 octobre 2005.
159
spontanment des efforts des constructeurs dont la production s'amliore
d'anne en anne.
Il dclare que les entreprises japonaises sont trs en avance, notamment
dans le domaine des transports , alors que les deux groupes automobiles fran-
ais produisent les vhicules les plus conomes et les plus propres du monde au
total de leur gamme, ce qui n'est pas le cas de leurs homologues japonais.
Le mme discours affirme qu'il est aberrant que le cot d'une voiture lec-
trique soit suprieur celui d'une voiture essence , comme s'il ne s'agissait
pas l d'une consquence strictement technique de l'incapacit des batteries
emmagasiner suffisamment d'nergie, malgr les efforts poursuivis depuis deux
sicles par les chercheurs du monde entier.
Il se dclare enfin partisan du ferroutage, modalit d'acheminement des mar-
chandises aussi ruineuse pour les deniers publics que voue l'chec malgr
d'innombrables tentatives dans les conditions gographiques de notre pays et
de l'Europe, face au transport direct de porte porte que seule permet la voie
routire.
On parle souvent du tout routier , et c'est juste titre ou presque. Mais ce-
lui-ci n'est pas le rsultat de la politique des pouvoirs publics qui s'y opposent
en vain depuis des dcennies. Il dcoule du libre choix des usagers. Beaucoup
voudraient le contrer, mais pourquoi, et comment ?
Est-il vraiment impossible d'imaginer qu'un responsable ose un jour dire la
vrit, c'est--dire que les carburants routiers ne viennent qu'au cinquime rang
des missions mondiales de gaz effet de serre et sont dj beaucoup plus taxs
que les autres sources ; que la voiture, le camion et l'avion sont indispensables
l'efficacit des socits contemporaines, ce qu'ont compris la Chine et le reste
du monde, et que les usagers ont raison d'y recourir ; qu'il est vain et ruineux
de chercher s'opposer au choix des usagers ; qu'il est physiquement impossi-
ble de transfrer le trafic des camions vers le rail ; que l'essentiel des lignes des
TER est du ressort de l'autocar et non de la voie ferre ; que nous ne pouvons
pas continuer entretenir des dizaines de milliers de kilomtres de voies ferres
pour deux ou trois autorails par jour aux trois quarts vides ou pour des trains de
marchandises en voie de disparition ; que les chemins de fer nous cotent des
sommes gigantesques au lieu d'tre bnficiaires ; que des investissements injus-
tifis ont une influence ngative sur notre croissance ; que ceux qui seraient jus-
tifis et ne sont pas mis en uvre obrent la fois notre prosprit, notre quali-
t de vie et le niveau de nos emplois ; que nous pourrions avoir des transports pu-
blics pour beaucoup moins cher et tout aussi efficaces ?
Les Franais sont-ils condamns la pense unique, au politiquement cor-
rect ? Ont-ils droit la vrit ?
160
CHAPITRE XII
Tout ne va pas mal !
S'il est une ide dominante dans notre pense collective, c'est que le monde
va de plus en plus mal, et tout particulirement le tiers-monde, celui qui re-
groupe cinq milliards d'habitants de la plante sur six, c'est--dire la masse de
l'humanit.
Les rsultats des sondages sont nouveau parlants
1
. Pour quatre de nos com-
patriotes sur cinq, le sort du tiers-monde s'aggrave ou stagne. Seul un sur cinq
d'entre nous estime qu'il s'amliore un peu. Quant aux originaux qui dclarent
que le tiers-monde progresse beaucoup, ils ne reprsentent qu'un pour cent des
Franais. Et pourtant, ce sont eux qui ont raison et 99 % de nos compatriotes
qui sont nouveau dans l'erreur.
Car le bilan que l'on peut tirer de l'volution du globe au cours du XX
e
sicle
dfie presque la description. Qu'il s'agisse de sant, d'hygine, de dmographie,
d'alimentation, d'ducation, d'accs aux techniques modernes ou de niveau de
vie, ce n'est pas d'volution qu'il faut parler, mais de rvolution.
Bien entendu, tout est loin d'tre parfait et le chemin qui reste parcourir est
immense. Il l'est particulirement pour l'Afrique dite subsaharienne, c'est--dire
l'Afrique noire qui n'a encore bnfici que faiblement du progrs d'ensemble
et a mme parfois rgress, et qui inspire le plus souvent notre vision. Mais, avec
moins de 700 millions d'habitants sur les 5 milliards d'tres humains que comp-
te aujourd'hui le tiers-monde, l'Afrique subsaharienne ne peut occulter le bilan
global, qui dpasse tout ce que nous pouvons imaginer, comme en tmoignent
notamment les rapports sur l'tat du monde que publient chaque anne les Na-
tions unies
2
.
1
Sondage Ipsos/FFAC, juillet 2006.
2
Programme des Nations unies pour le Dveloppement, Rapport mondial sur le dveloppement hu-
main 2005, Economica, 2006.
161
La sant
Lorsqu'on regarde le chemin parcouru au cours du sicle dernier, le moins
que l'on puisse dire, c'est que la ralit n'a gure de rapport avec l'image que
nous en avons. Parler de qualit de vie suppose tout d'abord que l'on vive. Or,
de 1900 l'an 2000, l'esprance de vie la naissance est passe en moyenne
dans les pays du tiers-monde de 27 ans 65 ans. Vous avez bien lu ! En un seul
sicle, l'esprance de vie des enfants qui naissent dans les pays pauvres de notre plante a
t multiplie par deux et demi.
Le rsultat est tout simplement stupfiant, d'autant plus qu' une exception
prs, il concerne toutes les rgions de la plante. L'esprance de vie au sein du
tiers-monde est maintenant trs suprieure ce qu'elle tait il y a peu encore
dans les pays dvelopps. Plus prcisment, elle s'lve aujourd'hui 72 ans en
Amrique latine (540 millions d'habitants), 70 ans en Asie de l'Est (1 900 mil-
lions d'habitants dont 1 300 millions en Chine), 67 ans dans les pays arabes
(300 millions d'habitants) et 64 ans en Asie du Sud (1 900 millions dont 1 100
en Inde). Seule exception, l'Afrique subsaharienne o l'esprance de vie la
naissance est de 46 ans seulement, et o elle a mme recul du fait des ravages
du sida sans lesquels elle s'tablirait plus de 55 ans.
Aujourd'hui, plus de neuf enfants sur dix survivent, au lieu d'un sur deux il y
a un sicle. Et le progrs ne s'arrte pas. Un enfant qui nat aujourd'hui dans le
tiers-monde vivra en moyenne dix ans de plus que celui qui a vu le jour il y a
trente ans.
La vaccination a fait reculer ou parfois disparatre la variole, la diphtrie, la
rougeole, la rubole, le ttanos, la tuberculose, la poliomylite. Les Nations
unies en ont fait juste titre l'une de leurs priorits. La proportion des enfants
du tiers-monde recevant les 6 vaccins de base est passe de 5 % en 1974 74 %
en 1998 et plus de 80 % en 2006.
Certes, tout n'est pas rgl. Le paludisme recule difficilement. La tuberculose
reste aussi un problme grave : elle touche prs de 3 % de la population du
tiers-monde et prs de 5 % en Afrique subsaharienne. On comprend donc tout
l'intrt du vaccin contre cette maladie, qui fort heureusement se gnralise.
Il n'y a pas que les vaccins. La thrapie par rhydratation orale (ORT) fait
galement des miracles. Il s'agit l de l'un des traitements les plus lmentaires
et les plus efficaces pour sauver des vies. Mise au point au Bangladesh, cette th-
rapie a dj sauv des millions de nourrissons pour un cot drisoire. Il s'agit
tout simplement d'un mlange de sel et de sucre qu'il suffit de dissoudre dans
de l'eau pour viter la dshydratation et garder les enfants en vie. Avant cette
invention, le traitement standard ncessitait une perfusion par intraveineuse et
cotait au moins 50 dollars. Les sachets d'ORT ont commenc tre fabriqus
162
en masse dans les annes quatre-vingt, et reviennent moins de 10 centimes
d'euros chacun...
Ceci ne signifie pas videmment que la tche soit acheve, d'autant qu'appa-
raissent des risques nouveaux lis au dveloppement conomique. Parmi ceux-
ci, les accidents de la route revtent une importance croissante et dramatique.
Les Nations unies n'valuent-elles pas plus d'un million de morts chaque an-
ne le nombre de victimes de l'inscurit routire sur l'ensemble de la plante,
dont la grande majorit sur les routes du tiers-monde ? L aussi, l'espoir est
permis, car les pays dvelopps ont russi non pas mettre fin cette hcatom-
be, mais en rduire l'ampleur anne aprs anne, la France ayant montr
pour sa part au cours des annes rcentes ce qu'il tait possible de faire lors-
qu'une politique efficace tait mise en uvre.
L'eau
La sant suppose l'hygine, et celle-ci est directement lie l'eau. Sans accs
une eau potable sans danger, et sans dispositifs d'assainissement efficaces, les
risques de maladie et de mort sont trs fortement accrus. On comprend qu'il
s'agisse l d'un aspect essentiel du dveloppement et que celui-ci focalise tout
particulirement l'attention. A cet gard, la diffrence est grande entre les r-
gions du globe qui bnficient naturellement de ressources en eau abondantes,
et celles qui n'ont pas cette chance. On imagine aussi sans mal que l'amliora-
tion de la situation ne puisse tre obtenue qu'au prix de travaux lourds et relati-
vement longs mettre en uvre.
Pourtant, ici galement, les progrs sont patents. En treize ans seulement,
de 1990 2003, la proportion des habitants du tiers-monde ayant accs une
eau de qualit est passe de 70 80 %. Alors qu'en 1990, seuls un tiers d'entre
eux disposaient en outre d'installations sanitaires acceptables, la proportion at-
teignait 50 % en 2003 et elle continue progresser. En treize ans, 1 200 000 000
d'habitants de plus ont bnfici de systmes d'assainissement efficaces (tout--
l'gout ; fosses septiques ; puits ventils...), soit 250 000 de plus par jour
1
!
L'alimentation
L aussi, tous les pronostics ont t djous. Dj, la fin du XVIII
e
sicle, Mal-
thus annonait que notre globe s'acheminait vers la catastrophe et qu'il serait
impossible de nourrir une population sans cesse croissante. Malthus reconnut
1
Ibid.
163
plus tard qu'il s'tait tromp, mais cela n'empcha pas d'autres bons esprits de
reprendre leur compte sa thorie tout au long des sicles suivants et aujour-
d'hui encore. Il faut d'ailleurs reconnatre que les choses n'avaient rien d'vi-
dent. Il y a cinquante ans, la famine rgnait en Inde et en Chine, et l'accroisse-
ment prvisible de leur population ne pouvait qu'incliner au pessimisme le plus
sombre. Le pronostic le plus raisonnable tait celui de centaines de millions de
morts de faim au cours des dcennies suivantes.
Ce n'est pourtant pas ce qui s'est pass. La population du globe s'est bien ac-
crue, mais la production agricole a augment plus vite encore, grce la rvo-
lution verte qui s'est rpandue dans le tiers-monde en quelques annes pei-
ne. Des centaines de millions de paysans ont commenc utiliser des semences
hybrides haut rendement, des engrais chimiques, des pesticides et des herbi-
cides, avec des rsultats insouponns. Alors qu'il paraissait vident que les be-
soins de l'Inde seraient tels que tous les excdents disponibles des pays dve-
lopps ne suffiraient pas les combler, il n'en fut rien. A partir de 1990, l'Inde
devint mme un modeste exportateur de crales et sa population est pourtant
passe de 500 millions en 1960 1 100 000 000 aujourd'hui !
En utilisant les mmes techniques, la Chine accrut sa production de riz des
deux tiers entre 1970 et 1995. Certains ont pu avancer en consquence que la
rvolution verte avait sauv de la famine un milliard d'tres humains ! Au
total, et contrairement tous les pronostics, 4,3 milliards d'habitants des pays du
tiers-monde mangent aujourd'hui leur faim contre 2 milliards il y a trente ans. Autre-
ment dit, le nombre des tres humains qui sont correctement nourris s'est accru
de plus de 2 milliards en trois dcennies.
Ceci ne signifie pas que tout soit rgl, puisque les Nations unies estiment le
nombre de ceux qui sont aujourd'hui insuffisamment nourris 800 millions de
personnes. Mais les rsultats obtenus ont t inesprs, mme si leur poursuite
n'est pas garantie.
Les OGM
Il est impossible de ne pas ouvrir ici le dbat, tant les OGM dfraient la chro-
nique dans notre pays, car certains en ont fait leur vecteur d'attaque de notre
socit. De quoi s'agit-il ?
De temps en temps, les vgtaux ou les animaux sont l'objet de mutations g-
ntiques qui en modifient les caractristiques. Au milieu d'un verger de pom-
mes uniformment jaunes, un fruit rouge apparatra soudain. Si les ppins en
sont plants, ils pourront ventuellement donner naissance une nouvelle va-
rit de cette mme couleur. Pour leur part, les hommes ont compris depuis
164
des millnaires qu'ils avaient intrt aider la nature pour crer des espces
nouvelles. Le bl qui nourrit aujourd'hui une grande partie de l'humanit a t
ainsi invent il y a prs de dix millnaires. Il s'agit d'un hybride de diffren-
tes crales sauvages soigneusement apparies par nos lointains anctres.
Plus rcemment, les hybrides de bl, de mas ou de riz crs il y a un demi-
sicle environ ont permis la rvolution verte prcdemment voque. Dans
un pays comme le ntre, le rendement moyen du bl est pass de moins de 10
quintaux l'hectare il y a deux sicles plus de 60 de nos jours, de telle sorte
que notre hexagone pourrait lui seul nourrir plusieurs centaines de millions
d'habitants. Mais la mise au point d'hybrides performants demande au moins
une dizaine d'annes, et les essais sont loin d'tre toujours couronns de succs,
car les modifications gntiques auxquelles ils aboutissent laissent une grande
part au hasard.
Il en va autrement avec les modifications gntiques contrles, celles qui
donnent naissance aux OGM modernes en permettant notamment de transf-
rer un gne d'une espce une autre espce entirement diffrente. C'est ainsi
qu'il a t possible de crer des espces vgtales rsistant aux virus et aux insec-
tes, et permettant donc des rendements trs suprieurs. D'autres OGM
contiennent des doses accrues de protines, certains renferment mme des vac-
cins contre l'hpatite !
Ces plantes ainsi transformes prsentent de multiples avantages un mo-
ment o il va falloir accrotre nouveau la production agricole, la rvolution
verte des dcennies passes ayant pour l'essentiel atteint ses limites. Elles r-
duisent notamment les besoins d'eau et d'engrais.
Face ces avantages, certains affirment que des risques considrables existent,
ce qui les conduit faucher grand spectacle les parcelles exprimentales en-
semences dans notre pays et faire fuir l'tranger les recherches correspon-
dantes, avec des consquences trs graves pour nos entreprises de ce secteur.
La vrit oblige toutefois dire qu'aucun danger li aux OGM dj cultivs
l'tranger n'a jamais t mis en vidence, comme l'a constat un rcent rapport
de l'Assemble nationale en date d'avril 2005. Cela fait dix ans que les Amri-
cains, et bien d'autres encore, mangent du mas ou du soja gntiquement mo-
difis sans aucun inconvnient dcelable. Aprs avoir vu en 1992 des rcoltes
entires de coton dtruites par des insectes devenus rsistants aux pesticides et
des centaines de milliers de fermiers ruins, la Chine a adopt un coton gnti-
quement modifi qui venait d'tre mis au point aux Etats-Unis. Les rendements
se sont immdiatement accrus et les cots ont t rduits en moyenne de 14 %,
amenant les experts chinois crer leur tour des cotons gntiquement modi-
fis pour viter d'avoir acquitter l'avenir des royalties la firme amricaine
concerne.
165
L'Inde a fait la mme exprience et a vu le rendement de ses plantations de
coton OGM progresser de 40 % avec un usage de pesticides divis par cinq, ce
qui n'a pu qu'tre favorable la sant des paysans concerns. Elle continue sur-
tout de miser sur la recherche pour accrotre encore sa production agricole.
Le 9 octobre 2006, l'ouverture du congrs international du riz New Delhi,
le Premier ministre indien Mannohan Singh a solennellement appel les scien-
tifiques et les agriculteurs du monde entier provoquer une deuxime rvolu-
tion verte , afin d'assurer la scurit alimentaire de l'humanit en mettant au
point de nouveaux riz , qui pourraient tre enrichis en fer ou en nutriments,
ou programms pour tre plus conomes en eau, et qui seraient ncessairement
des OGM.
Bien entendu, il est toujours possible d'imaginer le pire. Mais il faut avoir des
certitudes profondment ancres, ou tre tout fait insensible au malheur des
autres, pour condamner par principe le recours des innovations qui pour-
raient sauver de la faim et de la misre des centaines de millions d'tre hu-
mains, au nom d'un principe de prcaution qui peut servir de prtexte
l'inaction dans tous les domaines.
La vogue elle-mme des produits bio n'est pas exempte de risque, si elle de-
vait se gnraliser. Le renoncement aux engrais diminue les rendements, et il
faut donc, pour une mme production, multiplier les surfaces cultives et rdui-
re les espaces naturels.
La dmographie
La chute de la mortalit infantile et plus gnralement l'amlioration de l'es-
prance de vie se sont accompagnes d'une autre volution aussi brutale
qu'inattendue. Contrairement au clich profondment ancr dans nos esprits et
qui le restera trs longtemps encore, les familles du tiers-monde ont pour la
plupart cess d'avoir beaucoup d'enfants. Bien au contraire, les femmes ont
matris les naissances. Du coup, les prvisions catastrophistes sur la progression
de la population du globe n'ont plus lieu d'tre, et c'est un avenir matrisable
qui nous attend.
Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour le constater. Il suffit de regarder ce
qui s'est pass en un tiers de sicle nos portes, de l'autre ct de la Mditerra-
ne. En 1970, le nombre moyen d'enfants par femme dans les pays du Maghreb
se situait entre 6 et 7, et les touristes qui arpentaient les villes du Maroc ou de
Tunisie taient assaillis de hordes de gamins rieurs et dpenaills qui il tait
difficile de ne pas prdire un avenir bien sombre, tant ils taient nombreux.
166
En 2005, le nombre moyen d'enfants par femme ne dpasse plus 2,3 au Ma-
roc, 2,2 en Algrie et 1,9 en Tunisie, et il continue baisser ! Autrement dit, les
familles maghrbines deviennent moins prolifiques que celles de France o le
nombre moyen d'enfants par femme se situe 2 et a tendance crotre !
Le chemin parcouru en trois dcennies est peine croyable et nul n'aurait
os l'envisager, d'autant plus que le Maghreb n'est pas une exception. Plus ou
moins rapidement, les autres pays du tiers-monde ont suivi ou suivent la mme
voie, tel point que certains d'entre eux ne renouvellent plus leurs gnrations.
C'est le cas non seulement en Chine, en Core ou Singapour, mais par exem-
ple en Thalande ou au Sri Lanka o les familles de 5 ou 6 enfants taient pour-
tant la norme il y a peu.
Bien qu'elle fasse exception nouveau, l'Afrique subsaharienne n'est pas res-
te entirement l'cart de cette rupture plantaire. Certes, on y compte enco-
re en moyenne 5,5 enfants par femme, ce qui est insoutenable terme et in-
compatible avec un dveloppement humain harmonieux. Mais le chiffre tait
de prs de 7 il y a une gnration, et la baisse commence se faire jour dans
certains pays ctiers, tels que le Ghana, l'un des mieux grs, o l'on recense
actuellement 4 enfants seulement par femme si l'on ose dire, ou au Came-
roun qui en compte 4,7.
Le maintien d'un taux de natalit lev explique d'ailleurs le comportement
de beaucoup d'Africaines immigres en France. Le dcalage entre les femmes
issues de certains pays de l'Afrique subsaharienne et celles qui sont originaires
du Maghreb a des consquences que notre pays n'a pas encore mesures. Lors-
qu'elles viennent en France, les premires continuent avoir beau coup d'en-
fants, comme c'est encore la tradition chez elles, l'inverse des secondes qui ne
se distinguent plus gure sur ce plan de la majorit des autres Franaises.
Ce constat concerne essentiellement l'immigration originaire d'un certain
nombre de villages de pays du Sahel qui ont russi dvelopper depuis deux
dcennies des filires de passage vers la France. A elle seule, l'le-de-France re-
cense ainsi 80 000 enfants de parents maliens ou sngalais, ns dans des famil-
les o la prsence de 8 enfants est frquente, c'est--dire plus mme que dans
leurs villages d'origine
1
. Il est inutile de dire qu'une telle situation pose et pose-
ra de plus en plus de multiples et graves problmes commencer par la sur-
population des logements une socit de culture diffrente o la norme est
dsormais de deux ou trois enfants...
L'extrme soudainet de la chute de la natalit dans la plupart des pays du
tiers-monde a surpris tous les spcialistes, qui ne s'y attendaient nullement. En
une gnration, les femmes d'Asie, d'Amrique latine ou des pays arabes ont
parcouru le chemin qui avait demand plus d'un sicle aux pays europens.
1
Insee, Atlas des populations immigres en le-de-France.
167
Les nouvelles technologies
La diffusion des technologies modernes explique aussi les progrs des pays en
voie de dveloppement au cours des annes rcentes, et elle va sans nul doute y
contribuer de plus en plus au cours des annes venir.
En octobre 2006, l'Agence de presse algrienne signalait que l'Algrie comp-
tait dornavant parmi ses 33 millions d'habitants 19 millions d'abonns au tl-
phone mobile contre 80 000 en 2000, ainsi que 3 millions d'internautes ! Une
telle rapidit est stupfiante, et nous ne pouvons aujourd'hui imaginer quelles
seront, en Algrie et ailleurs, les effets d'un tel bouleversement sans quivalent
dans l'histoire humaine. Nous nous dirigeons trs grands pas vers un monde
o chaque habitant de la plante, ft-ce dans le village le plus recul d'Afrique
ou d'Asie, aura son tlphone portable.
Ds aujourd'hui, les commerants de Zambie utilisent le tlphone portable
pour procder des oprations bancaires, les paysans sngalais pour connatre
l'volution des cours de leurs produits, et les personnels de sant d'Afrique du
Sud pour crer des fichiers sanitaires de leurs patients. Dans ce mme pays, ils
servent dornavant au paiement des dpenses courantes pour rgler ses achats
ou son coiffeur.
Les retombes positives de la diffusion des moyens de communication mo-
dernes sont multiples et vont parfois trs loin. Chacun sait que l'Inde a mis
profit les technologies modernes pour devenir le premier fournisseur mondial
de programmes informatiques. Plus de cinq cent mille ingnieurs et techniciens
indiens travaillent Bangalore et ailleurs pour des compagnies du monde entier
et rapportent ainsi leur pays plusieurs milliards de dollars de devises chaque
anne.
Les transports
Mais les changes ne sont pas seulement immatriels. Ils sont aussi physiques,
et le dveloppement acclr des transports joue galement un rle essentiel
pour l'amlioration du sort de l'humanit. Grce lui, les pays pauvres peuvent
exporter vers les pays riches de plus en plus massivement, qu'il s'agisse de ma-
tires premires, de produits agricoles ou de produits finis : vtements, meubles,
appareils lectroniques, etc. Mme si la mondialisation peut localement avoir
les consquences douloureuses que chacun connat, il s'agit l en dfinitive
d'changes gagnant-gagnant , les habitants des pays dvelopps payant alors
moins cher leurs achats au bnfice de leur niveau de vie, et vendant en retour
aux pays en dveloppement des avions, des trains, voire des articles de luxe et
168
plus gnralement tous les produits que ceux-ci ne sont pas en mesure de fabri-
quer.
Pour leur part, les dplacements massifs de personnes rendus aujourd'hui
possibles par l'aviation ont bris l'isolement et boulevers les changes humains
dans des conditions qui taient inimaginables il y a quelques dcennies seule-
ment, qu'il s'agisse des flux massifs de touristes, d'tudiants ou d'hommes d'af-
faires qui contribuent la diffusion des richesses et des savoirs.
La route enfin joue un rle dcisif pour le dveloppement. Ce n'est pas un
hasard si les rgions les plus pauvres de la plante sont celles qui ne sont pas ou
peu accessibles par la route.
L'ducation
L'ducation constitue aussi l'un des domaines les plus prometteurs d'utilisa-
tion de l'Internet. Avec ou sans le recours celui-ci, elle constitue la cl de tout
progrs durable, car elle seule peut permettre de tirer tout le potentiel des mil-
liards d'tres humains qui peuplent la plante. Fort heureusement, dans ce do-
maine galement, les progrs vont trs vite. En 1920, moins du quart des en-
fants du tiers-monde apprenait lire. Aujourd'hui, la proportion est de 85 %
parmi les jeunes adultes, et l'analphabtisme a presque disparu dans beaucoup
de pays.
Le taux de scolarisation clans le primaire atteint ainsi 97 % en Chine, 97 % en
Tunisie, 95 % en Algrie, 94 % au Vietnam, 92 % en Indonsie, 87 % en Inde, et
approche 90 % en moyenne mondiale. nouveau, l'Afrique subsaharienne d-
tonne. Si l'on recense un taux officiel de 67 % au Nigeria et de 58 % au Sngal,
il n'excde pas 36 % au Burkina Faso et 48 % au Niger, pays le plus pauvre du
monde. Il faut ajouter que les pourcentages ne traduisent pas tout, et que la
qualit de l'enseignement est souvent trs variable, avec des difficults accrues
pour les pays qui n'ont pas de langue nationale majoritaire et o l'enseigne-
ment de base doit se faire dans une langue trangre.
Au sein des dpenses publiques d'ducation, une proportion importante est
de surcrot souvent affecte l'enseignement suprieur, c'est--dire la forma-
tion des futures lites nationales. 22 % des crdits publics d'ducation bnfi-
cient ainsi l'enseignement suprieur au Brsil, 23 % en Tunisie, 32 % en Tur-
quie, etc., contre 17 % seulement en France qui fait exception parmi les nations
du globe, tel point qu'elle consacre plus d'argent ses chemins de fer qui r-
pondent moins de 5 % de ses besoins de transport qu' ses universits !
169
L'lvation du niveau de vie
Tous ces efforts ne sont pas rests vains : le niveau de vie de la plupart des ha-
bitants du tiers-monde progresse vive allure.
De 1975 nos jours, le produit intrieur brut moyen par habitant, exprim en
dollars de 2003, est pass de 1 850 4 400. Autrement dit, il a plus que doubl
en trente ans. Pendant le mme laps de temps, la population concerne a vo-
lu d'un peu moins de 3 milliards d'habitants un peu plus de 5 milliards. La
richesse globale du tiers-monde a donc quadrupl en une gnration.
Un montant de 4 400 dollars est encore faible en pouvoir d'achat, en regard
des 26 000 dollars dont bnficie l'habitant des pays de l'OCDE, soit six fois
plus. Mais la somme n'est plus ngligeable et s'lve anne aprs anne, per-
mettant des masses sans cesse croissantes d'tres humains de sortir progressi-
vement de la misre et d'accder une vie moins dure.
nouveau, l'Afrique subsaharienne se situe malheureusement l'cart de ce
mouvement mondial, avec un PIB moyen par habitant qui n'excde pas aujour-
d'hui le montant drisoire de 1 320 euros.
Pour comparer les pays les uns aux autres, les Nations unies ont adopt un in-
dicateur synthtique qui a le mrite de la simplicit et de la clart. Il prend en
compte trois composants qui reprsentent respectivement le revenu, la sant et
l'ducation. Chacun de ces trois composants est caractris par un indice, et la
moyenne des trois indices constitue l'indicateur du dveloppement humain
de chaque pays.
Compte tenu des constats prcdemment dvelopps, personne ne sera ton-
n d'apprendre que l'indicateur du dveloppement humain a connu au
cours des dcennies rcentes des volutions trs positives pour la grande majori-
t des 177 pays dont les Nations unies suivent l'volution.
La Dclaration du millnaire
Les progrs exceptionnels enregistrs dans la plupart des pays au cours des
dcennies coules ne doivent pas conduire penser que tout est rgl et qu'il
n'y a plus rien faire. La tche qui reste accomplir reste immense, et c'est
pourquoi 147 chefs d'tat et de gouvernement ont adopt New York, le 8 sep-
tembre 2000, dans le cadre solennel de l'Assemble gnrale des Nations unies,
un document fondamental. Baptis Dclaration du millnaire, celui-ci a fix la
communaut mondiale quelques objectifs simples pour 2015. Ces Objectifs du
millnaire pour le dveloppement (OMD) font dsormais rfrence et per-
170
mettent de suivre, anne aprs anne, les progrs de l'humanit sur la voie qui
l'loigne de la faim, de la misre et de la mort.
Ces objectifs sont au nombre de sept :
rduire nouveau des trois quarts la mortalit maternelle et de moiti la mortalit in-
fantile ;
gnraliser l'accs l'ducation primaire pour l'ensemble des enfants de la plante ;
arrter la propagation du sida ;
matriser le flau du paludisme ;
admettre en franchise les produits exports par les pays les moins avancs ;
engager une politique spcifique d'aide l'Afrique subsaharienne ;
rduire de moiti la proportion de la population mondiale vivant encore avec moins
de 1 ou 2 dollars par jour.
Il faut souligner la qualit remarquable de cet engagement mondial trop m-
connu dans notre pays, qui tmoigne pour la premire fois d'une prise de cons-
cience plantaire des problmes auxquels est confronte l'humanit, et dont on
peut seulement regretter qu'il ne comprenne aucune rfrence la ncessit de
limiter les naissances l o elles sont encore trop nombreuses. Du fait de son
existence mme, les progrs s'acclrent, comme le note le rapport mondial des
Nations unies sur le dveloppement humain de 2005 : Au moment de la D-
claration du millnaire en 2000, le verre de l'aide tait au trois quarts vide.
Dsormais il est aux trois quarts plein. Le sommet du groupe des huit pays les
plus riches du monde (G8) de 2005 a notamment donn un nouvel lan l'aide
au dveloppement en annulant la dette des pays pauvres et en prenant de nou-
veaux engagements financiers.
De multiples exemples d'action concrte peuvent tre cits. Les bienfaits
continus de la vaccination et des traitements mdicaux surpassent largement
l'investissement initial. En Afrique de l'Ouest, un programme financ par 14
pays bailleurs de fonds a enray l'onchocercose, maladie terrible qui rend aveu-
gles ses victimes : 18 millions d'enfants vulnrables ont t protgs et 60 000
cas de ccit vits. Pour sa part, la firme amricaine Merck, qui avait trouv
en 1987 le mdicament ncessaire, a mis gratuitement celui-ci la disposition
de tous les pays qui en avaient besoin.
D'autres pays donateurs se sont engags par ailleurs hauteur d'un milliard
de dollars dans le cadre de l'Alliance mondiale pour les vaccins (GAVI), vitant
ainsi plus de 600 000 nouveaux dcs depuis 2000.
Le secteur priv s'est joint au mouvement avec le dveloppement de multiples
ONG dont l'intervention est essentielle. une autre chelle, la Fondation de
Bill et Melinda Gates joue de plus en plus un rle dcisif, avec ses 60 milliards
de dollars de dotation provenant pour moiti de ses fondateurs et pour moiti
171
de la fortune d'un autre milliardaire amricain, Warren Buffets, qui donnent
ainsi la plus belle des leons aux riches du monde entier. Parmi de multiples
initiatives, et aprs s'tre consacr la lutte contre le paludisme et d'autres ma-
ladies tropicales contre lesquelles il a dj fait vacciner 55 millions d'enfants,
Bill Gates annonait ainsi, le 19 juillet 2006, l'octroi de 16 dons totalisant 287
millions de dollars afin de crer un rseau mondial de recherche pour la mise
au point d'un vaccin contre le sida. Jamais un tel effort coordonn n'avait enco-
re t conduit au niveau mondial pour tenter de prvenir ce flau. Cette fonda-
tion s'est par ailleurs engage financer 4 000 puits quips de pompes dans 10
pays africains, qui procureront de l'eau courante plus de 10 millions d'habi-
tants.
Pour sa part, l'ancien prsident amricain Bill Clinton a cr sa propre fonda-
tion, la Clinton Global Initiative, pour offrir un nouveau modle de philanthro-
pie au XXI
e
sicle. En moins de deux ans, sa CGI a recueilli des centaines de
promesses de dons totalisant prs de 10 milliards de dollars ! L'initiative franai-
se UNITAID s'inscrit dans le mme mouvement.
L'actualit a enfin rcemment mis ses projecteurs sur les microcrdits dont
l'inventeur, Muhammad Yunus, a reu juste titre le prix Nobel de la Paix. Se-
lon la Banque mondiale, prs de 100 millions de personnes sont sorties de la
misre grce ce professeur d'conomie du Bangladesh. Certaines estimations
parlent mme de 500 millions de bnficiaires. Ce ne sont pas moins de 1 275
institutions de microfinance ONG, coopratives, banques qui distribuent
aujourd'hui aux plus pauvres des prts de trs faible montant qui leur permet-
tent d'acheter des outils, des semences, des matriaux de construction, et qui
leur servent se procurer des revenus qu'ils n'auraient pas eus en leur absence.
Le retentissement de ce prix Nobel sans prcdent se traduira trs probable-
ment par une diffusion encore accrue des microcrdits, qui sont sans conteste
l'une des inventions les plus remarquables des dernires dcennies au service
des plus dshrits. Le dernier livre de Muhammad Yunus n'est-il pas intitul
Vers la fin de la pauvret ?
Les performances du tiers-monde s'amliorent donc. Malgr l'accroissement
de leur population, le niveau de vie des pays en dveloppement s'tait lev en
moyenne de 1,5 % par an au cours des annes 1990. Depuis 2000, le rythme an-
nuel est pass 3,4 % et il s'acclre encore. Se fondant sur les rsultats acquis
au cours des cinq premires annes du sicle, la Banque mondiale a pu ainsi
estimer que le taux de pauvret pourrait dcrotre d'ici 2015 des deux tiers en
Asie du Sud et notamment en Inde, et non de moiti comme le demandaient
les Objectifs du millnaire . L'Afrique subsaharienne elle-mme commence
percevoir les fruits du progrs et vient d'enregistrer trois annes de croissance
plus de 5 %.
172
Au niveau mondial, la Banque mondiale prvoit une croissance moyenne des
pays en dveloppement de 4,5 % par an au cours du quart de sicle venir,
permettant de diviser par deux le nombre des plus pauvres d'ici 2030 grce la
poursuite de la mondialisation.
Mme si nous en sommes peu conscients en France, les efforts de la commu-
naut internationale sous l'gide des Nations unies ne sont donc pas vains. Ils
sont remarquables et la prise de conscience s'acclre. Malgr les apparences, et
en dpit du gaspillage que reprsentent les sommes absurdement consacres
la guerre et aux conflits, la plante n'a jamais t aussi solidaire et le progrs
technique aussi efficace.
Le chemin parcouru
Le chemin parcouru est donc stupfiant. En quelques dcennies, le tiers-
monde a accompli sous nos yeux des progrs fulgurants sans que nous en ayons
pris conscience, puisque seuls 1 % des Franais le savent.
La vrit, c'est que, malgr ce qui reste faire, les progrs l'emportent de trs
loin. Notre espce ne court pas la catastrophe, bien au contraire.
La Chine, premier pays communiste du monde, et l'Inde, premire dmocra-
tie de la plante, s'tant rallies l'conomie de march, le reste du globe a sui-
vi dans sa presque totalit. Aprs avoir longuement vgt et connu des quasi-
famines du fait d'une gestion de type sovitique, le Vietnam a par exemple d-
cid son tour au cours des annes 1980 d'adopter la libre entreprise avec des
rsultats qui se passent de commentaires. De 2001 2005, le taux de progres-
sion de son conomie a t de 8 % par an et il pourrait dpasser prochaine-
ment 10 %. Le niveau de vie a tripl ; la grande pauvret qui frappait en 1990 la
moiti de la population n'en affecte plus qu'un dixime ; les exportations ont
connu une croissance plus rapide encore que celles de la Chine, attei-
gnant 25 % par an ; le pays est en passe d'exporter plus de riz que la Thalande ;
deux tiers des jeunes suivent des tudes secondaires ; la mortalit infantile est
en chute...
L'Inde a approch une croissance de 10 % en 2006, et tout laisse penser
qu'elle sera bientt une seconde Chine. Jamais les progrs de l'humanit n'ont
t aussi rapides. En leur absence, se sont des centaines de millions de morts
supplmentaires que nous aurions d dplorer. Le dbat sur les bienfaits de l'co-
nomie de march est clos, comme en tmoignent les rsultats du sondage de l'Insti-
tut Globescan mentionn au dbut de ce livre. Il n'y a plus que dans notre pays
qu'il soit encore ouvert !
173
Il faut dire que nos compatriotes ont des excuses, car pendant longtemps,
personne ou presque ne leur a dit la vrit sur l'volution de l'humanit. Fid-
les leur manire de voir les choses, les cologistes en particulier n'ont lanc
que des messages ngatifs. Ils n'ont pas t les seuls. Jacques Chirac lui-mme
n'a-t-il pas encore stigmatis au dtriment des faits, en septembre 2006 devant
l'Assemble gnrale des Nations unies, le foss qui ne cesse de se creuser en-
tre les riches et les pauvres ?
Il ne faut donc pas s'tonner que 99 % des Franais aient encore une ide
fausse de ce qui se passe dans le tiers-monde, aujourd'hui engag dans une pha-
se de progrs sans prcdent dans l'histoire de l'Homme.
174
CONCLUSION
Oui, la plante est menace. La concentration de gaz effet de serre dans son
atmosphre ne cesse de s'accrotre vive allure, avec des consquences que nul
ne peut prvoir. Et l'humanit ne fait rien d'efficace pour lutter contre ce qui
pourrait tre un jour un flau catastrophique.
Notre pays a pourtant montr ce qu'il fallait faire. Avec 6 tonnes de rejet de
gaz carbonique par an et par habitant contre 12 pour la moyenne des pays dve-
lopps, la France donne l'exemple. Si le reste du monde faisait comme elle, les
risques de changement climatique pourraient tre carts pour l'essentiel. Mais
les cologistes s'opposent la principale solution qui permet d'afficher ce bilan
exceptionnel et qui est la seule aujourd'hui disponible l'chelle du problme.
Ils rejettent avec acharnement l'nergie nuclaire, et sont ainsi les ennemis de
l'cologie car ils ne proposent que des leurres inefficaces.
lectricit olienne, solaire, biocarburants ne sont que des paravents qui mas-
quent la construction un rythme sans cesse acclr de centrales thermiques
charbon ou gaz qui, du point de vue du climat, sont de vritables catastrophes
puisqu'elles rejettent elles seules prs de la moiti du gaz carbonique d'origi-
ne humaine.
Sans aucun rsultat positif pour l'volution de la plante, cette politique est
en outre ruineuse. Selon les responsables du programme Environnement
des Nations unies, les investissements consacrs au mythe des nergies renouve-
lables ont reprsent 70,9 milliards de dollars en 2006, et ils excderont 100
milliards avant 2010. Pour rien. Ils sont consacrs l'lectricit olienne (38 %),
aux biocarburants (26 %), l'nergie solaire (16 %) et la biomasse
1
. Encore
ces sommes ne constituent-elles qu'une partie minoritaire des montagnes d'ar-
gent dpenses de par le monde au nom ou au prtexte de la sauvegarde de la
plante.
Pour notre seul pays, qui n'aurait pourtant aucune raison de cder au politi-
quement correct qui inspire cette manire d'agir, le total des dpenses inutiles
atteint au moins 25 milliards d'euros par an et ne cesse de s'accrotre.
1
The Guardian, 21 juin 2007.
175
Il serait pourtant possible de rduire celles-ci court terme d'une dizaine de
milliards par an, sans qu'il en rsulte le moindre impact ngatif sur nos mis-
sions. un moment o le nouveau gouvernement veut mettre fin aux dpenses
inutiles, il y a l un chantier qui s'impose.
Mais il est trs difficile de lutter contre le politiquement correct. En juin 2007,
le nouveau ministre en charge de l'environnement et des transports dclarait
vouloir mettre fin l'cologie incantatoire , et il avait raison. Mais, tout aussi-
tt, il faisait exactement l'inverse en se fixant comme objectif de reporter au
moins un quart du trafic routier vers le rail et la voie d'eau . Lorsqu'on sait que
le transport des marchandises par la route reprsente plus de vingt fois le fret
ferroviaire, ceci signifie qu'il faudrait multiplier ce dernier par cinq au moins,
ce qui est physiquement impossible et serait en tout tat de cause ruineux. Cer-
taines valuations n'indiquent-elles pas qu'obtenir ce rsultat pnaliserait beau-
coup plus notre conomie que les 35 heures ? Les exemples de dpenses injusti-
fies dans le secteur des transports abondent dj et les potentiels d'conomies
reprsentent un nombre insouponn de milliards d'euros. Il n'y a aucun do-
maine o il soit possible d'conomiser autant et si facilement, condition de
rsister au terrorisme cologique.
Parmi d'autres, n'est-il pas srieusement prvu de construire autour de l'le de
la Runion un tramway qui n'est qu'une suite de viaducs gigantesques pour un
cot d'un milliard et demi d'euros, alors que tous les Runionnais ont une voi-
ture. N'y a-t-il vraiment rien de plus utile faire pour eux ?
Dans le concert des nations, la France a pourtant vocation faire entendre la
voix de la raison et jouer un rle majeur pour promouvoir une politique
mondiale nouvelle de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre, qui parte des
faits et non des ides reues, et cesse d'tre dconnecte de la ralit. Notre
pays est le seul qui ait le droit de parler haut et fort, puisque, seul, il donne
l'exemple au reste de la plante.
Ce que nous pourrions proposer tient en quelques points.
Comme l'a tardivement compris la communaut internationale, il faut tout
d'abord mettre la Chine et l'Inde autour de la table pour discuter srieusement.
Sans le concours de ces deux gants, rien n'est possible, puisque les pays dve-
lopps ont peu prs matris leurs missions et que c'est ailleurs que le pro-
blme est en train de littralement exploser.
La production de l'lectricit est alors la premire question qu'il faudra met-
tre l'ordre du jour. Tant que se poursuivra dans le monde entier et marche
force la construction de centrales gaz naturel ou charbon, rien ne sera pos-
sible.
L'adoption par la communaut internationale d'une rsolution prvoyant la
cessation dans un dlai dfinir une vingtaine d'annes au plus de la cons-
176
truction de toute centrale lectrique de moyenne ou de grande puissance reje-
tant du gaz carbonique dans l'atmosphre est l'objectif premier atteindre, sans
lequel tout le reste ne serait que littrature.
Dans l'tat actuel des techniques, ceci implique la gnralisation de la solu-
tion franaise, c'est--dire du recours au nuclaire associ l'hydrolectricit
quand c'est possible, en attendant la mise au point ventuelle de technique de
captation et de stockage du gaz carbonique pour les centrales thermiques clas-
siques un prix abordable.
Nous pourrions de mme nous mobiliser pour que les autres pays soient aussi
vertueux que nous pour leurs voitures, que les tats-Unis cessent de produire
des modles aux consommations absurdes, et que l'Allemagne limite enfin la
vitesse sur ses autoroutes.
Un autre volet de l'action que nous pourrions proposer concerne l'adoption
par la communaut internationale d'un montant commun pour la somme qu'il
est justifi de dpenser pour pargner le rejet d'une tonne de gaz carbonique
dans l'atmosphre.
Ce montant pourrait tre de 25 dollars, comme le propose l'Agence interna-
tionale de l'nergie. Il pourrait ventuellement tre deux ou trois fois plus le-
v, comme d'autres le suggrent, sans que cela change d'ailleurs beaucoup les
choses. Mais il faut surtout qu'il existe pour viter les gaspillages inefficaces qui
ont lieu aujourd'hui trs grande chelle sur la plante.
Une telle manire de faire permettrait d'avoir une approche rationnelle du
secteur des transports. Elle met trait tout d'abord en vidence que la voie de la
taxation n'est pas la bonne pour rduire les missions de ce secteur, car il fau-
drait que celle-ci atteigne des niveaux prohibitifs pour tre efficace. La taxe sur
les carburants routiers atteint dj l'quivalent de prs de 300 euros par tonne
de gaz carbonique mise en Europe sans que cela dissuade les Europens
d'avoir recours leur voiture et les entreprises au camion.
Taxer l'aviation au niveau de 25 euros par tonne de gaz carbonique mise
comme c'est parfois envisag aboutirait pour sa part accrotre le prix moyen
du billet de 1 % environ, et n'aurait donc rigoureusement aucun effet sur le vo-
lume des missions.
La seule solution raliste pour rduire les missions des transports repose non
sur d'imaginaires transferts modaux , mais sur l'acclration du progrs
technique des vhicules, et sur d'ventuelles rglementations destines rdui-
re ou interdire l'usage des matriels les plus consommateurs et donc les plus
polluants.
Aversion du nuclaire et phobie de la voiture, du camion et de l'avion sont
bien les deux mamelles du politiquement correct cologique.
177
Dans les deux cas, les cologistes proposent des alternatives irralistes et rui-
neuses auxquelles nous pourrions consacrer toutes nos ressources sans aucun
rsultat significatif. Ils nous conduisent sur la voie de gaspillages sans fin et nous
empchent d'agir vraiment pour l'cologie.
Au lieu de chercher rduire les inconvnients rels ou supposs des seules
solutions possibles, ils les rcusent, et il ne reste alors que des problmes.
Le succs actuel de l'cologisme ne peut enfin s'expliquer que si l'on en re-
vient aux deux visions du monde qui, depuis plus de deux sicles, partagent
l'humanit en deux camps opposs.
Les uns ont une perception optimiste de l'homme. Ils font confiance au pro-
grs. Ils voient l'histoire comme une marche en avant de la civilisation. Les au-
tres professent une vision pessimiste de l'humanit et sont persuads que tout
progrs a ncessairement un cot cach, de telle sorte que, mme lorsque le
monde semble avancer, il rgresse en ralit. Dans notre pays, ce sont eux qui
ont jusqu' prsent largement gagn le combat des ides.
Ils ont russi imposer une vritable loi du silence, une omert cologique.
Car tous les faits qui ont t cits dans ce livre sont connus. Mais nul n'ose les
dire. Les dirigeants de nos grandes entreprises du secteur de l'nergie, des
transports et de bien d'autres encore savent parfaitement ce qu'il en est. Mais
tous se considrent obligs de mentir face au rouleau compresseur du terroris-
me cologique. Et ils gaspillent alors par milliards notre argent.
Rveillons-nous.
Comment se fait-il que nous nous soyons laisss garer ce point par des
concepts qui ne viennent pas de chez nous ? Comment se fait-il que nous ayons
perdu tout bon sens, au point d'couter sans ragir les sirnes de ceux qui nous
conduisent sur des voies sans issue ?
C'est que nous avons t dirigs pendant un quart de sicle par des responsa-
bles qui ont accord aux ides et aux opinions plus d'importance qu'aux faits et
aux chiffres.
Telle est sans doute la racine du politiquement correct qui continue svir
sans partage dans le domaine de l'cologie.
Il n'est que temps de nous souvenir que nous sommes les hritiers de Descar-
tes, et que la vocation de notre pays est de porter au monde la voix de la raison
et du bon sens, et non de nous perdre dans des brumes venues d'ailleurs.
178
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Coran Phonetique PDFDocument460 pagesLe Coran Phonetique PDFzbimbo100% (3)
- Rapport de StageDocument36 pagesRapport de StageMaryem Hamed100% (3)
- Memoires D'un Temoin Du Siecle "Malek Bennabi"Document121 pagesMemoires D'un Temoin Du Siecle "Malek Bennabi"panicaud100% (6)
- Calendrier Musulman - Prières Et InvocationsDocument53 pagesCalendrier Musulman - Prières Et InvocationsSaf Fall100% (23)
- L'Histoire Secrete de L'espece HumaineDocument229 pagesL'Histoire Secrete de L'espece HumaineZaltissi Mohamed100% (1)
- Histoire D'un ParjureDocument119 pagesHistoire D'un ParjureZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- Les Moyens Utiles Pour Une Vie HeureuseDocument43 pagesLes Moyens Utiles Pour Une Vie HeureusetakkiddinePas encore d'évaluation
- Atlas Du Coran-ArabicDocument335 pagesAtlas Du Coran-ArabicZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- Ibn Arabî AlwasayaDocument349 pagesIbn Arabî AlwasayaZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- Al Fatiha Et Juz 'Amma Avec La Traduction de Leur Sens en FrançaisDocument57 pagesAl Fatiha Et Juz 'Amma Avec La Traduction de Leur Sens en FrançaisZaltissi Mohamed86% (7)
- Le Chemin Du Paradis - DR - Muhammad Muhsin KhanDocument212 pagesLe Chemin Du Paradis - DR - Muhammad Muhsin KhanZaltissi Mohamed100% (1)
- Islam-Civilisation de Demain - Du Sheikh Yusuf Al QardawiDocument232 pagesIslam-Civilisation de Demain - Du Sheikh Yusuf Al QardawiZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- Conseils Profitables Sur L'interdiction de La Médisance Et La CalomnieDocument23 pagesConseils Profitables Sur L'interdiction de La Médisance Et La CalomnieZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- 5 - Ramadan Expliqué Aux EnfantsDocument46 pages5 - Ramadan Expliqué Aux EnfantsZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- La Citadelle Du Musulman (Cheikh QahtaaniDocument145 pagesLa Citadelle Du Musulman (Cheikh QahtaaninabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Histoire Des ProphetesDocument594 pagesHistoire Des ProphetesSaidPas encore d'évaluation
- L'Unicité Divine (Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan)Document211 pagesL'Unicité Divine (Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan)nabsthetoonsPas encore d'évaluation
- Conseils Pour Le Mois de RamadanDocument7 pagesConseils Pour Le Mois de RamadanryadstreamingPas encore d'évaluation
- 4 - Ramadan Expliqué Aux EnfantsDocument54 pages4 - Ramadan Expliqué Aux EnfantsZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- Tableau Recapitulatif Sur La SalatDocument2 pagesTableau Recapitulatif Sur La SalatZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- La Différence Entre Le Bon Conseil Et Le DénigrementDocument44 pagesLa Différence Entre Le Bon Conseil Et Le DénigrementZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- 7 - Ramadan Expliqué Aux EnfantsDocument20 pages7 - Ramadan Expliqué Aux EnfantsZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- 2 - Ramadan Expliqué Aux EnfantsDocument29 pages2 - Ramadan Expliqué Aux EnfantsZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- Message À Ceux Qui Ne Croient Pas Au Prophète de L'islamDocument22 pagesMessage À Ceux Qui Ne Croient Pas Au Prophète de L'islamZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- 350 Plantes MediDocument131 pages350 Plantes MediBrigitte CarruthersPas encore d'évaluation
- IslamDocument30 pagesIslamjwimiliPas encore d'évaluation
- Ferhat Abbas - L'Independance Confisquee Algerie 1984Document119 pagesFerhat Abbas - L'Independance Confisquee Algerie 1984nabicha100% (8)
- Le Veritable Musulman-MusulmaneDocument73 pagesLe Veritable Musulman-MusulmaneZaltissi MohamedPas encore d'évaluation
- RapportPFE HouyemDocument79 pagesRapportPFE HouyemSebastian MessiPas encore d'évaluation
- WHJDR Magie ElfiqueDocument3 pagesWHJDR Magie ElfiqueRyu OsakiPas encore d'évaluation
- Flux GpaoDocument1 pageFlux GpaoAbdessalem BachaPas encore d'évaluation
- Traffic PlaybookDocument12 pagesTraffic Playbooksylvain NYETAMPas encore d'évaluation
- Tele-Immatriculation CNPSDocument2 pagesTele-Immatriculation CNPSlegende androidePas encore d'évaluation
- Alimentation D Un Moteur DieselDocument128 pagesAlimentation D Un Moteur DieselJdd Kas100% (4)
- La Ruine Presque Cocasse D'un PolichinelleDocument140 pagesLa Ruine Presque Cocasse D'un PolichinelleandrePas encore d'évaluation
- WPS Spécimen CSC ASME IXDocument5 pagesWPS Spécimen CSC ASME IXMenad SalahPas encore d'évaluation
- CoursDocument35 pagesCourschahrazed youtubePas encore d'évaluation
- Évaluation SDEDocument4 pagesÉvaluation SDEnc9qg6jmh7Pas encore d'évaluation
- 1876 20151205 PDFDocument25 pages1876 20151205 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- TransForce Transverse Arch Developing AppliancesDocument2 pagesTransForce Transverse Arch Developing AppliancesOrtho OrganizersPas encore d'évaluation
- Le Chemin de La Baie N 7Document4 pagesLe Chemin de La Baie N 7ecenarroPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document3 pagesChapitre 3Amal Bouaziz Ep BakloutiPas encore d'évaluation
- AmbroxanDocument3 pagesAmbroxanmohamedtounsi2012Pas encore d'évaluation
- 2018-Chap4-Application Du Premier PrincipeDocument54 pages2018-Chap4-Application Du Premier PrincipeOthMane TaPas encore d'évaluation
- LogDocument3 pagesLogZakaria El KhiyatiPas encore d'évaluation
- Le Commerce InternationaleDocument98 pagesLe Commerce Internationaleabderrahim.elmastour1Pas encore d'évaluation
- Patrimoine Bâti - À Chacun Sa Pierre - Parc Naturel Régional de ...Document24 pagesPatrimoine Bâti - À Chacun Sa Pierre - Parc Naturel Régional de ...Camelia SmahanPas encore d'évaluation
- 01 Lima Action Plan FR FinalDocument13 pages01 Lima Action Plan FR FinalSalomé DahanPas encore d'évaluation
- Calcul de Pont Type - Ponts CadreDocument37 pagesCalcul de Pont Type - Ponts CadreMansour LassouedPas encore d'évaluation
- La Lettre Des Militants Socialistes de VilleurbanneDocument4 pagesLa Lettre Des Militants Socialistes de VilleurbanneParti Socialiste VilleurbannePas encore d'évaluation
- Transformateur MonophaséDocument10 pagesTransformateur MonophaséYASSINE ALMOUTAOUAKILPas encore d'évaluation
- Plan Fundatie 1 3: Sectiunea 1 - 1 Sectiunea 2 - 2 Sectiunea 3 - 3 Sectiunea 4 - 4Document1 pagePlan Fundatie 1 3: Sectiunea 1 - 1 Sectiunea 2 - 2 Sectiunea 3 - 3 Sectiunea 4 - 4Proiectare constructii BucurestiPas encore d'évaluation
- Le Choix de La PureteDocument4 pagesLe Choix de La PureteOlivier KangoPas encore d'évaluation
- GuideTechnique LCPC GTINPONTDocument128 pagesGuideTechnique LCPC GTINPONTYacine NadirPas encore d'évaluation
- Offre D Emploi Campus FranceDocument2 pagesOffre D Emploi Campus FranceJanell Marie De GuzmanPas encore d'évaluation
- Fr-esr-Descriptif Ed Historique AnnuelDocument2 pagesFr-esr-Descriptif Ed Historique AnnuelOrnella ANAGONOU-ZODJIPas encore d'évaluation
- Ileus Biliaire Avec Evacuation Spontanee Dun Gros Calcul: A Propos Dun CasDocument3 pagesIleus Biliaire Avec Evacuation Spontanee Dun Gros Calcul: A Propos Dun CasIJAR JOURNALPas encore d'évaluation