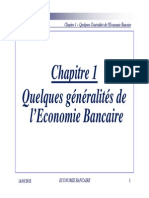Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
2 Assiette Impots Locaux
2 Assiette Impots Locaux
Transféré par
Nassima Nait Slimane0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
14 vues28 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
14 vues28 pages2 Assiette Impots Locaux
2 Assiette Impots Locaux
Transféré par
Nassima Nait SlimaneDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 28
L'assiette des impts locaux : la
dtermination des bases cadastrales
et leur gestion par les services de lEtat
_____________________
PRESENTATION
____________________
La Cour a conduit, dans les services fiscaux, une enqute sur la
manire dont ils tablissent et grent les valeurs locatives servant
dassiette aux impts directs locaux, afin den valuer lefficience.
Les taxes directes locales qui apportent aux collectivits locales
66,1 Md de recettes, sont le rsultat du produit dune assiette (les bases
cadastrales tablies par lEtat) par un taux, vot par les collectivits
territoriales, chacune pour ce qui la concerne. Le lgislateur a, en effet,
souhait instaurer une dualit de responsabilit dans la dtermination du
montant des taxes locales.
Les modes de gestion des bases sont ainsi au cur de la relation
entre lEtat et les collectivits territoriales. La mesure de leur efficience
revt un intrt particulier dans le contexte des rflexions
institutionnelles en cours sur les comptences et les ressources de ces
dernires. En outre, la conjoncture financire et conomique, marque
par un ralentissement de la construction, est de nature ralentir le
dynamisme spontan des bases cadastrales, rendant dautant plus
ncessaire la modernisation de leur gestion.
Lenqute de la Cour sest droule un moment o les services
fiscaux faisaient lobjet dune double rorganisation avec la fusion entre
les centres des impts et les centres des impts fonciers au sein de lex
direction gnrale des impts (DGI), et la fusion de cette dernire avec la
direction gnrale de la comptabilit publique (DGCP) pour former la
direction gnrale des finances publiques (DGFIP).
28 COUR DES COMPTES
La Cour a examin les modes dorganisation retenus pour la
gestion des bases cadastrales, lvolution des effectifs chargs de cette
mission et le cot de celle-ci pour lEtat. Elle a galement mesur les
rsultats obtenus au regard du rendement de limpt mais aussi de sa
transparence et de son quit, afin dapprcier lefficacit fiscale du
dispositif mis en uvre.
Les impts assiette cadastrale
Les impts locaux dont lassiette procde, partiellement ou totalement,
des bases cadastrales, constituent une ressource majeure pour les collectivits
territoriales.
Selon la DGFIP, les ressources de fonctionnement de lensemble des
collectivits territoriales (communes, dpartements, rgions, collectivits
fiscalit propre), en 2007, se sont leves 169,7 Md dont 66,1 Md pour
les impts dont lassiette est totalement ou partiellement fonde sur les bases
cadastrales.
Cinq impts sont concerns :
- les deux taxes foncires, btie et non btie (15,25 Md en 2007) :
lassiette repose sur la valeur locative cadastrale laquelle est applique un
abattement de 50% pour le bti et 20 % pour le non bti ;
- la taxe dhabitation (19,2 Md en 2007) : lassiette repose sur la
valeur locative de limmeuble occup ;
- la taxe professionnelle (26,8 Md en 2007) : lassiette est beaucoup
plus complexe et les bases cadastrales y interviennent hauteur de 16 % ;
- la taxe denlvement des ordures mnagres (4,8 Md en 2007) :
son assiette est tablie daprs le revenu net servant de base la taxe foncire
sur les proprits bties.
Si les ressources dont ont dispos les collectivits locales, en 2007, au
titre de ces cinq impts se sont leves 66,1 Md, ce chiffre ne correspond
pas au montant acquitt par le contribuable local pour deux raisons : lEtat a
pris sa charge 16 Md afin de compenser des exonrations et dgrvements
divers ; en revanche, le produit vot et peru par les collectivits territoriales
est augment dun prlvement (5,5 Md en 2007) correspondant aux frais
de gestion perus par l'Etat.
L'enqute de la Cour montre que le processus dtablissement des
bases cadastrales par la DGFIP est dune grande opacit : il est la fois
exagrment complexe, fragile, et dun cot mal cern. En outre,
labsence de rvision gnrale des bases depuis 1970, combine une
mise en uvre trop restreinte des procdures dactualisation par les
services fiscaux, dans le cadre du droit existant, produit une situation
obsolte et inquitable.
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 29
I - Un processus opaque
Les oprations permettant de dterminer la valeur locative dun
bien constituent une chane longue et complexe, marque par de
nombreuses fragilits, au cot mal identifi.
A - Une chane doprations longue et complexe
Les modalits de dtermination de la valeur locative varient selon
que le bien est usage dhabitation, usage commercial ou est un
btiment industriel. Lnumration qui suit en montre lextrme et
excessive complexit :
1 - Les proprits usage dhabitation
Les proprits usage dhabitation reprsentent 30 millions de
locaux. Le calcul de leur valeur locative revient multiplier une surface
pondre, obtenue aprs de nombreuses oprations, par le tarif de la
catgorie dans laquelle est class le bien.
Treize tapes sont suivies par les agents de ladministration
fiscale :
1. La proprit usage dhabitation est dabord
classe dans une catgorie
21
en fonction des
lments de confort quelle est suppose dtenir.
Il existe huit catgories, elles-mmes divises
22
en sous catgories
(6M ; 6, 5M, 5), allant du local trs dgrad (catgorie 8) au
grand luxe (catgorie 1). Les dpendances isoles sont classes de
la catgorie A D et celles de pur agrment de CA DA.
2. La surface pondre comparative est ensuite
calcule.
21) Article 324 H de lannexe III du code gnral des impts (CGI)
22) Annexe III, article 324 F du CGI
30 COUR DES COMPTES
Ladministration fiscale part dune surface de rfrence, dite
surface relle dans le CGI, correspondant au nombre de mtres
carrs au sol. Ce mode de calcul de la surface est diffrent des
rgles imposes au march immobilier (calcul en loi Carrez) qui
ne prennent en compte que les surfaces dont la hauteur sous
plafond est suprieure 1,80 mtre.
Cette surface de rfrence est pondre par lappartenance la
catgorie au terme dun calcul ralis travers trois tranches de
superficie. Pour une maison individuelle, les premiers 20 m
2
sont
affects dun coefficient variant de 3 (catgorie 1) 1,10
(catgorie 8) ; les mtres carrs suivants sont affects dun
coefficient uniforme de 0,90 jusqu un plafond correspondant la
norme de la catgorie ; les mtres carrs supplmentaires par
rapport la norme de la catgorie sont affects dun coefficient de
0,75. Dans un immeuble collectif, les premiers 20 m
2
sont affects
dun coefficient de pondration variant de 2,60 1,05.
3. La surface pondre nette est alors dtermine,
grce un correctif appliqu la surface pondre
comparative, pour tenir compte de ltat dentretien de la
partie principale.
4. Un coefficient de situation gnrale et particulire
est affect la surface pondre nette en fonction de la
situation gnrale du bien dans la commune (proximit
ou loignement du centre ville, cadre tranquille, risques
dinondation) et de sa situation particulire (exposition,
prsence despaces verts, prsence ou absence de
dpendances non bties).
5. Le confort de lhabitation est examin pour obtenir
une quivalence superficielle. Les divers lments,
supposs illustrer un surcrot ou une dficience de
confort, ajoutent ou retranchent des mtres carrs.
Ainsi, une salle de bains augmente la surface de 5m
2
.
Chaque pice de lhabitation bnficiant dun chauffage
central accrot la surface de 2 m
2
. Un vide-ordures compte
pour 3 m
2
et leau courante pour 4 m
2
.
6. Les mmes calculs sont effectus pour les
dpendances tels que garages, places de stationnement,
hangarsUn garage ou une place de stationnement dans
un garage collectif dot dune prise deau courante est,
par exemple, davantage tax que la mme dpendance
qui nen bnficie pas.
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 31
7. Le total de ces pondrations successives donne la
surface pondre totale.
8. La surface pondre totale est multiplie par le tarif
de la catgorie dans la partie de commune concerne
pour donner la valeur locative 1970, date de la
dernire rvision des bases.
9. Cette valeur locative 1970 est ensuite actualise en
valeur 1980, anne de la dernire et unique
actualisation intervenue pour tenir compte de
lvolution locale du prix des loyers, qui stait faite
au moyen de coefficients dpartementaux.
10. La valeur locative 1980 est enfin revalorise par
un taux annuel vot en loi de finances.
11. Cette valeur revalorise est divise par deux pour
donner le montant du revenu cadastral.
12. Le revenu cadastral se voit affecter un taux vot
par chaque collectivit concerne (commune,
intercommunalit, dpartement, rgion), auquel
sajoute la part de la taxe pour les ordures mnagres.
Le produit du revenu cadastral par le taux dtermine
limpt d chaque collectivit.
13. Le total de limpt, toutes collectivits
confondues, est major dun taux de 8 %
reprsentant le prlvement de lEtat pour frais
de gestion (cf. infra).
Aprs ces treize oprations successives, les services
fiscaux sont en mesure de dterminer le montant de la
taxe sur le foncier bti. A partir de la valeur locative,
ils procdent au calcul de la taxe dhabitation qui fait
entrer en jeu des lments qui ne sont plus seulement
lis la valeur du bien comme le revenu des cohabitants
ou le nombre de personnes charge.
32 COUR DES COMPTES
Exemple de calcul du montant d par le redevable
pour un bien en catgorie 5 (source DGFIP)
Surface relle de lappartement 132 m
2
Surface pondre comparative de la partie principale :
(20 m
2
* 1,45) (90 m
2
* 0,90) + (22 m
2
* 0,75)
126 m
2
Surface pondre brute des dpendances incorpores
(par exemple : vranda)
+22 m
2
Equivalences superficielles (correspondant la prise en
compte dlments tels que la situation du bien ainsi que le
confort de lhabitation et des ses dpendances)
+52 m
2
Surface pondre totale 229 m
2
Dpendances non incorpores
(par exemple : parking distinct de lhabitation)
19 m
2
Surface pondre nette 7 m
2
Surface pondre totale 7 m
2
TOTAL : 229 m
2
+
7 m
2
236 m
2
valeur locative pondre 6,86 / m
2
valeur locative du local 1970 : 236 m
2
x 6,86 1 619
valeur actualise 1980 : 1 619 * 1,49 2 412
valeur revaloris : 2 412 * 2,689
(taux annuel vot en loi de finances)
6 486
Revenu cadastral : 6 486 / 2 3 243
Impt d la commune : 3 243 * 24,66 %
(taux vot par la commune)
800
Impt d lIntercommunalit 3 243 * 7,27 %
(taux vot par lEPCI)
236
Impt d au Dpartement : 3 243 * 11,45 %
(taux vot par la Dpt)
371
Impt d la Rgion 3 243 * 3,66 %
(taux vot par la Rgion)
119
Taxe d'enlvement des ordures mnagres :
3 243 * 13 %
422
Montant de limpt total 1 948
Prlvement de lEtat pour frais de gestion : 1 948 * 8 % 156
Montant d par le redevable : 1948 + 156 2 104
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 33
2 - Les locaux industriels
La dtermination de la valeur locative cadastrale est une opration
moins complexe. Elle se fonde sur la "mthode comptable"
23
: le prix de
revient des diffrents lments (terrain et constructions), revaloris
annuellement par les coefficients prvus en matire de rvision des bilans,
est affect dun coefficient fix par dcret en Conseil dEtat.
3 - Les locaux commerciaux
Trois mthodes
24
sont utilises. Le local peut tre valu au moyen
des baux sous rserve quil ait t lou des conditions de prix normales
au 1
er
janvier 1970, par comparaison si le bien ntait pas lou dans les
conditions requises en 1970 ou, dfaut, par la mthode dapprciation
directe.
Lvaluation partir des baux conclus avant 1970 reprsente 5,7 %
du parc.
L'valuation par comparaison, aujourdhui la plus utilise (92,7 %
des locaux valus) consiste, selon le CGI, " attribuer un immeuble ou
un local donn une valeur locative proportionnelle celle qui a t
adopte pour dautres biens de mme nature pris comme types.".
Lexercice de la comparaison suppose quexiste la possibilit de
comparer. Lagent des services fiscaux doit trouver un local type, existant
en 1970, ce qui nest pas le cas par exemple pour les chanes
dhypermarch ou les complexes cinmatographiques, par exemple,
apparus postrieurement cette date.
Lvaluation par apprciation directe
25
consiste dterminer la
valeur locative partir de la valeur vnale du local apprcie en valeur
1970, affecte dun taux dintrt. Elle concerne 1,5 % des valuations
mais des entreprises importantes (socits de tlphonie mobile). Il sagit
pour lagent des services fiscaux de reprer, pour un immeuble
comparable, la transaction la plus proche possible de 1970.
23) Article 1499 du CGI
24) Article 1498 du CGI
25) Le CGI dcrit cette mthode comme subsidiaire , dans son article 1498,
prcis par les articles 324 AB et 324 AC de lannexe (dcret du 28 novembre 1969)
34 COUR DES COMPTES
B - Un processus marqu par de nombreux points de
fragilit
1 - Des moyens limits pour apprcier la valeur cadastrale du bien
Le processus de dtermination des valeurs cadastrales ptit dune
forte contradiction entre le nombre et la nature des critres utiliss pour
tablir cette valeur et les moyens de ladministration pour en vrifier
lexistence.
Les permis de construire constituent le principal outil de
renseignement des services. Les autorisations dlivres par les communes
sont centralises dans les bases de donnes du ministre charg de
lquipement et reverses aux services de la DGFIP. Les propritaires ont,
quant eux, une obligation dclarative
26
. Six mois aprs la cration du
permis de construire, les services fiscaux envoient une lettre les invitant
fournir des renseignements sur leur proprit, aprs lachvement des
travaux. Les nouveaux propritaires ont 90 jours pour sacquitter de cette
obligation. Sils ne le font pas, une lettre de mise en demeure leur est
adresse. La deuxime mise en demeure intervient aprs trente jours. Si
labsence de dclaration persiste, les services fiscaux procdent une
valuation doffice, soit partir des documents dposs la mairie si
lachvement des travaux a t dclar la commune, soit en se rendant
sur place.
Cette procdure est correctement suivie par les services fiscaux. Il
reste que les informations contenues dans les permis de construire sont
dune prcision ingale pour les 36 000 communes franaises, supposer
mme que le droit, en matire de permis de construire, soit totalement
respect. En outre, des dispositions rcentes viennent rduire les
obligations relatives ces derniers, privant ladministration dune partie
des informations quelle recueillait antrieurement. Le dcret du 5 janvier
2007 rduit de manire trs significative le nombre de changements de
consistance susceptibles dtre ports la connaissance de
ladministration, hors secteurs protgs. Sont dsormais exemptes de
toutes formalits des constructions diverses dont les btiments dont la
hauteur au sol est infrieure 12 mtres et qui ont pour effet de crer une
surface hors uvre brute de moins de 2 m
2
(abri de jardin, par exemple),
ou les piscines dont la superficie est infrieure ou gale 10 m
2
. De mme,
lobligation de dpt dun permis de construire est supprime au bnfice
dune simple dclaration pour les btiments dune surface situe entre 2 m
2
et 20 m
2
(garage, par exemple) ou pour une piscine dont la superficie est
infrieure 100 m
2
.
26) Article 1406 du CGI.
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 35
En tout tat de cause, la notion de changement de consistance na
jamais inclus les modifications intrieures du bien : la construction de
trois salles de bains dans une maison qui en tait dpourvue ne ncessite
pas un permis de construire ; elle nest donc pas porte la connaissance
des services fiscaux alors que chaque salle de bains identifie entre dans
lassiette fiscale et compte pour 5 m
2
dans le calcul de la surface pondre
totale.
La situation est encore plus contraste en cas de changement de
propritaire. Les renseignements concernant le bien qui arrivent dans les
services fiscaux sont parcellaires et rarement exploits, pour plusieurs
raisons.
Le descriptif du bien peut tre trs incomplet et ne dtailler que
partiellement les lments de confort. Certains professionnels soucieux
doptimisation fiscale pour leurs clients y veillent particulirement.
Les contribuables nont, en outre dans ce cas, aucune obligation
dclarative, la diffrence de celle faite aux dposants de permis de
construire. Les pratiques des services fiscaux sont dailleurs diffrentes
selon les dpartements : certains nenvoient aucun formulaire destin
recueillir des renseignements loccasion dune mutation, dautres le font
systmatiquement : une convention avec la mairie de Paris le prvoit
expressment, mais ce cas est unique. Les professionnels (syndics,
gestionnaires de biens) sont parfaitement informs du caractre non
obligatoire de la rponse aux interrogations des services fiscaux,
contrairement aux contribuables non professionnels qui rpondent plus
volontiers. Cet tat de fait cre une ingalit de traitement peu justifiable.
Enfin, la Cour a constat que les services fiscaux ne vrifiaient pas
systmatiquement la cohrence entre le prix dachat du bien et la
catgorie dans laquelle il est class.
La DGFIP met en place, dsormais, un livret foncier, accompagn
dune dclaration pr-remplie, diffuser aux acqureurs dun bien. Ceux-
ci valident la description de leur bien. Le projet a dbut en 2008, pour
exprimentation dans trois dpartements : Hrault, Seine-et-Marne,
Somme. Cette initiative est positive. La validation de la dclaration reste
nanmoins facultative. En outre, lexprience ralise en partenariat avec
le notariat venant de dbuter, il est impossible den faire le bilan, tant du
point de vue du civisme dclaratif que de la capacit des services
fiscaux exploiter les dclarations.
En tout tat de cause, cette initiative ne rgle pas les problmes
dgalit entre contribuables. Un propritaire ayant dpos un permis de
construire ou un acheteur parisien remplissant scrupuleusement le
formulaire prvu par un accord entre lEtat et la Ville alimentent les
36 COUR DES COMPTES
services fiscaux en renseignements permettant dasseoir la taxation sur
une base correspondant aux lments rels de superficie et de confort. A
linverse, un redevable, propritaire depuis plusieurs annes dun bien
dans lequel il a fait raliser dimportants amnagements intrieurs, voire
extrieurs, pourra tre tax sur la base dune assiette sans rapport avec les
lments rels de confort dont il bnficie.
2 - Un risque non ngligeable derreurs matrielles ou
dapprciation
La complexit du processus dtablissement des bases cre
invitablement des risques derreurs. Si certaines des treize oprations
dcrites plus haut sont totalement automatises comme les calculs
dactualisation, de revalorisation ou lapplication de taux, il nen va pas
de mme de celles qui relvent dune valuation du bien.
Certains critres renvoient une apprciation purement subjective :
la classification dans la catgorie, lapprciation de ltat dentretien de la
partie principale de limmeuble, le jugement port sur les avantages et les
inconvnients de la situation gnrale du bien dans la commune, de la
situation particulire
Le risque derreurs peut galement tre dordre matriel : le
dcompte exhaustif de tous les lments contribuant la pondration
(existence dun ascenseur, dun vide-ordures, dune prise deau dans le
garage, nombre de salles de bains, de cabinets de toilettes) ou la
vrification de la prennit de labri de jardin ou de la vranda laisse
place des inexactitudes, quelle que soit la conscience professionnelle de
lagent.
Places de stationnement et taxe dhabitation
Lassiette fiscale des particuliers peut aussi tre concerne par une
application variable dun droit incertain. Ainsi, la jurisprudence du Conseil
dEtat considre quun garage ou une place de stationnement individuel
situe proximit de lhabitation principale est une dpendance de celui-
ci et donc soumis la taxe dhabitation. La proximit est dfinie par une
distance de moins dun kilomtre en voiture. Aucune prcision nest fournie
pour le cas, frquent dans les grandes villes, o le plan de circulation entrane
une distance de moins dun kilomtre laller et de plus dun kilomtre au
retour. Dans la pratique, les services fiscaux ne calculent jamais la distance
parcourir et imposent une taxe toutes les places de garage.
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 37
Or, la DGFIP ne dispose daucune statistique interne sur les erreurs
ou les facteurs de risques et na pas mis en place les contrles ncessaires.
Les travaux relatifs lassiette cadastrale sont, en effet, effectus
par un seul agent, pour chaque proprit concerne. J usquen dcembre
2008, il nexistait aucune traabilit de lopration de classification,
le nom de lagent responsable ne figurant pas dans le fichier. Cette
traabilit vient dtre mise en place la suite du contrle de la Cour. Les
quipes sont formes dagents de catgorie C encadrs par un agent de
catgorie B. Ce dernier ne contrle pas systmatiquement le classement
opr, sauf sil est consult sur un cas prcis. En outre, aucun agent
rencontr, durant linstruction de la Cour, na vu son travail de classement
vrifi par un contrleur extrieur (contrle de deuxime niveau) au cours
de sa carrire.
Ladministration avance deux arguments pour justifier la faiblesse
de ces contrles. Le premier porte sur le fait que la liste dite 41, remise
aux communes chaque anne, fait mention des modifications opres,
pour lessentiel les constructions neuves, instaurant ainsi un contrle
implicite par la collectivit locale. Ces dernires tiennent, en effet, au
moins sur une base annuelle, des commissions communales des impts
directs qui examinent les crations ou modifications de classification dans
le parc immobilier communal. Le second argument sappuie sur la
faiblesse du contentieux de lvaluation.
Aucun de ces deux arguments ne peut tre reu. Le lgislateur a
expressment confi aux services de lEtat la responsabilit de lassiette
des impts locaux pour viter des distorsions de tous ordres entre
collectivits. Une commission communale des impts directs ne peut tre
considre comme un contrle de deuxime niveau.
Quant la faiblesse des contentieux de lvaluation, elle est
incontestable et de plus en plus marque. En 2007, on ne compte
quenviron 80 000 rclamations sur plus de 22 millions darticles mis
pour la taxe foncire btie alors que ce chiffre atteignait 120 000 en 1995.
Les contentieux devant les juridictions administratives sont de lordre de
2 500 par an. La diminution des rclamations traduit dindniables
progrs dus la meilleure qualit de linformatisation des services. La
faiblesse des rclamations et des contentieux parat, nanmoins, devoir
tre attribue, pour partie, lopacit du processus mme si la faiblesse
de la valeur locative, compare au loyer rel, facilite lacceptation de
limposition. Le contribuable, surtout lorsquil est un particulier, ne
connat ni la catgorie dans laquelle son bien est class, ni les lments de
pondration qui affectent ce classement. Il na aucun moyen rel de
contester lassiette de son impt, la diffrence de limpt sur le revenu
pour lequel il connat lassiette retenue.
38 COUR DES COMPTES
Enfin, si la fusion des centres des impts fonciers, spcialistes de
ces travaux, et des centres des impts, destine faire traiter par les
mmes agents les dossiers fiscaux des particuliers, est une mesure qui va
dans le sens de la simplification pour lusager, il nest pas certain,
nanmoins, qu'elle ne cre pas provisoirement un risque derreurs plus
lev, les agents tant moins expriments et le contrle interne n'ayant
pas t renforc.
C - Un cot mal cern
Le nombre et la complexit des oprations exiges pour
ltablissement des bases cadastrales requirent ncessairement un
nombre important dagents dont lvolution est devenue trs imprcise.
1 - Des effectifs qui ne sont plus quantifis depuis 2005
Pour lidentification des agents chargs de ces tches, la DGFIP ne
dispose que des chiffres de lanne 2005, priode antrieure la fusion
des centres des impts et des centres des impts fonciers.
A cette date, sur un total de 6 058 agents du cadastre dans les
services dconcentrs, 3 020 agents environ, soit 82 % des effectifs non
affects des tches topographiques dans les 294 centres des impts
fonciers et les 17 bureaux antennes, assuraient, pour lessentiel, les tches
dites fiscales :
lvaluation de tous les biens fonciers, lexception des
tablissements industriels ;
le recensement des changements affectant la dtermination des
bases dimposition des taxes foncires, de la taxe dhabitation
et de la taxe professionnelle ;
la mise jour des dbiteurs de taxes foncires ;
le traitement du contentieux de lvaluation et de lattribution.
A ce chiffre, il fallait ajouter la participation des responsables de
centre des impts, des inspecteurs et des gomtres aux tches fiscales,
que lex-DGI dclarait ne pouvoir quantifier avec prcision. Il fallait
galement comptabiliser les agents de ladministration centrale chargs
de ces questions, soit une trentaine de personnes.
La DGFIP allgue que la fusion des centres des impts et des
centres des impts fonciers ne permet plus didentifier aussi prcisment
les effectifs ncessaires pour tablir lassiette des taxes directes locales.
Dans les dpartements ou parties de dpartement dans lesquels la fusion a
t ralise, le mme agent traite la fois, sagissant des particuliers, de
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 39
lassiette des impts locaux et de celle de limpt sur le revenu. Elle ne
fournit donc plus depuis 2005 les chiffres des effectifs impliqus dans les
tches dassiette des impts locaux. De mme, les dernires mesures du
cot de lassiette et du contrle de limpt, valu 230 M, ont t
ralises en 2006 partir dun chantillon de services non encore
fusionns.
En fait, lex-DGI ne sest pas dote des outils permettant de
mesurer la fois le cot de la rorganisation entreprise (amnagements de
locaux, formation des agents) et les gains de productivit attendus. Cet
tat de fait est dautant plus regrettable que les services concerns sont
dsormais affects par une deuxime rorganisation, en raison de la
fusion de lex-DGI avec lex-DGCP : la mise en place dun service des
impts des particuliers devrait runir les agents chargs de lassiette et du
recouvrement de tous les impts directs des particuliers.
Dans cette situation, le risque est de ne pouvoir mesurer que trs
imparfaitement les gains ventuels de productivit entre la situation
antrieure, la situation transitoire prvalant durant la mise en place de la
rforme et la situation postrieure aux rorganisations.
Au stade actuel, il est, en tout tat de cause, impossible dvaluer,
pour les effectifs existants, la part qui pourrait tre conomise par une
simplification du dispositif dtablissement des bases du surcrot de temps
dagents que requiert une gestion moins routinire de lassiette fiscale.
2 - Un cot de gestion de l'assiette surfactur
Le montant total de limposition du contribuable, aprs
dtermination de la part respective de chaque collectivit locale, est
major de 4,4 % pour frais dassiette et de recouvrement de l'impt
foncier, et de 3,6 % pour les dgrvements et admissions en non valeur,
aux termes de larticle 1641 du CGI.
Le taux pour frais dassiette et de recouvrement a t de 4 %
jusquen 1990 avant dtre port 4,4 % en 1991 et 1992 au motif de la
rvision en cours des bases cadastrales. Il a t prennis par la loi de
finances pour 1996, alors que la rvision des bases, certes effectue par la
DGI, na pas t mise en uvre.
S'agissant de la taxe d'habitation, les frais d'assiette et de
recouvrement sont de 4 % pour les rsidences principales et de 8 % pour
les rsidences secondaires.
40 COUR DES COMPTES
Le tableau ci-dessous, constitu partir dun chantillon de 500
services montre que, pour les taxes foncires, le taux de 4,4 % du produit
fiscal appel ne correspond pas la ralit des cots pour lEtat. Ceux-ci
sont chiffrs, en 2006, par les deux directions de la DGFIP, 1,7 % du
produit collect, ce dernier incluant le montant des frais dassiette et de
recouvrement.
Taux d'intervention sur les taxes foncires en M
Source :
Les gains de productivit raliss par les deux directions
accroissent rgulirement lcart entre le cot rel et le taux peru.
Il est vrai que, si les cots de gestion sont surfacturs, les cots
rels pour lEtat des dgrvements et des admissions en non valeur
reprsentent, en revanche, beaucoup plus que 3,6 % des taxes locales. La
surfacturation vient compenser une sous-facturation.
Il nest toutefois pas acceptable que lEtat laisse se prenniser deux
prlvements dtachs des fondements rels que sont les dpenses quils
sont censs compenser. Cet tat de fait cre une situation peu saine dans
laquelle les collectivits territoriales se jugent prives de recettes du fait
du prlvement pour cots de gestion alors quelles ignorent le cot rel
des dgrvements et dfauts de paiement des contribuables pris en charge
par lEtat.
II - Un dispositif obsolte et inquitable
Lobsolescence des bases cadastrales a une double origine : une
absence de rvision gnrale et une mise en uvre trop restreinte des
procdures qui permettraient dactualiser ces donnes droit constant.
Cet tat de fait produit des situations inquitables et cre un risque de
fluctuation des ressources pour les collectivits locales, l'assiette des taxes
ne progressant que grce aux constructions neuves.
2003 2004 2005 2006
Cot DGI assiette/contrle* en M 230,17 227,25 236,35 229,33
Cot DGCP recouvrement en M 191,77 200,48 210,61 202,12
Cot global en M 421,94 427,73 446,96 431,45
Recettes en M 20 800,00 22 081,00 23 528,00 24 714,00
Taux d'intervention global 2,03 % 1,94 % 1,90 % 1,75 %
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 41
A - La double origine de lobsolescence des bases
Lchec de la rvision gnrale intervenue aprs la loi de 1990
comme la gestion souvent routinire des bases cadastrales par
ladministration produisent une situation de grave obsolescence.
1 - Labsence de rvision gnrale des bases depuis 1970
Un rapport du Conseil des impts, paru en 1989, soulignait les
dfauts des modalits retenues pour lassiette des taxes locales qui se
caractrisaient par labsence de prise en compte des ralits conomiques
et de la valeur relle des biens. La dernire rvision gnrale des bases
datait de 1970 pour le foncier bti et de 1960 pour le foncier non bti. Le
rapport mentionnait tout particulirement le caractre inquitable des
classifications opres, remarquant notamment que les immeubles
anciens des centres-villes dont ltat rel navait pas t actualis taient
sous-fiscaliss, alors que les habitations collectives construites la fin des
annes 60 taient surfiscalises puisque dotes du confort moderne .
Le Conseil des impts prconisait une adaptation du systme pour
le rendre plus quitable fiscalement et plus efficace en simplifiant les
critres de calcul des bases cadastrales et en rvisant les bases cadastrales
une frquence rgulire.
Au demeurant, la loi du 18 juillet 1974 prvoyait dj :
- une rvision gnrale tous les six ans, partir des valeurs
locatives cadastrales fixes au 1
er
janvier 1970 ;
- une actualisation triennale, destine tenir compte de lvolution
locale du prix des loyers (la dernire et unique - actualisation par
application de coefficients dpartementaux date de 1980 ;
- une revalorisation annuelle dont les taux sont dcids chaque
anne en loi de finances, car appliques des bases non rvises, ces
majorations en prennisent ou en accentuent les dfauts ;
- des mises jour priodiques : celles-ci devaient rsulter dune
dclaration du contribuable (constructions nouvelles, changement de
consistance, changement daffectation) ou dune constatation doffice par
ladministration (changement de caractristiques physiques ou
denvironnement).
Sur ces quatre dispositions de la loi, la revalorisation annuelle a t
la seule tre pleinement mise en uvre.
42 COUR DES COMPTES
Sagissant de la premire disposition, lex-DGI a travaill une
rvision gnrale des bases pendant deux ans. Les simulations ralises
ont alors rvl des transferts dune ampleur qui a t juge insupportable
par les autorits politiques. La rvision a t abandonne en 1992, et
toutes les tentatives de reprendre la mme dmarche ont chou pour les
mmes raisons.
La non-application de la loi de 1990 est lorigine dune curiosit
administrative : la juxtaposition dans linformatique de lex DGI de deux
bases de donnes, lune datant de 1970, lautre de 1991/1992. Le mme
bien a, aujourdhui, une valeur 1970 et une valeur 1990, cette dernire
ntant pas utilise.
Elle a surtout contribu figer le paysage fiscal la situation des
annes 70. Les catgories servant classer les biens des particuliers,
mentionnes ci-dessus, sont dfinies dans le code gnral des impts par
des critres archaques et sont dclines, commune par commune, par des
procs verbaux qui reproduisent les mmes dfauts.
Chacune des huit catgories est dfinie par quatre batteries de
critres
27
:
le caractre architectural de limmeuble, allant du nettement
somptueux de la catgorie 1 laspect dlabr de la catgorie
8. La catgorie 2 a une architecture particulirement soigne ,
les catgories 3 et 4 ont une belle apparence , mais les
catgories 5, 6 et 7 nont aucun caractre particulier ;
la qualit de la construction, excellente en catgories 1 et 2,
puis de plus en plus modeste, avec un pronostic de dure de vie
limite pour la catgorie 6, et entache de vices divers en
catgories 7 et 8 ;
la distribution du local : les pices de rception sont
spacieuses en catgorie 1 et 2, assez spacieuses en
catgories 3 et 4. Une pice de rception existe en gnral en
catgorie 5, mais disparait des catgories 6, 7 et 8. A partir de la
catgorie 4, on peut constater labsence de salles de bains au
profit dun cabinet de toilettes avec eau courante ;
les quipements intrieurs : partir de la catgorie 5, on note
labsence possible de cabinets de toilettes intrieurs au profit de
cabinets de toilettes extrieurs. A partir de la catgorie 7, leau
courante est lextrieur du local. Le tapis descalier disparait
partir de la catgorie 5 pour les immeubles.
27) CGI, annexe 3, article 324.
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 43
Les procs-verbaux communaux qui datent de 1970 et dcrivent,
pour chaque catgorie, un local type existant sur le territoire de la
commune destin servir de point de comparaison, participent
logiquement de la mme obsolescence. Le classement dans une catgorie
est, en effet, effectu par un agent de la DGFIP laide du procs-verbal
communal sur lequel figurent les locaux de rfrence. Lagent dispose
aussi, le plus souvent, dune monographie communale, tablie par les
services fiscaux, qui dfinit les critres de classification et nest pas
ncessairement totalement identique aux procs-verbaux communaux.
Dans les procs-verbaux, les apprciations sur la nature du confort
sont trs marques par les proccupations architecturales des annes
soixante. Pour tre qualifi de confortable, lappartement doit avoir un
vaste sjour mais rien nest dit de la taille des chambres. Les couloirs
sont un lment considr comme source de confort supplmentaire, ce
qui enlve de la valeur fiscale un appartement class du 17
me
sicle aux
pices en enfilade mais en ajoute un appartement dans un immeuble
loyers modrs.
Les dfinitions appliques chaque catgorie sont au demeurant
trs imprcises. Ainsi, dans le procs-verbal dune ville du Val-dOise, la
rubrique conception gnrale des locaux indique :
catgorie 3M : les diverses parties du local sont spacieuses,
surtout les salles de rception ;
catgorie 4 : les pices sont spacieuses mais moins que
prcdemment, grande salle de sjour ;
catgorie 4M : les pices demeurent spacieuses, mais moins que
dans la catgorie prcdente
Le rle jou par certains lments descriptifs peine tre trouv.
Dans la mme ville, la maison type classe 3M, se caractrise par des
motifs dcoratifs et un perron . On ne sait quel est le degr dimportance
de ces lments et s'il faut en infrer que toutes les maisons classes 3 M
ont un perron ou qu'il sagit simplement dun lment dapprciation
subsidiaire. La rponse peut varier en fonction de lagent charg de
classer la maison concerne.
La part laisse lapprciation individuelle pour le classement
dans la catgorie est donc trs large ainsi que le risque derreur
dapprciation dj voqu, dautant que lagent des services fiscaux
dispose aussi, pour lclairer , de la monographie communale tablie
par les services fiscaux qui fournit des critres parfois lgrement
diffrents. Les monographies ont, en effet, t ralises, pour beaucoup
44 COUR DES COMPTES
dentre elles, aprs 1970, voire en 1991, pour permettre la rvision
gnrale qui na pas t mise en uvre.
Lenqute de la Cour a dailleurs permis de relever que des biens
trs similaires relevaient de classements diffrents selon les communes. A
titre dexemple, un pavillon simple mais confortable est class en
catgorie 6 dans une commune de lAisne et en catgorie 5 dans le Val-
dOise. Il est vrai que ces disparits sont attnues par le fait que limpt
local est essentiellement un impt de rpartition communal ; cette ralit
ne supprime pas les distorsions nes des carts de classement dune
commune lautre.
A la fragilit juridique sajoute la fragilit matrielle. Les procs-
verbaux de 1970 tablis sur un support papier sont dans un tat de
conservation dgrad. La DGFIP na entrepris quen 2008 leur
dmatrialisation.
2 - Une actualisation trs peu frquente
Mme si labsence de rvision gnrale des bases reprsente un
handicap majeur pour moderniser lassiette des taxes locales, une rponse
partielle ce constat, insuffisamment mise en uvre selon la Cour,
pourrait tre apporte par le biais des procdures dactualisation.
Plusieurs modalits peuvent tre utilises pour actualiser les bases :
a) La premire est la cration de nouvelles catgories dhabitation
dans les procs-verbaux communaux ou la mise jour des locaux de
rfrence. La DGFIP ne dispose pas de statistiques nationales sur ces
crations. Lexamen de la situation dans les dpartements montre que les
mises jour sont trs rares.
A titre dexemple, un audit interne ralis dans un dpartement en
novembre 2007 indique que les procs-verbaux communaux
complmentaires sont en nombre trs restreint. Lauditeur voque une
situation fige depuis 35 ans pour les locaux dhabitation . Il cite la
commune chef lieu dont le PV date de 1972, comporte 117 locaux de
rfrence, avec un seul PV complmentaire ralis en 1982. Dans une
autre ville du mme dpartement, aucune mise jour du PV na t
ralise depuis 1972.
En fait, les procs-verbaux complmentaires se sont presque
partout limits prendre en compte les piscines. Dans le mme
dpartement, pourtant situ dans le Nord de la France, on constate que 80
90 %, selon les localits, des PV complmentaires portent sur les
piscines. Celles-ci constituent une amlioration du confort et ont
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 45
lavantage dtre visibles. Il est nanmoins difficile de penser quelles
reprsentent la seule amlioration de lhabitat en France depuis 1970.
b) La deuxime modalit dactualisation revient constater
lamlioration de lhabitat, local par local, et reclasser, si ncessaire, les
biens concerns. La procdure utilise par la DGFIP cet effet porte le
nom officiel de vrification slective de locaux (VSL) et officieux de
sorties de frigidaire . La DGFIP ne dispose pas davantage de
statistiques nationales sur ces oprations.
A dfaut de donnes portant sur lensemble du territoire, lenqute
de la Cour a procd par sondages et a pu constater que le redressement
des valeurs locatives jouait un rle marginal dans laugmentation des
bases.
Dans une commune de la rgion parisienne, les rsultats sont les
suivants :
Nombre dhabitants 70103
Foyers fiscaux 39 450
Nombre de locaux 47 998
VSL(2007) 388
(soit 0,008 % du nombre de locaux)
Les 388 VSL ralises en 2007 portent sur les habitations de
catgorie 8.
Dans une circonscription administrative plus vaste et plus peuple
dun dpartement rural, les chiffres sont les suivants :
Nombre dhabitants 134 597
Foyers fiscaux 73 471
Nombre de locaux 78 641
VSL en 2005 381 (soit 0,005 % )
VSL en 2006 78 (soit 0, 001 %)
La faiblesse du nombre de vrifications slectives est donc
vidente. La plus grosse opration a t conduite dans le dpartement du
Nord en 2003 pour 9 000 locaux concerns, essentiellement des petites
maisons individuelles pour lesquelles le redressement fiscal a t de
lordre de 40 %. Laugmentation des valeurs locatives avait entran une
forte motion et a d tre lisse sur plusieurs annes.
46 COUR DES COMPTES
c) Lapplication dune autre disposition
28
est tout aussi peu
effective. Le code gnral des impts indique quil doit tre procd
annuellement la constatation des changements de caractristiques
physiques : travaux importants raliss dans limmeuble, dpassant
largement les travaux dentretien normaux incombant au propritaire.
Cest ladministration qui doit procder au constat de la modification
opre et lvaluer.
Cette disposition est peu applique dans la pratique pour deux
raisons : le changement doit affecter plus de 10 % de la valeur locative ;
ladministration fiscale na aucun moyen de vrification, puisquelle ne
peut pntrer lintrieur des proprits.
Le code gnral des impts prvoit galement la constatation de
changements relatifs lenvironnement. Cette terminologie dsigne la
ralisation doprations durbanisme, la cration despaces verts,
limplantation ou la suppression dtablissements pouvant prsenter des
risques ou des nuisances.
Cette possibilit pour ladministration est galement peu utilise, le
changement denvironnement comme la modification de caractristiques
physiques devant entraner une modification de plus de 10 % de la valeur
locative. Or, la construction dune autoroute proximit du bien ou celle
dun aroport nest pas, a priori, considre comme modifiant de plus de
10 % cette dernire. Il a nanmoins t procd une baisse de catgorie
pour des quartiers proches de laroport de Roissy-Charles de Gaulle.
La porte de laction de ladministration est, au demeurant, limite
par la jurisprudence. Le Conseil dEtat a, en effet, jug que la variation de
plus de 10 % de la valeur locative devait sapprcier pour chaque nature
de changement (caractristiques physiques ou denvironnement) et ne
pouvait se cumuler.
B - Les consquences de lobsolescence : des valeurs
loignes de la ralit et inquitables
Labsence de rvision des bases et les dfaillances de
lactualisation par les services produisent un classement des biens
immobiliers sans rapport avec la ralit et peu quitable.
28) Article 1517-I-1 du CGI.
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 47
1 - Un classement sans rapport avec la ralit du parc immobilier
Les classements oprs restent, en grande partie, tributaires des
quilibres entre catgories existant dans les annes 1970. Il en rsulte une
forte concentration du parc immobilier dans la catgorie 6, suppose
reflter un confort quasi-inexistant et dans la catgorie 5, dont le
descriptif suggre un confort modeste. Les catgories 7 et 8 qui renvoient
thoriquement un habitat trs dlabr restent fortement reprsentes.
Comme le montrent les tableaux ci-dessous, la prise en compte de
lamlioration de lhabitat se fait un rythme peu soutenu.
Classement des maisons individuelles
Catg. 2000 Part % 2007 Part % Evolution
en % 2000-
2007
1 et 1M 160 0,001 % 219 0,001 % 36,88 %
2 et 2M 2 808 0,017 % 3 920 0,022 % 39,60 %
3 et 3M 63 947 0,391 % 80 982 0,455 % 26,64 %
4 498 711 3,048 % 623 094 3,501 % 24,94 %
4M 364 548 2,228 % 487 664 2,740 % 33,77 %
5 4 406 582 26,934 % 5 307 713 29,820 % 20,45 %
5M 2 400 669 14,674 % 2 854 297 16,036 % 18,90 %
6 5 890 330 36,004 % 6 322 215 35,519 % 7,33 %
6M 467 590 2,858 % 493 630 2,773 % 5,57 %
7 et 7M 1 947 217 11,902 % 1 390 811 7,814 % -28,57 %
8 317 862 1,943 % 234 807 1,319 % -26,13 %
Total 16 360 424 100 % 17 799 352 100 % 8,80 %
48 COUR DES COMPTES
Classement des logements collectifs (appartements)
Si la diminution des biens classs en catgories 7 et 8 est
incontestable, la DGFIP recense nanmoins encore 1 625 618 maisons et
649 400 appartements classs dans ces catgories. Or, la dernire tude de
lINSEE sur le logement en France mtropolitaine fournit les donnes
suivantes :
273 000 logements insalubres ;
270 000 logements sans WC intrieurs ;
210 000 logements sans installations sanitaires.
De son ct, la Fondation Abb Pierre chiffre 400 000 le nombre
de locaux insalubres en France, en 2005, et les logements trs
inconfortables , dfinis par labsence dau moins deux sur trois lments
de confort (salle de bain, cabinets de toilettes intrieur, chauffage),
586 000.
La classification de la DGFIP, lvidence, ne correspond pas la
ralit pour les catgories 7 ou 8, qui avaient pourtant t les cibles, quasi
uniques, des vrifications slectives de locaux.
En outre, il ressort des chiffres de la DGFIP que 38,3 % des
maisons et 33 % des appartements sont classes en 6 ou 6 M. 39,3 % des
maisons individuelles et 48,5 % des appartements relvent des catgories
5 ou 5 M. Les catgories 5 et 6 rassemblent ainsi soit 77,6 % des maisons
individuelles et 81,5 % des appartements.
Catg. 2000 Part % 2007 Part % Evolution
en % 2000-
2007
1 et 1M 831 0,006 % 798 0,005 % -3,97 %
2 et 2M 14 028 0,097 % 14 493 0,095 % 3,31 %
3 et 3M 208 611 1,444 % 229 871 1,504 % 10,19 %
4 1 115 495 7,720 % 1 232 019 8,060 % 10,45 %
4M 600 923 4,159 % 725 942 4,749 % 20,80 %
5 4 486 723 31,051 % 4 978 081 32,569 % 10,95 %
5M 2 234 923 15,467 % 2 431 964 15,911 % 8,82 %
6 4 587 829 31,751 % 4 788 680 31,329 % 4,38 %
6M 248 188 1,718 % 233 685 1,529 % -5,84 %
7 et 7M 896 034 6,201 % 609 739 3,989 % -31,95 %
8 55 732 0,386 % 39 661 0,259 % -28,84 %
Total 14 449 317 100,000 % 15 284 933 100,000 % 5,78 %
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 49
Si le classement dans ces catgories recouvrait la ralit, il faudrait
en conclure que les classes moyennes de notre pays disposent, en 2008,
dune cuisine comme seule pice de rception et trs alatoirement-
dune salle deau. Il faudrait galement considrer que le nombre des
maisons de luxe ou de trs grand luxe se limite 4 139 units sur le
territoire national, celui des appartements de mme catgorie se montant
seulement 15 291 units.
2 - Des facteurs d'iniquit
Lobsolescence des bases, mme si elle affecte lensemble du parc
immobilier, est plus marque dans certains cas. A cet gard, elle est
cratrice de situations inquitables.
Lexamen des deux tableaux ci-dessus montre que les biais
introduits par ltat du parc immobilier de 1970 nont pas t
significativement rsorbs. Le faible nombre dappartements en
immeubles collectifs, rapport au nombre de maisons individuelles,
classs en catgories 7 et 8 montre que cette rpartition remonte une
priode durant laquelle le confort moderne tait suppos davantage
prsent dans les immeubles neufs que dans les maisons individuelles plus
anciennes. En outre, les pavillons sont, en majorit, classs en 6 et 5 M, et
les appartements en 5, ce qui ne se justifie par aucune donne tenant au
confort relatif ou la valeur vnale. La situation actuelle est mme
inverse : elle est marque par la dgradation des grands ensembles des
priphries des villes beaucoup plus que par des difficults particulires
dans les zones pavillonnaires.
Toutefois, les effets de labsence de rvision gnrale depuis 1970
ne sont pas les seuls responsables des dfauts dquit du dispositif
actuel. Cest ainsi quune construction neuve ou un bien ayant connu une
lourde rnovation extrieure sont ports la connaissance des services
fiscaux : le classement dans la catgorie prend en compte les lments de
confort dclars. En revanche, un bien ancien n'est soumis aucun permis
de construire ou dclaration obligatoire peut continuer appartenir une
catgorie trs infrieure son niveau rel de confort.
De mme, un bien immobilier qui fait lobjet dune ou plusieurs
mutations peut donner lieu une actualisation de sa valeur. Tel est le sens
du livret foncier mis en place auprs des notaires par la DGFIP titre
exprimental, qui permettra de disposer dlments dclaratifs actualiss
sur le niveau de confort du bien. En revanche, un immeuble qui nest
soumis aucune mutation pendant des annes chappe ce dispositif.
50 COUR DES COMPTES
En outre, la prise en compte dlments de confort dsormais
quasiment gnraliss tout le parc immobilier ne permet aucunement de
discriminer entre des locaux pourtant trs diffrents du point de vue de la
valeur conomique du bien considr. Un loft dapparence extrieure
modeste, luxueusement amnag lintrieur, chauff par des radiateurs
lectriques, donne lieu, si on applique les critres du code gnral des
impts, une assiette fiscale moins leve quun appartement loyer
modr, de mme superficie, qui a le mme nombre de salles de bains, un
chauffage central et un vide-ordures.
Enfin, la faible prise en compte par les services fiscaux des
changements relatifs aux caractres physiques ou lenvironnement
empche de dclasser des immeubles construits dans les annes 1960
ou 1970, et aujourdhui trs dgrads.
C - Un lment de vulnrabilit pour les ressources des
collectivits territoriales
Le dynamisme de lassiette des taxes locales est li au niveau lev
des constructions neuves. En cas de flchissement de la construction, le
dfaut dactualisation des bases reprsente une menace relle pour les
ressources des collectivits territoriales.
1 - Un dynamisme des bases port par les constructions neuves
En dpit du caractre trs conservateur du dispositif actuel, une
grande partie de laccroissement de la ressource des collectivits locales
durant les dix dernires annes provient de lvolution des bases,
lexception du foncier non bti.
Sagissant, en effet, de limpt sur les proprits non bties, on
constate une volution ngative due la multiplicit des exonrations en
faveur des exploitations agricoles : - 9,5 % en dix ans en euros courants ;
-18,5 % hors coefficient de revalorisation. Les taux moyens restant
faibles, le produit final constitue un lment rsiduel de la fiscalit locale.
En revanche, pour limpt sur les proprits bties, le dynamisme
des bases est rel, avec une hausse de 39 % en euros courants et de
21,3 % hors coefficient de revalorisation.
Pour la taxe dhabitation, les chiffres sont respectivement de
39,2 % et 21,5 %.
Cette croissance de la valeur des bases est un effet mcanique du
dynamisme de la construction neuve, mme si elle est trs loin de reflter
le niveau rel de laugmentation de la valeur du parc immobilier qui
slve +145 %, pour les dix dernires annes.
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 51
Pour le foncier bti, comme pour la taxe dhabitation, la
progression des bases a t nettement plus forte que celle des taux,
lexception des rgions pour les annes 2005 et 2006. La seule hausse des
bases a assur, en 2007, la croissance des produits vots par les
communes et leurs groupements.
3 - Une assiette appele stagner en cas de flchissement de la
construction
Les dfauts dactualisation des bases, longtemps dissimuls par le
nombre lev des constructions neuves, sont susceptibles dapparatre de
manire beaucoup plus accentue dans une conjoncture de forte baisse de
la construction.
En priode de contraction de la construction immobilire, le
produit fiscal mis la disposition des collectivits locales pourrait donc
tre amen stagner eu euros constants. Ces dernires devraient alors,
pour disposer du mme niveau de ressources, et sauf solliciter une
compensation encore accrue de l'Etat, augmenter les taux appliqus une
assiette devenue atone ou diminuer les dgrvements et exonrations
divers qui amputent le produit fiscal.
__________
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
________
Les constats qui prcdent, quils tiennent la complexit et
lopacit du dispositif, son caractre obsolte et inquitable qui
saggrave danne en anne, ou au risque quil reprsente pour les
finances locales, rendent un changement indispensable.
Plusieurs pistes sont possibles. Un premier choix consiste
dterminer si lassiette des taxes locales doit tre fonde sur des valeurs
conomiques relles ou sur des valeurs administres. Si loption
privilgiant la valeur conomique relle du bien tait retenue, il
conviendrait de dterminer si celle-ci ferait lobjet dune dclaration
obligatoire et systmatique, comme pour limpt de solidarit sur la
fortune, ou serait prise en compte au fil de leau , loccasion des
mutations. Si un dispositif fond sur des valeurs administres tait
maintenu, il faudrait mettre en place, soit une rvision gnrale des bases
partir des travaux effectus en 1991 et 1992, soit une simplification du
dispositif dtablissement des bases couple une actualisation de celles-
ci.
La Cour ne sous-estime pas les difficults dune rforme de cette
nature. Le maintien du statu quo pendant de trop longues annes na pu
quaggraver les effets de transferts potentiels entre contribuables et entre
collectivits territoriales, en cas de modifications apportes au dispositif.
Ces effets devraient pouvoir tre lisss sur plusieurs annes.
52 COUR DES COMPTES
Quels que soient les choix retenus, ceux-ci devraient privilgier la
simplicit des procdures, la transparence pour le contribuable et des
garanties de stabilit pour les finances locales.
En toute hypothse, la DGFIP, pour ce qui la concerne, doit grer
beaucoup plus efficacement un segment de la fiscalit auquel elle doit
accorder toute lattention ncessaire, en raison de l'enjeu qu'il reprsente
pour les citoyens. La fusion de la direction gnrale des impts avec la
direction gnrale de la comptabilit publique pour former la direction
gnrale des finances publiques (DGFIP) doit tre une occasion de
revoir non seulement les modes dorganisation mais aussi les mthodes
de travail. Les services fiscaux doivent profiter de lexprience acquise
par lex-direction gnrale de la comptabilit publique dans sa relation
aux collectivits locales.
La Cour recommande de :
- Scuriser les procdures dvaluation des valeurs cadastrales en
mettant en place une vritable traabilit et des contrles de premier
et de deuxime niveau. Cette exigence est encore plus forte dans le cas o
le dispositif actuel serait prorog dans toute sa complexit.
- Mettre en uvre une gestion beaucoup plus dynamique des bases.
A droit constant, la DGFIP doit se doter dun programme dactualisation
des bases existantes travers des vrifications slectives des locaux
beaucoup plus nombreuses et rgulires.
- Mettre en place les outils de suivi permettant de mesurer
prcisment les gains de productivit obtenus par la fusion des centres
des impts et des centres des impts fonciers et dsormais par la
constitution des services des impts des particuliers.
- Clarifier les relations avec les collectivits territoriales afin que
les cots de gestion de lassiette et du recouvrement des taxes locales se
rapprochent des cots rels, principe qui doit valoir aussi pour la part
prise par lEtat dans la compensation des dgrvements et admissions en
non valeur.
- Rompre avec lopacit totale qui entoure lassiette de la fiscalit
locale pour le contribuable, en faisant figurer sur sa feuille dimposition
les calculs qui ont dtermin la valeur cadastrale du local concern. Le
redevable doit pouvoir connatre la catgorie dans laquelle est class son
bien et lensemble des pondrations qui dterminent sa valeur locative.
L'ASSIETTE DES IMPTS LOCAUX 53
RPONSE DU MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le rapport de la Cour des comptes intitul L'assiette des impts
locaux : la dtermination des bases cadastrales et leur gestion par les
services de lEtat appelle de ma part les observations suivantes.
Le rapport de la Cour des comptes intitul Lassiette des impts
locaux : la dtermination des bases cadastrales et leur gestion par les
services de lEtat appelle de ma part les observations suivantes :
Tout dabord, je partage le constat de la Cour sur lanciennet des
valeurs locatives, qui reposent sur des principes dfinis en 1970, et la
ncessit dune rforme. A cet gard, il convient de souligner que le
Prsident de la Rpublique a appel de ses vux une rforme de la fiscalit
locale lors du Congrs des maires et prsidents de communaut de France,
fin 2007. Le Premier ministre sest galement rcemment exprim en ce sens
loccasion de la Confrence nationale des excutifs. Lors des rcents
dbats parlementaires sur les lois de finances, il a par ailleurs t convenu
dengager une rflexion sur une rforme de la fiscalit locale ds la fin des
travaux du comit pour la rforme des collectivits locales, prsid par
lancien Premier ministre Edouard Balladur.
En revanche, je ne partage pas les formulations retenues par la Cour
pour qualifier les travaux de mes services ( le rapport indique en labsence
de rvision gnrale des bases depuis 1970 combine une mise en uvre
trop restreinte des procdures dactualisation par les services fiscaux, dans
le cadre du droit existant, produit une situation obsolte et inquitable ; il
est fait tat dune mise en uvre trop restreinte des procdures qui
permettraient dactualiser ces donnes droit constant ). Je tiens
souligner le professionnalisme des agents de la DGFIP et le srieux de leurs
travaux au bnfice des collectivits locales. A cet gard, les changements
affectant les proprits bties et non bties sont pris en compte rgulirement
par les services fiscaux et prsents annuellement aux commissions
communales des impts directs. De surcrot, des oprations de vrification
slective des locaux, dont certaines sont formalises dans le cadre de
conventions, sont rgulirement menes en troite collaboration avec les
communes.
Par ailleurs, sagissant plus particulirement du classement des
locaux, il convient de souligner que la nomenclature-type fixe par dcret
dfinit des critres ncessairement gnraux destins tre adapts aux
normes locales de construction. Ds lors, il apparat hasardeux daffirmer
page 22 si le classement dans ces catgories recouvrait la ralit, il
faudrait en conclure que les classes moyennes de notre pays disposent, en
2008, d'une cuisine comme seule pice de rception et -trs alatoirement-
dune salle deau . En effet, une maison ou appartement class aujourdhui
en 5me catgorie correspond un logement assez confortable dot de tous
54 COUR DES COMPTES
les lments de confort. Les comparaisons entre les dnombrements effectus
par la DGFiP et ceux effectus par lINSEE apparaissent galement
hasardeuses. En effet lINSEE ne recense que les logements occups, alors
que la taxe foncire sapplique galement aux logements vacants.
En outre, il est important de prciser que la taxe foncire sur les
proprits bties et la taxe dhabitation sont des impts de rpartition. Une
dcision dinstaurer un glissement gnral vers le haut du classement de
lensemble des locaux d'habitation n'aurait aucun effet sur la rpartition de
l'impt entre les redevables.
Enfin, la DGFiP travaille rgulirement amliorer ses prestations
pour les collectivits territoriales. Ds 2009, la DGFIP proposera aux
collectivits une nouvelle offre de services en matire fiscale, en assurant
notamment une information plus rgulire des lus sur le rle et les
modalits de fonctionnement des commissions communales des impts
directs. Elle sengagera galement sur une fourniture beaucoup plus prcoce
des bases prvisionnelles de lensemble des taxes locales, lment
indispensable une meilleure matrise budgtaire.
Vous aimerez peut-être aussi
- Mémoire Cartographie Des RisquesDocument127 pagesMémoire Cartographie Des Risquesneghli100% (1)
- Comptabilite Audit DSCG ExtraitDocument20 pagesComptabilite Audit DSCG ExtraitNezha Lakmassi100% (1)
- Recueil Informations Pratiques Sur Les CL - VR 110914 - 0Document52 pagesRecueil Informations Pratiques Sur Les CL - VR 110914 - 0Moctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- Correction Du Test Psychotechnique 2012 - 1Document2 pagesCorrection Du Test Psychotechnique 2012 - 1Benjamin KambouPas encore d'évaluation
- 30370262culture Generale Et Actualite 2010 Correction PDFDocument23 pages30370262culture Generale Et Actualite 2010 Correction PDFMoctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- Dpbep 2019 2021Document86 pagesDpbep 2019 2021Moctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- CoursDocument151 pagesCoursMoctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- 82376562correction Culture Generale 2009 Nouveau1 PDFDocument9 pages82376562correction Culture Generale 2009 Nouveau1 PDFMoctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- Pedo4 2012Document54 pagesPedo4 2012Moctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- GenresDocument50 pagesGenresMoctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- Pieces A Fournir Bourses - Ccb2 20162017Document2 pagesPieces A Fournir Bourses - Ccb2 20162017Moctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- 7494 Culture Redacteur BRDocument358 pages7494 Culture Redacteur BRMoctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- Sol P1 1Document13 pagesSol P1 1Moctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- Optique MpsiDocument58 pagesOptique Mpsihakkay86% (14)
- Economie Bancaire - Chapitre 1 PPT - Quelques Generalites de L'economie Bancaire Ugb Lea (Mode de Compatibilité)Document15 pagesEconomie Bancaire - Chapitre 1 PPT - Quelques Generalites de L'economie Bancaire Ugb Lea (Mode de Compatibilité)Moctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- AjiliDocument35 pagesAjiliMoctar Mdbsfamille FallPas encore d'évaluation
- Cours01 MonopoleDocument44 pagesCours01 MonopoleMAHTOUTPas encore d'évaluation
- Audit Interne PDFDocument77 pagesAudit Interne PDFEya HEPas encore d'évaluation
- IAS 27 Avant La Révision Et Aprés La RévisionDocument4 pagesIAS 27 Avant La Révision Et Aprés La RévisionHassanPas encore d'évaluation
- CV+ Lettre MotivationDocument4 pagesCV+ Lettre MotivationSophie Danielle NzetePas encore d'évaluation
- Le Guide de La Comptabilité D'entreprise Pour TousDocument17 pagesLe Guide de La Comptabilité D'entreprise Pour TousMerveille SayabPas encore d'évaluation
- 2 - Specificites de L'audit JuridiqueDocument7 pages2 - Specificites de L'audit JuridiqueSeydouPas encore d'évaluation
- Equivalences Et Dispenses Du Dscg. Nouvelle Liste Des DispensesDocument2 pagesEquivalences Et Dispenses Du Dscg. Nouvelle Liste Des DispensesayoubPas encore d'évaluation
- DSCG Ue4 Enonce Table Des MatieresDocument2 pagesDSCG Ue4 Enonce Table Des MatieresWahib YayaPas encore d'évaluation
- Prise de Position Audit Interne Qualite Mai 2004 1Document8 pagesPrise de Position Audit Interne Qualite Mai 2004 1Azalea De l'AtlasPas encore d'évaluation
- Eléments Probants ISA 500 Résumé.Document14 pagesEléments Probants ISA 500 Résumé.Koussay MahjoubPas encore d'évaluation
- Ingénierie Financière-Adel DerouicheDocument142 pagesIngénierie Financière-Adel DerouicheAicha Ben TaherPas encore d'évaluation
- Cours Comptabilite Publique - Ali Bissaad 2021Document97 pagesCours Comptabilite Publique - Ali Bissaad 2021LINA BENAMARAPas encore d'évaluation
- Evenement LogistiqueDocument7 pagesEvenement LogistiqueMohamed ELKORCHIPas encore d'évaluation
- La Reddition Des Comptes Dans L'administration PubliqueDocument16 pagesLa Reddition Des Comptes Dans L'administration PubliqueImad El FouissiPas encore d'évaluation
- Sujet Dec Mai 2014 Epreuve 1Document6 pagesSujet Dec Mai 2014 Epreuve 1Dalal ZouhdiPas encore d'évaluation
- Cours Audit Interne - MACDocument126 pagesCours Audit Interne - MACEric100% (1)
- INTOSAI P 20 Principes de Transparence Et de ResponsabiliteDocument13 pagesINTOSAI P 20 Principes de Transparence Et de ResponsabiliteJason MAGUSTINPas encore d'évaluation
- Rajoroarivonysm Ges m1 08Document89 pagesRajoroarivonysm Ges m1 08yonga payosPas encore d'évaluation
- UNIMER1Document92 pagesUNIMER1Hamza HamzaPas encore d'évaluation
- Modèle Rapport CACDocument4 pagesModèle Rapport CACOumaima BOULASSAFERPas encore d'évaluation
- Appel A Candidature - Relance: ContexteDocument23 pagesAppel A Candidature - Relance: Contexteroldes josthenPas encore d'évaluation
- Audit Hind CDocument10 pagesAudit Hind CHind DriouchPas encore d'évaluation
- Voie de L'excellence - 5ème Édition - 2013 - Copie-1Document57 pagesVoie de L'excellence - 5ème Édition - 2013 - Copie-1Soukroumde MarcelPas encore d'évaluation
- Ilovepdf MergedDocument31 pagesIlovepdf MergedOUMAIMA BOUTAYEBPas encore d'évaluation
- Chema RAHMANIDocument1 pageChema RAHMANIchema rahmeniPas encore d'évaluation
- Rapport-Financier-Annuel-2021 - Compressed-Compressed-1-75 (1) - 53-56Document4 pagesRapport-Financier-Annuel-2021 - Compressed-Compressed-1-75 (1) - 53-56Anass OkhitaPas encore d'évaluation
- Objectifs de Contrôle Interne Appliqué Au Cycle de TrésorerieDocument2 pagesObjectifs de Contrôle Interne Appliqué Au Cycle de Trésorerieoumaima chaieri100% (1)
- UploadedFile 131025239591138408Document21 pagesUploadedFile 131025239591138408gtrPas encore d'évaluation
- Annexe Au Rapport - Responsabilités de L'auditeurDocument4 pagesAnnexe Au Rapport - Responsabilités de L'auditeurDjibril COULIBALYPas encore d'évaluation