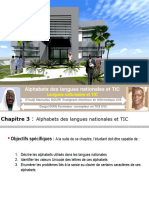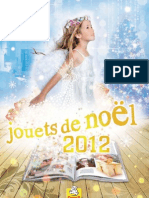Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Intro Au Marketing
Intro Au Marketing
Transféré par
Youssef AbidCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Intro Au Marketing
Intro Au Marketing
Transféré par
Youssef AbidDroits d'auteur :
Formats disponibles
ntroduction au marketing
Dfinition et histoire
Les 3 niveaux de la dmarche marketing :
- Stratgie marketing
- Marketing oprationnel
- Marketing informationnel
Dfinition
La dfinition actuelle de lAmerican Marketing
Association :
Le marketing consiste planifier et mettre en
uvre llaboration, la tarification, la promotion
et la distribution dune ide, dun produit ou dun service en vue dun change
mutuellement satisfaisant pour les organisations comme pour les individus .
On retrouve dans cette formulation la double dimension stratgique et oprationnelle du
marketing, les 4 P : politiques de produit, de prix, de distribution (placement) et de
promotion-publicit ; les diffrents objets dapplication : produits, services et ides
(prvention routire, association, politique...) ; enfin, la finalit du marketing est
souligne : crer de la satisfaction mutuelle.
Dfinition MERCATOR
Le marketing est l'effort d'adaptation des entreprises des marchs
concurrentiels, pour changer, en leur faveur, le comportement des clients par
une offre dont la valeur perue est durablement suprieure celle des
concurrents.
Le r!le du marketing est de crer de la valeur conomi"ue pour lentreprise en
crant de la valeur pour les clients .
Le marketing, qui sinscrit dans la ligne de la rhtorique
conue comme lart de la persuasion, est un moyen
dinfluence des publics dont dpend lentreprise.
#$%&'(L, ou comment persuader le plus grand nombre
manger du )aourt $*#+,( '#%&-
Le march europen
En matire d'eau plate, l'Europe produit 35 milliards de litres en bouteille sur un march total mondial de
120 milliards de litres. Le march franais se situe au 3me rang europen, derrire l'Allemagne et l'talie.
Chaque Franais boirait en moyenne 125 litres d'eau embouteille par an, contre 100 litres en moyenne
dans le reste de l'Europe.
En France, seulement 1 % de l'eau du robinet est consomm pour la boisson. 64 % des personnes
interroges dans le cadre d'une tude (effectue pour le compte du Centre d'information sur l'eau) boivent
au moins une fois par mois de l'eau du robinet, et 67 % de l'eau minrale.
Les eaux de source reprsentent 32,65 % de la totalit des eaux embouteilles (3,15 milliards de litres en
2005). Dans cette catgorie, les eaux plates reprsentent 90 % des bouteilles vendues, les eaux
ptillantes 10 % (attention, contribution la marge plus importante)
Un exemple de valeur perue
Ct prix, " raison de deux litres par jour, oire de l!eau
du roinet revient " # par an contre $"% $&% # pour
une consommation 'uivalente d!eau de source, et (&%
()% # pour les eaux minrales", a calcul "*ue Choisir"+
,aux - Les dpenses pulicitaires rutes en millions d.euros en "%$%+
Dpenses publicitaires brutes en millions deuros en 2010.
Evolutions par rapport 2009
.ource / 0antar 'edia, 1 mdias 2presse, radio, %3, publicit e4trieure, cinma5 pour 6a)on 7oissons.
Nestl Waters 36,8 (+ 4,6 %)
Danone Eaux 30,6 (+ 4,8 %)
Roxane (Cristaline) 18,3 (+ 2,5 %)
Wattwiller 1,2 (- 53,7 %)
Saint-Amand 0,8 (+ 205 %)
Mont Roucous 0,4 (+ 220 %)
Le mar/etin0 est une discipline 1ondamentalement pra0mati'ue+
889 naissance et son dveloppement sont essentiellement nord8amricains
Au service de la stratgie et de la tactique de l'entreprise elle se focalise sur les problmes poss
par l'adaptation des productions de l'entreprise l'environnement du march.
l y a donc plusieurs acteurs sur un march :
- des consommateurs/clients
- des firmes (acheteurs/producteurs/vendeurs)
- des institutions (tats, syndicats...)
$e march s'inscrit dans un environnement et des tendances
en cours.
(4 / Le visage de certains marchs change avec
l'apparition de notions de dveloppement durable,
le march des alcools est tributaire des campagnes
de sant publi"ue, le march de la musi"ue doit
faire face l'intrusion de la gratuit...
(4emple de changement d'une tendance lourde, la lutte contre le tabac /
Les co:8bo)s disparaissent du pa)sage, Luck) Luke broute comme ;oll) ;umper,
et (au .auvage retouche <elon en large...
2345637, du mar/etin0 8 9en:se
Apparition lie au grandes tapes de la rvolution industrielle :
- surplus des mnages (surplus des rcoltes devient surplus montaire, dveloppement de
labourgeoisie...)
- transfert de statuts, des paysans aux salaris (ouvriers agricoles --> ouvriers de manufacture,
population urbaine...)
- sauts technologiques (machines vapeur,
machines tisser, lectricit, train...)
La manufacture du XXme sicle utilise
de nouveaux moyens de production, pour
une fabrication de srie, et de gros volumes.
Pour l'couler, il faut des clients capables
d'acheter, des moyens pour faire connatre
sa production, des moyens pour la transporter.
Un exemple du lien entre invention, innovation, et pra0matisme l!amricaine -
Les travaux de Nicolas Appert (1749-1841) portent davantage sur la conservation des lgumes que sur
celle de la viande. Mais comme inventeur de la bote de conserve, il reoit, en 1822, le titre de
Bienfaiteur de l'humanit. Ses procds amliors par Winslow Chicago, ville connue pour ses
abattoirs, permettent la fabrication des botes de corned-beef qui servent pendant la guerre de
Scession avant d'tre consommes dans les tranches de la Premire Guerre mondiale.
En Argentine, paissent d'normes troupeaux de bovins qu'on tue seulement pour le suif et le cuir. Les
carcasses sont abandonnes sur place. Quel gchis ! pense le chimiste allemand Justus von Liebig
(1803-1873). En faisant bouillir longuement cette viande sous certaines conditions de pression, il en tire
des sucs concentrs. Ainsi nat le bouillon-cube.
A l'Exposition universelle de 1855, la Compagnie alimentaire de Buenos Aires prsente "des tablettes et
des biscuits de viande obtenus par des mthodes qui restent son secret... Par ces prparations, tous
les dchets de l'tal peuvent tre utiliss, et les inventeurs pensent que leurs procds fourniraient
bon march des bouillons aux armes, aux voyageurs, aux habitants des campagnes, aux bureaux de
charit.
Trente ans plus tard, ce sont des bateaux frigorifiques
qui transportent vers l'Europe les viandes de boeuf que
la croissance de sa dmographie et de son niveau de vie
exige.
Lien entre mar/etin0 et 0o0raphie
--> transporter ses produits au del de la ville
ou du comt
--> transporter l'information sur ces mmes produits
Exemple de la conqute de l'Ouest
Les manufactures sont
l'(st 2-e: =ork, 7oston,
>hiladelphie...5
Les clients
migrants sont au
centre et l'?uest
889 &nvention des premiers catalogues de vente par correspondance
889 importance des premi@res voies ferres 2,nion >acific et $entral >acific, Aonction en
BCDE5
Catalogue Sears et Roebuck
Lien entre mar/etin0 et 0o0raphie ;m<me principe pour l!e=usiness>
--> transporter l'information sur les produits
--> transporter le point de vente virtuellement,
--> transporter les produits eux-mmes (rle des firmes de messagerie amricaine
DHL, FedEx, etc)
N.B : les 2 cartes sont la mme chelle...
LES TROIS NIVEAUX DE LA DEMARCHE MARKETING
Marketing informationnel ni!ea"# $e $%&i'ion
Etudier le jeu des acteurs, ?6L353*U, ;actionnaires>
les tendances du march, les signaux faibles. 457@5,93*U, ;A9>
889 attention au4 corrlations 5@C53*U, ;responsales>
6?,7@536BB,L ;tous>
Marketing 'trat%gi("e
Au niveau de la direction gnrale :
choix de l'avantage stratgique; portefeuille activits,
segmentation stratgique (choix du lieu et des armes).
Marketing o)%rationnel
Mise en oeuvre du mix, dfinition et suivi du cycle de vie
Schmas tactiques, c'est dire en raction un lment nouveau sur le march.
La dmarche strat0i'ue
La stratgie est lensemble des oprations intellectuelles et ph)si"ues re"uises
pour concevoir, prparer et conduire toute action collective finalise
en milieu conflictuel
(Gnral Poirier)
* l n'y a stratgie qu'en cas de conflit (sportif, commercial, militaire...)
* La stratgie c'est un niveau conceptuel et un niveau oprationnel (o
intervient la tactique)
* En 3 verbes : Concevoir Prparer - Conduire
" 1acteurs de ase - Lespace
2e4 / comment livrer dans l(urope des G1 H
$omment entrer dans %roie H $omment lancer 'alouda
sur l'aile gauche H ?ccuper le bon emplacement pour une
enseigne commerciale comme .phora H5
--> occuper l'espace AVANT les concurrents
Le temps
2e4 / faire croire au dbar"uement dans le >as de $alais
BG heures durantIchanger une collection te4tile tous
les moisIAouer le hors Aeu en ligne5
--> possder l'information AVANT ses concurrents
S'ajoutent le facteur HUMAIN (management) et celui du TERRAIN
Sources gnralistes :
.,- %J,ILart de la guerre 2vaincre sans combattre comme idal5
$L#,.(K&%JI<e la guerre 2dtruire pour vaincre totalement comme idal5
Le marketing stratgique, c'est d'abord une srie de questions simples :
*U3 ,45 L!@AC,74@37, D
Ex : l'adversaire n1 de Microsoft, est-ce l'tat fdral US ?
En Ligue des champions, l'adversaire est Arsenal ou Wenger ?
L'adversaire de celui qui envahit la Russie, c'est l'arme russe ou le climat russe ?
*U,LL, ,45 4@ 457@5,93, D
.'atta"uer non l'adversaire mais sa stratgie 2.un %Lu5
mportance du renseignement, de la veille concurrentielle, voire de l'espionnage
Distinguer l'info et l'intox (Ex : Quelle est la stratgie de la Chine ?)
6U C6UL6B4=B6U4 @LL,7 et A!6U ?@756B4=B6U4 D
Echec de Vivendi dans l'industrie du cinma Hollywood
?6UC6B4=B6U4 E @LL,7, C6FF,B5, ,5 @C,C *U3 D
Ex : Echec des fabricants automobiles franais aux USA et russite des nippons
La dmarche stratgique est continue, ce n'est pas une
photographie mais une scnarisation
Exemple de posture stratgique dnamique !
exploiter ses "ictoires #redfinir de nou"eaux o$%ectifs&
Exemple de la guerre en Afghanistan : que faire aprs une premire
victoire ?
"Guerre des toiles des USA avec Reagan : mettre l'conomie russe
en difficult (objectif premier et cach).
Quand Apple sort le pod, c'est un lecteur. Rapidement, c'est le march
global de la musique qui est vis (+60% du march internet de la
musique payante, et bientt majoritaire pour le streaming)
>atton
demandait
combattre
l',6.. une
fois le rgime
naLi abattu
'remier ni"eau d'tude ! les tendances lourdes de
l'en"ironnement
- politiques (dmocratie ? conflit ? terrorisme ?...)
- dmographiques (vieillissement, migration ou immigration)
- lgales/rglementaires (principe de prcaution, droits de douane)
- conomiques (croissance, concentration, monnaie...)
- technologiques (niveau d', universits...)
- socio-culturelles (le divertissement, le repli sur soi, le tourisme...)
- cologiques
(4emple /
Le rec)clage d'un produit devient un lment maAeur parce "ue l'cologie a rencontr
le socio8culturel. <es solutions technologi"ues en sont issues ainsi "u'une
reconfiguration conomi"ue.5
,x $. mutation des produits et procds + attente cologique = march produits
isolants et march des experts qui dfinissent l'isolation d'un logement)
,x ". contrle technique auto = nouveau march des centres techniques, influence
sur le march des pices dtaches, etc....
,x (. La combinaison entre technologie + mondialisation du sport d'lite +
valorisation de la russite relaye par les mdias = dopage gnralis.
Seule une nouvelle tendance de fond s'appuyant sur l'cologie peut, terme,
renverser le phnomne.
Mondialisation = tendance l'uniformation des
comportements et des produits
Freins la
mondialisation:
- Culture
- Histoire
- Tribus (au sens
marketing)
Rsolution de ces problmes :
- adaptation (exemple de Mc Donald sans boeuf en nde)
- repositionnement (Perrier premium aux USA ou Levis en Europe)
l reste des impasses :
- pas de base-ball en Europe
- les Anglais roulent gauche,,,
Pour une firme, le premier but est : maximiser la rentabilit de l'euro investi.
Ensuite, le stratgique (politique) mane des actionnaires, c'est une finalit exprimable
en une phrase :
--> dominer le secteur des mdias,
--> innover dans le traitement mdical
---> devenir leader du secteur des loisirs
Le mar/etin0 strat0i'ue d1init le porte1euille
produits dtenir en fonction des objectifs
politiques, des concurrents, des besoins
clients, de l'environnement...
Le mar/etin0 oprationnel ;mix mar/etin0>
met en musi'ue le strat0i'ue, en s'adaptant
au terrain (tactique).
Le $oncorde, archt)pe
d'une innovation sans stratgie
F<me raisonnement au niveau politi'ue
Si l'objectif d'un tat ou groupe d'tats, c'est de faire
gagner la dmocratie dans le monde (et si les tensions
justifiant un haut niveau d'armement diminuent),
#lors les outils utiliser pour atteindre ses obAectifs seront par e4emple /
8 l'humanitaire 2mi4 de haute technologie et de haute valeur morale M e4emple
des ?-N en #rmnie dans les annes CO ou 7am en &ran5
8 la propagande 2financer des Aournau4 d'opposition M e4emple de la rvolution
orange en ,kraine5
8 la rglementation 2alourdir les dpenses de l'adversaire politi"ue M
(4 / 'oderniser le nuclaire russe apr@s %chernob)l, renforcer la lgislation
sociale...5
FNALTE
STRATEGE
OBJECTFS MOYENS
- dats - rels
- quantifis - affichs
Mix marketing
(oprationnel, les 4 P)
Si les moyens ne sont pas la hauteur des objectifs :
- rviser les objectifs la baisse,
- augmenter les moyens (partenariat, dette, cession de titres bourse - ou d'actifs)
F@7G,53B9 457@5,93*U,
L'analyse stratgique repose sur 2 diagnostics qui dicteront des dcisions :
- le dia0nostic interne : on parle de (orces)(ai$lesses ou d'Atouts d'une entreprise
- le dia0nostic externe : on parle de *enaces)+pportunits ou d'Attraits d'un march
--> La formulation d'une stratgie dcoule du rapprochement de ces deux diagnostics.
# partir de ce "ue Ae suis 2en tant "u'entreprise5,
"ue puis8Ae faire, avec "ui, dans "uel march H
Horces 6pportunits
Hailesses Fenaces
LES TROIS NIVEAUX DE LA DEMARCHE MARKETING
Marketing informationnel ni!ea"# $e $%&i'ion
Etudier le jeu des acteurs, ?6L353*U, ;actionnaires>
les tendances du march, les signaux faibles. 457@5,93*U, ;A9>
--> attention aux corrlations 5@C53*U, ;responsales>
6?,7@536BB,L ;tous>
Marketing 'trat%gi("e
Au niveau de la direction gnrale :
choix de l'avantage stratgique, portefeuille activits,
segmentation stratgique (choix du lieu et des armes).
Marketing o)%rationnel
Mise en oeuvre du mix, dfinition et suivi du cycle de vie
Schmas tactiques, c'est dire en raction
un lment nouveau sur le march.
F@7G,53B9 457@5,93*U,
*uel'ues notions pralales
Nombre d'acteurs sur un march :
- concurrence
- monopole (un seul vendeur)
- oligopole (vendeurs en petit nombre)
- monopsone (un seul acheteur, trs rare,
exemple : arme)
- oligopsone (acheteurs en petit nombre)
Le monopole n'a pas besoin de stratgie, mais de planification 2e4 / (<P avant
libralisation du march de l'nergie, l'tat soviti"ue...5
La bourse, seul e4emple de concurrence pure et parfaite
F@7G,53B9 457@5,93*U,, rappel de notions conomi'ues
Fixation du prix d'quilibre
On peut retrouver ici la notion de
segmentation marketing
l y a en effet des demandeurs
(en petit nombre), prts payer
P2.
D'autres, en grand nombre, prts
payer P3.
Segmenter, ce sera donc aussi
diffrencier l'offre pour ces deux
segments, ces deux prix.
Segment Segment low cost
VP
TGV 1re classe iD TGV
Dans les marchs rels, il y a rarement fixation intgrale du prix par jeu d'offre et de demande (sauf
Bourse et certains marchs du travail)
Botion d!lasticit -
Elasticit de la demande par rapport au prix
e = AD / AP
Elle peut tre trs diffrente d'un march un autre.
Par exemple, l'lasticit de la demande de carburant est relativement faible par rapport au prix, tout
comme celle de la baguette de pain, de l'lectricit domestique...
l arrive qu'une hausse des prix provoque une hausse de la demande (le produit passe dans
une catgorie suprieure en qualit ou dclenche une spculation par crainte
de hausses futures, l'effet de Giffen : si le pain augmente, les mnages ne peuvent plus
acheter de viande, donc ils se rabattent sur le pain dont les ventes augmentent).
F@7G,53B9 457@5,93*U,, rappel de notions conomi'ues
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Botion de cIcle de vie du produit
Emprunte la biologie, elle dcoupe la vie du produit en 4 tapes successives.
Temps
Qt
vendue
ou part de
march
',A-E-
lancement croissance maturit dclin
$oQts
importants
>eu de
concurrents
>ublicit
cible
$#
augmente, la
concurrence
aussi si
russite
$oQts baissent,
march "uasi
satur, sries
limites,
renouvellement,
concurrents lo:
price
$# en baisse,
<sinvestissement
>romotion des
ventes
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Botion de cIcle de vie du client
Temps
Qt
consomme
d'eau
EVAN
'remier .ge enfance .ge adulte /0me .ge
(au adapte
au4
nourrissons,
vente
conditonne
en biberons
'langer
l'eau avec le
fruit, gamme
sportive
7onbonnes pour
la maison et le
bureau, petits
formats pour le
bureau,
complments
alimentaires
$omposition
spcifi"ue M
calcium, anti Rge,
etc...
Evolution de la cible quanti et qualitativement
Ex : le lecteur DVD de produit innovant, il passe une offre
discount, segmentation avec haut de gamme ou lecteur portable
Segment haut de gamme,
marketing de loffre avec
technologie !lu"ra#
Segment bas de gamme,
marketing de loffre avec
portable $c#cle de vie du
client%
F@7G,53B9 457@5,93*U,
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Botion de cIcle de vie du produit
On peut y ajouter la notion de rentabilit (axe des ordonnes change)
F@7G,53B9 457@5,93*U,
CIcle de vie du produit
* toutes les courbes n'ont pas la mme forme
(encphalogramme plat pour le livre lectronique)
* certaines montent trs vite et redescendent trs vite
(produits de mode)
* distinguer courbe de vie d'un produit gnrique, LE 2 ROUES, d'un produit prcis, LE VTT, de ma
marque, ROULERAOUL, et d'un modle de ma marque, LE DOUBLE VRENQUE
En revanche, la courbe idale permet :
* d'amortir les investissements,
* de grer harmonieusement la marge (Prix de vente unitaire cot unitaire)
* de dgager des excdents pour 1. le profit, 2. la mise en lancement de nouveaux produits
#%%(-%&?- / l'obsolescence du produit fait partie intgrante du marketing.
Pabri"uer une voiture inusable et incassable "uivaut un suicide commercial S
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Fatrice JC9, issue du cycle de vie.
Elle va faire entrer le march et l'ide de portefeuille de produits
4cnarios verteux - les vaches lait 1inancent les dilemmes 'ui deviennent toiles
'ui deviennent vaches lait, etc+++
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Fatrice JC9, issue du cycle de vie.
Pour qu'un scnario vertueux se droule, il faut donc un portefeuille quilibr, et donc ni
trop juvnile, ni trop snile
Matrice BCG et portefeuille
Forte faible
Part de march
T
a
u
x
d
e
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
F
a
i
b
l
e
f
o
r
t
Portefeuillejuvnile
Portefeuille snile
Forte faible
Part de march
T
a
u
x
d
e
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
F
a
i
b
l
e
f
o
r
t
F@7G,53B9 457@5,93*U,, rappel de notions conomi'ues
Botion de Coure d!exprience
Prix de revient
unitaire
Quantit cumule
de production
1 2 4 8
1
0,5
effets constats empiriquement
Ne tient pas compte des innovations technologiques ventuelles
Comparer niveau! de calcul quivalent
" ne pas confondre avec la cour#e de vie
$mplique que les gros producteurs ont forcment l%avantage
Elle aide dicter la dcision d'entrer dans un march
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Coure d!exprience
@ ne pas con1ondre avec -
K ,conomies d!chelle ;ex - acheter moins cher
parce 'u!en 0ros volumes>
K 4Iner0ie dont la d1inition est $ L$ M "
;ex - une 'uipe d!in1ormaticiens a0r0e
une 'uipe de Neasters>
La coure d!exprience mesure plutt la productivit 0randissante avec le temps+
Analyse classique
&iagnostic
'()'*N'
+enaces,
-pportunits
&iagnostic
$N)'*N'
.orces,.ai#lesses
CONFRONTATION
Evaluation
des alternatives
CHOIX
TRATE!IQ"E
P#AN
-#/ectifs
et valeurs
?76JL,F, A, L!@B@LE4, CL@443*U, 3B5,7B, O ,P5,7B,
- On ne sait pas qui sont nos concurrents
- On ne sait pas lesquels sont bons, et o
- On ne connat pas assez les risques du march
D'aprs Michael Porter, il faut dgager un avanta0e concurrentiel pour l'entreprise
sur chacun de ses marchs :
- Avantage en terme de cot
ou
- Avantage en terme d'offre (diffrenciation)
Dans un premier temps, on peut distinguer & cas de 1i0ures selon l'avantage
concurrentiel et la taille du front
.../...
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Horces de ?orter
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Fichael ?orter
?ffre uni"ue ou >ri4 moindre
e4clusive
Pront large diffrentiation domination
2secteur entier5
pire des positions
Pront rduit focalisation concentration
2segments5
1. Domination par les cots
Elle peut dcouler de l'avance sur la
courbe d'exprience, Elle existe le plus
souvent sur des marchs de produits
manufacturs, standards, avec
investissements lourds, et une distribution
puissante. Ex : DELL (produit standard
mais distribu autrement)
. Diffrentiation
Elle n'existe que si le march la
peroit aussi --> le client
accepte de payer un surcot
Elle dcoule d'une crativit,
d'une capacit d'innovation.
Ex : SONY, Michelin
?ffre uni"ue ou >ri4 moindre
e4clusive
Pront large diffrentiation domination
2secteur entier5
pire des positions
Pront rduit focalisation concentration
2segments5
F@7G,53B9 457@5,93*U,
Horces de ?orter
!. "oncentration
Elle porte l'avantage prix sur une partie du front, elle
drive plus d'un concept que d'une innovation
technologique
L'entreprise doit tre mobile
Ex : Chanes htelires, rseaux de rparation auto
pneus, chappement
#. $ocalisation
La cible doit percevoir le surcot --> l'entreprise
doit suivre les besoins et apporter un plus
Forte innovation, services levs et
personnaliss
Ex : Bang et Olufsen, Porsche
F@7G,53B9 457@5,93*U,
F+ ?orter
Au niveau de l'analyse interne/externe, Porter propose de passer en revue 5 forces
qui s'exercent sur l'entreprise
A3@9B6453C ,P5,7B, - les Q H67C,4 A, ?675,7
7ivalit entre 1irmes
0 Croissance du secteur (faible/forte)
qui dterminera le type d'affrontement
(sur mmes consommateurs ou sur nouveaux)
0 Partage frais fixes/frais variables
0 Fidlit aux marques ou non
0 Surcapacit de production du secteur (autrement dit si concurrents en sous-
production)
0 Niveau des barrires la sortie (actifs, rglements adm)
0Taille des concurrents, nombre (atomisation, oligopole..)
A3@9B6453C ,P5,7B, - les Q H67C,4 A, ?675,7
?ouvoir des 1ournisseurs
0 Si le secteur est peu ou fortement concentr
0 Si le secteur est fortement dpendant de certains produits non substituables (ex : le
ptrole, certains mtaux)
0 Si le cot de transfert de fournisseur est trs lev
0 Si menace d'intgration en aval (un fournisseur devenant concurrent ou mme
propritaire)
Si excdent de la demande p/r offre de faon durable (ex : diamant)
A3@9B6453C ,P5,7B, - les Q H67C,4 A, ?675,7
?ouvoir des clients
0 Si achats en quantit importantes (et nombre rduit, oligopsone)
0 Si cot de transfert d'un fournisseur un autre est faible
0 Si clients faibles profits ou en baisse de cots (ex : sous-traitance auto vis vis des
constructeurs ou petits producteurs face aux grandes surfaces)
0 Si intgration par l'amont (client devenant concurrent ou propritaire, ex. de la
distribution spcialise type Dcathlon)
?ouvoir des distriuteurs
0 Si distribution plus concentre que le secteur
lui-mme (grande distrib)
0 Si part importante des ventes dans ce canal
0 Si les clients sont plus fidles un distributeur
qu' une marque (ex : FLY, Fnac)
0 Si la distribution propose un service indispensable
au client (ex : le pneu et son montage)
A3@9B6453C ,P5,7B, -
les Q H67C,4 A, ?675,7
7is'ue des nouveaux entrants
0 Quelles barrires l'entre ? (exemple des frquences TV ou radio)
Est-il possible de raliser des conomies d'chelle ?
(stratgies de volume diffrenciation par le cot existence d'une forte courbe
d'exprience ou non)
0 Y-a-t-il un fort besoin en capital ?
0 Cot des transferts et de l'adaptation un circuit de distribution
0 Quelle sont les contraintes gographiques du secteur ? (et quelle est la politique
tatique vis--vis des entreprises trangres, ex : quotas voitures japonaises
conduite gauche Fusion de GDF et Suez contrainte par l'Etat)
0 Quelles possibilits d'entente si firmes existantes peu nombreuses et bien installes ?
(ex : interdiction de revente d'actif spcifique un nouvel entrant)
A3@9B6453C ,P5,7B, - les Q H67C,4 A, ?675,7
7is'ue de produit ;ou service> de sustitution
0
Soit grce une fonctionnalit supplmentaire,
plus marketing en terme de besoin client
(ex : le premier portable solaire, customisation)
0 Produit menac par obsolescence (lecteur CD, cassette audio, appareil photo
argentique)
0 Produit menac par dsintrt (ex : le march du pressing, le charbon, le flipper)
0 Produit menac par intgration dans la filire (ex : march de la mercerie)
Porter : rentabilit et risque dun secteur
12**$'*'3
2 4%'N)*''
Ele!%e'
*ai+le'
12**$'*'3 2 42 3-*)$'
Ele!%e' *ai+le'
...et risque
...mais stable
...mais haut risque ...et stable
Revenu gnralement fort...
Revenu gnralement faible...
@xes de dveloppement
0 ntgration verticale (amont - aval)
0 ntgration horizontale
0 Spcialisation
0 Diversification
Fode de dveloppement
Croissance nterne (moyens propres)
Croissance Externe (achats)
C76344@BC, 3B5,7B,
- Concerne la grande majorit des PME
- possible si les ressources financires
voluent en mme temps que la croissance
du march, ou si les gains de
productivit/baisse des cots augmentent les marges
Elle est efficace si :
- le nouveau mtier a des cots fixes faibles,
- l'entreprise rutilise une partie de ses comptences (voir matrices
Mc Kinsey, Ansoff...)
- le secteur investi est en forte croissance (voir matrices)
C76344@BC, ,P5,7B,
Acqurir des firmes oprant dans des
mtiers diffrents.
Logique de prix complexe (diffrence
entre rachat d'une PME avec concours
bancaire et rachat d'actions travers
une OPA)
L'achat est d'autant plus facile/efficace si :
- les vendeurs ont besoin d'un acheteur (ex : Alitalia vendre, qui fait des
pertes sans pilote dans l'avion)
- l'acheteur est un des rares apporter de la performance (ex : LVMH qui
rachte une maison de haute couture)
- le march financier est intressant (taux bas, bourses peu dynamiques...)
Vous aimerez peut-être aussi
- L'acte Créateur Entre Culture de L'oralité Et Cognition Musicale - Mondher AyariDocument28 pagesL'acte Créateur Entre Culture de L'oralité Et Cognition Musicale - Mondher AyariAcohenPas encore d'évaluation
- 2 Cours Lecture Plan ArchitectureDocument8 pages2 Cours Lecture Plan Architecturetewngom-1Pas encore d'évaluation
- La Tour de BabelDocument2 pagesLa Tour de Babelreine marie AbiHannaPas encore d'évaluation
- Orniformation Bts Corrige Droit 2011Document3 pagesOrniformation Bts Corrige Droit 2011bkeutchayaPas encore d'évaluation
- Projet de Renforcement Des Capacités Des Petits Producteurs Horticoles en République Du SénégalDocument462 pagesProjet de Renforcement Des Capacités Des Petits Producteurs Horticoles en République Du SénégalMamadou DiagnePas encore d'évaluation
- Hermès Trismégiste - Corpus Hermeticum IIIDocument0 pageHermès Trismégiste - Corpus Hermeticum IIIAlmuric59Pas encore d'évaluation
- Découverte: Qu'est-Ce Que Le Web ?Document2 pagesDécouverte: Qu'est-Ce Que Le Web ?Max Wursching100% (1)
- SENEGAL Rapport Forages Manuels (FINAL) PDFDocument45 pagesSENEGAL Rapport Forages Manuels (FINAL) PDFDiseyPetitPas encore d'évaluation
- 01-Chapitre 3 Alphabets Des Langues Nationales Et TicDocument35 pages01-Chapitre 3 Alphabets Des Langues Nationales Et TicFallou MbayePas encore d'évaluation
- Essai Accéléré de Réaction Sulfatique Externe (RSE)Document11 pagesEssai Accéléré de Réaction Sulfatique Externe (RSE)Rafik SiamPas encore d'évaluation
- D Cours N4 Elaborer Des Schémas Et Des Plans D Une Installation SolaireDocument20 pagesD Cours N4 Elaborer Des Schémas Et Des Plans D Une Installation SolaireWeam Mouloudi100% (1)
- LT Circuits Hydraulique-1Document52 pagesLT Circuits Hydraulique-1ThaPas encore d'évaluation
- CatalogueDocument88 pagesCatalogueNicoleta ValsanPas encore d'évaluation
- HeboidophreniaDocument2 pagesHeboidophreniaMariano OutesPas encore d'évaluation
- Sio-6009 S02Document35 pagesSio-6009 S02morad lamchachtiPas encore d'évaluation
- 4am Deuxième Devoir Du 2ème TrimestreDocument2 pages4am Deuxième Devoir Du 2ème TrimestreHaya Al YassifiPas encore d'évaluation
- J'Ai Longtemps Erre Sans Guide 246-Il Y A Un Jour Qui Vient 245 - C'Est Comme Le Ciel Pour MoiDocument3 pagesJ'Ai Longtemps Erre Sans Guide 246-Il Y A Un Jour Qui Vient 245 - C'Est Comme Le Ciel Pour MoiANAGONOUPas encore d'évaluation
- Classement, Declassement Reclassement BOURDIEU PDFDocument23 pagesClassement, Declassement Reclassement BOURDIEU PDFSoledad RJabbazPas encore d'évaluation
- 15-Observatoire Littoral2011Document38 pages15-Observatoire Littoral2011mansour14Pas encore d'évaluation
- Cours Marketing ApprofondiDocument48 pagesCours Marketing ApprofondiHajar LirariPas encore d'évaluation
- Chapitre 2-Limpôt Sur Les SociétésDocument28 pagesChapitre 2-Limpôt Sur Les SociétésAmal MabroukiPas encore d'évaluation
- Urbanisation de La Vallee Du Mzab Et Mitage de LaDocument17 pagesUrbanisation de La Vallee Du Mzab Et Mitage de LaMoussa FraouiPas encore d'évaluation
- HellpDocument16 pagesHellpUsf LabcPas encore d'évaluation
- Support Du Cours de Consolidation Master CCADocument72 pagesSupport Du Cours de Consolidation Master CCAMaryem rh100% (3)
- Archit RenaissanceDocument3 pagesArchit RenaissanceCristina Petriciuc-ValicovPas encore d'évaluation
- Molière Volume IIDocument330 pagesMolière Volume IIpomegranate246Pas encore d'évaluation
- LaterDocument15 pagesLaterZahra HammoudiPas encore d'évaluation
- Pfe Sameh Maizi .EAEEDocument157 pagesPfe Sameh Maizi .EAEEManong Sheguey100% (1)
- Expose e CommerceDocument14 pagesExpose e CommerceSaBér El AllaouiPas encore d'évaluation
- Corrigé Type Lecture BEPC Examen Blanc DONGA 2023-2024Document2 pagesCorrigé Type Lecture BEPC Examen Blanc DONGA 2023-2024ernestlemajeurPas encore d'évaluation