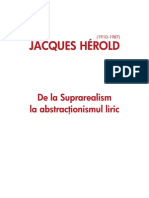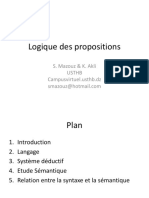Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Activités Humaines Dans Les Terroirs
Les Activités Humaines Dans Les Terroirs
Transféré par
Lidia Cardel0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
11 vues12 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
11 vues12 pagesLes Activités Humaines Dans Les Terroirs
Les Activités Humaines Dans Les Terroirs
Transféré par
Lidia CardelDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 12
Les activits humaines dans les terroirs
coutumiers face aux plans
damnagement des aires protges :
Le cas du Parc National dOdzala
(Congo-Brazzaville)
Norbert Gami
*
Jusqu rcemment, les aires protges dAfrique ont t cres de
manire unilatrale par ladministration coloniale, puis par les gouverne-
ments des tats indpendants.
Les limites de ces aires protges ont t dfinies le plus souvent sans tenir
compte des besoins dexploiter les ressources naturelles des populations
riveraines. Dans certains cas, comme Odzala au Congo-Brazzaville, les
populations ont t expulses de leurs terroirs et rinstalles sur des
terres appartenant autrui, au mpris du mode traditionnel de gestion
fond sur des savoirs et des pratiques ancestrales. Comme lexprimait un
vieux sage du village Olm au Nord du Congo Brazzaville (Gami, 1995a)
Si ces forts taient mal gres depuis nos anctres et si ces derniers nous
avaient lgu une mauvaise ducation dans le sens de la conservation de la
faune et de la flore, elles ne seraient pas en bon tat maintenant.
Au Congo-Brazzaville, le Parc National dOdzala (district de Mbomo)
bnficie depuis 1992 dun appui technique et financier de la part de
lUnion Europenne
1
pour des tudes ayant pour but dlaborer de
nouvelles stratgies de gestion impliquant les populations locales.
Cette proccupation nest pas encore bien ancre dans la manire de
travailler des agents des Eaux et Forts en charge de la gestion des
ressources floristiques et fauniques, ni de certains cadres africains ayant
une formation de type occidental. Ces derniers adoptent un comportement
-467-
*
ECOFAC/APFT, BP : 15115 Libreville, Gabon
1
Programmes ECOFAC : Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystmes Forestiers en
Afrique Centrale ; APFT : Avenir des Peuples des Forts Tropicales
rpressif
2
, excluant le plus souvent tout dialogue entre les parties
concernes, et feignent dignorer la culture autochtone, ce qui est regrettable.
Dans le parc dOdzala, les zones tampons nont pas t lobjet de dlimi-
tations raisonnes. Les deux exemples que nous prsentons vont illustrer
ce propos et les consquences sur la gestion des ressources naturelles.
Cette dlimitation arbitraire vient dtre corrige par le nouveau projet
dextension du parc, soumis lapprobation du Ministre des Eaux et
Forts par la Composante ECOFAC-Congo.
Le terroir coutumier et sa dynamique : quelques dfinitions
Pour Joiris (1996a) le concept de terroir coutumier doit tre envisag
dans une perspective dynamique car il ne correspond pas seulement ce
qui est exploit au moment de lenqute mais ce qui est potentiellement
exploitable par les habitants dun village. En effet, le terroir coutumier (ou
finage villageois) recouvre lensemble des zones dactivits villageoises
(chasse, pche, agriculture, cueillette, jachres anciennes, forts sacres
rserves aux crmonies rituelles).
Selon Sayer cit par Colchester (1995), une zone tampon est une zone,
priphrique dun parc national ou dune rserve quivalente, dans laquelle
certaines restrictions sont imposes sur lutilisation des ressources, ou dans
laquelle des mesures spciales sont prises pour amliorer la valeur de
conservation de la rgion concerne.
Pour Mackinnon et Kathy (1990) La zone tampon ne doit pas tre une
bande linaire troite qui suit les limites de laire protge. Elle doit tenir
compte du contexte conomique, social et culturel de la population vivant
dans ou en priphrie de la rserve.
Dans la plupart des cas, la zone tampon est une bande linaire et arbitraire
excluant ainsi les villageois de certaines zones dactivits de subsistance.
Le Programme ECOFAC-Congo, suite aux tudes socio-conomiques
menes par les anthropologues, vient de proposer au Ministre Congolais
de lconomie Forestire les nouvelles limites de la zone tampon prenant
suffisamment en compte les besoins de la population.
Pour Jean Marc Froment (1997) ... les zones tampons (du parc) seront
destines permettre aux populations de disposer de ressources pour leur
subsistance. Dune profondeur de 10 km (au lieu de 5 km auparavant), cette
zone sera subdivise en deux secteurs :
- un secteur agricole proximit des villages et des routes, de 3 km de
profondeur ;
- un secteur chasse/cueillette denviron 7 km.
-468-
2
La sensibilisation de la population la ncessit dun prlvement rationnel des ressources
naturelles nest souvent pas assure par les agents des Eaux et Forts. Ceux-ci se contentent le plus
souvent de faire des saisies de gibiers et darmes, se rtribuant en nature ou en espces. Il nest pas
tonnant que lagent des Eaux et Forts soit peru par la population comme un agent de rpression.
Les zones tampons des aires protges du rseau ECOFAC sont actuel-
lement en cours de reconsidration, car elles ne correspondent pas aux
besoins des populations pour leur subsistance. Tel est le cas de la rserve
du Dja au Cameroun, o des tudes de terroirs villageois sont menes par
les anthropologues et les agronomes. Ces tudes ont pour finalit la mise
en place dun zonage qui concilie dveloppement et conservation (Joiris et
Tchikangwa, 1995 ; Vermeulen, 1998 ; MINEF, 1998). Dautres projets de
conservation des ressources naturelles dans le bassin du Congo sont
confronts ce problme de dlimitation de la zone dactivits villageoises.
Dans le complexe daires protges de Gamba au Sud du Gabon, Blaney
et al. (1997), ont men une tude socio-conomique dans les villages situs
dans et en priphries du complexe. Celle-ci a permis dvaluer de faon
qualitative et quantitative lampleur des pressions exerces par les
populations sur les ressources. Ceci en se basant sur ltude des terroirs
villageois. Selon lauteur, ce travail doit favoriser la mise en place dun
systme de gestion participatif.
La lgislation forestire du Congo-Brazzaville (Loi N48/83 du
21/04/1983, article 46) dfinit les zones banales comme tant des zones
situes en dehors des aires classes (..) dclares zones de chasse banales ;
dans ces zones la chasse peut sexercer librement dans le respect des dispo-
sitions de la prsente loi et de ses textes dapplication.
Aspects mthodologiques
Les donnes ont t collectes au cours dexpertises anthropologiques
menes dans le cadre des programmes ECOFAC et APFT par une quipe
danthropologues
3
.
Afin didentifier les terroirs coutumiers (ou finages villageois), nous
avons adopt plusieurs mthodes complmentaires :
- Les runions : elles ont rassembl la population dun mme village, de
tout ge et des deux sexes. Au cours des discussions ont merg les
problmes relatifs aux terroirs coutumiers, le plus souvent sous une forme
revendicative, car la plupart de ces terroirs se trouvent actuellement dans
la rserve.
- Les entretiens semi-directifs : ils ont t mens auprs dayants droit
propritaires fonciers que nous avions slectionns. partir des noms de
rivires, nous avons identifi et report sur une carte IGN au 1/200 000 les
diffrents terroirs de la zone.
- La participatory mapping : elle sest rvle trs intressante, dans la
mesure o les personnes interroges ragissent spontanment au dessin
dun participant en voquant les principaux problmes de gestion : accs
-469-
Lhomme et la fort tropicale 1999
3
Daou V. Joiris, APFT, Universit Libre de Bruxelles et Christophe LIA, Universit Libre de
Bruxelles (ULB) ; Norbert GAMI, APFT/ECOFAC-Congo.
aux ressources, modalits de gestion par les diffrents acteurs. Ce schma
commence souvent par la route qui traverse ou borde le village.
- Les sorties sur le terrain : comme lcrivent Penelon et al. (1998), elles
sont indispensables pour bien comprendre les explications donnes dans
les propos recueillis et leur donner un sens concret. Cest au cours de ces
sorties que lexpert apprend reconnatre certaines ressources, reprer
lemplacement dlments naturels (cours deau, arbres, lignes de crtes)
qui dlimitent les terres de chaque clan ou lignage.
Le Parc National dOdzala et les villages priphriques
Le Parc National dOdzala (carte) se trouve environ 744 km au nord-
ouest de Brazzaville. Il couvre actuellement une superficie denviron 13
546 km. Il est actuellement subdivis en 3 parties, remplissant chacune
une fonction prcise :
- Le noyau central (6 912 km) est consacr au dveloppement du
tourisme de vision, la prservation et ltude de la diversit biologique
et de son volution en labsence dactivits de prlvement par lhomme,
la recherche sur la grande faune forestire ;
- Les zones priphriques (6 464 km), vritables innovations dans le
cadre de limplication des populations locales dans la gestion des
ressources naturelles afin den tirer des bnfices substantiels gnrs par
lactivit touristique. Elles sont au nombre de quatre Odzala. Selon
Froment (1997), leurs objectifs sont de conserver les ressources fauniques
par leur valorisation travers le tourisme de vision et la chasse sportive
au profit des populations locales. Cest un bel exercice en ce qui concerne
lapplication de la notion de gestion participative ou cogestion des
ressources naturelles entre les diffrentes parties prenantes ;
Enfin, les zones tampons (2 283 km), dont la dfinition a t donne plus
haut (Froment, 1997).
Sur le plan humain, le District de Mbomo comme le reste de la zone
forestire du Nord-Congo nest pas trs peupl. Selon le recensement de
1987 la population de Mbomo slevait 4 541 habitants, ce qui correspond
une densit de 0,5 hab/km
2
. Elle comprend 4 groupes ethniques : les
Mboko, les Kota, les Mongom et les Pygmes Bakola. Ce sont des essar-
teurs pratiquant une agriculture itinrante sur brlis, complte par des
activits de prdation : chasse, collecte, pche dans les ruisseaux et les
marcages de fort (Joiris, 1996b). proximit, sur laxe Mbomo-Olloba
(frontire Congo-Gabon) se trouvent des essarteurs-chasseurs appar-
tenant aux mmes groupes ethniques mais sadonnant des activits
artisanales dorpaillage.
-470-
Les terroirs coutumiers des villages Mbandza et Olm
Les villages de Mbanza et Olm sont situs en priphrie du Parc
National dOdzala. Ils ne disposent que dune bande de 5 km lintrieur
du Domaine de Chasse de Mboko (zone tampon), le long de la route
Lbango Mbandza, pour mener leurs activits agricoles, de chasse, de
pche et de cueillette (arrt N4220/CE du 3 Dcembre 1959).
La chasse est limite lutilisation des moyens traditionnels, tels que le
stipule larticle 32 de la Loi N48/83 du 21/04/1983 dfinissant les condi-
tions de la conservation et de lexploitation de la faune sauvage en
Rpublique du Congo : ... Est seul reconnu chacun comme droit dusage
celui dassurer sa subsistance laide des moyens traditionnels non
prohibs par la prsente loi, mme en priode de fermeture de la chasse
Il faut ce propos comprendre par moyens traditionnels : les sagaies,
lances, collets, filets, arbaltes, assommoirs, trappes, nasses trbuchets,
glus, confectionnes partir des matriaux dorigine locale.
-471-
Lhomme et la fort tropicale 1999
Carte : Situation du parc national dOdzala au Congo Brazzaville.
La pche est entirement libre, mais pourra toutefois tre rglemente
au cas o seraient constats de trop nombreux dlits de chasse lis la
prsence des pcheurs.
Il apparat donc que la lgislation impose aux villageois concernant la
zone tampon ne tient pas compte de leurs besoins, puisquelle nautorise
quun nombre limit dactivits.
En effet, le domaine de chasse a t cr pour favoriser le tourisme
cyngtique - ou chasse sportive - rserv exclusivement aux chasseurs
non rsidents et aux chasseurs rsidents, titulaires dun permis de grande
chasse. Elle ne peut sexercer quavec une autorisation administrative et,
en principe, sous la conduite dun garde-chasse ou dun guide licenci.
Le port darmes feu est soumis aux mmes rgles. Lexcuse de la
lgitime dfense ne saurait en aucun cas tre retenue si ces rgles
ntaient pas respectes.
La Loi exige lutilisation des moyens traditionnels pour le pigeage des
animaux. Or dans cette zone, les cbles base de lianes ont disparu et les
personnes matrisant la technique de leur fabrication sont de plus en plus
rares. La loi est caduque et ne peut tre applique moins quon ne veuille
affamer ces populations.
Insuffisance de la zone de chasse rserve aux populations
Le village de Mbandza
Avec ses 518 habitants en 1995 (Gami, 1995b), le village Mbandza ne
peut subvenir ses besoins en protines animales si elle na accs qu la
petite superficie situe dans les zones tampon et banale (zone de chasse
situe en dehors des limites de laire protge ; cf dfinition supra). En
effet, la zone banale, prise en sandwich entre les villages de laxe Mbandza
et ceux de laxe Mbomo-Olloba (vers le Gabon), est trs frquente. En
raison du nombre de chasseurs venant de Mbomo-centre et des villages
situs sur laxe Mbomo-Olloba, nombreux sont les accidents de chasse.
Confronts ltroitesse de la zone autorise aux activits de subsis-
tance, les hommes de Mbandza traversent la rivire Epoloba, limite
naturelle de la zone tampon, pour pratiquer la chasse. Ainsi, les
chasseurs arrivent parfois au niveau de la rivire Edzabandzi, situe
environ 19 km du village vol doiseau. Les campements servant dabris
pour les chasseurs sont, pour les plus loigns, situs de 22 24 km du
village, sur les sites des anciens villages (ekombo en langue mboko). Le
type de chasse pratiqu Mbandza est destin la consommation
familiale ; le faible excdent est commercialis, soit au sein du village,
soit Mbomo-centre.
-472-
Le village dOlm
Le village Olm est situ entre la zone banale et la rserve. la diff-
rence de Mbandza, Olm la zone banale est trop troite. Le terroir de
chasse du village couvre, selon les enqutes de Vanwijnsberghe, (1996),
une superficie de 81 km
2
. En consquence, la quasi-totalit des activits
de chasse se droule dans la zone tampon et au-del. Cela explique la diffi-
cult que nous avons eue au dbut de lenqute accder aux lignes de
piges (olambo ma waya). Les villageois ne croyaient pas notre
neutralit et nous prenaient pour des agents des Eaux et Forts, dguiss
en anthropologues !
Les chasseurs de ce village se rendent jusqu la rivire Edzabandzi,
situe lintrieur de la rserve environ 15 km du village. Ils y
sjournent une semaine ou davantage.
Le caractre illgal de la chasse se manifeste par lutilisation de codes par
les chasseurs et leur famille, pour dsigner le dpart la chasse : on dira
que le chasseur est parti Djamena (allusion la guerre du Tchad) ou
Etoumbi (ville voisine de Mbomo) pour justifier leur absence prolonge.
tant donne linadaptation de la loi forestire au Congo, toutes les
activits de chasse pratiques par les villageois (utilisation de fusils, de
piges cbles dacier) sont illgales. Les villageois en sont conscients,
mais se justifient par le fait de navoir jamais t concerts. Ainsi, les
conflits clatent trs frquemment entre les cogardes (gardes forestiers)
et les villageois lorsque ces derniers arrachent les piges cble dacier
dans la zone tampon.
La pche
La pche est une activit saisonnire qui participe aux stratgies alimen-
taires dveloppes par les populations forestires du Nord-Congo car,
pendant la saison sche, la chasse est moins productive. Pousss par la
scheresse, les animaux se dirigent vers les cours deau o les piges sont
facilement dtectables. Cest la priode idale pour les Mboko, Kota,
Mongom et Pygmes Kola de se rendre en fort pour exercer la pche
lcope. Chaque clan ou lignage possde son tang de pche (tongo), gr
par le chef de lignage. Laccs cet tang se fait avec la bndiction du chef
de lignage, qui invoque dabord les anctres avant de donner son accord.
Le dplacement des villages, occasionn par les diffrents remembre-
ments, a abouti priver les villageois de laccs leurs propres tangs. Nous
avons pu les recenser et les localiser approximativement sur une carte.
Notre tude de la gestion traditionnelle des tangs a mis en vidence
que le meilleur cogarde tait le chef de lignage, responsable de ltang. En
effet, tous les villageois lui reconnaissent un pouvoir sur la ralisation
dune partie de pche fructueuse et sans accidents, morsures de serpents,
agressions par les animaux froces.
-473-
Lhomme et la fort tropicale 1999
Actuellement, les habitants des villages dOlm et de Mbandza ne
peuvent accder librement leurs tangs. Ils refusent de payer les droits
de pche exigs par le Ministre des Eaux et Forts et pntrent de faon
clandestine dans la rserve.
La cueillette de produits non ligneux
Si certains produits de cueillette, tels que le peke (Irvingia gabonensis),
le kana (Panda oleosa), libambu (Gambeya africana et lacourtiana)
abondent dans la zone tampon et banale, cela nest pas le cas dautres
fruits tels que le kura ou kuta (Coula edulis), fruit haute valeur symbo-
lique et alimentaire, trs apprci par les Mboko, Kota, Mongom et
Bakola, comme en tmoigne cette expression couramment utilise par les
Mboko, lekura lepedi ledzo, cest--dire le kura est plus apptissant que
larachide.
Actuellement la zone kura, jadis gre par les chefs de clans ou de
lignages, se trouve lintrieur de la rserve. Les villageois sont trs
mcontents et refusent de payer les droits exigs par ladministration des
Eaux et Forts. Ils nacceptent pas non plus de devoir se rendre dans la
zone sans fusil comme lexige la loi, car ils craignent les attaques des
animaux sauvages.
Propositions pour une gestion durable en concertation avec les
populations
Lapproche participative, qui intgre toutes les parties intresses, est la
meilleure solution pour une gestion durable des cosystmes du bassin du
Congo. Pour linstant, elle se fait timidement sans que lon puisse citer de
modle de russite dans la zone.
La Composante ECOFAC-Congo, la lumire des tudes socio-cono-
miques et biologiques, vient de proposer un projet dextension du parc
national dOdazala. Ainsi, la zone tampon des villages Mbandza et Olm
est agrandie de 5 km 10 km, intgrant les zones de pche et de cueillette.
Lun des progrs signaler est la cration des zones priphriques voues
une cogestion impliquant la population. Celle-ci ne sera plus spectateur,
mais aussi acteur dans la gestion des ressources naturelles.
Les limites prvues de la zone tampon tiennent compte des besoins de la
population en produits agricoles, gibier, fruits sauvages et poissons. Il est
vrai que la satisfaction nest pas totale au niveau des villageois, mais un
pas important a t franchi par les partisans de la conservation.
Nous nous approchons du concept de zone tampon fonction sociale,
dont, selon Mackinnon et al. (1990), le rle essentiel serait dencourager la
-474-
population locale rechercher des produits forestiers au sein mme de la
rserve. Il est vrai que si lon devait respecter tous les terroirs coutumiers,
le parc dOdzala nexisterait plus. La solution adopte par ECOFAC et le
Ministre des Eaux et Forts, dtendre la zone tampon de faon ce que
cette dernire englobe au mieux les terroirs coutumiers, est fliciter.
La gestion des zones tampons et priphriques en concertation avec
toutes les parties prenantes (population, Etat, projet) est une nouveaut
encourager. Cette forme de gestion devrait aboutir au partage des
bnfices gnrs par la mise en valeur des zones priphriques.
Lapproche participative doit tre encourage, afin de garantir la gestion
durable des ressources naturelles du bassin du Congo. On pourrait aller
plus loin en responsabilisant les familles la gestion traditionnelle des
tangs de pche situs dans la zone priphrique et leur mise en valeur
sur le plan touristique. Il pourrait tre envisageable de collecter en dehors
de la zone priphrique des produits naturels comme Coula edulis
certaines priodes de lanne.
Ces propositions devront faire face de nombreux cueils comme ce fut
le cas pour le parc national Royal Chitwan (Ledec et Goodland, 1988, cit
par Colchester, 1995), dont le modle de gestion fut critiqu pour ses
impacts sociaux par Ghimire (1992) qui ne donne pas de dtails. Pour
notre part, nous considrons cette dmarche comme intressante. En effet,
le parc autorise les villageois pntrer chaque anne pendant une
priode de quinze jours, pour cueillir des hautes herbes servant confec-
tionner les toits de chaume. Cet arrangement selon lauteur a contribu
amliorer lacceptation du parc par les populations autochtones. Il est
normal dans cette forme de gestion dassurer un encadrement et un suivi
des structures associatives villageoises concernes.
Sil savre important de protger la faune et la flore, les peuples de la
fort mritent notre avis autant dattention que le gorille et llphant.
Les textes rglementaires standardiss en matire de gestion des
ressources naturelles sont souvent mal adapts la ralit. Seul, un
dialogue interdisciplinaire entre biologistes, cologistes, anthropologues,
sociologues, conomistes peut aboutir llaboration de modles de
gestion adapts chaque contexte, en particulier au contexte sociocul-
turel. Le dialogue est encourager. Pourquoi dit-on tort que les peuples
de la fort ne sintressent pas la conservation de la biodiversit ? Avons-
nous suffisamment fait defforts en leur direction ?
-475-
Lhomme et la fort tropicale 1999
BIBLIOGRAPHIE
BLANEY S., et al., 1997, Complexe daires protges de Gamba - caractristiques socio-conomiques
des populations des dpartements de Ndougou, de la Basse-Banio et de la Mougoutsi (Mouenda).
WWF - Programme pour le Gabon, 74p.
CATINOT R., 1997, Lamnagement durable des forts denses tropicales humides. Ed. SCYTALE,
ATIBT : contribution de lAssociation technique internationale des bois tropicaux, 100p.
COLCHESTER M., 1995, Nature sauvage, nature sauve ? Peuples indignes, zones protges et
conservation de la biodiversit. UNRISD (Institut de Recherche des Nations Unies pour le
Dveloppement Social), Genve, 69p.
GAMI N., 1995a, Etude du milieu humain - parc national dOdzala (Congo). Rapport intermdiaire
villages Olm et Lbango. Rapport ECOFAC, 38p.
GAMI N., 1995b, Etude du milieu humain - parc national dOdzala (Congo). Rapport intermdiaire
village Mbandza. Rapport ECOFAC, 24p.
JOIRIS D.V., 1996a, Importance des terroirs coutumiers pour la conservation : rflexions partir du
programme ECOFAC au Cameroun, au Gabon, au Congo et en Rpublique Centrafricaine. Colloque
panafricain sur la gestion communautaire des ressources naturelles et le dveloppement durable,
Harare, Zimbabwe, 12p.
JOIRIS D.V., 1996b, Synthse rgionale des expertises anthropologiques. Rapport AGRECO-CTFT,
projet ECOFAC.
JOIRIS D.V., TCHIKANGWA, NKANJE B., 1995, Systmes fonciers et socio-politiques des popula-
tions de la rserve du Dja. Approche anthropologique pour une gestion en collaboration avec les
villages. Projet ECOFAC, Composante Cameroun. Groupement AGRECO-CTFT, 154p.
MACKINNON J ; KATHY, 1990, Amnagement et gestion des aires protges tropicales. UICN,
Programme des Nations Unies pour lEnvironnement, CCE, Gland, Suisse, 289p.
MINEF - Cellule de Coordination du programme Dja, ECOFAC - Cameroun, 1998, Protocole dinter-
vention pour une opration de ngociation des modalits de gestion en partenariat des zones dexploi-
tations des ressources naturelles en priphrie de la rserve de Biosphre du Dja. MINEF (Ministre
des Eaux et Forts) - Cameroun, 11p.
MINISTERE DES EAUX ET FORETS - SECRETARIAT GENERAL AUX EAUX ET FORETS -
CONGO, 1983, Loi n 48/83 du 21/04/1983 dfinissant les conditions de la conservation et de
lexploitation de la faune sauvage, 17p.
PENELON A., MENDOUNGA L., KARSENTY A., 1998, Lidentification des finages villageois en
zone forestire au Cameroun - Justification, analyse et guide mthodologique. CIRAD - Fort,
Montpellier, France, 29p.
VANWIJNSBERGHE S., 1996, Etude sur la chasse villageoise aux environs du parc national
dOdzala. Rapport intermdiaire, AGRECO/CTFT, 45p.
VERMEULEN C., 1998, Analyse de loccupation spatiale de lespace forestier par les populations : un
outil aux usages multiples. Canope (Bulletin sur lenvironnement en Afrique centrale - ECOFAC),
n 12, pp11-12.
-476-
Dj parus :
Lhomme et le Lac, 1995
Impact de lhomme sur les milieux naturels : Perceptions et mesures, 1996
Villes du Sud et environnement, 1997
Lhomme et la lagune. De lespace naturel lespace urbanis, 1998
Cet ouvrage trouve son origine dans les X
e
journes scientifiques de la Socit dcologie
Humaine (Marseille, novembre 1998) organises par la SEH, le programme Avenir des
Peuples des Forts Tropicales et lUMR 6578 du CNRS-Universit de la Mditerrane.
Elles ont bnfici de lappui du programme Environnement, vie, socits du CNRS et
du Dpartement Environnement, technologies et socit de lUniversit de Provence.
Les diteurs scientifiques tiennent remercier : Patrick Baudot (Universit de
Provence, Marseille), Edmond Dounias (IRD, Montpellier), Alain Froment (IRD,
Orlans), Annette Hladik (CNRS, Paris), Annie Hubert (CNRS, Bordeaux), Pierre
Lemonnier (CNRS, Marseille), Glenn Smith (LASEMA, Paris) et Theodore Trefon
(APFT, Bruxelles) pour leur aide prcieuse dans la relecture de certains manuscrits.
Cet ouvrage a t publi avec le concours financier de lUnion Europenne (programme
APFT, DG Dveloppement) et du Conseil Gnral des Bouches-du-Rhne.
Les opinions mises dans le cadre de chaque article nengagent que leurs auteurs.
SOCIT DCOLOGIE HUMAINE
c/o UMR 6578 du CNRS-Universit de la Mditerrane
Facult de Mdecine, 27, boulevard Jean-Moulin
13385 Marseille cedex 5
Dpt lgal : 2
e
trimestre 2000
ISBN 2-9511840-5-0
ISSN 1284-5590
Tous droits rservs pour tous pays
ditions de Bergier
476 chemin de Bergier, 06740 Chteauneuf de Grasse
bergier@wanadoo.fr
Travaux de la Socit dcologie Humaine
Directeur de la Publication : Nicole Vernazza-Licht
Dbut1/14:Dbut1/14 26/08/09 15:23 Page2
LHOMME
ET LA
FORT TROPICALE
diteurs scientifiques
Serge Bahuchet, Daniel Bley,
Hlne Pagezy, Nicole Vernazza-Licht
1999
Dbut1/14:Dbut1/14 26/08/09 15:23 Page3
Vous aimerez peut-être aussi
- SSIAP - Cours.fascicule6.1. R Diger Une Notice de S Curit .Exercice D ApplicationDocument14 pagesSSIAP - Cours.fascicule6.1. R Diger Une Notice de S Curit .Exercice D ApplicationJeremy Riviere100% (2)
- Rapport D EtonnementDocument2 pagesRapport D EtonnementJàMàl Mejor100% (1)
- Solution TD IV - MastDocument12 pagesSolution TD IV - Mastmohammed8nizar100% (1)
- La Stratégie de La Différenciation Des Produit: DéfinitionDocument4 pagesLa Stratégie de La Différenciation Des Produit: DéfinitionRachida El moudenPas encore d'évaluation
- Chapitre IDocument12 pagesChapitre IGauss JordanPas encore d'évaluation
- Interview Des Sibériens de Nytt LandDocument8 pagesInterview Des Sibériens de Nytt LandClitorine de VolangesPas encore d'évaluation
- PoliceadministrativeDocument19 pagesPoliceadministrativeMohammed Benali100% (3)
- Husserl - La Science Des PhénomènesDocument226 pagesHusserl - La Science Des PhénomènesStéphane VinoloPas encore d'évaluation
- Lecture Analytique HugoDocument6 pagesLecture Analytique HugoAhmed DahmachePas encore d'évaluation
- TD3 S6 EconometrieDocument9 pagesTD3 S6 EconometrieFoOt TvPas encore d'évaluation
- Memoire SelectiveDocument6 pagesMemoire Selectivereina dibPas encore d'évaluation
- Production Décrits Relater Des ÉcritsDocument2 pagesProduction Décrits Relater Des ÉcritsLaminePas encore d'évaluation
- 4 - Les Listes Des MédicamentsDocument2 pages4 - Les Listes Des Médicamentssamir hamadPas encore d'évaluation
- Contrôle D'identité Dans Le CloudDocument15 pagesContrôle D'identité Dans Le CloudTOULASSI-ANANI Yves LoloPas encore d'évaluation
- Temoigner Du Spirituel Patrice Sauvage - Doc - EmmanuelDocument45 pagesTemoigner Du Spirituel Patrice Sauvage - Doc - EmmanuelppgazaPas encore d'évaluation
- Expoziția Jacques Herlod "De La Suprarealism La Abstracționismul Liric" at Colors Art GalleryDocument52 pagesExpoziția Jacques Herlod "De La Suprarealism La Abstracționismul Liric" at Colors Art GalleryModernismPas encore d'évaluation
- 1er Cours 2022 PR Lehur Procto UM6SS Généralités - CompressedDocument43 pages1er Cours 2022 PR Lehur Procto UM6SS Généralités - Compressedyoussef maadenPas encore d'évaluation
- Delimiter Et Analyser La Polysemie de Fagon DiachroniqueDocument31 pagesDelimiter Et Analyser La Polysemie de Fagon DiachroniqueTerescenco MarinaPas encore d'évaluation
- Fre oDocument4 pagesFre oNatalia GilPas encore d'évaluation
- Logique Des Propositions Langage Et DéductionDocument32 pagesLogique Des Propositions Langage Et DéductionAhzuePas encore d'évaluation
- Iatf 16949 2016Document12 pagesIatf 16949 2016haitemPas encore d'évaluation
- Analyse Baudelaire - L'invitation Au VoyageDocument2 pagesAnalyse Baudelaire - L'invitation Au Voyagebeebac200950% (4)
- (Free Scores - Com) Traditional Les Yeux NoirsDocument2 pages(Free Scores - Com) Traditional Les Yeux NoirsArmelle SebbanPas encore d'évaluation
- تحميل دليل صياغة النصوص القانونية بالمغربDocument209 pagesتحميل دليل صياغة النصوص القانونية بالمغربمحمد فهميPas encore d'évaluation
- Gram 13 Ordre Des ComplementsDocument2 pagesGram 13 Ordre Des ComplementsClelia RamlotPas encore d'évaluation
- PromesseDocument8 pagesPromesseJacob sékou MillimounoPas encore d'évaluation
- Ancient History Lesson by SlidesgoDocument28 pagesAncient History Lesson by SlidesgoFATIMA-ZAHRAE ROUASPas encore d'évaluation
- Projet S - Quentiel N - 1 La B. - M Sefrioui PDFDocument63 pagesProjet S - Quentiel N - 1 La B. - M Sefrioui PDFizmos0150% (2)
- (NOUVELLE EDITION) Yram - Le Médecin de L'ameDocument223 pages(NOUVELLE EDITION) Yram - Le Médecin de L'amee-libraire100% (3)
- Refractometre AbbeDocument4 pagesRefractometre AbbeBENSLIMANEOTHMANE100% (1)