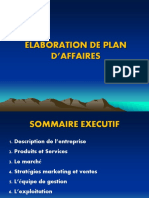Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ricoeur Soi Meme
Ricoeur Soi Meme
Transféré par
darouchkaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ricoeur Soi Meme
Ricoeur Soi Meme
Transféré par
darouchkaDroits d'auteur :
Formats disponibles
PAULRI CUR
SOI-MME
COMME UN
AUTRE
DITIONS DU SEUIL
27, rue J acob, Paris VF
L'ORDRE PHILOSOPHIQUE
SOUS LA DIRECTION DE
FRANOIS WAHL
ISBN 2-02-011458-5
ditions du Seuil, mars 1990,
l'exception des langues anglo-saxonnes.
Le Code de la proprit intellectuelle interdit les copies ou reproductions destines une utilisation
collective. Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite par quelque procd que ce
soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaon
sanctionne par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la proprit intellectuelle.
A FRANOIS WAHL
en tmoignage de reconnaissance et d'amiti
REMERCIEMENTS
Mes premiers remerciements vont l'universit
d'Edimbourg dans la personne de son Chancelier qui m'a
confr l'honneur de prononcer en 1986 les Gifford Lec-
tures sous le titre On Seljhood, the Question of Personal
Identity. C'est de ces confrences que sont issues les
tudes ici publies.
J'exprime galement ma gratitude au professeur
Spae-mann de l'universit de Munich, qui m'a permis de
donner, la mme anne, une seconde version des
confrences initiales dans le cadre des Schelling
Vorlesungen.
Je remercie en outre le professeur Bianco de l'univer-
sit de Rome La Sapienza , qui m'a offert l'occasion
de dvelopper la partie thique de mon ouvrage, dans le
cadre de l'enseignement qu'il m'a confi en 1987.
Je suis reconnaissant mes amis Jean Greisch et
Richard Kearney de m'avoir permis d'esquisser les
considrations ontologiques sur lesquelles s'achve mon
travail, dans le cadre de la dcade de Cerisy qu'ils ont
organise et prside durant l't 1988.
Enfin, je veux dire Franois Wahl, des ditions du
Seuil, ma profonde gratitude pour l'aide qu'il m'a appor-
te dans la composition et la rdaction de ce livre. Ce
dernier, comme mes prcdents travaux dits par lui,
est redevable, au-del de ce que je puis exprimer, son
esprit de rigueur et son dvouement l'criture.
PRFACE
La question de l'ipsit
Par le titre Soi-mme comme un autre, j'ai voulu dsigner le point de
convergence entre les trois intentions philosophiques majeures qui ont
prsid l'laboration des tudes qui composent cet ouvrage.
La premire intention est de marquer le primat de la mdiation
rflexive sur la position immdiate du sujet, telle qu'elle s'exprime la
premire personne du singulier: je pense, je suis. Cette premire
intention trouve un appui dans la grammaire des langues naturelles
lorsque celle-ci permet d'opposer soi je . Cet appui prend des
formes diffrentes selon les particularits grammaticales propres
chaque langue. Au-del de la corrlation globale entre le franais soi,
l'anglais self, l'allemand Selbsl, l'italien se, l'espagnol simismo, les
grammaires divergent. Mais ces divergences mmes sont instructives,
dans la mesure o chaque particularit grammaticale claire une partie du
sens fondamental recherch. En ce qui concerne le franais, soi est
dfini d'emble comme pronom rflchi. Il est vrai que l'usage
philosophique qui en est fait tout au long de ces tudes enfreint une
restriction que les grammairiens soulignent, savoir que soi est
un pronom rflchi de la troisime personne (il, elle, eux). Cette
restriction toutefois est leve, si on rapproche le terme soi du terme
se , lui-mme rapport des verbes au mode infinitif- on dit : se
prsenter , se nommer . Cet usage, pour nous exemplaire, vrifie
un des enseignements du linguiste G. Guillaume ', selon lequel c'est
l'infinitif, et encore jusqu' un certain point au participe, que le verbe
exprime la plnitude de sa signification, avant de se distribuer entre les
temps verbaux et les personnes grammaticales ; le se dsigne alors le
rflchi de tous les pronoms personnels, et mme de pronoms
impersonnels, tels que chacun , quiconque , on , auxquels il
sera fait frquemment allusion au cours de nos investigations. Ce
dtour
1. G. Guillaume, Temps et Verbe, Paris, Champion, 1965.
11
SOI-MME COMME UN AUTRE PRFACE
par le se n'est pas vain, dans la mesure o le pronom rflchi soi
accde lui aussi la mme amplitude omnitemporelle quand il
complte le se associ au mode infinitif: se dsigner soi-mme
(je laisse provisoirement de ct la signification attache au mme
dans l'expression soi-mme ). C'est sur ce dernier usage - relevant
sans conteste du bon usage de la langue franaise ! - que prend
appui notre emploi constant du terme soi , en contexte
philosophique, comme pronom rflchi de toutes les personnes
grammaticales, sans oublier les expressions impersonnelles cites un
peu plus haut. C'est, son tour, cette valeur de rflchi
omnipersonnel qui est prserve dans l'emploi du soi dans la
fonction de complment de nom : le souci de soi - selon le titre
magnifique de Michel Foucault. Cette tournure n'a rien d'tonnant,
dans la mesure o les noms qui admettent le soi un cas indirect sont
eux-mmes des infinitifs nominaliss, comme l'atteste l'quivalence des
deux expressions : se soucier de soi(-mme) et le souci de soi . Le
glissement d'une expression l'autre se recommande de la permission
grammaticale selon laquelle n'importe quel lment du langage peut
tre nominalis : ne dit-on pas le boire , le beau , le bel
aujourd'hui ? C'est en vertu de la mme permission grammaticale que
l'on peut dire le soi , alignant ainsi cette expression sur les formes
galement nominaiises des pronoms personnels dans la position de sujet
grammatical : le je , le tu , le nous , etc. Cette nominalisation,
moins tolre en franais qu'en allemand ou en anglais, ne devient
abusive que si l'on oublie la filiation grammaticale partir du cas
indirect consign dans l'expression dsignation de soi , elle-mme
drive par premire nominalisation de l'infinitif rflchi : se dsigner
soi-mme . C'est cette forme que nous tiendrons dsormais pour
canonique. La seconde intention philosophique, implicitement
inscrite dans le titre du prsent ouvrage par le biais du terme mme ,
est de dissocier deux significations majeures de l'identit (dont on va dire
dans un moment le rapport avec le terme mme ), selon que l'on
entend par identique l'quivalent de Y idem ou de Vipse latin.
L'quivocit du terme identique sera au cur de nos rflexions sur
l'identit personnelle et l'identit narrative, en rapport avec un caractre
majeur du soi, savoir sa temporalit. L'identit, au sens d'idem,
dploie elle-mme une hirarchie de significations que nous
expliciterons le moment venu (cinquime et sixime tudes), et dont la
permanence dans le temps constitue le degr le plus lev, quoi
s'oppose le diffrent, au sens de
12
changeant, variable. Notre thse constante sera que l'identit au sens
Upse n'implique aucune assertion concernant un prtendu noyau non
changeant de la personnalit. Et cela, quand bien mme l'ipsit
apporterait des modalits propres d'identit, comme l'analyse de la
promesse l'attestera. Or l'quivocit de l'identit concerne notre titre
travers la synonymie partielle, en franais du moins, entre mme et
identique . Dans ses acceptions varies
1
, mme est employ
dans le cadre d'une comparaison ; il a pour contraires : autre,
contraire, distinct, divers, ingal, inverse. Le poids de cet usage
comparatif du terme mme m'a paru si grand que je tiendrai
dsormais la mmet pour synonyme de l'identit-/em et que je lui
opposerai l'ipsit par rfrence l'identit-/p.se. Jusqu' quel point
l'quivocit du terme mme se reflte-t-elle dans notre titre Soi-mme
comme un autre ? Indirectement seulement, dans la mesure o
soi-mme n'est qu'une forme renforce de soi , l'expression
mme servant indiquer qu'il s'agit exactement de l'tre ou de la chose
en question (c'est pourquoi il n'y a gure de diffrence entre le souci de
soi et le souci de soi-mme , sinon l'effet de renforcement qu'on
vient de dire). Nanmoins, le fil tnu qui rattache mme , plac aprs
soi l'adjectif mme , au sens d'identique ou de semblable, n'est
pas rompu. Renforcer, c'est encore marquer une identit. Ce n'est pas le
cas en anglais ou en allemand o same ne peut pas tre confondu avec
self, der die, dasselbe, ou gleich, avec Selbst, sinon dans des philosophies
qui drivent expressment la seljhood ou la Selbstheit de la mmet
rsultant d'une comparaison. Ici, l'anglais et l'allemand sont moins
sources d'quivoque que le franais.
La troisime intention philosophique, explicitement incluse, celle-ci,
dans notre titre, s'enchane avec la prcdente, en ce sens que
Vienlit-ipse met en jeu une dialectique complmentaire de celle de
l'ipsit et de la mmet, savoir la dialectique du soi et de Vautre que
soi. Tant que l'on reste dans le cercle de Pidentit-mmet, l'altrit de
l'autre que soi ne prsente rien d'original : autre figure, comme on a
pu le remarquer en passant, dans la liste des antonymes de mme ,
ct de contraire , distinct , divers , etc. Il en va tout
autrement si l'on met en couple l'altrit avec l'ipsit. Une altrit qui
n'est pas - ou pas
1. Le Robert place en tte des significations de l'adjectif mme l'identit
absolue (la mme personne, une seule et mme chose), la simultanit (dans le
mme temps), la similitude (qui fait du mme le synonyme de l'analogue, du
pareil, du semblable, du similaire, du tel que), l'galit (une mme quantit de).
13
SOI-MME COMMEUN AUTRE
seulement - de comparaison est suggre par notre titre, une alt-rit
telle qu'elle puisse tre constitutive de l'ipsit elle-mme.
Soi-mme comme un autre suggre d'entre de jeu que l'ipsit du
soi-mme implique l'altrit un degr si intime que l'une ne se
laisse pas penser sans l'autre, que l'une passe plutt dans l'autre,
comme on dirait en langage hglien. Au comme , nous vou-
drions attacher la signification forte, non pas seulement d'une
comparaison - soi-mme semblable un autre -, mais bien d'une
implication : soi-mme en tant que... autre.
De la premire la troisime considration, nous avons pris appui
sur les suggestions de la simple grammaire ; mais c'est aussi sous la
conduite du questionnement philosophique que nous avons identifi
les formes canoniques qui dans notre propre langue soutiennent
l'analyse conceptuelle. S'impose ds lors la tche de procurer
l'expression soi-mme comme un autre les dveloppements
philosophiques qui, sans perdre de vue les contraintes et les
suggestions de la simple grammaire, transcendent les idiotismes de
notre propre langue.
Il m'est apparu qu'une rapide confrontation avec le double
hritage - positif et ngatif - des philosophies du sujet pourrait
constituer une prface approprie pour faire comprendre pourquoi
la querelle du Cogito sera par aprs considre comme dpasse.
C'est pourquoi je prfre parler ici de prface que d'introduction.
Certes, d'autres dbats se proposeront en cours de route, o la
dialectique de l'identit-i/w et de ridentit-ifem, celle du soi et de
son autre, tiendront les premiers rles. Mais les polmiques dans
lesquelles nous serons alors engags se situeront au-del du point o
notre problmatique se sera spare de celle des philosophies du
sujet.
Je tiens ici pour paradigmatique des philosophies du sujet que
celui-ci y soit formul en premire personne - ego cogito -, que le
je se dfinisse comme moi empirique ou comme je
transcen-dantal, que le je soit pos absolument, c'est--dire sans
vis--vis autre, ou relativement, l'gologie requrant le complment
intrinsque de l'intersubjectivit. Dans tous ces cas de figure, le
sujet c'est je . C'est pourquoi l'expression philosophies du sujet
est tenue ici pour quivalente philosophies du Cogito. C'est
pourquoi aussi la querelle du Cogito, o le je est tour tour en
position de force et de faiblesse, m'a paru le mieux capable de faire
ressortir d'entre de jeu la problmatique du soi, sous la rserve que
nos investigations ultrieures confirment la prten-
PRFACE
tion que nous formulons ici, savoir que l'hermneutique du soi se
trouve gale distance de l'apologie du Cogito et de sa destitution.
Le style spcifique de l'hermneutique du soi se comprend mieux si
l'on a pris au pralable la mesure des tonnantes oscillations que
semblent prsenter les philosophies du sujet, comme si le Cogito
dont elles sont issues tait inluctablement soumis un rythme
altern de surestimation et de sous-estimation. Du a je de ces
philosophies, devrait-on dire, comme certains le disent du pre,
qu'il y en a soit pas assez, soit trop ?
1. Le Cogito se pose
Le Cogito n'a aucune signification philosophique forte, si sa
position n'est pas habite par une ambition de fondation dernire.
ultime. Or, cette ambition est responsable de la formidable
oscillation sous l'effet de laquelle le je du je pense parat tour
tour exalt hors de toute mesure au rang de premire vrit, et
rabaiss au rang d'illusion majeure. S'il est vrai que cette ambition
de fondation dernire s'est radicalise de Descartes Kant. puis de
Kant Fichte, enfin au Husserl des Mditations cartsiennes, il
nous a paru nanmoins suffisant de la pointer son lieu de
naissance, chez Descartes lui-mme, dont la philosophie atteste que
la crise du Cogito est contemporaine de la position du Cogito
1
.
L'ambition fondationnelle attache au Cogito cartsien se laisse
reconnatre ds l'abord au caractre hyperbolique du doute qui
ouvre l'espace d'investigation des Mditations. La radicalit du
projet
2
est ainsi la mesure du doute qui n'excepte du rgime de '
opinion ni le sens commun, ni les sciences - tant mathmatiques
que physiques -, ni la tradition philosophique. Plus prcisment,
cette radicalit tient la nature d'un doute sans commune mesure
avec celui qu'on peut exercer l'intrieur des trois domaines
susnomms. L'hypothse d'une tromperie totale procde d'un doute
que Descartes appelle mtaphysique poui en marquer la
disproportion par rapport tout doute interne un
1. R. Descartes. Mditations mtaphysiques, Paris, Garnier-Flammarion, 1979.
Les chiffres entre parenthses renvoient la pagination Adam-Tannery (AT).
2. ... il me fallait entreprendre srieusement une fois en ma vie de me dfaire
de toutes les opinions que j'avais reues jusqu'alors en ma crance, et commencer
tout de nouveau ds les fondements, si je voulais tablir quelque chose de ferme et
de constant dans les sciences (PremireMditation, AT, t. IX, p. 13).
14 15
SOI-MME COMME UN AUTRE
espace particulier de certitude. C'est pour dramatiser ce doute que
Descartes forge, comme on sait, l'hypothse fabuleuse d'un grand
trompeur ou malin gnie, image inverse d'un Dieu vrace, rduit
lui-mme au statut de simple opinion '. Si le Cogito peut procder de
cette condition extrme de doute, c'est que quelqu'un conduit le doute
2
.
Certes, ce sujet de doute est radicalement dsancr, ds lors que le
corps propre est entran dans le dsastre des corps. Mais il reste encore
quelqu'un pour dire : ... j'emploie tous mes soins me tromper
moi-mme feignant que toutes ces penses sont fausses et imaginaires.
Mme l'hypothse du malin gnie est une fiction que je forme. Mais
ce j e qui doute, ainsi dsancr au regard de tous les repres
spatio-temporels solidaires du corps propre, qui est-il ? Dplac par
rapport au sujet autobiographique du Discours de la mthode - dont la
trace subsiste dans les premires lignes des Mditations* -, le je qui
mne le doute et qui se rflchit dans le Cogito est tout aussi
mtaphysique et hyperbolique que le doute l'est lui-mme par rapport
tous ses contenus. 11 n'est vrai dire personne
4
.
Que reste-t-il dire de ce je dsancr ? que, par son obstination mme
vouloir douter, il tmoigne d'une volont de certitude et de vrit -
nous ne distinguons pas entre les deux expressions ce stade -, qui
donne au doute mme une sorte d'orient : en ce sens, le doute cartsien
n'est pas le dsespoir kier-kegaardien. Bien au contraire, la volont de
trouver est ce qui le motive : et, ce que je veux trouver, c'est la vrit de
la chose mme. Ce dont on doute, en effet, c'est que les choses soient
telles qu'elles semblent tre. A cet gard, il n'est pas indiffrent que
l'hypothse du malin gnie soit celle d'un grand trompeur. La tromperie
consiste prcisment faire passer le sembler pour l'tre vritable.
Par le doute, je me persuade que rien n'a jamais t ; mais, ce que je
veux trouver, c'est une chose qui soit certaine et vritable . Cette
dernire remarque est capitale pour comprendre le
1. Il se peut faire qu'il ait voulu que je me trompe toutes les fois que je fais
l'addition de deux et de trois (ibid., AT, t. IX, p. 16).
2. ...je m'appliquerai srieusement et avec libert dtruire gnralement
toutes mes anciennes opinions (ibid., AT, t. IX, p. 13).
3. Il y a dj quelque temps que je me suis aperu que, ds mes premires
annes, j'avais reu quantit de fausses opinions pour vritables... (ibid.).
4. C'est pourquoi le qui du doute ne manque d'aucun autrui puisqu'il est
sorti, en perdant tout ancrage, des conditions d'interlocution du dialogue. On ne
peut mme pas dire qu'il monologue, dans la mesure o le monologue marque un
retrait par rapport i un dialogue qu'il prsuppose en l'interrompant.
16
PRFACE
retournement du doute en la certitude du Cogito dans la Seconde
Mditation : conformment la vise ontologique du doute, la premire
certitude qui en drive est la certitude de mon existence, implique
dans l'exercice mme de pense en quoi l'hypothse du grand trompeur
consiste : Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe ; et
qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois
rien, tant que je penserai tre quelque chose (AT, t. IX, p. 19). C'est
bien l une proposition existentielle : le verbe tre y est pris
absolument et non comme copule : je suis, j'existe' .
La question qui ?, lie d'abord la question qui doute ?, prend un tour
nouveau en se liant la question qui pense
7
et, plus radicalement, qui
existe ?. L'indtermination extrme de la rponse -indtermination
hrite du caractre initialement hyperbolique du doute - explique sans
doute que Descartes soit contraint, pour dvelopper la certitude acquise,
de lui adjoindre une question nouvelle, savoir celle du savoir ce que je
suis
2
. La rponse cette question conduit la formule dveloppe du
Cogito : Je ne suis donc prcisment parlant qu'une chose qui pense,
c'est--dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des
termes dont la signification m'tait auparavant inconnue (AT, t. IX,
p. 21). Par la question quoi ?, nous sommes entrans dans une recherche
prdicative, portant sur ce qui appartient cette connaissance que j'ai
de moi-mme (AT, t. IX, p. 22), ou plus nettement encore ce qui
appartient ma nature '. A ce point,
1. Le lecteur accoutum au Discours de la mthode peut s'tonner de ne pas
trouver ici la formule fameuse : Cogito ergo sum. Elle est pourtant implicite la
formule : je doute, je suis. De plusieurs manires : d'abord douter, c'est pen
ser ; ensuite, le je suis est reli au doute par un donc , renforc par toutes les
raisons de douter, si bien qu'il faut lire : Pour douter, il faut tre. Enfin, la pre
mire certitude n'est pas de l'ordre du sentiment, c'est une proposition : De
sorte qu'aprs y avoir bien pens et avoir soigneusement examin toutes choses,
enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition : Je suis, j'existe,
est ncessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conois en
mon esprit (Seconde Mditation, AT, t. IX, p. 19). Laissons pour l'instant de
ct la restriction : toutes les fois que je la prononce... ; elle jouera un rle dci
sif dans ce que j'appellerai plus loin la crise du Cogito.
2. Mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis
certain que je suis (ibid). Et encore : j'ai reconnu que j'tais, et je cherche quel je
suis, moi que j'ai reconnu tre (ibid., AT, t. IX. p. 21). Ce passage de la question
qui ? la question quoi ? est prpar par un usage du verbe tre qui oscille entre
l'usage absolu, Je suis, j'existe et l'usage prdicatif, Je suis quelque chose .
Quelque chose, mais quoi ?
3. Ici recommence un criblage d'opinions par le doute mthodique, criblage
parallle celui de la Premire Mditation, mais dont l'enjeu est la liste des prdi-
cats attribuables ce je certain d'exister dans la nudit du je suis .
17
SOI-MME COMME UN AUTRE
le je perd dfinitivement toute dtermination singulire en
devenant pense, c'est--dire entendement. Il est vrai que cette
tendance qu'on peut dire pistmologisante (renforce par le
dveloppement fameux de la Seconde Mditation connu sous le nom
du morceau de cire ) est tempre par une tendance
phnomnologisante , exprime dans l'numration qui prserve la
relle varit intime de l'acte de penser: Qu'est-ce qu'une chose qui
pense ? C'est--dire une chose qui doute, qui conoit, qui affirme,
qui nie. qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent
(ibid.). Cette numration pose la question de l'identit du sujet,
mais en un tout autre sens que l'identit narrative d'une personne
concrte. Il ne peut s'agir que de l'identit en quelque sorte
ponctuelle, anhistorique, du je dans la diversit de ses oprations
; cette identit est celle d'un mme qui chappe l'alternative de la
permanence et du changement dans le temps, puisque le Cogilo est
instantan
1
.
Au terme de la Seconde Mditation, le statut du sujet mditant
apparat sans commune mesure avec ce que, dans la suite de nos
investigations, nous appellerons locuteur, agent, personnage de
narration, sujet d'imputation morale, etc. La subjectivit qui se pose
elle-mme par rflexion sur son propre doute, doute radica-lis par
la fable du grand trompeur, est une subjectivit dsan-cre, que
Descartes, conservant le vocabulaire substantialiste des
philosophies avec lesquelles il croit avoir rompu, peut encore
appeler une me. Mais c'est l'inverse qu'il veut dire : ce que la
tradition appelle me est en vrit sujet, et ce sujet se rduit l'acte
le plus simple et le plus dpouill, celui de penser. Cet acte de
penser, encore sans objet dtermin, suffit vaincre le doute, parce
que le doute le contient dj. Et, comme le doute est volontaire et
libre, la pense se pose en posant le doute. C'est dans ce sens que le
j'existe pensant est une premire vrit, c'est--dire une vrit que
rien ne prcde.
Or la question se pose de savoir si, chez Descartes lui-mme, le
j'existe pensant se soutient dans cette position de premire vrit
immdiatement connue par rflexion sur le doute. Ce serait le cas si,
dans l'ordre des raisons, toutes les autres vrits procdaient de la
certitude du Cogito. Or, l'objection formule par
1. L'argument, ici, vaut d'tre rapport : Car il est de soi si vident que c'est
moi qui doute, qui entends et qui dsire, qu'il n'est pas ici besoin de rien ajouter
pour l'expliquer. (AT, t. IX. p. 22). L'vidence porte ici sur l'impossibilit de
disjoindre aucun de ces modes de la connaissance que j'ai de moi-mme, donc de
ma vritable nature.
PRFACE
Martial Gueroult dans Descartes selon l'ordre des raisons
1
continue
de me paratre imparable. La certitude du Cogito donne de la vrit
une version seulement subjective ; le rgne du malin gnie continue,
quant savoir si la certitude a valeur objective ; que mon me soit
pure intelligence, cela est certain, mais c'est seulement une ncessit
interne de la science : Toutefois, si cette science est, pour mon
entendement, aussi certaine que le Cogito, elle n'a de certitude qu'
l'intrieur de lui, c'est--dire pour mon moi enferm en lui-mme
(op. cit., p. 87). La difficult tant celle qu'on vient de dire, il apparat
que chez Descartes la dmonstration de Dieu permettra seule de
rsoudre la question (ibid., p. 137). Or, cette dmonstration, telle
qu'elle est conduite dans la Troisime Mditation, renverse l'ordre de
la dcouverte, ou ordo cognoscendi, qui devrait lui seul, si le Cogito
tait tous gards vrit premire, conduire du moi Dieu, puis aux
essences mathmatiques, puis aux choses sensibles et aux corps ; et
elle le renverse au bnfice d'un autre ordre, celui de la vrit de la
chose , ou ordo essendi : ordre synthtique selon lequel Dieu, simple
chanon dans le premier ordre, devient le premier anneau. Le Cogito
serait vritablement absolu, tous gards, si l'on pouvait montrer qu'il
n'y a qu'un ordre, celui o il est effectivement premier, et que l'autre
ordre, qui le fait rgresser au second rang, drive du premier. Or il
semble bien que la Troisime Mditation renverse l'ordre, en plaant
la certitude du Cogito en position subordonne par rapport la
vracit divine, laquelle est premire selon la vrit de la chose
2
.
1. M. Gueroult. Descartes selon l'ordre des raisons. 2 vol., Paris,
Aubier-Montaigne, 1953.
2. Que pour Descanes il n'y ait eu ni sophisme ni cercle, cela n'est pas douteux.
Mais le prix payer est considrable. L'argument repose sur la distinction entre
deux statuts des ides : quant leur tre formel - c'est--dire en tant que pr-
sentes en moi, abstraction faite de leur valeur reprsentative -, elles sont simple-
ment en moi, toutes de mme rang, car galement penses par moi. Quant leur
valeur reprsentative, appele tre objectif, elle prsente des degrs variables
de perfection : gales en tant que penses, les ides ne le sont plus quant ce
qu'elle reprsentent. On connat la suite : l'ide de perfection, tenue pour syno-
nyme de l'ide philosophique de Dieu, s'avre dote d'un contenu reprsentatif
disproportionn mon intrieur, qui est celui d'un tre imparfait, puisque
condamn aller au vrai par le chemin pnible du doute. Telle est l'tonnante
situation : un contenu plus grand que son contenant. La question se pose alors de la
cause de cette ide : de toutes les autres ides je pourrais soutenir que je suis la
cause, car elles n'ont pas plus d'tre que moi. De l'ide de Dieu je ne suis pas la
cause capable . Reste qu'elle ait t mise en moi par l'tre mme qu'elle repr-
sente. Je ne discute pas ici les innombrables difficults qui s'attachent chacun
des moments de l'argument : droit de distinguer l'tre objectif des ides de leur
tre formel, droit de tenir les degrs de perfection de l'ide pour proportionns
18 19
SOI-MME COMME UN AUTRE
Qu'en rsulte-t-il pour le Cogito lui-mme ? Par une sorte de choc
en retour de la nouvelle certitude, savoir celle de l'existence de
Dieu, sur celle du Cogito, l'ide de moi-mme apparat
profondment transforme du seul fait de la reconnaissance de cet
Autre qui cause la prsence en moi de sa propre reprsentation. Le
Cogito glisse au second rang ontologique. Descartes n'hsite pas
crire : j'ai en quelque faon premirement en moi la notion de
l'infini que du fini, c'est--dire de Dieu que de moi-mme
(Troisime Mditation, AT, t. IX, p. 36). Il faut donc aller jusqu'
dire que, si Dieu est ratio essendi de moi-mme, il devient par l
mme ratio cognoscendi de moi-mme, en tant que je suis un tre
imparfait, un tre de manque ; car l'imperfection attache au doute
n'est connue qu' la lumire de l'ide de perfection ; dans la Seconde
Mditation, je me connaissais comme existant et pensant, mais non
point encore comme nature finie et borne. Cette infirmit du Cogito
s'tend fort loin : elle n'est pas seulement attache l'imperfection du
doute, mais la prcarit mme de la certitude qui a vaincu le doute,
essentiellement son absence de dure ; livr lui-mme, le moi du
Cogito est le Sisyphe condamn remonter, d'instant en instant, le
rocher de sa certitude contre-pente du doute. En revanche, parce
qu'il me conserve, Dieu confre la certitude de moi-mme la per-
manence que celle-ci ne tient pas d'elle-mme. Cette stricte
contemporanit de l'ide de Dieu et de l'ide de moi-mme, prise
sous l'angle de la puissance de produire des ides, me fait dire que
comme l'ide de moi-mme, [l'ide de Dieu] est ne et produite avec
moi ds lors que j'ai t cr (AT, t. IX, p. 41). Mieux : l'ide de
Dieu est en moi comme la marque mme de l'auteur sur son ouvrage,
marque qui assure la ressemblance de l'un l'autre. Il me faut alors
confesser que je conois cette ressemblance (...) par la mme
facult par laquelle je me conois moi-mme (ibid.).
Il n'est gure possible de pousser plus loin la fusion entre l'ide de
moi-mme et celle de Dieu. Mais qu'en rsulte-t-il pour l'ordre des
raisons ? Ceci, qu'il ne se prsente plus comme une chane linaire,
mais comme une boucle ; de cette projection rebours du point
d'arrive sur le point de dpart, Descartes n'aperoit que le bnfice,
savoir l'limination de l'hypothse insidieuse du
aux tres ainsi reprsents, droit de tenir Dieu comme la cause de la prsence de sa
propre ide en nous. Je vais droit aux consquences qui concernent le Cogito lui-mme,
ainsi excd par cette ide d'infini ou de perfection incommensurable avec sa condition
d'tre fini.
20
PRFACE
Dieu menteur qui nourrissait le doute le plus hyperbolique ; l'image
fabuleuse du grand trompeur est vaincue en moi, ds lors que
l'Autre vritablement existant et entirement vridique en a occup
la place. Mais, pour nous, comme pour les premiers contradicteurs
de Descartes, la question est de savoir si, en donnant l'ordre des
raisons la forme du cercle, Descartes n'a pas fait de la dmarche qui
arrache le Cogito, donc le je , sa solitude initiale un gigantesque
cercle vicieux.
Une alternative semble alors ouverte : ou bien le Cogito a valeur
de fondement, mais c'est une vrit strile laquelle il ne peut tre
donn une suite sans rupture de l'ordre des raisons ; ou bien, c'est
l'ide du parfait qui le fonde dans sa condition d'tre fini, et la
premire vrit perd l'aurole du premier fondement.
Cette alternative, la postrit de Descartes l'a transforme en
dilemme : d'un ct Malebranche et plus encore Spinoza, tirant les
consquences du renversement opr par la Troisime Mditation,
n'ont plus vu dans le Cogito qu'une vrit abstraite, tronque,
dpouille de tout prestige. Spinoza est cet gard le plus cohrent :
pour Vthique, seul le discours de la substance infinie a valeur de
fondement ; le Cogito, non seulement rgresse au second rang, mais
perd sa formulation en premire personne ; on lit ainsi au livre II de
Vthique, sous le titre de l'axiome n : L'homme pense
1
. Un
axiome prcde cette formule lapidaire - axiome i - qui souligne un
peu plus le caractre subordonn du second : L'essence de
l'homme n'enveloppe pas l'existence ncessaire, c'est--dire qu'il
peut aussi bien se faire suivant l'ordre de la nature que cet homme-ci
ou celui-l existe, qu'il peut se faire qu'il n'existe pas
2
. Notre
problmatique du soi s'loigne de l'horizon philosophique. De l'autre
ct, pour tout le courant de l'idalisme, travers Kant, Fichte et
Husserl (du moins celui des Mditations cartsiennes), la seule
lecture cohrente du Cogito, c'est celle pour laquelle la certitude
allgue de l'existence de Dieu est frappe du mme sceau de
subjectivit que la certitude de ma propre existence ; la garantie de la
garantie que constitue la vracit divine ne constitue alors qu'une
annexe de la premire certitude. S'il en est ainsi, le Cogito n'est pas
une premire vrit que suivraient une seconde, une troisime, etc.,
mais le fondement qui se fonde lui-mme, incommensurable toutes
les propositions, non seulement empiriques, mais transcendantales.
Pour viter de tomber dans un idalisme subjectiviste, le je
1. Spinoza, thique, livre II, texte et trad. fr. de C. Appuhn, Paris, Vrin, 1977.
2. I bid.
21
SOI-MME COMME UN AUTRE
pense doit se dpouiller de toute rsonance psychologique, plus
forte raison de toute rfrence autobiographique. Il doit devenir le
je pense kantien, dont la Dduction transcendantale dit qu'il
doit pouvoir accompagner toutes mes reprsentations . La
problmatique du soi en ressort en un sens magnifie, mais au prix
de la perte de son rapport avec la personne dont on parle, avec le
je-tu de l'interlocution, avec l'identit d'une personne historique,
avec le soi de la responsabilit. L'exaltation du Cogito doit-elle tre
paye ce prix ? La modernit doit au moins Descartes d'avoir t
place devant une alternative aussi redoutable.
2. Le Cogito bris
Le Cogito bris : tel pourrait tre le titre emblmatique d'une
tradition, sans doute moins continue que celle du Cogito. mais dont
la virulence culmine avec Nietzsche, faisant de celui-ci le vis--vis
privilgi de Descartes.
Pour comprendre l'attaque mene par Nietzsche contre le Cogito
cartsien, en particulier dans les fragments de la dernire priode, il
n'est pas inutile de remonter quelques crits contemporains de La
Naissance de la tragdie, o le plaidoyer contre la rhtorique vise
subvenir la prtention de la philosophie s'riger en science, au
sens fort de discipline du fondement '.
L'attaque contre la prtention fondationnelle de la philosophie
prend appui sur le procs du langage dans lequel la philosophie se
dit. Or il faut bien avouer que, part Herder, la philosophie de la
subjectivit a fait entirement abstraction de la mdiation langa-
gire qui vhicule son argumentation sur le je suis et le je pense
. En mettant l'accent sur cette dimension du discours phi-
losophique, Nietzsche porte au jour les stratgies rhtoriques
1. Deux textes mritent cet gard de retenir notre attention : le premier appar-
tient un Cours de rhtorique profess Ble durant le trimestre d'hiver
1872-1873 (t. V de l'd. Krner-Musarion, trad. et prsent en franais par P.
Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy in Potique, n 5, 1971, et en anglais par C. Blair in
Philo-sophy and Rhetoric. 1983, p. 94-129). Le second texte, intitul Introduction
thor-tique : sur la vrit et le mensonge au sens extra-moral, tait destin figurer
dans un ouvrage qui se serait appel Dos Philosophenbuch - Le livre du
philosophe - et qui aurait servi de complment thorique La Naissance de la
tragdie (Le Livre du philosophe, d. bilingue, trad. fr. de A.K.. Mariei, Paris,
Aubier-Flammarion, 1969).
PRFACE
enfouies, oublies, et mme hypocritement refoules et dnies, au
nom de l'immdiatet de la rflexion.
Le Cours de rhtorique propose l'ide nouvelle selon laquelle les
tropes - mtaphore, synecdoque, mtonymie - ne constituent pas des
ornements surajouts un discours de droit littral, non figuratif,
mais sont inhrents au fonctionnement le plus primitif du langage.
En ce sens, il n'y a pas de naturalit non rhtorique du langage.
Celui-ci est tout entier figuratif.
C'est dans Vrit et Mensonge au sens extra-moral
1
(t 1873) que
le paradoxe d'un langage de part en part figurai, et de ce fait rput
mensonger, est pouss le plus loin. Paradoxe, en un double sens :
d'abord en ce que, ds les premires lignes, la vie, prise apparemment
en un sens rfrentiel et non figurai, est mise la source des fables par
lesquelles elle se maintient. Ensuite en ce que le propre discours de
Nietzsche sur la vrit comme mensonge devrait tre entran dans
l'abme du paradoxe du menteur. Mais Nietzsche est prcisment le
penseur qui a assum jusqu'au bout ce paradoxe, que manquent les
commentateurs qui prennent l'apologie de la Vie, de la Volont de
puissance, pour la rvlation d'un nouvel immdiat, substitu la
mme place et avec les mmes prtentions fondationnelles que le
Cogito. Je ne veux pas dire par l que Nietzsche, dans son effort pour
surmonter le nihilisme, n'ait pas eu en vue pareille reconstruction.
Mais il importe que celle- i reste la merci du geste de dconstruction
auquel est soumise la mtaphysique antrieure. En ce sens, si
l'argument dirig contre le Cogito peut tre interprt comme une
extension au Cogito lui-mme de l'argument cartsien du malin
gnie, au nom du caractre figurai et mensonger de tout langage, il
n'est pas certain qu'en se plaant lui-mme sous le paradoxe du
menteur, Nietzsche ait russi soustraire sa propre philosophie
l'effet de dconstruction dchan par son interprtation rhtorique de
toute philosophie. Le paradoxe initial est celui d'une illusion
servant d' exp-
1. Le Cours de rhtorique cite avec faveur une dclaration de l'crivain
Jean-Paul dans un extrait de la Vorschule der Aesthetik qui conclut en ces termes :
Ainsi, eu gard aux connexions spirituelles, tout langage est un dictionnaire de
mtaphores fanes. La mtaphore parat ici privilgie entre tous les tropes, mais
la mtonymie - remplacement d'un mot par un autre - n'est pas pour autant clipse
: le remplacement de l'effet par la cause (mtalepsis) deviendra, dans les fragments
de La Volont de puissance, le mcanisme principal du sophisme dissimul dans le
Cogito.
2. F. Nietzsche, Vrit et Mensonge au sens extra-moral, in uvres philo-
sophiques compltes, 1, vol. 2, crits posthumes, 1870-1873, d. Colli-Montinari.
Paris, Gallimard, 1975.
22
23
SOI-MME COMME UN AUTRE
dient au service de la conservation de la vie
1
. Mais la nature
elle-mme a soustrait l'homme le pouvoir de dchiffrer cette
illusion : Elle a jet la cl (op. cit., p. 175). Pourtant, cette cl,
Nietzsche pense la possder : c'est le fonctionnement de l'illusion
comme Verstellung. Il importe de conserver le sens de dplacement
ce procd, qui signifie aussi dissimulation, car c'est lui qui
dsigne le secret du fonctionnement non seulement langagier, mais
proprement rhtorique de l'illusion. Nous revenons ainsi la
situation du Cratyle de Platon et l'affrontement dont parle le
dialogue socratique entre une origine naturelle et une origine
conventionnelle des dsignations de choses par les mots.
Nietzsche n'hsite pas : le modle - si l'on ose dire -, c'est le menteur
qui msuse du langage coups de substitutions volontaires et
d'inversions de noms (ibid.). Mais, de mme que le langage
figuratif, dans le texte prcdent, ne pouvait plus tre oppos un
quelconque langage littral, le langage du menteur n'a pas non plus
pour rfrence un langage non mensonger, car le langage est en tant
que tel issu de telles substitutions et inversions
2
.
En quel sens le Cogito cartsien est-il ici vis, au moins oblique-
ment ? En ce sens qu'il ne peut constituer une exception au doute
gnralis, dans la mesure o la mme certitude qui couvre le
j'existe, le j'existe-pensant , la ralit formelle des ides et
finalement leur valeur reprsentative, est frappe par la sorte de
rduction tropologique ici prononce. De mme que le doute de
Descartes procdait de l'indistinction suppose entre le rve et la
veille, celui de Nietzsche procde de findistinction plus hyper-
bolique entre mensonge et vrit. C'est bien pourquoi le Cogito doit
succomber cette version elle-mme hyperbolique du malin gnie,
car, ce que celui-ci ne pouvait inclure, c'tait l'instinct de vrit. Or
c'est lui qui maintenant devient nigmatique . Le malin gnie
s'avre ici plus malin que le Cogito. Quant la philosophie propre
de Nietzsche, ou bien elle s'excepte elle-mme de
1. L'intellect humain est dit appartenir la nature en tant qu'apanage d'un animal
inventeur de l'intelligence : Il n'y a pas pour cet intellect une mission plus vaste qui
dpasserait la vie humaine (Vritet Mensonge, op. cit., p. 171).
2. D'o la dclaration prononce d'un ton solennel : Qu'est-ce donc que la vrit ?
Une multitude mouvante de mtaphores, de mtonymies, d'anthropomor-phismes,
bref, une somme de relations humaines qui ont t potiquement et rh-toriquement
hausses, transposes, ornes, et qui, aprs un long usage, semblent un peuple fermes,
canoniales et contraignantes : les vrits sont des illusions dont on a oubli qu'elles le
sont, des mtaphores qui ont t uses et qui ont perdu leur force sensible, des pices de
monnaie qui ont perdu leur empreinte et qui entrent ds lors en considration, non plus
comme pices de monnaie, mais comme mtal (ibid.. p. 181-183).
PRFACE
ce rgne universel de la Verstellung - mais par quelle ruse sup-
rieure chapperait-elle au sophisme du menteur ? -, ou bien elle y
succombe - mais alors comment justifier le ton de rvlation sur
lequel seront proclams la volont de puissance, le surhomme et le
retour ternel du mme ? Ce dilemme, qui ne parat pas avoir
empch Nietzsche de penser et d'crire, est devenu celui de ses
commentateurs partags en deux camps : les fidles et les ironistes
1
.
Ce qui vient d'tre appel rduction tropologique
2
constitue une
cl fort utile pour interprter la critique frontale du Cogito qui se lit
dans les fragments du Nachlass parpills entre 1882 et 1884
3
. Il va
sans dire que le choix des fragments dont la frappe anli-Cogito est
la plus manifeste, ne lve qu'un coin du voile jet sur ce gigantesque
chantier o la critique du christianisme voisine avec l'laboration
des thmes nigmatiques de la volont de puissance, du surhomme
et de l'ternel retour. Mais la slection svre ici pratique est fidle
mon propos qui est de montrer dans Van-Cogito de Nietzsche
non pas l'inverse du Cogito cartsien, mais la destruction de la
question mme laquelle le Cogito tait cens apporter une rponse
absolue.
En dpit du caractre fragmentaire de ces a^horismes dirigs
contre le Cogito, la constellation qu'ils dessinent permet d'y voir les
rigoureux exercices d'un doute hyperbolique dont Nietzsche
lui-mme serait le malin gnie. Ainsi ce fragment de novembre
1887-mars 1888
4
: Je retiens fich halte] la phnomnalit gale-
ment du monde intrieur : tout ce qui nous devient conscient est
!. Les commentateurs franais se rangent plutt dans le second camp, accompagns
par Paul de Man dans son essai Rhetoric of tropes (in Allgories ofreading, New
Haven. Londres, Yale University Press. 1979, p. 103-118).
2. Dans une tude consacre l'uvre de Nietzsche pour lui-mme, cette rduction
tropologique devrait tre complte par la rduction gnalogique l'uvre dans la
Gnalogie de la morale. On y retrouverait une alliance entre symptomatologie
mdicale et dchiffrement textuel. La critique de la conscience (morale), la fin de cet
ouvrage, donnera l'occasion de rendre justice ce grand texte.
3. Dans la grande dition in-octavo, antrieure l'dition de Colli-Montinari, ces
fragments taient regroups dans la section III d'un ouvrage qui n'a jamais vu le jour
et qui avait t imprudemment plac sous le titre de La Volontdepuissance(trad. fr.
de G. Bianquis. Paris, Gallimard, 1948). Ces fragments sont aujourd'hui replacs dans
leur ordre chronologique dans l'dition savante Colh-Montinari ; trad. fr. : uvres
philosophiques compltes, t. IX XIV, Paris, Gallimard (t. XIV, 1977).
4. Trad. fr. de P. Klossowski. Fragments posthumes, in uvres philosophiques
compltes, op. cit.. t. XIII, p. 248. Dans l'ancienne dition in-octavo. La Volont de
puissance. n 477.
24
25
SOI-MME COMME UN AUTRE
PRFACE
d'un bout l'autre pralablement arrang, simplifi, schmatis,
interprt - le processus rel de la " perception " interne,
Yen-chanement causal entre les penses, les sentiments, les
convoitises, comme celui entre le sujet et l'objet, nous sont
absolument cachs - et peut-tre pure imagination .
Proclamer ainsi la phnomnalit du monde intrieur, c'est
d'abord aligner ce dernier sur le monde dit extrieur, dont la ph-
nomnalit ne signifie aucunement objectivit en un sens kantien,
mais prcisment arrangement, simplification, schmatisation,
interprtation ; pour comprendre ce point, il faut avoir prsente
l'esprit l'attaque contre le positivisme ; l o celui-ci dit : il n'y a que
des faits, Nietzsche dit : les faits, c'est ce qu'il n'y a pas, seulement
des interprtations. En tendant la critique la soi-disant
exprience interne , Nietzsche ruine dans le principe le caractre
d'exception du Cogito l'gard du doute que Descartes dirigeait
contre la distinction entre le monde du rve et celui de la veille.
Assumer la phnomnalit du monde intrieur, c'est en outre aligner
la connexion de l'exprience intime sur la causalit externe,
laquelle est galement une illusion qui dissimule \ejeu des forces
sous l'artifice de l'ordre. C'est encore poser une unit tout fait
arbitraire, cette fiction appele penser, part de la foisonnante
multiplicit des instincts. C'est enfin imaginer un substrat de sujet
dans lequel les actes de pense auraient leur origine. Cette
dernire illusion est la plus perfide, car elle met en action, dans le
rapport entre l'acteur et son faire, la sorte d'inversion entre l'effet et
la cause que nous avons plus haut rapporte au trope de la
mtonymie, sous la figure de la mta-
1. On lira la suite : Ce " monde intrieur apparent " se voit trait selon des
formes et des procdures absolument identiques celles dont on traite le monde "
extrieur ". Nous ne rencontrons jamais de " faits " : plaisir et dplaisir ne sont que
des phnomnes tardifs et drivs de l'intellect... La "causalit" nous chappe ;
admettre entre les penses un lien originaire immdiat comme le fait la logique -
voil la consquence de l'observation la plus grossire et la plus balourde. Entre
deux penses tous les affects possibles mnent encore leur jeu : mais leurs
mouvements sont trop rapides pour ne pas les mconnatre, c'est pourquoi nous les
nions... " Penser ", tel que le supposent les thoriciens de la connaissance, ne se
produit seulement pas : c'est l une fiction tout fait arbitraire, obtenue par le
dgagement d'un lment unique hors du processus et la soustraction de tout le reste,
un arrangement artificiel aux fins de la comprhensibilit... " L'esprit ", quelque
chose qui pense : et pourquoi pas mme " l'esprit absolu, pur " - cette conception est
une seconde consquence drive de la fausse observation de soi, laquelle croit au
fait de " penser " ; ici est imagin pour la premire fois un acte qui ne se produit
gure, " le penser ", et secondement imagin un substrat de sujet dans lequel tout
acte de ce penser et rien d'autre a son origine : c'est--dire autant le taire que
l'acteur sont des fictions (ibid., p. 248).
lepsis. C'est ainsi que nous tenons pour cause, sous le titre du je,
ce qui est l'effet de son propre effet. L'argument ne fonctionne
videmment que si on introduit la causalit, donc une certaine
discursivit, sous la soi-disant certitude immdiate du Cogito. Dans
l'exercice du doute hyperbolique, que Nietzsche porte la limite, le
je n'apparat pas comme inhrent au Cogito, mais comme une
interprtation de type causal. Nous rejoignons ici notre argument
tropologique antrieur: en effet, placer une substance sous le Cogito
ou une cause derrire lui, ce n'est l qu'une simple habitude
grammaticale, celle d'adjoindre un agent chaque action. On
retombe sur Finversion des mots , dnonce vingt ans plus tt.
Je n'insiste pas davantage sur ces arguments o il ne faut rien voir
d'autre, mon avis, qu'un exercice de doute hyperbolique pouss
plus loin que celui de Descartes, retourn contre la certitude mme
que celui-ci pensait pouvoir soustraire au doute. Nietzsche ne dit
pas autre chose, dans ces fragments du moins, que ceci : je doute
mieux que Descartes. Le Cogito aussi est douteux. C'est sur ce mode
hyperbolique que je comprends des formules telles que celles-ci :
mon hypothse, le sujet comme multiplicit. Nietzsche ne dit pas
dogmatiquement - quoiqu'il arrive aussi qu'il le fasse - que le sujet
est multiplicit : il essaie cette ide ; il joue en quelque sorte avec
l'ide d'une multiplicit de sujets luttant entre eux, comme autant de
cellules en rbellion contre l'instance dirigeante. Il atteste ainsi
que rien ne rsiste l'hypothse la plus fantastique, aussi longtemps
du moins qu'on reste l'intrieur de la problmatique dlimite par
la recherche d'une certitude qui garantirait absolument contre le
doute.
3, Vers une hermneutique du soi
Sujet exalt, sujet humili : c'est toujours, semble-t-il, par untel
renversement du pour au contre qu'on s'approche du sujet ; d'o il
faudrait conclure que le je des philosophies du sujet est ato-pos,
sans place assure dans le discours. Dans quelle mesure peut-on
dire de l'hermneutique du soi ici mise en uvre qu'elle occupe un
lieu pistmique (et ontologique, comme on dira dans la dixime
tude) situ au-del de cette alternative du cogito et de Yanti-cogito
?
Un survol rapide des neuf tudes qui constituent proprement
l'hermneutique du soi peut donner au lecteur une ide sommaire
26
27
SOI-MME COMME UN AUTRE
PRFACE
de la faon dont le discours philosophique rpond au niveau
conceptuel aux trois traits grammaticaux voqus plus haut,
savoir l'usage du se et du soi en cas obliques, le ddoublement du
mme selon le rgime de Vident et de Vipse, la corrlation entre soi
et l'autre que soi. A ces trois traits grammaticaux correspondent les
trois traits majeurs de l'hermneutique du soi, savoir : le dtour de
la rflexion par l'analyse, ia dialectique de l'ipsit et de la mmet,
celle enfin de l'ipsit et de l'altrit. Ces trois traits de
l'hermneutique seront progressivement dcouverts, selon l'ordre
o ils viennent d'tre numrs, dans la suite des tudes qui
composent cet ouvrage. On donnera une forme interrogative cette
perspective, en introduisant par la question qui ? toutes les
assertions relatives la problmatique du soi, en donnant ainsi
mme amplitude la question qui ? et la rponse - soi. Quatre
sous-ensembles correspondent ainsi quatre manires d'interroger :
qui parle ? qui agit ? qui se raconte ? qui est le sujet moral
d'imputation ? Dtaillons.
Le premier sous-ensemble (tudes i et H) relve d'une philosophie
du langage, sous le double aspect d'une smantique et d'une
pragmatique. Ds ces premires tudes, le lecteur sera confront
une tentative pour enrler l'hermneutique du soi, hritire comme
on l'a vu de dbats internes la philosophie europenne - appele
drlement continentale par les hritiers d'une philosophie qui fut
d'abord... insulaire -, des fragments significatifs de la philosophie
analytique de langue anglaise. Ces emprunts, qui se poursuivront
dans le deuxime et le troisime sous-ensemble, ne sont pas
arbitraires ; ils ne rsultent d'aucune volont a priori d'acculturer
mutuellement deux traditions largement trangres l'une l'autre ;
encore moins trahissent-elles quelque ambition maniaque de
mariage forc entre deux familles d'esprit qui se sont peu
frquentes. Le recours l'analyse, au sens donn ce terme par la
philosophie analytique, est le prix payer pour une hermneutique
caractrise par le statut indirect de la position du soi. Par ce
premier trait, l'hermneutique se rvle tre une philosophie du
dtour : le dtour par la philosophie analytique m'a paru tout
simplement le plus riche de promesses et de rsultats. Mais c'est
bien la question qui ? que revient l'impulsion. Question qui se
divise en deux questions jumelles : de qui parle-t-on quand on
dsigne sur le mode rfrentiel la personne en tant que distincte des
choses ? Et qui parle en se dsignant soi-mme comme locuteur
(adressant la parole un interlocuteur) ?
Le deuxime sous-ensemble (tudes m et iv) relve d'une philo-
sophie de l'action, au sens limit que le terme a pris principalement
en philosophie analytique. Ce sous-ensemble est dans un rapport
complexe avec le prcdent ; en un sens, celui-ci sert d'or-ganon,
dans la mesure o c'est dans des noncs, donc des propositions,
singulirement sur la base de verbes et de phrases d'action, qu'il est
parl de l'action, et o c'est dans des actes de discours que l'agent de
l'action se dsigne comme celui qui agit. En un autre sens, le second
sous-ensemble s'annexe le premier, dans la mesure o les actes de
discours sont eux-mmes des actions et o, par implication, les
locuteurs sont aussi des agissants. La question qui parle ?et la
question qui agit ? apparatront ainsi troitement entrelaces. Ici
encore, le lecteur sera invit participer une confrontation
constructive entre philosophie analytique et hermneutique. C'est en
effet la thorie analytique de l'action qui rgira le grand dtour par la
question quoi ? et la question pourquoi ?, quitte ne pouvoir
accompagner jusqu'au bout le mouvement de retour vers la question
qui ? - qui est l'agent de l'action ? Rptons que ces longues boucles
de l'analyse sont caractristiques du style indirect d'une
hermneutique du soi, l'inverse de la revendication d'immdiatet
du Cogito.
Cette sorte de concurrence entre philosophie analytique et her-
mneutique se continue dans le troisime sous-ensemble (tudes v et
vi), o la question de Videntit personnelle se pose au point
d'intersection des deux traditions philosophiques. La question de
l'identit, lie celle de la temporalit, sera reprise au point o
l'avait laisse Temps et Rcit III sous le titre de l' identit narrative
, mais avec des ressources nouvelles procures par l'analyse de
l'identit personnelle en fonction de critres objectifs d'identi-
fication. Ce que nous venons d'appeler la concurrence entre deux
traditions philosophiques sera soumise l'arbitrage de la dialectique
entre l'identit-te/n et l'identit-/p.se, dont nous avons fait, avec le
caractre rflchi du soi, le second trait grammatical du soi-mme'.
A la faveur de ce dveloppement nouveau du thme de l'identit
narrative, le concept d'action - dont, rappelons-le, le rcit est la
mimsis - recouvrera l'amplitude de sens que pouvait avoir le
concept aristotlicien de praxis, rencontre des dlimitations
drastiques - mais justifies par le propos de l'analyse - auxquelles la
smantique de l'action aura soumis l'agir humain dans le
sous-ensemble prcdent. En mme temps, et corrlativement, le
sujet de l'action raconte commencera s'galer au concept le plus
large de l'homme agissant et souffrant que notre procdure
analytico-hermneutique est capable de dgager.
28
29
SOI-MME COMME UN AUTRE
Il reviendra au quatrime sous-ensemble (tudes vu, vin et ix) de
proposer un dernier dtour par les dterminations thiques et
morales de l'action, rapportes respectivement aux catgories du
bon et de Y obligatoire. Ainsi seront portes au jour les dimensions
elles-mmes thiques et morales d'un sujet qui l'action, bonne ou
non, faite par devoir ou non, peut tre impute. Si la premire et la
seconde tudes ont t les premires mettre en uvre le procs de
l'analyse et de la rflexion, et si les cinquime et sixime tudes ont
mis l'accent principal sur l'opposition entre ipsit et mmet, c'est
dans les trois tudes thiques que la dialectique du mme et de
Vautre trouvera son dveloppement philosophique appropri. A
vrai dire, la dialectique du soi-mme et de Vautre n'aura pas fait
dfaut aux tudes prcdentes, ni d'ailleurs celle de Vipse et de
Videm. A aucune tape, le soi n'aura t spar de son autre. Il reste
que cette dialectique, la plus riche de toutes, comme le titre de cet
ouvrage le rappelle, ne trouvera son plein dploiement que dans les
tudes places sous le signe de l'thique et de la morale.
L'autonomie du soi y apparatra intimement lie la sollicitude pour
le proche et \a justice pour chaque homme.
Le survol qu'on vient de proposer des tudes qui composent cet
ouvrage donne une premire ide de l'cart qui spare l'herm-
neutique du soi des philosophies du Cogito. Dire soi, ce n'est pas
dire je,. Le je se pose - ou est dpos. Le soi est impliqu titre
rflchi dans des oprations dont l'analyse prcde le retour vers
lui-mme. Sur cette dialectique de l'analyse et de la rflexion se
greffe celle de Vipse et de Videm. Enfin, la dialectique du mme et
de l'autre couronne les deux premires dialectiques. On conclura
cette prface en soulignant encore deux traits qui s'opposent dia-
mtralement, non plus seulement Vimmdiatet du je suis, mais
l'ambition de le placer dans la position du fondement dernier. Il est
possible d'introduire sommairement ces deux traits compl-
mentaires en compltant la vue perspective qu'on vient d'esquisser.
Le premier trait concerne le caractre fragmentaire de la srie de
nos tudes. Il rcuse la thse de la simplicit indcomposable du
Cogito. qui s'ajoute celle de son immdiatet. On verra qu'il
rcuse la thse de la simplicit rflexive sans cder pour autant au
vertige de la dissociation du soi poursuivie avec acharnement par la
dconstruction nietzschenne. Examinons donc avec soin les deux
aspects de la contestation.
Le caractre fragmentaire de nos tudes procde de la structure
analytique-rflexive qui impose notre hermneutique des dtours
laborieux dans lesquels nous allons nous engager ds la
PRFACE
premire tude. En introduisant la problmatique du soi par la
question qui ?, nous avons du mme mouvement ouvert le champ
une vritable polysmie inhrente cette question mme : qui parle
de quoi ? qui fait quoi ? de qui et de quoi fait-on rcit ? qui est
moralement responsable de quoi ? Autant de manires diverses dont
se dit le qui ? Or ces manires diverses de poser la question qui ?
n'chappent pas une certaine contingence du questionnement,
contingence lie celle des dcoupages que proposent
conjointement la grammaire des langues naturelles (on en a donn
un exemple ds les premires lignes de cette prface), l'usage du
discours ordinaire, enfin le surgissement du questionnement
philosophique au cours de l'histoire. L'hermneutique est ici livre
l'historicit du questionnement, d'o rsulte la fragmentation de l'art
de questionner
1
.
En revanche, cette fragmentation n'est pas telle que nulle unit
thmatique ne la garde de la dissmination qui reconduirait le
discours au silence. En un sens, on peut dire que l'ensemble de ces
tudes a pour unit thmatique Vagir humain, et que la notion
d'action acquiert, au fil des tudes, une extension et une concrtion
sans cesse croissantes. Dans cette mesure, la philosophie qui se
dgage de l'ouvrage mriterait d'tre appele philosophie pratique et
d'tre reue comme philosophie seconde , au sens que Manfred
Riedel donne ce terme
2
, aprs l'chec du Cogito se constituer en
philosophie premire et rsoudre la question du fondement
dernier. Mais l'unit que le souci de l'agir humain confre
l'ensemble de nos tudes n'est pas celle qu'un fondement ultime
confrerait une srie de disciplines drives. Il s'agit plutt d'une
unit seulement analogique entre des acceptions multiples du terme
agir, dont la polysmie est impose, comme on vient de le dire, par
la varit et la contingence des questions qui mettent en mouvement
les analyses reconduisant la rflexion sur soi
3
.
1. Cette fragmentation justifie que le titre d'tude ait t prfr celui de cha
pitre, tant il est vrai que chacune de nos investigations constitue une partie totale,
autorisant la limite le lecteur entrer dans notre cheminement n'importe quel
stade.
2. M. Riedel, Fur eine zweite Philosophie. Vorlrge und Abhandlungen, Francfort.
Suhrkamp, 1988.
3. En introduisant ici le terme d'unit analogique, je fais allusion au problme
pos par la suite des catgories de l'tre chez Aristote et l'interprtation que les
scolastiques ont donne de la rfrence de la srie entire un terme premier (pros
hen) qui serait Vousia. traduit en latin par suhsianlia. C'est, bien entendu, un autre
champ problmatique que nous appliquons le terme d'unit analogique. On y
reviendra dans la dixime tude.
30
31
SOI-MME COMME UN AUTRE
Parler seulement d'unit analogique, c'est encore trop dire, dans la
mesure o l'on peut hsiter sur le choix du terme premier ou unique
de rfrence. Le sens premier de l'agir humain consiste-t-il dans
l'autodsignation d'un sujet parlant ? Ou dans la puissance de faire
de l'agent de l'action ? Ou dans l'imputation morale de l'action ?
Chacune de ces rponses a son bon droit. On objectera qu'il nous
arrivera chemin faisant de surimposer la diversit de nos tudes
sur l'agir le rythme ternaire : dcrire, raconter, prescrire. Comme
on le verra le moment venu, ce ternaire permet d'assigner
l'approche narrative - qui, dans Temps et Rcit III, plaait la notion
d'identit narrative sur une sorte de sommet - une fonction de
transition et de liaison entre la description qui prvaut dans les
philosophies analytiques de l'action, et la prescription qui dsigne
d'un terme gnrique toutes les dterminations de l'action partir
des prdicats bon et obligatoire. Mais cette mise en ordre n'a
gure plus qu'une fonction didactique visant guider le lecteur dans
la traverse de la polysmie de l'agir. Cette fonction didactique
n'empche pas que, suivant la question pose, le ternaire se lise dans
un ordre diffrent. Aucune approche n'est premire tous gards.
La perplexit cre par ce style fragmentaire n'est aucunement
leve dans l'tude terminale dont je n'ai encore rien dit et dont je
souligne ds maintenant le caractre exploratoire. Dans cette tude,
de style ontologique, c'est bien l'unit analogique de l'agir humain
qui est en question. On se demande si, pour traiter l'agir humain
comme un mode d'tre fondamental, l'hermneutique peut
s'autoriser de ressources des ontologies du pass qui seraient en
quelque sorte rveilles, libres, rgnres son contact. On se
demandera principalement si la grande polysmie du terme tre ,
selon Aristote, permet de revaloriser la signification de l'tre en tant
qu'acte et puissance, gageant ainsi l'unit analogique de l'agir sur
une signification ontologique stable. Mais, prcisment, cette
rvaluation d'une signification de l'tre, trop souvent sacrifie
l'tre-substance, ne peut se faire que sur le fond d'une pluralit plus
radicale que toute autre, savoir celle des significations de l'tre. En
outre, il apparatra trs vite que l'ontologie de l'acte et de la
puissance ouvre son tour un espace de variations de sens difficile
fixer travers ses expressions historiques multiples. Enfin, et
surtout, la dialectique du mme et de l'autre, rajuste la mesure de
notre hermneutique du soi-mme et de son autre, empchera une
ontologie de l'acte et de la puissance de s'enfermer dans la
tautologie. La polysmie de l'alt-
32
PRFACE
rite, que nous proposerons dans la dixime tude, imprimera toute
l'ontologie de l'agir le sceau de la diversit de sens qui met en
droute l'ambition de fondation dernire caractristique des
philosophies du Cogito.
Un dernier trait va creuser l'cart entre notre hermneutique et les
philosophies du Cogito. Il concerne le type de certitude auquel la
premire peut prtendre et qui la diffrencie de manire dcisive de
celle qui s'attache la prtention d'autofondation des secondes. On
verra poindre lentement au cours des premires tudes, puis prendre
vigueur dans les tudes mdianes, enfin s'panouir pleinement dans
les dernires tudes, la notion d'attestation par laquelle nous
entendons caractriser le mode althique (ou vritatif) du style
appropri la conjonction de l'analyse et de la rflexion, la
reconnaissance de la diffrence entre ipsit et mmet, et au
dploiement de la dialectique du soi et de l'autre -bref, appropri
l'hermneutique du soi considre dans sa triple membrure.
L'attestation dfinit nos yeux la sorte de certitude laquelle peut
prtendre l'hermneutique, non pas seulement au regard de
l'exaltation pistmique du Cogito partir de Descartes, mais encore
au regard de son humiliation chez Nietzsche et ses successeurs.
L'attestation parat exiger moins que l'une et plus que l'autre. En fait,
compare l'une et l'autre, elle aussi est proprement atopos.
D'une part, en effet, l'attestation s'oppose plus la certitude que
revendique le Cogito qu'au critre de vrification des savoirs
objectifs. Le dtour par l'analyse impose prcisment le mode
indirect et fragmentaire de tout retour au soi. En ce sens, la vrifi-
cation est incluse dans le procs rflexif comme un moment
pistmique ncessaire. C'est fondamentalement la notion
"pislm, de science, prise au sens de savoir dernier et auto-
fondateur. que l'attestation s'oppose. Et c'est dans cette opposition
qu'elle parat exiger moins que la certitude attache la fondation
dernire. L'attestation, en effet, se prsente d'abord comme une sorte
de croyance. Mais ce n'est pas une croyance doxique, au sens o la
doxa - la croyance - a moins de titre que Vpistm - la science, ou
mieux le savoir. Alors que la croyance doxique s'inscrit dans la
grammaire du je crois-que , l'attestation relve de celle du je
crois-en . Par l elle se rapproche du tmoignage, comme
l'tymologie le rappelle, dans la mesure o c'est en la parole du
tmoin que l'on croit. De la croyance ou, si l'on prfre, de la
crance qui s'attache la triple dialectique de la rflexion et de
l'analyse, de l'ipsit et de la mmet, du soi-
33
SOI-MME COMME UN AUTRE PRFACE
mme et de l'autre que soi-mme, on ne peut en appeler aucune
instance pistmique plus leve.
On pourrait objecter cette premire approche de l'attestation
qu'elle s'loigne moins qu'il ne parat de la certitude du Cogito :
l'hyperbole du malin gnie n'a-t-elle pas situ la problmatique de la
premire vrit dans la dimension de la tromperie et de la vracit ?
Et n'est-ce pas sur le Dieu vrace que se fonde tout l'difice cartsien
du savoir ? Cela est bien vrai : en ce sens, la problmatique de
l'attestation trouve une de ses sources dans la problmatique
cartsienne du Dieu trompeur. Mais ce que ne revendique pas pour
elle-mme l'attestation, c'est le caractre de garantie, attach au
Cogito par l'intermdiaire de la dmonstration prtendue de
l'existence de Dieu, garantie qui finalement rsorbe la vracit dans
la vrit, au sens fort de savoir thortique auto-fondateur. A cet
gard, l'attestation manque de cette garantie et de l'hypercertitude
attache cette dernire. Les autres traits de l'hermneutique
voque un peu plus haut confirment l'infirmit de l'attestation au
regard de toute prtention la fondation dernire : la fragmentation
qui fait suite la polysmie de la question qui ?, la contingence du
questionnement lui-mme rsultant, rptons-le, tant de l'histoire
des systmes philosophiques que de la grammaire des langues
naturelles et de l'usage du discours ordinaire - pour ne rien dire du
caractre bien souvent aportique de maintes analyses venir -,
confrent l'attestation une fragilit spcifique quoi s'ajoute la
vulnrabilit d'un discours conscient de son dfaut de fondation.
Cette vulnrabilit s'exprimera dans la menace permanente du
soupon, tant entendu que le soupon est le contraire spcifique de
Y attestation. La parent entre attestation et tmoignage se vrifie ici
: il n'y a pas de vrai tmoin sans faux tmoin. Mais il n'y a pas
d'autre recours contre le faux tmoignage qu'un autre tmoignage
plus crdible ; et il n'y a pas d'autre recours contre le soupon qu'une
attestation plus fiable.
D'autre part - et l'attestation fait maintenant face sur le front
oppos du Cogito humili -, la crance est aussi (et, devrions-nous
dire, nanmoins) une espce de confiance, comme l'expression d'
attestation fiable vient l'instant de le suggrer. Crance est aussi
fiance. Ce sera un des leitmotive de notre analyse : l'attestation est
fondamentalement attestation de soi. Cette confiance sera tour
tour confiance dans le pouvoir de dire, dans le pouvoir de faire,
dans le pouvoir de se reconnatre personnage de rcit, dans le
pouvoir enfin de rpondre l'accusation par
l'accusatif: me voici ! selon une expression chre Lvinas. A ce
stade, l'attestation sera celle de ce qu'on appelle communment
conscience morale et qui se dit prcisment en allemand Gewissen
(mieux que le terme franais de conscience, qui traduit galement
Bewusstsein et Gewissen, le Gewissen allemand rappelle sa parent
smantique avec la Gewissheit ou certitude). Et, si l'on admet que la
problmatique de l'agir constitue l'unit analogique sous laquelle se
rassemblent toutes nos investigations, l'attestation peut se dfinir
comme Vassurance d'tre soi-mme agissant et souffrant. Cette
assurance demeure l'ultime recours contre tout soupon ; mme si
elle est toujours en quelque faon reue d'un autre, elle demeure
attestation de soi. C'est l'attestation de soi qui, tous les niveaux -
linguistique, praxique, narratif, prescrip-tif -. prservera la question
qui ? de se laisser remplacer par la question quoi ? ou la question
pourquoi ? Inversement, au creux dpressif de l'aporie, seule la
persistance de la question qui ?, en quelque sorte mise nu par le
dfaut de rponse, se rvlera comme le refuge imprenable de
l'attestation.
En tant que crance sans garantie, mais aussi en tant que
confiance plus forte que tout soupon, l'hermneutique du soi peut
prtendre se tenir gale distance du Cogito exalt par Descartes et
du Cogito proclam dchu par Nietzsche. Le lecteur jugera si les
investigations qui suivent justifient cette ambition.
*
Je dois mes lecteurs d'expliquer pourquoi j'ai renonc inclure
dans le prsent ouvrage les deux confrences jumelles qui
terminaient la srie originale des Gifford Lectures prononces
Edimbourg en 1986. Ces confrences relevaient de l'hermneutique
biblique dont j'expose le projet dans Du texte l'action*. Dans la
premire, intitule Le soi dans le miroir des critures , je
m'interrogeais, la faon de N. Frye dans Le Grand Code
1
, sur la
sorte d'instruction et d'interpellation manant du rseau symbolique
tiss par les critures bibliques, juive et chrtienne. L'accent
principal tait mis sur la nomination de Dieu , qui. travers une
grande varit de genres littraires, distingue la dimension
krygmatique de ces Ecritures de la dimension argu-mentative de la
philosophie, l'intrieur mme de la dimension
1. P. Ricur, Du texte l'action. Paris, d. du Seuil, 1986.
2. N. Frye. LeGrand Code. La Bibleet la littrature, prface de T. Todorov, trad. fr.
de C. Malamoud, Pans, d. du Seuil, 1984.
34 35
SOI-MME COMME UN AUTRE
PRFACE
potique dont elle relve. Dans la seconde confrence, intitule Le
soi mandat ' , prenant pour guide les rcits de vocation de
prophtes et de disciples dans l'Un et l'Autre Testament (pour
reprendre l'heureuse expression propose par Paul Beauchamp
2
),
j'explorais les traits par lesquels la comprhension de soi-mme
rpondait le mieux l'instruction, l'interpellation, qui sollicitent le
soi la faon d'un appel sans contrainte. Le rapport entre appel et
rponse tait ainsi le lien fort qui faisait tenir ensemble ces deux
confrences que j'ai dites jumelles.
Pourquoi, alors, ne les ai-je pas conserves dans cet ouvrage qui
constitue par ailleurs une version dveloppe des Gifford Lectures
originales ? Je ne m'arrterai pas l'argument technique allguant
l'allongement excessif d'un ouvrage dj volumineux, quoique cette
considration ait jou un rle important dans ma dcision.
La premire raison de cette exclusion, que je sais discutable et
peut-tre regrettable, tient au souci que j'ai eu de tenir, jusqu' la
dernire ligne, un discours philosophique autonome. Les dix tudes
qui composent cet ouvrage supposent la mise entre parenthses,
consciente et rsolue, des convictions qui me rattachent la foi
biblique. Je ne prtends pas qu'au niveau profond des motivations
ces convictions soient restes sans effet sur l'intrt que je porte
tel ou tel problme, voire mme l'ensemble de la problmatique
du soi
3
. Mais je pense n'avoir offert mes lecteurs que des
arguments qui n'engagent pas la position du lecteur, que celle-ci
soit de rejet, d'acceptation ou de mise en suspens, l'gard de la foi
biblique. On observera que cet asctisme de l'argument, qui
marque, je crois, toute mon uvre philosophique, conduit un type
de philosophie dont la nomination effective de Dieu est absente et
o la question de Dieu, en tant que question philosophique, reste
elle-mme tenue dans un suspens qu'on peut dire agnostique,
comme en tmoignent les dernires lignes de la dixime tude. C'est
pour ne pas faire exception ce suspens que le seul prolongement
donn aux neuf tudes relevant express-
1. Cette confrence peut tre lue dans la Revue de l'Institut catholique de Paris,
octobre-dcembre 1988, p. 88-89, sous le titre Le sujet convoqu. A l'cole des
rcits de vocation prophtique .
2. Paul Beauchamp, L'Un et l'Autre Testament. Essai de lecture, Paris, d. du
Seuil, 1977.
3. Je ne clerai pas la sorte d'enchantement dans lequel me tient cette citation de
Bernanos, qui figure la fin du Journal d'un cur de campagne : Il est plus facile
que l'on croit de se har. La grce est de s'oublier. Mais, si tout orgueil tait mort en
nous, la grce des grces serait de s'aimer humblement soi-mme, comme n'importe
lequel des membres souffrants de Jsus-Christ
ment d'une phnomnologie hermneutique consiste dans une
investigation ontologique qui ne prte aucun amalgame
onto-thologique.
A cette raison principale, j'aimerais en ajouter une autre, qui tient
au rapport que les exercices d'exgse biblique, sur lesquels se
fonde mon interprtation du Grand Code, entretiennent avec les
tudes ici rassembles. Si je dfends mes crits philosophiques
contre l'accusation de crypto-thologie, je me garde, avec une
vigilance gale, d'assigner la foi biblique une fonction
crypto-philosophique, ce qui serait assurment le cas si on attendait
d'elle qu'elle apporte une solution dfinitive aux apories que la
philosophie multiplie l'occasion principalement du statut de
l'identit-/;?, aux plans pratique, narratif, thique et moral.
11 faut dire, d'abord, qu'entre la philosophie et la foi biblique le
schma question-rponse ne vaut pas. Si la confrence sur le soi
mandat met en jeu la notion de rponse, celle-ci n'y est pas mise
en face de la notion de question, mais de celle d'appel : une chose
est de rpondre une question, au sens de rsoudre un problme
pos, une autre de rpondre un appel, au sens de correspondre la
manire d'exister propose par le Grand Code .
Ensuite, il faut affirmer que, mme au plan thique et moral, la foi
biblique n'ajoute rien aux prdicats bon et obligatoire
appliqus l'action. L'agapc biblique relve d'une conomie du don
de caractre mta-thique, qui me fait dire qu'il n'existe pas de
morale chrtienne, sinon au plan de l'histoire des mentalits. mais
une morale commune (celle que j'essaie d'articuler dans les trois
tudes consacres l'thique, la morale et la sagesse pratique)
que la foi biblique place dans une perspective nouvelle, o l'amour
est li la nomination de Dieu . C'est en ce sens que Pascal
assignait la charit un ordre transcendant celui des corps et
celui des esprits pris ensemble. Qu'une dialectique de l'amour et de
la justice en rsulte, cela mme prsuppose que chacun des termes
conserve son allgeance l'ordre duquel il relve. En ce sens, les
analyses que je propose des dterminations thiques et morales de
l'action sont confirmes dans leur autonomie par une mditation
greffe sur la potique de Vagap que les analyses du prsent
ouvrage laissent volontairement entre parenthses.
Enfin - et peut-tre surtout -, si, sous le titre du soi mandat et
rpondant , les dterminations du soi parcourues dans le prsent
ouvrage se retrouvent la fois intensifies et transformes par la
rcapitulation que la foi biblique en propose -
36
37
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
cette rcapitulation ne constitue nullement une revanche sournoise de
l'ambition de fondation dernire que notre philosophie hermneutique
ne cesse de combattre. La rfrence de la foi biblique un rseau
symbolique culturellement contingent fait que cette foi doit assumer sa
propre inscurit qui fait d'elle, au mieux, un hasard transform en
destin travers un choix constamment renouvel, dans le respect
scrupuleux des choix adverses. La dpendance du soi une parole qui le
dpouille de sa gloire, tout en confortant son courage d'exister, dlivre
la foi biblique de la tentation, que j'appelle ici crypto-philosophique, de
tenir le rle dsormais vacant de fondation ultime. En retour, une foi qui
se sait sans garantie, selon l'interprtation qu'en donne le thologien
luthrien E. Jingel dans Dieu le mystre du monde
1
, peut aider
l'hermneutique philosophique se garder de Yhubris qui la ferait se
poser en hritire des philosophies du Cogito et de leur ambition
d'autofondation ultime.
En cela le prsent travail se reconnat appartenir ce que Jean
Greisch dnomme l'ge hermneutique de la raison
2
.
1. E. Jngel, Dieu le. mystredu monde, 2 vol., Paris, d. du Cerf, 1983.
2. Jean Greisch, L'gehermneutiquedela raison, Paris, d. du Cerf, 1985.
PREMIRE TUDE
La personne et la rfrence
identifiante
Approche smantique
Dans cette premire tude, nous partirons du sens le plus pauvre
susceptible d'tre attach la notion $ identification. Identifier quelque
chose, c'est pouvoir faire connatre autrui, au sein d'une gamme de
choses particulires du mme type, celle dont nous avons l'intention de
parler. C'est sur ce trajet de la rfrence identifiante que nous
rencontrons pour la premire fois la personne, en un sens trs pauvre du
mot qui distingue globalement cette entit des corps physiques.
Identifier, ce stade lmentaire, ce n'est pas encore s'identifier
soi-mme, mais identifier quelque chose .
1. Individu et individualisation
Que la personne soit d'abord une des choses que nous distinguons par
rfrence identifiante, nous allons l'tablir par une enqute pralable
applique aux procdures par lesquelles nous individualisons un quelque
chose en gnral, et le tenons pour un chantillon indivisible l'intrieur
d'une espce
1
. Le langage, en effet, est ainsi fait qu'il ne nous laisse pas
enferms dans l'alternative, longtemps professe par Bergson : ou bien le
conceptuel, ou
1. Je propose le terme individualisation plutt qu' identification , plus
familier en anglais qu'en franais, pour dsigner la procdure. Aussi bien Peter
Strawson, qui nous ferons un large crdit dans la seconde partie de cette tude,
titre Individuals (Londres, Methuen and Co, 1957; trad. fr. d'A. Shalom et P.
Drong. Les Individus, Paris, d. du Seuil, 1973 ; les rfrences entre crochets ren-
voient la pagination originale indique dans l'dition franaise) son ouvrage
consacr l'identification des particuliers. Je saisis l'occasion pour dire ici ma
dette l'gard de l'ouvrage de J.-C. Pariente, LeLangageet 1 Individuel, Paris,
A. Colin, 1973.
39
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
bien l'ineffable. Le langage comporte des montages spcifiques qui
nous mettent en mesure de dsigner des individus. Si toutefois nous
prfrons parler d'individualisation plutt que d'individu, c'est pour
marquer le fait que l'assignation des individualits peut partir, suivant
les ressources lexicales diffrentes des langues naturelles, de degrs trs
variables de spcification : telle langue spcifie plus finement que telle
autre dans tel domaine, et cela selon l'empirique des langues naturelles ;
ce qui est commun toutes, c'est l'individualisation, l'opration plutt
que le rsultat.
L'individualisation peut tre caractrise, en gros, comme le procs
inverse de celui de la classification, lequel abolit les singularits au profit
du concept. Mais, si nous mettons l'accent principal sur l'adjectif
inverse , nous soulignons seulement deux traits ngatifs de l'individu,
savoir qu'il soit un chantillon non rptable et de plus non indivisible
sans altration ; ces ngations nous ramnent en effet du ct de
l'ineffable. Or, ce n'est pas parce que le mouvement est inverse ' que le
langage est dmuni, comme s'il s'puisait classer et caractriser par
prdicats. La vise individualisante commence l o s'arrtent
classification et prdication, mais prend appui sur ces oprations et,
comme on le verra, les relance. On n'individualise que si on a
conceptualis et individualis en vue de dcrire davantage. C'est parce
que nous pensons et parlons par concepts que le langage doit en quelque
manire rparer la perte que consomme la conceptualisation. Mais il
n'use pas cet effet des mmes procdures que celles par lesquelles il
conceptualise, savoir la prdication. Quelles sont ces procdures ?
Logiciens et pistmologues regroupent sous le titre commun
d'oprateurs d'individualisation des procdures aussi diffrentes que les
descriptions dfinies - le premier homme qui a march sur la lune,
l'inventeur de l'imprimerie, etc. -, les noms propres -Socrate, Paris, la
Lune -, les indicateurs - je, tu, ceci, ici, maintenant. Soulignons que, ce
stade de notre investigation, l'individu humain n'a de privilge dans
aucune des trois classes d'oprateurs d'individualisation, mme dans
celle des indicateurs, comme on le verra l'instant. Dsigner un
individu et un seul, telle est la vise individualisante. Le privilge de
l'individu humain dans le choix des exemples - le premier homme
qui... ;
I. Caractriser l'individualisation comme l'inverse de la spcification, c'est se
dtourner de la direction ouverte par Leibniz et sa caractristique universelle
(cf. J.-C. Pariente. op. cit.. p. 48 sq. ; P. Strawson, op. cit.. p. 131 (117) sq.).
40
LA PERSONNE ET LA RFRENCE IDENTIFIANTE
Socrate, je-tu - vient de ce que nous sommes particulirement intresss
individualiser les agents de discours et d'actions ; nous le faisons en
projetant le bnfice des tapes ultrieures du procs d'identification,
dont nous parlerons dans les tudes suivantes, sur la premire tape
ici considre.
Un mot sur chacune des trois catgories d'oprateurs. La description
dfinie consiste crer une classe un seul membre, par intersection de
quelques classes bien choisies (homme, marcher, lune). Les logiciens se
sont intresss ce procd pour deux raisons : parce qu'il parat tre en
continuit avec la classification et la prdication, et parce qu'il parat
encourager la construction d'un langage sans noms propres ni
indicateurs (pronoms personnels et dictiques), si toutefois on pouvait y
ramener les autres oprateurs. En effet, on peut construire un tel langage
comme Quine et d'autres l'on tent. Mais ce n'est pas l, dit fortement
Pariente, un langage qui puisse tre parl dans une situation concrte
d'interlocution ; c'est une langue artificielle qui ne peut tre qu'crite et
lue. A cet gard, si les descriptions dfinies recourent des procds de
classification et de prdication, c'est dans une autre vise qui n'est plus
de classer mais d'opposer un membre d'une classe tous les autres.
Voil l'altrit minimum requise : cet lment de la classe, mais pas le
reste de la classe. Un seul oppos tous les autres. En ce sens, la vise des
descriptions dfinies est bien ostensive, mme si le procd est encore
prdica-tif.
Quant aux noms propres, ils se bornent singulariser une entit non
rptable et non divisible sans la caractriser, sans la signifier au plan
prdicatif, donc sans donner sur elle aucune information '. Au point de
vue purement logique, abstraction faite du rle de l'appellation dans la
dnomination des individus (rle sur lequel on reviendra plus loin),
la dnomination singulire consiste faire correspondre une
dsignation permanente au caractre non rptable et indivisible d'une
entit, quelles que soient ses occurrences. Le mme individu est dsign
du mme nom. Comment ? Sans autre moyen que l'assignation de la
mme chane phonique au mme individu dans toutes ses occurrences.
Dira-t-on qu'il n'y a pas de rapport entre les deux termes de la relation
biunivoque ? Mais, prcisment, la dsignation la fois
1. Pour la smantique issue de Frege, les noms propres logiques dsignent des
tres rels. Socrate est le nom de Socrate rel. Le nom est ainsi une tiquette
qui colle la chose. On examinera plus loin le problme pos par les noms propres
d'tres fictifs : Hamlet, Raskolnikov...
41
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
singulire et permanente n'est pas faite pour dcrire, mais pour dsigner
vide. Presque insignifiant (Pariente), le nom propre admet tous les
prdicats, donc appelle une dtermination ultrieure. L'altrit, une
seconde fois, est incorpore la dsignation : un seul nom, parmi la liste
des noms disponibles, dsigne titre permanent un seul individu oppos
tous les autres de la mme classe. Et, une fois encore, le privilge des
noms propres assigns des humains tient leur rle ultrieur de
confirmation de leur identit et de l'ipsit de ceux-ci '. Et, mme si dans
le langage ordinaire les noms propres ne remplissent pas pleinement
leur rle
2
, du moins leur vise est bien de dsigner chaque fois un
individu a l'exclusion de tous les autres de la classe considre.
La troisime catgorie d'oprateurs d'individualisation, celle des
indicateurs, contient les pronoms personnels (je, tu), les
dictiques, qui regroupent eux-mmes les dmonstratifs ( ceci ,
cela ), les adverbes de lieu ( ici , l , l-bas ), de temps (
maintenant , hier , demain ), etc. ; quoi il faut ajouter les
temps verbaux ( il venait , il viendra ). A la diffrence des noms
propres, ce sont des indicateurs intermittents, qui en outre dsignent
chaque fois des choses diffrentes. Seul est dterminant le rapport de
renonciation, prise pour repre fixe. Ici , c'est tout lieu proche de la
source d'mission du message ; maintenant , c'est tout vnement
contemporain du message. Le je et le tu mergent certes du groupe
titre d'interlocuteurs de renonciation. Mais, ce stade, renonciation
est elle-mme traite comme vnement du monde, donc certes comme
objet bizarre, mais encore comme arrivant au-dehors ; c'est pourquoi,
reprs par rapport l'vnement-nonciation, tous les indicateurs sont
sur le mme plan. Cela est si vrai que, dans une phase de son uvre,
Russell a tent d'or-
1. De fait, dans le langage ordinaire, nous ne connaissons gure que des noms
propres dsignant des humains, parce que nous nous intressons par ailleurs une
certaine permanence des peuples, des familles, des individus, laquelle est consti-
tue un autre niveau que celui o fonctionnent les oprateurs d'individualisa-
tion. Nous nommons les villes, les rivires, et mme les astres, eu gard certains
comportements humains les concernant (habiter, naviguer, relier les travaux et les
jours dans te temps calendaire). En ce sens, identifier en nommant dit plus qu'in-
dividualiser.
2. La surdtermination laquelle il est fait aliusion dans la note prcdente
explique que les noms propres usuels ne soient que rarement des noms propres
logiquement purs. Ainsi en est-il des noms de famille : les rgles de dnomination
lies au statut matrimonial des femmes dans notre culture, au moins dans la pra-
tique dominante, font que Jeanne Dupont peut dsigner au moins deux personnes
diffrentes : la soeur non marie de Pierre Dupont et son pouse.
LA PERSONNE ET LA RFRENCE IDENTIFIANTE
donner les indicateurs en fonction du ceci , rencontre de leur
caractrisation d'un autre point de vue comme particuliers
go-centriques . Mais Pariente a raison de dire que ceci et ego
n'exercent leur fonction de reprage qu'en liaison avec cette non-ciation
' ; en ce sens, je dirai que le dmonstratif accol renonciation remporte
sur l'assignation de celle-ci tel locuteur et tel interlocuteur, tel site
et tel moment. Je tire de cette analyse prparatoire trois conclusions :
/. L'individualisation repose sur des proccd i'es spcifiques de
dsignation distinctes de la prdication, visant un exemplaire et un seul,
l'exclusion de tous les autres de la mme classe.
2. Ces procdures n'ont aucune unit en dehors de cette vise.
3. Seuls parmi les oprateurs d'identification, les indicateurs visent
le je et le tu ; mais ils n'ont aucun privilge par rapport aux autres
dictiques, dans la mesure o ils gardent pour point de repre
renonciation entendue encore comme un vnement du monde.
2. La personne comme particulier de base
Comment passer de l'individu quelconque l'individu que nous
sommes chacun ? Dans Les Individus, P.F. Strawson dveloppe une
stratgie que nous adopterons comme cadre gnral l'intrieur duquel
nous placerons ultrieurement de nouvelles analyses, visant une
dtermination toujours plus riche et plus concrte du soi. Cette stratgie
consiste isoler, parmi tous les particuliers auxquels nous pouvons
nous rfrer pour les identifier (au sens d'individualiser prcis plus
haut), des particuliers privilgis relevant d'un certain type, que l'auteur
appelle particuliers de base . Les corps physiques et les personnes
que nous sommes sont, selon cette habile stratgie, de tels particuliers
de base, en ce sens qu'on ne peut identifier quoi que ce soit sans renvoyer
titre ultime l'un ou l'autre de ces deux types de particuliers. En ce
sens, le concept de personne, comme celui de corps physique, serait un
concept primitif, dans la mesure o on ne saurait remonter au-del de lui,
sans le prsupposer dans l'argument qui prtendrait le driver d'autre
chose.
1. Le terme reprage est bien choisi (Pariente oppose reprer
dcrire ) ; il dsigne un stade trs fruste o l'on est encore bien loin de l'ipsit :
simple dcentrage de tous les faits et tats de choses dans la mouvance de renon-
ciation, encore considre comme vnement du monde.
42 43
SOI-MME COMME UN AUTRE
S'il fallait donner un anctre cette stratgie, ce serait certainement
Kant, non le Kant de la seconde Critique, mais bien celui de la Critique
de la Raison pure. C'est en effet une sorte de dduction transcendantale
de la notion de personne que nous allons procder, en montrant que, si
nous ne disposions pas du schme de pense qui la dfinit, nous ne
pourrions pas procder aux descriptions empiriques que nous en faisons
dans la conversation ordinaire et dans les sciences humaines.
Notons ds l'abord que ce traitement de la personne comme
particulier de base ne met pas l'accent sur la capacit de la personne se
dsigner elle-mme en parlant comme ce sera le cas dans la prochaine
tude, consacre au pouvoir qu'a le sujet de renonciation de se
dsigner lui-mme ; ici, la personne est une des choses dont nous
parlons, plutt qu'un sujet parlant. Il ne faut sans doute pas opposer trop
radicalement les deux approches de la personne : par rfrence
identifiante et par autodsignation. Elles ont deux occasions de se
croiser ds le dpart de l'analyse. D'abord, c'est dans une situation
d'interlocution qu'un sujet parlant dsigne son interlocuteur quel
particulier il choisit dans une gamme de particuliers de mme sorte, de
qui il se propose de parler, et s'assure par un change de questions et de
rponses que son partenaire a bien en vue le mme particulier de base
que lui. La thorie des particuliers de base croise une seconde fois celle de
l'autorfrence l'occasion du rle que la premire assigne aux
dmonstratifs, au sens large du terme, et parmi ceux-ci aux pronoms
personnels, aux adjectifs et pronoms possessifs ; mais ces expressions
sont traites comme des indicateurs de particularit, donc comme des
instruments de rfrence identifiante. En dpit de ces empitements
mutuels entre les deux approches linguistiques, on ne se soucie pas dans
l'approche rfrentielle de savoir si la rfrence soi, implique dans la
situation d'interlocution ou dans l'usage des dmonstratifs, fait partie de
la signification donne la chose laquelle on se rfre au titre de
personne. Ce qui importe plutt, c'est la sorte de prdicats qui
caractrise la sorte de particuliers qu'on appelle des personnes. La
personne reste ainsi du ct de la chose dont on parle, plutt que du
ct des locuteurs eux-mmes qui se dsignent en parlant.
Il ne faut certes pas se mprendre sur l'usage du mot chose , pour
parler des personnes en tant que particuliers de base. Il sert simplement
marquer l'appartenance de notre toute premire investigation de la
notion de personne la problmatique gnrale de la rfrence
identifiante. Est une chose, ce dont on
LA PERSONNE ET LA RFRENCE IDENTIFIANTE
parle. Or, on parle de personnes en parlant des entits qui composent
le monde. On en parle comme de choses d'un type particulier.
On doit toutefois se demander si l'on peut avancer bien loin dans la
dtermination du concept de personne sans faire intervenir, un
moment ou l'autre, le pouvoir d'autodsignation qui fait de la
personne non plus seulement une chose d'un type unique, mais un soi.
On doit mme demander si on peut vritablement distinguer les
personnes des corps, sans inclure l'auto-dsignation dans la
dtermination mme du sens donn cette sorte de choses vers quoi se
dirige la rfrence identifiante. Dans la stratgie de Strawson, le recours
l'autodsignation est en quelque sorte intercept ds l'origine par la thse
centrale qui dcide des critres d'identification de quoi que ce soit au
titre de particulier de base. Ce critre est l'appartenance des individus
un unique schme spatio-temporel dont il est dit ds le dbut qu'il nous
contient, que nous y prenons place nous-mmes. Le soi est bien
mentionn par cette remarque incidente, mais il est immdiatement
neutralis par cette inclusion dans le mme schme spatio-temporel que
tous les autres particuliers. Je dirais volontiers que, dans Les Individus,
la question du soi est occulte, par principe, par celle du mme au sens
de Y idem. Ce qui importe l'identification non ambigu, c'est que les
interlocuteurs dsignent la mme chose. L'identit est dfinie comme
mmet et non comme ipsit. Ce disant, je ne mconnais pas l'avantage
que se donne au dpart une problmatique qui privilgie la question du
mme par rapport celle du soi. Elle met en garde ds le dpart contre
la drive possible vers la rfrence prive et non publique, quoi
pourrait entraner un recours prmatur l'autodsignation. En ne
mettant pas l'accent principal sur le qui de celui qui parle mais sur le
quoi des particuliers dont on parle, y compris les personnes, on place
toute l'analyse de la personne comme particulier de base sur le plan
public du reprage par rapport au schme spatio-temporel qui le
contient.
Le primat ainsi donn au mme par rapport au soi est parti-
culirement soulign par la notion cardinale de ridentification. Il ne
s'agit, en effet, pas seulement de s'assurer qu'on parle de la mme
chose, mais qu'on peut l'identifier comme tant la mme chose dans la
multiplicit de ses occurrences. Or cela ne se fait que par reprage
spatio-temporel : la chose reste la mme en des lieux et des temps
diffrents. Finalement, la mmet fondamentale, c'est celle du cadre
spatio-temporel lui-mme : pour des
44 45
SOI-MME COMME UN AUTRE
occasions diffrentes, nous utilisons le mme cadre (Les Individus, p.
35 [32]). Mme veut alors dire unique et rcurrent. Quant la
manire dont nous-mmes faisons partie du cadre, elle n'est pas rige en
problme propre. Or, la suite le vrifiera, c'est un immense problme de
comprendre la manire par laquelle notre propre corps est la fois un
corps quelconque, objectivement situ parmi les corps, et un aspect du
soi, sa manire d'tre au monde. Mais, pourrait-on dire de faon abrupte,
dans une problmatique de la rfrence identifiante, la mmet du
corps propre occulte son ipsit. Il en sera ainsi aussi longtemps que les
caractres lis aux pronoms et adjectifs possessifs - mon , le mien
- n'auront pas t rattachs la problmatique explicite du soi. Cela ne
commencera de se faire que dans le cadre de la pragmatique du
langage.
3. Les corps et les personnes
La seconde grande thse de Strawson dans Les Individus est que les
premiers particuliers de base sont les corps, parce qu'ils satisfont titre
primaire aux critres de localisation dans l'unique schme
spatio-temporel. Mieux, il y a entre le critre et ce qui le satisfait une
telle convenance mutuelle que l'on peut se hasarder dire que cela mme
qui rsout le problme est aussi ce qui permet de le poser (p. 43-44 [40]).
Strawson note juste titre que cette lection mutuelle du problme et de
sa solution caractrise les vritables arguments transcendantaux.
Cette priorit reconnue aux corps est de la plus grande importance
pour la notion de personne. Car, s'il est vrai, comme il sera dit plus loin,
que le concept de personne n'est pas moins une notion primitive que
celui de corps, il ne s'agira pas d'un second rfrent distinct du corps,
telle l'me cartsienne, mais, d'une manire qui restera dterminer,
d'un unique rfrent dot de deux sries de prdicats, des prdicats
physiques et des prdicats psychiques. Que les personnes soient aussi des
corps, cette possibilit est tenue en rserve dans la dfinition gnrale
des particuliers de base, selon laquelle ceux-ci sont des corps ou
possdent des corps. Possder un corps, c'est ce que font ou plutt ce
que sont les personnes.
Or la notion primitive de corps renforce le primat de la catgorie de
mmet que nous venons de souligner : ce sont eux qui,
LA PERSONNE ET LA RFRENCE IDENTIFIANTE
titre minent, sont identifiables et ridentifiables comme tant les
mmes.
L'avantage de cette nouvelle dcision stratgique est certain : dire que
les corps sont les premiers particuliers de base, c'est liminer, comme
candidats ventuels, les vnements mentaux, disons les
reprsentations, les penses, dont le tort, pour ce type d'analyse, est
d'tre des entits prives et non publiques. Leur sort, en tant que
prdicats spcifiques des personnes, est seulement ajourn. Mais il
fallait d'abord qu'ils soient dlogs de la position dominante de
rfrents ultimes qu'ils occupent dans un idalisme subjectiviste.
Le premier corollaire de cette espce de dclassement des vnements
mentaux au titre de particuliers de base est que la personne ne pourra
pas tre tenue pour une conscience pure quoi on ajouterait titre
secondaire un corps, comme c'est le cas dans tous les dualismes de l'me
et du corps. Les vnements mentaux et la conscience, en quelque sens
qu'on prenne ce terme, pourront seulement figurer parmi les prdicats
spciaux attribus la personne. Cette dissociation entre la personne
comme entit publique et la conscience comme entit prive est de la
plus grande importance pour la suite de nos analyses.
Un second corollaire, dont l'importance gale celle du prcdent, est
que la personne qui on attribue, de la manire qu'on dira plus loin, les
prdicats mentaux et une conscience n'est pas exclusivement exprime
par les pronoms de la premire et de la seconde personne du singulier,
comme ce serait le cas dans une thorie de renonciation rflexive. Ils
sont attribus quelqu'un qui peut tre aussi une troisime personne. Si
la personne est ce dont on parle, il est admis que l'on parle, dans une
situation d'in-terlocution, de la douleur ressentie par un tiers qui n'est
pas l'un des interlocuteurs.
Mais nombreuses sont les perplexits suscites par cette dcision
stratgique d'attaquer le problme de la personne par celui des corps
objectifs situs dans un seul et mme cadre spatiotemporel. Premire
perplexit : la question du corps propre revient au premier plan, non
plus seulement au titre de notre appartenance l'unique schma
spatio-temporel, mais celui du rapport du corps propre au monde
objectif des corps. Dans une problmatique purement rfrentielle,
sans autodsignation explicite, il n'y a pas vrai dire de problme du
corps propre. On doit se borner la constatation suivante : Ce que je
nomme mon corps est au moins un corps, une chose matrielle
(Les
46
47
SOI-MME COMME UN AUTRE LA PERSONNE ET LA RFRENCE IDENTIFIANTE
Individus, p. 100 [89]). Cela est vrai, mais il est le mien en un sens qui
suppose reconnue la force logique du soi. Seconde perplexit : le
dclassement des vnements mentaux et de la conscience par rapport
la position de particulier de base, donc de sujet logique, a pour
contrepartie une occultation accrue de la question du soi. Cette
perplexit n'est pas trangre la prcdente, dans la mesure o les
vnements mentaux posent la mme sorte de problme que le corps
propre, savoir la liaison troite qui semble exister entre possession et
ipsit. Mais il s'agit d'une perplexit supplmentaire : on ne voit pas
comment la proprit de l'ipsit pourrait figurer dans une liste de
prdicats attribus une entit, mme aussi originale que la personne. Il
semble qu'elle soit chercher du ct de l'autodsignation lie
renonciation et non du ct de la chose qui sert de terme dans une
rfrence identifiante. Ce sera plutt un problme pour nous de
comprendre comment le soi peut tre la fois une personne dont on
parle et un sujet qui se dsigne la premire personne, tout en
s'adressant une seconde personne. Ce sera un problme, car il ne faudra
pas qu'une thorie de la rflexivit nous fasse perdre le bnfice certain
de la possibilit de viser la personne comme une troisime personne, et
non pas seulement comme un je et un tu. La difficult sera plutt de
comprendre comment une troisime personne peut tre dsigne dans le
discours comme quelqu'un qui se dsigne soi-mme comme premire
personne. Or cette possibilit de reporter l'autodsignation en premire
personne sur la troisime, aussi insolite soit-elle, est sans doute
essentielle au sens que nous donnons la conscience que nous joignons
la notion mme d'vnement mental : car pouvons-nous assigner des
tats mentaux une troisime personne sans assumer que ce tiers les
ressent ? Or ressentir semble bien caractriser une exprience la
premire personne. Si tel est le cas. il appartiendrait la notion
d'vnements mentaux d'tre la fois des prdicats attribus une
certaine sorte d'entits et d'tre les porteurs d'une autodsignation que
nous comprenons d'abord en premire personne en raison de
l'autodsignation solidaire de l'acte d'nonciation. J'avoue qu' ce stade
de l'analyse nous n'avons aucun moyen de rendre raison de cette
structure insolite des vnements mentaux, la fois prdicable des
personnes et autodsignatifs.
4. Le concept primitif de personne
Nous abordons maintenant la dmonstration du caractre primitif de
la notion de personne. J'en retiendrai trois points :
1. Premirement, la dtermination de la notion de personne se fait par
le moyen des prdicats que nous lui attribuons. La thorie de la personne
tient ainsi dans le cadre gnral d'une thorie de la prdication des sujets
logiques. La personne est en position de sujet logique par rapport aux
prdicats que nous lui attribuons. C'est la grande force d'une approche de
la personne par le ct de la rfrence identifiante. Mais il importe ds
maintenant de souligner que l'occultation de la question du soi se
poursuit dans la mesure o l'ascription de ces prdicats la personne ne
porte aucun caractre spcifique qui la distingue de la procdure
commune d'attribution. Strawson ne s'tonne nullement de ce que
peut avoir d'insolite par rapport une thorie gnrale de la prdication
l'nonc suivant : We ascribe to ourselves certain things (Nous nous
ascrivons certaines choses). Je ne nie pas la force que peut avoir cet
alignement de l'ascription nous-mmes sur l'attribution quelque
chose : le nous est si peu accentu qu'il quivaut un on , one en
anglais. L'ascription, c'est ce que fait n'importe qui, chacun, on,
l'gard de n'importe qui, de chacun, de on. Il faudra pouvoir garder la
force de ce chacun, qui est celle d'une dsignation distributive plutt
qu'anonyme, dans une analyse du soi issue de la thorie de
renonciation.
2. Deuxime point fort : l'tranget qui s'attache la notion primitive
de personne - ou mieux, qui fait que la notion de personne est primitive
- consiste en ceci que la personne est la mme chose laquelle on
attribue deux sortes de prdicats, les prdicats physiques que la personne
a en commun avec les corps, et les prdicats psychiques qui la distinguent
des corps. Nous touchons une nouvelle fois la force du mme au sens
'idem dans Les Individus. Je cite: One's states of consciousness,
one's thoughts and sensations are ascribed to the very same thing to
which thse physical characteristics, this physical situation, is
48 49
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LA PERSONNE ET LA RFRENCE IDENTIFIANTE
ascribed (p. 89)'. Remarquez avec quelle habilet la forme passive
de la proposition (is ascribed) consolide la neutralit du one de one
's states of consciousness, one's thoughts and sensations, et du
mme coup l'insignifiance du sujet de l'ascription en tant
qu'nonciation et acte de discours. Omis le soi de l'ascription, le
champ est libre pour la mmet de the very same thing quoi on
attribue prdicats physiques et mentaux. C'est cette mmet qui fait
toute la force de l'argument et qui rend compte pour une part de
l'tranget mme de notre concept de personne.
L'avantage majeur de cette identit d'attribution est, comme on l'a
anticip plus haut, d'liminer, par une simple analyse de la
grammaire de notre discours sur la personne, l'hypothse d'une
attribution double, l'me (ou la conscience) d'une part, au corps
de l'autre, des deux sries de prdicats. C'est la mme chose qui pse
soixante kilos et qui a telle ou telle pense. Le paradoxe de ce genre
d'analyse est bien que c'est la faveur de la neutralisation des
caractres spcifiques de l'ascription - ceux qui tiennent son
caractre sui-rfrentiel - que peut tre porte au premier plan la
problmatique centrale de la personne, savoir ce phnomne de
double attribution sans double rfrence : deux sries de prdicats
pour une seule et mme entit. Mmet et ipsit, est-on tent de
dire, sont deux problmatiques qui s'occultent mutuellement. Ou,
pour tre plus exacte, la problmatique de la rfrence identifiante,
par laquelle est promue au premier rang la mmet du sujet logique
de prdication, ne requiert qu'une sui-rfrence marginale un on
, qui est un quiconque .
pu mme coup est pose la question du fondement de cette
mmet. Peut-on se contenter de l'argument selon lequel notre cadre
de pense est ainsi fait que nous ne pouvons oprer de rfrence
identifiante des personnes sans assumer l'identit du sujet
d'attribution des prdicats ? Ne peut-on chercher justifier cette
structure de notre pense et de notre langage par une analyse ph-
nomnologique de la constitution mme de la personne en son unit
psychophysique? N'est-ce pas une telle unit que l'on a tenue plus
haut pour acquise, lorsqu'on a invoqu la convenance mutuelle entre
le schma spatio-temporel et les proprits des corps, en tant
qu'entits directement localisables, discrtes, continues dans
l'espace, stables dans le temps? Or, toute tentative
1 Le fait que nos tats de conscience, nos penses et nos sensations soient
attribus cette mme chose laquelle nous attribuons ces caractristiques phy-
siques, cette situation physique (Les Individus, op. cit., p. 100 [89]).
pour justifier la structure de pense qui impose la mmet au sujet
d'attribution rencontre inluctablement la question du corps propre,
voque chacun des moments critiques de l'analyse. Qu'en est-il
de l'unit psychophysique sous-jacente la rfrence un soi ? La
rponse de Strawson laisse perplexe : la relation de dpendance ,
voque dans l'argument paradoxal selon lequel trois corps distincts
seraient susceptibles d'tre impliqus dans la vision - un corps pour
ouvrir les yeux, un autre pour les orienter, un troisime pour situer
le lieu d'o l'on voit (Les Individus, p. 101 [90] sa.) -, semble tenue
pour un cas ordinaire de liaison causale (ibid., p. 103 [92]).
L'argument est dj peu satisfaisant tant qu'on parle du corps de
quelqu'un, voire de chacun : il l'est moins encore quand on introduit
les adjectifs possessifs de la premire personne: this body as mine
(ibid., p. 103 [93]). La possession implique par l'adjectif mien
est-elle de mme nature que la possession d'un prdicat par un sujet
logique ? Il y a certes une continuit smantique entre propre (own),
propritaire (owner), possession (ownness) ; mais elle n'est
pertinente que si l'on se confine dans la neutralit du one's own; et,
mme sous cette condition de neutralisation du soi, la possession du
corps par quelqu'un ou par chacun pose l'nigme d'une proprit non
transfrable, ce qui contredit l'ide usuelle de proprit. trange
attribution, en effet, que celle d'un corps, qui ne peut tre ni faite ni
dfaite. Il faudra revenir plus tard sur cette tranget bien parti-
culire.
3. Le troisime point fort de l'analyse du concept primitif de
personne est celui qui mettrait le plus dans l'embarras une thorie du
soi uniquement drive des proprits rflexives de renonciation. Il
concerne une autre sorte de mmet, assume par le langage et la
pense quand on caractrise comme personne une chose
particulire. Elle concerne les prdicats psychiques l'exclusion
des prdicats physiques. Elle consiste en ceci que les vnements
mentaux, que nous avons fait plus haut rtrograder du rang d'entits
de base celui de prdicats, ont ceci de remarquable, en tant
prcisment que prdicats, de garder le mme sens qu'ils soient
attribus soi-mme ou d'autres que soi-mme, c'est--dire
n'importe qui d'autre (anyone else) : The ascribing phrases, dit
Strawson, are used in just the same sens when the subject is
ano-ther as when the subject is oneself.
1. On utilise les expressions attributives exactement dans le mme sens
lorsque le sujet est un autre que lorsqu'il s'agit de soi-mme * (ibid., p. 111 [99]).
50 51
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LA PERSONNE ET LA RFRENCE IDENTIFIANTE
Voil donc un nouveau cas de mmet ; non plus la mme chose
recevant deux sortes de prdicats, mais le mme sens attribu
aux prdicats psychiques, que l'attribution se fasse soi ou autrui.
Une nouvelle fois, la force logique du mme (same) clipse celle du
soi (self), bien que, dans la dclaration qui prcde, il soit question
de sujet et de soi-mme. Mais, dans le contexte philosophique de la
rfrence identifiante, le statut de sujet n'est pas spcifi autrement
que par la nature de ce qui lui est attribu, savoir les prdicats
psychiques et physiques ; c'est pourquoi les pronoms personnels je
et tu n'ont pas tre mentionns ; oneself suffit, sans que le
suffixe self en tant que tel fasse problme, puisqu'on peut remplacer
oneself et another par quelqu'un (someone) et n'importe qui d'autre
(anyone else) (Les Individus, p. 108 [91]).
Je veux dire, une dernire fois, l'importance qu'il faut attacher
cette thse. D'abord, comme on le verra plus loin, cette double
ascription quelqu'un et n'importe qui d'autre est ce qui permet de
former le concept d'esprit (mind), c'est--dire le rpertoire des
prdicats psychiques attribuables chacun. Disons ds maintenant
que le caractre distributif du terme chacun est essentiel la
comprhension de ce que dsormais j'appellerai le psychique .
Les tats mentaux sont certes toujours ceux de quelqu'un ; mais ce
quelqu'un peut tre moi, toi. lui, quiconque. Ensuite, quoi qu'il en
soit du sens vritable de la corrlation quelqu'un - n'importe qui
d'autre . sur laquelle je vais revenir l'instant, elle impose ds le
dbut une contrainte aussi inluctable que celle de tenir la personne
comme une chose qui possde un corps ; pas de conscience pure
au dpart, disions-nous. Nous ajouterons maintenant : pas de moi
seul au dpart ; l'attribution autrui est aussi primitive que
l'attribution soi-mme. Je ne peux parler de faon significative de
mes penses, si je ne peux en mme temps les attribuer
potentiellement un autre que moi : To put it briefly, one can
ascribe states of consciousness to oneself only ifone can ascribe them
to others. One can ascribe them to oihers only ifone can identify
other subjects of exprience. And one cannot identify others, if one
can identify them only as subjects of exprience, possessors of states
of consciousness
1
.
1. En bref, on ne peut s'attribuer des tats de conscience que si on peut les
attribuer d'autres. On ne peut les attribuer d'autres que si on peut identifier
d'autres sujets d'exprience. Et on ne peut identifier d'autres sujets, si on peut les
identifier uniquement comme sujets d'expriences, comme possesseurs d'tats de
conscience (Md.. p. 112 [100]).
En revanche, on peut se demander, une fois encore, si la contrainte
de cette ascription identique est prendre comme un simple fait, une
condition inexplicable en elle-mme du discours, ou s'il est possible
d'en rendre raison partir d'une lucidation des termes soi-mme
(oneself) et autre que soi (another). Or on ne peut pas s'empcher
de se demander si l'expression mes expriences est quivalente
l'expression les expriences de quelqu'un (et, corrlativement,
l'expression tes expriences quivalente l'expression les
expriences de n'importe quel autre). L'analyse purement
rfrentielle du concept de personne peut assez longtemps viter la
mention je-tu qui relve de l'analyse rflexive de renonciation, mais
elle ne peut l'viter jusqu'au bout. Elle est contrainte de l'voquer, au
moins marginalement, ds lors qu'elle s'interroge sur les critres
d'attribution dans l'une ou l'autie situation : attribu soi-mme
(oneselj), un tat de conscience est ressenti (felt) ; attribu l'autre, il
est observ. Cette dissymtrie dans les critres d'attribution conduit
dplacer l'accent sur le suffixe mme (self) dans l'expression
soi-mme (oneself). Dire qu'un tat de conscience est ressenti, c'est
dire qu'il est ascriptible soi-mme (self-ascri-bable). Or, comment
ne pas inclure dans la notion de quelque chose ascriptible
soi-mme l'autodsignation d'un sujet qui se dsigne comme le
possesseur de ses tats de conscience ? Et comment,
corrlativement, pour expliciter la formule ascriptible un autre ,
ne pas accentuer l'altrit de l'autre, avec tous les paradoxes d'une
assignation cet autre du pouvoir de s'auto-dsigner, sur la base
mme de l'observation externe, s'il est vrai comme l'accorde
Strawson que cet autre doit tre tenu galement pour un
sclf-ascriber, c'est--dire quelqu'un capable description soi-mme
(Les Individus, p. 120-129 [108])'. Au vu de ces questions. la thse
de la mmet d'ascription soi-mme et un autre que soi requiert
que l'on rende compte de l'quivalence entre les critres d'ascription :
ressentis et observs : et, par-del cette quivalence, que l'on rende
compte de la rciprocit qui reste interprter entre quelqu'un qui est
moi et un autre qui est toi. Autrement dit. il faut acqurir
simultanment l'ide de rflexivit et celle d'altrit. afin de passer
d'une corrlation faible et trop facilement assume entre quelqu'un et
n'importe qui d'autre la corrlation forte entre soi, au sens de
mien, et autrui, au sens de tien.
1. Le lecteur aura not que nous avons renonc traduire ascription (angl.) par
attribution , afin de marquer dans le vocabulaire la rfrence qui spare l'attri-
bution d' expriences a quelqu'un de l'attribution au sens gnral.
52
53
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
Il faut avouer que la tche n'est pas aise ; l'enrichissement que la
notion de personne peut recevoir d'une thorie rflexive de
dnonciation ne saurait rsulter de la substitution d'une thorie de
renonciation la thorie de la rfrence identifiante, sous peine de
se laisser entraner dans les apories du solipsisme et dans les
impasses de l'exprience prive. La tche sera plutt de prserver la
contrainte initiale de penser le psychique comme assignable
chacun, donc de respecter aussi la force logique du chacun, lors
mme que l'on fera appel l'opposition entre je et tu pour
donner toute sa force l'opposition entre soi et autre que soi. En ce
sens, si une approche purement rfrentielle o la personne est
traite comme un particulier de base doit tre complte par une
autre approche, elle ne saurait tre abolie, mais conserve dans ce
dpassement mme
1
.
1. Je n'ai pas fait mention, pour cette analyse critique de la notion de personne
dans la perspective de la rfrence identifiante, de la suggestion que fait Strawson,
vers la fin de son chapitre sur le concept de personne, de dplacer vers le centre
du tableau (ibid., p. 124 [111] une certaine classe de prdicats, savoir ceux-l
mme qui impliquent fairequelquechose. Le privilge de cette classe de prdicats
est d'exemplifier, mieux que d'autres ne le feraient, les trois points forts de l'ana-
lyse du concept primitif de personne. L'action offrirait, sinon une rponse, du
moins le commencement d'une rponse la question de savoir ce qui, au niveau
des faits naturels, rend intelligible notre possession d'un tel concept [de per-
sonne] (ibid.). Ce sera la tche de la troisime tude d'valuer, non seulement la
pertinence de la notion d'action pour une thorie de la personne comme parti-
culier de base, mais sa capacit conduire l'analyse au-del de ce premier cadre
thorique. 11 nous faut, auparavant, dployer l'autre volet de la philosophie lin-
guistique qui. prise comme un tout, sert d'organon la thorie de l'action.
DEUXIME TUDE
L'nonciation et le sujet
parlant
Approche pragmatique
Dans la prcdente tude, nous avons suivi aussi loin que possible
la premire des deux grandes voies d'accs la problmatique du soi
ressortissant la philosophie du langage, savoir celle de la
rfrence identifiante. Nous tentons une nouvelle perce en
direction du soi en suivant la seconde voie, celle de Y nonciation,
dont la thorie des actes de langage (speech-acts), que je prfre
appeler actes de discours, constitue aujourd'hui la pice matresse.
Ce faisant, nous passons d'une smantique, au sens rfrentiel du
terme, une pragmatique, c'est--dire une thorie du langage tel
qu'on l'emploie dans des contextes dtermins d'interlocution. On
ne doit toutefois pas s'attendre, avec ce changement de front, un
abandon du point de vue transcendantal : ce n'est pas en effet une
description empirique des faits de communication que la
pragmatique entend procder, mais une recherche portant sur les
conditions de possibilit qui rglent l'emploi effectif du langage,
dans tous les cas o la rfrence attache certaines expressions ne
peut tre dtermine sans la connaissance de leur contexte d'usage,
c'est--dire essentiellement la situation d'interlocution.
Ce nouveau type d'investigation est d'autant plus prometteur qu'il
met au centre de la problmatique, non plus l'nonc, mais
renonciation, c'est--dire l'acte mme de dire, lequel dsigne
rflexivement son locuteur. La pragmatique met ainsi directement
en scne, titre d'implication ncessaire de l'acte dnonciation, le
je et le tu de la situation d'interlocution.
Notre problme sera, au terme de cette exploration des liens entre
l'acte d'nonciation et son locuteur, de confronter les contributions
respectives de nos deux sries d'enqutes, l'enqute rfrentielle et
l'enqute rflexive, une thorie intgre du soi (du moins au plan
linguistique). Il apparatra en effet trs vite que
55
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
L'ENONCIATION ET LE SUJETPARLANT
la pragmatique ne peut pas plus se substituer la smantique que celle-ci
n'a pu mener bien sa tche sans emprunt la pragmatique. De mme
que la dtermination complte de la personne comme particulier de
base s'est rvle impossible sans un recours la capacit
d'autodsignation des sujets d'exprience, de mme l'analyse complte de
la rflexivit implique dans les actes d'nonciation ne pourra tre mene
bien sans que soit attribue cette rflexivit une valeur rfrentielle
d'un genre particulier. Ce sont donc les empitements mutuels des deux
disciplines qui se rvleront finalement les plus fructueux pour notre
recherche sur le soi ; certes, en premire approximation, les deux
approches paraissent imposer des priorits discordantes : pour l'enqute
rfrentielle, la personne est d'abord la troisime personne, donc celle
dont on parle. Pour l'enqute rflexive, en revanche, la personne est
d'abord un moi qui parle un toi. La question sera finalement de savoir
comment le je-tu de l'interlocution peut s'extrioriser dans un lui
sans perdre la capacit de se dsigner soi-mme, et comment le il/elle
de la rfrence identifiante peut s'intrioriser dans un sujet qui se dit
lui-mme. C'est bien cet change entre les pronoms personnels qui
parait tre essentiel ce que je viens d'appeler une thorie intgre du soi
au plan linguistique.
1. nonciaton et actes de discours (speech-acts)
Que l'approche rflexive ne s'oppose pas purement et simplement
l'approche rfrentielle. nous en avons la preuve dans le fait que c'est
d'abord comme une complication sur le trajet de la rfrence de certains
noncs que nous rencontrons des phnomnes exigeant leur mise en
forme dans une thorie explicite de renonciation. Sous le titre vocateur
de La Transparence et l'Enonciation, Franois Rcanati ' introduit la
pragmatique en faisant apparatre la rflexivit comme un facteur
d'opacit interfrant avec la transparence prsume d'un sens qui, sans
lui, se laisserait traverser par la vise rfrentielle. Il n'est pas indif-
frent que la rflexivit soit prsente d'abord comme un obstacle la
transparence recherche dans l'acte de faire rfrence ... Si, avec les
Anciens et encore avec les grammairiens de Port-Royal, on dfinit le
signe comme une chose qui reprsente une autre
1. F. Rcanati, La Transparenceet l'Enonciation, Paris, d. du Seuil, 1979.
56
chose, la transparence consiste en ceci que, pour reprsenter, le signe
tend s'effacer et ainsi se faire oublier en tant que chose. Mais cette
oblitration du signe en tant que chose n'est jamais complte. Il est des
circonstances o le signe ne russit pas se rendre aussi absent ; en
s'opacifiant, il s'atteste nouveau comme chose et rvle sa structure
minemment paradoxale d'entit prsente-absente. Or la circonstance
majeure o s'atteste l'opacit du signe, c'est celle o le fait de
renonciation, en se rflchissant dans le sens de l'nonc, vient inflchir
la vise rfrentielle elle-mme'. Le tour nouveau qu'a pris la thorie
de renonciation avec l'analyse des actes de discours ne constitue donc
pas une nouveaut radicale. Celle-ci redonne vie un paradoxe bien
connu des classiques, rsultant de la concurrence, dans le mme nonc,
entre la vise reprsentative de quelque chose et ce que la grammaire de
Port-Royal appelait rflexion virtuelle . En termes modernes, ce
paradoxe consiste en ceci que la rflexion du fait de renonciation dans le
sens de l'nonc fait partie intgrante de la rfrence de la plupart des
noncs de la vie quotidienne dans la situation ordinaire
d'interlocution.
Le moment est venu de montrer de quelle faon la thorie des actes de
discours contribue la reconnaissance de ce facteur d'opacit des
signes du discours, et de prciser la sorte de sujet qui est ainsi promu.
Le terrain sera ds lors prpar pour une confrontation des rsultats
atteints sur l'une et l'autre ligne de la philosophie du tangage
concernant le soi.
La thorie des actes de discours est bien connue. Aussi serai-je bref
dans le rsum de son dveloppement, d'Austin Searle. Le point de
dpart a t, comme on sait, la distinction, tablie dans la premire
partie de Quand dire, c'est faire
1
, entre deux classes d'noncs, celle des
performatifs et celle des constatifs. Les premiers sont remarquables en
ceci que le simple fait de les noncer quivaut accomplir cela mme
qui est nonc. L'exemple de la promesse, qui jouera un rle dcisif
dans la dtermination thique du soi, est cet gard remarquable. Dire :
je promets , c'est promettre effectivement, c'est--dire s'engager
faire plus tard et - disons-le tout de suite - faire pour autrui ce que je
dis maintenant que je ferai. Quand dire, c'est faire , dit le traduc-
1. Dans le sens d'un nonc, crit Rcanati, se rflchit le fait de son
noncia-tion (ibid., p. 7). Nous discuterons plus loin le bien-fond du
vocabulaire de la rflexion dans un contexte o renonciation - l'acte d'noncer -
est traite comme un vnement mondain.
2. J.L. Austin, Howto do Things with Words, Harvard University Press, 1962 ;
trad. fr. de G. Lane, Quand dire, c'est faire. Paris. d. du Seuil, 1970.
57
SOI-MMECOMMEUNAUTRE L'NONCIATION ET LE SUJET PARLANT
teur franais du livre d'Austin. Et voici comment le je est
d'emble marqu : les performatifs n'ont la vertu de
faire-en-disant qu'exprims par des verbes la premire personne
du singulier du prsent de l'indicatif. L'expression je promets (ou
plus exactement je te promets ) a ce sens spcifique de la pro-
messe, que n'a pas l'expression il promet , qui garde le sens d'un
constatif, ou, si l'on prfre, d'une description.
Mais la distinction entre performatif et constatif devait tre
dpasse par Austin lui-mme, ouvrant ainsi la voie la thorie des
actes de discours de Searle'. L'opposition initiale entre deux classes
d'noncs est incorpore une distinction plus radicale qui
concerne les niveaux hirarchiques qu'on peut distinguer dans tous
les noncs, qu'ils soient constatifs ou performatifs. Il est de la plus
grande importance, pour la discussion qui suit, que ces niveaux
dsignent des actes diffrents. Si dire, c'est faire, c'est bien en
termes d'acte qu'il faut parler du dire. L rside l'intersection
majeure avec la thorie de l'action qui sera dveloppe ult-
rieurement : d'une manire qui reste dterminer, le langage
s'inscrit dans le plan mme de l'action.
Quels sont les actes ainsi enchevtrs dans l'acte global de dire ?
On connat la distinction cardinale entre acte locutoire, acte
illocutoire et acte perlocutoire. L'acte locutoire, c'est l'opration
prdicative elle-mme : dire quelque chose sur quelque chose. Il
n'est pas indiffrent que l'appellation d'acte ne soit pas rserve au
niveau illocutoire, mais soit dj applique au plan locutoire ; il est
ainsi soulign que ce ne sont pas les noncs qui rfrent, mais les
locuteurs qui font rfrence : ce ne sont pas non plus les noncs qui
ont un sens ou signifient, mais ce sont les locuteurs qui veulent dire
ceci ou cela, qui entendent une expression en tel ou tel sens. De
cette faon, l'acte illocutoire s'articule sur un acte plus fondamental,
l'acte prdicatif. Quant lui, l'acte illocutoire consiste, comme son
nom l'indique, en ce que le locuteur fait en parlant ; ce faire
s'exprime dans la force en vertu de laquelle, selon les cas,
renonciation compte comme constatation, commandement,
conseil, promesse, etc. La notion de force illocutoire permet ainsi
de gnraliser au-del des performatifs proprement dits
l'implication du faire dans le dire : dans les constatifs eux-mmes,
un faire est inclus, qui demeure le plus
1. J.R. Searle, Les Actesdelangage, trad. fr. de H. Pauchard, Paris, Hermann,
1972. Je prfre traduire speech-act par acte de discours , pour marquer la sp-
cificit du terme speech par rapport celui trop gnral de langage. En outre le
terme discours souligne la parent entre le speech act des analystes de langue
anglaise et l'instancedediscours du linguiste franais E. Benveniste.
souvent non dit, mais que l'on peut expliciter en faisant prcder
l'nonc par un prfixe de la forme j'affirme que, tout fait
comparable au je promets que , forme dans laquelle toute pro-
messe peut tre rcrite. Le procd n'a rien d'arbitraire : il satisfait
au critre de substitution tabli en smantique logique ; les deux
noncs : le chat est sur le paillasson et j'affirme que le chat est
sur le paillasson ont mme valeur de vrit. Mais l'un a la
transparence d'un nonc entirement travers par sa vise
rfrentielle, l'autre l'opacit d'un nonc qui renvoie
rflexive-ment sa propre nonciation. Le prfixe des performatifs
explicites devient ainsi le modle pour l'expression linguistique de
la force illocutoire de tous les noncs.
C'est dans de tels prfixes que le je est port l'expression. En
outre, avec le je du prfixe, c'est une situation complexe
d'interlocution qui se rvle contribuer au sens complet de l'nonc.
Or, cette situation d'interlocution appartient le fait qu' un
locuteur en premire personne correspond un interlocuteur en
deuxime personne qui le premier s'adresse. Pas d'illocution donc
sans allocution et, par implication, sans un allo-cutaire ou
destinataire du message. L'nonciation qui se rflchit dans le sens
de l'nonc est ainsi d'emble un phnomne bipolaire : elle
implique simultanment un je qui dit et un tu qui le premier
s'adresse. J'affirme que gale je te dclare que ; je promets
que gale je te promets que . Bref, nonciation gale
interlocution. Ainsi commence prendre forme un thme qui n'ira
qu'en s'amplifiant dans les tudes suivantes, savoir que toute
avance en direction de l'ipsit du locuteur ou de l'agent a pour
contrepartie une avance comparable dans l'al-trit du partenaire.
Au stade atteint par la prsente tude, cette corrlation n'a pas
encore le caractre dramatique que la confrontation polmique
entre deux programmes narratifs introduira au cur de
l'interlocution. La thorie des actes de discours ne nous donne cet
gard que le squelette dialogique d'changes interpersonnels
hautement diversifis.
On peut apporter une prcision complmentaire ce rapport
allocutif sans quitter le plan de renonciation en compltant la
thorie des actes de discours par la thorie de renonciation qu'a
propose H. Paul Grice ', thorie selon laquelle toute nonciation
1. H.P. Grice, Meaning, The Phil. Rev., vol. LXV1, 1957, p. 377-388;
Utterer's meaning and intentions, in thePhil. Rev., vol. LXXV11I, 1969, p.
147-177 ; Utterer's meaning, sentence-meaning, and word-raeaning , in, J.R.
Searle (d.) ThePhilosophyoflanguage, Oxford, Oxford University Press, 5* d.,
1977, p. 54-70.
58
59
SOI-MME COMME UN AUTRE L'NONCIATION ET LE SUJET PARLANT
consiste en une intention de signifier qui implique dans sa vise l'attente
que l'interlocuteur ait de son ct l'intention de reconnatre l'intention
premire pour ce qu'elle veut tre. L'inter-locution ainsi interprte se
rvle tre un change d'intentionna-lits se visant rciproquement.
Cette circularit d'intentions exige que soient places sur le mme plan la
rflexivit de renonciation et l'altrit implique dans la structure
dialogique de l'change d'intentions.
Telle est, en trs gros, la contribution de la thorie des actes de
discours la dtermination du soi. La question est maintenant de
prparer la confrontation attendue entre la thorie rfrentielle et celle
de renonciation rflexive par quelques remarques critiques concernant
la nature du sujet exhib par la thorie de renonciation.
2. Le sujet de renonciation
C'est maintenant sur le rapport entre renonciation et l'noncia-teur
que nous allons exercer notre vigilance critique.
A premire vue, ce rapport ne parait pas faire problme. Si la rflexion
du fait de renonciation dans l'nonc, pour reprendre la formule de
Rcanati, introduit un degr d'opacit au cur de la vise rfrentielle
qui traverse le sens de l'nonc, il ne semble pas d'abord que le rapport
- interne renonciation - entre l'acte de discours en tant qu'acte et son
auteur soit en lui-mme opaque ; il n'y a pas lieu en somme de
supposer que le sujet de renonciation doive constituer l'opaque de
l'opaque.
L'implication de l'nonciateur dans renonciation n'est-elle pas
dcele sans ambigut par la possibilit d'adjoindre la formule
dveloppe des performatifs explicites - j'affirme que, j'ordonne
que, je promets que - tous les actes illo-cutoires ? N'est-ce pas
dans ce prfixe mme que le je est marqu, et n'est-ce pas travers ce
prfixe que le je atteste sa prsence en toute nonciation ' ?
I. C'est un problme de savoir si le lien entre le je et renonciation qui l'in-
clut ne relve pas de la problmatique plus vaste de l'attestation que nous avons
vu affleurer une premire fois l'occasion du rapport description des prdicats
psychiques l'entit personnelle. La question ne cessera de se prciser dans les
tudes qui suivent.
En outre, la faveur de cette mention du sujet dans le prfixe
intensionnel des noncs extensionnels, il devient possible de
regrouper, comme deux grands ensembles coordonns sous l'gide de
la pragmatique, la thorie des actes de discours qu'on vient de rsumer
et la thorie des indicateurs voque une premire fois sous le titre des
procdures d'individualisation, donc dans la perspective d'une
smantique rfrentielle. Ce regroupement s'avre bnfique pour
chacun des deux partenaires. D'une part, l'analyse des actes de discours
trouve dans le fonctionnement des indicateurs le complment requis
pour arrimer, si l'on peut dire, l'nonciateur renonciation. D'autre
part, les indicateurs - je , ceci , ici , maintenant - sont
dissocis des deux autres catgories d'oprateurs d'individualisation
introduits dans la premire tude, savoir les noms propres et les
descriptions dfinies, lesquels sont renvoys la smantique, tandis que
les premiers sont attirs dans l'espace de gravitation de la pragmatique.
Bien plus, en mme temps que les indicateurs pris en bloc sont
dtachs du lot des oprateurs d'individualisation, le je est son tour
promu au premier rang des indicateurs, lesquels, pris en dehors du
rapport de rflexivit de renonciation, ne prsentent aucun ordre
privilgi. Mis en rapport avec l'acte d'nonciation, le je devient le
premier des indicateurs ; il indique celui qui se dsigne lui-mme dans
toute nonciation contenant le mot je , entranant sa suite le tu de
l'interlocuteur. Les autres indicateurs - les dictiques : ceci , ici ,
maintenant - se regroupent autour du sujet de renonciation : ceci
indique tout objet situ dans le voisinage de l'nonciateur ; ici est le
lieu mme o celui-ci se tient ; maintenant dsigne tout vnement
contemporain de celui o l'nonciateur prononce l'nonciation.
En devenant ainsi le pivot du systme des indicateurs, le je se
rvle dans son tranget par rapport toute entit susceptible d'tre
range dans une classe, caractrise ou dcrite. Je dsigne si peu le
rfrent d'une rfrence identifiante que ce qui parat en tre la
dfinition, savoir: toute personne qui se dsigne elle-mme en
parlant , ne se laisse pas substituer aux occurrences du mot je . Il n'y a
pas d'quivalence, au point de vue rfrentiel, entre je suis content et
la personne qui se dsigne est contente ; cet chec de l'preuve de
substitution est ici dcisif; il atteste que l'expression n'appartient pas
l'ordre des entits susceptibles d'tre identifies par voie rfrentielle. Le
60 61
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
L'NONCIATION ET LE SUJET PARLANT
foss logique est donc profond entre la fonction d'index qui est
celle du je et celle de rfrent au sens de la premire tude
1
.
La singularit du fonctionnement des indicateurs, qui vient de
conforter la thorie des actes de discours, est confirme par un trait
dcisif avec lequel nous terminerons la revue des acquis de la
pragmatique concernant la position du sujet dans le discours. Ce
trait scelle l'autonomie de la prsente approche du sujet par rapport
l'approche travers la rfrence identifiante. La dichotomie entre
les deux approches est marque de faon spectaculaire par le
traitement oppos qu'elle propose des pronoms personnels. Alors
que, dans l'approche rfrentielle, c'est la troisime personne qui est
privilgie, ou du moins une certaine forme de la troisime
personne, savoir lui/elle, quelqu'un, chacun , on , la
thorie des indicateurs, une fois accole celle des actes de
discours, non seulement privilgie la premire et la deuxime
personne, mais exclut expressment la troisime personne. On a
prsent l'esprit l'anathme de Benveniste contre la troisime
personne
2
. Selon lui, seules la premire et la deuxime personne
grammaticales mritent ce nom, la troisime tant la non-personne.
Les arguments en faveur de cette exclusion se ramnent un seul : il
suffit du je et du tu pour dterminer une situation
d'interlocution. La troisime personne peut tre n'importe quoi dont
on parle, chose, animal ou tre humain : le confirment les usages
incoordonnables entre eux du pronom il - il pleut, il faut, il y a,
etc. -, ainsi que la multiplicit des expressions de la troisime
personne - on, chacun, a, etc. Si la troisime personne est si
inconsistante grammaticalement, c'est qu'elle n'existe pas comme
personne, du moins dans l'analyse du langage qui prend comme
unit de compte l'instance du discours, investie dans la phrase. On
ne peut mieux souder la premire et la deuxime personne
l'vnement de renonciation qu'en excluant du champ de la
pragmatique la troisime personne, dont il est parl seulement
comme d'autres choses.
Cela dit, ce pacte nou entre renonciation et les indicueurs
je-tu. suivis des dictiques ceci, ici, maintenant.
1. Lui correspond une diffrence, galement trs connue depuis Wittgenstein,
entre dcrire et montrer . Le je peut tre indiqu ou montr, non rfr
ou dcrit. On en tirera quelques consquences plus loin.
2. E. Benveniste, Problmes delinguistiquegnrale, Paris, Gallimard, 1966 ;
Le langage et l'exprience humaine , Problmes du langage, Paris, Gallimard,
coll. Diogne . 1966. repris dans Problmes delinguistiquegnraleII, Paris,
Gallimard, 1974.
rend-il impossible toute discordance entre la thorie de renonciation
et celle de son sujet ?
Deux ou trois notations que nous avons laiss passer inaperues
auraient d pourtant nous alerter : la premire concerne le terme
matre de la thorie des actes de discours : qui est prcisment
Yacte. et non l'agent, et, dans l'acte, la force illocutoire, c'est--dire,
selon la dfinition qu'en donne G.G. Granger, ce qui permet de
donner aux messages des fonctions spcifiques de communication
ou permet de prciser les conditions de leur exercice ' . L' lment
illocutoire , selon l'expression prudente de Granger. peut tre
dfini et soumis une typologie fine, sans qu'il soit fait
expressment mention de l'auteur du discours. C'est au prix de cette
lision que les conditions transcendantales de la communication
peuvent tre entirement dpsychologises et tenues pour des
rgulations de la langue, non de la parole. Mais jusqu'o peut aller la
depsychologisation, si un ego doit encore tre pris en compte ?
Une seconde notation reste non souligne augmente notre per-
plexit : la rflexivit dont il a t question jusqu' prsent a t
constamment attribue, non au sujet de renonciation, mais au fait
mme de renonciation : je rappelle la formule de Rcanati : dans
le sens d'un nonc se rflchit le fait de son nonciation (La
Transparence et l'nonciation, p. 7). Une telle dclaration devrait
nous tonner dans la mesure o elle attache la rflexivit
renonciation traite comme un fait, c'est--dire comme un vne-
ment qui se produit dans le monde. Ce qu'on appelait tout l'heure
acte est devenu un fait, un vnement qui a lieu dans l'espace
commun et dans le temps public - bref, un fait survenant dans le
mme monde que les faits et les tats de choses viss
rf-rentiellement par les noncs dclaratifs ou assertifs.
Finalement, c'est le statut de chose du signe, dont on a dit plus
haut qu'il marque l'opacit mme du signe, que la rflexion du fait
de renonciation dans le sens de l'nonc fait passer au premier plan.
A cet gard, les dclarations de Rcanati sont sans quivoque : un
nonc est par son nonciation quelque chose (ibid., p. 26); et
encore: renonciation (...) se pose comme un tant... (ibid., p. 27).
A la limite, il faudrait dire que la rflexivit n'est pas
intrinsquement lie un soi au sens fort d'une conscience de soi. A
travers la formule : dans le sens d'un nonc se rflchit le fait de
son nonciation , l'expression se rflchit pourrait tout aussi
bien tre remplacs par se
1. G.G. Granger, Langages et pistmologie, Paris, Klincksieck, 1979, p. 170.
62
63
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
L'NONCIATION ET LE SUJET PARLANT
reflte. Le paradoxe ici ctoy est celui d'une rflexivit sans ipsit ;
un se sans soi-mme ; pour dire la mme chose autrement, la
rflexivit caractristique du faire de renonciation ressemble plus une
rfrence inverse, une rtro-rfrence, dans la mesure o le renvoi se
fait la /actualit qui opacifie l'nonc. Du mme coup, au lieu
d'opposer entre elles une rflexivit rebelle toute caractrisation en
termes de rfrence et la vise d'un fait extra-linguistique, qui seul vaut
comme vise rf-rentielle, on oppose seulement sw/'-rfrence
rfrence ad extra. Mais rflexivit et sui-rfrence sont-elles deux
notions quivalentes ? Le je ne disparat-il pas en tant que je, ds lors
que l'on confre l'nonc deux rfrences de direction opposes, une
rfrence vers la chose signifie et une rfrence vers la chose signifiante
? Le glissement tait en fait contenu dans la dfinition du signe reue des
Anciens : une chose qui reprsente une autre chose. Or, comment un
acte peut-il n'tre qu'une chose ? Plus gravement, comment le sujet qui
rfre et signifie, peut-il tre dsign comme une chose tout en restant
un sujet ? N'a-t-on pas perdu l de vue deux des conqutes les plus
prcieuses de la thorie de renonciation, savoir :
1) que ce ne sont pas les noncs, ni mme les nonciations, qui
rfrent, mais, on l'a rappel plus haut, les sujets parlants, usant des
ressources du sens et de la rfrence de l'nonc pour changer leurs
expriences dans une situation d'interlocution ;
2) que la situation d'interlocution n'a valeur d'vnement que dans la
mesure o les auteurs de renonciation sont mis en scne par le discours
en acte et, avec les nonciateurs en chair et en os, leur exprience du
monde, leur perspective sur le monde quoi aucune autre ne peut se
substituer ?
Cette drive de la pragmatique vers un concept de sui-rfrence,
o l'accent principal est mis sur la /actualit de renonciation, ne peut tre
enraye que si l'on veut bien s'arrter un moment un certain nombre
de paradoxes, voire d'apories, sur lesquels ouvre la pragmatique, ds
lors qu'on interroge le statut du sujet de renonciation en tant que tel, et
non pas seulement l'acte de renonciation trait comme un fait, titre
d'vnement qui arrive dans le monde, dans ce monde mme auquel
appartiennent les choses auxquelles nous faisons rfrence ad extra.
Affronter ces paradoxes et apories, c'est se placer dans le droit-fil de la
question qui ? - qui parle ? -, telle que nous l'avons vue ouvrir la
problmatique de Videntification.
Le premier paradoxe est le suivant : l'expression je est frap-
pe d'une trange ambigut : Husserl parlait cet gard d'expression
ncessairement ambigu. D'un ct, je, en tant que pronom
personnel appartenant au systme de la langue, est un membre du
paradigme des pronoms personnels. A ce titre, c'est un terme vacant qui,
la diffrence des expressions gnriques qui gardent le mme sens
dans des emplois diffrents, dsigne chaque fois une personne diffrente
chaque emploi nouveau ; je, en ce premier sens, s'applique
quiconque en parlant se dsigne lui-mme et qui, en assumant ce mot,
prend en charge le langage tout entier, selon la belle expression de
Benveniste. A ce titre de terme vacant, je est un terme voyageur, une
position l'gard de laquelle plusieurs nonciateurs virtuels sont substi-
tumes l'un l'autre ; d'o le terme de shifter qui a t attribu tous les
termes similaires dans la srie des dictiques, et que traduit mal le
franais embrayeur , moins que, de la mtaphore mcanique, on
retienne le phnomne prcis du changement d'embrayage : savoir
l'assignation du terme vacant un seul nonciateur effectif actuel, qui
assume, hic et nunc, la force illo-cutoire de l'acte d'nonciation. Mais, du
mme coup, on a bascul d'un sens l'autre de l'expression je. Ce
n'est plus l'aspect substituable du terme voyageur, du shifter, que l'on
souligne, mais au contraire la fixation qu'opre la prise de parole. Nous
sommes passs du point de vue paradigmatique, en vertu duquel je
appartient au tableau des pronoms, au point de vue syntag-matique,
en vertu duquel je ne dsigne chaque fois qu'une personne
l'exclusion de toute autre, celle qui parle ici et maintenant. Appelons avec
G.G. Granger ' ancrage ce renvoi une position non substituable, un
unique centre de perspective sur le monde. Le paradoxe consiste trs
prcisment dans la contradiction apparente entre le caractre
substituable du shifter et le caractre non substituable du phnomne
d'ancrage.
On peut certes donner une explication de ce premier paradoxe sans
sortir de la pragmatique ; mais la solution propose ne fera que reporter
d'un degr la difficult. L'explication en question repose sur la
distinction venue de Peirce entre type et token
1
-type et chantillon -,
que l'on prendra bien garde de confondre avec celle du genre et du
particulier, dans la mesure o elle ne
1. G.G. Granger, ibid., p. 174-175. L'exploration des paradoxes attenant au
sujet de renonciation reste fortement redevable cet ouvrage.
2. Cf. C.S. Peirce, Coltected Papers, IV, 537, cit par F. Rcanati, La Trans-
parenceet l'nonciation, op. cit., p. 724 ; cf. galement C.S. Peirce, Ecrits sur le
signe, rassembls, traduits et comments par G. Deledalle, Paris, d. du Seuil,
coll. L'ordre philosophique, 1978, p. 190.
64
65
SOI-MME COMME UN AUTRE
L'NONCIATION ET LE SUJET PARLANT
vaut que pour les index. Le type est de l'ordre du chaque fois ,
l'chantillon est de l'ordre du une seule fois , sur le plan effectif
de l'instance de discours. Entre les deux, toute contradiction
disparat, si l'on veut bien considrer que le type implique dans sa
notion mme un choix obligatoire entre les candidats au poste de
sujet parlant '. En vertu de ce choix obligatoire, le shifter exerce une
fonction de distribution, prenant appui sur le chaque fois qui
rgle l'assignation exclusive du terme je un seul locuteur actuel.
On peut alors dire, sans plus de paradoxe, que l'ancrage actuel de
l'chantillon je est corrlatif au caractre substituable du type
je, au sens distributif et non gnrique de la constitution de
l'index. Nous retrouvons Husserl : l'amphibologie du je est celle
d'une signification ncessairement occasionnelle. Le terme
occasionnel a le sens trs prcis de relier le chaque fois du type
au une seule fois de l'chantillon.
Cette distinction entre type et chantillon limine-t-elle tout
paradoxe concernant le je ? On peut en douter, si l'on considre
qu'elle est parfaitement compatible avec une interprtation de la
rflexivit dans le sens de la sui-rfrence, c'est--dire d'un renvoi
la factualit d'un vnement spatio-temporel arrivant dans le
monde. C'est de l'acte de renonciation, entendu comme un fait
mondain, qu'on peut dire qu'il n'a lieu qu'une seule fois et n'a
d'existence que dans l'instant o renonciation est produite. On parle
alors des occurrences diffrentes d'un mme signe, ne diffrant
numriquement que par leur position spatio-temporelle, mais
illustrant le mme type. Le signe en question, c'est l'acte
d'nonciation trait comme un fait. Le je n'est plus alors vis
qu'obliquement, savoir comme expression marque l'intrieur
d'un performatif explicite de la forme: j'affirme que, j'ordonne
que, je promets que, etc.
Que la distinction entre type et chantillon ait pour enjeu privi-
lgi renonciation plutt que l'nonciateur, cela est confirm par les
analyses d'une grande technicit, dans lesquelles je n'entrerai pas,
des expressions dites token-reflexives. Ces expressions sont certes
des nonciations justiciables de la thorie des actes de discours ;
mais d'elles on n'a aucune peine dire qu'elles renvoient un fait
qui a lieu dans l'espace et dans le temps public, bref dans
1. A la diffrence de la substituabilit de l'nonciateur caractristique du shifter,
observe Granger, la fixation du renvoi de chaque message constitue un choix
obligatoire, rgulateur de la communication (Langages et Epistmologie. op. cit.,
p. 174).
le monde
1
. Par l est lud le paradoxe, qui ne surgit que lorsqu'on
thmatise pour lui-mme le sujet de renonciation. Mais ce paradoxe
ne peut tre plus longtemps occult, ds lors que l'on affronte
l'tranget du rapport que peut avoir un locuteur singulier avec la
multiplicit de ses nonciations. Si celles-ci constituent chacune un
vnement diffrent, susceptible de prendre place dans le cours des
choses du monde, le sujet commun de ces multiples vnements
est-il lui-mme un vnement
2
? On se rappelle les hsitations de
Husserl thmatiser de manire distincte Vego du cogito cogitatum.
On n'a pas oubli non plus les difficults attaches des expressions
mtaphoriques telles que Ich-strahl, rayon du moi , ou Ichpol,
moi comme ple identique des actes , pour caractriser la sorte de
rayonnement ou d'manation qui exprime le rapport d'un locuteur
unique la multiplicit de ses actes de discours.
C'est ici que le paradoxe se transforme en aporie. Le rapport
type-chantillon n'est plus en effet d'aucun secours, ni non plus le
rapport entre le je voyageur (shifter) et le je ancr. Ce qui est
en question, c'est la notion mme d'ancrage du je chantillon.
Quel sens attacher en effet l'ide d'un point de perspective
singulier sur le monde ? L'aporie qui nous arrte ici est celle sur
laquelle Wittgenstein n'a cess de revenir du Tractatus aux Inves-
tigations et au Cahier bleu. Je l'appellerai l'aporie de l'ancrage. Le
point de perspective privilgi sur !e monde, qu'est chaque sujet
parlant, est la limite du monde et non un de ses contenus
3
. Et
1. Cf. Recanati, La Transparence et l'nonaaiion, op ci:., p. 153-171 (chap. vin,
La token-rflcxivit . ...renonciation, par quelqu'un, de cette phrase [l'eau bout
cent degrs], le fait, pour quelqu'un, de dire cela, est un vnement qui a lieu,
comme tout vnement, un certain moment et en un certain lieu : cet vnement
spatio-temporelement dtermin, c'est le dire, ou renonciation. Le fait de dire
quelque chose est un vnement, comme le fait de se casser une jambe, comme le
fait de recevoir une dcoration, comme le fait de natre ou de mourir L'expression "
le fait de dire " souligne l'vnementialit de l'nonciation. en tant qu'elle est un fait
: un fait, c'est, avant tout, quelque chose qui " a Heu ", ou qui " est le cas ", selon
l'expression anglaise (ibid.. p. 1 53).
2. La question du statut de l'vnement dans une enqute sur i'ipsit reviendra
plusieurs fois au cours de cet ouvrage, en particulier dans la discussion des thses
de Donald Davidson sur l'action (troisime tude) et de celles de Dcrek Parfit sur
l'identit personnelle (sixime tude).
3 Granger dit trs bien : Le renvoi renonciation n'est pas du mme ordre que
les renvois proprement smantiques L'nonciation ne se trouve pas alors repre
dans le monde dont on parle : elle est prise comme rfrence limite de ce monde ..
(Langages et Epistmologie. op. cit., p. 174). La clause restrictive sur iaquelle
s'achve la citation ne prendra tout son sens qu' travers la tentative que nous
faisons plus loin pour conioindre rflexivit et rfrentialit.
66
67
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
L'NONCIATION ET LE SUJET PARLANT
pourtant, d'une certaine faon, qui devient nigmatique, aprs avoir
paru aller de soi, Yego de renonciation apparat dans le monde, comme
l'atteste l'assignation d'un nom propre au porteur du discours. C'est en
effet moi, un tel, moi P.R., qui suis et qui ne suis pas la limite du
monde. A cet gard, le texte suivant du Cahier bleu porte haut l'aporie :
Par je (dans "je vois "), je n'ai pas voulu dire : L.W., quoique,
m'adressant autrui, je pourrais dire : " C'est maintenant L.W. qui voit
rellement ", encore que ce ne soit pas cela que j'aie voulu dire (Cahier
bleu, p. 66-67) '. La non-concidence entre le je limite du monde et
le nom propre qui dsigne une personne relle, dont l'existence est
atteste par l'tat civil, conduit l'aporie ultime du sujet parlant.
L'aporie restait occulte dans une version de la pragmatique selon
laquelle le renvoi rflexif se faisait moins l'ego de renonciation qu'au
fait de renonciation, trait comme un vnement du monde. La
rflexivit pouvait alors sans difficult apparente tre assimile une
sorte subtile de rfrence, la rfrence l'vnement du monde qu'est
renonciation. L'nonciation s'alignait ainsi sur les choses du monde
dont on parle. Cette assimilation n'est plus possible, du moins sans qu'on
ait pris en considration l'aporie de l'ancrage, ds lors que l'accent tombe
sur l'acte dans le fait de renonciation et sur le je-tu dans cet acte.
3. La conjonction des deux voies de la philosophie du langage
C'est pour rsoudre cette aporie qu'il faut, mon avis, faire converger
les deux voies de la philosophie du langage, la voie de la rfrence
identifiante et celle de la rflexivit de renonciation. Au terme de la
premire voie, on s'en souvient, la personne apparaissait comme un
particulier de base irrductible tout autre :
1. Texte cit et traduit par Granger, ibid., p. 175. Granger cite encore : Le mot
jene veut pas dire la mme chose que L. W ni ne veut dire la mme chose que
l'expression : la personne qui parle maintenant. Mais cela ne signifie pas que L. W.
et jeveuillent dire des personnes diffrentes. Tout ce que cela signifie est que ces
mots sont des instruments diffrents dans notre langage (ibid.). On comparera
les traductions par Granger avec celles de Guy Durand (Wittgenstein, LeCahier
bleu et leCahier brun. Paris, Gallimard, 1965, repris en coll. Tel , Paris, Galli-
mard. 1988, p. 145, 147). Granger voit essentiellement dans cette aporie la confir-
mation du caractre non empirique des conditions de possibilit de la communi-
cation : Si l'on adopte cette vue, on voit que le phnomne d'ancrage, en tant
que position privilgie d'un centre de perspective, exprime bien une condition
non empirique de la communication complte d'une exprience (ibid.).
elle tait le lui dont on parle et qui on attribue des prdicats
physiques et psychiques. Au terme de la seconde voie, le sujet apparat
comme le couple de celui qui parle et de celui qui le premier parle,
l'exclusion de la troisime personne, devenue une non-personne. Or la
convergence des deux entreprises est assure par les emprunts que
chacune doit faire l'autre pour accomplir son propre dessein. On se
souvient que la troisime personne selon la thorie de la rfrence
identifiante n'acquiert sa signification complte de personne que si
l'attribution de ses prdicats psychiques est accompagne , pour
reprendre le mot de Kant, par la capacit de se dsigner soi-mme,
transfre de la premire la troisime personne, la faon d'une
citation place entre guillemets. L'autre, la tierce personne, dit dans son
cur : j'affirme que. Voici maintenant que le phnomne d'ancrage
ne devient comprhensible que si le je du j'affirme que est extrait
du prfixe d'un verbe d'action et pos pour lui-mme comme une
personne, c'est--dire un particulier de base parmi les choses dont on
parle. Cette assimilation entre le je qui parle toi et le lui/elle
dont on parle opre en sens inverse de l'assignation au lui/elle du
pouvoir de se dsigner soi-mme. Le rapprochement consiste cette fois
dans une objectivation d'un type unique, savoir l'assimilation entre
le je, sujet dnonciation, et la personne, particulier de base
irrductible. La notion de sui-rfrence, dont on suspectait plus haut la
cohrence, est en fait le mixte issu du recroisement entre rflexivit et
rfrence identifiante.
Avant de poser la question de savoir si ce mixte du je rflexif et
de la personne rfre n'est pas arbitrairement constitu, autrement dit
s'il s'agit de plus que d'un fait de langage invitable, certes, mais
impossible driver de quoi que ce soit de l'ordre du fondamental, il
importe de montrer que l'entrecroisement des deux voies de la
philosophie du langage rgit le fonctionnement de tous les indicateurs et
peut tre repr partir d'oprations linguistiques trs prcises.
Le dictique maintenant offre un bon point de dpart pour cette
dmonstration, puisque aussi bien c'est la caractrisation de renonciation
comme vnement, ou instance de discours, qui a donn l'occasion
d'assimiler l'acte de langage un fait. En outre, je dispose ici d'une
analyse dtaille du dictique temporel que j'emprunte mon travail
antrieur, Temps et Rcit III. J'ai essay de dmontrer dans cet ouvrage
que ce que nous dsignons du terme maintenant rsulte de la
conjonction entre le prsent vif
68 69
SOI-MME COMME UN AUTRE
L'NONCIATION ET LE SUJET PARLANT
de l'exprience phnomnologique du temps et l'instant quelconque
de l'exprience cosmologique. Or cette conjonction ne consiste pas
dans une simple juxtaposition entre des notions appartenant des
univers de discours distincts ; elle repose sur des oprations prcises
qui assurent ce que j'ai appel l'inscription du temps
phnomnologique sur le temps cosmologique et dont le modle est
l'invention du temps calendaire. De cette inscription rsulte un
maintenant dat. Sans date, la dfinition du prsent est purement
rflexive : arrive maintenant tout vnement contemporain du
moment o je parle ; rduite elle-mme, la sui-rfrence du
moment de la parole n'est que la tautologie du prsent vif: c'est
pourquoi nous sommes toujours aujourd'hui. Nous sortons de la
tautologie en posant la question : quel jour sommes-nous ? La
rponse consiste donner une date ; c'est--dire faire correspondre
le prsent vif avec un des jours dnombrs par le calendrier. Le
maintenant dat est le sens complet du dictique maintenant .
11 en est de mme du ici : il s'oppose au l-bas , comme
tant le lieu o je me tiens corporellement ; ce lieu absolu a le mme
caractre de limite du monde que l'ego de renonciation ; la
mtaphore spatiale de l'orientation dans l'espace est mme l'ori-
gine de l'ide du sujet comme centre de perspective non situ dans
l'espace occup par les objets de discours ; absolument parlant, ici
, en tant que lieu o je me tiens, est le point zro par rapport auquel
tous les lieux deviennent proches ou lointains. En ce sens, ici
n'est nulle part. Et pourtant, l'emploi du ici dans la conversation
implique un savoir topographique minimum, grce auquel je puisse
situer mon ici par rapport un systme de coordonnes dont le point
origine est aussi quelconque que l'instant du temps cosmologique.
Le lieu fonctionne ainsi comme la date, savoir par inscription du
ici absolu sur un systme de coordonnes objectives. En vertu de
cette inscription, comparable au phnomne de la datation, la
signification complte du dictique ici est celle d'un ici localis.
Des dictiques maintenant et ici , nous pouvons revenir
aux indicateurs je-tu . La conjonction entre le sujet, limite du
monde, et la personne, objet de rfrence identifiante, repose sur un
processus de mme nature que l'inscription, illustre par la datation
calendaire et la localisation gographique. Que le phnomne
d'ancrage soit assimilable une inscription, l'expression qui
intriguait tellement Wittgenstein, savoir l'expression : moi, L.W.
, l'atteste souhait. Le rapport entre le pronom per-
sonnel je, pris comme sujet d'attribution, et le nom propre,
comme dsignation de l'chantillon d'un particulier de base, est un
rapport d'inscription au sens institutionnel du terme. Je est
littralement inscrit, en vertu de la force illocutoire d'un acte de
discours particulier, Y appellation, sur la liste publique des noms
propres, suivant les rgles conventionnelles qui rgissent
l'attribution des patronymes et des prnoms (ainsi, en France et dans
d'autres pays, le patronyme est impos par les rgles de parent -
rgles matrimoniales, rgles de filiation - et le prnom choisi de
faon relativement libre par des parents lgaux, donc par d'autres
que le porteur du nom ; en ce sens, l'appellation est de part en part un
acte d'inscription). L'expression est si bien approprie que ce qu'on
appelle l'acte de naissance d'une personne contient une triple
inscription : un nom propre conforme aux rgles d'appellation qu'on
vient de dire, une date conforme aux rgles de la datation
calendaire, un lieu de naissance conforme aux rgles de localisation
dans l'espace public, le tout inscrit sur les registres de l'tat civil.
Ainsi inscrit, le je est, au sens propre du terme, enregistr. De cet
enregistrement rsulte ce qui s'nonce : Moi, un tel, n le..., ...
De cette manire, je et P.R. veulent dire la mme personne.
Ce n'est donc pas arbitrairement que la personne, objet de rfrence
identifiante, et le sujet, auteur de renonciation, ont mme
signification ; une inscription d'un genre spcial, opre par un acte
spcial d'noncia-tion, Y appellation, opre la conjonction.
Une dernire question nous arrtera au seuil de notre conclusion
provisoire. Peut-on fonder cette assimilation entre la personne de la
rfrence identifiante et le je chantillon rflexif sur une ralit
plus fondamentale ?
On ne le peut, mon avis, qu'en sortant de la philosophie du
langage et en s'interrogeant sur la sorte d'tre qui peut ainsi se prter
une double identification en tant que personne objective et que
sujet rflchissant. Le phnomne d'ancrage suggre de lui-mme la
direction dans laquelle il faudrait s'engager ; c'est celle mme que
l'analyse prcdente a dj indique, savoir la signification
absolument irrductible du corps propre. On se souvient que la
possibilit d'attribuer la mme chose des prdicats physiques et
psychiques nous avait paru fonde dans une structure double du
corps propre, savoir son statut de ralit physique observable et
son appartenance ce que Husserl appelle, dans la cinquime
Mditation cartsienne, la sphre du propre ou du mien . La
mme allgeance double de corps propre fonde la
70
71
SOI-MME COMME UN AUTRE
structure mixte du je-un t el ; en tant que corps parmi les corps, il
constitue un fragment de l'exprience du monde ; en tant que mien,
il partage le statut du je entendu comme point de rfrence limite
du monde ; autrement dit, le corps est la fois un fait du monde et
l'organe d'un sujet qui n'appartient pas aux objets dont il parle. Cette
trange constitution du corps propre s'tend du sujet de renonciation
l'acte mme d'nonciation : en tant que voix pousse au-dehors par
le souffle et articule par la phonation et toute la gestuelle,
renonciation partage le sort des corps matriels. En tant
qu'expression du sens vis par un sujet parlant, la voix est le
vhicule de l'acte d'nonciation en tant qu'il renvoie au je, centre
de perspective insubstituable sur le monde.
Ces brves rflexions anticipent le moment o il faudra sortir du
plan langagier sur lequel nous nous tenons strictement dans cette
premire srie d'investigations. L'trange statut du corps propre
relve d'une problmatique plus vaste qui a pour enjeu le statut
ontologique de cet tre que nous sommes, qui vient au monde sur le
mode de la corporit.
TROISIME TUDE
Une smantique de l'action
sans agent
Les deux tudes qui suivent sont consacres la thorie de l'ac-
tion, au sens limitatif que ce terme a pris dans les ouvrages de
langue anglaise placs sous ce titre. Elles entretiennent avec les
prcdentes un rapport d'une grande complexit. D'un ct, la
philosophie du langage qu'on vient d'exposer joue l'gard de la
thorie de l'action le rle d'organon, dans la mesure o cette thorie
met en uvre, dans la description qu'elle offre des phrases d'action,
les analyses devenues classiques de la rfrence identifiante et des
actes de discours. De l'autre ct, les actions sont des entits si
remarquables, et le lien entre l'action et son agent constitue une
relation si originale, que la thorie de l'action est devenue bien autre
chose qu'une simple application de l'analyse linguistique esquisse
ci-dessus. Bien plus, en conqurant l'autonomie d'une discipline
distincte, la thorie de l'action a fait apparatre, comme par choc en
retour, des ressources nouvelles du langage, tant dans sa dimension
pragmatique que dans sa dimension smantique. Du mme coup, les
difficults, paradoxes, apories sur lesquelles les prcdentes tudes
avaient dbouch prennent des proportions nouvelles dans le cadre
nouveau de la thorie de l'action.
Cette complexit du rapport entre thorie du langage et thorie de
l'action sera mise l'preuve, d'abord au cours de la prsente tude
dans la ligne de la smantique philosophique, puis au cours de
l'tude suivante dans la ligne de la pragmatique du langage. C'est
chaque fois l'nigme du rapport entre l'action et son agent qui sera
sonde, mais avec des ressources diffrentes tenant la distinction
initiale entre smantique et pragmatique. Qu'est-ce que l'action,
demanderons-nous, enseigne sur son agent ? Et dans quelle mesure
cet enseignement ventuel contribue-t-il prciser la diffrence
entre ipse et idem ?
Deux remarques pralables s'imposent au seuil de la prsente
73
SOI-MME COMME UN AUTRE
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
tude. Il doit d'abord tre entendu que, dans une smantique de
l'action, il peut tre question de l'agent de l'action, de la mme faon
que, dans l'analyse des particuliers de base de notre premire tude,
la personne dont on parle a pu tre dsigne comme l'entit
laquelle des prdicats d'ordres diffrents sont attribus (ascrits).
Mais le recours explicite la rflexivit de renonciation par quoi le
sujet du discours se dsigne lui-mme n'est pas du ressort d'une
smantique axe sur la rfrence identifiante. Cette premire
limitation doit tre reconnue ds le dpart, si l'on ne veut pas tre
du par la relative minceur des rsultats de la thorie de l'action,
pourtant si riche en analyses rigoureuses, sur le point prcis de la
dtermination conceptuelle de l'agent de l'action. Ce n'est vrai dire
qu'au terme de la prochaine tude qu'il sera possible d'entrecroiser
la voie de la rfrence identifiante et celle de l'autodsignation du
sujet parlant, et ainsi de thmatiser de faon explicite la rfrence
soi d'un sujet agissant.
La seconde limitation de la prsente enqute concerne
l'troi-tesse du champ des exemples couverts par le concept
d'action. Il sera certes question de chanes d'actions, l'occasion
principalement de l'analyse du raisonnement pratique ; mais on
mettra entre parenthses le principe unificateur qui fait de ces
chanes d'actions ces units pratiques de rang suprieur que nous
appellerons dans une tude ultrieure des pratiques. Or cette
seconde limitation a des consquences importantes : ne parlant pas
des pratiques dignes de ce nom - techniques, mtiers, arts, jeux -,
nous ne prendrons pas non plus en compte les procdures de hi-
rarchisation entre pratiques qui autorisent parler de l'unit nar-
rative d'une vie. Or, cette mise entre parenthses de tout principe
unificateur intrieur aux pratiques et de toute hirarchisation entre
pratiques enchane son tour l'abstraction des prdicats thiques de
la famille soit du bon. soit du juste ; seules, en effet, les units
pratiques de rang suprieur assument de faon explicite, outre
l'enchanement logique dont il sera parl ici, une signification
tlologique selon le bon et dontologique selon le juste. Cette
seconde limitation est parfaitement lgitime, dans la mesure o la
smantique de l'action se borne par principe dcrire et analyser les
discours dans lesquels l'homme dit son faire, l'exclusion de toute
attitude prescriptive en termes de permis et de dfendu. Dans cette
mesure mme, l'agent de l'action sera loin de pouvoir s'galer un
soi responsable de sa parole et de son action. Il ne faudra donc pas
s'tonner si l'auteur de l'action apparat lui-mme comme un agent
thiquement neutre, soustrait )a louange et au blme.
1. Le schma conceptuel de l'action et la question qui ?
En premire approximation, l'enqute parat prometteuse quant
la rfrence de l'action son agent. Action et agent appartiennent
un mme schme conceptuel, lequel contient des notions telles que
circonstances, intentions, motifs, dlibration, motion volontaire ou
involontaire, passivit, contrainte, rsultats voulus, etc. Le caractre
ouvert de cette numration est ici moins important que son
organisation en rseau. Ce qui importe en effet la teneur de sens de
chacun de ces termes, c'est leur appartenance au mme rseau que
tous les autres ; des relations d'intersignification rgissent ainsi leur
sens respectif, de telle faon que savoir se servir de l'un d'entre eux,
c'est savoir se servir de manire signifiante et approprie du rseau
entier. Il s'agit d'un jeu de langage cohrent, dans lequel les rgles
qui gouvernent l'emploi d'un terme forment systme avec celles qui
gouvernent l'emploi d'un autre terme. En ce sens, le rseau notionnel
de l'action partage le mme statut transcendantal que le cadre
conceptuel des particuliers de base. A la diffrence, en effet, des
concepts empiriques labors par les sciences humaines, de la
biologie la sociologie, le rseau entier a pour fonction de dter-
miner ce qui compte comme action, par exemple dans les
sciences psychologiques du comportement et dans les sciences
sociales de la conduite. C'est la spcificit de ce rseau par rapport
la dtermination gnrale du concept de personne, acquise dans la
premire tude, qui nous importe dsormais.
Une manire efficace de procder la dtermination mutuelle
des notions appartenant ce rseau de l'action est d'identifier la
chane des questions susceptibles d'tre poses au sujet de l'action :
qui fait ou a fait quoi, en vue de quoi, comment, dans quelles
circonstances, avec quels moyens et quels rsultats ? Les notions
cls du rseau de l'action tirent leur sens de la nature spcifique des
rponses portes des questions spcifiques qui elles-mmes
s'entre-signifient : qui ? quoi ? pourquoi ? comment ? o ? quand ?
On voit en quel sens cette mthode d'analyse parat prometteuse :
un accs privilgi au concept d'agent nous est donn par les
rponses que nous faisons la question qui ?. Ce que Strawson
appelait la mme chose quoi sont attribus prdicats psy-
74
75
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
chiques et prdicats physiques devient maintenant un quelqu'un en
rponse la question qui ?. Or cette question rvle une affinit certaine
avec la problmatique du soi telle que nous l'avons dlimite dans
l'introduction. Chez Heidegger, l'investigation du qui ?
x
appartient la
mme circonscription ontologique que celle du soi (Selbstheit). Hannah
Arendt
2
, lui faisant cho, rattache la question qui ? une spcification
propre celle du concept d'action, qu'elle oppose celui de travail et
celui d'oeuvre. Alors que le travail s'extriorise entirement dans la chose
fabrique, et que l'uvre change la culture en s'incarnant dans des
documents, des monuments, des institutions, dans l'espace
d'apparition ouvert par la politique, l'action est cet aspect du faire
humain qui appelle rcit. A son tour, c'est la fonction du rcit de
dterminer le qui de l'action . En dpit de ces affinits manifestes
entre la thorie de l'action et la phnomnologie hermneutique, on
aurait tort de croire que la premire puisse conduire aussi loin. Chez
Heidegger, c'est la dpendance de la problmatique du Selbst l'gard de
l'existential Dasein qui entrane le qui dans le mme espace
ontologique de gravitation. Quant au qui de H. Arendt, il est
mdiatis par une thorie de l'action qui sort des limites de la prsente
analyse et ne trouvera sa place que beaucoup plus tard, quand nous
passerons de l'action au sens troit la pratique au sens large annonc
plus haut.
De fait, la contribution de la thorie de l'action la question qui
?
est
considrablement plus modeste. Pour des raisons que nous allons dire,
elle marque mme souvent un recul par rapport la problmatique de
Strawson, dans la mesure o celle-ci posait carrment la question de
l'attribution un quelqu'un , tenu pour une mme chose . des
prdicats caractristiques de la personne. Or c'est cette question de
l'attribution qui tend passer dans les marges, au bnfice d'une
question devenue beaucoup plus importante. Laquelle ? Pour le dire
d'un mot, c'est le rapport entre les questions quoi ? et pourquoi ? qui
prend ici le pas sur le rapport entre le couple des questions
quoi-pourquoi ? et la question qui ?. C'est d'abord comme un dfi une
dtermination du qui ? heideggrien que se prsente la thorie de
l'action. Notre problme sera, la fin de cette tude, de retourner ce
dfi en
1. treet Temps, 25, 64; trad. fr. d'E. Martineau, Authentica, 1985, p.
114*7. et 3\6sq. ; trad. fr. de F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986, p. 1565$. et 176sq.
2. Hannah Arendt, TheHuman Condition, 1958, trad. fr. de G. Fradier, La
Condition del'hommemoderne, prface de Paul Ricur, Paris, Calmann-Lvy,
1961, rd., 1983, repris par Agora, Paris, Presses Pocket, 1988, chap. v.
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
avantage, en faisant de l'investigation sur le quoi-pourquoi ? de l'action le
grand dtour au terme duquel la question qui ? reviendra en force,
enrichie de toutes les mdiations que l'investigation du quoi-pourquoi
? aura traverses.
Qu'est-ce qui explique l'effet d'occultation de la question qui ? par
l'analyse des rponses aux questions quoi ? et pourquoi ?. Il ne suffit pas
de dire que, dans une perspective smantique, largement domine par la
manire dont le discours rfre un quelque chose, on ne peut gure
s'attendre rencontrer des rponses la question qui ? susceptibles
d'chapper la dtermination d'un quelque chose entendu comme une
composante du monde dit rel. Certes, la problmatique de l'vnement
que nous voquerons tout l'heure vrifiera amplement cette capture du
qui ? par le quelque chose. Cette explication ne suffit toutefois pas,
dans la mesure o rien n'empche que, dans le cadre rfrentiel du
quelque chose en gnral, la question qui ? conserve une autonomie par
rapport aux questions quoi-pourquoi ?. Nous l'avons dj dit propos de
Strawson, les rponses spcifiques la question qui ? prsentent un
intrt considrable, non pas en dpit de, mais grce , la limitation de
l'enqute mene dans le cadre de la rfrence identifiante. A la question :
qui a fait cela ? Il peut tre rpondu soit en mentionnant un nom propre,
soit en usant d'un dmonstratif (lui, elle, celui-ci, celle-l), soit en donnant
une description dfinie (le tel et tel). Ces rponses font du quelque chose
en gnral un quelqu'un. Cela n'est pas rien, mme s'il manque cette
identification de la personne comme quelqu'un qui fait (ou subit) la
dsignation par soi laquelle seule l'approche pragmatique donnera
accs en faisant merger le couple je-tu de la situation d'interlocution.
Mais, si l'approche rfrentielle de l'agent de l'action ne saurait franchir
ce seuil, du moins a-t-elle en revanche l'avantage de tenir largement
ouvert l'ventail des pronoms personnels (je, tu, il/elle, etc.), et par l
d'accorder le statut conceptuel de la personne la troisime personne
grammaticale. Au niveau d'une simple smantique de l'action, la
question qui ? admet toutes les rponses introduites par n'importe quel
pronom personnel : je fais, tu fais, il fait '. Cet accueil sans discrimination
1. Il reviendra la pragmatique d'ordonner la liste des pronoms personnels en
fonction d'actes de discours diffrencis par leur force illocutoire : alors
pourra-t-on dire dans l'aveu ou la revendication : c'est moi qui... ; dans le
remerciement ou l'accusation: c'est toi qui...; dans l'accusation ou la description
narrative. c'est lui qui... Mais ces dterminations pragmatiques diffrencies se
greffent toutes sur le quelqu'un de l'analyse rfrentielle.
76
77
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
des trois personnes grammaticales, au singulier et au pluriel, reste
la grande force de l'analyse rfrentielle.
Ce n'est donc pas l'approche rfrentielle en tant que telle qui
empche de dployer les ressources contenues dans les rponses
la question qui ? dans le champ de l'action humaine. Aussi bien
tenterons-nous, dans l'tude suivante, de poursuivre l'examen
commenc l'instant et de reprendre avec les ressources de l'ana-
lyse des rponses aux questions quoi-pourquoi ? le problme rest
en suspens au terme de l'tude prsente, savoir celui de
Yascrip-tion de l'action son agent.
L'occultation de la question qui ? est attribuer, mon avis,
l'orientation que la philosophie analytique a impose au traitement
de la question quoi .
?
en la mettant en relation exclusive avec la
question pourquoi ?. En dpit des normes diffrences qui vont
progressivement apparatre entre plusieurs varits de
philo-sophies analytiques de l'action, on peut dire que celles-ci ont
toutes en commun de focaliser la discussion sur la question de
savoir ce qui vaut - au sens de ce qui compte - comme action
parmi les vnements du monde. C'est par rapport la notion de
quelque chose qui arrive que l'on s'emploie dterminer le statut
descriptif te l'action. C'est cette orientation donne la question
quoi ?, par rapport la notion d'vnement mondain, qui contient en
puissance l'effacement jusqu' l'occultation de la question qui ?, en
dpit de la rsistance obstine que les rponses cette question
opposent leur alignement sur la notion minemment
impersonnelle d'vnement. Les rponses la question quoi ?
appliques l'action tendent en effet se dissocier des rponses
requises par la question qui ?, ds lors que les rponses la question
quoi ? (quelle action a-t-elle t faite ?) sont soumises une
catgorie ontologique exclusive par principe de celle de l'ipsit :
savoir l'vnement en gnral, le quelque chose qui arrive ' .
Cette dissociation entre le quoi ? et le qui ?, la faveur de
laquelle la problmatique de l'action bascule du ct d'une onto-
logie de l'vnement anonyme, a t son tour rendue possible par
une coalition en sens contraire entre la question quoi ? et la question
pourquoi ? : afin de dterminer ce qui vaut comme action (question
quoi ?), on a en effet cherch dans le mode d'explication de l'action
(question pourquoi ?) le critre mme de ce qui mrite d'tre dcrit
comme action. L'usage du parce que
1. Nous reprenons ici une discussion amorce plus haut concernant le statut
pistmologique et ontologique de l'vnement. Cf. deuxime tude, p. 67.
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
dans l'explication de l'action est ainsi devenu l'arbitre de la des-
cription de ce qui compte comme action.
2. Deux univers de discours :
action contre vnement, motif contre cause
Par souci didactique, je distinguerai trois degrs (2, 3 et 4) dans
cette capture du quoi ? par le pourquoi ? et finalement du couple
quoi-pourquoi ? par une ontologie de l'vnement impersonnel. Je
ne m'intresse pas ici la chronologie du dbat, mme si les posi-
tions que je vais voquer sont peu prs chelonnes dans le temps
selon l'ordre o je vais les faire paratre. Mes repres restent
nanmoins plus thoriques qu'historiques.
Je caractrise le premier degr par deux arguments matres : le
premier concerne le quoi de l'action dans sa spcificit ; le second,
le rapport, tenu galement pour spcifique, entre le quoi ? et le
pourquoi ?.
1. Concernant le premier point, il est remarquable que la thorie
de l'action a cru prserver la spcificit de l'agir humain en prenant
dj pour terme de rfrence la notion d'vnement. Ce fut certes
d'abord pour opposer action vnement. On verra plus loin la
faveur de quel retournement l'opposition est devenue inclusion.
Mais, d'abord, ce fut l'opposition qui prvalut. L'vnement, dit
l'argument, arrive simplement ; l'action, en revanche, est ce qui fait
arriver. Entre arriver et faire arriver, il y a un foss logique, comme
le confirme le rapport des deux termes de l'opposition l'ide de
vrit : ce qui arrive est l'objet d'une observation, donc d'un nonc
constatif qui peut tre vrai ou faux ; ce que l'on fait arriver n'est ni
vrai ni faux, mais rend vrai ou faux l'assertion d'une certaine
occurrence, savoir l'action une fois faite. Comme l'exprime le
franais : l'action faite est devenue un fait ; mais le rendre vrai est
l'uvre du faire. De cette opposition rsulte que la force logique
d'une action ne peut tre drive d'aucun ensemble de
constatations portant sur des vnements et sur leurs proprits
1
.
1. On trouve un expos dtaill de cet argument chez A.I. Melden, FreeAction,
Londres, Routledge and Kegan Paul, 1961, et chez S.T. Hampshire, Thought and
Action, New York et Notre Dame (lnd.) Notre Dame University Press, 1983. Un
argument comparable est dvelopp par A. Danto dans Analytical Philosophyof
Action. Cambridge, 1973. Toutefois, l'accent principal est mis par l'auteur sur
l'isomorphisme qui demeure entre les deux sries d'noncs : d'une part, m
78 79
SOI-MMECOMMEUN AUTRE UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
Je ne sous-estime pas les mrites de cette approche du problme
de l'action. Parmi ceux-ci, j'inscris volontiers l'limination de
quelques prjugs rsultant d'une mauvaise construction par maints
auteurs du concept d'action ; ainsi en est-il de pseudoconcepts tels
que celui de sensations kinesthsiques, qui nous feraient connatre
comme un vnement interne la production par nous des
mouvements volontaires ; ainsi en est-il encore des prtendues
sensations affectives, qui nous feraient connatre nos dsirs,
galement titre d'vnements internes. Le vice logique consiste en
ce que l'observation interne, ici allgue, est construite sur le
modle de l'observation externe ; ce prjug soutient en sous-main
la recherche vaine de quelque vnement intrieur ; on peut parler
ici d'un prjug contemplatif, qui invite poser la question :
Comment savez-vous que vous faites ce que vous faites ? La
rponse est : Vous le savez en le faisant.
Je rapprocherai de la distinction entre faire arriver et arriver la
distinction que fait E. Anscombe entre savoir-comment et
savoir-que
1
. Le savoir-comment a en effet faire avec des
vnements dont Anscombe dit qu'ils sont connus sans
observation ; cette notion, son tour, justifie qu'on parle leur
propos de connaissance pratique . Or, avant d'tre applique la
notion d'intention dont on parlera plus loin, la notion d'vnements
connus sans observation s'applique des expressions aussi
primitives que la position de mon corps et de mes membres, et que
la production de mes gestes. Le savoir du geste est dans le geste :
Cette connaissance de ce qui est fait est la connaissance pratique ;
Un homme qui sait comment faire des choses en a une
connaissance pratique (ibid., p. 48).
Ces arguments sont assurment trs forts, en premire approxi-
mation. Leur dfaut, toutefois - dfaut par omission, si l'on peut dire
-, est de se concentrer sur le quoi de l'action, sans thma-tiser
son rapport au qui ?. Du mme coup, ils vont s'avrer trs
vulnrables une critique qui aboutira faire de l'action une espce
du genre vnement, plutt qu'un terme alternatif. L'ironie est que
c'est l'opposition entre action et vnement qui a fray la voie la
rsorption du premier terme dans le second.
connat que s travers l'vidence e: d'autre part, mfait arriver a en faisant b.
Entre tre vrai que s et rendre vrai que a arrive, une certaine homognit sub-
siste.
1. E. Anscombe, Intention, Basil Blackwell, 1979. Je ne m'attarde pas ici sur cet
argument ; il prendra place dans un autre cadre conceptuel, centr sur la notion
d'intention, dans lequel je vois le deuxime degr de l'occultation de la problma-
tique du soi au bnfice de celle de l'vnement.
2. Le mme renversement paradoxal se produira sur le second
front ouvert par la thorie de l'action. Le quoi de l'action, en
effet, est spcifi de faon dcisive par son rapport au pourquoi ?.
Dire ce qu'est une action, c'est dire pourquoi elle est faite. Ce rapport
d'une question l'autre s'impose : on ne peut gure informer autrui
sur ce qu'on fait sans lui dire en mme temps pourquoi on le fait ;
dcrire, c'est commencer d'expliquer ; et expliquer plus, c'est dcrire
mieux. C'est ainsi qu'un nouveau gouffre logique se creuse, cette
fois entre motif et cause. Un motif, fait-on remarquer, est en tant que
tel motif d'agir. Il est logiquement impliqu dans la notion de
l'action faite ou faire, en ce sens qu'on ne peut mentionner le motif
sans mentionner l'action dont il est le motif. La notion de cause, du
moins au sens humien, gnralement pris pour terme de
comparaison, implique au contraire une htrognit logique entre
la cause et l'effet, dans la mesure o je peux mentionner l'une sans
mentionner l'autre (ainsi l'allumette d'une part et l'incendie d'autre
part). La connexion interne - ncessaire et, en ce sens, logique -
caractristique de la motivation est exclusive de la connexion
extrinsque, contingente et, en ce sens, empirique de la causalit. On
le voit, l'argument a la prtention d'tre logique et non
psychologique, en ce sens que c'est la force logique de la connexion
motivationnelle qui exclut que l'on classe le motif comme cause ; le
motif se laisse mieux interprter en tant que raison-de... : non point
que toute motivation soit rationnelle, ce qui pourrait exclure le dsir
. tout motif est raison-de, en sens que la connexion entre motif-de et
action est une relation d'implication mutuelle. Le vrifie, selon cette
cole de pense, la grammaire propre du mot wanting, dont l'emploi
est plus large que le terme dsir et qui correspond peu prs ce
que. en franais, on appellerait envie de... et qu'on exprime
volontiers par ce qu'on aimerait ou voudrait faire (tre ou avoir) ,
ou ce qu'on ferait volontiers, ce qu'on voudrait bien faire,
rservant au terme dsir un champ plus restreint, au sens
alimentaire ou sexuel, principalement. Quoi qu'il en soit du terme et
de sa traduction approprie, la grammaire propre du terme wanting
exige que l'envie-de ne puisse tre nomme qu'en liaison avec cela
vers quoi elle tend, c'est--dire l'action elle-mme; avoir envie-de,
c'est avoir-envie-de-faire (to do), d'obtenir (to get). L'envie, conti-
nue l'argument, peut tre empche, interdite, refoule ; mais, mme
alors, elle ne peut tre comprise dans quelque indpendance logique
que ce soit l'gard du faire. Dans tous les cas, il y a une implication
logique (logical involvement) entre dsirer et
80 81
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
faire ; avoir envie de quelque chose implique logiquement l'obtenir.
Logiquement signifie que, dans notre langage, avoir envie et faire
s'appartiennent mutuellement ; c'est selon une chane logique
d'implication que l'on passe d' avoir envie avoir
envie-de-faire , essayer (trying)-de-faire et finalement
faire (Joing).
Cette grammaire de l'envie-de confirme la critique faite plus haut
de la notion contemplative d'vnement intrieur, observable
par un il intrieur. L'envie-de n'est pas une tension qu'une
impression intrieure ferait ressentir ; une mauvaise grammaire du
mot envie , trait comme un substantif, est responsable de cette
interprtation du dsir comme un vnement intrieur, logiquement
distinct de l'action mentionne dans le langage public. L'limination
des entits intrieures, commence au plan du premier argument qui
oppose action vnement, se poursuit ainsi au plan du second
argument qui oppose motif cause.
Une variante du mme argument mrite d'tre signale : voquer
la raison d'une action, c'est demander de placer l'action dans un
contexte plus large, gnralement fait de rgles d'interprtation et de
normes d'excution, qui sont supposes communes l'agent et la
communaut d'interaction ; ainsi, je vous demande de considrer
mon geste, par exemple de lever la main, comme une salutation,
comme une prire, comme l'appel lanc un taxi, etc. Bien que ce
type d'argument ne trouve son panouissement que dans le cadre
d'une analyse applique la force illocutoire des nonciations
(saluer, prier, appeler, etc.) et donc relve de la pragmatique de
l'action, il donne plus de force l'opposition entre deux schmas
d'explication, dans la mesure o un seul peut tre trait comme une
forme d'interprtation. Du mme coup, se rvle une certaine
proximit entre cette analyse conceptuelle de l'action et la tradition
hermneutique, lorsque celle-ci oppose comprendre expliquer, et
fait de l'interprtation un dveloppement de la comprhension.
Interprter, lit-on dans tre et Temps, c'est dvelopper la
comprhension en disant en tant que quoi (als was) nous
comprenons quelque chose
1
. Cette parent n'est pas tonnante, dans
la mesure o l'action peut tre traite comme un texte et
l'interprtation par les motifs comme une lecture
2
. Rattacher une
action un ensemble de motifs, c'est comme interprter un texte ou
une partie d'un texte en fonction de son contexte.
1. Heidegger, treet Temps, 32.
2. P. Ricur, Le modle du texte : l'action sense considre comme un
texte, in Du texte l'action, op. cit., p. 183-211.
3. On voit bien la parent entre ce second type d'argument et le
premier : l'opposition entre motif et cause est rigoureusement
homogne l'opposition entre action et vnement. L'explication de
l'action en termes de motifs renforce mme la description de l'action
comme un faire-arriver . Action et motif sont du mme ct,
comme vnement et cause le sont de l'autre, ainsi que la tradition
humienne nous prpare l'admettre. En ce sens, on peut dire, au
sens de Wittgenstein, que l'action et ses motifs, d'une part,
l'vnement et sa cause, d'autre part, appartiennent deux jeux de
langage qu'il importe de ne pas confondre ; la philosophie de
l'action s'est de fait donn pour tche, dans une premire phase au
moins, de restituer ces deux jeux de langage leur cohrence
respective et leur indpendance mutuelle. Et pourtant. cette franche
dissociation de deux univers de discours ne devait pas rsister aux
assauts d'une analyse conceptuelle plus attentive aux variations de
sens de termes supposs appartenir deux jeux de langage
nettement distincts, variations qui font que ces termes ne cessent
d'empiter l'un sur l'autre au point de rendre problmatique le
principe mme de leur dissociation. C'est ce stade de
l'empitement entre deux univers de discours que nous allons nous
placer, avant de rejoindre le stade o le jeu de langage de l'action et
de ses raisons d'agir se voit englouti dans celui de l'vnement et de
la causalit.
Mais disons d'abord pourquoi l'approche dichotomique tait
condamne tre fortement nuance avant d'tre franchement
rejete.
Je dirai d'abord que, phnomnologiquement parlant, l'opposition
entre motif et cause ne s'impose pas (on verra plus loin qu'elle est
contestable au plan logique o elle est affirme). Il apparat bien
plutt que la catgorie du dsir, que je prends ici au sens du wanting
anglais, se propose comme une catgorie mixte dont la pertinence
est lude, ds lors que. pour des raisons logiques, on tire le motif
du ct de la raison d'agir. Mme si l'on ne veut souligner par l que
l'originalit du mode d'implication entre motif et action, le danger
reste que la raison-de soit prise dans le sens d'une rationalisation de
type technologique, stratgique ou idologique, et que soit occult
ce qui fait l'tranget mme du dsir, savoir qu'il se donne, et
comme un sens qui peut tre exprim dans le registre de la
justification, et comme une force qui peut tre transcrite, d'une
manire plus ou moins analogique, dans le registre de l'nergie
physique ; ce caractre mixte du dsir - dont j'ai tent jadis de faire
la smantique dans
82
83
SOI-MME COMME UN AUTRE
mon livre sur Freud - trouve un reflet au plan mme o se tient
strictement la thorie de l'action, savoir celui du langage ordinaire. Ne
demande-t-on pas : Qu'est-ce qui vous a pouss faire ceci ou cela ?
On dit mme en anglais : Qu'est-ce qui vous a " caus * agir ainsi ?
Je vois trois situations types o ce genre de question est justifi par une
rponse de type causal. La premire est celle o, la question :
Qu'est-ce qui vous a pouss faire ceci ou cela ? , on donne une rponse
qui n'nonce ni un antcdent au sens de la cause humienne, ni une
raison-de, au sens rationnel, mais une impulsion incidente, ou, comme on
dit en psychanalyse, une pulsion (ail. : Trieb ; angl. : drive). Seconde
situation type : celle o, la question : Qu'est-ce qui vous amne
d'habitude vous conduire ainsi ? , la rponse mentionne une
disposition, une tendance durable, voire permanente. Troisime
situation type : si, la question : Qu'est-ce qui vous a fait sursauter ? .
vous rpondez : Un chien m'a fait peur , vous ne joignez pas comme
prcdemment le comment au pourquoi, mais l'objet la cause ; c'est
le trait spcifique de l'motion, au point de vue de son expression
linguistique, que son objet soit sa cause et rciproquement.
Ces trois contextes peuvent tre rapprochs sous le titre gnrique de
l'affection ou de la passion, au sens ancien du terme. Dans ces trois
contextes, en effet, une certaine passivit s'avre tre corrlative
l'action de faire. La mdiation de cette passivit parat bien essentielle
la relation dsirer-agir, qu'on ne saurait rduire la justification que
donnerait de son action un agent purement rationnel ; cette action serait
prcisment sans dsir ! Cette phnomnologie du dsir, largie celle
de l'affection, contraint dire que, mme dans le cas de la motivation
rationnelle, les motifs ne seraient pas des motifs de l'action s'ils
n'taient pas aussi ses causes.
Cette justification phnomnologique donnera une plausibilit
certaine la thse causaliste. La question sera alors de savoir si un autre
modle causal que celui de Hume n'est pas requis paralllement la
refonte de l'ide de motif rduite celle de raison-de. Ce point ne
pourra tre discut qu'au terme de l'itinraire qui aura conduit rsorber
l'ide de motif dans celle de cause.
Ce n'est pas finalement au plan phnomnologique seulement que la
dichotomie entre deux univers de discours est critiquable et qu'elle a t
critique dans le sens que l'on dira plus loin, mais
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
au plan ontologique. Le terme absent de toute la discussion, et qui
deviendra tout l'heure terme exclu, c'est curieusement celui d'agent. Or,
c'est la rfrence l'agent qui nous interdit d'aller jusqu'au bout de la
double opposition entre faire arriver et arriver, et entre motif et cause.
L'opposition est en effet plausible au niveau du couple quoi-pourquoi ?.
Dans le vocabulaire de Straw-son qui a t le ntre dans la premire
tude, elle revient opposer les prdicats psychiques aux prdicats
physiques, sous la rserve qu'une place soit faite au cas mixte du dsir
avec sa double valence de force et de sens. Mais une conclusion errone
est tire d'une analyse partiellement juste. Ce qui a t perdu de vue,
c'est l'attribution la mme chose - nous disons maintenant au mme
agent - des deux sries de prdicats. De cette attribution unique rsulte
que l'action est la fois une certaine configuration de mouvements
physiques et un accomplissement susceptible d'tre interprt en
fonction des raisons d'agir qui l'expliquent. Seul le rapport un mme
particulier de base justifie que les deux jeux de langage ne restent pas
juxtaposs, mais superposs, selon le rapport qui prvaut entre le
concept de personne et celui de corps, et qui contraint dire que les
personnes sont aussi des corps. C'est donc l'analyse conceptuelle de la
notion de personne au plan ontologique des entits dernires, qui exerce
ici une contrainte pralable sur la smantique de l'action ; en retour, il est
demand celle-ci de satisfaire aux exigences du cadre conceptuel qui
dtermine notre emploi sens et appropri du terme de personne.
La fragilit de la thorie dichotomique de l'action que nous venons
d'exposer s'explique, mon avis, par son caractre
phno-mnologiquement peu plausible et par son manque d'gards pour
les contraintes attenantes la thorie des particuliers de base. Il ne sera
ds lors pas tonnant qu'un renversement complet du rapport entre action
et vnement au niveau du quoi ? et du rapport entre motif et cause au
niveau du pourquoi ? soit li un oubli plus complet encore des
contraintes ontologiques qu'on vient de dire, oubli qui sera scell par la
substitution d'une ontologie gnrale de l'vnement l'ontologie
rgionale de la personne. Mais ce double renversement, au plan de
l'analyse du discours et celui des entits de base, ne sera pas atteint
directement. Avant de prendre en considration la confusion des
univers de discours au bnfice de l'vnement et de la cause, il est bon
de s'attarder au stade intermdiaire, celui de leur empitement mutuel.
84
85
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
3. L'analyse conceptuelle de l'intention
Il est remarquable que ce soit l'analyse conceptuelle de la notion
d'intention, que nous avons dessein tenue en rserve jusqu'
prsent, qui ait donn lieu la sorte d'analyse toute en nuances et en
dgrads, hrite du Wittgenstein des Investigations
philosophiques, laquelle, avant toute attaque frontale, a contribu
un effritement des polarits trop symtriques
1
. Le livre d'E.
Anscombe Intention est cet gard le tmoin le plus loquent de ce
que j'appellerai, sans intention pjorative, un impressionnisme
conceptuel, pour le distinguer du tranchant en quelque sorte cubiste
de la thorie de D. Davidson laquelle nous consacrerons l'analyse
suivante. On attendrait volontiers d'une analyse conceptuelle de
l'intention qu'elle ramne du couple quoi-pourquoi ? la question
qui ?. L'intention n'est-elle pas, phnomnologiquement parlant, la
vise d'une conscience en direction de quelque chose faire par moi
? Curieusement, l'analyse conceptuelle tourne dlibrment le dos
la phnomnologie : l'intention, pour elle, n'est pas l'intentionnalit
au sens de Husserl. Elle ne tmoigne pas de la transcendance
soi-mme d'une conscience. Suivant en cela Wittgenstein, E.
Anscombe ne veut rien connatre de phnomnes qui seraient
accessibles la seule intuition prive, et donc susceptibles
seulement d'une description ostensive prive. Or ce serait le cas si
l'intention tait prise au sens d'intention-de... Cette sorte d'intention
tourne vers le futur, et non vrifie par l'action elle-mme, n'est par
principe accessible qu' l'agent lui-mme qui la dclare. Pour une
analyse conceptuelle qui n'admet qu'un critre linguistique public,
l'intention-de ne vaut qu' titre de dclaration d'intention.
L'intention non dclare, on ne sait pas ce que c'est. Or la grammaire
de surface de la dclaration d'intention est incertaine : rien ne
distingue le futur de l'intention (je vais me promener) de celui de
l'estimation du futur (je vais tre malade) et de celui du
commandement (vous allez m'obir). Par-del la
I. J.-L. Petit montre dans son ouvrage indit La Smantique de l'action.
(Universit Paris I - Sorbonne, 1988) que l'cole dite d'Oxford fait essentielle-
ment appel la traditionnelle philosophie du sens commun pour combler le vide
creus par les Investigationsphilosophiques( 611-660) entre le niveau smantique
du langage et l'exprience effective de l'agir. Les paradoxes des Investigations
occupent ds lors une position stratgique dans la philosophie analytique de l'ac-
tion.
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
grammaire de surface, ce qui fait dfaut, c'est le critre de vrit de
la dclaration d'intention, si l'intuition de la signification j'ai
l'intention-de est tenue pour irrductible.
Est-ce dire que l'analyse conceptuelle de l'intention soit
impossible ? L'obstacle peut tre tourn si, suivant en cela l'usage
commun de la langue, nous distinguons entre trois emplois du terme
intention : avoir fait ou faire quelque chose intentionnellement ;
agir dans (with) une certaine intention ; avoir l'intention-de. Seul le
troisime emploi contient une rfrence explicite au futur. La
rfrence au pass est en revanche la plus frquente dans le cas de
l'action faite intentionnellement. Mais, surtout, seul le troisime
emploi ne tombe sous l'analyse qu'au niveau de sa dclaration. Les
deux autres emplois sont des qualifications secondes d'une action
observable par tous. On commencera donc par l'usage adverbial du
terme intention (dont l'quivalent adjectival est action
intentionnelle ). Cet emploi n'oblige aucune violation des rgles
de la description.
Cette attaque du problme, fragment aprs fragment,
(piece-meal), est pour notre propre investigation trs remarquable :
en prenant pour pivot de l'analyse l'usage adverbial de l'intention,
on privilgie aussi l'usage qui tmoigne de la manire la moins
explicite du rapport de l'intention l'agent. Autant le lien parat
troit entre l'intention-de et celui qui elle appartient, autant la
qualification intentionnelle de l'action va pouvoir se faire ind-
pendamment de toute considration du rapport de possession qui
rattache l'action l'agent. Le critre de l'intentionnel - donc du quoi
? de l'action -, c'est en effet la forme assume par certaines rponses
donnes a la question pourquoi ?. En ce sens, c'est le pourquoi ?qui
gouverne le quoi ?et qui, dans cette mesure mme, loigne de
l'interrogation sur le qui ?.
La thse centrale s'nonce en effet dans ces termes : Qu'est-ce
qui distingue les actions qui sont intentionnelles de celles qui ne le
sont pas ? La rponse que je suggre est que ce sont les actions
auxquelles s'applique un certain sens de la question pourquoi?; ce
sens est bien entendu celui selon lequel la rponse, si elle est
positive, fournit une raison d'agir
1
. C'est dans la mise l'preuve
de ce critre que se manifeste l'esprit de finesse d'une analyse qui va
faire s'effriter les dichotomies tranches de l'analyse antrieure et,
paradoxalement, frayer la voie l'esprit de gomtrie d'une thorie
de l'action diamtralement oppose la prcdente. Loin, en effet,
que le critre de la question pourquoi ?
1. E. Anscombe, Intention, op. cit., p. 9 [trad. de l'auteur].
86
87
SOI-MME COMME UN AUTRE
ferme le jeu, son application donne accs un champ
extra-ordinairement vari d'exemples mixtes et de contre-exemples,
quand elle ne fait pas pntrer en un labyrinthe d'analyses dans
lesquelles le lecteur se sent quelque peu perdu. Ce souci de distinctions
fines s'exprime d'abord dans l'investigation des cas o la question
pourquoi ? n'a pas d'application. C'tait dj la prcaution prise par
Aristote dans son analyse de la prohairsis (choix prfrentiel): cas
d'ignorance, cas de contrainte. Anscombe raffine : tout dpend sous
quelle description de l'action l'agent n'tait pas au courant (aware) de ce
qu'il tait en train de faire (il ne savait pas qu'il faisait du bruit en sciant
une planche). Mais la principale victime est l'opposition tranche entre
raison d'agir et cause. On a plutt faire une gamme de cas o l'oppo-
sition ne vaut que pour les cas extrmes. Les exemples mixtes sont
cet gard les plus intressants. Aussi bien, estime Anscombe, est-ce
toute la problmatique de la causalit qui est dans un tat d'excessive
confusion ; qu'on se borne donc dire que, dans certaines des rponses
acceptables la question pourquoi ?, nous employons de faon
significative le terme de cause. Comme on l'a dit plus haut, on parle
volontiers et de faon lgitime de ce qui a pouss quelqu'un agir.
Mme la notion de cause mentale a sa place lgitime dans certaines
descriptions de l'action intentionnelle (la musique militaire m'excite ;
c'est pourquoi je marche en cadence). Les cas les plus frquents o raison
d'agir et cause tendent se confondre sont ceux o les motifs regardent
eux-mmes en arrire (backward-looking motives) (cas de la vengeance ou
de la gratitude, par exemple) ; en revanche, les motifs prospectifs
correspondent plutt la notion d'intention-dans (ou avec) laquelle on
agit. De cela on parlera plus loin. On voit combien est floue la frontire
entre raison d'agir, motif prospectif, cause mentale et cause tout court (
Une figure grimaante m'a fait sursauter ). Le critre de la question
pourquoi ? est donc ferme ; son application tonnamment flexible.
Qu'en est-il de l'opposition entre action et vnement, que, dans
l'analyse prcdente, nous avons fait paratre avant celle du motif et de la
cause ? Ici encore, la position d'E. Anscombe est trs nuance. D'une
part, elle tient ferme que l'action intentionnelle est objet de description
; la place occupe par la notion d'action sous telle description en
tmoigne ; en ce sens, le quoi de l'acte relve d'une connaissance qui
peut tre vraie ou fausse. Nous reviendrons plus loin sur cette insistance
sur la description en philosophie analytique. D'autre part, les
actions inten-
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
tionnelles constituent une sous-classe des choses connues sans
observation : je ne dis pas que je savais que je faisais ceci ou cela parce
que je l'avais observ. C'est en faisant que l'on sait que l'on fait ce que
l'on fait et pourquoi on le fait. Cette notion de connaissance sans
observation, dont nous avons dj parl plus haut, et qui est aussi
appele connaissance pratique (savoir-comment et non savoir-que)
rapproche incontestablement la position d'E. Anscombe de celle des
partisans de la dualit des jeux de langage.
Mais il ne faudrait pas croire que la notion de connaissance pratique
invite prendre en compte la relation de l'action son agent, bien que,
dans tous les cas examins, le verbe d'action soit prcd d'un pronom
personnel. Le critre par la question pourquoi ?, et par les rponses
acceptables cette question, privilgie le ct objectif de l'action,
savoir le rsultat obtenu, qui est lui-mme un vnement. Comme le dit
Anscombe de faon peine paradoxale : je fais ce qui arrive.
L'oblitration de l'agent de l'action est encore renforce par
l'accentuation du ct objectif de la raison d'agir. Reprenant l'analyse de
l'envie-de, commence plus haut, l'auteur prend systmatiquement en
compte la forme du grondif anglais (wanting) sans jamais considrer
l'expression j'ai envie-de (I want) ; ainsi crit-elle : le sens primitif
d'avoir envie-de, c'est essayer d'atteindre (trying to get - le grontif gram-
matical permet cette lision du sujet du verbe exprim des temps
verbaux). Quant l'espce la plus frquemment nomme de l'envie,
savoir le dsir, ce qui compte pour l'analyse conceptuelle, ce n'est pas le
manque et la tension ressentis par un sujet ainsi affect, mais le
caractre de dsirabilit , c'est--dire ce en tant que quoi quelque chose
est dsirable. Pourquoi cette accentuation du ct objectif du dsir ?
Pour deux raisons. La premire est le souci de rendre compte de la
dimension d'valuation insparable de la dimension descriptive, sans
pour autant introduire des considrations morales dans l'analyse
conceptuelle. La seconde raison est le souci de fournir une transition
intelligible entre action intentionnelle (au sens de faite inten-
tionnellement ) et action dans l'intention-de.
Ce second emploi du mot intention recouvre ce qu'on a appel
plus haut motif prospectif. Mais il doit tre bien entendu qu'on ne
rintroduit pas par l quelque entit interne accessible au seul agent.
L'action est l, et, pour la dcrire, on l'explique. Or, l'expliquer par la
vise d'un rsultat ultrieur, c'est simplement procder un
raisonnement pratique qui donne la
88 89
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
raison d'agir une complexit discursive en mme temps que l'on place en
position de prmisse un caractre de dsirabilit. Nous sommes ici sur
un terrain sr, jalonn autrefois par Aristote sous le titre du syllogisme
pratique, mme s'il faut corriger les interprtations modernes, voire
celles d'Aristote lui-mme (dans la mesure o celui-ci en met l'analyse au
service de la morale et surtout dans la mesure o il n'apparat pas
clairement que la conclusion du syllogisme pratique soit une action).
L'erreur, dit E. Ans-combe, est de faire du syllogisme pratique un
raisonnement qui prouve, alors que c'est un raisonnement qui conduit
l'action. La vertu du raisonnement pratique, en effet, est de faire
apparatre un tat de choses futur comme stade ultrieur d'un
processus dont l'action considre est le stade antrieur. Dans
l'expression : je fais ceci en vue de cela, l'accent n'est pas mis sur je
mais sur en vue de , c'est--dire sur la relation de dpendance entre
deux tats de choses, l'un antrieur, l'autre ultrieur.
C'est ici que l'implication mutuelle entre question quoi ? et question
pourquoi ? joue en plein et dans les deux sens : de la description vers
l'explication, mais aussi, rebours, de l'explication vers la description,
dans la mesure o Tordre introduit entre une srie de raisons d'agir par le
raisonnement pratique rejaillit sur la description elle-mme de l'action
'.
1. Je rappelle l'exemple qui a rendu fameuse l'analyse d'E. Anscombe : Un
homme pompe de l'eau dans la citerne qui alimente une maison en eau potable.
Quelqu'un a trouv le moyen de contaminer systmatiquement la source au
moyen d'un poison lent dont les effets se font sentir quand il est trop tard pour les
soigner. La maison est rgulirement habite par un petit groupe d'agitateurs qui
agissent pour le compte de meneurs politiques qui sont la tte d'un vaste tat. Ils
sont occups exterminer les juifs et peut-tre prparent une guerre mondiale.
L'homme qui a contamin la source a calcul que, si ces gens sont dtruits, ses
matres prendront le pouvoir et gouverneront bien, voire tabliront le royaume
des cieux sur terre et assureront une vie heureuse au peuple entier. Et il a mis au
courant de son calcul, en mme temps que de la nature du poison, l'homme qui
fait marcher la pompe. La mon des habitants de la maison aura, bien entendu,
toutes sortes d'autres effets ; par exemple un certain nombre de personnes
inconnues ces hommes recevront des legs dont ils ne connatront pas l'origine.
Ajoutons pour compliquer l'exemple : le bras de l'homme qui pompe monte et
descend. Certains muscles dont les mdecins connaissent les noms latins se
contractent et se relchent. Certaines substances sont produites dans certaines
fibres nerveuses, substances dont la formation au cours du mouvement volontaire
intresse les physiologistes. Le bras, en bougeant, jette une ombre sur un rocher o
il fait apparatre une figure dont le regard semble sortir du rocher. En outre, la
pompe produit une suite de grincements qui font apparatre un rythme connu. La
question pose par cet exemple est la suivante : qu'est-ce que l'homme est en train
de faire ? Quelle est la description de son action ? Rponse : la question admet
autant de rponses que permet l'chelonnement des en vue de... ; toutes les
descriptions sont galement valables. En particulier, on peut aussi bien dnommer
L'ironie de la situation est que ce soit prcisment cette implication
mutuelle entre la question quoi ? et la question pourquoi ? qui ait
contribu oblitrer la question qui ?. Je m'explique de la faon suivante
ce phnomne premire vue surprenant. C'est mon avis le souci
exclusif pour la vrit de la description qui a tendu effacer l'intrt pour
l'assignation de l'action son agent. Or l'assignation de l'action l'agent
pose un problme de vracit, et non plus de vrit, au sens descriptif du
terme. C'est ce problme que nous retrouverons plus loin avec l'analyse
de la dclaration d'intention que nous avons systmatiquement mise
de ct. Le montrent aussi les cas d'allgation mensongre faite aux
autres ou soi-mme, les mprises de l'auteur de l'action sur ses propres
intentions, ou tout simplement les hsitations, les dbats intrieurs
placs par Aristote sous le titre de la dlibration. A cet gard, la relation
moyen-fin et la logique qui s'y rattache n'puisent pas la signification de
l'intention dans laquelle on agit. Celle-ci, me semble-t-il, implique en
outre le pur acte de vise (act of intending) qu'on a dlog de la premire
place. Je suggre ici de dire que la question de vracit, distincte de
celle de vrit, relve d'une problmatique plus gnrale de l'attestation,
elle-mme approprie la question de l'ipsit : mensonge, tromperie,
mprise, illusion ressortiraient ce registre. Il appartient peut-tre au
style de la philosophie analytique, et son souci quasi exclusif pour la
description, ainsi que pour les critres de vrit appropris la
description, d'occulter les problmes affrents l'attestation. Si la
possibilit de souponner la vracit d'une dclaration d'intention
plaide contre son caractre de description et contre la prtention la
vrit attache aux descriptions, cette possibilit mme de souponner
prouve elle seule que le problme pos relve d'une phnomnologie
de l'attestation qui ne se laisse pas rduire une critriologie approprie
la description. Les tests de sincrit, comme on le dira plus loisir dans
le cadre de l'tude consacre l'identit narrative, ne sont pas des
vrifications, mais des preuves qui se terminent finalement dans un
acte de confiance, dans un dernier tmoignage, quels que soient les
pisodes intermdiaires de suspicion. Il y a un
l'action en fonction de la premire chose qu'on fait ou en fonction du dernier
rsultat vis. Que l'agent soit mentionn dans chaque question et dans chaque
rponse n'importe pas l'enchanement des raisons d'agir rgl sur celui des rsul-
tats viss. Or c'est cet enchanement des raisons d'agir qui seul permet de
rpondre la question de savoir s'il y a quatre actions ou quatre descriptions
d'une mme action : pomper, alimenter la citerne, empoisonner les habitants,
dclencher la guerre. Cf. I ntention, op. cit., 21sq.
90
91
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
moment, reconnat Anscombe elle-mme, o seul un homme peut
dire ce qu'est son intention. Mais ce dire est de l'ordre de l'aveu :
expression du tmoignage intrieur communiqu, l'aveu est accept
ou non. Mais ce n'est jamais l'quivalent d'une description publique
; c'est une confession partage. Ce qu'Anscombe appelle
connaissance sans observation relve, selon moi, et cela contre le
gr de l'auteur, de ce registre de l'attestation. Je suis bien d'accord
que l'attestation de la vise intentionnelle n'est pas l'uvre de
quelque trange il qui regarderait au milieu de l'agir ( 32 [trad.
de l'auteur]). Prcisment, l'attestation chappe la vision, si la
vision s'exprime dans des propositions susceptibles d'tre tenues
pour vraies ou fausses ; la vracit n'est pas la vrit, au sens
d'adquation de la connaissance l'objet '. C'est faute de pouvoir
thmatiser cette attestation que l'analyse conceptuelle d'E.
Anscombe est incapable de rendre un compte dtaill du troisime
emploi du terme d'intention : l'inten-tion-de... On se rappelle avec
quels arguments cet usage, majeur au point de vue
phnomnologique, avait t dlog de la premire place au dbut
de l'enqute et relgu au troisime rang. Revenant cet emploi au
terme de son parcours, l'auteur se borne dire que le critre de la
question pourquoi ? et des rponses appropries vaut aussi pour
l'intention d'une action propose. Autant dire que la marque du
futur, que l'intention partage avec la prdiction ou l'estimation du
futur (ceci va arriver), n'est pas discriminante, mais seulement
l'explication par des raisons ; de ce point de vue, il n'importe pas que
l'intention soit remplie ou non. ou que l'explication se borne un
laconique : parce que j'en avais envie, un point c'est tout. On a
simplement limin ce que j'appellerai l'intention de l'intention,
savoir l'lan spcifique vers le futur o la chose faire est faire par
moi, le mme (ipse) que celui qui dit qu'il fera
2
. Autrement dit, est
limin ce qui dans l'intention la met sur la voie de la promesse,
mme s'il manque la ferme intention le cadre conventionnel et
public de la promesse explicite.
1. La question de l'attestation (et celle connexe de la vracit) se fraie lente-
ment son chemin d'tude en tude, avant d'tre aborde de front dans la dixime
tude.
2. On trouve chez Anscombe elle-mme la trace de ce problme ; elle dfinit
ainsi l'expression de l'intention : C'est la description de quelque chose de futur
o le locuteur est une sorte d'agent, description qu'il justifie (si en fait il la justifie)
par des raisons d'agir, savoir des raisons pour lesquelles il serait utile ou
attrayant si la description se rvlait vraie, non par la preuve matrielle [vidence]
qu'elle est vraie (ibid., p. 6 [trad. de l'auteur]).
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
En conclusion, l'intention-de, relgue au troisime rang par
l'analyse conceptuelle, revient au premier rang dans une perspective
phnomnologique. Il restera dire en quel sens l'attestation de
l'intention-de est en mme temps attestation du soi.
4. Smantique de l'action et ontologie de l'vnement
Le troisime degr de la capture du quoi ? dans le pourquoi ?,
avec son corollaire - l'lision presque complte de la question qui ?
-, est atteint dans une thorie de l'action o le couple des questions
quoi ? et pourquoi ? se voit aspir par une ontologie de l'vnement
impersonnel qui fait de l'action elle-mme une sous-classe
d'vnements. Cette double rduction logique et ontologique est
mene avec une vigueur remarquable par Donald Davidson dans la
srie des articles recueillis en volume sous le titre significatif
Actions and EventsK
La thorie dbute par un paradoxe apparent. Si, en effet, elle
commence par souligner le caractre tlologique qui distingue
l'action de tous les autres vnements, ce trait descriptif se trouve
rapidement subordonn une conception causale de l'explication.
C'est dans cette subordination que rside l'intervention dcisive de
cette thorie de l'action, aussi taille la hache, aussi carre si j'ose
dire, que les analyses d'E. Anscombe ont pu paratre
impressionnistes. A son tour, l'explication causale sert, dans la
stratgie de Davidson, insrer les actions dans une ontologie, non
pas occulte, mais dclare, qui fait de la notion d'vnement, au
sens d'occurrence incidente, une classe d'entits irrductibles
mettre sur un pied d'galit avec les substances au sens d'objets
fixes. C'est cette ontologie de l'vnement, par nature impersonnel,
qui, mon sens, structure l'espace entier de gravitation de la thorie
de l'action et empche un traitement thmatique explicite du rapport
action-agent que pourtant l'analyse ne cesse de ctoyer. Je vois dans
cet chec du retour de l'action l'agent une incitation, en quelque
sorte par dfaut, chercher dans une autre sorte d'ontologie, plus
consonante avec la requte du soi, le vritable lieu d'articulation
entre l'action et son agent.
1. Procdant par ordre, je conduirai l'analyse dans les limites du
groupe d'essais consacrs au rapport entre intention et action,
1. D. Davidson, Essays on Actions and Evenis. Oxford. Clarendon Press, 1980.
92 93
SOI-MME COMME UN AUTRE UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
en prenant pour guide le premier de ces essais : Actions, Rea-sons
and Causes (1963) '. Cet essai, qui fut tout la fois un coup
d'envoi et un coup de matre, a suscit un ralignement de toute la
philosophie de l'action, contrainte prendre position par rapport
cette nouvelle donne. Ce premier essai - dont on dira plus loin
quelle importante rvision il fut soumis quelque quinze ans plus
tard dans le dernier essai du groupe, intitul Intending (1978)
2
-
ne traite pas thmatiquement du fondement ontologique de la
thorie de l'action dans une ontologie de l'vnement, mais la
suppose chaque page ; l'essai se borne rduire implacablement
l'explication tlologique, qu'on est tent d'associer la description
de l'action en termes d'intention, l'explication causale. En effet,
l'intrt et, jusqu' un certain point, le caractre paradoxal de la
thorie de Davidson, c'est qu'elle commence par reconnatre le
caractre tlologique de l'action au plan descriptif. Ce qui
distingue l'action de tous les autres vnements, c'est prcisment
l'intention. Les actions sont certes des vnements, pour autant que
leur description dsigne quelque chose qui arrive, comme le
suggre la grammaire des verbes, mais nulle grammaire ne permet
de trancher entre des verbes qui ne dsignent pas des actions, tels
que trbucher, et des verbes qui dsignent des actions, tels que
frapper , tuer . En ce sens, la distinction entre faire-arriver et
arriver, sur laquelle les auteurs prcdents ont tant insist, tombe
l'intrieur de la circonscription des vnements. C'est l'intention qui
constitue le critre distinctif de l'action parmi tous les autres
vnements.
Mais en quel sens faut-il prendre le mot intention ? Dans sa
prsentation, D. Davidson prend son compte la distinction pro-
pose par E. Anscombe entre plusieurs usages linguistiques du
terme intention : intention-dans-laquelle..., intentionnellement,
intention-de... La stratgie adopte en 1963 consiste privilgier
chez lui aussi l'usage adverbial de l'intention (X a fait A
intentionnellement) et lui subordonner l'usage substantif (A a
l'intention de faire X dans les circonstances Y),
Pintention-dans-laquelle tant tenue pour une simple extension
discursive de l'adverbe intentionnellement . Plusieurs raisons
justifient cette stratgie. D'abord, en traitant l'intention comme un
adverbe de l'action, il est possible de la subordonner la description
de l'action en tant qu'elle est un vnement chu; il est remarquable
1. In Essays on Actions and Events, op. cit.. p. 3-19.
2. I bid. p. 83-102.
que, dans la plupart des exemples canoniques soumis l'analyse
logique des phrases d'action, les verbes sont noncs dans l'un des
temps verbaux du pass : Brutus tua Csar, etc. ; ce sera l une
source d'embarras dans l'analyse de l'intention-de, o l'orientation
vers le futur est aussi fortement marque que la forme passe de
l'action-vnement l'est peu. Autre argument : Davidson partage
avec toute la philosophie analytique une extrme mfiance l'gard
de ces entits mystrieuses que seraient les volitions, sans pour
autant rejeter la notion d'vnement mental, puisque les dsirs et les
croyances, qui seront dans un instant placs dans la position
d'antcdent causal, sont bel et bien des vnements mentaux. Mais
ces vnements mentaux sont tels qu'ils ne sont pas incompatibles
avec une version physicaliste, dont je ne parlerai pas ici. Ce n'est
donc pas la notion d'vnement mental qui embarrasse, mais la sorte
d'vnement qui ne se laisse pas inscrire dans le schma de la
causalit antcdente qu'on va dvelopper plus loin. C'est
finalement l'aptitude entrer dans un schma causaliste qui fait
privilgier l'usage adverbial du terme intention . C'est cette
inscription de la tlologie du plan descriptif dans la causalit du
plan explicatif que l'on va maintenant tablir.
A vrai dire, avec l'intention prise au sens adverbial, la description
vaut explication. Dcrire une action comme ayant t faite
intentionnellement, c'est l'expliquer par la raison que l'agent a eue
de faire ce qu'il a fait. Autrement dit, c'est donner une explication en
forme de rationalisation ; c'est dire que la raison allgue
rationalise l'action. A partir de l, la thse de Davidson se
dveloppe en deux temps : d'abord expliciter ce que signifie
rationaliser ; ensuite montrer que la rationalisation est une espce
d'explication causale. Quelqu'un peut tre dit avoir une raison de
faire quelque chose, s'il a, d'une part, une certaine proattitude -
disons : une attitude favorable, une inclination - l'gard des
actions d'une certaine sorte, en entendant par inclination quelque
chose de plus large que le dsir, l'envie (wanting), l'attitude
favorable incluant les obligations, et tous les buts privs ou publics
de l'agent ; d'autre part, une croyance (connaissance, perception,
observation, souvenir) que l'action de l'agent appartient cette
catgorie d'actions. (On peut remarquer que l'agent est ici nomm.
Mais sera-t-il thmatis comme tel ?) Bref, une action
intentionnelle est une action faite pour une raison . On pourra
appeler raison primaire l'ensemble constitu par l'attitude
favorable et la croyance : connatre la raison primaire pour
94 95
SOI-MME COMME UN AUTRE UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
laquelle quelqu'un a agi comme il a fait, c'est connatre l'intention dans
laquelle Faction a t faite ' .
C'est sur la base de cette quation entre raison de faire et intention
dans laquelle on a fait que Davidson tablit sa thse majeure, selon
laquelle l'explication par des raisons est une espce d'explication causale.
C'est d'abord pour lui une thse de bon sens : ne demande-t-on pas ce qui
a men, conduit (et en anglais caused) quelqu'un faire ce qu'il a fait ?
C'est en outre une thse homogne toute l'ontologie de l'vnement.
Qu'est-ce que la causalit, en effet, sinon une relation entre des
vnements singuliers, discrets ? Or, contrairement l'argument voqu
dans le paragraphe prcdent, raison et action sont bien des vnements,
par leur caractre d'incidence (une disposition ne devient une raison
d'agir qu'en se faisant accs soudain), et en outre des vnements
distincts, qu'on peut nommer et dcrire sparment, donc des candidats
srieux aux rles de cause et d'effet ; cet gard, l'vnement mental,
considr sous l'angle de l'incidence, est tout fait parallle la fissure
soudaine qui transforme un dfaut dans la construction d'un pont en
vnement qui cause la catastrophe.
Ajoutons encore, et ce point est plus dlicat, qu'une thorie causale
ne doit pas tre confondue avec une thorie nomolo-gique : il n'est
pas ncessaire de connatre une loi pour affirmer un lien causal, lequel,
on l'a dit, rgit des vnements particuliers. Cette dissociation entre
explication causale et explication nomo-logique permet d'carter
l'obstacle principal oppos en philosophie analytique une
interprtation causale de l'explication de l'action par des raisons. Or c'est
une entreprise pour le moins plausible
2
. J'ai dfendu moi-mme dans
Temps et RcitI la
1. To know a primary reason why someone acted as he did is to know an inten-
tion with which the action was done (ibid., p. 7).
2. Davidson concde que c'est l une version faible de la dfinition humienne de
la causalit. Celle-ci prend certes en compte des vnements singuliers, puisqu'elle
n'invoque que la ressemblance entre ce qu'elle appelle des objets ; mais en outre
elle retient la rgularit dans la rptition ; un lien causal peut ainsi tre observ
sans que la loi sous-jacente soit connue. P. Strawson, dans un des essais consacrs
l'uvre de Davidson ( Causation and explanation , in B. Vermazen et M.B.
Hintikka (d.), Essays on Davidson Actions and events. Oxford, Clarendon Press,
1985, p. 115-136), apporte la thse de Davidson un renfort qui, il est vrai, pourrait
finalement l'affaiblir : il observe qu'au simple niveau de l'observation ordinaire, le
phnomne de production (le faire-arriver tant discut en philosophie
analytique) se prte une typiftcation d'o mergent des rgularits qui, leur tour,
font appel, un autre niveau de discours explicatif, de vritables lois ; ainsi
voit-on le tracteur tirer ou pousser, comme nous pouvons tirer ou pousser la force
de nos bras. Cest le cas de toutes les transactions mcaniques , selon
l'expression de Strawson. La thse qui incorpore la tlologie la causalit entre
vnements particuliers risque alors de perdre tout caractre non seulement
notion d'explication causale singulire au plan de la connaissance
historique, la suite de Max Weber et de Raymond Aron. En outre, j'ai
exprim un peu plus haut mes propres doutes l'gard d'un traitement
purement dichotomique de la paire conceptuelle motif-cause. Mais je
me suis born alors un simple inventaire des situations langagires
dans lesquelles il parat lgitime de traiter les motifs comme des causes.
Je voudrais pousser l'argument plus loin et proposer une interprtation
de la motivation qui tout la fois satisfasse l'intuition
phnomnologique et offre une alternative la thorie causaliste de
Davidson en ce qu'elle reste foncirement humienne. Si la
phnomnologie de l'envie-de exige une refonte de l'ide de motivation
qui, comme nous le disions, tienne compte de la dimension de passivit
qui parat bien corrlative de l'action de faire, une refonte parallle de
l'ide de cause qui la dissocie du modle humien parat s'imposer. D'un
ct, il semble bien que ce soit le prestige de ce modle qui ait empch
de prendre en compte les cas o motif et cause sont indiscernables,
savoir tous ceux o s'exprime la vieille ide d'efficience, voire l'ide de
disposition, remise en honneur par Ryle dans La Notion d'esprit
1
. D'un
autre ct, on peut certes arguer que l'ide d'efficience, chasse de la
physique par la rvolution galilenne, a tout simplement rintgr son
lieu d'origine, sa terre natale, dans l'exprience du dsir ; mais on ne
saurait se satisfaire d'une analyse qui se bornerait restaurer une
signification archaque de la cause pour faire droit des expriences o
le motif est effective-
paradoxal, mais mme discriminant. Comme d'autres auteurs l'ont soulign
l'envi. la notion de cause dploie une telle polysmie qu'on ne sait plus si c'est en
vertu d'un anthropomorphisme non remarqu que nous croyons voir le bulldozer
pousser, comme nous poussons une pierre coups d'efforts physiques, ou bien si
c'est par transfert des choses nous que nous appliquons notre propre action un
modle mcanique. Aussi bien Strawson retire-t-il tout intrt cette question de
priorit dans la mesure o pour lui la coupure importante n'est pas entre causalit
humaine (que ce soit dans l'effort ou dans la pese des motifs) et causalit mat-
rielle, mais entre le caractre naturel de la relation causale entre vnements et cir-
constances particulires et le caractre non naturel de la relation explicative qui
relie entre eux, non les vnements eux-mmes, mais le fait qu'ils arrivent. Or,
selon Strawson. les faits dsignent des tats de choses, lesquels n'arrivent pas
proprement parler, mais sont seulement exemplifis par les occurrences singu-
lires. Je ne me laisse pas entraner ici dans la querelle ouverte par Strawson
concernant le rapport entre tats de choses (intemporels) et vnements (ph-
mres). Davidson lui consacre deux essais: Events as Particulars (1970) et
Eternal vs. Ephemeral Events ( 1971 ), repris dans la seconde section de Actions and
Events. op. cit.. p. 181-203.
1. G. Ryle, The Concept ofMind, Londres, New York, Hutchinson's University
Library, 1949 ; trad. fr. de S. Stern-Gillet, La Notion desprit. Paris, Payot, 1978.
96 97
SOI-MME COMME UN AUTRE
ment vcu comme cause. C'est la grammaire mme des notions de
pulsion, de disposition, d'motion, bref la grammaire du concept
d'affection, qui exige que le caractre intentionnel de l'action soit
articul sur un type d'explication causale qui lui soit homogne.
Celle-ci ne peut tre que l'explication tlologique
1
.
Qu'est-ce qu'une explication tlologique ? C'est une explication
dans laquelle l'ordre est en tant que tel un facteur de sa production,
c'est un ordre self-imposed. Dire qu'un vnement arrive parce qu'il
est vis comme fin, ce n'est pas recourir une entit cache, vinus
dormitiva ou autre, mais dcrire un systme et une loi de systme,
tels que dans ce systme un vnement arrive parce que les
conditions qui l'ont produit sont celles qui sont requises pour
produire celte fin, ou, pour citer Charles Taylor : La condition
d'apparition d'un vnement est que se ralise un tat de choses tel
qu'il amnera la fin en question, ou tel que cet vnement est requis
pour cette fin. Ainsi, dire qu'un animal guette sa proie, c'est dire
que la sorte d'action dcrite comme guet est celle qui, dans son
rpertoire de comportements disponibles, est requise pour satisfaire
sa faim. On ne postule donc aucune entit antrieure ou intrieure ;
on dit seulement que le fait pour un vnement d'tre requis pour
une fin donne est une condition de l'apparition de cet vnement.
Le fait que l'tat de systme et son environnement sont tels qu'ils
requirent un vnement donn (tel comportement : ici, le guet)
pour qu'un certain rsultat se produise est parfaitement observable ;
de mme aussi le fait que cette condition antcdente peut tre
tablie indpendamment de la preuve matrielle produite par
l'vnement lui-mme.
C'est, partir de l, la tche de la smantique de l'action d'tablir
la corrlation entre la forme de loi propre l'explication tlo-
logique et les traits descriptifs qui nous ont conduits dire qu'un
motif ne remplit sa fonction que s'il est aussi une cause. Entre lan-
gage ordinaire et explication tlologique, une corrlation intres-
sante apparat alors, qui vaut dans les deux directions. Selon la
premire direction, la forme d'explication tlologique est le sens
implicite de l'explication de l'action par des dispositions ; on peut
parler dans ce cas d'une dduction transcendantale de l'explication
tlologique partir du caractre du discours ordinaire que cette
explication rend possible. Classer une action comme intentionnelle,
c'est dcider par quel type de loi elle doit tre explique, et du mme
coup exclure (to mie out) un certain type d'explica-
1. Je dois l'analyse qui suit Charles Taylor dans TheExploitation o/Beha-viour,
Londres, Routledge and Kegan Paul, 1954.
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
tion ; autrement dit, c'est dcider de la forme de loi qui rgit l'action
et en mme temps exclure que ce soit une loi mcanique ; ici,
dcrire et expliquer concident ; la classe descriptive est la mme
chose que le style d'explication : la question quoi ? s'effectue dans la
question pourquoi?; un nonc par le but vaut description;
l'explication est une redescription par le but en vue de quoi.
L'pistmologie de la causalit tlologique vient lgitimer le
caractre indpassable du langage ordinaire. Mais, dans la direction
inverse, si l'explication tlologique explicite la forme implicite la
description du discours ordinaire (disposition ...), en retour celui-ci
ajoute la forme d'explication la rfrence un caractre
phnomnologique de l'exprience de l'action, caractre qui n'est
pas contenu dans cette forme (qui, en tant que telle, se rduit la loi
d'un systme) ; c'est pourquoi il y a plus dans la description
phnomnologique que dans l'explication tlologique ; la notion
gnrale de l'explication par un but, l'exprience humaine ajoute
celle d'une orientation consciente par un agent capable de se
reconnatre comme le sujet de ses actes ; l'exprience n'est pas
seulement ici l'application de la loi ; elle la spcifie, en dsignant le
noyau intentionnel d'une action consciemment oriente.
L'interprtation alternative que je propose ici des rapports entre
causalit et motivation ne couvre pas seulement, mon avis, l'usage
adverbial de la notion d'intention, mais rouvre une carrire nouvelle
celle d'intention-de.
2. Le vritable problme pos par l'analyse de l'action chez
Davidson n'est en effet pas. mon sens, de savoir si les raisons
d'agir, dans le cas o l'intention est prise adverbialement, sont ou
non des causes, mais si l'on est justifi tenir l'usage substantif de
l'intention - l'intention-de - pour driv de son usage adverbial.
On a dj not qu'en philosophie analytique l'expression
intention dans laquelle une action est faite revt par prfrence
une des formes du pass des temps verbaux. Ce n'est pas surprenant,
ds lors que l'vnement-action est tenu pour chu ; ce qui, en
revanche, surprend, c'est que le temps verbal ne fait l'objet d'aucune
analyse distincte ; ce que l'on ne pourra plus omettre de faire avec
l'intention-de, dont la direction vers le futur est, comme on le verra
plus loin, fortement marque. On peut alors se demander si la
dimension temporelle ne doit pas tre prise en compte dans
l'analyse de l'intention, et si l'intention-dans-laquclle. dont le
caractre pass est rest non marqu, n'est
98 99
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
pas cet gard une forme attnue, sinon mutile, de l'inten-tion-de,
pour laquelle le dlai entre intention et action est essentiel. Or un dlai
nul n'est pas un non-dlai, mais une sorte d'accompagnement
simultan. Si l'on demande aprs coup quelqu'un pourquoi il a fait
ceci ou cela intentionnellement, celui-ci rpondra en levant
l'intention-dans-laquelle il a agi au rang d'intention-de : la raison de
son action est l'intention-de, qu'il aurait forme s'il avait rflchi, s'il
avait eu le temps de dlibrer.
Or cette premire attnuation, celle de la dimension temporelle,
n'est pas sans rapport avec une seconde attnuation, celle de la rfrence
l'agent dans la formulation de Faction-vnement et de sa
raison-cause ; sans tre ignore, l'attribution de l'action et de ses raisons
leur agent n'est jamais thmatise ; elle aussi reste non marque '. Elle
est mme absente de la formule que tout l'essai commente, C2 : La
raison primaire d'une action est sa cause (Davidson, ibid., p. 12)
2
. Ne
serait-ce pas,
1. L'agent est nomm par Davidson dans la proposition Cl : R est une raison
primaire pour laquelle un agent a excut l'action A sous la description d, seule-
ment si R consiste en une pro-attitude de l'agent l'gard des actions dotes d'une
certaine proprit, et une croyance de l'agent que A. sous la description d, dtient
cette proprit (Essays on Actions and Events. op. cit., p. 5 [trad. de l'auteur]). On
peut surprendre le moment de l'attnuation de la rfrence l'agent dans la
dclaration suivante : connatre une raison primaire pour laquelle quelqu'un a
agi comme il l'a fait, c'est connatre une intention dans laquelle l'action a t
faite (ibid. p. 7). Les syllogismes pratiques construits sur cette base ne men-
tionnent en effet que le caractre de dsirabilit de l'attitude favorable, pour
reprendre l'expression heureuse d'E. Anscombe clans Intention.
2. On trouvera une confirmation de cette attnuation de la rfrence l'agent
dans l'essai consacr au concept d'agency (ibid.. p. 43-61). que je traduis par
puissance d'agir. On pourrait attendre, sous ce titre, une analyse du
pouvoir-faire de l'agent. Il n'en est rien ; il est seulement question du critre
distinctif des actions proprement dites (deeds and doings) par rapport aux
vnements qui ne sont que de simples occurrences (happenings), lorsque semble
faire dfaut le caractre intentionnel. Le principal contre-exemple ici considr est
celui des mprises. Tel amiral coule en fait le Bismarck alors qu'il voulait couler le
Tirpitz ; Hamlet tue Polonius en croyant transpercer un inconnu derrire la
tenture. La proprit de constituer une action et non une occurrence quelconque -
quoi quivaut dans ce contexte le terme d'agency- fait problme ; dans la mesure
o nul ne met en doute que l'vnement considr - couler un navire, tuer un
homme - soit une action, alors que fait dfaut en premire approximation le
caractre intentionnel. Peut-il y avoir agency sans intention, demande-t-on ?
L'argument, fort subtil, consiste montrer, par une simple analyse logique de la
forme des phrases d'action, que le critre de l'action reste intentionnel : Un
homme, est-il dit, est l'agent d'un acte, si ce qu'il fait peut tre dcrit sous un
aspect qui le rend intentionnel (ibid.. p. 46). Va-t-on parler de l'intention de
l'agent ? Non point. Tout se joue dans l'cart entre, d'une part, la raison de
l'attitude favorable et la croyance qui l'accompagne, et, d'autre part, la ralit de
l'effet advenu. Il est pourtant
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
ds lors, un effet pervers caus par l'alignement sur l'ontologie
sous-jacente de l'vnement, d'occulter l'attribution de l'action son
agent, dans la mesure o il n'est pas pertinent pour la notion d'vnement
qu'il soit suscit, amen (brought about) par des personnes ou par des
choses ?
Ce soupon trouve une confirmation dans le traitement
accord l' intention pure , c'est--dire non accompagne d'action -
intending . selon le titre de l'essai qui lui est consacr en 1978, donc
quinze ans aprs Actions. Reasons and Causes' . Selon la stratgie
adopte dans le premier essai, tous les usages de la notion d'intention
devaient pouvoir tre drivs de l'usage adverbial: I was wrong,
(j'avais tort), avoue Davidson dans l'introduction sa collection
d'essais (ibid., p. xm). Il n'a pas chapp, en effet, l'auteur que
l'intention-de prsente des traits originaux, prcisment l'orientation
vers le futur, le dlai dans l'accomplissement, voire l'absence
d'accomplissement, et. en sourdine au moins, l'implication de
l'agent. Toutefois, la thse nouvelle est que ces traits ne requirent
aucune rvision fondamentale de l'explication causale en termes
d'attitude favorable et de croyance, mais seulement l'adjonction d'un
facteur supplmentaire incorpor la notion bien tablie de raison d'agir.
De ce facteur supplmentaire, il est exig qu'il ne rintroduise pas en
fraude quelque acte mystrieux du type volitionnel. Avec un soin
extrme, plusieurs candidats sont interrogs : ne peut-on traiter le
processus de formation de l'intention comme une action ? C'est
plausible : mais qu'est-ce qu'une action non observable ?
Assi-milera-t-on l'intention quelque acte de discours du type de la
promesse (ou de commandement) ? C'est galement plausible : mais
l'intention manque l'appareil de conventions, le caractre d'obligation par
lequel l'agent se tiendrait li et le caractre public d'une dclaration, tous
traits qui distinguent la promesse en tant qu'acte de discours.
Ramnera-t-on l'intention la croyance que l'on veut faire
effectivement, ou que l'on fera si certaines conditions sont satisfaites,
ou que l'on pourrait faire si l'on voulait ? On est par l certainement
plus prs du but : mais l'analyse ne vaut au mieux que pour des
intentions conditionnelles, o les conditions invoques sont de
l'ordre des circonstances ext-
remarquable que Davidson ne puisse viter de distinguer dans ce contexte entre
event causalityet agent causalitypour rendre compte de la substitution consid-
re. Mais, ma connaissance du moins, il ne dveloppe nulle pan cette distinction
emprunte d'ailleurs I. Thalberg (ibid.. p. 52).
1. In Essays on Actions and Events. op. cit., p. 83-102.
100
101
SOI-MME COMME UN AUTRE
rieures. Reste la solution consistant reprendre nouveaux frais
l'analyse de l'attitude favorable sous la forme de l'analyse cano-
nique de l'envie (wanting).
L'analyse antrieure a, en effet, nglig la composante
valua-tive, donc le rle du jugement, dans la formation de l'envie.
Or, former une intention , c'est aussi arriver un jugement .
Mais il y a deux sortes de jugements : d'une part le jugement que l'on
peut appeler prima facie. qui correspond au dsir, par exemple, de
manger quelque chose de sucr, et qui n'est autre que la
considration d'un caractre de dsirabilit, pour reprendre encore le
vocabulaire d'Anscombe ' ; d'autre part, le jugement inconditionnel
(all-out judgment) qui peut conclure un raisonnement pratique. Il
s'agit d'un jugement supplmentaire selon lequel le caractre
dsirable suffit rgir l'action. Une chose est donc le jugement qui
plaide seulement en faveur d'une action, une autre celui qui engage
l'action et y suffit. La formation d'une intention n'est rien d'autre que
ce jugement inconditionnel. L'avantage de la thorie est qu'elle reste
dans les limites de l'analyse antrieure de la raison d'agir, tout en
respectant la distinction entre intention et simple envie. C'est ce que
permet l'introduction, au titre d'lment nouveau dans l'analyse de
l'action intentionnelle, du jugement inconditionnel. Ainsi
intending et wanting appartiennent au mme genre de pro-attitude
exprim par des jugements de valeur (ibid., p. 102). Cela dit,
l'explication causale de l'intention est sauve.
A mon avis, Davidson a sous-estim le bouleversement que cette
adjonction du jugement inconditionnel impose l'analyse
antrieure. Toute la problmatique tenue jusque-l l'cart, savoir
le sens donner la composante temporelle du dlai et la
rfrence Yagent dont l'intention est la sienne, revient en force
sous le couvert du jugement inconditionnel. Ainsi lit-on dans la
dernire phrase de l'essai : Les intendings purs constituent une
sous-classe des all-out judgments, savoir ceux qui sont dirigs vers
des actions futures de l'agent et qui sont forms la lumire de ces
croyances (ibid.).Or, avec ce dlai, se dcouvre non seulement le
caractre d'anticipation, de vise vide, de l'intention, comme nous
le disons dans une perspective husserlienne, mais le caractre
projectif de la condition mme d'agent, comme nous le disons dans
une perspective heideggrienne. Pour ce qui concerne
1. Appelons les jugements selon lesquels les actions sont dsirables, pour autant
qu'ils ont un certain attribut, jugements prima facie (Davidson, ibid, p. 98).
102
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
le caractre d'anticipation de l'intention, c'est l'intention-de, et non
sa forme adverbiale, qui constitue l'usage de base du concept
d'intention. Dans le cas de l'action accomplie intentionnellement, la
dimension temporelle de l'intention est seulement attnue et
comme recouverte par l'excution quasi simultane. Mais, ds que
l'on considre des actions qui, comme on dit, prennent du temps,
l'anticipation opre en quelque sorte tout au long de l'action. Est-il
un geste un peu prolong que je puisse accomplir sans anticiper
quelque peu sa continuation, son achvement, son interruption ?
Davidson considre lui-mme le cas o, crivant un mot, j'anticipe
l'action d'crire la lettre suivante tout en crivant la lettre prsente.
Comment ne pas voquer, cette occasion, l'exemple fameux de la
rcitation du pome dans les Confessions d'Augustin ? Toute la
dialectique de Yintentio et de la distentio, constitutive de la
temporalit elle-mme, s'y trouve rsume : je vise le pome en son
entier tout en l'pelant vers aprs vers, syllabe aprs syllabe, le futur
anticip transitant travers le prsent en direction du pass rvolu.
Pour ce qui concerne le caractre projectif affectant Y agent
lui-mme, c'est encore l'intention-de qui constitue l'usage de base de
la notion d'intention. Dans son usage adverbial, l'intention apparat
comme une simple modification de l'action, laquelle peut tre
traite comme une sous-classe d'vnements impersonnels. Il n'en
est plus de mme de l'intention-de qui renvoie directement l'agent
qui elle appartient. Du mme coup la question de priorit, au plan
phnomnologique, entre les usages multiples de la notion
d'intention renvoie au problme ontologique sous-jacent, celui de
savoir si une ontologie de l'vnement est apte prendre en compte
l'appartenance de l'intention - et, travers celle-ci, de l'action
elle-mme - des personnes.
3. C'est cet enjeu ontologique qui est pris en charge par les essais
de Davidson qui, sous le sous-titre Event and Cause , composent
la seconde srie de Actions and Events. Le poids de l'argumentation
vise justifier la thse selon laquelle les vnements, et parmi eux
les actions, mritent autant que les substances le titre d'entits
primitives, si l'on appelle entits les ralits qui donnent une valeur
de vrit aux propositions qui s'y rfrent. Ce critre frgen
d'assignation d'existence est commun maintes coles de
philosophie analytique. Celles-ci diffrent seulement par la manire
dont le critre est appliqu, c'est--dire pour l'essentiel en fonction
de l'analyse logique des phrases ou
103
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
des propositions qui sont le support d'une exigence de vrit
(truth-claim). A cet gard, la comparaison entre la thse de Straw-son
dans Les Individus, que nous avons prise pour guide dans notre
premire tude, et celle de Davidson dans Actions and Evenis, est du
plus haut intrt. Elle concerne directement le statut de l'agent de l'action
au plan ontologique. Dans Les Individus, la distinction entre les deux
sortes de particuliers de base - les corps et les personnes - se fait en
fonction de l'attribution de part et d'autre de sries diffrentes de
prdicats, les prdicats psychiques et les prdicats physiques. C'est ainsi
que l'agent de l'action est reconnu comme un particulier ultime, mme si
ce titre l'agent n'est pas encore un soi, au sens fort que nous donnons
ce terme, mais seulement une des choses dont on parle. Avec
Davidson, la coupure impose par la forme logique des phrases d'action
- c'est le titre du premier essai de la srie considre -passe entre les
substances, c'est--dire les entits fixes, et les vnements, c'est--dire les
entits transitoires. Or cette coupure -c'est l mon souci majeur - non
seulement ne permet pas de faire avancer l'ontologie de l'agent, mais
contribue d'une certaine faon l'occulter. En effet, les personnes, au
sens de Strawson, sont plutt du ct des substances, dans la mesure o
c'est elles que les actions-vnements arrivent. Chez Davidson, en
revanche, dans l'analyse logique de la phrase : Pierre a assen un
coup, ce qui importe c'est que le veue assener soit dit de Pierre et du
coup. Le coup est dans la position d'vnement particulier. Pierre est dans
celle de substance, non pas en tant que personne distincte des choses
matrielles (des corps dans le vocabulaire de Strawson), mais en tant que
porteur de l'vnement. Ce qui importe ici, c'est que l'vnement ait
mme dignit ontologique que la substance, que celle-ci soit chose ou
personne '. Pour achever l'occultation de la problmatique spcifique de
l'agent, l'assimilation des raisons primitives (attitudes favorables et
1. Je n'entre pas dans la discussion par Davidson de la thse de Strawson selon
laquelle les vnements sont conceptuellement dpendants des objets ; l'analyse
de l'exemple cit l'instant invite conclure que ni la catgorie de substance ni
la catgorie de changement ne sont concevables part l'une de l'autre (David-
son, op. cit.. p. 175). Je laisse galement de ct la discussion d'une thse hostile
l'ontologie des vnements, savoir celle de R. Chisholm (in Events and propo-
sitions , Nous. n 5,1971, p. 179-189), selon laquelle les vnements seraient seu-
lement l'exemplification d'tats de choses (states ofaffairs) qui seraient les vri-
tables entits en cause : ces deux discussions, auxquelles sont consacrs deux
essais appartenant la mme srie, se droulent l'intrieur d'un mme primtre
dfini par la reconnaissance des conditions de vrit lies la forme logique des
phrases d'action .
UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
croyances) des vnements mentaux fait que la notion de personne se
trouve cartele entre l'vnement et la substance, sans jamais tre
pertinente ; en effet, quand l'accent porte sur le porteur d'vnements, la
personne est substance sans privilge ; mais quand l'accent tombe sur la
notion d'vnements mentaux appartenant la personne, celle-ci tend
se fondre dans la masse des vnements, c'est--dire de tout ce qui
arrive.
Quant au fait que les vnements doivent tre traits sur un pied
d'galit avec les substances, les raisons avances par Davidson mritent
d'tre prises en considration, surtout si l'on tient compte de la prudence
et de la modestie avec laquelle la thse est avance. La forme logique des
phrases d'action exerce ici une contrainte peu discutable. Si l'explication
de l'action par des raisons est une espce d'explication causale, et si la
causalit opre entre des vnements particuliers, il faut bien que les
actions soient des vnements et que ces vnements existent, pour assu-
rer leur valeur de vrit aux propositions qui s'y rfrent. Cette thse
vigoureuse trouve un renfort dans les nombreux parall-lismes que
l'analyse de la forme logique des phrases d'action dcouvre entre les
substances et les vnements. Comment, par exemple, pourrait-on dire
qu'une certaine action est susceptible de plusieurs descriptions (nous
avons rencontr maintes fois l'expression telle action sous une
description d) si elle ne constituait pas une entit particulire ? A cet
gard, l'analyse des excuses, inaugure par Austin, et celle des mprises,
esquisse plus haut, ramnent par d'autres voies la notion d'une pluralit
de descriptions d'une certaine action accomplie. Il en est de mme de
la polyadicit variable ' (A. Kenny), en vertu de laquelle il est toujours
possible d'ajouter l'nonc de l'action la mention du rcipiendaire, celle
du lieu, celle du temps, celle du moyen et des autres circonstances, sans
que soit altre la valeur de vrit de la rfrence telle action effectue.
De faon plus frappante encore. pourrait-on parler de l'identit
numrique d'une mme action ou de l'identit qualitative entre deux
actions ? La question d'identit est tellement centrale dans le plaidoyer
en faveur d'une ontologie de l'vnement qu'elle fournit l'argument
majeur dans l'essai intitul The individuation of events (Davidson,
op. cit., p. 163 sq.). Celui-ci commence ainsi : Quand des vnements
sont-ils identiques, et quand distincts? Quel critre existe-t-il pour
dcider dans un sens ou dans l'autre dans les cas parti-
1. A. Kenny, Action, Emotion and Witt, Londres, Routledge and Kegan Paul,
1963.
104
105
SOI-MME COMME UN AUTRE UNE SMANTIQUE DE L'ACTION SANS AGENT
culiers ? (Ibid., p. 163.) La rponse est que les critres d'identit
sont les mmes pour les vnements et pour les objets-substances.
Pourrait-on dire qu'une action se produit plusieurs fois (rcurrence
d'une occurrence), pourrait-on quantifier la dnomination d'une
action (une, quelques, toutes), si les actions n'taient pas des
vnements dont on peut dire qu'ils existent au mme titre que les
objets matriels (et, pouvons-nous ajouter, que les personnes en
position de substance) ? Tout concourt soutenir la thse que les
vnements sont individus au mme titre que les substances
singulires. Il est ds lors plausible de conclure : L'individuation
des vnements ne pose en principe aucun problme plus grave que
ceux que pose l'individuation des objets matriels. Il y a de bonnes
raisons de croire que les vnements existent {ibid., p. 180).
La disparition de la rfrence aux personnes, dans la dernire
assertion cite, n'est pas fortuite et devrait alerter notre attention. La
question pose est celle-ci : une ontologie des vnements, fonde
sur la sorte d'analyse logique des phrases d'action conduite avec la
rigueur et la subtilit dont il faut crditer Davidson, n'est-elle pas
condamne occulter la problmatique de l'agent en tant que
possesseur de son action ? Un indice de cet effet d'occultation est
fourni par la discussion mme laquelle il vient d'tre fait allusion
concernant l'identit entre vnements. Il ne s'agit, du dbut la fin,
que de l'identit au sens de Y idem et non de l'identit au sens de
Vipse qui serait celle d'un soi '. A mon sens, cette occultation de la
question de l'agent est le rsultat accumul d'une srie de choix
stratgiques qui peuvent tous tre mis en question.
D'abord, la priorit donne l'intention-dans-Iaquelle par rapport
l'intention-de a permis d'attnuer, sans russir tout fait
1. Cf. la dfinition : Des vnements sont identiques si et seulement si ils ont
exactement les mmes [same] causes et les mmes effets (Davidson, op. cit., p.
179). Quoi qu'il en soit des autres critres de mmet (mme lieu, mme temps), la
mmet des relations causales est la seule condition toujours suffisante pour tablir
la mmet des vnements. Entre ces critres d'identit et la position d'entit, le
rapport est troit ; on lit dans The indi viduation of events : Quine s'est risqu
dire : Pas d'entit sans identit, l'appui de la thse frgenne selon laquelle nous
n'avons le droit d'affirmer des entits que si nous sommes prts donner un sens
aux phrases qui affirment ou qui nient l'identit de ces entits. Mais alors s'affirme
avec plus d'vidence la formule : pas d'identit sans une entit, sans oublier sa
contrepartie linguistique : pas d'nonc d'identit sans terme singulier {ibid.. p.
164). Nous nous tenons fermement sur le terrain dlimit par Frege, savoir que
toutes les phrases semblables quant leur valeur de vrit dnomment la mme
chose (mme au sens i'idem).
l'abolir, la dimension temporelle d'anticipation qui accompagne le
jet en avant de soi de l'agent lui-mme. C'est la tche d'une
phnomnologie explicite du projet, comme celle que j'esquissais
autrefois au dbut du Volontaire et l'Involontaire, de porter au
langage le non-dit de ce choix initial.
Ensuite, l'inclusion de l'explication tlologique par des raisons
dans l'explication causale a consacr l'effacement du sujet au
bnfice d'une relation entre vnements impersonnels. Il revient
une analyse de caractre pistmologique de rtablir les droits de la
causalit tlologique, et de montrer son affinit avec le moment
phnomnologique, pralablement dgag, de l'inten-tionnalit. On
a commenc le faire plus haut.
Enfin, il importe de se demander si l'incapacit d'une ontologie de
l'vnement rendre compte de l'imputation de l'action son agent
ne rsulte pas de la manire dont cette ontologie est introduite. Tout
se passe comme si la recherche d'une symtrie entre l'incidence de
l'vnement et la permanence de la substance empchait de
poursuivre la confrontation engage par Strawson dans Les
Individus entre ces particuliers de base que sont les personnes et les
choses. La question de l'agent devient non pertinente dans cette
recherche de symtrie entre vnement et substance. Pour rpondre
ce dfi, au plan ontologique o il est pos, il faudrait introduire la
question du mode d'tre de l'agent sur une autre base que l'analyse
de la forme logique des phrases d'action, sans aucunement rcuser
la validit, sur son propre terrain, de cette approche typique de la
philosophie analytique. Il s'agirait bien, selon nous, d'une ontologie
autre, en consonance avec la phnomnologie de l'intention et avec
l'pistmologie de la causalit tlologique voque l'instant.
Cette ontologie autre serait celle d'un tre en projet, auquel
appartiendrait de droit la problmatique de l'ipsit, comme
appartient de droit l'ontologie de l'vnement la problmatique de
la mmet.
Ce sera la tche de la prochaine tude d'explorer les ressources de
la notion description de l'action l'agent, laisse en suspens au
terme de la premire tude, dans la perspective de cette ontologie
autre
1
. On peut s'attendre aussi que le rle pistmologique,
1. Ces deux ontologies sont-elles exclusives l'une de l'autre ? Je ne le pense pas ;
elles sont, selon moi, simplement autres en raison de la diffrence entre leurs
points de dpart, incomparables. Davidson serait-il aussi accueillant de son ct
cette ontologie autre que je le suis l'gard de la sienne ? Je ne sais : je m'autorise
nanmoins de la modestie de son propos, telle qu'elle s'exprime dans le texte sui-
vant que je traduis in extenso : Nous avons appris nous mfier (...) de ce que
suggre la surface du langage, spcialement quand il touche l'ontologie. Aprs
tout, les vnements en tant que particuliers pourraient n'tre pas la base de
106 107
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
plusieurs fois ctoy, de Yattestation passe au premier plan avec
l'analyse de l'ascription. Ni l'ascription, ni son attestation ne pou-
vaient trouver place dans une smantique de l'action que sa stra-
tgie condamne demeurer une smantique de l'action sans
agent.
QUATRIME TUDE
De l'action l'agent
notre comprhension du monde. Mais comment trancher ? Nous serions mieux
placs pour en juger si nous disposions d'une conception cohrente et englobante
des conditions auxquelles nos croyances communes (ou les phrases que nous
tenons pour vraies) sont vraies. Si nous disposions d'une telle thorie et si cette
thorie requrait un domaine d'vnements particuliers, tandis que nous ne trou-
verions, en dpit de tous nos efforts, aucune thorie qui marche aussi bien sans
vnements, alors nous aurions toutes les raisons imaginables de dire que les v-
nements existent. Le dbut mme d'une telle thorie englobante nous fait encore
dfaut ; cela, nous le savons ; mais nous pouvons apprendre en essayant (ibid.. p.
181-182).
Le propos de cette tude est de remettre sur le chantier la question
du rapport de l'action son agent aprs les rsultats dcevants de
l'tude prcdente. Pour ce faire, remontons quelque peu en arrire.
Nous notions au dbut de la premire tude que les questions qui ?,
quoi ?, pourquoi .'. appliques au champ smantique de l'action,
forment un rseau d'intersignifications tel que, pouvoir rpondre
l'une d'entre elles, c'est pouvoir rpondre toute autre appartenant
au mme circuit de sens. Or, l'tude prcdente, prenant appui sur
une smantique du discours. n'a parcouru le rseau que dans une
direction qui a loign progressivement de la question qui .''au
bnfice de la paire quoi-pourquoi ?. Est-il possible, faisant fond
davantage sur une pragmatique du discours, de parcourir la chane
des questions en sens inverse, autrement dit de remonter de la paire
quoi-pourquoi .' la question-pivot qui .''L'obstacle majeur, ce fut
jusqu' prsent l'attraction exerce sur l'analyse logique des phrases
d'action par une ontologie de l'vnement qui ferme la voie de retour
la question qui ?. C'est dans cette situation bloque qu'une reprise
des analyses de Strawson, au point o nous les avons laisses au
terme de la premire tude, peut paratre opportune. En effet, les
trois thses que nous avons retenues de l'analyse de Strawson visent,
chacune son tour, et avec une exigence croissante, un unique
phnomne de langage que je dsignerai, aprs l'auteur, par le terme
d'ascription. Je rappelle ces thses :
1) Les personnes sont des particuliers de base, en ce sens que
toute attribution de prdicats se fait, titre ultime, soit des corps,
soit des personnes. L'attribution de certains prdicats des
personnes n'est pas traductible en termes d'attribution des corps.
2) C'est aux mmes choses - les personnes - que nous attri-
buons des prdicats psychologiques et des prdicats physiques ;
autrement dit, la personne est l'entit unique quoi nous attri-
109
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
DE L'ACTION L'AGENT
buons les deux sries de prdicats ; il n'y a donc pas lieu de poser
une dualit d'entits correspondant la dualit des prdicats psy-
chiques et physiques.
3) Les prdicats psychiques, tels qu'intentions et motifs, sont
d'emble attribuables soi-mme et un autre que soi ; dans les
deux cas, ils gardent le mme sens.
C'est cette attribution trois fois vise qui est mieux dnomme
ascription. Ce terme dsigne dsormais le point critique de toute
notre entreprise ; la question est en effet de savoir si l'ascription
d'une action un agent n'est pas une espce si particulire d'attri-
bution qu'elle remette en question la logique apophantique de
l'attribution. Ds lors, si la smantique de l'action trbuche sur la
question du rapport de l'action l'agent, ce n'est peut-tre pas
seulement parce qu'une ontologie adverse, celle de l'vnement
anonyme, fait obstacle l'identification de la personne comme
particulier de base, mais aussi parce que l'ascription pose la
smantique de l'action un problme qu'elle est mal arme pour
rsoudre. La pragmatique sera-t-elle d'un secours plus efficace ?
1. Un problme ancien et un problme nouveau
La difficult que nous affrontons n'est pas nouvelle. Elle a t
formule ds l'Antiquit sans les ressources analytiques dont nous
disposons, et pourtant avec un flair linguistique qui ne laisse pas
d'tonner.
Que l'action dpende de l'agent, en un sens spcifique de la
relation de dpendance. Aristote le laisse entendre, bien avant les
Stociens, sans toutefois traiter thmatiquement ce rapport. Il est
nanmoins un des premiers, aprs les sophistes peut-tre, vrifier
et codifier la pertinence des choix linguistiques faits par les
orateurs, les potes tragiques, les magistrats, et aussi les usagers du
langage ordinaire, ds lors qu'il s'agit de soumettre l'action et son
agent au jugement moral. C'est pourquoi le soin qu'Aristote apporte
dans ses distinctions et dans ses dfinitions mrite qu'on examine
celles-ci en portant une attention particulire aux ressources de
langage qu'elles mettent en uvre.
Aristote. on l'a assez dit, ne dispose pas dans ses thiques d'un
concept unifi de volont, comme on le trouvera chez Augustin,
Descartes et les cartsiens, Kant. Hegel. Afin nanmoins de donner
un point d'ancrage au plan de l'action son tude dtaille des
vertus, c'est--dire des traits d'excellence de l'action, il pro-
cde au Livre III de Y thique Nicomaque' une premire dli-
mitation du couple des actions qu'on dit faites malgr soi (Akn,
akousios) ou de son plein gr (hkn, hkousios)
2
, puis une dli-
mitation plus fine l'intrieur de ce premier cercle des actions
exprimant un choix, plus prcisment un choix prfrentiel
(pro-hairsis) que dtermine au pralable la dlibration
(bouleusis). Ce rapport entre prfr et prdlibr
(probbouleumnon) sert de socle une dfinition de la vertu qui
met en jeu d'autres traits diffrentiels que nous considrerons dans
une autre tude
3
.
Comment, sur cette base, dire le rapport de l'action l'agent ?
L'expression la plus abrge de ce rapport rside dans une formule
qui fait de l'agent le principe (arkh) de ses actions, mais en un sens
de Xarkh qui autorise dire que les actions dpendent de
(prposition pi) l'agent lui-mme (auto) (th. Nie, III, 1, 1110a
17).
La relation de l'agent est ainsi exprime par la conjonction entre
le concept gnrique de principe et l'un des dictiques de la famille
du soi, dont on fera plus loin l'numration, par le truchement d'une
prposition privilgie et de quelques autres de sens voisin. La
prsence simultane de ces trois composantes est essentielle
l'interprtation aristotlicienne de ce que nous appelons aujourd'hui
ascription. Cette triple membrure de l'ascription prend un sens de
plus en plus prcis mesure que l'analyse progresse depuis le plan
du contre-gr et du plein gr jusqu'au plan du choix prfrentiel o
le rapport entre thorie de l'action et thorie thique se fait plus
troit.
Commenant par les actions faites contre-gr caractrises par
la contrainte ou l'ignorance, Aristote dclare : Est fait par
contrainte tout ce qui a son principe hors [de nous], c'est--dire un
principe dans lequel on ne relve aucun concours de l'agent ou du
patient (III, 1. 1110a 1-3)
4
. Par contraste, le principe qui [dans
les actions faites de plein gr] meut les parties instru-
1. Trad. fr. de J. Tricot, Pans, V'rin, 1987.
2. Je suis ici la traduction de Gauthier-Jolif (Louvain, Publications universi-
taires de Louvain, Pans, Batrice Nauwelaerts, 1958) de prfrence celle de Tri-
cot qui traduit akn-hkn par involontaire-volontaire. On pourrait, de faon plus
frappante, opposer le contre-grau plein gr.
3. Ainsi donc la vertu est une disposition agir d'une faon dlibre, consis-
tant en une mdit relative nous, laquelle est rationnellement dtermine
comme le dterminerait l'homme prudent [le phronimos] (th. Nie, trad. Tricot,
11,6, 1106 b 36- 1107 a 2).
4. Cf. de mme III, 1. 1110b 1 S-17 (qui conclut le chapitre sur le malgr soi) :
Ainsi donc il apparat bien que l'acte forc soit celui qui a son principe hors de
nous, sans aucun concours de l'agent qui subit la contrainte.
110
111
SOI-MMECOMMEUN AUTRE DE L'ACTION L'AGENT
mentales de son corps rside en lui [en auto] et, les choses dont le
principe est en l'homme mme [en auto], il dpend de lui [p'aut]
de les faire ou de ne les pas faire (III, 1, 1110a 15-18)'. On
remarque qu' ce stade de l'analyse, la prposition dans (en)
prvaut sur la prposition de (pi). Ce ne sera plus le cas avec
l'analyse plus prcise (plus prs de l'thique, dira Aristote) du choix
prfrentiel. Mais l'analyse linguistique et conceptuelle du malgr
soi et du de plein gr permet dj de mettre l'accent sur la
conjonction entre la notion de principe et un pronom rpondant la
question qui ?( nous , quelqu'un , chacun et. pour rsumer,
autos, lui-mme ). Or cette conjonction pose un problme
considrable ds l'analyse du couple akn-hkn, dans la mesure o
la notion de principe, prise isolment, ne suffit pas marquer le
sens pr-moral du volontaire au sens large (le de plein gr ) et a
fortiori le sens plus appropri au champ thique du choix
prfrentiel (ou dcision) au sens strict du terme. Principe , en
effet, est commun toute investigation des choses premires,
quelles qu'elles soient : il ne peut donc servir dpartager le plan
physique et le plan thique ; ainsi, c'est parce que la nature est
principe de mouvement qu'on peut s'attacher claircir la notion de
mouvement, ce qui est le dessein principal de la Physique
2
. Si donc
la notion de principe peut tre commune la physique et l'thique,
c'est parce que, de part et d'autre, il est question de devenir, de
changement, de mouvement. Nos modernes diraient : d'vnement.
Du mme coup, la notion de principe ne suffit pas elle seule
spcifier le lien de l'action l'agent. La notion plus spcifique de
principe interne ou immanent n'a pas davantage valeur
discriminante : car ce qui distingue les tres naturels (les animaux et
leurs parties, les plantes, les corps lmentaires simples et tous les
tres du mme
1. Et plus loin : l'acte volontaire semblerait tre ce dont le principe rside
dans [en] l'agent lui-mme [auto] connaissant les circonstances particulires au
sein desquelles son action se produit (III, 3, 1110 a 22-23).
2. On lit en PhysiqueIII, l, dbut, 200 b 12-15 : Puisque la nature est principe
de mouvement et de changement et que notre recherche porte sur la nature, il
importe de ne pas laisser dans l'ombre ce qu'est le mouvement ; ncessairement,
en effet, si on l'ignore, on ignore aussi la nature (trad. fr. de H. Carteron, Paris,
Les Belles Lettres, 1961). Sur tout ceci, cf. A. Mansion, Introduction la physique
aristotlicienne, Louvain, 1946, p. 49-79 ; rd., Paris, Vnn, 1973. Cet auteur rap-
pelle que l'expression de 184 a 15-16, ta pri tas arkhas. a mme extension que le
titre classique pri phuss, reu des Prsocratiques. Ainsi parle-t-on des prin-
cipes des tres naturels concernant leur production (191 a 3). Ces principes sont,
comme l'enseigne le premier livre de la Physique, la matire, la forme et la priva-
tion.
genre) des produits de l'art, disons des tres artificiels, c'est prci-
sment qu'ils ont en eux-mmes un principe de mouvement et de
repos'.
Si donc ce n'est ni le terme principe , ni mme la prposition
dans , qui spcifient la relation de l'action l'agent, seule peut le
faire la conjonction entre le principe et l'un des termes qui rpondent
la question qui ? ( nous , etc.). Un principe qui est soi, un soi qui
est principe, voil le trait marquant de la relation cherche. Eu gard
cette relation sans gale au plan physique, le subtil glissement de la
prposition dans la prposition de ( de nous ) revt un
sens certain. On pourrait dire que le dans (en) marque la
continuit entre la physique et l'thique, continuit plus visible dans
la classe plus vaste des actes faits malgr soi ou de plein gr, tandis
que la prposition de (pi) atteste la spcificit du plan thique,
plus vidente dans la classe plus restreinte des actes choisis, dcids,
prfrs aprs dlibration
2
. Quoi qu'il en soit de cette variation
fine, c'est la fonction de ces prpositions de relier le principe au
pronom personnel. L'effet est double sens : en plaant le nous
paradigmatique en position de complment grammatical, la
prposition installe le soi dans la position du principe ; inversement,
en qualifiant le principe par la dpendance nous , elle dplace la
notion de principe du plan physique au plan thique. L est
l'essentiel : la sorte de court-circuit instaur entre arkh et autos fait
que chacun de ces termes est interprt en fonction de l'autre. Dans
cette interprtation mutuelle, rside toute l'nigme de ce que les
Modernes placent sous le titre de Pascription \
1. On lit la dfinition complte et prcise de la phusis en PhysiqueII, 1, 192
b 20 : La nature est un principe et une cause de mouvement et de repos pour la
chose en laquelle elle rside immdiatement, titre d'attribut essentiel et non
accidentel. Cf. Mansion, op. cit., p. 99. Autrement dit, la tendance interne au
changement est ce qui fondamentalement distingue la nature de l'art.
2. Nous voquerons, plus loin, propos de l'amiti (septime tude, section 2),
un jeu plus subtil entre le pronom non rflchi autoset le rflchi hauton. (Faut-il
tre ami de soi-mme pour tre ami de l'autre ?) Ce jeu est anticip dans le cha-
pitre m de l'thique Nicomaque l'occasion d'une notation remarquable : Ces
diffrentes circonstances, personne, moins d'tre fou, ne saurait les ignorer
toutes la fois ; il est vident aussi que l'ignorance ne peut pas non plus porter sur
l'agent, car comment s'ignorer soi-mme [hauton] ? (III, 2, 1111 a 8.)
3. Les variations dans les traductions franaises tmoignent de la situation
insolite cre par la conjonction entre principe et soi par le truchement d'une pr-
position dtermine; ainsi Tricot traduit eph'hmin par dpend de nous;
Gauthier-Jolif prfrent : est en notre pouvoir . L'introduction du terme pou-
voir met sur la piste d'un dveloppement que nous entreprendrons la fin de la
prsente tude.
112
113
SOI-MMECOMMEUNAUTRE DE L'ACTION L'AGENT
C'est avec l'analyse de la prohairsis, du choix prfrentiel (ou
dcision), que la dtermination thique du principe de l'action
l'emporte sur sa dtermination physique. Nous atteignons ici le
noyau de l'agir proprement humain dont Aristote dit qu'il est
essentiellement propre la vertu (Voilquin) ' ou troitement
apparent celle-ci (Tricot), ou possdant un lien plus troit
avec elle (Gauthier-Jolif) (Eth. Mie, III, 4, 111 1 b 5) ; c'est en effet
le choix prfrentiel qui rend l'action humaine susceptible de
louange ou de blme, dans la mesure o c'est lui qui permet mieux
que les actes [extrieurs] de porter un jugement sur le caractre de
[quelqu'un] (ibid.). De ce choix prfrentiel, il est dit, avec plus de
force et de prcision que du plein gr, qu'il porte, selon toute
apparence, sur les choses qui dpendent de nous {ta eph 'hminj
(trad. Tricot, 1111 b 30). Certes, dans l'analyse qui suit, l'accent
principal n'est pas mis sur ce lien de dpendance (Tricot), de
pouvoir (Gauthier-Jolif), mais sur la dlibration qui prcde le
choix : le pr-fr, note Aristote, exprime le pr-dlibr. Aristote
anticipe ainsi toutes les analyses dont nous avons trait plus haut,
o le rapport quoi-pourquoi ? tend clipser le rapport quoi-qui?
par neutralisation de l'attribution expresse un agent. Mais le
philosophe ne tarde pas prciser que, de toutes les choses sur
lesquelles on ne dlibre pas (les entits ternelles, les intempries,
le gouvernement des autres peuples, etc.), aucune ne pourrait tre
produite par [dia] nous (III, 5, 1112 a 30). Mais nous dlibrons
sur les choses qui dpendent de nous [ton eph'hmin], que nous
pouvons raliser (Tricot) [celles qui sont objets d'action (G.-J.)] (...)
et chaque classe d'hommes [hkastoi] dlibre sur les choses qu'ils
peuvent raliser eux-mmes [pri ton dihautn praktn] (cf.
Tricot, III, 5, 1112a 30-34)
2
. La dfinition canonique du choix
prfrentiel exprime merveille cette attribution subtile de l'action
l'agent travers le pr-dlibr : L'objet du choix tant, parmi
les choses
1. Aristote, thique Nkomaque, trad. A. Voilquin, Paris, Garnier, 1963,
Gar-nier-Flammarion, 1965.
2. Bien des remarques terminologiques et grammaticales seraient faire ici : on
notera en particulier l'expression la voix passive de ce que, en termes
husser-liens, on appellerait le nomed'action : le ralis (qui appelle son tour
la prposition dia proche de pi) ; on notera en outre une construction
grammaticale diffrente quelques lignes plus loin : Il apparat ainsi que
l'homme est principe de [ses] actions et que la dlibration porte sur les choses qui
sont ralisables par [l'agent] lui-mme [ton auto praktn] (1112 b 31-32). On
notera aussi l'emploi du distributif chacun (hkastoi) et le recours au terme
l'homme quivalent au nous des autres textes cits. Enfin, le jeu entre le
pronom non rflchi (autos) et le rflchi (hautn, haute) se poursuit.
en notre pouvoir, un objet de dsir sur lequel on a dlibr [G.-J. :
du dsir dlibr], le choix sera un dsir dlibratif des choses qui
dpendent de nous. Car, une fois que nous avons dcid la suite
d'une dlibration, nous dsirons alors conformment [notre]
dlibration (1113 a 9-12)'.
Je ne voudrais pas clore cette revue des choix terminologiques et
grammaticaux d'Anstote sans avoir voqu quelques expressions
qui soulignent le caractre nigmatique de ce rapport entre l'action
et son agent. Deux d'entre elles sont franchement mtaphoriques. La
premire opre un rapprochement entre principe et paternit. Ce
lien mtaphorique a pour contexte la rfutation du proverbe selon
lequel nul [oudeis] n'est volontairement ni malgr soi bienheureux
(Tricot, III, 7, 1113 b 14-15). Admettre cet aphorisme serait, dit
Aristote, refuser l'homme d'tre principe et gnrateur [G.-J. :
pre] de ses actions, comme il l'est de ses enfants (1113 b 18-19).
La seconde mtaphore, politique cette fois, est celle de la matrise,
qui parat en clair dans le texte suivant : De nos actions (...) c'est
depuis le commencement jusqu' la fin que nous sommes les matres
[kurioi] (1114 b 31-32). Ces deux mtaphores prises ensemble
marquent de faon oblique l'originalit de l'ascription de l'action
son agent par rapport l'attribution ordinaire un sujet logique. Ne
pourrait-on pas dire que le lien entre principe (arkh) et soi (autos)
est lui-mme profondment mtaphorique, au sens du
voir-comme que je propose dans La Mtaphore vive ? L'thique,
en effet, ne demande-t-elle pas voir le principe comme soi
et le soi comme principe ? En ce sens, les mtaphores expresses
de la paternit et de la matrise seraient la seule manire de porter au
langage le lien issu du court-circuit entre principe et soi.
Dernire approche oblique de l'ascription en philosophie aris-
totlicienne : pour exprimer la sorte de collaboration, ou pour
mieux dire de synergie, entre nos choix et la nature, dans la for-
mation des dispositions (hexeis) dont l'ensemble constitue notre
caractre, Aristote forge l'expression sunaitioi, co-respon-sables
: Si donc, comme il est dit, nos vertus sont volontaires (et, en
fait, nous sommes bien nous-mmes, dans une certaine mesure,
partiellement causes [sunaitioi ps] de nos propres dispositions, et,
d'autre part, c'est la nature mme de notre caractre
1. La deuxime partie de la phrase cite dplace l'accent sur le rapport dci-
sion-dlibration. donc quoi-pourquoi ; mais ce rapport n'efface pas l'insistance
pralable sur la dpendance nous de l'objet du dsir dlibratif, donc sur le pou-
voir qui est le ntre l'gard de ces choses.
114 115
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
DE L'ACTION L'AGENT
qui nous fait poser telle ou telle fin), nos vices seront volontaires,
car le cas est le mme (trad. Tricot, III, 7, 1114b 20-25). L'in-
tention d'Aristote est assurment d'tendre la responsabilit de nos
actes nos dispositions, donc notre personnalit morale tout
entire : elle est aussi de la tenir dans les limites d'une responsabilit
partielle. Or le langage pour le dire ne peut tre qu'insolite (ailion
plutt qu aitia, adjonction de sun et nuance du ps)
1
. Ici aussi,
serait-on tent de dire, les mots manquent.
C'est bien ce qu'un bond travers les sicles va nous faire red-
couvrir.
Je voudrais montrer que la thorie moderne de l'action conduit
donner l'ascription une signification distincte de l'attribution,
signification qui transforme le cas particulier en exception, le place
du mme ct - savoir celui de la pragmatique - que la capacit de
se dsigner soi-mme, dont nous connaissons le lien avec la thorie
de renonciation et des actes de discours. Cette signification distincte
est signale, chez Strawson lui-mme, par des traits qui rappellent
Aristote. Dans Les Individus, l'auteur observe en effet que les
caractres physiques et psychiques appartiennent la personne, que
celle-ci les possde. Or, ce dont un possesseur (owner) dispose est
dit lui tre propre (own), en opposition ce qui appartient un autre
et qui, de ce fait, est dit lui tre tranger. A son tour, le propre
gouverne le sens que nous donnons aux adjectifs et pronoms que
nous appelons prcisment possessifs : mon - le mien , ton - le
tien , son/sa - le sien/la sienne ..., sans oublier l'impersonnel on
(one's own), ni le dis-tributif chacun , comme dans l'expression
chacun le sien , sur laquelle se construit l'thique du juste,
comme on le montrera plus loin.
La question est de savoir si ces expressions, bien souvent idio-
matiques, reposent sur des significations universelles qui mritent
d'tre assimiles des transcendantaux du mme ordre que ceux
que nous avons assigns au champ smantique de l'action. Il y a tout
lieu de le penser. Il est remarquable en effet que l'ascription marque
le renvoi de tous les termes du rseau conceptuel de l'action son
pivot qui ?. Inversement, nous dterminons la rponse la question
qui ?en procurant une rponse la chane
1. Sur l'expression sunaition, on lira W.F.R. Hardie, Aristotle's Ethical Theory,
Oxford University Press, 2
e
d., 1981, p. 177-181 ; le chapitre vin, consacr la
distinction entre le volontaire et l'involontaire , et le chapitre ix, consacr au
choix et l'origine [origination] de l'action , proposent une revue complte des
problmes discuts ici sous l'angle particulier de la relation entre l'action et son
agent.
des questions quoi ?, pourquoi ?, comment ?, etc. Vrifions-le pour
les deux questions qui nous ont occups dans l'tude prcdente : la
question quoi ? et la question pourquoi ?
C'est d'abord de Vaction elle-mme que nous disons qu'elle est de
moi, de toi, de lui/d'elle, qu'elle dpend de chacun, qu'elle est en son
pouvoir. C'est encore de Vinteniion que nous disons qu'elle est
l'intention de quelqu'un et c'est de quelqu'un que nous disons qu'il
(ou elle) a l'intention-de. Nous pouvons certes comprendre
l'intention en tant que telle ; mais, si nous l'avons dtache de son
auteur pour l'examiner, nous la lui restituons en la lui attribuant
comme tant la sienne. C'est d'ailleurs ce que fait l'agent lui-mme
lorsqu'il considre les options ouvertes devant lui et qu'il dlibre,
selon l'expression d'Aristote. L'ascription consiste prcisment dans
la rappropriation par l'agent de sa propre dlibration : se dcider,
c'est trancher le dbat en faisant sienne une des options considres.
Quant la notion de motif, dans la mesure o elle se distingue de
l'intention dans laquelle on agit, principalement en tant que motif
rtrospectif, l'appartenance l'agent fait autant partie de la
signification du motif que son lien logique l'action elle-mme dont
il est la cause ; on demande lgitimement : Pourquoi A a-t-il fait X
? Qu'est-ce qui a amen A faire X ? Mentionner le motif, c'est
mentionner aussi l'agent. Ce rapport a mme un caractre
particulirement trange, paradoxal. D'une part, la recherche de
l'auteur est une enqute terminable qui s'arrte la dtermination de
l'agent, gnralement dsign par son nom propre : Qui a fait cela ?
Un tel. D'autre part, la recherche des motifs d'une action est une
enqute interminable, la chane des motivations se perdant dans le
brouillard des influences internes et externes insondables : la
psychanalyse a un rapport direct avec cette situation. Cela n'em-
pche pas toutefois que nous reliions l'enqute interminable des
motifs l'enqute terminable de l'agent ; cette relation trange fait
partie de notre concept d'ascription. C'est donc en fonction du rseau
entier qui quadrille la smantique de l'action que nous comprenons
l'expression : agent. Cette remarque est l'occasion de rappeler que la
matrise du rseau entier est comparable l'apprentissage d'une
langue et que, comprendre le mot agent , c'est apprendre le
placer correctement dans le rseau.
116 117
SOI-MME COMME UN AUTRE
DE L'ACTION L'AGENT
2. Les apories de l'ascription
Si les choses paraissent relativement simples aussi longtemps
qu'on reste dans les gnralits concernant la relation
d'inter-signification qui unit entre eux tous les termes du rseau et
en particulier le qui ? le quoi ? et le pourquoi ? de l'action, comment
expliquer la rsistance, observable dans les diverses versions de la
thorie de l'action, toute investigation plus serre du rapport
description ? Il ne suffit pas d'incriminer l'ontologie adverse de
l'vnement, dont nous avons montr la force d'obstruction l'gard
d'une investigation plus pousse des rapports de l'action l'agent.
On peut se demander s'il ne faut pas sortir du cadre de la smantique
de l'action, l'intrieur duquel se dploie la thorie des particuliers
de base selon Strawson. La personne, en tant que terme rfrentiel,
reste une des choses dont nous parlons. En ce sens, la thorie
tout entire des particuliers de base est comme aspire par une
ontologie du quelque chose en gnral qui, confronte la requte
de reconnaissance de Yipse, dveloppe une rsistance comparable,
quoique diffremment argumente, celle de l'ontologie de
l'vnement.
^ Cela veut-il dire que la pragmatique du discours, axe sur
renonciation et ouverte sur la dsignation par soi de l'noncia-teur,
est d'un plus grand secours? Oui, sans doute. Mais jusqu' un certain
point seulement, dans la mesure o se dsigner comme agent
signifie plus que se dsigner comme locuteur. C'est de cet cart
entre deux degrs d'autodsignation que tmoignent les apories
propres l'ascription. Celles-ci, comme c'est gnralement le cas
avec les apories les plus intraitables, ne portent pas condamnation
contre la philosophie qui les dcouvre. Bien au contraire, elles sont
mettre son crdit, comme je l'ai montr par ailleurs'.
1. La premire difficult peut tre aperue dans le prolongement
de la troisime des thses de Strawson rappele ci-dessus, la thse
selon laquelle il appartient au sens des prdicats pratiques, comme
celui de tous les prdicats psychiques, d'tre attribumes un autre
que soi, ds lors qu'ils sont attribuables soi. et de garder le mme
sens dans les deux situations d'attribution.
I. Temps et Rcit. t. III, est entirement construit sur le rapport entre une
apo-rtique de la temporalit et la riposte d'une potique de la narrativit.
Il est remarquable que, la diffrence des deux autres thses
considres, l'attribution se fait ici non plus seulement la mme
chose - donc sous le couvert du quelque chose en gnral - mais au
soi et son autre (self-ascribable/other-ascribable). Le rapport du
qui /au quoi ?est ici mis nu. Or, l'tranget de ce rapport mrite
qu'on s'y arrte. Le ddoublement de l'ascription entre soi-mme et
un autre suggre que l'ascription compense en quelque sorte une
opration inverse, consistant tenir en suspens l'attribution
quelqu'un, dans le seul but de donner une teneur descriptive aux
prdicats d'action ainsi mis, si j'ose dire, en rserve d'attribution.
C'est le rapport entre le ddoublement de l'ascription effective et la
possibilit de tenir celle-ci en suspens qui fait problme. Or, c'est un
phnomne tonnant qui, l'chelle d'une culture entire, prend des
proportions considrables, que nous ne cessions d'accrotre le
rpertoire des penses, au sens large du mot, incluant cognitions,
volitions, motions, dont nous comprenons le sens sans tenir
compte de la diffrence des personnes auxquelles elles sont
attribues. C'est ce que vrifient les Traits des passions, en
commenant par le livre II de la Rhtorique d'Aristote, et en
continuant par les traits mdivaux et classiques (saint Thomas,
Descartes, Spinoza, etc.)
1
.
Non seulement les phnomnes psychiques, que les classiques
appelaient des affections et des actions, sont attribuables qui-
conque, chacun, mais leur sens peut tre compris hors de toute
attribution explicite. C'est trs exactement sous cette forme qu'ils
entrent dans le thsaurus des significations psychiques. On peut
mme dire que cette aptitude des prdicats psychiques tre
compris en eux-mmes, dans le suspens de toute attribution expli-
1. Ainsi lit-on dans le premier article du Trait des passions de l'me de Descartes
: Et, pour commencer, je considre que tout ce qui se fait ou qui arrive de nouveau,
est gnralement appel par les Philosophes une Passion au regard du sujet auquel
il arrive et une Action au regard de celui qui fait qu'il arrive. En sorte que. bien que
l'agent et le patient soient souvent fort diffrents, l'Action et la Passion ne laissent
pas d'tre toujours une mme chose qui a ces deux noms, raison des deux divers
sujets auxquels on la peut rapporter (Descartes, Les Passions de l'me, intr. et
notes p. G. Rodis-Lewis, Paris, Vrin, 1964 ; et d. Adam-Tannery, t. XI, Paris,
Vrin, 1974). C'est pourquoi le dnombrement des passions peut se faire sans
acception de personnes. Certes, les passions sont appeles passions de l'me Mais le
mot me n'introduit aucune diffrence entre je et tu. C'est pourquoi le
nous , qui entre dans la dfinition de chacune des passions. dsigne quiconque
qui les passions sont attribues. On lira cet gard les articles 53, 56, 57, 61, qui
donnent les dfinitions des passions principales et les rapports de chacune un
nous indtermin. Dans ce contexte, nous ne signifie pas plus que on ou
chacun . Aussi bien parle-t-on, sans scrupule particulier, de l'me la troisime
personne.
118
119
SOI-MME COMME UN AUTRE
DE L'ACTION L'AGENT
cite, constitue ce qu'on peut appeler le psychique . La littrature nous
donnera plus tard une confirmation clatante de la comprhension que
nous avons d'tats psychiques non attribus ou en suspens d'attribution,
dans la mesure o cette comprhension est la condition de leur
attribution des personnages fictifs. Cette possibilit de dnommer des
phnomnes psychiques et d'en comprendre le sens, abstraction faite
de leur attribution, dfinit trs exactement leur statut de prdicat : le
psychique , c'est le rpertoire des prdicats psychiques disponibles
pour une culture donne.
Ce suspens de l'attribution des prdicats pratiques un agent
dtermin rvle la particularit du rapport entre la question qui ? et le
couple des questions quoi-pourquoi ? Il appartient en effet ce rapport
de pouvoir tre suspendu, et l'ascription se comprend prcisment en
corrlation avec ce suspens. Du mme coup il devient comprhensible
que la thorie de l'action dveloppe dans l'tude prcdente ait pu
procder une pokh mthodique de la question de l'agent, sans
paratre faire violence l'exprience et son expression au niveau du
langage ordinaire. L'attraction exerce par l'pistmologie causaliste et
par l'ontologie de l'vnement sur l'analyse logique des phrases d'action
se trouvait favorise, et en quelque sorte encourage, par la moindre
rsistance du rseau conceptuel de l'action au point de suture entre la
question qui ? et le bloc des autres questions suscites par le phnomne
de l'action. L'attention porte au contenu de nos intentions et leur
motivation tend d'elle-mme dtacher le quoi ?de la chose faire, et le
pourquoi ?de la chose faite, du qui ? de l'action. Ce dtachement a le
double effet, d'une part, de faciliter l'incorporation du sens des intentions
et des motifs au rpertoire des phnomnes psychiques, sans que nous
ayons prciser qui ces phnomnes appartiennent, d'autre part, de
rendre plus nigmatique l'appropriation qui lve le suspens de
l'ascription.
La leve du suspens prsente en effet des degrs. Entre le suspens
total de l'attribution et l'attribution effective tel ou tel agent
s'intercalent au moins trois degrs : celui du on, entirement anonyme,
antithse absolue du soi ; celui du quiconque au sens du n'importe qui,
donc au sens d'une individuation admettant la substitution
indiffrente, celui enfin du chacun, qui implique une opration de
distribution de parts distinctes, comme le suggre l'adage juridique
chacun le sien (suum cuique). Ces phases intermdiaires d'attribution
neutralise sont prcisment celles qui assurent la permutation vise par
Strawson entre l'ascription soi et un autre que soi. Il rsulte de cette
dia-
lectique de suspens et d'appropriation que la prsente aporie de
l'ascription ne peut trouver sa solution dans le cadre de la thorie de la
rfrence identifiante : pour passer du suspens de l'ascription, travers
l'ascription neutralise, l'ascription effective et singulire, il faut qu'un
agent puisse se dsigner lui-mme, de telle sorte qu'il ait un autre
vritable qui la mme attribution est faite de faon pertinente. Il faut
alors sortir de la smantique de l'action et entrer dans la pragmatique qui
prend en compte les propositions dont la signification varie avec la
position du sujet parlant et, dans cette mme mesure, implique une
situation d'in-terlocution mettant face face un je et un tu. Mais,
si le recours la pragmatique du discours est ncessaire, suffit-elle
rendre compte des particularits de l'autodsignation comme agent ?
C'est la question que soulvent les autres apories de l'ascription.
2. La seconde difficult concerne le statut de l'ascription par rapport
la description. Si ascrire n'est pas dcrire, n'est-ce pas en vertu d'une
certaine affinit, qui reste prciser, avec prescrire ? Or prescrire
s'applique simultanment aux agents et aux actions. C'est quelqu'un
qu'il est prescrit d'agir en conformit avec telle ou telle rgle d'action.
Ainsi se dterminent simultanment le permis et le non-permis du ct
des actions, le blme et la louange du ct des agents. Une double
prsupposition est ainsi assume, savoir que les actions sont
susceptibles d'tre soumises des rgles et que les agents peuvent tre
tenus pour responsables de leurs actions. On peut appeler imputation
l'acte de tenir un agent pour responsable d'actions tenues elles-mmes
pour permises ou non permises.
Cette sorte d'analyse peut s'autoriser d'Aristote qui, on l'a vu plus
haut, joint d'emble le choix prfrentiel l'ide de louange et de blme.
Pour lui, les critres du plein gr et plus encore ceux du choix
prfrentiel sont d'emble des critres d'imputation morale et
juridique. La contrainte et l'ignorance ont valeur expresse d'excuse,
de dcharge de responsabilit. Si le plein gr mrite louange et blme, le
contre-gr appelle pardon et piti (il est vrai toutefois qu'Aristote ne
prcise pas ce qui relve plus prcisment des tribunaux ou de la simple
apprciation morale). De l l'ide ingnieuse de tenir l'imputation, non
pas comme une opration surajoute l'ascription, mais de mme
nature qu'elle. Ainsi H.L.A. Hart ' propose-t-il, pour interprter les
propositions
1. H.L.A. Hait, The Ascription of Responsability and Rights, in Procee-dings of the
Arislotelian Society, n 49, 1948, p. 171-194.
120
121
SOI-MME COMME UN AUTRE DE L'ACTION
L'AGENT
du langage ordinaire du type : il a fait cela , de les rapprocher des
dcisions juridiques par lesquelles un juge statue que ceci est un
contrat valide, que ceci est un meurtre, non un assassinat. Selon
l'auteur, la transition entre les propositions du langage ordinaire,
sans coloration morale ou juridique, et les dcisions juridiques, est
assure par des propositions de statut intermdiaire de la forme :
ceci est moi. vous, lui, c'est--dire des propositions qui
revendiquent, confrent, transfrent, reconnaissent, bref attribuent
des droits. De ce rapprochement entre imputation et attribution de
droits, rsulte par contraste la complte csure entre ascrire et
dcrire. Ascrire, selon Hart, est le rsultat d'un processus spcifique
o des revendications (daims) opposes sont confrontes, et o l'une
d'entre elles est dboute, invalide (defeated), non parce qu'on
aurait atteint le noyau positif de l'intention bonne ou mauvaise, mais
parce qu'on aurait puis les excuses tenues pour recevables dans
les cas semblables. L'aptitude d'une revendication tre dboute -
la defeasibility -devient ainsi un critre de toute prtention ascrire
une action un agent.
L'intention qui prside cette assimilation entre ascription et
imputation morale et juridique est fort lgitime : elle tend creuser
l'cart qui spare l'ascription au sens moral et l'attribution au sens
logique. Cet cart concerne aussi le sens assign aux mots
possder et appartenir , ainsi qu'au groupe de dictiques de la
famille des adjectifs et des pronoms possessifs. L'agent,
disions-nous, est le possesseur des actions qui sont les siennes. Il
appartient quelqu'un, disions-nous aussi, de faire ceci plutt que
ceia. Or la possession n'a cess de poser un problme juridique.
comme l'attestent l'cole du droit naturel, la philosophie kantienne
du droit priv tout entire centre sur la distinction du mien et du
tien dans la Mtaphysique des murs, et la thorie du droit abstrait
dans les Principes de la philosophie du droit de Hegel'.
On peut douter toutefois que l'imputation morale et juridique
constitue la forme forte d'une structure logique dont l'ascription
serait la forme faible. Ceci pour trois raisons au moins.
Premire raison : les nonciations juridiques s'appliquent diffi-
cilement des actions aussi simples - certains diront outrageuse-
ment banales - que celles que la grammaire et la logique des
1. Mme la possession du corps propre peut tre tenue pour une dclaration de
teneur juridique (Principes de la philosophie du droit, 47-48 ; trad. fr. de R.
Dera-th, Paris, Vnn, 1989. p. 104-105).
phrases d'action se plaisent dcrire, dans le dessein lgitime de ne
pas laisser l'intrt moral, politique ou idologique que le lecteur
peut avoir pour les contenus d'action considrs interfrer avec leur
structure propositionnelle. L'imputation morale ou juridique n'entre
vritablement en ligne de compte que lorsque l'on considre des
actions complexes - ces chanes d'actions que nous appellerons dans
la sixime tude des pratiques. Or les rgles de complexification qui
prsident la composition de ces pratiques relvent d'un autre type
d'enqute que celle que contrle encore la smantique des phrases
d'action, mme si la pragmatique ajoute sa complexit propre
ladite smantique. 11 faudra donc ajourner l'examen de l'imputation
morale et juridique au-del de l'tude consacre aux pratiques.
Seconde raison : si l'on reste dans le cadre prescrit par la prag-
matique. il semble bien que les nonciations proprement juridiques
s'appliquent de faon slective des actions considres sous
l'angle du blmable et du punissable. Or sont blmes les actions
juges mauvaises par un verdict de condamnation. L'imputation
juridique s'inscrit ainsi dans une classe d'actes de discours. savoir
celles des verdictives, lesquelles outrepassent la simple ascription
d'une action un agent. Soumettre une action un acte de
condamnation, c'est la soumettre une procdure accusatoire qui a,
comme tous les actes de discours, ses rgles constitutives propres.
Or, si l'ascription parat tre une opration pralable toute
nonciation accusatoire du type des verdictives, le trait distinctif de
l'ascription est-il chercher au plan o se distinguent les actes de
discours ?
Troisime raison : ce que l'assignation de responsabilit au sens
thico-juridique parat prsupposer est d'une autre nature que la
dsignation par soi-mme d'un locuteur, savoir un lien de nature
causale - qui reste dterminer - et que dsigne l'expression de
pouvoir-faire ou de puissance d'agir. Il faut que l'action puisse tre
dite dpendre de l'agent pour tomber sous le blme et la louange.
Ainsi, dans Y thique Nicomaque, Aristote a-t-il fait prcder, on
l'a rappel ci-dessus, sa thorie des vertus par une analyse d'un acte
fondamental, le choix prfrentiel, dans lequel s'exprime une
puissance d'agir plus primitive que le caractre blmable ou louable
- nous dirions aujourd'hui verdictible - de l'action produite.
Nous sommes ainsi renvoys vers une analyse spcifique de la
puissance d'agir, centre sur l'efficacit causale de cette puissance.
C'est en ce point que le lien de l'action son agent ajoute une
dimension nouvelle, proprement pratique, la
122 123
SOI-MME COMME UN AUTRE DE L'ACTION L'AGENT
dsignation par soi du locuteur et la dsignation de son inter-
locuteur comme autre que soi.
3. Mais que signifie puissance d'agir ? C'est ici que surgit la
troisime aporie dans laquelle semble s'enliser notre concept des-
cription. Dire qu'une action dpend de son agent, c'est dire de faon
quivalente qu'elle est en son pouvoir
1
.
Or, avec la notion de pouvoir-faire revient la vieille ide de
causalit efficiente que la rvolution galilenne avait chasse de la
physique. Est-il permis de dire qu'avec l'ascription, la causalit
efficiente rintgre simplement son lieu d'origine, sa terre natale,
savoir prcisment l'exprience vive de la puissance d'agir?
Suffit-il. pour autoriser une telle rhabilitation, de tirer argument de
la relle polysmie de la notion de causalit, que maints auteurs
contemporains reconnaissent volontiers, soit pour justifier une
reformulation de la causalit approprie aux sciences humaines, en
particulier l'historiographie, comme on le voit chez Collingwood
2
,
soit pour justifier son limination dfinitive du champ scientifique
des ides de lois ou de fonctions, comme on le voit chez Russell
3
?
Mais une restauration de la causalit efficiente au seul bnfice
de l'ascription risque de faire figure d'argument paresseux, comme
toutes les fois qu'on invoque quelque chose comme un fait primitif.
Je ne rcuse pas la notion de fait primitif. Il m'ar-rivera. un stade
beaucoup plus avanc de cette investigation, d'opposer la modestie
de l'aveu de quelques faits primitifs inhrents l'laboration d'une
anthropologie fondamentale l'ambition promthenne d'une
fondation ultime sur le modle du Cogita cartsien et de ses
radicalisations successives
4
. Encore ne faut-il pas rendre les armes
avant d'avoir combattu. C'est pourquoi je veux donner la forme de
l'aporie l'aveu que la puissance d'agir de l'agent doit tre tenue en
dernire instance pour un fait primitif. Fait primitif ne veut pas dire
fait brut. Bien au contraire, on ne doit pouvoir reconnatre un fait
primitif qu'au terme d'un travail de pense, d'une dialectique,
c'est--dire d'un conflit d'arguments, dont il faut avoir prouv toute
la rigueur.
Cette dialectique passe, selon moi, par deux stades : un stade
1. Cf. ci-dessus, p. 113, notre remarque sur la traduction franaise du eph'hcmin
d'Aristote.
2. Cf. Temps et Rcit, t. I. Paris, d. du Seuil, 1983, p. 179, n. 1.
3. Ibid. p. 162.
4. Cf. ci-dessous, dixime tude.
disjonctif. au terme duquel est affirm le caractre ncessairement
antagoniste de la causalit primitive de l'agent par rapport aux
autres modes de causalit ; un stade conjonctif, au terme duquel est
reconnue la ncessit de coordonner de manire synergique la
causalit primitive de l'agent avec les autres formes de causalit :
alors, et alors seulement, sera reconnu le fait primitif de ce qu'il
faudra appeler non seulement pouvoir-faire, mais, au sens fort du
mot, initiative.
Dans sa phase disjonctive, notre dialectique croise inluctable-
ment l'argument kantien de la Troisime antinomie cosmologique
de la Raison pure ' . Je ne propose ici aucune interprtation
nouvelle de l'antinomie kantienne de la causalit libre et de la
causalit selon les lois de la nature. Mon ambition est de porter au
jour, la lumire de la dialectique kantienne, quelques-uns des
points forts de notre analyse de l'ascription, voire d'en susciter de
nouveaux.
Insistons d'abord sur le caractre ncessairement dialectique de
la notion de puissance d'agir, autrement dit sur la formulation
ncessairement antithtique de la position mme de la question. Je
rappelle l'nonc kantien de la thse de la causalit libre : La
causalit selon les lois de la nature n'est pas la seule dont puissent
tre drivs tous les phnomnes du monde. Il est encore ncessaire
d'admettre une causalit libre pour l'explication de ces phnomnes
(III. 308) [A 444, B 472]
2
. Or notre discussion de la thorie
analytique de l'action nous a constamment confronts une
formulation antithtique semblable celle de Kant. On n'a pas
oubli l'opposition entre l'vnement qui arrive et l'vnement
qu'on fait arriver, ou l'opposition entre cause et motif, dans
1. Une certaine reconnaissance du caractre antagoniste de la causalit se laisse
dj discerner dans l'analyse d'Aristote par laquelle nous avons commenc cette
tude S'il y a des choses qui dpendent de nous, il en est d'autres qui relvent de
causes traditionnellement places sous le titre de la nature, de la ncessit et de la
fortune {th. Sic. III, 5. 1112a 31-32). Apres avoir affirm que l'homme est principe
et gnrateur (pre) de ses actions comme il l'est de ses enfants. Aristote ajoute :
Mais, s'il est manifeste que l'homme est bien l'auteur de ses propres actions, et si
nous ne pouvons pas ramener nos actions d'autres principes que ceux qui sont en
nous, alors les actions dont les principes sont en nous dpendent elles-mmes de
nous et sont volontaires (trad. Tricot, III, 7, 1113 b 18-19). Ainsi, le de nous
est-il dialectiquement oppos au par d'autres causes que nous . l'intrieur
mme du champ d'application de la notion de principe.
2. E. Kant. Critique de la Raison pure, trad. fr. d'A. Tremesaygues et B. Pacaud,
Paris. PUF, 1963. p. 348. Se reporter galement l'dition F. Alqui des uvres
philosophiques de Kant, Paris. Gallimard, coll. Bibliothque de la Pliade , 1.1,
1980. pour la Critique de la Raison pure, qui comporte en marge la pagination cor-
respondant celle de l'dition de l'Acadmie de Berlin. Ici, t. 1, p. 1102.
124
125
SOI-MME COMME UN AUTRE
DE L ACTION L AGENT
la phase dichotomique de la thorie de l'action. On pourrait objecter
que, dans une phase ultrieure, cet aspect dichotomique a t
surmont. Il n'en a rien t. On a vu resurgir ultrieurement
l'antithse sous d'autres formes plus subtiles, que ce soit chez E.
Anscombe, avec l'opposition entre connaissance par observation et
connaissance sans observation, ou chez D. Davidson lui-mme avec
la distinction entre event agency et agent agencyK Mais c'est dans la
polarit entre ascrire et dcrire que culmine la formulation
antithtique du problme, qui fait dire, avec Kant, que la causalit
selon les lois de la nature n'est pas la seule... . Entrons maintenant
dans l'argument proprement dit de la Thse dans l'antinomie
kantienne de la libert et du dterminisme. Ce qui se donne ici
penser, c'est ce que Kant dnomme spontanit absolue des causes
, qu'il dfinit par la capacit de commencer de soi-mme [von
selbst] une srie de phnomnes qui se droulera selon des lois de la
nature (III, 310)
2
; dans la Remarque qui suit la Preuve ,
Kant note qu'une telle spontanit absolue de l'action est le
fondement propre de l'imputabilit de cette action (III, 310 [A
448, B 476])
3
. Nous avions donc bien raison de chercher sous
l'imputation, au sens moral et juridique du terme, la couche
primitive d'un pouvoir-faire. Qu'est-ce qui, dans la thorie
analytique de l'action, correspond la notion kantienne de
spontanit absolue ? C'est la notion devenue classique, la suite
d'A. Danto, d' actions de base . Je rappelle la dfinition que Danto
en donne : ce sont des actions qui ne requirent aucune autre action
intermdiaire qu'il faudrait avoir faites pour (in order to) pouvoir
faire ceci ou cela. En liminant ainsi, dans la dfinition de l'action
de base, la clause de sorte que , on met nu une sorte de causalit
qui se dfinit par elle-mme. Sont des actions de base celles de nos
actions qui relvent du rpertoire de ce que chacun sait comment
faire, sans recourir une action mdiate d'ordre instrumental ou
stratgique qu'il aurait fallu apprendre au pralable. En ce sens, le
concept d'action de base dsigne un fait primitif. On comprend
pourquoi il en est ainsi : le concept primitif d'action de base tient
dans l'ordre pratique la place qu'occupe l'vidence dans l'ordre
cogni-tif: Nous savons tous de faon directe et intuitive, crit
1. Cf. ci-dessus, p. 100 n. 2.
2. Tremesaygues-Pacaud, p. 350 ; Alqui, t. I, p. 1104.
3. Ibid.
A. Danto, qu'il y a des actions de base et quelles actions sont des
actions de base .
Le lien entre cette dernire assertion et l'argument antithtique de
type kantien reste masqu aussi longtemps qu'on ne le replace pas
dans le champ conflictuel de la causalit. C'est en effet titre de
commencement d'une srie causale que la notion d'action de base
revt son caractre problmatique et du mme coup chappe
l'accusation d'argument paresseux. Sous sa forme ngative, en effet,
l'ide de commencement implique un arrt dans le mouvement de la
pense remontant plus haut en direction d'une cause antrieure. Or.
c'est cet arrt que Y Antithse kantienne dnonce comme illgitime
affranchissement des lois ; c'est en ce point prcis que prend
naissance le ncessaire conflit des ides transcen-dantales . La
thorie de l'action ne saurait ignorer ce caractre antithtique de la
notion de commencement qui risque de rester masqu dans une
approche encore nave du concept d'action de base. A vrai dire, c'est
parce que cette notion laisse non dveloppe la question de
l'attribution un agent que son caractre antithtique reste
lui-mme inaperu. En revanche, l'antinomie passe au premier plan
lorsqu'on confronte les rponses la question qui ?aux rponses la
question pourquoi ?. Ainsi avons-nous not avec surprise que, si la
recherche des motifs d'une action est interminable, celle de son
auteur est terminable : les rponses la question qui ?, qu'elles
contiennent un nom propre, un pronom, une description dfinie,
mettent fin l'enqute. Ce n'est pas que l'investigation soit
interrompue arbitrairement, mais les rponses qui terminent
l'enqute sont tenues pour suffisantes par celui qui les donne et
acceptables comme telles par celui qui les reoit. Qui a fait cela?
demande-t-on. Un tel, rpond-on. L'agent s'avre ainsi tre une
trange cause, puisque sa mention met fin la recherche de la
cause, laquelle se poursuit sur l'autre ligne, celle de la motivation.
De cette faon, l'antithtique dont parle Kant pntre dans la thorie
de l'action au point d'articulation de la puissance d'agir et des
raisons d'agir.
Mais nous n'avons pas encore atteint l'essentiel de l'argument
kantien. L'ide de commencement absolu n'est pas seulement jus-
tifie par un argument ngatif (il n'est pas ncessaire de remonter
dans la chane causale) ; elle l'est plus encore par l'argument positif
qui constitue le nerf mme de la preuve. Sans un commencement
dans la srie, argumente Kant, la srie des causes ne serait
1. A. Danto, Basic actions, American Philosophical Quarterly, n 2, 1965, p.
141-143 [trad. de l'auteur).
126 127
SOI-MMECOMMEUNAUTRE DE L'ACTION L'AGENT
pas complte ; il appartient donc l'ide de commencement que celui-ci
assure l'intgralit de la srie du ct des causes drivant les unes des
autres (III, 308 [A 446, B 474]) ' ; ce sceau de compltude appos sur
l'ide de srie causale est essentiel la formulation de l'antinomie ; c'est
l'ide mme d'intgralit d'une srie causale que s'oppose l'ouverture
illimite du processus causal selon l'antithse. Mais l'argument kantien
n'est pas encore complet. Dans la remarque qui fait suite la
Preuve de la Thse, Kant distingue deux sortes de commencements,
l'un qui serait le commencement du monde, l'autre qui est un
commencement au milieu du cours du monde ; ce dernier est celui de
la libert. Or, concde Kant, il y a l la source d'un malentendu : n'a-t-on
pas appel plus haut absolue, c'est--dire non relative, la spontanit ?
Comment peut-on parler maintenant d'un commencement
relativement premier (III 312 [A 450, B 478])
2
? Rponse:
commencement absolu eu gard une srie particulire d'vnements, la
libert n'est qu'un commencement relatif eu gard au cours entier du
monde. Kant prcise : Nous ne parlons pas ici d'un commencement
absolument premier quant au temps, mais quant la causalit (ibid.).
Suit l'exemple de l'homme qui se lve de son sige tout fait librement
et sans subir l'influence ncessairement dterminante des causes natu-
relles (ibid.)
3
. Et Kant de rpter : Ce n'est donc pas au point de vue
du temps qu'il doit tre un commencement absolument premier d'une
srie de phnomnes, mais par rapport la causalit (III, 313 [A 451, B
477]). Cette distinction entre commencement du monde et
commencement dans le monde est essentielle la notion de
commencement pratique prise du point de vue de sa fonction
d'intgration. Le commencement pratique in mdias res n'exerce sa
fonction de compltude que sur des sries dtermines de causes qu'il
contribue distinguer d'autres sries inaugures par d'autres
commencements.
Cette fonction d'intgration du commencement par rapport une
srie dtermine de causes trouve dans nos analyses antrieures une
confirmation intressante, en mme temps que l'antinomie kantienne en
rvle le caractre antithtique implicite.
La thorie de l'action rencontre le problme du rapport entre
commencement et srie complte dans des termes qui lui sont propres.
Elle le fait d'abord dans le cadre provisoire de la thorie
1. Tremesaygues-Pacaud, p. 348 ; Alqui, 1.1, p. 1102.
2. Tremesaygues-Pacaud, p. 350 ; Alqui, 1.1, p. 1106.
3. Tremesaygues-Pacaud, p. 352 ; Alqui, 1.1, p. 1108.
des descriptions. Le problme initial, comme on l'a montr plus haut, est
d'identifier et de dnommer les actions appartenant une chane
pratique. La question est alors de savoir quelle est la vraie
description dans ce cas complexe. On se rappelle l'exemple d'E.
Anscombe : des hommes, en mouvant leurs bras, actionnent une pompe,
qui fait monter l'tage suprieur une eau pralablement empoisonne ;
ce faisant ils font mourir des comploteurs et contribuent au succs d'un
mouvement rvolutionnaire. Que font au juste ces hommes? Si les
multiples rponses donnes sont galement recevables, c'est parce
que, selon le mot d'Anscombe, le premier geste - qui est en fait une
action de base selon les critres de Danto - avale (swallows) la chane
des vnements qui en rsultent jusqu' la dernire srie, laquelle
l'histoire s'arrte. Pour la logique du raisonnement pratique, la srie,
pour parler comme Kant, est unifie par un lien d'implication du type
moyen-fin ; mais, du point de vue causal, celui des vnements et non
plus des intentions, l'unification de la srie est assure par la capacit
d'intgration et de sommation exerce par le commencement lui-mme
de la srie considre, dont la vise intentionnelle traverse la srie
entire
1
.
Ces hsitations de la description, qui ne constituent pas vrai dire
une aporie, conduisent au seuil d'un vritable embarras, lorsqu'on passe
de la description du quoi ? l'ascription au qui ?. Le problme prend
alors la forme suivante : jusqu 'o s'tend l'efficace du commencement
et, par consquent, la responsabilit de l'agent, eu gard au caractre
illimit de la srie des consquences physiques ? Ce problme est, en un
sens, inverse de celui des actions de base : on se demandait alors s'il
fallait s'arrter en amont de la srie ascendante des causes ; on se
demande maintenant o il faut s'arrter en aval de la srie descendante
des effets ; or, si la causalit de l'agent constituait une sorte de butoir
pour le mouvement de remonte dans la srie des causes, la diffusion de
l'efficace du commencement parat sans bornes du ct des effets. Or ce
problme, qu'on peut appeler celui de la porte du commencement, a un
rapport troit avec la notion kantienne d'un commencement
relativement premier dans le cours entier du monde . Ds lors que le
commencement de l'action ne concide pas avec celui du monde, il prend
place en effet dans une constellation de commencements qui ont chacun
une porte qu'il s'agit
1. Nous reviendrons sur cette question de l'unit intgrale d'une srie, lorsque
nous parlerons ultrieurement de l'unit narrative d'une vie et de l'identit narra-
tive d'un personnage.
128 129
SOI-MMECOMMEUN AUTRE DE L'ACTION L'AGENT
prcisment d'apprcier comparativement. Pour chacun de ces
commencements, il est lgitime de s'interroger sur ce qu'on pourrait
appeler les confins du rgne du commencement. Cette question ouvre un
problme trs rel que connaissent bien les juristes, pnalistes ou autres,
mais aussi les historiens. Un agent n'est pas dans les consquences
lointaines comme il l'est en quelque sorte dans son geste immdiat. Le
problme est alors de dlimiter la sphre d'vnements dont on peut le
rendre responsable. Or ce n'est pas ais. Cela pour plusieurs raisons.
D'abord, ne suivre qu'une seule srie, les effets d'une action se
dtachent en quelque sorte de l'agent, comme le discours le fait de la
parole vive par la mdiation de l'criture. Ce sont les lois de la nature qui
prennent en charge la suite de nos initiatives. C'est ainsi que l'action a
des effets qu'on peut dire non voulus, voire pervers. Seulement, la
sparation de ce qui revient l'agent et de ce qui revient aux
enchanements de causalit externe se rvle tre une opration fort
complexe ; il faudrait pouvoir mettre les segments intentionnels
susceptibles d'tre formaliss en syllogismes pratiques part des
segments qu'on peut dire systmiques, dans la mesure o ils expriment la
structure de systmes physiques dynamiques ; mais, comme on le dira
plus loin, la continuation, qui prolonge l'nergie du commencement,
exprime l'enchevtrement des deux modes de liaison ; sans cet
enchevtrement, on ne pourrait pas dire qu'agir, c'est produire des
changements dans le monde.
Ajoutons qu'il est une autre sorte d'enchevtrement qui rend difficile
d'attribuer un agent particulier une srie dtermine d'vnements ;
c'est celui de l'action de chacun avec l'action de chaque autre. Nous
avons insist ailleurs, la suite de W. Schapp, sur l'ide, propre au
champ narratif, d'tre enchevtr dans des histoires ' ; l'action de
chacun (et son histoire) est enchevtre non seulement dans le cours
physique des choses, mais dans le cours social de l'activit humaine.
Comment, en particulier, distinguer dans une action de groupe ce qui
revient chacun des acteurs sociaux ? Cette difficult, comme la
prcdente, ne concerne pas moins l'historien que le juge, ds lors qu'il
s'agit de dsigner distributivement des auteurs en leur assignant des
sphres distinctes d'action ; ici, attribuer, c'est distribuer. Il ne faut pas
craindre de dire que la dtermination du point extrme o s'arrte la
responsabilit d'un agent est affaire de dcision plutt que de
constatation ; c'est ici que reprend vigueur la thse de H.L.A. Hart
2
selon laquelle l'attribution d'une action un agent
1. W. Schapp, In Geschichten verstrickt, Wiesbaden, B. Heymann, 1976.
2. H.L.A. Hart, The Ascription of Responsability and Rights , art. cit.
ressemble plus l'arrt - c'est le cas de le dire - par lequel un juge attribue
chacune des parties en comptition ce qui lui revient ; l'ascription
tend nouveau se confondre avec l'imputation, dans une situation
d'affrontement entre revendications rivales ; toutefois, le seul fait que
l'historien peut avoir lui aussi rpartir des responsabilits entre les
acteurs d'une action complexe donne penser que cette dlimitation de
sphres respectives de responsabilit ne revt pas ncessairement un
aspect d'incrimination et de condamnation. Raymond Aron, la suite
de Max Weber, n'avait pas tort de distinguer responsabilit historique et
responsabilit morale '. Ce que l'une et l'autre ont en commun, c'est pr-
cisment d'illustrer la notion kantienne d'un commencement
relativement premier ; celle-ci implique en effet une multiplicit d'agents
et de commencements d'actions qui ne se laissent identifier que par les
sphres distinctes d'actions qui peuvent tre assignes chacun. Or la
structure conflictuelle de cette assignation ne saurait tre limine ; la
dlimitation de la porte d'une dcision responsable contribue l'effet
de clture sans lequel on ne saurait parler de srie intgrale ; mais cet
effet de clture, essentiel la thse de la causalit libre, contredit
l'ouverture illimite de la srie des causes exige par VAntithse dans
l'antinomie kantienne.
Tout cela tant dit, peut-on en rester au stade antinomique dans la
comprhension de ce qui est signifi par puissance d'agir ? Kant
lui-mme ne le fait pas. Aprs avoir dit et rpt que la Thse et
VAntithse du commencement, comme la Thse et VAntithse des trois
autres antinomies cosmologiques, doivent tre renvoyes dos dos
par le tribunal de la raison (III, 345 [A 501, B 529])
2
, Kant rserve
finalement un sort diffrent aux ides transcendantales qu'il appelle
mathmatiques et qui ont rapport l'extension finie ou infinie de la
matire (premire et deuxime antinomies cosmologiques) : pour
celles-ci, la solution sceptique reste sans appel. Il n'en est pas de mme
des ides transcendantales dites dynamiques concernant le
commencement relativement premier, celui des actions humaines, et le
commencement absolu du monde dans son ensemble ; la solution des
deux premires antinomies tait une solution sceptique, parce que
dans la liaison mathmatique des sries de phnomnes, il est impos-
sible d'introduire d'autres conditions qu'une condition sensible ;
c'est--dire une condition qui soit elle-mme une partie de la
1. Temps et Rcit, t. I, op. cit.. p. 265. n. 1.
2 Tremesaygues-Pacaud, p. 378 ; Alqui, t. I, p. 1145.
130 131
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
DE L'ACTION L'AGENT
srie (III, 360 [A 530, B 558])'. En revanche, la solution de la
troisime et de la quatrime antinomie peut consister garder cte
cte la Thse et Y Antithse ; en effet, la srie dynamique des
conditions sensibles permet encore une condition htrogne qui
n'est pas une partie de la srie, mais qui, en tant que purement
intelligible, rside en dehors de la srie, ce qui donne satisfaction
la raison et place l'inconditionn la tte des phnomnes, sans
troubler la srie de ces phnomnes toujours conditionns et sans
pour cela la briser contrairement au principe de l'entendement (III,
362 [A 531, B 559])
2
. Il en rsulte que la Thse et Y Antithse
peuvent tre tenues pour vraies toutes les deux, condition de les
maintenir sur deux plans diffrents. On connat la suite : la libert
comme ide transcendantale pure, sans attaches phnomnales,
constitue le sens ultime de la facult de commencer de soi-mme
une srie causale. Sur cette libert transcendantale se fonde le
concept pratique de libert, c'est--dire l'indpendance de la volont
par rapport la contrainte des penchants de la sensibilit (III. 362 [A
532. B 560])
3
. Mais qu'est-ce qu'une libert transcendantale ? C'est
une libert intelligible, si l'on appelle intelligible ce qui dans un
objet des sens n'est pas lui-mme phnomne (III. 366 [A 358, B
566])\ Et la suite: Si donc ce qui doit tre considr comme
phnomne dans le monde sensible a aussi en lui-mme un pouvoir,
qui n'est pas un objet d'intuition sensible, mais par lequel,
cependant, il peut tre une cause des phnomnes, on peut alors
considrer la causalit de cet tre sous deux points de vue, comme
intelligible quant son action, ou comme causalit d'une chose en
soi. et comme sensible quant aux effets de cette action ou comme
causalit d'un phnomne dans le monde sensible .
Je voudrais suggrer ici une autre issue l'antinomie, issue vers
laquelle Kant lui-mme s'oriente en un sens lorsqu'il dclare :
Rien n'empche d'attribuer cet objet transcendantal, outre la
proprit qu'il a de nous apparatre, une causalit encore qui n'est
pas phnomne bien que son effet se rencontre cependant dans le
phnomne
6
. Or quel est cet effet qui se rencontre dans le ph-
nomne ? Kant l'appelle caractre, en distinguant caractre empi-
rique et caractre intelligible. Ne pourrait-on pas dire que. en un
1. Tremesaygues-Pacaud, p. 393 , Alqui, t. I. p. 1106.
1 I bid
3. Tremesaygues-Pacaud, p. 394-408 : Alqui. t. 1, p. 1167-1186.
4. Tremesaygues-Pacaud, p. 397 ; Alqui. t. 1. p. 1171.
5. Tremesaygues-Pacaud. p. 397 ; Alqui, t. 1, p. 1171-1172.
6. Tremesaygues-Pacaud. p. 397 : Alqui, t. I, p. 1172.
sens non phnomniste du terme phnomne, c'est--dire au sens de
ce qui se montre, le phnomne de l'agir exige que soient conjointes
la Thse et Y Antithse dans un phnomne - au sens que je viens de
dire - spcifique du champ pratique, qu'on peut appeler initiative ' ?
Penser l'initiative, telle est la tche qui se propose au terme de la
prsente tude. L'initiative, dirons-nous, est une intervention de
l'agent de l'action dans le cours du monde, intervention qui cause
effectivement des changements dans le monde. Que nous ne
puissions nous reprsenter cette prise de l'agent humain sur les
choses, au milieu du cours du monde, comme le dit lui-mme Kant,
que comme une conjonction entre plusieurs sortes de causalit, cela
doit tre reconnu franchement comme une contrainte lie la
structure de l'action en tant qu'initiative. A cet gard, Aristote a
fray la voie, avec sa notion de sunaition, qui fait de l'agent une
cause partielle et concourante dans la formation des dispositions et
du caractre. Mais on se rappelle la prudence avec laquelle Aristote
a introduit cette notion mixte, qu'il nuance d'un en quelque sorte
(ps). C'est en effet en quelque sorte que se composent les
causalits. Nous avons nous-mmes rencontr plusieurs reprises
l'exigence de procder une telle union ; elle rsulte titre ultime de
la ncessit mme de conjoindre le qui ? au quoi .''et au pourquoi
.
?
de l'action, ncessit issue elle-mme de la structure
d'intersignification du rseau conceptuel de l'action. En accord avec
cette exigence, il apparat ncessaire de ne pas se borner opposer le
caractre terminable de l'enqute sur l'agent et le caractre
interminable de l'enqute sur les motifs. La puissance d'agir consiste
prcisment dans la liaison entre l'une et l'autre enqute, o se
reflte l'exigence de lier le qui ? au pourquoi ? travers le quoi '.' de
l'action. Mais le cours de motivation ne fait pas sortir de ce qu'on
peut appeler avec prcaution le plan
1. Comparer avec l'claircissement de l'ide cosmologique d'une libert en
union avec la ncessit universelle de la nature (III, 368 [A 543, B 570] sq. ; Tre-
mesaygues-Pacaud. p. 399-408 ; Alqui. t. 1. p. 1174-1186). Kant parle en ce sens
de l' action primitive, par rapport aux phnomnes d'une cause qui, ce titre,
n'est donc pas un phnomne mais qui est intelligible quant ce pouvoir, bien
que. du reste, elle doive tre comprise comme un anneau de la chane de la nature
dans le monde sensible (III, 369 (A 544. B 572] : Tremesaygues-Pacaud, p. 480 ;
Alqui. t. I, p. 1175-1176). Mais, pour Kant le critre exclusif de la ralit de la
libert intelligible, c'est l'aptitude de l'action se soumettre des rgles, obir
ou non au devoir. C'est cette solution morale, prmature mon sens, que je
veux rsister ici, en cherchant dans le phnomne de la puissance d'agir les raisons
d'un dpassement de l'antinomie.
132 133
SOI-MMECOMMEUN AUTRE DE L'ACTION L'AGENT
des faits mentaux . C'est sur le cours de la nature extrieure
que la puissance d'agir exerce sa prise.
La reprsentation la plus rapproche d'une telle conjonction me
parat tre celle propose par H. von Wright, dans Explana-tion and
Understanding ', sous le titre de modle quasi causal. J'en ai rendu
compte ailleurs dans le cadre d'une investigation consacre
l'explication en histoire
2
. Mais, en fait, il s'agissait bien, par-del
l'pistmologie de la connaissance historique, de rendre compte du
phnomne gnral de l'intervention. Le modle propos est un
modle mixte, en ce sens qu'il conjoint des segments tlologiques,
justiciables du raisonnement pratique, et des segments systmiques,
justiciables de l'explication causale. Ce qui importe ici et qui fait
difficult, ce sont prcisment les points de suture entre les uns et
les autres. En effet, chaque rsultat d'un syllogisme pratique est une
action effective qui introduit un fait nouveau dans l'ordre du monde,
lequel fait dclenche son tour une chane causale ; parmi les effets
de celle-ci, de nouveaux faits surgissent qui sont assums titre de
circonstances par le mme agent ou d'autres agents. Or qu'est-ce qui
rend fondamentalement possible cet enchanement entre fins et
causes ? Essentiellement la capacit qu'a l'agent de faire concider
une des choses qu'il sait faire (qu'il sait pouvoir faire) avec l'tat
initial d'un systme dont il dtermine du mme coup les conditions
de clture . Selon l'expression mme de von Wright, cette
conjonction n'advient que si nous sommes assurs (we feel
confident), sur la base de l'exprience passe, de pouvoir ainsi
mettre en mouvement un systme dynamique. Avec l'ide de
mettre un systme en mouvement . les notions d'action et de
causalit se rejoignent, dclare von Wright. Mais se
recouvrent-elles ?
Il est remarquable que, dans une telle analyse, que j'abrge ici
outrageusement, les deux composantes - systmique et
tlo-logique - restent distinctes quoique enchevtres. Cette
impuissance surmonter la discontinuit - au plan pistmologique
-
1. Londres. Routledge and Kegan Paul. 1971.
2. Temps et Rcit, t. I, op. cit., p. 187-202. Je laisse ici de ct l'interprtation
narrative que je propose de l'enchanement des causes et des fins dans le modle
dit quasi causal.
3. Je reprends ici les termes mmes de mon expos dans Temps et Rcit I :
L'action ralise un autre type remarquable de clture, en ceci que c'est en faisant
quelque chose qu'un agent apprend " isoler " un systme clos de son environne-
ment, et dcouvre les possibilits de dveloppement inhrentes ce systme. Cela,
l'agent l'apprend en mettant en mouvement le systme partir d'un tat initial
qu'il " isole ". Cette mise en mouvement constitue l'intervention, l'intersection
d'un des pouvoirs de l'agent et des ressources du systme (p. 192).
entre les composantes disparates de l'intervention n'est-elle pas
l'indice que ce serait dans un type de discours diffrent de celui que
nous tenons ici que le je peux pourrait tre reconnu comme
Yorigine mme de la liaison entre les deux ordres de causalit ? Ce
qui ferait de ce discours du je peux un discours autre, c'est, titre
ultime, son renvoi une ontologie du corps propre, c'est--dire
d'wn corps qui est aussi mon corps et qui, par sa double allgeance
l'ordre des corps physiques et celui des personnes, se tient au point
d'articulation d'un pouvoir d'agir qui est le ntre et d'un cours des
choses qui relve de l'ordre du monde. Ce n'est que dans cette
phnomnologie du je peux et dans l'ontologie adjacente au
corps propre que le statut de fait primitif accord la puissance
d'agir serait dfinitivement tabli.
Au terme de cette investigation consacre au rapport entre l'ac-
tion et son agent, il importe de dessiner les voies ouvertes par les
apories successives auxquelles donne lieu le phnomne de
l'as-cription. Aucune complaisance pour l'aporie en tant qu'aporie
ne doit en effet transformer la lucidit rflexive en paralysie
consentie. Le phnomne de l'ascription ne constitue, tout compte
fait, qu'une dtermination partielle et encore abstraite de ce qui est
signifi par l'ipsit du soi. De l'aportique de l'ascription peut et
doit rsulter une impulsion franchir les limites imposes par la
thorie du discours expose ci-dessus en direction de dtermina-
tions plus riches et plus concrtes de l'ipsit du soi. Chacune des
apories de l'ascription pointe vers un dpassement spcifique du
point de vue strictement linguistique.
La premire aporie fait encore appel une transition interne au
point de vue linguistique, savoir de la smantique la prag-
matique. Ce qui distingue en effet l'ascription de la simple attri-
bution d'un prdicat un sujet logique, c'est d'abord le pouvoir de
l'agent de se dsigner lui-mme en dsignant un autre. La
considration strawsonienne portant sur l'identit de sens que
conservent les prdicats psychiques dans l'ascription soi-mme et
dans l'ascription un autre que soi orientait dj vers un tel
dplacement en direction d'oprations de langage o prdomine la
double dsignation de soi et de l'autre dans une situation
d'in-terlocution. En ce sens, la premire aporie n'tait pas vaine.
La seconde aporie non plus ne s'est pas ferme sur une impasse.
Les difficults qu'a rencontres notre effort pour distinguer l'as-
cription de l'imputation conduisent penser que l'cart entre l'une et
l'autre doit tre combl par une investigation de modali-
134
135
SOI-MME COMME UN AUTRE
ts pratiques, qui, par leur complexit et leur organisation, excdent
les limites de la thorie de l'action elle-mme, du moins au sens limit
qui a t le ntre jusqu' prsent. Ce sera la tche d'une enqute sur la
praxis et les pratiques de discerner les points d'implantation d'une
valuation proprement thique de l'agir humain, au sens tlologique et
au sens dontologique, autrement dit selon le bon et selon l'obligatoire.
Alors, mais alors seulement, il pourra tre rendu compte de
l'articulation entre ascription et imputation, au sens moral et
juridique.
La troisime aporie, suscite par la notion de puissance d'agir, donc
par l'efficacit causale assigne l'agent de l'action, a pu paratre la plus
intraitable. Elle l'est en effet. Le passage par la troisime antinomie
kantienne a certainement accentu l'apparence d'une difficult sans
issue. Nous n'avons pourtant pas manqu d'affirmer que l'antinomie
relevait d'une stratgie antithtique destine combattre l'accusation
d'argument paresseux oppose, comme il se doit, toute allgation de
fait primitif. Car c'est bien d'un fait primitif qu'il s'agit, savoir
l'assurance que l'agent a de pouvoir faire, c'est--dire de pouvoir
produire des changements dans le monde. Le passage du stade
disjonctif au stade conjonctif de la dialectique n'avait pas d'autre but
que de porter un niveau rflexif et critique ce qui est dj pr-compris
dans cette assurance de pouvoir-faire. Dire assurance, c'est dire deux
choses. C'est d'abord mettre en lumire, au plan pistmolo-gique, un
phnomne que nous avons plusieurs fois ctoy, celui de l'attestation.
Nous sommes assurs, d'une certitude qui n'est pas une croyance, une
doxa infrieure au savoir, que nous pouvons faire les gestes familiers que
Danto enracine dans les actions de base. Mais l'aveu du fait primitif
attest dans la certitude de pouvoir faire n'a pas seulement une face
pistmologique, il a aussi une face ontologique. Le fait primitif de
pouvoir-faire fait partie d'une constellation de faits primitifs qui relvent
de l'ontologie du soi que nous esquisserons dans la dixime tude. Ce que
nous venons de dire de la phnomnologie du je peux et de
l'ontologie adjacente au corps propre pointe dj dans la direction de
cette ontologie du soi. Quant dire par quels liens concrets cette
phnomnologie du je peux et cette ontologie du corps propre
ressortissent une ontologie du soi, en tant que sujet agissant et
souffrant, ce n'est qu'au terme d'un long parcours au travers et au-del des
philosophies de la subjectivit que nous pourrons l'tablir. En ce sens, la
troisime aporie de l'ascription ne sera effectivement dpasse qu'au
terme de notre entreprise.
CINQUIME TUDE
L'identit personnelle et
l'identit narrative
Avec la discussion des rapports entre agent et action, une premire
srie d'tudes, places sous l'gide de la conception analytique du
langage, a atteint son terme. Dans les deux premires tudes, on s'est
born aux ressources que la smantique et la pragmatique, considres
successivement, offraient l'analyse de l'action et des rapports
complexes entre action et agent. Au cours de cette analyse, il est apparu
que, en dpit de sa dpendance de principe l'gard de la thorie du
langage, la thorie de l'action constituait une discipline autonome, en
raison des traits propres de l'agir humain et de l'originalit du lien entre
l'agir et son agent. Pour asseoir son autonomie, cette discipline nous a
paru requrir une alliance nouvelle entre la tradition analytique et la
tradition phnomnologique et hermneutique, ds lors que l'enjeu
majeur en tait moins de savoir ce qui distingue les actions des autres
vnements survenant dans le monde, que ce qui spcifie le soi,
impliqu dans le pouvoir-faire, la jonction de l'agir et de l'agent. Ainsi
affranchi de sa tutelle initiale, la thorie de l'action assumait le rle de
propdeutique la question de l'ipsit. En retour, la question du soi,
reprenant le pas sur celle de l'action, suscite des remaniements
considrables au plan mme de l'agir humain.
La lacune la plus considrable que prsentent nos tudes antrieures
un regard rtrospectif concerne bien videmment la dimension
temporelle tant du soi que de l'action elle-mme. Ni la dfinition de la
personne dans la perspective de la rfrence identifiante, ni celle de
l'agent dans le cadre de la smantique de l'action, cense pourtant
enrichir la premire approche, n'ont pris en compte le fait que la
personne dont on parle, que l'agent dont l'action dpend, ont une
histoire, sont leur propre histoire. L'approche du soi sur le second
versant de la philosophie du langage, celui de renonciation, n'a pas non
plus suscit de rflexion particulire concernant les changements qui
affectent un sujet capable
137
SOI-MME COMME UN AUTRE
de se dsigner lui-mme en signifiant le monde. Or ce n'est pas
seulement une dimension importante parmi d'autres qui a t ainsi
omise, mais une problmatique entire, savoir celle de Y identit
personnelle qui ne peut prcisment s'articuler que dans la
dimension temporelle de l'existence humaine. C'est pour combler
cette lacune majeure que je me propose de remettre ici en chantier la
thorie narrative, non plus dans la perspective de ses rapports avec
la constitution du temps humain comme il a t fait dans Temps et
Rcit, mais de sa contribution la constitution du soi. Les dbats
contemporains, trs vifs dans le champ de la philosophie
anglo-amricaine, sur la question de l'identit personnelle ont paru
offrir une occasion excellente pour aborder de front la distinction
entre mmet et ipsit, toujours prsuppose dans les tudes
prcdentes, mais jamais traite thmatiquement. On espre
montrer que c'est dans le cadre de la thorie narrative que la
dialectique concrte de l'ipsit et de la mmet - et non pas
seulement la distinction nominale entre les deux termes invoqus
jusqu' prsent - atteint son plein panouissement '.
Une fois la notion d'identit narrative confronte - victorieuse-
ment, mon avis - aux perplexits et aux paradoxes de l'identit
personnelle, il sera possible de dployer, dans un style moins
polmique et plus constructif, la thse annonce ds l'introduc-
1. La notion d'identit narrative, introduite dans Temps et Rcit III, rpondait
une autre problmatique : au terme d'un long voyage travers le rcit historique et le
rcit de fiction, je me suis demand s'il existait une structure de l'exprience
capable d'intgrer les deux grandes classes de rcits. J'ai form alors l'hypothse
selon laquelle l'identit narrative, soit d'une personne, soit d'une communaut,
serait le lieu recherch de ce chiasme entre histoire et fiction. Selon la pr-
comprhension intuitive que nous avons de cet tat de choses, ne tenons-nous pas
les vies humaines pour plus lisibles lorsqu'elles sont interprtes en fonction des
histoires que les gens racontent leur sujet ? Et ces histoires de vie ne sont-elles pas
rendues leur tour plus intelligibles lorsque leur sont appliqus des modles
narratifs - des intrigues - emprunts l'histoire proprement dite ou la fiction
(drame ou roman) ? Il semblait donc plausible de tenir pour valable la chane sui-
vante d'assertions : la comprhension de soi est une interprtation ; l'interprtation
de soi, son tour, trouve dans le rcit, parmi d'autres signes et symboles, une
mdiation privilgie ; cette dernire emprunte l'histoire autant qu' la fiction,
faisant de l'histoire d'une vie une histoire fictive, ou, si l'on prfre, une fiction
historique, entrecroisant le style historiographique des biographies au style roma-
nesque des autobiographies imaginaires. Ce qui manquait cette apprhension
intuitive du problme de l'identit narrative, c'est une claire comprhension de ce
qui est en jeu dans la question mme de l'identit applique des personnes ou
des communauts. La question de l'entrecroisement entre histoire et fiction
dtournait en quelque sorte l'attention des difficults considrables attaches la
question de l'identit en tant que telle. C'est ces difficults qu'est consacre la
prsente tude.
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
tion cet ouvrage, selon laquelle la thorie narrative trouve une de
ses justifications majeures dans le rle qu'elle exerce entre le point
de vue descriptif sur l'action, auquel nous nous sommes tenus
jusqu' prsent, et le point de vue prescriptif qui prvaudra dans les
tudes ultrieures. Une triade s'est impose moi : dcrire, raconter,
prescrire - chaque moment de la triade impliquant un rapport
spcifique entre constitution de l'action et constitution du soi. Or la
thorie narrative ne saurait exercer cette mdiation, c'est--dire tre
plus qu'un segment intercal dans la suite discrte de nos tudes, s'il
ne pouvait tre montr, d'une part, que le champ pratique couvert
par la thorie narrative est plus vaste que celui couvert par la
smantique et la pragmatique des phrases d'action, d'autre part, que
les actions organises en rcit prsentent des traits qui ne peuvent
tre labors thmatiquement que dans le cadre d'une thique.
Autrement dit, la thorie narrative ne fait vritablement mdiation
entre la description et la prescription que si l'largissement du
champ pratique et l'anticipation de considrations thiques sont
impliqus dans la structure mme de l'acte de raconter. Qu'il suffise
pour le moment de dire qu'en maints rcits, c'est l'chelle d'une vie
entire que le soi cherche son identit ; entre les actions courtes,
auxquelles se sont bornes nos analyses antrieures, sous la
contrainte de la grammaire des phrases d'action, et la connexion
d'une vie, dont parle Dilthey dans ses essais thoriques sur l'auto-
biographie, s'tagent des degrs de complexit qui portent la thorie
de l'action au niveau requis par la thorie narrative '. C'est de la
mme faon que je dirai par anticipation qu'il n'est pas de rcit
thiquement neutre. La littrature est un vaste laboratoire o sont
essays des estimations, des valuations, des jugements d'appro-
bation et de condamnation par quoi la narrativit sert de
prop-deutique l'thique. C'est ce double regard, rtrospectif en
1. On a souvent reproch la philosophie analytique de l'action la pauvret des
exemples invoqus. Pour ma part, je ne raille pas ce misrabilisme dans l'emploi
des exemples : en mettant entre parenthses les enjeux thiques et politiques, la
philosophie analytique de l'action a pu se concentrer sur la seule constitution
grammaticale, syntaxique et logique des phrases d'action. Or, c'est ce mme
asctisme de l'analyse que nous sommes redevables, jusque dans la critique interne
que nous avons faite de cette thorie de l'action. Nous n'avons pas eu besoin de
restituer l'action ni la complexit des pratiques quotidiennes, ni la dimension
tlologique et dontologique requise par une thorie morale de l'imputation, pour
dessiner les premiers linaments d'une thorie de l'ipsit. Les actions les plus
simples - tires, disons, des actions de base selon Danto - suffisent faire paratre
l'nigme de la mmet, en laquelle se trouvent rsumes in nuce toutes les
difficults d'une thorie dveloppe de l'ipsit.
138 139
SOI-MME COMME UN AUTRE
direction du champ pratique, prospectif en direction du champ
thique, que sera consacre la sixime tude dont je marque ici
l'troite solidarit avec la prsente tude.
1. Le problme de l'identit personnelle
Le problme de l'identit personnelle constitue mes yeux le lieu
privilgi de la confrontation entre les deux usages majeurs du
concept d'identit que j'ai maintes fois voqus sans jamais les
thmatiser vritablement. Je rappelle les termes de la confrontation :
d'un ct l'identit comme mmet (latin : idem ; anglais : sameness
; allemand : Gleichheit), de l'autre l'identit comme ipsit (latin :
ipse ; anglais : seljhood ; allemand : Selbstheit). L'ip-sit, ai-je
maintes fois affirm, n'est pas la mmet. Et c'est parce que cette
distinction majeure est mconnue - la deuxime section le vrifiera -
que les solutions apportes au problme de l'identit personnelle
ignorant la dimension narrative chouent. Si cette diffrence est si
essentielle, pourquoi, demandera-t-on, ne l'avoir pas traite
thmatiquement plus tt, alors que son fantme n'a cess de hanter
les analyses antrieures ? Pour la raison prcise qu'elle n'est leve
au rang problmatique que lorsque passent au premier plan ses
implications temporelles. C'est avec la question de la permanence
dans le temps que la confrontation entre nos deux versions de
l'identit fait pour la premire fois vritablement problme.
1. A premire vue, en effet, la question de la permanence dans le
temps se rattache exclusivement l'identit-/<fem, que d'une
certaine faon elle couronne. C'est bien sous cette unique rubrique
que les thories analytiques que nous examinerons plus loin
abordent la question de l'identit personnelle et les paradoxes qui
s'y rattachent. Rappelons rapidement l'articulation conceptuelle de
la mmet, afin de pointer la place minente qu'y tient la
permanence dans le temps.
La mmet est un concept de relation et une relation de relations.
En tte, vient l'identit numrique: ainsi, de deux occurrences d'une
chose dsigne par un nom invariable dans le langage ordinaire,
disons-nous qu'elles ne forment pas deux choses diffrentes mais
une seule et mme chose. Identit, ici, signifie unicit : le
contraire est pluralit (non pas une mais deux ou plusieurs) ; cette
premire composante de la notion d'identit correspond l'opration
d'identification, entendue au sens de
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
ridentification du mme, qui fait que connatre c'est reconnatre : la
mme chose deux fois, n fois.
Vient en second rang l'identit qualitative, autrement dit la res-
semblance extrme : nous disons de X et de Y qu'ils portent le
mme costume, c'est--dire des vtements tellement semblables
qu'il est indiffrent qu'on les change l'un pour l'autre ; cette
deuxime composante correspond l'opration de substitution sans
perte smantique, salva veritate.
Ces deux composantes de l'identit sont irrductibles l'une
l'autre, comme chez Kant les catgories de quantit et de qualit ;
elles ne sont point pour autant trangres l'une l'autre ; c'est
prcisment dans la mesure o le temps est impliqu dans la suite
des occurrences de la mme chose que la ridentification du mme
peut susciter l'hsitation, le doute, la contestation ; la ressemblance
extrme entre deux ou plusieurs occurrences peut alors tre
invoque titre de critre indirect pour renforcer la prsomption
d'identit numrique : c'est ce qui arrive lorsque l'on parle de
l'identit physique d'une personne ; on n'a pas de peine reconnatre
quelqu'un qui ne fait qu'entrer et sortir, apparatre, disparatre,
rapparatre ; encore le doute n'est-il pas loin, dans la mesure o l'on
compare une perception prsente un souvenir rcent ;
l'identification de son agresseur par une victime, parmi une srie de
suspects qui lui sont prsents, donne au doute une premire
occasion de s'insinuer ; il crot avec la distance dans le temps ; ainsi,
un accus prsent la barre du tribunal peut contester qu'il soit le
mme que celui qui est incrimin ; que fait-on alors ? on compare
l'individu prsent des marques matrielles tenues pour la trace
irrcusable de sa prsence antrieure dans les lieux eux-mmes en
litige ; il arrive que l'on tende la comparaison des tmoignages
oculaires, tenus avec une grande marge d'incertitude pour
quivalents la prsentation passe de l'individu examin ; la
question de savoir si l'homme ici prsent la barre du tribunal et
l'auteur prsum d'un crime ancien sont une seule et mme personne
peut alors rester sans rponse assure : les procs de criminels de
guerre donnent l'occasion de pareilles confrontations, dont on
connat les alas.
C'est la faiblesse de ce critre de similitude, dans le cas d'une
grande distance dans le temps, qui suggre que l'on fasse appel un
autre critre, lequel relve de la troisime composante de la notion
d'identit, savoir la continuit ininterrompue entre le premier et le
dernier stade du dveloppement de ce que nous tenons pour le
mme individu ; ce critre l'emporte dans tous les
140 141
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
cas o la croissance, le vieillissement, oprent comme des facteurs de
dissemblance et, par implication, de diversit numrique ; ainsi
disons-nous d'un chne qu'il est le mme, du gland l'arbre entirement
dvelopp ; de mme d'un animal, de la naissance la mort ; de mme
enfin d'un homme - je ne dis pas d'une personne - en tant que simple
chantillon de l'espce. La dmonstration de cette continuit
fonctionne comme critre annexe ou substitutif de la similitude ; la
dmonstration repose sur la mise en srie ordonne de changements
faibles qui, pris un un, menacent la ressemblance sans la dtruire ;
ainsi faisons-nous avec les portraits de nous-mmes des ges successifs
de la vie ; comme on voit, le temps est ici facteur de dissemblance,
d'cart, de diffrence.
C'est pourquoi la menace qu'il reprsente pour l'identit n'est
entirement conjure que si l'on peut poser, la base de la similitude et
de la continuit ininterrompue du changement, un principe de
permanence dans le temps. Ce sera par exemple la structure invariable
d'un outil dont on aura progressivement chang toutes les pices : c'est
encore le cas, qui nous touche de prs, de la permanence du code
gntique d'un individu biologique ; ce qui demeure ici. c'est
l'organisation d'un systme combinatoire ; l'ide de structure, oppose
celle d'vnement, rpond ce critre d'identit, le plus fort qui
puisse tre administr ; elle confirme le caractre relationnel de
l'identit, qui n'apparaissait pas dans l'antique formulation de la
substance, mais que Kant rtablit en classant la substance parmi les
catgories de la relation, en tant que condition de possibilit de penser
le changement comme arrivant quelque chose qui ne change pas. du
moins dans le moment de l'attribution de l'accident la substance ; la
permanence dans le temps devient ainsi le transcendantal de l'identit
numrique '. Toute la problmatique de l'identit personnelle
1. Le dplacement chez Kant de l'ide de substance du plan ontologique au
plan transcendantal est marqu par la simple correspondance entre la catgorie,
son schme et le principe (ou premier jugement). A la substance, premire catgo-
rie de la relation, correspond le schme qui en dit la constitution temporelle,
savoir : la permanence [Beharrlichkeii] du rel dans le temps, c'est--dire la
reprsentation de ce rel comme un substrat de la dtermination empirique de
temps en gnral, substrat qui demeure donc pendant que tout le reste change
(Critiquedela Raison pure) III. 137 [A 144. B 183]; Tremesaygues-Pacaud. p.
154 ; Alqui, 1.1, p. 889). Au schme de la substance correspond le principe qui en
exprime la constitution relationnelle, savoir ( Premire analogie de l'exp-
rience ) : Tous les phnomnes contiennent quelque chose de permanent [dos
Beharrliche] (substance) considr comme l'objet lui-mme, et quelque chose de
changeant, considr comme une simple dtermination de cet objet (III, 162
[A 182] ; Tremesaygues-Pacaud, p. 177 ; Alqui, t. I, p. 919). Et dans la seconde
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
va tourner autour de cette qute d'un invariant relationnel, lui
donnant la signification forte de permanence dans le temps.
2. Cette analyse conceptuelle de l'identit-mmet tant faite, nous
pouvons revenir la question qui rgit la prsente tude : l'ipsit du soi
implique-t-elle une forme de permanence dans le temps qui ne soit pas
rductible la dtermination d'un substrat, mme au sens relationnel que
Kant a assign la catgorie de substance, bref, une forme de
permanence dans le temps qui ne soit pas simplement le schme de la
catgorie de substance ? Pour reprendre les termes d'une opposition qui
a jalonn nos tudes antrieures : une forme de permanence dans le
temps se laisse-t-elle rattacher la question qui ? en tant qu'irrductible
toute question quoi ? Une forme de permanence dans le temps qui soit
une rponse la question : qui suis-je ?
Que la question soit difficile, la rflexion suivante va tout de suite le
rendre manifeste. Parlant de nous-mmes, nous disposons en fait de
deux modles de permanence dans le temps que je rsume par deux
termes la fois descriptifs et emblmatiques : le caractre et la parole
tenue. En l'un et en l'autre, nous reconnaissons volontiers une
permanence que nous disons tre de nous-mmes. Mon hypothse est
que la polarit de ces deux modles de permanence de la personne rsulte
de ce que la permanence du caractre exprime le recouvrement quasi
complet l'une par l'autre de la problmatique de Vident et de celle de
Vipse, tandis que la fidlit soi dans le maintien de la parole donne
marque l'cart extrme entre la permanence du soi et celle du mme, et
donc atteste pleinement l'irrductibilit des deux problmatiques l'une
l'autre. Je me hte de complter mon hypothse : la polarit que je vais
scruter suggre une intervention de l'identit narrative dans la
constitution conceptuelle de l'identit personnelle, la faon d'une
mdit spcifique entre le ple du caractre, o idem et ipse tendent
concider et le ple du maintien de soi, o l'ipsit s'affranchit de la
mmet. Mais j'anticipe trop !
Que faut-il entendre par caractre ? En quel sens le terme a-t-il la
fois valeur descriptive et valeur emblmatique ? Pourquoi dire qu'il
cumule l'identit du soi et celle du mme ? Qu'est-ce qui trahit, sous
l'identit du mme, l'identit du soi et empche d'assigner purement et
simplement l'identit du caractre celle du mme ?
dition : La substance persiste [beharrt] dans tout le changement des phno-
mnes et sa quantit n'augmente ni ne diminue dans la nature ([B 224] ; Treme-
saygues-Pacaud, p. 177 ; Alqui, t. 1, p. 918-919).
142 143
SOI-MMECOMMEUNAUTRE L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
J'entends ici par caractre l'ensemble des marques distinctives qui
permettent de ridentifier un individu humain comme tant le mme.
Par les traits descriptifs que l'on va dire, il cumule l'identit numrique
et qualitative, la continuit ininterrompue et la permanence dans le
temps. C'est par l qu'il dsigne de faon emblmatique la mmet de
la personne.
Ce n'est pas la premire fois que je rencontre sur mon chemin la
notion de caractre. A l'poque o j'crivais Le Volontaire et
l'Involontaire, je plaais le caractre sous le titre de l' involontaire
absolu, pour l'opposer l'involontaire relatif des motifs dans
l'ordre de la dcision volontaire et celui des pouvoirs dans l'ordre de
la motion volontaire. En tant qu'involontaire absolu, je l'assignais, en
conjonction avec l'inconscient et avec l'tre-en-vie symbolis par la
naissance, la couche de notre existence que nous ne pouvons changer,
mais quoi il nous faut consentir. Et dj je soulignais la nature
immuable du caractre en tant que perspective finie, non choisie, de
notre accs aux valeurs et de l'usage de nos pouvoirs
1
. Je devais revenir
dix ans plus tard, dans L'Homme faillible, ce thme fascinant du carac-
tre, mais dans un contexte quelque peu diffrent. Non plus en fonction
de la polarit du volontaire et de l'involontaire, mais
1. Cette immutabilit du caractre, que je nuancerai tout l'heure, servait la
mme poque de caution une discipline, la caractrologie, dont nous mesurons
mieux aujourd'hui la nature approximative, sinon arbitraire. Ce qui m'intressait
nanmoins dans cette entreprise prilleuse, c'tait la prtention de donner un
quivalent objectif cette couche de notre existence subjective. C'est ce que j'ap-
pellerai aujourd'hui l'inscription du caractre dans la Mmet. La caractrologie,
en effet, entendait traiter le caractre comme un portrait dessin de l'extrieur ; ce
portrait, elle le recomposait par un jeu de corrlations entre un petit nombre d'in-
variants (activit / motivit. primante / secondante), de manire dessiner, par
cette combinatoire de traits distinctifs, une typologie susceptible d'un affinement
relativement pertinent ; quels qu'aient t les simplifications et durcissements de
cette caractrologie, aujourd'hui tombe en dfaveur, elle tmoignait par son
ambition mme de la valeur emblmatique du caractre comme destin. Ce mot
mme de destin, qui rappelle invinciblement le mot fameux d'Heraclite, rappro-
chant caractre (thos) et daimn (Diels / Kranz, Fragmenteder Vorsokratiker,
B 119, trad. fr. de J.-P. Dumont. D. Delattre et J.-L. Poirier. Les Prsocratiques.
Pans, Gallimard, coll. Bibliothque de la Pliade , 1988, p. 173), suffit alerter
notre attention, car il ne relve plus d'une problmatique objectivante, mais exis-
tentielle. Seule une libert a ou est un destin. Cette simple remarque restitue aux
dterminations mises en avant par la caractrologie l'quivocit qui la fait parti-
ciper simultanment deux rgnes, celui de l'objectivit et celui de l'existence. Un
portrait peint du dehors ? Mais aussi une manire d'tre propre. Une combina-
toire de traits permanents ? Mais un style indivisible. Un type ? Mais une singula-
rit insubstituable. Une contrainte ? Mais un destin que je suis, c'est--dire cela
mme quoi je dois consentir.
sous le signe du thme pascalien de la disproportion , de la
non-concidence entre finitude et infinitude. Le caractre
m'ap-paraissait alors comme ma manire d'exister selon une perspective
finie affectant mon ouverture sur le monde des choses, des ides, des
valeurs, des personnes
1
.
D'une certaine faon, c'est encore dans la mme direction que je
poursuis mon investigation. Le caractre m'apparat, aujourd'hui encore,
comme l'autre ple d'une polarit existentielle fondamentale. Mais, au
lieu de concevoir le caractre dans une problmatique de la perspective
et de l'ouverture, comme le ple fini de l'existence, je l'interprte ici en
fonction de sa place dans la problmatique de l'identit. Ce
dplacement d'accent a pour vertu principale de remettre en question
le statut d'immutabilit du caractre, tenu pour acquis dans mes analyses
antrieures. En fait, cette immutabilit s'avre tre d'un genre bien
particulier, comme l'atteste la rinterprtation du caractre en termes de
dis-
1. Cette notion de perspective tait franchement transpose du plan
thor-tique, prcisment de la phnomnologie husserlienne de la perception, au
plan pratique. Elle servait ainsi de rsum tous les aspects de finitude pratique
(rceptivit du dsir, persvration des habitudes), ce qui me permettait d'insister
pour la premire fois sur le caractre de totalit finie du caractre : ainsi parlais-je
du caractre comme ouverture limite de notre champ de motivation considr
dans son ensemble . Cette deuxime version du caractre dans L'Hommefaillible
confirmait en un sens la mmet du caractre, au prix peut-tre d"une insistance
excessive sur son immutabilit, autorise par la lecture et l'approbation de quel-
ques textes tincelants d'Alain. Je suis ainsi all jusqu' dire qu' la diffrence de
la perspective de perception, que je peux changer en me dplaant, il n'y a plus
de mouvement par lequel je changerais l'origine zro de mon champ total de moti-
vation p. 79). Ma naissance, disais-je encore, c'est le dj l de mon caractre
(p. 80). Ainsi le caractre pouvait-il tre dfini sans nuance comme nature
immuable et hrite (ibid.). Mais, en mme temps, l'adhrence de la perspective
au mouvement d'ouverture par quoi je dfinissais l'acte d'exister imposait de pla-
cer le caractre dans le plan de l'existence dont je souligne aujourd'hui la
mien-net : Le caractre, c'est l'ouverture finie de mon existence prise comme
un tout (p. 72). Le caractre, dirai-je aujourd'hui, c'est la mmet dans la
miennet. Dans L'Homme faillible, la raison fondamentale pour laquelle le
caractre devait tre plac du ct de l'existence vcue en dpit de son
immutabilit prsume, c'tait sa relation contraste avec le ple d'infinit que je
voyais reprsent, dans une perspective la fois aristotlicienne et kantienne, par
la notion de bonheur. L'ouverture dont le caractre marque la fermeture, la
partialit constitutive. c"est la vise du bonheur. Cette opposition se justifiait, dans
une anthropologie d'une part attentive la faille de l'existence, ce qui rend
possible la chute dans le mal, d'autre part prompte interprter la
disproportion responsable de la faillibi-lit dans les termes du couple fini-infini.
L'avantage majeur tait de faire porter tout le poids de la fragilit sur le troisime
terme, lieu de la faille existentielle. La prsente tude placera la narrativit dans
une position comparable de mdiation entre deux extrmes.
144 145
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
position acquise. Avec cette notion, se laisse enfin thmatiser pour
elle-mme la dimension temporelle du caractre. Le caractre,
dirais-je aujourd'hui, dsigne l'ensemble des dispositions durables
quoi on reconnat une personne. C'est ce titre que le caractre peut
constituer le point limite o la problmatique de Yipse se rend
indiscernable de celle de Videm et incline ne pas les distinguer
l'une de l'autre. Il importe par consquent de s'interroger sur la
dimension temporelle de la disposition : c'est elle qui remettra plus
loin le caractre sur la voie de la narrativisation de l'identit
personnelle.
Premiiement, la notion de disposition se rattache celle d'ha-
bitude, avec sa double valence d'habitude en train d'tre, comme on
dit, contracte, et d'habitude dj acquise '. Or ces deux traits ont
une signification temporelle vidente : l'habitude donne une histoire
au caractre ; mais c'est une histoire dans laquelle la sdimentation
tend recouvrir et, la limite, abolir l'innovation qui l'a prcde.
Ravaison le premier s'tonnait, dans sa fameuse thse De l'habitude,
de cette force de l'habitude o il voyait le retour de la libert la
nature. C'est cette sdimentation qui confre au caractre la sorte de
permanence dans le temps que j'interprte ici comme recouvrement
de Yipse par Videm. Mais ce recouvrement n'abolit pas la diffrence
des problmatiques : en tant mme que seconde nature, mon
caractre c'est moi, moi-mme, ipse ; mais cet ipse s'annonce
comme idem. Chaque habitude ainsi contracte, acquise et devenue
disposition durable. constitue un trait - un trait de caractre,
prcisment -, c'est--dire un signe distinctif quoi on reconnat une
personne, on la ridentifie comme tant la mme, le caractre n'tant
pas autre chose que l'ensemble de ces signes distinctifs.
Deuximement, se laisse rattacher la notion de disposition
l'ensemble des identifications acquises par lesquelles de l'autre
entre dans la composition du mme. Pour une grande part, en effet,
l'identit d'une personne, d'une communaut, est faite de ces
identifications- des valeurs, des normes, des idaux, des modles,
des hros, dans lesquels la personne, la communaut se
reconnaissent. Le se reconnatre-dans contribue au
se
1. Aristote est le premier avoir rapproch caractre et habitude la faveur de
la quasi-homonymie entre thos (caractre) et ithos (habitude, coutume). Du
terme thos. il passe hexis (disposition acquise), qui est le concept anthropolo-
gique de base sur lequel il difie son thique, dans la mesure o les vertus sont de
telles dispositions acquises, en conformit la rgle droite et sous le contrle du
jugement du phronimos, de l'homme prudent (th. Nie. trad. Tricot, 111, 4, 1112a
\lsq.,VI, 2. 1139 a 23-24; VI, 13, 1144 b 27).
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
reconnatre-... L'identification des figures hroques manifeste en
clair cette altrit assume ; mais celle-ci est dj latente dans
l'identification des valeurs qui fait que l'on met une cause
au-dessus de sa propre vie ; un lment de loyaut, de loyalisme,
s'incorpore ainsi au caractre et le fait virer la fidlit, donc au
maintien de soi. Ici les ples de l'identit se composent. Cela prouve
que l'on ne peut penser jusqu'au bout Videm de la personne sans
Yipse, lors mme que l'un recouvre l'autre. Ainsi s'intgrent aux
traits de caractre les aspects de prfrence valuative qui
dfinissent l'aspect thique du caractre, au sens aristotlicien du
terme '. Cela se fait par un processus parallle la contraction d'une
habitude, savoir par l'intriorisation qui annule l'effet initial
d'altrit, ou du moins le reporte du dehors dans le dedans. La
thorie freudienne du surmoi a affaire avec ce phnomne qui
donne l'intriorisation un aspect de sdimentation. Ainsi se sta-
bilisent les prfrences, apprciations, estimations, de telle faon
que la personne se reconnat ses dispositions qu'on peut dire
valuatives. C'est pourquoi un comportement qui ne correspond pas
ce genre de dispositions fait dire qu'il n'est pas dans le caractre de
l'individu considr, que celui-ci n'est plus lui-mme. voire qu'il est
hors de soi.
Par cette stabilit emprunte aux habitudes et aux identifications
acquises, autrement dit aux dispositions, le caractre assure la fois
l'identit numrique, l'identit qualitative, la continuit
ininterrompue dans le changement et finalement la permanence
dans le temps qui dfinissent la mmet. Je dirai de faon peine
paradoxale que l'identit du caractre exprime une certaine adh-
rence du quoi ? au qui ?. Le caractre, c'est vritablement le quoi
du qui . Ce n'est plus exactement le quoi encore extrieur au
qui , comme c'tait le cas dans la thorie de l'action, o l'on
pouvait distinguer entre ce que quelqu'un fait, et celui qui fait (et
nous avons vu la richesse et les piges de cette distinction qui
conduit tout droit au problme de l'ascription). Il s'agit bien ici de
recouvrement du qui ? par le quoi ?, lequel fait glisser de la question
: qui suis-je ? la question : que suis-je ?.
Mais ce recouvrement de Yipse par Videm n'est pas tel qu'il exige
de renoncer leur distinction. La dialectique de l'innovation et de la
sdimentation, sous-jacente au processus d'identification, est l
pour rappeler que le caractre a une histoire, contracte dirait-on, au
double sens du mot contraction :
1. Sur l'valuation considre comme seuil de l'thique, cf. ci-dessous, septime
tude.
146
147
SOI-MMECOMMEUN AUTRE L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT
NARRATIVE
abrviation et afiection. Il est comprhensible ds lors que le ple
stable du caractre puisse revtir une dimension narrative, comme
on le voit dans les usages du terme caractre qui l'identifient au
personnage d'une histoire raconte; ce que la sdimentation a
contract, le rcit peut le redployer. Et c'est le langage
dispositionnel, pour lequel Gilbert Ryle plaide dans La Notion
d'esprit, qui prpare ce redploiement narratif. Que le caractre
doive tre replac dans le mouvement d'une narration, nombre de
vains dbats sur l'identit l'attestent, en particulier lorsqu'ils ont pour
enjeu l'identit d'une communaut historique. Lorsque Fernand
Braudel traite de L'Identit de la France, il s'emploie certes
dgager des traits distinctifs durables, voire permanents, quoi on
reconnat la France en tant que quasi-personnage. Mais, spars de
l'histoire et de la gographie, ce que le grand historien se garde bien
de faire, ces traits se durciraient et donneraient aux pires idologies
de l' identit nationale l'occasion de se dchaner. Ce sera la tche
d'une rflexion sur l'identit narrative de mettre en balance les traits
immuables que celle-ci doit l'ancrage de l'histoire d'une vie dans
un caractre, et ceux qui tendent dissocier l'identit du soi de la
mmet du caractre.
3. Avant de nous engager dans cette voie, il importe de tirer
argument, en faveur de la distinction entre identit du soi et identit
du mme, de l'usage que nous faisons de la notion dans les contextes
o les deux sortes d'identit cessent de se recouvrir au point de se
dissocier entirement, mettant en quelque sorte nu l'ipsit du soi
sans le support de la mmet. 11 est en effet un autre modle de
permanence dans le temps que celui du caractre. C'est celui de la
parole tenue dans la fidlit la parole donne. Je vois dans cette
tenue la figure emblmatique d'une identit polairement oppose
celle du caractre. La parole tenue dit un maintien de soi qui ne se
laisse pas inscrire, comme le caractre, dans la dimension du
quelque chose en gnral, mais uniquement dans celle du qui ?. Ici
aussi l'usage des mots est un bon guide. Une chose est la
persvration du caractre ' ; une autre, la persvrance de la fidlit
la parole donne. Une chose est la continuation du caractre ; une
autre, la constance dans l'amiti. A cet gard, Heidegger a raison de
distinguer de la permanence
1. Il est remarquable que Kant dsigne la substance (premire catgorie de
la relation) par le terme dos Geharrliche(ce qui persiste) (cf. ci-dessus, p. 142,
ni).
substantielle le maintien de soi (Selbstndigkeit) dcompos en
Selbst-Stndigkeit - que Martineau traduit par maintien de soi ,
plutt que par constance soi , comme je le fais dans Temps et
Rcit III \ Cette distinction majeure demeure, mme s'il n'est pas
certain que la rsolution devanante, face la mort, puise le sens
du maintien de soi
2
. Aussi bien cette posture exprime-t-elle un
certain investissement existentiel des transcen-dantaux de
l'existence que Heidegger appelle existentiaux, desquels relve
l'ipsit. D'autres attitudes, situes la mme jonction de
l'existential et de l'existentiel que toutes les analyses
heideggriennes tournant autour de l'tre-pour (ou envers)-la-mort,
sont tout autant rvlatrices de la conjonction fondamentale entre la
problmatique de la permanence dans le temps et celle du soi, en
tant que le soi ne concide pas avec le mme.
A cet gard, la tenue de la promesse, comme il a t rappel plus
haut, parat bien constituer un dfi au temps, un dni du changement
: quand mme mon dsir changerait, quand mme je changerais
d'opinion, d'inclination, je maintiendrai. Il n'est pas ncessaire,
pour qu'elle fasse sens, de placer la tenue de la parole donne sous
l'horizon de l'tre-pour (ou envers)-la-mort. Se suffit elle-mme la
justification proprement thique de la promesse, que l'on peut tirer
de l'obligation de sauvegarder l'institution du langage et de
rpondre la confiance que l'autre met dans ma fidlit. Cette
justification thique, prise en tant que telle, droule ses propres
implications temporelles, savoir une modalit de permanence
dans le temps susceptible d'tre polairement oppose celle du
caractre. Ici, prcisment, ipsit et mmet cessent de concider.
Ici, en consquence, se dissout l'quivocit de la notion de
permanence dans le temps.
1. Ontologiquement, le Dasein est fondamentalement diffrent de tout tant
sous-la-main ou rel. Sa " teneur " [Bestand] ne se fonde pas dans la substantialit
d'une substance, mais dans le maintien du soi-mme [Selbstndigkeit] existant,
dont l'tre a t conu comme souci (treet Temps, op cit. [303], trad. Marti-
neau modifie selon sa propre traduction de Selbst-Stndigkeit dans d'autres
contextes, cf. note suivante). F. Vezin traduit : Ontologiquement, le Dasein dif-
fre fondamentalement de tout ce qui est l-devant et de tout ce qui est rel. Ce en
quoi il " consiste " ne se ramne pas la substantialitd'une substance, mais la
" constanceen soi " [Selbstndigkeit] du soi-mme existant dont l'tre a t conu
comme souci (op. cit. [303], p. 363). Il est vrai que Heidegger dit encore ici
Selbstndigkeit. que Martineau traduit par autonomie , et pas encore
Selbst-Stndigkeit.
2. "Le maintien du soi-mme" (autonomie) [dieSelbst-Stndigkeit] ne signifie
existentialement rien d'autre que la rsolution devanante (Martineau, p. 227
[322]). La constancedesoi-mme[Selbststndigkeit] ne signifie existentialement
rien d'autre que la rsolution en marche (Vezin [322], p. 382-383).
148 149
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
Cette manire nouvelle ' d'opposer la mmet du caractre au
maintien de soi-mme dans la promesse ouvre un intervalle de sens qui
reste combler. Cet intervalle est ouvert par la polarit, en termes
temporels, entre deux modles de permanence dans le temps, la
persvration du caractre et le maintien de soi dans la promesse. C'est
donc dans l'ordre de la temporalit que la mdiation est chercher. Or,
c'est ce milieu que vient occuper, mon avis, la notion d'identit
narrative. L'ayant ainsi situe dans cet intervalle, nous ne serons pas
tonns de voir l'identit narrative osciller entre deux limites, une limite
infrieure, o la permanence dans le temps exprime la confusion de
Yidem et de Yipse, et une limite suprieure, o Yipse pose la question de
son identit sans le secours et l'appui de Yidem.
Mais auparavant il faut examiner les titres de thories de l'identit
personnelle qui ignorent la fois la distinction de Yidem et de Yipse et les
ressources qu'offre la narrativit pour rsoudre les paradoxes de
l'identit personnelle, que ces mmes thories ont l'avantage de poser
en termes forts et clairs.
2. Les paradoxes de l'identit personnelle
1. Que, sans le fil conducteur de la distinction entre deux modles
d'identit et sans le secours de la mdiation narrative, la question de
l'identit personnelle se perde dans les arcanes de difficults et de
paradoxes paralysants, les philosophes de langue anglaise et de culture
analytique l'ont appris d'abord chez Locke et chez Hume.
Du premier, la tradition ultrieure a retenu l'quation entre identit
personnelle et mmoire. Mais il faut voir au prix de
1. La manire est nouvelle, si on la compare la stratgie dveloppe dans mes
ouvrages antrieurs. Dans LeVolontaireet l'Involontaire, la mdiation n'tait pas
un problme majeur ; je parlais alors tranquillement de la rciprocit du volon-
taire et de l'involontaire et reprenais sans grand scrupule la formule de Maine de
Biran : Homo simplex in vitalitate, duplex in humanitate ; tout au plus pou-
vait-on dire que le volontaire relatif de la motivation et des pouvoirs occupait le
milieu entre les deux extrmes du projet et du caractre. Dans L'Hommefaillible.
tout entier construit sur la disproportion de l'homme, la question du troisime
terme, lieu par excellence de fragilit, devenait l'enjeu mme de l'entreprise.
Ayant pos le problme en termes de fini et d'infini, je voyais dans le respect de la
personne morale, union de la particularit et de l'universalit reprsente chez
Kant par l'ide d'humanit, le troisime terme requis par la disproportion entre le
caractre et le bonheur.
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
quelle inconsistance dans l'argumentation et de quelle invraisemblance
dans l'ordre des consquences cette quation a t paye. Inconsquence
dans l'argumentation, d'abord : au dbut du fameux chapitre xxvn de Y
Essai philosophique concernant l'entendement humain (2
e
d., 1694)',
intitul Identit et diversit, Locke introduit un concept d'identit qui
parat chapper notre alternative de la mmet et de l'ipsit ; aprs
avoir dit que l'identit rsulte d'une comparaison, Locke introduit l'ide
singulire de l'identit d'une chose elle-mme (mot mot : de
mmet avec elle-mme, sameness with itselj) ; c'est en effet en
comparant une chose avec elle-mme dans des temps diffrents que nous
formons les ides d'identit et de diversit ; quand nous demandons si
une chose est la mme [same] ou non, il est toujours fait rfrence
quelque chose qui a exist en tel temps et tel lieu, dont il tait certain qu'
ce moment cette chose tait identique elle-mme [the same with itselj]
. Cette dfinition parat cumuler les caractres de la mmet en vertu de
l'opration de comparaison, et ceux de l'ipsit en vertu de ce qui fut
concidence instantane, maintenue travers le temps, d'une chose avec
elle-mme. Mais la suite de l'analyse dcompose les deux valences de
l'identit. Dans la premire srie d'exemples - le navire dont on a chang
toutes les pices, le chne dont on accompagne la croissance du gland
l'arbre, l'animal et mme l'homme dont on suit le dveloppement de la
naissance la mort -, c'est la mmet qui prvaut ; l'lment commun
tous ces exemples, c'est la permanence de l'organisation, laquelle, il est
vrai, n'engage, selon Locke, aucun substantialisme. Mais, au moment
d'en venir l'identit personnelle que Locke ne confond pas avec celle
d'un homme, c'est la rflexion instantane qu'il assigne la mmet
avec soi-mme allgue par la dfinition gnrale. Reste seulement
tendre le privilge de la rflexion de l'instant la dure ; il suffit de
considrer la mmoire comme l'expansion rtrospective de la rflexion
aussi loin qu'elle peut s'tendre dans le pass ; la faveur de cette
mutation de la rflexion en mmoire, la mmet avec soi-mme peut
tre dite s'tendre travers le temps. Ainsi Locke a-t-il cru pouvoir
introduire une csure dans le cours de son analyse sans avoir
abandonner son concept gnral de mmet [d'une chose] avec
elle-mme . Et pourtant, le tournant de la rflexion et de la mmoire
marquait en fait un renversement conceptuel o l'ipsit se substituait
silencieusement la mmet.
1. Essai philosophiqueconcernant l'entendement humain, trad. fr. de P. Coste,
Paris, Vrin, 1972.
150
151
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
Mais ce n'est pas au niveau de la cohrence de l'argument que Locke a
suscit la perplexit majeure : la tradition l'a crdit de l'invention d'un
critre d'identit, savoir l'identit psychique, quoi l'on pourra
dsormais opposer le critre d'identit corporelle, duquel relevait en
fait la premire srie d'exemples o prvalait la permanence d'une
organisation observable du dehors. Une discussion sur les critres de
l'identit occupera dsormais l'avant-scne, suscitant des plaidoyers
opposs et galement plausibles en faveur de l'un ou de l'autre. Ainsi,
Locke et ses partisans, on opposera rgulirement les apories d'une
identit suspendue au seul tmoignage de la mmoire ; apories
psychologiques concernant les limites, les intermittences (durant le
sommeil par exemple), les dfaillances de la mmoire, mais aussi apories
plus proprement ontologiques : plutt que de dire que la personne
existe pour autant qu'elle se souvient, n'est-il pas plus plausible,
demande J.Butler
1
, d'assigner la continuit de la mmoire l'existence
continue d'une me-substance? Sans l'avoir prvu, Locke rvlait le
caractre aportique de la question mme de l'identit. En tmoignent
plus que tout les paradoxes qu'il assumait sans sourciller, mais que ses
successeurs ont transforms en preuves d'indcidabilit : soit le cas
d'un prince dont on transplante la mmoire dans le corps d'un savetier ;
celui-ci devient-il le prince qu'il se souvient avoir t, ou reste-t-il le
savetier que les autres hommes continuent d'observer ? Locke, cohrent
avec lui-mme, tranche en faveur de la premire solution. Mais des
lecteurs modernes, plus sensibles la collision entre deux critres
opposs d'identit, concluront l'indcidabilit du cas. De cette faon,
l're des puzzling cases tait ouverte, en dpit de l'assurance de Locke.
On y reviendra plus loin
2
.
Auparavant s'tait ouverte avec Hume l're du doute et du
1. J. Butler, Of personal Identity , TheAnalogyof Religion ( 1736), repris in
i. Perry (d.), Personal Identity, University of California Press, 1975, p. 99-105.
2. Ce n'est pas chez Locke, mais chez ses successeurs, que la situation cre par
l'hypothse de la transplantation d'une mme me dans un autre corps a
commenc de paratre plus indtermine que simplement paradoxale, c'est--dire
contraire au sens commun. Car comment la mmoire du prince pourrait-elle ne
pas affecter le corps du cordonnier au plan de la voix, des gestes, des postures ? Et
comment situer l'expression du caractre habituel du cordonnier par rapport
celle de la mmoire du prince ? Ce qui est devenu problmatique aprs Locke, et
ce qui ne l'tait pas pour ce dernier, c'est la possibilit de distinguer entre deux
critres d'identit : l'identit dite psychique et l'identit dite corporelle, comme si
l'expression de la mmoire n'tait pas un phnomne corporel. En fait le vice
inhrent au paradoxe de Locke, outre la circularit ventuelle de l'argument, c'est
une description imparfaite de la situation cre par la transplantation imaginaire.
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
soupon. C'est un concept fort de la relation d'identit que Hume pose au
dbut de l'analyse qu'on lit dans le Trait de la nature humaine, livre I,
quatrime partie, sixime section (1739): Nous avons une ide
distincte d'un objet qui demeure invariable et ininterrompu durant une
variation suppose de temps ; cette ide, nous l'appelons identit ou
samenessK Point d'ambigut, donc: il n'existe qu'un modle
d'identit, la mmet. Comme Locke, Hume parcourt une suite
d'exemples-types, des navires et des plantes aux animaux et aux
humains. A la diffrence de Locke, toutefois, il introduit, ds ses
premiers exemples, des degrs dans l'assignation d'identit, selon par
exemple que les mutations d'un tre matriel ou vivant sont plus ou
moins amples ou plus ou moins soudaines. La question de l'identit se
trouve ainsi soustraite ds le dbut aux rponses en noir et blanc. Mais,
surtout, la diffrence de Locke, Hume ne renverse pas ses critres
d'assignation d'identit quand il passe des choses et des tres anims au
soi. Et comme, en bon empi-riste, il demande pour chaque ide une
impression correspondante (il doit exister une impression qui donne
naissance chaque ide relle
2
... ) et qu' l'examen de son intrieur
il ne trouve qu'une diversit d'expriences et nulle impression invariable
relative l'ide d'un soi, il conclut que cette dernire est une illusion.
Mais cette conclusion ne clt pas le dbat, elle l'ouvre plutt.
Qu'est-ce qui, demande Hume, nous donne une propension si forte
superposer une identit ces perceptions successives, et supposer que
nous sommes en possession d'une existence invariable et ininterrompue
durant le cours entier de nos vies ? C'est dans l'explication de Yillusion
d'identit que Hume dploie les ressources de subtilit qui, aprs avoir
fait grande impression sur Kant, ont laiss une marque durable sur la
discussion ultrieure. Deux concepts nouveaux entrent en scne,
l'imagination et la croyance. C'est Yimagination qu'est attribue la
facult de passer avec facilit d'une exprience l'autre si leur
diffrence est faible et graduelle, et ainsi de transformer la diversit en
identit. C'est la croyance qui sert ensuite de relais, comblant le dficit
de l'impression. Dans une culture comme celle laquelle Hume
appartient encore, l'aveu qu'une ide repose sur une croyance, et
1 Trad. de l'auteur. La traduction de Leroy (Hume, Trait de la nature
humaine. 2 vol., Paris, Aubier-Montaigne, 1968) rend trop approximativement
sameness par du mme (t. I, p. 345) et self par moi .
2. Trad. de l'auteur (cf. trad. Leroy, op. cit.. 1.1, p. 343).
152 153
SOI-MME COMME UN AUTRE
non sur une impression, ne discrdite pas entirement cette ide ; les
croyances ont une place et un rle que la philosophie prcisment
dlimite. Toutefois, dire que la croyance engendre des fictions, c'est
annoncer un temps o la croyance sera devenue incroyable. Hume
ne franchit pas encore ce pas et suggre que l'unit de la
personnalit peut tre assimile celle d'une rpublique ou d'un
Commonweahh dont les membres ne cessent de changer tandis que
les liens d'association demeurent. 11 appartiendra Nietzsche
d'achever le pas du soupon. La violence de la dngation
remplacera la subtilit de l'insinuation.
On objectera : Hume ne cherchait-il pas ce qu'il ne pouvait trouver
: un soi qui ne soit qu'un mme ? Et ne prsupposait-il pas le soi qu'il
ne cherchait pas ? Qu'on lise son argument principal : Quant moi,
quand je pntre le plus intimement dans ce que j'appelle
moi-mme, je bute toujours sur l'une ou l'autre perception
particulire, chaleur ou froid, lumire ou ombre, amour ou haine,
douleur ou plaisir. Je ne m'atteins jamais moi-mme un moment
quelconque en dehors d'une perception et ne peux rien observer
d'autre que la perception
1
. Voici donc quelqu'un qui professe ne
pas trouver autre chose qu'un donn priv d'ipsit ; quelqu 'un qui
pntre en lui-mme, cherche et dclare n'avoir rien trouv. Au
moins, observe Chisholm dans Person and Objeci
1
. quelqu'un se
trouve-t-il en train de trbucher, en train d'observer une perception.
Avec la question qui ? - qui cherche, trbuche et ne trouve pas, et qui
peroit ? -, revient le soi au moment o le mme se drobe.
C'est un paradoxe semblable que la suite de la discussion va
maintes fois ctoyer. Je ne m'arrterai pas la question de savoir si
le meilleur critre de l'identit est d'ordre corporel ou psycho-
logique. Et cela pour plusieurs raisons.
D'abord, je ne veux pas laisser croire que le critre psychologique
aurait une affinit privilgie pour l'ipsit et le critre corporel
pour la mmet. Si la mmoire a pour l'ipsit une affinit sur
laquelle je reviendrai plus loin, le critre psychologique ne se rduit
pas la mmoire ; tout ce qui a t dit plus haut sur le caractre
l'atteste suffisamment ; or, on l'a vu, le fait du caractre est ce qui
incline le plus penser l'identit en termes de mmet. Le caractre,
disions-nous, c'est le soi sous les apparences de la mmet. En sens
inverse, le critre corporel n'est pas par nature
1. Cf. trad. Leroy, op. cit., t. 1, p. 343.
2. R. Chisholm, Person andObiect, a Metaphysical Study, Londres, G. Allen &
Unwin, 1976, p. 37-41.
154
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
tranger la problmatique de l'ipsit, dans la mesure o l'ap-
partenance de mon corps moi-mme constitue le tmoignage le
plus massif en faveur de l'irrductibilit de l'ipsit la mmet '.
Aussi semblable lui-mme que demeure un corps - encore n'est-ce
pas le cas : il suffit de comparer entre eux les autoportraits de
Rembrandt -. ce n'est pas sa mmet qui constitue son ipsit, mais
son appartenance quelqu'un capable de se dsigner lui-mme
comme celui qui a son corps.
Ensuite, j'ai le plus grand doute concernant l'usage du terme de
critre dans le champ de la prsente discussion. Est critre ce qui
permet de distinguer le vrai du faux dans une comptition entre
prtentions la vrit. Or la question est prcisment de savoir si
ipsit et mmet se prtent de la mme faon l'preuve du
jugement de vrit. Dans le cas de la mmet, le terme de critre a
un sens bien prcis : il dsigne les preuves de vrification et de
falsification des noncs portant sur l'identit en tant que relation :
mme que... (on se rappelle l'affirmation de Locke et de Hume selon
lesquels l'identit rsulte d'une comparaison : chez Kant encore, la
substance est la premire catgorie de la relation). On peut alors
lgitimement appeler critre l'preuve de vrit des assertions
portant sur la mmet. En est-il de mme de l'ipsit ?
L'appartenance de mon corps moi-mme relve-t-elle d'une
cri-triologie ? Ne tombe-t-elle pas plutt dans le champ de
l'attestation
2
? La mmoire - le prtendu critre psychologique
privilgi - est-elle le critre de quoi que ce soit ? Ne tombe-t-elle
pas, elle aussi, dans le champ de l'attestation ? On peut hsiter : on
rpondra non, si l'on identifie critre preuve de vrification ou de
falsification ; oui, si l'on admet que l'attestation se prte une
preuve de vrit d'un autre ordre que l'preuve de vrification ou
de falsification. Or, cette discussion ne pourra tre mene bien que
lorsque la distinction des deux problmatiques de l'ipsit et de la
mmet aura t fermement tablie et aprs que l'ventail entier des
cas de figure, allant de leur superposition
1. La confrontation entre critre corporel et critre psychologique a donn lieu
une littrature considrable en langue anglaise ; on consultera les collections
d'essais suivants: Amlie Oksenberg Rorty, The Identities of Persons. Univ. of
California Press, 1976: J. Perry, Personal Identity, Univ. of California Press,
1975; et les ouvrages de Sidney Shoemaker. Self-knonledge and Self-Identity,
Ithaca, Cornell University Press. 1963, et de Bernard Williams, Problems ofthe
Self, Cambridge University Press, 1973.
2. Ce n'est pas la premire fois que le statut pistmologique de l'attestation
passe au premier plan : cf. ci-dessus, p. 108. Le lien entre ipsit et attestation sera
abord de front dans la dixime tude.
155
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
leur disjonction, aura t parcouru. Ce qui ne se pourra faire qu'au
terme de nos rflexions sur l'identit narrative.
2. Plutt donc qu'entrer dans la discussion des critres d'identit
personnelle, j'ai dlibrment choisi de me mesurer avec une uvre
majeure, qui, transcendant le dbat sur les mrites respectifs du critre
psychologique et du critre corporel, s'adresse directement aux
croyances que nous attachons d'ordinaire la revendication d'identit
personnelle. Cette uvre hors du commun est celle de Derek Parfit,
Reasons and Persons
x
. J'y ai reconnu l'adversaire - non l'ennemi, loin de
l - le plus redoutable pour ma thse de l'identit narrative, dans la
mesure o ses analyses se droulent sur un plan o l'identit ne peut
signifier que mmet, l'exclusion expresse de toute distinction entre
mmet et ipsit, et donc de toute dialectique - narrative ou autre -
entre mmet et ipsit. L'uvre rappelle la fois celle de Locke, moins
par la place qu'y tient la mmoire que par le recours aux cas paradoxaux,
et celle de Hume, par sa conclusion sceptique ; les fameux puzzling
cases qui servent d'preuve de vrit tout au long du livre de Parfit
conduisent en effet penser que la question mme de l'identit peut se
rvler vide de sens, dans la mesure o, dans les cas paradoxaux au
moins, la rponse est indtermine. La question sera pour nous de savoir
si, comme Hume, Parfit n'a pas cherch ce qu'il ne pouvait trouver,
savoir un statut ferme de l'identit personnelle dfinie en termes de
mmet, et s'il ne prsuppose pas le soi qu'il ne cherchait pas.
principalement lorsqu'il dploie, avec une vigueur de pense peu
commune, les implications morales de sa thse et en vient crire :
Personal identity is not what matters (l'identit personnelle n'est pas
ce qui importe)
2
.
C'est aux croyances de base sous-jacentes au maniement des critres
d'identit que s'attaque Parfit. Pour une raison didactique, on peut
dcomposer en trois sries d'assertions les croyances ordinaires
relatives l'identit personnelle ; la premire concerne ce que l'on doit
entendre par identit, savoir l'existence spare d'un noyau de
permanence ; la seconde consiste en la conviction qu'il peut toujours
tre donn une rponse dtermine concernant l'existence d'une telle
permanence ; la troisime nonce que la question pose est impor-
1. Oxford, Oxford Univcrsity Press, 1986.
2. ReasonsandPersons, op. cit., p. 255 et passim(trad. de l'auteur). On remar-
quera que D. Parfit crit parfois : our identityis not what matters (p. 245 et
passim), formule qui ne manque pas de rintroduire la question de l'appartenance
(ownership).
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
tante, pour que la personne puisse revendiquer le statut de sujet moral.
La stratgie de Parfit consiste dmanteler l'une aprs l'autre ces trois
sries d'assertions qui sont moins juxtaposes que superposes, de la
plus manifeste la plus dissimule.
La premire thse de Parfit est que la croyance commune doit tre
reformule dans des termes qui ne lui sont pas propres, savoir dans
ceux de la thse adverse qu'il tient pour seule vraie et qu'il appelle thse
rductionniste. La thse adverse sera donc appele thse non
rductionniste. Selon la thse rductionniste, l'identit travers le temps
se ramne sans reste au fait d'un certain enchanement (connectedness)
entre vnements, que ceux-ci soient de nature physique ou psychique.
Les deux termes ici employs doivent tre bien compris : par
vnement, il faut entendre toute occurrence susceptible d'tre dcrite
sans qu'il soit explicitement affirm que les expriences qui composent
une vie personnelle sont la possession de cette personne, sans que soit
affirm que cette personne existe. C'est sous la condition d'une telle
description impersonnelle que toute recherche de connexion peut tre
mene, que ce soit au plan physique ou corporel, ou au plan mental ou
psychique.
La thse rductionniste rintroduit ainsi dans le dbat la notion neutre
d'vnement avec laquelle nous nous sommes confronts une premire
fois dans le cadre de la thorie de l'action l'occasion des thses de
Donald Davidson sur le rapport entre action et vnement'. Comme
chez Davidson, la catgorie d'vnement parat tre primitive,
c'est--dire non tributaire de celle d'entit substantielle, au contraire de
la notion d'tat qui, semble-t-il, doit tre tat de quelque entit. La notion
d'vnement une fois prise en ce sens large, incluant vnement
psychique et vnement physique, la thse rductionniste peut tre ainsi
formule : l'existence d'une personne consiste exactement en
l'existence d'un cerveau et d'un corps et dans l'occurrence d'une srie
d'vnements physiques et mentaux relis entre eux
2
.
1. Cf. ci-dessus, troisime tude, p. 73 sq.
2. D. Parfit, Reasons and Persons, op. cit., p. 211 [trad. de l'auteur]. Il est vrai
que Parfit admet deux variantes de la thse rductionniste : selon la premire, la
personne n'est que ce qu'on vient de dire ; selon la deuxime, la personne pourrait
tre tenue pour une entit distincte sans que cette entit ait une existence spare :
cette variante fait droit l'analogie propose par Hume entre la personne et une
rpublique ou Commonwealth ; ainsi dit-on que la France existe mais non la
Rusi-tanie, bien que la premire n'existe pas sparment, part de ses citoyens et
de son territoire. C'est cette deuxime version que Parfit adopte pour la notion de
personne. A ses yeux, elle ne viole pas la thse rductionniste. Dans cette
deuxime version, la personne peut tre mentionne sans que son existence soit
revendique (claimed).
156 157
SOI-MME COMME UN AUTRE
Qu'est-ce que la thse rductionniste exclut ? Exactement : que
nous sommes des entits existant sparment (Reasons and
Persons, p. 210). Par rapport la simple continuit psychique ou
psychologique, la personne constitue un fait spar suppl-
mentaire (a separate further fact). En quel sens, spar ? Au sens
de distinct de son cerveau et de son vcu psychique (his exp-
riences). Pour Parfit, la notion de substance spirituelle, quoi il
identifie le pur ego cartsien, n'est sans doute qu'une des versions de
la thse non rductionniste, mais c'est la plus connue, mme si une
version matrialiste est galement concevable ; l'essentiel en est
l'ide que l'identit consiste dans un fait supplmentaire par rapport
la continuit physique et/ou psychique : j'appelle cette
conception la Conception du Fait Supplmentaire {Further Fact
View-ibid., p. 210).
Avant d'aller plus loin, il importe de souligner que c'est la thse
rductionniste qui tablit le vocabulaire de rfrence dans laquelle la
thse adverse est formule, savoir le vocabulaire de l'vnement,
du fait, dcrit de faon impersonnelle ; par rapport ce vocabulaire
de base, la thse adverse est dfinie la fois par ce qu'elle dnie (le
rductionnisme) et ce qu'elle ajoute (le fait supplmentaire). De
cette manire est lud, mon avis, le phnomne central que la
thse rduit, savoir la possession par quelqu'un de son corps et de
son vcu. Le choix de l'vnement comme terme de rfrence
exprime, ou mieux opre, cette lusion ou mieux cette lision de la
miennet. Et c'est dans le vocabulaire de l'vnement, issu de
pareille lision, que l'existence de la personne fait figure de fait
supplmentaire. La thse dite non rductionniste est ainsi rendue
parasitaire de la thse rductionniste, rige en unit de compte. Or.
toute la question est de savoir si la miennet relve de la gamme des
faits, de l'pistmologie des observables, finalement de l'ontologie
de l'vnement. Nous sommes ainsi renvoys une fois de plus la
distinction entre deux problmatiques de l'identit, celle de Yipse et
celle de Y idem. C'est parce qu'il ignore cette possible dichotomie
que Parfit n'a pas d'autre ressource que de tenir pour superflu, au
sens prcis du terme, le phnomne de miennet par rapport la
factualit de l'vnement.
De cette mconnaissance rsulte titre de corollaire la fausse
apparence que la thse dite non rductionniste trouve son illus-
tration la plus remarquable dans le dualisme spiritualiste quoi le
cartsianisme est lui-mme trop rapidement assimil. A mon sens,
ce que la thse rductrice rduit, ce n'est pas seulement, ni
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
mme titre primaire, la miennet du vcu psychique (the exp-
riences, au sens anglais du terme), mais plus fondamentalement
celle du corps propre : de mon corps. L'impersonnalit de l'vne-
ment marque avant toute chose la neutralisation du corps propre.
Ds lors, la vritable diffrence entre thse non rductionniste et
thse rductionniste ne concide aucunement avec le soi-disant
dualisme entre substance spirituelle et substance corporelle, mais
entre appartenance mienne et description impersonnelle. Dans la
mesure o le corps propre constitue une des composantes de la
miennet, la confrontation la plus radicale doit mettre en prsence
les deux perspectives sur le corps, le corps comme mien et le corps
comme un corps parmi les corps. La thse rductionniste, en ce
sens, marque la rduction du corps propre au corps quelconque.
C'est cette neutralisation qui, dans toutes les expriences de pense
que l'on va maintenant faire paratre, facilite la focalisation sur le
cerveau du discours sur le corps. Le cerveau, en effet, diffre de
maintes parties du corps, et du corps tout entier en tant
qu'exprience intgrale, en ce qu'il est dnu de tout statut ph-
nomnologique et donc du trait d'appartenance mienne. J'ai un
rapport vcu mes membres en tant qu'organes de mouvement (la
main) ou de perception (l'il), d'motion (le cur) ou d'expression
(la voix). Je n'ai aucun rapport vcu mon cerveau. A vrai dire,
l'expression mon cerveau ne signifie rien, du moins directement
: absolument parlant, il y a un cerveau dans mon crne, mais je ne le
sens pas. Ce n'est que par le dtour global par mon corps, en tant que
mon corps est aussi un corps et que le cerveau est contenu dans ce
corps, que je puis dire : mon cerveau. Le caractre droutant de cette
expression se trouve renforc par le fait que le cerveau ne tombe pas
sous la catgorie des objets perus distance du corps propre. Sa
proximit dans ma tte lui confre le caractre trange d'intriorit
non vcue.
Quant aux phnomnes psychiques, ils posent un problme
comparable ; cet gard, on peut tenir pour le moment le plus cri-
tique de toute l'entreprise la tentative pour dissocier le critre
psychologique du trait d'appartenance mienne. Si, estime Parfit, le
Cogito cartsien ne peut bien videmment tre dpouill du trait de
la premire personne, il n'en est pas de mme de l'identit dfinie
par la seule continuit psychique ou corporelle. On doit donc
pouvoir dfinir la continuit mnmique sans rfrence au mien, au
tien, au sien. Si on le pouvait, on se serait vritablement dbarrass
du trait d'appartenance mienne, bref du propre. On le pourrait, si
l'on pouvait crer une rplique de la mmoire de l'un
158 159
SOI-MME COMME UN AUTRE
dans le cerveau de l'autre (il s'agit certes de manipulation sur le
cerveau, mais on verra plus loin la place que celle-ci et d'autres
semblables tiennent dans les expriences imaginaires construites par
Parfit) ; la mmoire peut alors tre tenue pour quivalente une trace
crbrale. On parlera en ce sens de traces mnmiques. Rien alors ne
s'oppose ce que l'on fabrique une rplique de ces traces. Sur cette base,
on peut dfinir un concept large de quasi-mmoire, dont la mmoire
ordinaire serait une sous-classe, savoir celle des quasi-souvenirs de
nos propres expriences passes (cf. ibid., p. 220). Mais le propre
peut-il tre un cas particulier de l'impersonnel ? En fait, on s'est tout
accord en substituant la mmoire propre la notion de trace
mnmique, laquelle relve en effet de la problmatique de l'vnement
neutre. C'est ce glissement pralable qui autorise traiter en termes de
dpendance causale l'enchanement spcifique entre exprience passe
et exprience prsente.
Le cas de la mmoire est seulement le cas le plus frappant dans l'ordre
de la continuit psychique. Ce qui est en cause, c'est Inscription de la
pense un penseur. Peut-on substituer, sans perte smantique, cela
pense (ou : la pense est en cours ) je pense ? L'ascription soi
et un autre, pour reprendre le vocabulaire de Strawson, parat bien
intraduisible dans les termes de la description impersonnelle.
La seconde croyance laquelle Parfit s'attaque est celle que la
question de l'identit est toujours dterminable, donc que tous les cas
apparents d'indterminabilit peuvent tre tranchs par oui ou par non.
En vrit, cette croyance est sous-jacente la prcdente : c'est parce
que nous tenons pour dterminables les cas aberrants que nous
cherchons la formule stable de l'identit. A cet gard, l'invention de
puzzling cases avec le secours de la science-fiction, o s'atteste
l'indcidabilit de la question d'identit, exerce une fonction
stratgique si dcisive que Parfit ouvre la partie de son ouvrage, la
troisime, consacre l'identit personnelle, par la prsentation du plus
troublant de ses puzzling cases. Ainsi est insinue ds le dbut la vacuit
d'une question qui suscite une telle indtermination de la rponse. J'ai
nanmoins prfr commencer par l'expos de la thse rductionniste
parce qu'elle rgit, en fait, la construction et la slection des puzzling
cases.
En un sens, la question de l'identit a toujours suscit l'intrt pour
des cas paradoxaux. Les croyances religieuses et thologiques relatives
la transmigration des mes, l'immortalit, la
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
rsurrection de la chair, n'ont pas manqu d'intriguer les esprits les plus
spculatifs (on en a un tmoignage dans la rponse de saint Paul aux
paroissiens de Corinthe dans 1 Cor 15,35^.). On a vu plus haut de quelle
faon Locke se sert d'un cas imaginaire troublant, non pas certes pour
miner par en dessous la croyance, mais pour mettre l'preuve du
paradoxe sa propre thse sur l'quation entre identit personnelle et
mmoire. Ce sont ses successeurs qui ont transform le paradoxe de
Locke en puzzling case. La littrature de l'identit personnelle est
pleine d'inventions de cette sorte : transplantation de cerveau, bisection,
duplication d'hmisphres crbraux, etc., pour ne rien dire des cas
offerts par l'observation clinique de ddoublement de la personnalit,
cas plus familiers au public de langue franaise. Nous-mmes serons
conduits assigner une place considrable l'quivalent des puzzling
cases de Parfit, dans le cadre d'une conception narrative de l'identit
personnelle. La confrontation entre les deux sortes de puzzling cases sera
mme un des points forts du plaidoyer en faveur de notre propre thse.
Bornons-nous pour l'instant l'observation suivante : cette continuit
saisissante dans le recours l'imagination de cas susceptibles de
paralyser la rflexion laisse entendre que la question de l'identit
constitue un lieu privilgi d'apories. Peut-tre faudra-t-il conclure, non
que la question est vide, mais qu'elle peut demeurer comme une ques-
tion sans rponse : c'est l prcisment l'enjeu de cette stratgie
singulire.
Que la slection des puzzling cases de Parfit soit rgie par l'hypothse
rductionniste qu'on vient de discuter, c'est ce qu'il importe de
souligner avec force. Soit l'exprience fictive de tl-transportation qui
ouvre avec clat la troisime partie de Reasons and Persons. L'auteur en
propose deux versions : dans les deux cas, il est fait une copie exacte de
mon cerveau, cette copie est transmise par radio un poste rcepteur
plac sur une autre plante o une machine reconstitue sur la base de
cette information une rplique exacte de moi-mme, donc identique au
sens d'exactement semblable quant l'organisation et l'enchanement
des tats de choses et des vnements. Dans le premier cas, mon cerveau
et mon corps sont dtruits au cours de mon voyage spatial. La question
est de savoir si j'ai survcu dans ma rplique ou si je suis mort. Le cas est
indcidable : quant l'identit numrique, ma rplique est un autre que
moi ; quant l'identit qualitative, elle est indiscernable de moi, donc
substituable. Dans le deuxime cas, mon cerveau et mon corps ne
sont pas dtruits
160 161
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
mais mon cur est abm ; je rencontre ma rplique sur Mars, je
coexiste avec elle ; elle sait que je vais mourir avant elle et entreprend de
me consoler en me promettant qu'elle tiendra ma place ; que puis-je
encore attendre du futur ? Vais-je mourir ou survivre dans ma rplique
?
Quelle prsupposition prside la fabrication de ce puzzling case et
de bien d'autres plus ingnieux les uns que les autres ? Il s'agit d'abord de
cas imaginaires qui restent concevables, lors mme qu'ils ne seraient pas
techniquement ralisables. Il leur suffit de n'tre ni logiquement, ni
physiquement impossibles ; la question sera de savoir s'ils ne violent
pas une contrainte d'un autre ordre, relative l'enracinement terrien de
l'homme. On y reviendra plus tard lorsque l'on comparera les cas de
science-fiction aux fictions littraires d'ordre narratif. En outre, il s'agit
de manipulations de haute technologie exerces sur le cerveau tenu
pour l'quivalent de la personne. C'est en ce point que la thse
rductionniste exerce son contrle ; dans une ontologie de l'vnement
et dans une pistmologie de la description impersonnelle des
enchanements porteurs de l'identit, le lieu privilgi des occurrences
dans lesquelles la personne est mentionne, sans que son existence
distincte soit explicitement revendique, est le cerveau. Il est clair que
les fictions de Parfit, la diffrence des fictions littraires dont nous
parlerons plus loin, portent sur des entits relevant du registre du
manipulable d'o la question de l'ipsit a t par principe limine.
La conclusion que Parfit tire de la situation d'indcidabilit rvle
par les puzzling cases est que la question pose tait elle-mme vide. Si
l'on tient qu'identit veut dire mmet, la conclusion est irrsistible ; en
effet, dans les cas les plus embarrassants, aucune des trois solutions
envisages n'est plausible, savoir :
a) il n'existe personne qui soit mme que moi ;
b) je suis le mme que l'un des deux individus issus de l'expri-
mentation ;
c) je suis le mme que les deux individus.
Le paradoxe est bien un paradoxe de la mmet : il a fallu tenir pour
quivalentes la question : Vais-je survivre ? et la question : Y
aura-t-il une personne qui soit la mme personne que moi ? Dans ce
cadre prdtermin, rsoudre le paradoxe, c'est dissoudre la question,
bref la tenir pour vide. A vrai dire, il faudrait nuancer et dire : dans cette
situation, la question est indtermine. Si, par une sorte d'extrapolation
discutable, Parfit accorde aux puzzling cases un rle si minent, c'est
parce que ceux-ci dis-
socient les composantes que dans la vie quotidienne nous tenons pour
indissociables et dont nous tenons mme la liaison pour non contingente,
savoir le recouvrement entre la connexion psychologique (et
ventuellement corporelle), qui peut la rigueur relever d'une
description impersonnelle, et le sentiment d'appartenance - en
particulier des souvenirs - quelqu'un capable de se dsigner lui-mme
comme leur possesseur. Ce sera une des fonctions de la comparaison
ultrieure entre science-fiction et fiction littraire de remettre sur le
chantier la question de la contingence prsume des traits les plus
fondamentaux de la condition humaine. Parmi ceux-ci, il en est au
moins un qui, dans les expriences imaginaires de tltransportation,
parat indpassable, savoir la temporalit, non du voyage, mais du
voyageur tltransport. Tant que l'on considre seulement l'adquation
de la rplique au cerveau rdupliqu, seule compte l'identit de struc-
ture, comparable celle du code gntique, prserv tout au long de
l'exprience
1
. Quant moi qui suis tltransport, il ne cesse de
m'arriver quelque chose : je crains, je crois, je doute, je me demande si je
vais mourir ou survivre, bref, je me soucie. A cet gard, le glissement de
la discussion des problmes de mmoire aux problmes de survie*
marque l'entre en scne d'une dimension d'historicit dont il parat bien
difficile de faire une description impersonnelle.
La troisime croyance que Parfit soumet sa critique froce concerne
le jugement d'importance que nous attachons la question de l'identit.
J'ai dj cit le mot fameux : Identity is not what matters. Le lien de
la croyance ici attaque la croyance prcdente est le suivant : si
l'indcidabilit nous semble inacceptable, c'est parce qu'elle nous trouble
; cela est clair dans tous les cas bizarres o la survie est en jeu : que
va-t-il m'arriver, me demand-je ? Or, si nous sommes troubls, c'est
parce que le juge-
1. Encore que l'on puisse objecter la construction mme du cas imaginaire
que, si la rplique de mon cerveau tait une rplique intgrale, elle devrait conte-
nir, outre les traces de mon histoire passe, la marque de mon histoire venir tis-
se de rencontres alatoires ; or cette condition parat bien violer les rgies du
concevable : ds la sparation entre moi et ma rplique, nos histoires nous dis-
tinguent et nous rendent insubstituables. La notion mme de rplique risque de
perdre tout sens.
2. Sur le problme de la survie, au sens de la persistance dans le futur au terme
d'une preuve d'altration radicale de l'identit personnelle, cf. in J. Perry (d.),
Personal Identity, op. cit., la section V : Personal Identity and Survival (articles
de B. Williams et de D. Parfit), p. 179-223 ; in A.O. Rorty (d.), TheIdentities of
Persons. op. cit., les articles de D. Lewis, Survival and identity, p. 18-40, et
G. Rey, Survival , p. 41-66.
162
163
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
ment d'identit nous parat important. Si nous renonons ce
jugement d'importance, nous cessons d'tre troubls. Mis en face
des options ouvertes par les puzzling cases, nous sommes prts
concder que nous savons tout ce qu'il est possible de savoir sur le
cas en question et arrter l l'enqute : sachant cela, nous savons
tout (ibid.. p. 261).
Cette attaque contre le jugement d'importance occupe en fait dans
l'ouvrage entier de Parfit une position stratgique centrale. On a en
effet nglig de dire que le problme de l'identit discut dans la
troisime partie du livre est destin rsoudre un problme moral
pos dans les deux parties prcdentes, savoir le problme de la
rationalit du choix thique pos par la morale utilitariste
prdominante dans le monde de langue anglaise. Parfit en attaque la
version la plus goste qu'il dnomme thorie de l'intrt propre
(self-interest theoryy. C'est bien le soi dans sa dimension thique
qui est ici en jeu. La thse de Parfit est que la dispute entre gosme
et altruisme ne peut tre tranche au plan o elle se droule, si l'on
n'a pas d'abord pris position sur la question de savoir quelle sorte
d'entits sont les personnes (d'o le titre de l'ouvrage Reasons and
Persons). Les raisons valables du choix thique passent par la
dissolution des croyances fausses sur le statut ontologique des
personnes. C'est donc la question pose par la premire partie que
nous revenons au terme de la troisime. En retour, c'est tout le poids
des questions thiques du dbut qui retombe sur la question de
l'identit. Celle-ci devient un enjeu proprement axiologique ; le
jugement d'importance est un jugement qui donne rang dans la
hirarchie des estimations. Mais quelle identit - l'identit en
quel sens du terme - est-il demand de renoncer ? Est-ce la
mmet que Hume tenait dj pour introuvable et peu digne
d'intrt ? Ou la miennet qui, selon moi, constitue le noyau de la
thse non rductionniste ? En vrit, tout porte penser que Parfit,
la faveur de l'indistinction entre ipsit et mmet, vise la premire
travers la seconde. Ce qui est loin d'tre inintressant : car la sorte
de bouddhisme que la thse morale de Parfit insinue consiste
prcisment ne pas faire la diffrence entre mmet et miennet.
Ce faisant, ne risque-t-il pas de vider l'enfant avec l'eau du bain ?
Car, autant je suis prt admettre que les variations Imaginatives
sur l'identit
1. Parfit la rsume dans ces termes : A chaque personne [la thorie] S donne
pour but les aboutissements qui seraient les meilleurs pour lui et qui assureraient
sa vie le cours le meilleur possible pour lui (Reasons and Persons. op. cit.. p. 3
[trad. de l'auteur]).
L'IDENTIT PERSONNELLE ET L'IDENTIT NARRATIVE
personnelle conduisent une crise de l'ipsit elle-mme - et les cas
bizarres d'ordre narratif que nous considrerons plus loin le
confirmeront l'envi -, autant je ne vois pas comment la question
qui ? peut disparatre dans les cas extrmes o elle reste sans
rponse. Car enfin, comment s'interrogerait-on sur ce qui importe si
l'on ne pouvait demander qui la chose importe ou non ? L'in-
terrogation portant sur ce qui importe ou non ne relve-t-elle pas du
souci de soi, qui parat bien constitutif de l'ipsit ? Et, si l'on
remonte du troisime niveau au second, puis au premier niveau des
croyances passes au crible de la critique, ne continue-t-on pas de se
mouvoir dans l'lment de la croyance, de la croyance concernant ce
que nous sommes ? La tnacit des pronoms personnels, jusque
dans l'nonc de la thse rductionniste dont nous sommes partis,
trahit beaucoup plus que la rhtorique de l'argumentation : elle
marque la rsistance de la question qui ? son limination dans une
description impersonnelle
1
.
Ce dont il s'agit en dernier ressort, c'est de changer la conception
que nous faisons de nous-mmes et de notre vie effective (ibid..
p. 217). C'est notre manire de voir [our view] la vie qui est en
cause.
On objectera ici mon plaidoyer en faveur de l'irrductibilit du
trait de miennet, et, par implication, de la question mme de
l'ipsit, que le quasi-bouddhisme de Parfit ne laisse pas intacte
l'assertion mme d'ipsit. Ce que Parfit demande, c'est que nous
nous souciions moins de nous-mme, entre autres de notre vieil-
lissement et de notre mort ; que nous attachions moins d'importance
la question de savoir si telles ou telles expriences proviennent
de mmes vies ou de vies diffrentes (ibid.. p. 341) : donc que nous
nous intressions aux expriences elles-mmes plutt qu' la
personne qui les a (ibid.) ; que nous fassions moins de diffrences
entre nous-mme des poques diffrentes de notre vie et autrui
ayant des expriences semblables aux ntres ; que nous ignorions le
plus possible les frontires entre les vies en donnant moins
d'importance l'unit de chaque vie ; que nous fassions de l'unit
mme de notre vie davantage une uvre d'art qu'une revendication
d'indpendance... N'est-ce pas la
1. Il faudrait pouvoir citer en entier les conclusions provisoires des pages
216-217 du livre de Parfit o il n'est question que de nos cerveaux , nos penses
et nos actions . notre identit . La substitution des dictiques autres que les pro-
noms et adjectifs personnels ( le cerveau de cette personne , ces expriences )
ne change rien l'affaire, vu la constitution des dictiques. A cet gard, l'expres-
sion la plus tonnante est celle qui rsume toute la thse : Ma thse [est] que nous
pourrions dcrire nos vies de manire impersonnelle (ibid.. p. 217).
164
165
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
neutralisation mme de la question de l'ipsit, par-del l'obser-
vation impersonnelle de l'enchanement d'une vie, que Parfit
moraliste invite ? N'est-ce pas Vinsouciance - prche aussi, aprs
tout, par Jsus dans le Sermon sur la montagne - que Parfit oppose
au souci ? J'entends bien l'objection. Mais je crois qu'elle peut tre
incorpore la dfense de l'ipsit face sa rduction la mmet.
Ce que la rflexion morale de Parfit provoque, c'est finalement une
crise interne l'ipsit. La crise consiste en ceci que la notion mme
d'appartenance de mes expriences moi-mme a un sens ambigu ;
il y a possession et possession. Ce que Parfit vise, c'est prcisment
l'gotisme qui nourrit la thse de l'intrt propre contre laquelle son
ouvrage est dirig. Mais un moment de dpossession de soi n'est-il
pas essentiel l'authentique ipsit ? Et ne faut-il pas, pour se rendre
disponible, s'appartenir en quelque faon ? Nous l'avons demand :
la question d'importance se poserait-elle s'il ne restait pas quelqu'un
qui la question de son identit cesse d'importer ? Ajoutons
maintenant : si mon identit perdait toute importance tous gards,
celle d'au-trui ne deviendrait-elle pas, elle aussi, sans importance ' ?
Nous retrouverons ces mmes questions au terme de notre plai-
doyer en faveur d'une interprtation narrative de l'identit ; celle-ci,
on va le voir, a aussi ses cas bizarres qui ramnent l'assertion de
l'identit son statut de question - et parfois de question sans
rponse : qui suis-je en vrit ? C'est en ce point que la thorie
narrative, sollicite de s'affronter aux interrogations de Parfit, sera
invite, elle aussi, explorer sa frontire commune avec la thorie
thique.
1. Sur la parent entre les thses de Parft et le bouddhisme, cf. D. Parfit,
Rea-sons and Persons, op. cit., p. 280 ; et M. Kapstein, Collins, Parfit and the
pro-blem of Personal identity in two philosophical traditions - A review of
selfless persons , FeatureBook Review (tir part).
SIXIME TUDE
Le soi et l'identit narrative
La prsente tude est troitement solidaire de la prcdente. Le
ton en est toutefois diffrent. On n'a trait jusqu'ici de l'identit
narrative que sur un mode polmique et au total plus dfensif que
constructif. Deux tches positives restent accomplir.
La premire est de porter son plus haut degr la dialectique de
la mmet et de l'ipsit, implicitement contenue dans la notion
d'identit narrative.
La seconde est de complter cette investigation du soi racont,
par l'exploration des mdiations que la thorie narrative peut oprer
entre thorie de l'action et thorie morale. Cette seconde tche aura
elle-mme deux versants. Revenant notre ternaire -dcrire,
raconter, prescrire - nous nous demanderons d'abord quelle
extension du champ pratique la fonction narrative suscite, si l'action
dcrite doit pouvoir s'galer l'action raconte. Nous examinerons
ensuite de quelle manire le rcit, jamais thique-ment neutre,
s'avre tre le premier laboratoire du jugement moral. Sur ce
double versant, pratique et thique, de la thorie narrative, se
poursuivra la constitution rciproque de l'action et du soi.
1. L'identit narrative et la dialectique de
l'ipsit et de la mmet
La nature vritable de l'identit narrative ne se rvle, mon avis,
que dans la dialectique de l'ipsit et de la mmet. En ce sens, cette
dernire reprsente la contribution majeure de la thorie narrative
la constitution du soi.
L'ordre suivi par l'argument sera le suivant :
1. On montrera d'abord, dans le prolongement des analyses de
Temps et Rcit, comment le modle spcifique de connexion entre
vnements que constitue la mise en intrigue permet d'int-
167
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
grer la permanence dans le temps ce qui parat en tre le contraire
sous le rgime de l'identit-mmet, savoir la diversit, la
variabilit, la discontinuit, l'instabilit.
2. On montrera ensuite comment la notion de mise en intrigue,
transpose de l'action aux personnages du rcit, engendre la dia-
lectique du personnage qui est trs expressment une dialectique de
la mmet et de l'ipsit ; revenant, cette occasion, sur la stratgie
des puzzling cases de la philosophie analytique, on fera place, dans
l'espace de variations imaginatives ouvert par la dialectique de
l'ipsit et de la mmet, des cas limites de dissociation entre deux
modalits d'identit, dignes d'entrer en comptition avec les cas
indcidables de Parfit ; une occasion remarquable sera ainsi offerte
de confronter les ressources respectives de la fiction littraire et de
la science-fiction face au caractre minemment problmatique de
l'identit personnelle.
1. Lorsque Dilthey formait le concept de Zusammenhang des
Lebens, de connexion de la vie, il le tenait spontanment pour
quivalent celui d'histoire d'une vie. C'est cette prcomprhension
de la signification historique de la connexion que tente d'articuler,
un niveau suprieur de conceptualit. la thorie narrative de
l'identit personnelle. L'identit, narrativement comprise, peut tre
appele, par convention de langage, identit du personnage. C'est
cette identit que l'on replacera plus loin dans le champ de la
dialectique du mme et du soi. Mais, auparavant, on montrera
comment l'identit du personnage se construit en liaison avec celle
de l'intrigue. Cette drivation d'une identit l'autre, seulement
indique dans Temps et Rcit, sera ici explicite.
Rappelons d'abord ce que dans Temps et Rcit on entend par
identit au plan de la mise en intrigue. On la caractrise, en termes
dynamiques, par la concurrence entre une exigence de concordance
et l'admission de discordances qui, jusqu' la clture du rcit,
mettent en pril cette identit. Par concordance, j'entends le principe
d'ordre qui prside ce qu'Aristote appelle agencement des faits .
Par discordance, j'entends les renversements de fortune qui font de
l'intrigue une transformation rgle, depuis une situation initiale
jusqu' une situation terminale. J'applique le terme de configuration
cet art de la composition qui fait mdiation entre concordance et
discordance. Afin d'tendre la validit de ce concept de
configuration narrative au-del de l'exemple privilgi d'Aristote -
la tragdie grecque et, un moindre degr, l'pope -, je propose de
dfinir la concordance
discordante, caractristique de toute composition narrative, par la
notion de synthse de l'htrogne. Par l, je tente de rendre compte
des diverses mdiations que l'intrigue opre - entre le divers des
vnements et l'unit temporelle de l'histoire raconte ; entre les
composantes disparates de l'action, intentions, causes et hasards, et
l'enchanement de l'histoire ; enfin, entre la pure succession et
l'unit de la forme temporelle -, mdiations qui, la limite, peuvent
bouleverser la chronologie au point de l'abolir. Ces multiples
dialectiques ne font qu'expliciter l'opposition, prsente dj dans le
modle tragique selon Aristote, entre la dispersion pisodique du
rcit et la puissance d'unification dploye par l'acte configurant
qu'est la poisis elle-mme.
C'est la configuration narrative ainsi comprise qu'il faut
comparer la sorte de connexion revendique par une description
impersonnelle. La diffrence essentielle qui distingue le modle
narratif de tout autre modle de connexion rside dans le statut de
Vvnement, dont nous avons fait plusieurs reprises la pierre de
touche de l'analyse du soi '. Alors que, dans un modle de type
causal, vnement et occurrence restent indiscernables, l'vnement
narratif est dfini par son rapport l'opration mme de
configuration ; il participe de la structure instable de concordance
discordante caractristique de l'intrigue elle-mme ; il est source de
discordance, en tant qu'il surgit, et source de concordance, en ce
qu'il fait avancer l'histoire
2
. Le paradoxe de la mise en intrigue est
qu'elle inverse l'effet de contingence, au sens de ce qui aurait pu
arriver autrement ou ne pas arriver du tout, en l'incorporant en
quelque faon l'effet de ncessit ou de probabilit, exerc
1. Cf. la discussion de Davidson dans la troisime tude et celle de Parfit dans
la cinquime tude. Je ne conteste pas l'acquis de ces thories, savoir, ni que
l'vnement, en tant qu'occurrence, ait droit un statut ontologique au moins gal
celui de la substance, ni qu'il puisse faire l'objet d'une description imper-
sonnelle. Je dis qu'en entrant dans le mouvement d'un rcit qui conjoint un per-
sonnage une intrigue, l'vnement perd sa neutralit impersonnelle. Du mme
coup, le statut narratif confr l'vnement prvient la drive de la notion d'v-
nement, qui rendrait difficile, sinon impossible, la prise en compte de l'agent dans
la description de l'action.
2. Je retrouve ici quelque chose de VUrsprung selon Walter Benjamin, dont le
surgissement ne se laisse pas rduire ce qui est d'ordinaire entendu par
Ent-stehung, et encore moins par Entwicklung. Or, aussi incoordonnable un tout
que soit le surgissement de l'vnement narratif, il ne s'puise pas dans son effet
de rupture, de csure ; il comporte des potentialits de dveloppement qui
demandent tre sauves . Cette Rettung de VUrsprung - thme central chez
Benjamin -, c'est, selon moi, l'intrigue qui l'opre. L'intrigue rachte l'origine
de la chute dans l'insignifiance. Cf. Jeanne-Marie Gagnebin, Histoire,
mmoire et oubli chez Walter Benjamin (indit).
168
169
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
par l'acte configurant '. L'inversion de l'effet de contingence en effet de
ncessit se produit au cur mme de l'vnement : en tant que simple
occurrence, ce dernier se borne mettre en dfaut les attentes cres par
le cours antrieur des vnements ; il est simplement l'inattendu, le
surprenant, il ne devient partie intgrante de l'histoire que compris
aprs coup, une fois transfigur par la ncessit en quelque sorte
rtrograde qui procde de la totalit temporelle mene son terme. Or
cette ncessit est une ncessit narrative dont l'effet de sens procde de
l'acte configurant en tant que tel ; c'est cette ncessit narrative qui
transmue la contingence physique, adverse de la ncessit physique, en
contingence narrative, implique dans la ncessit narrative.
De ce simple rappel de la notion de mise en intrigue, et avant toute
considration de la dialectique du personnage qui en est le corollaire, il
ressort que l'opration narrative dveloppe un concept tout fait
original d'identit dynamique, qui concilie les catgories mmes que
Locke tenait pour contraires l'une l'autre : l'identit et la diversit.
Le pas dcisif en direction d'une conception narrative de l'identit
personnelle est fait lorsque l'on passe de l'action au personnage. Est
personnage celui qui fait l'action dans le rcit. La catgorie du
personnage est donc elle aussi une catgorie narrative et son rle dans le
rcit relve de la mme intelligence narrative que l'intrigue elle-mme.
La question est alors de savoir ce que la catgorie narrative du
personnage apporte la discussion de l'identit personnelle. La thse ici
soutenue sera que l'identit du personnage se comprend par transfert sur
lui de l'opration de mise en intrigue d'abord applique l'action raconte
; le personnage, dirons-nous, est lui-mme mis en intrigue.
Rappelons brivement de quelle manire la thorie narrative rend
compte de la corrlation entre action et personnage.
La corrlation entre histoire raconte et personnage est simplement
postule par Aristote dans la Potique. Elle y parat mme si troite qu'elle
prend la forme d'une subordination. C'est en effet dans l'histoire
raconte, avec ses caractres d'unit, d'articulation interne et de
compltude, confrs par l'opration de mise en intrigue, que le
personnage conserve tout au long de l'histoire une identit corrlative de
celle de l'histoire elle-mme
2
.
1. Sur la ncessit ou la probabilit attache par Aristote au muthosde la trag-
die ou de l'pope, cf. les textes d'Aristote cits dans Temps et Rcit, 1.1, op. cit.,
p. 69-70.
2. J'ai comment dans Temps et Rcit I ce primat de la mise en intrigue
(muthos) sur le personnage (p. 64). Dans la squence des six parties de la trag-
LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
La narratologie contemporaine a tent de donner cette corrlation le
statut de contrainte smiotique, implicite en un sens l'analyse
conceptuelle du muthos en parties par Aristote. Propp a donn le
branle cette investigation un niveau d'abstraction que je discute
dans Temps et Rcit et sur lequel je ne reviens pas ici
l
. L'auteur de
Morphologie du conte
1
commence par dissocier les fonctions ,
savoir les segments rcurrents d'action, des personnages, afin de dfinir
le conte par le seul enchanement des fonctions. Mais, au moment de
ressaisir l'unit synthtique de la chane, il doit prendre en compte le
rle jou par les personnages. Ainsi est-il le premier tenter une
typologie de ces rles tablie sur la seule base de leur rcurrence
3
. Or la
liste des rles n'est pas indpendante de celle des fonctions ; elles se
croisent en plusieurs points que Propp appelle les sphres d'action :
De nombreuses fonctions se groupent logiquement selon certaines
sphres. Ces sphres correspondent aux personnages qui accomplissent
les fonctions (Morphologie du Conte, p. 96). Le problme de la
distribution des fonctions peut tre rsolu, au niveau du problme de la
distribution des sphres d'action entre les personnages (ibid., p. 97).
Citant ces dclarations de Propp dans Temps et Rcit II, p. 60-61, je
pose la question de savoir si toute mise en intrigue ne procde pas
d'une gense mutuelle entre le dveloppement d'un caractre et celui
d'une histoire raconte. J'adopte l'axiome nonc par Frank Kermode
die selon Aristote, l'intrigue vient en tte avant les caractres et la pense
(dia-noia), qui, avec l'intrigue, constituent le quoi de l'imitation de l'action.
Aristote pousse la subordination jusqu' dclarer: la tragdie est reprsentative
[mimsis] non d'hommes, mais d'action, de vie et de bonheur (le malheur rside
aussi dans l'action), et le but vis est une action, non une qualit (...) De plus, sans
action, il ne saurait y avoir de tragdie, tandis qu'il pourrait y en avoir sans carac-
tres (Aristote, La Potique, texte, trad. et notes par R. Dupont-Roc et J. Lallot,
Paris, Ed. du Seuil, 1980, Vil, 1450 a 16-24). Cette dernire hypothse nous arr-
tera plus loin, quand nous voquerons la disparition du personnage dans une partie
de la production romanesque contemporaine.
1. Dans Temps et Rcit II, je suis soucieux de souligner la filiation de sens entre
Y intelligencenarrative, immanente la comptence du spectateur, de l'auditeur
ou du lecteur, et la rationalitnarratologique que je tiens pour drive de la pre-
mire. Ce problme de prminence ne me concerne pas ici. Je cherche plutt
dans la narratologie une confirmation de la prcomprhension que nous avons au
niveau de l'intelligence narrative, de la coordination entre intrigue et personnage.
2. Trad. fr. de M. Derrida, T. Todorov et C. Kahn, Paris, Ed. du Seuil, coll.
Points, 1965 et 1970.
3. Je rappelle la liste de Propp : l'agresseur, le donateur (ou pourvoyeur), l'auxi-
liaire, la personne recherche, le mandateur, le hros, le faux hros. Cf. Temps et
Rcit, t. H, Paris, d. du Seuil, 1984, p. 60.
170 171
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
selon lequel, pour dvelopper un caractre, il faut raconter plus '.
C'est ce qu'a parfaitement mis en relief Claude Bremond dans sa
Logique du rcit
2
; pour lui, le rle ne saurait tre dfini que par
l'attribution un sujet-personne d'un prdicat-processus ventuel,
en acte, ou achev (p. 134). On peut voir dans cette attribution la
solution narrative, discute dans les tudes prcdentes, du
problme de l'ascription de l'action l'agent. La squence
lmentaire d'un rcit contient dj cette corrlation. En outre, la
rfrence, dans la dfinition mme du rle, aux trois stades de
l'ventualit, du passage ou non l'acte, de l'achvement ou de
l'inachvement, situe d'emble le rle dans un dynamisme d'action.
Sur la base de cette dfinition de la squence lmentaire, il devient
possible de composer un rpertoire aussi complet que possible des
rles, en tenant compte d'une srie d'enrichissements portant la
fois sur le sujet-personne et sur le prdicat-processus. Il est
remarquable que la premire grande dichotomie soit celle des
patients, affects par des processus modificateurs ou conservateurs,
et, par corrlation, des agents initiateurs de ces processus. Ainsi est
prise en compte la prcomprhension que nous avons que les rcits
sont au sujet d'agents et de patients. Pour ma part, je n'omets jamais
de parler de l'homme agissant et souffrant. Le problme moral, on le
dira assez plus loin, se greffe sur la reconnaissance de cette
dissymtrie essentielle entre celui qui fait et celui qui subit,
culminant dans la violence de l'agent puissant. tre affect par un
cours d'vnements raconts, voil le principe organisateur de toute
une srie de rles de patients, selon que l'action exerce est une
influence, une amlioration ou une dtrioration, une protection ou
une frustration. Un enrichissement remarquable de la notion de rle
concerne l'introduction de ce dernier dans le champ des valorisa-
tions par le biais des transformations qu'on vient de dire, puis dans
celui des rtributions, o le patient apparat bnficiaire de mrites
ou victime de dmrites, selon que l'agent se rvle paralllement
distributeur de rcompenses et de punitions. Bremond note avec
raison que c'est ces stades seulement qu'agents et patients se
trouvent levs au rang de personnes et d'initiateurs d'action. Ainsi
vient s'attester au plan narratif, par le biais des rles relevant du
champ des valorisations et de celui des rtribu-
1. F. Kermode, Thegenesis ofsecrecy, on theinterprtation of narrative, Cam-
bridge, Harvard University Press, 1979, p. 75-99.
2. Claude Bremond, Logiquedu rcit, Paris, d. du Seuil, 1973.
LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
tions, la connexion troite entre thorie de l'action et thorie thique
que l'on considrera plus loin.
C'est avec le modle actantiel de Greimas que la corrlation entre
intrigue et personnage est porte son niveau le plus lev de
radicalit, antrieurement toute figuration sensible. C'est pourquoi
on ne parle pas ici de personnage mais cactant, afin de subordonner
la reprsentation anthropomorphique de l'agent sa position
d'oprateur d'actions sur le parcours narratif. La radica-lisation se
poursuit sur deux lignes : du ct de l'actant, du ct du parcours
narratif. Sur la premire ligne, la liste encore empirique des
personnages du conte russe selon Propp est substitu un modle
tabli sur la base de trois catgories : de dsir (principe de la qute
d'un objet, d'une personne, d'une valeur), de communication
(principe de tout rapport de destinateur destinataire), d'action
proprement dite (principe de toute opposition entre adjuvants et
opposants). Voil donc un modle o, l'inverse de Propp, on
procde des relations possibles entre actants en direction de la riche
combinatoire des actions, que celles-ci s'appellent contrats,
preuves, qutes, luttes. Sur la seconde ligne, celle des parcours
narratifs, j'aimerais insister sur la place qu'occupent un plan
mdian entre structures profondes et plan figuratif une srie de
notions qui n'ont de place que dans une conception narrative de la
cohsion intime de la vie : d'abord celle de programme narratif, puis
celle de relation polmique entre deux programmes, d'o rsulte
l'opposition entre sujet et anti-sujet. Nous retrouvons l ce que nous
avons prcompris au plan de la simple intelligence narrative,
savoir que l'action est interaction, et l'interaction, comptition entre
projets tour tour rivaux et convergents. Ajoutons encore toutes les
translations ou transferts d'objets-valeurs qui narrativisent l'change.
Il faudrait enfin rendre compte de la topologie sous-jacente au
changement de lieux - lieux initiaux et lieux terminaux de
transfert -, partir de quoi il peut tre parl de suite performantielle
1
.
Si l'on recroise les deux lignes de l'analyse que je viens de rsu-
mer grossirement (renvoyant Temps et Rcit II, p. 71-91), on voit
se renforcer mutuellement une smiotique de l'actant et une
smiotique des parcours narratifs, jusqu'au point o ceux-ci
1. Pas plus qu' propos de Propp et de Bremond, je ne reviens, propos de
Greimas. sur les difficults pistmologiques lies l'entreprise de
dchronologi-sation des structures narratives. Encore une fois, je ne m'intresse ici
qu' ce qui lgitime la corrlation entre intrigue et personnage, intuitivement
comprise au plan de la simple intelligence narrative.
172 173
SOI-MME COMME UN AUTRE
LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
apparaissent comme parcours du personnage. J'aimerais insister, pour
conclure sur ce thme de la corrlation ncessaire entre intrigue et
personnage, sur une catgorie que le Maupassant ' de Greimas a
fortement accentue, bien qu'elle ft prsente ds le premier modle
actantiel, savoir celle du destinateur. Le couple destinateur/destinataire
prolonge celui du mandat chez Propp ou du contrat inaugural dans le
premier modle actantiel de Greimas, contrat en vertu duquel le hros
reoit la comptence de faire. Les destinateurs - qui peuvent tre des
entits individuelles. sociales ou mme cosmiques, comme on voit dans
la nouvelle Deux amis - relvent dans le Maupassant de ce que
Greimas appelle un statut proto-actantiel (p. 63)
2
.
11 n'a pas t vain de rappeler de quelle manire la structure narrative
conjoint les deux procs de mise en intrigue, celui de l'action et celui du
personnage. Cette conjonction est la vritable rponse aux apories de
l'ascription voques ds la premire tude. Il reste vrai que, d'un point
de vue paradigmatique, les questions qui ?, quoi ?, comment ?, etc.,
peuvent dsigner les termes discrets du rseau conceptuel de l'action.
Mais, d'un point de vue syntagmatique, les rponses ces questions
forment une chane qui n'est autre que l'enchanement du rcit.
Raconter, c'est dire qui a fait quoi, pourquoi et comment, en talant dans
le temps la connexion entre ces points de vue. Il reste galement vrai
qu'on peut dcrire sparment les prdicats psychiques pris hors
attribution une personne (ce qui est la condition mme de la
description du psychique ). Mais c'est dans le rcit que se recompose
l'attribution. De la mme faon, l'articulation entre intrigue et
personnage permet de mener de front une enqute virtuellement infinie
au plan de la recherche des motifs, et une enqute en principe finie au
pian de l'attribution quelqu'un. Les deux enqutes s'enchevtrent dans
le double procs d'identification de l'intrigue et du personnage. Il n'est
pas jusqu' la plus redoutable aporie de l'ascription qui ne trouve sa
rplique dans la dialectique du personnage et de l'intrigue. Confronte
la troisime antinomie kantienne, l'ascription apparat dchire entre la
thse, qui pose l'ide de commencement d'une srie causale, et
l'antithse, qui lui oppose celle d'un enchanement sans commen-
1. A.J. Greimas, Maupassant : la smiotique du texte, exercices pratiques, Paris,
d. du Seuil, 1976.
2. On trouvera une bonne synthse de l'approche smiotique de la catgorie de
personnage dans P. Hamon, Statut smiologique du personnage , in R. Barthes
et al.. Potique du rcit, Paris, Ed. du Seuil, 1977.
cernent ni interruption. Le rcit rsout sa faon l'antinomie, d'une
part en confrant au personnage une initiative, c'est--dire le pouvoir de
commencer une srie d'vnements, sans que ce commencement
constitue un commencement absolu, un commencement du temps,
d'autre part donnant au narrateur en tant que tel le pouvoir de dterminer
le commencement, le milieu et la fin d'une action. En faisant ainsi
concider l'initiative du personnage et le commencement de l'action, le
rcit donne satisfaction la thse sans violer l'antithse. Il constitue, sous
ses multiples aspects, la rplique potique que la notion d'identit narra-
tive apporte aux apories de l'ascription. Je reprends dessein le terme
de rplique potique appliqu par Temps et Rcit III au rapport entre les
apories du temps et la fonction narrative. Je disais alors que la fonction
narrative ne donnait pas une rponse spculative ces apories, mais les
rendait productives dans un autre registre du langage. C'est de la mme
faon que la dialectique du personnage et de l'intrigue rend productives
les apories de l'ascription et que l'identit narrative peut tre dite leur
apporter une rplique potique.
2. De cette corrlation entre action et personnage du rcit rsulte
une dialectique interne au personnage, qui est l'exact corollaire de la
dialectique de concordance et de discordance dploye par la mise en
intrigue de l'action. La dialectique consiste en ceci que, selon la ligne
de concordance, le personnage tire sa singularit de l'unit de sa vie
considre comme la totalit temporelle elle-mme singulire qui le
distingue de tout autre. Selon la ligne de discordance, cette totalit
temporelle est menace par l'effet de rupture des vnements
imprvisibles qui la ponctuent (rencontres, accidents, etc.) ; la synthse
concordante-discordante fait que la contingence de l'vnement
contribue la ncessit en quelque sorte rtroactive de l'histoire d'une
vie, quoi s'gale l'identit du personnage. Ainsi le hasard est-il trans-
mu en destin. Et l'identit du personnage qu'on peut dire mis en intrigue
ne se laisse comprendre que sous le signe de cette dialectique. La thse de
l'identit que Parfit appelle non rductionniste en reoit plus qu'un
renfort, un complet remaniement. La personne, comprise comme
personnage de rcit, n'est pas une entit distincte de ses expriences .
Bien au contraire : elle partage le rgime de l'identit dynamique propre
l'histoire raconte. Le rcit construit l'identit du personnage, qu'on
peut appeler son identit narrative, en construisant celle de l'histoire
raconte. C'est l'identit de l'histoire qui fait l'identit du personnage.
174 175
SOI-MME COMME UN AUTRE LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
C'est cette dialectique de concordance discordante du personnage
qu'il faut maintenant inscrire dans la dialectique de la mmet et de
l'ipsit. La ncessit de cette rinscription s'impose ds lors que
l'on confronte la concordance discordante du personnage la
requte de permanence dans le temps attache la notion d'identit,
et dont nous avons montr dans la prcdente tude l'quivocit :
d'un ct, disions-nous, la mmet d'un caractre, de l'autre l'ipsit
du maintien de soi. Il s'agit maintenant de montrer comment la
dialectique du personnage vient s'inscrire dans l'intervalle entre ces
deux ples de la permanence dans le temps pour faire mdiation
entre eux.
Cette fonction mdiatrice que l'identit narrative du personnage
exerce entre les ples de la mmet et de l'ipsit est essen-
tiellement atteste par les variations imaginatives auxquelles le
rcit soumet cette identit. A vrai dire, ces variations, le rcit ne fait
pas que les tolrer, il les engendre, il les recherche. En ce sens, le
littrature s'avre consister en un vaste laboratoire pour des
expriences de pense o sont mises l'preuve du rcit les res-
sources de variation de l'identit narrative. Le bnfice de ces
expriences de pense est de rendre manifeste la diffrence entre les
deux significations de la permanence dans le temps, en faisant
varier le rapport de l'une l'autre. Dans l'exprience quotidienne, on
l'a dit, elles tendent se recouvrir et se confondre ; ainsi, compter
sur quelqu'un c'est la fois faire fond sur la stabilit d'un caractre
et s'attendre que l'autre tienne parole, quels que soient les
changements susceptibles d'affecter les dispositions durables quoi
il se laisse reconnatre. Dans la fiction littraire, l'espace de
variations ouvert aux rapports entre les deux modalits d'identit est
immense. A une extrmit, le personnage est un caractre
identifiable et ridentifiable comme mme : c'est peu prs le statut
du personnage des contes de fes et du folklore. Quant au roman
classique - de La Princesse de Clves ou du roman anglais du xvm
c
sicle Dostoevski et Tolsto -, on peut dire qu'il a explor l'espace
intermdiaire de variations o, travers les transformations du
personnage, l'identification du mme dcrot sans disparatre. On se
rapproche du ple inverse avec le roman dit d'apprentissage et, plus
encore, le roman du courant de conscience. Le rapport entre intrigue
et personnage parat alors s'inverser: au contraire du modle
aristotlicien, l'intrigue est mise au service du personnage. C'est
alors que l'identit de ce dernier, chappant au contrle de l'intrigue
et de son principe d'ordre, est mise vritablement l'preuve. On
atteint ainsi le
ple extrme de variation, o le personnage a cess d'tre un
caractre. C'est ce ple que se rencontrent les cas limites o la
fiction littraire se prte une confrontation avec les puzzling cases
de la philosophie analytique. C'est dans cette confrontation que
vient culminer le conflit entre une version narrativiste et une version
non narrativiste de l'identit personnelle.
Que la narrativit ait aussi ses cas droutants, c'est ce que le thtre
et le roman contemporain enseignent l'envi. En premire
approximation, ces cas se laissent dcrire comme des fictions de la
perte d'identit. Avec Robert Musil, par exemple, L'Homme sans
qualits - ou plus exactement sans proprits (ohne Eigenschafteri) -
devient la limite non identifiable, dans un monde, est-il dit, de
qualits (ou de proprits) sans hommes. L'ancrage du nom propre
devient drisoire au point de devenir superftatoire. Le
non-identifiable devient l'innommable. Pour prciser l'enjeu
philosophique de pareille clipse de l'identit du personnage, il
importe de remarquer que, mesure que le rcit s'approche du point
d'annulation du personnage, le roman perd aussi ses qualits
proprement narratives, mme interprtes, comme plus haut, de la
faon la plus flexible et la plus dialectique. A la perte d'identit du
personnage correspond ainsi la perte de la configuration du rcit et en
particulier une crise de la clture du rcit '. Il se fait ainsi un choc en
retour du personnage sur l'intrigue. C'est un mme schisme - pour
parler comme Frank Kermode, dans The Sens ofan Ending
2
- qui
affecte la fois la tradition de l'intrigue mene jusqu' un terme qui
vaut clture, et la tradition du hros identifiable. L'rosion des
paradigmes -Kermode, encore - frappe la fois la figuration du
personnage et la configuration de l'intrigue ; ainsi, dans le cas de
Robert Musil, la dcomposition de la forme narrative, parallle la
perte d'identit du personnage, fait franchir les bornes du rcit et
attire l'uvre littraire dans le voisinage de l'essai. Ce n'est pas non
plus par hasard si maintes autobiographies contemporaines, celle de
Leiris, par exemple, s'loignent dlibrment de la forme narrative et
rejoignent, elles aussi, le genre littraire le moins configur, l'essai
prcisment.
Mais que signifie ici perte d'identit? Plus exactement de quelle
modalit de l'identit s'agit-il ? Ma thse est que, replacs dans le
cadre de la dialectique de Yidem et de Vipse, ces cas drou-
1. Sur cette crise de la clture, cf. Temps et Rcit, t. III, op. cit., p. 35-48.
2. F. Kermode, The Sensof an Ending, Studies in the Theory of Fiction,
Londres, Oxford, New York, Oxford University Press, 1966.
176 177
SOI-MME COMME UN AUTRE
tants de la narrativit se laissent rinterprter comme mise nu de
l'ipsit par perte de support de la mmet. C'est en ce sens qu'ils
constituent le ple oppos celui du hros identifiable par
superposition de l'ipsit et de la mmet. Ce qui est maintenant
perdu, sous le titre de proprit , c'est ce qui permettait d'galer le
personnage son caractre.
Mais qu'est-ce que l'ipsit, quand elle a perdu le support de la
mmet ? C'est ce que la comparaison avec les puzzling cases de
Parfit va permettre de prciser.
Les fictions littraires diffrent fondamentalement des fictions
technologiques en ce qu'elles restent des variations Imaginatives
autour d'un invariant, la condition corporelle vcue comme
mdiation existentielle entre soi et le monde. Les personnages de
thtre et de roman sont des humains comme nous. Dans la mesure
o le corps propre est une dimension du soi, les variations
imaginatives autour de la condition corporelle sont des variations
sur le soi et son ipsit. En outre, en vertu de la fonction mdiatrice
du corps propre dans la structure de l'tre dans le monde, le trait
d'ipsit de la corporit s'tend celle du monde en tant que
corporellement habit. Ce trait qualifie la condition terrestre en tant
que telle et donne la Terre la signification existentiale que, sous
des guises diverses, Nietzsche, Husserl et Heidegger lui
reconnaissent. La Terre est ici plus et autre chose qu'une plante :
c'est le nom mythique de notre ancrage corporel dans le monde.
Voil ce qui est ultimement prsuppos par le rcit littraire en tant
que soumis la contrainte qui en fait une mimsis de l'action. Car
l'action imite , dans et par la fiction, reste elle aussi soumise la
contrainte de la condition corporelle et terrestre.
Or ce que les puzzling cases frappent de plein fouet d'une
contingence radicale, c'est cette condition corporelle et terrestre que
l'hermneutique de l'existence, sous-jacente la notion de l'agir et
du souffrir, tient pour indpassable. Et quel est l'oprateur de cette
inversion de sens par quoi l'invariant existential devient la variable
d'un nouveau montage imaginaire ? C'est la technique ; mieux :
par-del la technique disponible, la technique concevable, bref le
rve technologique. Selon ce rve, le cerveau est tenu pour
l'quivalent substituable de la personne. C'est le cerveau qui est le
point d'application de la haute technologie. Dans les expriences de
bissection, de transplantation, de rduplication, de tltransport, le
cerveau figure l'tre humain en tant que manipulable. C'est de ce
rve technologique, illustr par les manipulations crbrales, que se
rend solidaire le traitement
LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
impersonnel de l'identit au plan conceptuel. En ce sens, on peut
dire que les variations imaginatives de la science-fiction sont des
variations relatives la mmet, tandis que celle de la fiction lit-
traire sont relatives l'ipsit, ou plus exactement l'ipsit dans
son rapport dialectique la mmet.
La vritable perplexit, ds lors, ne rside pas l'intrieur de l'un ou
l'autre champ de variations imaginatives, mais, si l'on peut dire, entre
l'un et l'autre. Sommes-nous capables, je ne dis pas d'effectuer, mais
de concevoir des variations telles que la condition corporelle et
terrestre elle-mme devienne une simple variable, une variable
contingente, si l'individu tltransport ne transporte pas avec lui
quelques traits rsiduels de cette condition, sans lesquels il ne
pourrait tre dit ni agir ni souffrir - ne serait-ce que la question qu'il
se pose de savoir s'il va survivre ? Peut-tre cette perplexit de
second degr ne peut-elle pas tre tranche au plan de l'imaginaire
mis contribution de part et d'autre. Elle ne peut l'tre qu'au plan
thique auquel nous viendrons dans la dernire section de cette
tude, lorsque nous confronterons l'identit narrative, oscillant entre
mmet et ipsit, et l'identit thique, laquelle requiert une
personne comptable de ses actes. C'est par rapport cette capacit
d'imputation que des manipulations crbrales peuvent tre dites
porter atteinte l'identit personnelle et donc violer un droit, celui de
la personne son intgrit physique. Mais, pour que la capacit
d'imputation, dont la signification est purement morale et juridique,
ne soit pas arbitrairement assigne aux personnes, ne faut-il pas que
l'invariant existential de la corporit et de la mondanit, autour
duquel tournent les variations imaginatives de la fiction littraire,
soit lui-mme tenu pour indpassable un plan ontologique? Ce que
les manipulations imaginaires sur le cerveau violent, n'est-ce pas
plus qu'une rgle, plus qu'une loi, savoir la condition existentiale de
possibilit pour qu'il y ait des rgles, des lois, c'est--dire finalement
des prceptes adresss la personne comme agissant et souffrant ?
Autrement dit : l'inviolable, n'est-ce pas la diffrence entre le soi et le
mme, ds le plan de la corporit ?
Je laisse en l'tat de suspens ce que je viens d'appeler perplexit
de deuxime degr. Car, si un imaginaire qui respecte l'invariant de
la condition corporelle et terrestre a plus d'affinit avec le principe
moral de l'imputation, une censure de l'autre imaginaire, celui qui
frappe de contingence cet invariant mme, ne serait-elle pas son
tour immorale un autre point de vue, en
178
179
SOI-MMECOMMEUNAUTRE LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
tant qu'interdiction de rver ? Il faudra sans doute interdire un jour
de faire ce quoi la science-fiction se borne rver. Mais le rve
n'a-t-il pas toujours t transgression de l'interdit ? Rvons donc
avec Parfit. Mais souhaitons seulement que jamais les
chirurgiens-manipulateurs de ces rves n'aient les moyens, ni sur-
tout le droit de faire ce qu'il reste parfaitement licite d'imaginer '.
2. Entre dcrire et prescrire : raconter
Il reste justifier dans la seconde section de ce parcours l'asser-
tion avance ds l'introduction gnrale, et reprise au dbut de la
cinquime tude, selon laquelle la thorie narrative occupe dans le
parcours complet de notre investigation une position charnire entre
la thorie de l'action et la thorie thique. En quel sens, donc, est-il
lgitime de voir dans la thorie de l'intrigue et du personnage une
transition significative entre l'ascription de l'action un agent qui
peut, et son imputation un agent qui doit ?
La question, cela est clair, a deux versants ; sur le premier, qui
regarde vers les tudes logico-pratiques prcdentes, il importe
de montrer dans quelle mesure la connexion, rvle par la thorie
narrative, entre intrigue et personnage, outre l'clairage nouveau
qu'elle jette sur les difficults attaches au rapport de l'action son
agent, appelle une extension considrable du champ pratique, si
l'action dcrite doit pouvoir s'galer l'action raconte. Sur le
second versant, qui regarde vers les tudes morales qui suivent,
la question est celle des appuis et des anticipations que la thorie
narrative propose l'interrogation thique. Le rapport de l'intrigue
au personnage n'apporte des lumires nouvelles sur le rapport entre
l'action et son agent qu'au prix d'une extension du champ pratique,
au-del des segments d'action que la grammaire logique inscrit le
plus aisment dans des phrases d'action, et mme au-del des
chanes d'action dont le seul intrt rside dans le mode de
connexion logique relevant d'une praxologie. Il est remarquable
qu'Aristote, qui nous devons la dfinition de la tragdie comme
imitation d'action, entend par action un assemblage (sustasis,
sunthsis) d'incidents,
1. Mon dernier mot concernant Parfit n'est pas encore dit. On se demandera
plus loin si une certaine convergence entre les fictions littraires que j'assigne
l'ipsit et celles de la science-fiction qui, selon moi, n'affectent que la mmet ne
se reconstitue pas lorsque l'on prend en compte les implications thiques de la
narrativit ; il y a peut-tre, pour nous aussi, une manire de dire : l'identit n'est
pas ce qui importe.
de faits, d'une nature telle qu'ils puissent se plier la configuration
narrative. Il prcise : Le plus important de ces lments [de la
tragdie] est l'agencement des faits en systme. En effet la tragdie
est reprsentation [mimsis] non d'hommes mais d'action, de vie
[bion] et de bonheur (le malheur aussi rside dans l'action), et le but
vis [tlos] est une action [praxis tis], non une qualit [ou poiots] ;
or, c'est d'aprs leur caractre que les hommes ont telle ou telle
qualit, mais d'aprs leurs actions qu'ils sont heureux ou l'inverse .
On ne saurait mieux dire qu'une rvision du rapport entre action et
agent exige en outre une rvision du concept mme d'action, s'il doit
pouvoir tre port au niveau de la configuration narrative dploye
l'chelle d'une vie.
Par rvision, il faut entendre bien plus qu'un allongement des
connexions entre les segments d'action mis en forme par la gram-
maire des phrases d'action. Il faut faire paratre une hirarchie
d'units praxiques qui, chacune son niveau, comporte un principe
d'organisation spcifique intgrant une diversit de connexions
logiques.
1. Les premires units composes sont celles qui mritent le
nom de pratiques (en franais, la forme verbale pratiquer
-pratiquer un sport, la mdecine, etc. - est plus usite que la forme
nominale que j'adopte ici sur le modle du terme anglais prac-tice).
Les exemples les plus familiers en sont les mtiers, les arts, les
jeux
2
. On peut se faire une premire ide de ce que sont les pratiques
en partant de la description des actions de base dans la thorie
analytique de l'action. On se souvient que Danto dfinit celle-ci en
soustrayant des actions ordinaires la relation en vue de . Restent
des actions de base, savoir ces actions que nous savons faire et que
nous faisons en effet, sans avoir faire une autre chose en vue de
faire ce que nous faisons ; tels sont en gros les gestes, les postures,
les actions corporelles lmentaires, que nous apprenons certes
coordonner et matriser, mais dont nous n'apprenons pas
vritablement les rudiments. Par contraste, tout le reste du champ
pratique est construit sur la relation en vue de : pour faire Y, il
faut d'abord faire X. Nous faisons arriver Y en nous procurant X. On
pourrait alors objecter l'introduction du concept de pratique qu'il
est superflu. Ne suffit-il pas,
1. Aristote, La Potique, op. cit., VI, 1450 a 7,15-19.
2. On montrera au chapitre suivant en quel sens le choix, conforme celui fait
par Aristote, de ces premires units de compte de la praxis s'accorde sa version
tlologique de l'thique.
180 181
OI-MME COMME UN AUTRE LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
pour galer le concept d'action celui de praxis, d'une part d'allonger les
chanes de moyens et de fins, comme le fait E. Ans-combe dans
l'exemple fameux d'Intention considr plus haut, d'autre part de
coordonner entre eux les segments de causalit physique et les
segments intentionnels, formaliss en syllogismes pratiques, l'intrieur
d'un modle mixte, celui par exemple que propose G. Von Wright dans
Explanation and Understanding
1
? On obtiendrait alors de longues
chanes d'action o le passage du point de vue systmique au point de
vue tlologique serait assur en chaque point de la chane par le fait
que l'agent est capable de tenir des effets de causalit pour des
circonstances de dcision, tandis qu'en retour les rsultats voulus ou
non voulus des actions intentionnelles deviennent de nouveaux tats
de choses entranant de nouvelles chanes causales. Cet enchevtrement
de la finalit et de la causalit, de l'intentionnalit et des connexions
systmatiques, est certainement constitutif de ces actions longues que
sont les pratiques. Il y manque toutefois l'unit de configuration qui
dcoupe un mtier, un jeu, un art, dans ces longues chanes d'actions.
Une seconde sorte de connexion contribue la dlimitation des
pratiques en tant qu'units de second ordre ; il s'agit, non plus des
relations linaires que nous venons de considrer, mais de relations
d'enchssement. Le vocabulaire attach notre rpertoire de pouvoirs
exprime merveille ces relations de subordination plus que de
coordination ; ainsi le mtier d'agriculteur inclut des actions
subordonnes, telles que labourer, semer, moissonner ; son tour,
labourer implique conduire un tracteur, et ainsi de suite en descendant
jusqu' des actions de base, du genre tirer ou pousser. Or, cette liaison
d'enchssement, donc de subordination des actions partielles une
action totale, ne s'articule sur la liaison de coordination entre segments
systmiques et segments tlolo-giques que dans la mesure o les
connexions de l'une et l'autre sorte sont unifies sous les lois de sens qui
font du mtier d'agriculteur une pratique. On en dirait autant d'autres
pratiques ; de mme que l'agriculture est une pratique, au sens d'un
mtier, et non pas labourer et encore moins mettre en route le tracteur,
de mme, tenir une maison, au sens grec de Yoikos auquel nous devons
le mot d'conomie, ou encore occuper une fonction publique dans
l'tat - exemple sur lequel nous reviendrons plus tard - dsignent autant
de pratiques, sans que les comportements subordonns mritent ce titre :
composer un menu, prononcer un
I. G.H. von Wright, Explanation and Understanding, op. cit.
discours dans une runion publique ; de mme encore peindre est une
pratique, la fois en tant que mtier et art, non poser une tache de
couleur sur la toile. Un dernier exemple va nous mettre sur la voie d'une
transition utile : dplacer un pion sur l'chiquier n'est en soi qu'un
geste, mais pris dans la pratique du jeu d'checs, ce geste revt la
signification d'un coup dans une partie de jeu.
Ce dernier exemple atteste que l'unit de configuration constitutive
d'une pratique repose sur une relation particulire de sens, celle
qu'exprime la notion de rgle constitutive, laquelle a t emprunte
prcisment la thorie des jeux avant d'tre tendue la thorie des
actes de discours, bientt rintgre, comme je le fais ici, la thorie de
la praxis. Par rgle constitutive, on entend des prceptes dont la seule
fonction est de statuer que, par exemple, tel geste de dplacer un pion
sur l'chiquier compte comme un coup dans une partie d'checs. Le
coup n'existerait pas. avec cette signification et cet effet dans la partie,
sans la rgle qui constitue le coup en tant que phase de la partie
d'checs. La rgle est constitutive en ce sens qu'elle n'est pas surajoute,
la faon d'un rglement extrieur appliqu des mouvements qui
auraient dj leur propre organisation (comme les signaux lumineux par
rapport la circulation de conducteurs ayant chacun leur propre projet).
La rgle elle seule revt le geste de la signification : dplacer un pion ; la
signification procde de la rgle ds lors que la rgle est constitutive :
constitutive prcisment de la signification, du valoir comme . La
notion de rgle constitutive peut tre tendue de l'exemple du jeu
d'autres pratiques. pour la simple raison que les jeux sont d'excellents
modles pratiques. Ainsi J. Searle a-t-il pu tendre la notion au domaine
des actes de discours, dans la mesure o ceux-ci sont aussi des actions ou
des phases de pratiques plus vastes ; ainsi les actes illocutoires, tels que
promettre, commander, avertir, constater, se distinguent par leur force
qui est elle-mme constitue par la rgle qui dit, par exemple, que
promettre c'est se placer sous l'obligation de faire demain ce que je
dclare aujourd'hui que je ferai.
Il importe de bien noter que les rgles constitutives ne sont pas des
rgles morales. Elles statuent seulement sur la signification de gestes
particuliers et font, comme on l'a dit plus haut, que tel geste de la main
compte comme , par exemple, saluer, voter, hler un taxi, etc. Certes,
les rgles constitutives mettent sur la voie des rgles morales, dans la
mesure o celles-ci rgissent les conduites susceptibles de revtir une
signification. Mais ce n'est
182 183
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
l que le premier pas en direction de l'thique. Mme la rgle
constitutive de la promesse, telle qu'on l'a nonce plus haut, n'a pas en
tant que telle une signification morale, bien qu'elle comporte dans son
nonc la rfrence une obligation ; elle se borne dfinir ce qui
compte comme promesse, ce qui en fait la force illocutoire. La
rgle morale, qu'on peut appeler rgle de fidlit, selon laquelle on doit
tenir ses promesses, a seule un statut dontique'.
L'introduction de la notion de rgle constitutive ce stade de
l'analyse a une autre vertu que d'introduire dans la structure des
pratiques des relations spcifiques de signification ; elle a en outre
celle de souligner le caractre d'interaction qui s'attache la plupart des
pratiques. Ce caractre n'est pas soulign dans la thorie analytique de
l'action, parce que les phrases d'action sont extraites de leur
environnement social. Ce n'est que sous l'aspect pragmatique que la
rception par un allocutaire du sens assign une phrase d'action par un
locuteur s'incorpore la signification de la phrase. Encore
l'interlocution ne constitue-t-elle que la dimension verbale de l'action.
Les pratiques reposent sur des actions dans lesquelles un agent tient
compte par principe de l'action d'autrui ; c'est ainsi que Max Weber
dfinit successivement et conjointement les termes d'action et d'action
sociale au dbut de son grand ouvrage conomie et Socit : Nous
entendons par " activit " [Handeln] un comportement humain (peu
importe qu'il s'agisse d'un acte extrieur ou intime, d'une omission [
Unterlassen] ou d'une tolrance [Dulden]), quand et pour autant que
l'agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif. Et, par activit
" sociale ", l'activit qui, d'aprs son sens vis [gemeinten Sinn] par
l'agent ou les agents, se rapporte au comportement d'autrui, par rapport
auquel s'oriente son droulement
2
.
Se rapporter , tenir compte de la conduite des autres agents, c'est l
l'expression la plus gnrale et la plus neutre qui puisse couvrir la
multitude des relations d'interaction que l'on rencontre au niveau de ces
units d'action que sont les pratiques. Ces interactions peuvent
elles-mmes tre places, comme les actions intentionnelles prises selon
leur signification subjective, sous les rubriques rserves ces dernires
par Max Weber. Les manires externes , ouvertes de tenir compte
du comportement des autres agents se rencontrent dans les interactions
chelonnes du
1. Cf. ci-dessous, huitime tude.
2. M. Weber, conomieet Socit, trad. fr. de J. Freund, P. Kamnitzer, P.
Bertrand, E. de Dampierre, J. Maillard et J. Chavry, Paris, Pion, 1971, p. 4.
conflit la coopration, en passant par la comptition. L'interaction
devient une relation elle-mme interne - intriorise -par exemple
dans la relation d'apprentissage peu peu rsorbe dans la comptence
acquise ; on peut ainsi jouer seul, jardiner seul, plus encore pratiquer
seul une recherche, au laboratoire, en bibliothque ou dans son bureau ;
mais les rgles constitutives de telles pratiques viennent de beaucoup
plus loin que l'excutant solitaire ; c'est de quelqu'un d'autre que la
pratique d'une habilet, d'un mtier, d'un jeu, d'un art, est apprise ; et
l'apprentissage et l'entranement reposent sur des traditions qui peuvent
tre transgresses certes, mais qui doivent d'abord tre assumes ; tout
ce que nous avons dit ailleurs sur la traditionalit et sur le rapport entre
tradition et innovation reprend sens ici dans le cadre du concept
d'interaction intriorise. J'aimerais ajouter cet exemple canonique
d'interaction, o la rfrence autrui est devenue elle-mme intrieure,
le subtil exemple que Hegel se plat voquer au chapitre v de
Phnomnologie de l'Esprit : il correspond au moment o la conscience
prend la mesure de la disproportion entre l'uvre, en tant qu'effectivit
borne, dtermine, et la puissance d'oprer qui porte le destin universel
de la raison oprante. Au moment o l'uvre se dtache de son auteur,
tout son tre est recueilli par la signification que l'autre lui accorde.
Pour l'auteur, l'uvre, en tant qu'indice de son individualit, et non de sa
vocation universelle, est tout simplement renvoye l'phmre'. Cette
manire pour l'uvre de ne tenir son sens, son existence mme comme
uvre, que de l'autre souligne l'extraordinaire prcarit du rapport entre
uvre et auteur, tant la mdiation de l'autre est constitutive de son sens.
Serait-ce enfin cder l'esprit de symtrie que de donner un parallle
en terme d'interaction ces manires dont un agent comprend
subjectivement l'action sur le mode ngatif de l'omission (Unterlassen)
et de la tolrance (Dulden) ? A vrai dire, omettre et supporter, voire
subir, souffrir, sont autant des faits
1. L'uvre est. c'est--dire qu'elle est pour d'autres individualits, et est pour
eux une ralit effective trangre, la place de laquelle ils doivent poser la leur
propre, pour se donner, moyennant leur opration, la conscience de leur unit
avec la ralit effective ; en d'autres termes, leur intrt cette uvre, pose tra-
vers leur propre nature originaire, est un autre intrt que l'intrt spcifique et
particulier de cette uvre qui, par l mme, est transforme en quelque chose
d'autre. L'uvre est donc en gnral quelque chose d'phmre qui s'teint par le
contre-jeu des autres forces et des autres intrts, et qui prsente la ralit de l'in-
dividualit plutt comme disparaissante que comme accomplie (Hegel, Phno-
mnologiedel'Esprit, trad. fr. de J. Hyppolite, Paris, Aubier-Montaigne, 1947, t.
1, p. 332).
184 185
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
d'interaction que des faits de comprhension subjective. Ces deux
termes rappellent qu'au plan de l'interaction comme celui de la
comprhension subjective, le non-agir est encore un agir : ngliger,
omettre de faire, c'esi aussi laisser faire par un autre, parfois de
faon criminelle ; quant supporter, c'est se tenir soi-mme, de gr
ou de force, sous la puissance d'agir de l'autre ; quelque chose est
fait quelqu'un par quelqu'un ; supporter devient subir, lequel
confine souffrir. En ce point, la thorie de l'action s'tend des
hommes agissants aux hommes souffrants. Cette adjonction est si
essentielle qu'elle commande une grande partie de la rflexion sur le
pouvoir, en tant qu'exerc par quelqu'un sur quelqu'un, et sur la
violence en tant que destruction par quelqu'un d'autre de la capacit
d'agir d'un sujet, et du mme coup conduit au seuil de l'ide de
justice, en tant que rgle visant galiser les patients et les agents de
l'action '. A vrai dire, toute action a ses agents et ses patients.
Telles sont quelques-unes des complexits de l'action sur les-
quelles l'opration narrative appelle l'attention, dans la mesure
mme o elle se tient son gard dans une relation mimtique. Non
que les pratiques comportent en tant que telles des scnarios
narratifs tout constitus ; mais leur organisation leur confre une
qualit prnarrative que j'ai place nagure sous le sigle de Mim-sis
I (prfiguration narrative). Ce rapport troit avec la sphre narrative
est renforc par les aspects d'interaction propres aux pratiques : c'est
ceux-l mmes que le rcit confre la forme polmique d'une
comptition entre programmes narratifs.
2. Le mme rapport entre praxis et rcit se rpte un degr plus
lev d'organisation : on a rappel ce texte de la Potique o
Aristote rapproche praxis et bios : En effet, la tragdie est repr-
sentation [mimsis] non d'hommes, mais d'action, de vie... Avant
de considrer ce que Maclntyre appelle l' unit narrative d'une
vie
2
, donnant ainsi une coloration narrative l'expression
dilthyenne de connexion d'une vie , il vaut la peine de s'arrter
un niveau mdian entre les pratiques - mtiers, jeux, arts - et le
projet global d'une existence ; on appellera plans de vie ces vastes
units pratiques que nous dsignons comme vie professionnelle, vie
de famille, vie de loisir, etc. ; ces plans de vie prennent forme -
forme mobile et rvocable au reste - la faveur
1. Cf. ci-dessous, huitime tude.
2. After Virtue, a Study I n Moral Theory, Notre Dame (Ind.), University of
Notre Dame Press, 1981.
d'un mouvement de va-et-vient entre les idaux plus ou moins
lointains, qu'il faut maintenant spcifier, et la pese des avantages et
des inconvnients du choix de tel plan de vie au niveau des
pratiques. Dans l'tude suivante, on dveloppera les applications
proprement thiques de cette formation des plans de vie et on
reprendra cette occasion, sous la conduite de Gadamer, l'analyse
aristotlicienne de la phronsis et du phronimos. Ce qu'on veut
mettre ici en lumire, c'est le simple fait que le champ pratique ne se
constitue pas de bas en haut, par composition du plus simple au plus
labor, mais selon un double mouvement de complexification
ascendante partir des actions de base et des pratiques, et de
spcification descendante partir de l'horizon vague et mobile des
idaux et des projets la lueur desquels une vie humaine
s'apprhende dans son unicit. En ce sens, ce que Maclntyre appelle
unit narrative d'une vie ne rsulte pas seulement de la
sommation des pratiques dans une forme englobante. mais est rgi
titre gal par un projet de vie, aussi incertain et mobile soit-il, et par
des pratiques fragmentaires, qui ont leur propre unit, les plans de
vie constituant la zone mdiane d'change entre l'indtermination
des idaux recteurs et la dtermination des pratiques. A vrai dire, il
arrive que, dans cet change, le projet global soit le premier tre
fermement dessin, comme dans les cas de vocation prcoce ou
imprieuse, et que, sous la pousse de cette contrainte venue de plus
haut, les pratiques perdent leurs contours assigns par la tradition et
conforms par l'apprentissage. Le champ pratique apparat ainsi
soumis un double principe de dtermination qui le rapproche de la
comprhension hermneutique d'un texte par change entre tout et
partie. Rien n'est plus propice la configuration narrative que ce jeu
de double dtermination.
3. C'est le moment de dire un mot de la notion d' unit narrative
d'une vie que Maclntyre place au-dessus de celles de pratiques et
de plans de vie. Il faut dire que cette notion ne dsigne pas chez lui
le dernier degr sur l'chelle de la praxis. Dans une perspective
dlibrment thique qui ne sera la ntre que dans la prochaine
tude, l'ide d'un rassemblement de la vie en forme de rcit est
destine servir de point d'appui la vise de la vie bonne, cl de
vote de son thique, comme elle sera de la ntre. Comment, en
effet, un sujet d'action pourrait-il donner sa propre vie, prise en
entier, une qualification thique, si cette vie n'tait pas rassemble,
et comment le serait-elle si ce n'est prcisment en forme de rcit ?
186 187
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
Je me rjouis de cette rencontre heureuse entre mes analyses de
Temps et Rcit et celles de After Virtue. Je ne voudrais pas nan-
moins identifier sans autre examen la dmarche de Maclntyre et la
mienne. Le premier a principalement en vue les histoires ren-
contres au vif de l'action quotidienne et n'attache pas une
importance dcisive, du moins pour l'investigation thique dans
laquelle il est engag, l'cart entre les fictions littraires et les
histoires qu'il dit mises en acte (enacted). Or, dans mon propre
traitement de la fonction mimtique du rcit, la rupture opre par
l'entre du rcit dans le champ de la fiction est prise si au srieux
que cela devient un problme fort pineux de faire se rejoindre
nouveau la littrature et la vie par le truchement de la lecture. Pour
Maclntyre, les difficults lies l'ide d'une refiguration de la vie
par la fiction ne se posent pas. En revanche, il ne tire pas avantage,
comme je cherche le faire, du double fait que c'est dans la fiction
littraire que la jointure entre l'action et son agent se laisse le mieux
apprhender, et que la littrature s'avre tre un vaste laboratoire
pour des expriences de pense o cette jonction est soumise des
variations Imaginatives sans nombre. Cet avantage d'un dtour par
la fiction, il est vrai, a son revers. Et une difficult que ne connat
pas Maclntyre se pose. A savoir : comment les expriences de
pense suscites par la fiction, avec toutes les implications thiques
qu'on dira plus loin, contribuent-elles l'examen de soi-mme dans
la vie relle ' ? Si le foss est si grand qu'il parat entre la fiction et la
vie, comment avons-nous pu, dans notre propre parcours des
niveaux de la praxis, situer l'ide d'unit narrative de la vie au
sommet de la hirarchie des pratiques multiples ? On pourrait
penser que le foss a t franchi par la thorie de la lecture que je
propose dans Temps et Rcit III, dans le dessein de mettre en contact
le monde du texte et le monde du lecteur
2
. Mais c'est prcisment de
l'acte de lire que
1. Selon le mot de Louis O. Mink, le grand thoricien du rcit historique, les
histoires ne sont pas vcues, mais racontes History and fiction as modes of
comprhension New Literary History. op. cit.. I, 1979, p. 557-558. Sur Louis
O. Mink, cf. Temps et Rcit, t. I, p. 219-228. Les principaux essais de Louis O.
Mink sur la philosophie de l'histoire ont t rassembls par Brian Fay et al. dans
un volume posthume: Louis O. Mink, Hislorical Understanding. Cornell
University Press, 1987.
2. Je retiens ici des analyses de Temps et Rcit III que la lecture, loin d'tre une
imitation paresseuse, est, au meilleur d'elle-mme, une lutte entre deux stratgies,
la stratgie de sduction mene par l'auteur sous la guise d'un narrateur plus ou
moins fiable, et avec la complicit de la Willing suspension ofdisbelief
(Cole-ridge) qui marque l'entre en lecture, et la stratgie de suspicion mene par
le lecteur vigilant, lequel n'ignore pas que c'est lui qui porte le texte la signifiance
la faveur de ses lacunes calcules ou non. A ces notations de Temps et Rcit,
j'ajoute-
surgissent les obstacles que l'on va dire sur le trajet du retour de la
fiction la vie.
Qu'en est-il, d'abord, du rapport entre auteur, narrateur et per-
sonnage, dont les rles et les discours sont bien distincts au plan de
la fiction ? Quand je m'interprte dans les termes d'un rcit de vie,
suis-je la fois les trois, comme dans le rcit autobiographique ' ?
Narrateur et personnage, sans doute, mais d'une vie dont, la
diffrence des tres de fiction, je ne suis pas l'auteur, mais au plus,
selon le mot d'Aristote, le coauteur, le sunai-tion
1
. Mais, compte
tenu de cette rserve, la notion d'auteur ne souffre-t-elle pas
d'quivocit quand on passe de l'criture la vie?
Autre difficult : au plan mme de la forme narrative, qu'on
voudrait semblable dans la fiction et dans la vie, des diffrences
srieuses affectent les notions de commencement et de fin. Certes,
dans la fiction, ni le commencement ni la fin ne sont ncessairement
ceux des vnements raconts, mais ceux de la forme narrative
elle-mme. Ainsi la Recherche commence par la phrase clbre :
Longtemps, je me suis couch de bonne heure. Ce longtemps ,
suivi d'un parfait accompli, renvoie un antrieur quasi
immmorial. Il n'empche que cette phrase est la premire du livre
et vaut commencement narratif. Il en est de mme des futurs
conditionnels de la fin du Temps retrouv , qui ouvrent sur un
futur indtermin, o l'criture de l'uvre est adjure de lutter de
vitesse avec la venue de la mort. Et pourtant
rai aujourd'hui que la condition de possibilit de l'application de la littrature la
vie repose, quant la dialectique du personnage, sur le problme de
Yidentifica-tion-avec dont nous avons dit plus haut qu'il est une composante du
caractre. Par le biais de l'identification avec le hros, le rcit littraire contribue
la narrativi-sation du caractre. Sur ce thme, cf. H.R. Jauss, La jouissance
esthtique : les expriences fondamentales de la poisis. de Vaisthsis et de la
catharsis , Potique. n 39, Paris, d. du Seuil, septembre 1979. C'est dans le
cadre de la lutte entre les deux stratgies propres l'acte de lire et sous le signe de la
narrativisation du caractre (et de l'identification-avec qui en est une
composante) qu'il faut replacer ce qui suit.
1. Cf. P. Lejeune, LePacteautobiographique. Paris, d. du Seuil, 1975.
2. Cf. ci-dessus, quatrime tude, p. 115. Maclntyre, dans After Virtue. ne voit
pas de difficult unir les traits des rcits de fiction et ceux des rcits de vie. Pour
ce dernier, les histoires de vie sont des rcits mis en action (enacted narratives).
Toutefois, aprs avoir dit : Ce que j'ai appel histoire est un rcit dramatique
mis en action o les personnages sont aussi les auteurs (p. 215), Maclntyre doit
concder qu'en raison de la dpendance o les actions des uns sont l'gard des
actions des autres, la diffrence entre personnages imaginaires et personnages
rels ne rside pas dans la forme narrative de ce qu'ils font, mais dans le degr
auquel ils sont les auteurs de cette forme et de leurs propres actions (ibid. [trad.
de l'auteur]).
188 189
SOI-MMECOMMEUNAUTRE LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
il y a une dernire page qui vaut fin narrative
1
. C'est cette clture,
cette clture littraire, si l'on veut, qui manque ce qu'A.
Maclntyre, dans After Virtue. appelle unit narrative de la vie et
dont il fait une condition de la projection de la vie bonne . Il faut
que la vie soit rassemble pour qu'elle puisse se placer sous la vise
de la vraie vie. Si ma vie ne peut tre saisie comme une totalit
singulire, je ne pourrai jamais souhaiter qu'elle soit russie,
accomplie. Or, rien dans la vie relle n'a valeur de commencement
narratif; la mmoire se perd dans les brumes de la petite enfance ;
ma naissance et, plus forte raison, l'acte par lequel j'ai t conu
appartiennent plus l'histoire des autres, en l'occurrence celle de
mes parents, qu' moi-mme. Quant ma mort, elle ne sera fin
raconte que dans le rcit de ceux qui me survivront ; je suis
toujours vers ma mort, ce qui exclut que je la saisisse comme fin
narrative.
A cette difficult fondamentale s'en joint une autre, qui n'est pas
sans rapport avec la prcdente ; sur le parcours connu de ma vie, je
peux tracer plusieurs itinraires, tramer plusieurs intrigues, bref
raconter plusieurs histoires, dans la mesure o, chacune, manque
le critre de la conclusion, ce sens ojan ending sur lequel
Kermode insiste tant.
Allons plus loin : alors que chaque roman dploie un monde du
texte qui lui est propre, sans que l'on puisse le plus souvent mettre
en rapport les intrigues en quelque sorte incommensurables de
plusieurs uvres ( l'exception peut-tre de certaines sries comme
celles des romans de gnrations : Buddenbrook de Thomas Mann,
Les Hommes de bonne volont de Jules Romains sur le modle du
bout--bout des histoires des patriarches dans la Bible), les histoires
vcues des uns sont enchevtres dans les histoires des autres. Des
tranches entires de ma vie font partie de l'histoire de la vie des
autres, de mes parents, de mes amis, de mes compagnons de travail
et de loisir. Ce que nous avons dit plus haut des pratiques, des
relations d'apprentissage, de coopration et de comptition qu'elles
comportent, vrifie cet enchevtrement de l'histoire de chacun dans
l'histoire de nombreux autres. C'est ce mme point que Maclntyre
souligne avec le plus de force, renchrissant, sans le savoir sans
doute, sur ce que Wil-helm Schapp avait dj crit sous le titre In
Geschichten verstrickt (enchevtr dans des histoires)
2
. Or, c'est
prcisment par cet
1. J'ai discut dans Temps et Rcit, t. II, op. cit.. ce problme de la distinction
entre clture du rcit et ouverture par les deux bouts de la srie des choses dites.
2. Cf. Temps et Rcit, t. I, op. cit.. p. 114.
enchevtrement, autant que par leur caractre ouvert par les deux
extrmits, que les histoires de vie diffrent des histoires littraires,
que celles-ci relvent de l'historiographie ou de la fiction. Peut-on
encore parler alors de l'unit narrative de la vie ?
Dernire objection : dans la comprhension de soi, la mimsis
praxs parat ne pouvoir couvrir que la phase dj rvolue de la vie
et devoir s'articuler sur les anticipations, les projets, selon un
schma voisin de celui que propose R. Koselleck dans Ver-gangene
Zukunft ', o la dialectique entre espace d'exprience et horizon
d'attente met en relation la slection des vnements raconts avec
les anticipations relevant de ce que Sartre appelait le projet
existentiel de chacun.
Tous ces arguments sont parfaitement recevables : quivocit de
la notion d'auteur ; inachvement narratif de la vie ; enche-
vtrement des histoires de vie les unes dans les autres ; inclusion des
rcits de vie dans une dialectique de remmort ion et d'anticipation.
Ils ne me semblent pas, toutefois, susceptibles de mettre hors jeu la
notion mme d'application de la fiction la vie. Les objections ne
valent que contre une conception nave de la mimsis, celle mme
que mettent en scne certaines fictions l'intrieur de la fiction, tels
le premier Don Quichotte ou Madame Bovary. Elles sont moins
rfuter qu' intgrer une intelligence plus subtile, plus dialectique,
de Y appropriation. C'est dans le cadre de la lutte, voque plus
haut, entre le texte et le lecteur qu'il faut replacer les objections
prcdentes. quivocit de la position d'auteur ? Mais ne doit-elle
pas tre prserve plutt que rsolue ? En faisant le rcit d'une vie
dont je ne suis pas l'auteur quant l'existence, je m'en fais le
coauteur quant au sens. Bien plus, ce n'est ni un hasard ni un abus si,
en sens inverse, maints philosophes stociens ont interprt la vie
elle-mme, la vie vcue, comme la tenue d'un rle dans une pice
que nous n'avons pas crite et dont l'auteur, par consquent, recule
au-del du rle. Ces changes entre les multiples sens des termes
auteur et position d'auteur (authorship) contribuent la
richesse de sens de la notion mme de la puissance d'agir (agency)
discute dans la quatrime tude.
Quant la notion d'unit narrative de la vie, il faut aussi y voir un
mixte instable entre fabulation et exprience vive. C'est prci-
sment en raison du caractre vasif de la vie relle que nous avons
besoin du secours de la fiction pour organiser cette dernire
rtrospectivement dans l'aprs-coup, quitte tenir pour
1. Cf. Temps et Rcit, t. III, Paris, d. du Seuil, 1985, p. 301-313.
190 191
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
rvisable et provisoire toute figure de mise en intrigue emprunte la
fiction ou l'histoire. Ainsi, c'est l'aide des commencements narratifs
auxquels la lecture nous a familiariss que, forant en quelque sorte le
trait, nous stabilisons les commencements rels que constituent les
initiatives - au sens fort du terme -que nous prenons. Et nous avons
aussi l'exprience, qu'on peut dire inexacte, de ce que veut dire terminer
un cours d'action, une tranche de vie. La littrature nous aide en quelque
sorte fixer le contour de ces fins provisoires. Quant la mort, les rcits
que la littrature en fait n'ont-ils pas la vertu d'mousser l'aiguillon de
l'angoisse en face du rien inconnu, en lui donnant imaginaire-ment le
contour de telle ou telle mort, exemplaire un titre ou l'autre ? Ainsi la
fiction peut-elle concourir l'apprentissage du mourir. La mditation de
la Passion du Christ a de cette faon accompagn plus d'un croyant
jusqu'au dernier seuil. Quand F. Kermode ou W. Benjamin
prononcent cet gard le mot de consolation , il ne faut pas crier
trop vite la tromperie de soi. En tant que contre-dsolation, la
consolation peut tre une manire lucide - lucide comme la catharsis
d'Aristote - de mener le deuil de soi-mme. Ici un change fructueux
peut s'instaurer entre la littrature et l'tre-pour-(ou envers)-la-mort.
L'enchevtrement des histoires de vie les unes dans les autres est-il
rebelle l'intelligence narrative que nourrit la littrature ? Ne
trouve-t-il pas plutt dans l'enchssement d'un rcit dans l'autre, dont
la littrature donne maints exemples, un modle d'intelligibilit ? Et
chaque histoire fictive, en faisant affronter en son sein les destins
diffrents de protagonistes multiples, n'offre-t-elle pas des modles
d'interaction o l'enchevtrement est clarifi par la comptition des
programmes narratifs ?
La dernire objection repose sur une mprise qu'il n'est pas toujours
facile de djouer. On croit volontiers que le rcit littraire, parce qu'il
est rtrospectif, ne peut instruire qu'une mditation sur la partie passe
de notre vie. Or le rcit littraire n'est rtrospectif qu'en un sens bien
prcis : c'est seulement aux yeux du narrateur que les faits raconts
paraissent s'tre drouls autrefois. Le pass de narration n'est que le
quasi-pass de la voix narrative
1
. Or, parmi les faits raconts un temps
du pass, prennent place des projets, des attentes, des anticipations,
par quoi les protagonistes du rcit sont orients vers leur avenir mortel :
en tmoignent les dernires pages puissamment prospectives
1. Sur cette interprtation dont je n'ai pas manqu de souligner le caractre
exploratoire, cf. Temps et Rcit, t. Il, op. cit., p. 131-149, en particulier p. 147-148.
de la Recherche, dj voque plus haut au titre de la clture ouverte du
rcit de fiction. Autrement dit, le rcit raconte aussi le souci. En un sens,
il ne raconte que le souci. C'est pourquoi il n'y a pas d'absurdit parler
de l'unit narrative d'une vie, sous le signe de rcits qui enseignent
articuler narrativement rtro-spection et prospection.
Il rsulte de cette discussion que rcits littraires et histoires de vie,
loin de s'exclure, se compltent, en dpit ou la faveur de leur
contraste. Cette dialectique nous rappelle que le rcit fait partie de la
vie avant de s'exiler de la vie dans l'criture ; il fait retour la vie selon
les voies multiples de l'appropriation et au prix des tensions
inexpugnables que l'on vient de dire.
3. Les implications thiques du rcit
Qu'en est-il, sur le second versant de notre investigation, des rapports
de la thorie narrative la thorie thique ? Ou, pour reprendre les
termes proposs plus haut : de quelle manire la composante narrative
de la comprhension de soi appelle-t-elle pour complment les
dterminations thiques propres l'imputation morale de l'action son
agent ?
Ici encore, la notion d'identit narrative aide expliciter des
relations entre narrativit et thique qui ont t anticipes dans ce qui
prcde sans tre tires au clair ; mais il faudra dire qu'elle apporte, ici
aussi, des difficults nouvelles lies la confrontation entre la version
narrative et la version thique de l'ipsit.
Que la fonction narrative ne soit pas sans implications thiques,
l'enracinement du rcit littraire dans le sol du rcit oral, au plan de la
prfiguration du rcit, le laisse dj entendre. Dans son essai fameux sur
le narrateur ' , W. Benjamin rappelle que, sous sa forme la plus
primitive, encore discernable dans l'pope et dj en voie d'extinction
dans le roman, l'art de raconter est l'art d'changer des expriences ; par
expriences, il entend non l'observation scientifique, mais l'exercice
populaire de la sagesse pratique. Or cette sagesse ne laisse pas de
comporter des apprciations, des valuations qui tombent sous les
catgories
1. W. Benjamin, Der Erzhler, Betrachtungen zum Werk Nicolaj Lesskows,
in llluminationen, Francfort, Suhrkamp, 1969 ; trad. fr. de M. de Gandillac, Le
narrateur , in Posieet Rvolution, Paris, Denol, 1971 ; repris in Rastelli raconte
et autres rcits, Paris. d. du Seuil, 1987.
192
193
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
tlologiques et dontologiques que nous laborerons dans la pro-
chaine tude ; dans l'change d'expriences que le rcit opre, les
actions ne manquent pas d'tre approuves ou dsapprouves et les
agents d'tre lous ou blms.
Dira-t-on que le rcit littraire, au plan de la configuration nar-
rative proprement dite, perd ces dterminations thiques au bnfice
de dterminations purement esthtiques ? Ce serait se mprendre sur
l'esthtique elle-mme. Le plaisir que nous prenons suivre le
destin des personnages implique certes que nous suspendions tout
jugement moral rel en mme temps que nous mettons en suspens
l'action effective. Mais, dans l'enceinte irrelle de la fiction, nous ne
laissons pas d'explorer de nouvelles manires d'valuer actions et
personnages. Les expriences de pense que nous conduisons dans
le grand laboratoire de l'imaginaire sont aussi des explorations
menes dans le royaume du bien et du mal. Transvaluer, voire
dvaluer, c'est encore valuer. Le jugement moral n'est pas aboli, il
est plutt lui-mme soumis aux variations imaginatives propres la
fiction.
C'est la faveur de ces exercices d'valuation dans la dimension
de la fiction que le rcit peut finalement exercer sa fonction de
dcouverte et aussi de transformation l'gard du sentir et de l'agir
du lecteur, dans la phase de refiguration de l'action par le rcit. Dans
Temps et Rcit III, je me suis mme risqu dire que la forme de
rcit qui se veut la plus neutre cet gard, savoir le rcit
historiographique, n'atteint jamais le degr zro de l'estimation.
Sans manifester une prfrence personnelle pour les valeurs de telle
ou telle poque, l'historien qui se veut davantage m par la curiosit
que par le got de commmorer ou d'excrer ne s'en trouve pas
moins rapport, par cette curiosit mme, la manire dont les
hommes ont vis, atteint ou manqu ce qu'ils tenaient pour
constituer la vraie vie. C'est au moins sur le mode de l'imagination et
de la sympathie qu'il fait revivre des manires d'valuer qui
continuent d'appartenir notre humanit profonde. Par l,
l'historiographie est rappele sa relation de dette l'gard des
hommes du pass. En certaines circonstances, en particulier lorsque
l'historien est confront l'horrible, figure limite de l'histoire des
victimes, la relation de dette se transforme en devoir de ne pas
oublier
1
.
1 Je reprendrai le problme en sens inverse dans la prochaine tude. Si les his-
toires racontes offrent tant de points d'appui au jugement moral, n'est-ce pas
parce que celui-ci a besoin de l'art de raconter pour, si l'on peut dire, schmatiser
sa vise? Au-del des rgles, des nonnes, des obligations, des lgislations qui
constituent ce qu'on peut appeler la morale, il y a, dirons-nous alors, cette vise de
la vraie vie, que Maclntyre, reprenant Aristote, place au sommet de la hirarchie
Ce n'est pas toutefois sur les certitudes affrentes aux implications
thiques de la fonction narrative que je veux conclure cette tude.
De mme que, sur le premier versant, des difficults particulires
taient apparues au point o se recroisent thorie narrative et thorie
de l'action, des difficults symtriques surgissent au point o la
thorie narrative s'inflchit en thorie thique. Elles ont affaire avec
le destin distinct, voire oppos, de Y identit, thme directeur de la
prsente tude dans l'un et l'autre registre. Dans la section consacre
la problmatique de l'identit, nous avons admis que
l'identit-ipsit couvrait un spectre de significations depuis un ple
extrme o elle recouvre l'identit du mme jusqu' l'autre ple
extrme o elle s'en dissocie entirement. Ce premier ple nous a
paru symbolis par le phnomne du caractre, par quoi la personne
se rend identifiable et ridentifiable. Quant au deuxime ple, c'est
par la notion, essentiellement thique, du maintien de soi qu'il nous a
paru reprsent. Le maintien de soi, c'est pour la personne la
manire telle de se comporter qu'autrui peut compter sur elle. Parce
que quelqu'un compte sur moi, je suis comptable de mes actions
devant un autre. Le terme de responsabilit runit les deux
significations : compter sur..., tre comptable de... Elle les runit, en
y ajoutant l'ide d'une rponse la question : O es-tu ? , pose
par l'autre qui me requiert. Cette rponse est : Me voici ' !
Rponse qui dit le maintien de soi.
En opposant polairement le maintien de soi au caractre, on a
voulu cerner la dimension proprement thique de l'ipsit, sans
gards pour la perptuation du caractre. On a ainsi marqu l'cart
entre deux modalits de la permanence dans le temps, que dit bien le
terme de maintien de soi, oppos celui de perptuation du mme.
O se situe finalement l'identit narrative sur ce spectre de
variations entre le ple d'ipsit-mmet du caractre et le ple de
pure ipsit du maintien de soi ?
A cette question, la rponse parat dj donne : l'identit nar-
rative se tient dans l'entre-deux ; en narrativisant le caractre, le
des niveaux de la praxis. Or cette vise ne peut manquer, pour devenir vision, de
s'investir dans des rcits la faveur desquels nous mettons l'essai divers cours
d'action en jouant, au sens fort du terme, avec des possibilits adverses. On peut
parler cet gard d'imagination thique, laquelle se nourrit d'imagination narra-
tive. Cf. P. Kemp, Ethics and narrativity , Aquinas, Rome, Presses de l'Univer-
sit du Latran, 1988, p. 435-458, et thiqueet Mdecine, Pans. Tierce-Mdecine,
1987.
1. E. Lvinas, Autrement qu tre ou au-del del'essence, La Haye, 1974, M.
Ny-hoff, p. 180.
194
195
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET L'IDENTIT NARRATIVE
rcit lui rend son mouvement, aboli dans les dispositions acquises,
dans les identifications-avec sdimentes. En narrativi-sant la vise de la
vraie vie, il lui donne les traits reconnaissables de personnages aims ou
respects. L'identit narrative fait tenir ensemble les deux bouts de la
chane : la permanence dans le temps du caractre et celle du
maintien de soi.
O donc est la difficult ? La difficult vient des cas droutants sur
lesquels nous avons conclu la section prcdente. Ces cas limites
paraissent proposer une problmatisation telle de l'identit narrative
que, loin de jouxter l'identit thique figure par le maintien de soi, elle
parat bien plutt lui retirer tout point d'appui. Aussi longtemps que la
ligne de partage passait entre les cas troublants de la fiction littraire et
les puzzling cases de la science-fiction, les premiers exeraient une sorte
de fonction apologtique au bnfice de l'ipsit et aux dpens de sa
confusion avec la mmet. Pourquoi, en effet, nous intresserions-nous
au drame de la dissolution de l'identit du personnage de Musil et
serions-nous plongs par lui dans la perplexit, si le non-sujet ne restait
pas une figure du sujet, ft-ce sur le mode ngatif? Un non-sujet n'est pas
rien, comme le rappelle la smiotique du sujet de discours ou d'action
1
.
Ce plaidoyer pour l'ipsit, que documentent les cas troublants de la
fiction littraire, commence virer son contraire lorsque, la fiction
retournant la vie, le lecteur en qute d'identit se trouve affront
l'hypothse de sa propre perte d'identit, cette Ichlosigkeit qui fut la
fois le tourment de Musil et l'effet de sens interminablement cultiv par
son uvre. Le soi ici refigur par le rcit est en ralit confront
l'hypothse de son propre nant. Certes, ce nant n'est pas le rien dont il
n'y a rien dire. Cette hypothse donne au contraire beaucoup dire,
comme en tmoigne l'immensit d'une uvre comme L'Homme sans
qualits. La phrase : Je ne suis rien , doit garder sa forme paradoxale
: rien ne signifierait plus rien, si rien n'tait en effet attribu
je. Mais qui est encore je quand le sujet dit qu'il n'est rien ? Un soi
priv du secours de la mmet. avons-nous dit et rpt. Soit. A cet
gard, l'hypothse ne manque pas de vrifications existentielles : il se
pourrait en effet que les transformations les plus dramatiques de
l'identit personnelle dussent traverser l'preuve de ce nant d'identit,
lequel nant serait l'quivalent de la case vide dans les trans-
1. J'adopte ici le vocabulaire de J. Coquet dans Le Discours et son Sujet 1. Essai
de grammaire modale. 2. Pratique de la grammaire modale. Paris, Klinck-sieck.
1984-1985.
formations chres Lvi-Strauss. Maints rcits de conversion portent
tmoignage sur de telles nuits de l'identit personnelle. En ces
moments de dpouillement extrme, la rponse nulle la question qui
suis-je ? renvoie, non point la nullit, mais la nudit de la question
elle-mme.
Or, ce qui rouvre le dbat, c'est prcisment cette mise nu de la
question qui ?, confronte la fire rponse : Me voici ! Comment
tenir ensemble le caractre problmatique de Yipse au plan narratif et son
caractre assertif au plan de l'engagement moral ? On est tent de dire
que les cas troublants de la fiction littraire ramnent paradoxalement au
voisinage de la conclusion thique que Parfit tirait de l'indcidabilit de
ses puzzling cases : savoir que l'identit personnelle n'est pas ce qui
importe ; s'effacent alors, non seulement l'identit du mme, mais
l'identit du soi, qu'on avait cru sauve du dsastre de la premire. En un
sens, cela est vrai : les rcits qui racontent la dissolution du soi peuvent
tre tenus pour des rcits interprtatifs l'gard de ce qu'on pourrait
appeler une apprhension apophatique du soi '. L'apophase du soi
consiste en ceci que le passage du Qui suis-je ? au Que
suis-je ? a perdu toute pertinence. Or, le quoi du qui , nous
l'avons dit plus haut, c'est le caractre, c'est--dire l'ensemble des
dispositions acquises et des identifications-avec sdimentes.
L'impossibilit absolue de reconnatre quelqu'un sa manire durable
de penser, de sentir, d'agir, n'est peut-tre pas praticable, du moins
est-elle pensable la limite. Seule est sans doute praticable la mise en
chec d'une suite indfinie de tentatives d'identification, lesquelles sont
la matire de ces rcits valeur interprtative au regard du retrait du
soi.
Comment, ds lors, maintenir au plan thique un soi qui, au plan
narratif, parat s'effacer ? Comment dire la fois : Qui suis-je ? , et :
Me voici ! ? N'est-il pas possible de faire travailler la limite l'cart
entre identit narrative et identit morale au bnfice de la dialectique
vivante entre l'une et l'autre ? Voici comment je vois l'opposition se
muer en tension fructueuse.
D'un ct, il n'est pas douteux que le Me voici ! par quoi la
personne se reconnat sujet d'imputation marque un coup d'arrt
l'gard de l'errance laquelle peut conduire la confrontation de
soi-mme avec une multitude de modles d'action et de vie, dont certains
vont jusqu' paralyser la capacit d'engagement ferme.
1. Sur la catgorie du rcit interprtatif, cf. mon article Le rcit interprtatif.
Exgse et thologie dans les rcits de la Passion . Recherches de science reli-
gieuse. 1985.
196
197
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
Entre l'imagination qui dit : Je peux tout essayer , et la voix qui
dit : Tout est possible, mais tout n'est pas bnfique [entendons :
autrui et toi-mme] , une sourde discorde s'installe. C'est cette
discorde que l'acte de la promesse transforme en concorde fragile :
Je peux tout essayer , certes, mais : Ici je me tiens !
De l'autre ct, l'angoissante question Qui suis-je?, que mettent
nu les cas troublants de la fiction littraire, peut, d'une certaine
faon, s'incorporer la fire dclaration : Ici je me tiens ! La
question devient : Qui suis-je, moi, si versatile, pour que,
nanmoins, tu comptes sur moi ? L'cart entre la question dans
laquelle s'abme l'imagination narrative et la rponse du sujet rendu
responsable par l'attente de l'autre devient faille secrte au cur
mme de l'engagement. Cette faille secrte fait la diffrence entre la
modestie du maintien de soi et l'orgueil stocien de la raide
constance soi. C'est en ce point exactement que la voie ici suivie
recoupe celle de Parfit. En un sens, la caractri-sation de l'ipsit
par le rapport de possession (ou d'appartenance) entre la personne et
ses penses, ses actions, ses passions, bref ses expriences , n'est
pas sans ambigut au plan thique. Autant ce rapport ne prte
aucune confusion au plan grammatical des dictiques (mon / le
mien ; ton / le tien ; son, sa / le sien, la sienne, etc.), autant il reste
suspect au plan o Parfit mne son combat contre le principe du
self-interest. Dans une philosophie de l'ipsit comme la ntre, on
doit pouvoir dire : la possession n'est pas ce qui importe. Ce que
suggrent les cas limites engendrs par l'imagination narrative, c'est
une dialectique de la possession et de la dpossession, du souci et de
l'insouciance, de l'affirmation de soi et de l'effacement de soi. Ainsi
le nant imagin du soi devient-il crise existentielle du soi '.
Que ce dpouillement, voqu par des penseurs aussi diffrents
que Jean Nabert, Gabriel Marcel, Emmanuel Lvinas, ait affaire
avec le primat thique de l'autre que soi sur le soi, cela est clair.
Encore faut-il que l'irruption de l'autre, fracturant la clture du
mme, rencontre la complicit de ce mouvement d'effacement par
quoi le soi se rend disponible l'autre que soi. Car il ne faudrait pas
que la crise de l'ipsit ait pour effet de substituer la haine de soi
l'estime de soi.
1. Sur la catgorie de la crise, cf. P. Landsberg et . Weil, Logiquedela philo-
sophie. Paris, Vrin, 1950, chap. xii, Personnalit, p. 293-296.
SEPTIME TUDE
Le soi et la vise thique
Prises ensemble, les trois tudes qui commencent ici ajoutent aux
dimensions langagire, pratique et narrative de l'ipsit une
dimension nouvelle, la fois thique et morale (sous la rserve de la
distinction que je proposerai sous peu entre les deux termes souvent
tenus pour synonymes). Une dimension nouvelle, mais qui ne
marque aucune rupture de mthode avec les prcdentes.
Comme il a t dit dans la prface, les quatre sous-ensembles qui
composent ces tudes jusqu'au seuil de la dixime correspondent, en
effet, quatre manires de rpondre la question qui ?: qui parle ?
qui agit ? qui se raconte ? qui est le sujet moral d'imputation ? Nous
ne sortons pas du problme de l'ipsit aussi longtemps que nous
restons dans l'orbe de la question qui ?. Le quatrime sous-ensemble
que nous abordons ici obit, en effet, comme les trois prcdents,
la rgle fondamentale du dtour de la rflexion par l'analyse : ainsi,
les prdicats bon et obligatoire , appliqus l'action, jouent le
mme rle que la proposition discursive par rapport au locuteur qui
se dsigne lui-mme en la prononant, ou que les phrases d'action
par rapport la position de l'agent capable de faire, ou enfin que les
structures narratives par rapport la constitution de l'identit
narrative. Les dterminations thiques et morales de l'action seront
traites ici comme des prdicats d'un nouveau genre, et leur rapport
au sujet de l'action comme une nouvelle mdiation sur le chemin de
retour vers le soi-mme.
La dtermination de l'action par des prdicats tels que bon et
obligatoire ne marquerait une rupture radicale avec tout ce qui
prcde que pour la tradition de pense issue de Hume, pour
laquelle devoir-tre s'oppose tre, sans transition possible. Pres-
crire signifie alors tout autre chose que dcrire. On peut dj trouver
dans les tudes prcdentes plusieurs raisons de refuser cette
dichotomie.
199
SOI-MME COMME UN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
D'abord, les tres sur lesquels nous avons mdit sont bien
particuliers : ce sont des parlants et des agissants ; or il appartient
l'ide d'action qu'elle soit accessible des prceptes qui, sous la
forme du conseil, de la recommandation, de l'instruction, enseignent
russir, donc bien faire, ce qu'on a entrepris. Les prceptes ne
sont certes pas tous d'ordre moral - loin de l : ce peuvent tre des
prceptes techniques, stratgiques, esthtiques, etc. ; du moins les
rgles morales s'inscrivent-elles dans le cercle plus vaste des
prceptes, lesquels sont intimement lis aux pratiques qu'ils
concourent dlimiter.
Ensuite, en plaant la thorie narrative la charnire de la thorie
de l'action et de la thorie morale, nous avons fait de la narration une
transition naturelle entre description et prescription ; c'est ainsi que,
dans les dernires pages de l'tude prcdente, la notion d'identit
narrative a pu servir d'ide directrice pour une extension de la
sphre pratique au-del des actions simples dcrites dans le cadre
des thories analytiques de l'action ; or ce sont ces actions
complexes qui sont refigures par des fictions narratives riches en
anticipations de caractre thique ; raconter, a-t-on observ, c'est
dployer un espace imaginaire pour des expriences de pense o le
jugement moral s'exerce sur un mode hypothtique.
Qu'en est-il maintenant de la distinction propose entre thique et
morale ? Rien dans l'tymologie ou dans l'histoire de l'emploi des
termes ne l'impose. L'un vient du grec, l'autre du latin ; et les deux
renvoient l'ide intuitive de murs, avec la double connotation
que nous allons tenter de dcomposer, de ce qui est estim bon et de
ce qui s'impose comme obligatoire. C'est donc par convention que
je rserverai le terme d'thique pour la vise d'une vie accomplie et
celui de morale pour l'articulation de cette vise dans des normes
caractrises la fois par la prtention l'universalit et par un effet
de contrainte (on dira le moment venu ce qui lie ces deux traits l'un
l'autre). On reconnatra aisment dans la distinction entre vise et
norme l'opposition entre deux hritages, un hritage aristotlicien,
o l'thique est caractrise par sa perspective tlologique, et un
hritage kantien, o la morale est dfinie par le caractre d'obliga-
tion de la norme, donc par un point de vue dontologique. On se
propose d'tablir, sans souci d'orthodoxie aristotlicienne ou kan-
tienne, mais non sans une grande attention aux textes fondateurs de
ces deux traditions : 1) la primaut de l'thique sur la morale ; 2) la
ncessit pour la vise thique de passer par le crible de la
norme ; 3) la lgitimit d'un recours de la norme la vise, lorsque
la norme conduit des impasses pratiques, qui rappelleront ce
nouveau stade de notre mditation les diverses situations
aportiques auxquelles a d faire face notre mditation sur l'ipsit.
Autrement dit, selon l'hypothse de travail propose, la morale ne
constituerait qu'une etfectuation limite, quoique lgitime et mme
indispensable, de la vise thique, et l'thique en ce sens
envelopperait la morale. On ne verrait donc pas Kant se substituer
Aristote en dpit d'une tradition respectable. 11 s'tablirait plutt
entre les deux hritages un rapport la fois de subordination et de
complmentarit, que le recours final de la morale l'thique
viendrait finalement renforcer.
En quoi cette articulation d'un genre trs particulier entre vise
tlologique et moment dontologique affecte-t-elle notre examen
de l'ipsit? L'articulation entre vise tlologique et moment
dontologique, d'abord aperue au niveau des prdicats appliqus
l'action - prdicat bon , prdicat obligatoire - trouvera enfin sa
rplique au plan de la dsignation de soi : c'est la vise thique que
correspondra ce que nous appellerons dsormais estime de soi, et au
moment dontologique le respect de soi. Selon la thse propose ici,
il devrait apparatre : 1) que l'estime de soi est plus fondamentale
que le respect de soi ; 2) que le respect de soi est l'aspect que revt
l'estime de soi sous le rgime de la norme ; 3) enfin, que les apories
du devoir crent des situations o l'estime de soi n'apparat pas
seulement comme la source mais comme le recours du respect,
lorsque aucune norme certaine n'offre plus de guide sr pour
l'exercice hic et nunc du respect. Ainsi, estime de soi, et respect de
soi reprsenteront conjointement les stades les plus avancs de cette
croissance qui est en mme temps un dpli de l'ipsit.
Pour conclure cette brve introduction aux trois tudes qu'on va
lire, disons d'un mot de quelle manire la distinction entre thique et
morale rpond l'objection humienne d'un foss logique entre
prescrire et dcrire, entre devoir-tre et tre. On peut attendre de la
conception tlologique par laquelle on caractrisera l'thique
qu'elle enchane de faon directe sur la thorie de l'action prolonge
par celle de la narration. C'est en effet dans des valuations o
estimations immdiatement appliques l'action que s'exprime le
point de vue tlologique. En revanche, les prdicats dontiques
relevant d'une morale du devoir paraissent s'imposer du dehors - ou
de haut - l'agent de l'action, sous les espces d'une contrainte que
l'on dit prcisment morale, ce qui
200
201
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA VISE THIQUE
donne du poids la thse de l'opposition irrductible entre devoir-tre
et tre. Mais, si l'on arrive montrer que le point de vue dontologique
est subordonn la perspective tlologique, alors l'cart entre
devoir-tre et tre paratra moins infranchissable que dans une
confrontation directe entre la description et la prescription ou, selon une
terminologie proche, entre jugements de valeur et jugements de fait.
1. Viser la vie bonne ...
La prsente tude se bornera tablir la primaut de l'thique sur la
morale, c'est--dire de la vise sur la norme. Ce sera la tche de la
suivante de donner la norme morale sa juste place sans lui laisser le
dernier mot.
Enqurir sur la vise thique, abstraction faite du moment
dontologique, est-ce renoncer tout discours sens et laisser le champ
libre l'effusion des bons sentiments ? Il n'en est rien. La dfinition
qui suit suscite au contraire, par son caractre articul, un travail de
pense qui occupera le reste de cette tude. Appelons vise thique la
vise de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes.
Les trois moments forts de cette dfinition feront successivement
l'objet d'une analyse distincte. Ce sont ces trois mmes composantes
qui, dans les deux tudes suivantes, formeront les points d'appui
successifs de notre rflexion sur le rapport de la norme morale la
vise thique.
L'avantage majeur d'une entre dans la problmatique thique par la
notion de vie bonne est de ne pas faire directement rfrence
l'ipsit sous la figure de l'estime de soi. Et, si l'estime de soi tire
effectivement sa premire signification du mouvement rflexif par
lequel l'valuation de certaines actions estimes bonnes se reporte sur
l'auteur de ces actions, cette signification reste abstraite aussi longtemps
que lui fait dfaut la structure dia-logique que la rfrence autrui
introduit. A son tour, cette structure dialogique reste incomplte hors de
la rfrence des institutions justes. En ce sens, l'estime de soi n'a son
sens complet qu'au terme du parcours de sens que les trois composantes
de la vise thique jalonnent.
La premire composante de la vise thique est ce qu'Aristote appelle
vivre-bien , vie bonne : vraie vie , pourrait-on
dire dans le sillage de Proust. La vie bonne est ce qui doit tre nomm
en premier parce que c'est l'objet mme de la vise thique. Quelle
que soit l'image que chacun se fait d'une vie accomplie, ce
couronnement est la fin ultime de son action. C'est le moment de se
souvenir de la distinction que fait Aristote entre le bien tel que l'homme
le vise et le Bien platonicien. En thique aristotlicienne, il ne peut tre
question que du bien pour nous. Cette relativit nous n'empche pas
qu'il ne soit contenu dans aucun bien particulier. Il est plutt ce qui
manque tous les biens. Toute l'thique suppose cet usage non
saturable du prdicat bon .
Le discours est-il une fois encore menac par l'informe ? Non point.
La premire grande leon que nous retiendrons d'Aristote est d'avoir
cherch dans la praxis l'ancrage fondamental de la vise de la vie
bonne '. La seconde est d'avoir tent d'riger la tlologie interne la
praxis en principe structurant de la vise de la vie bonne . A cet gard,
il n'est pas certain qu'Aristote ait rsolu le paradoxe apparent selon lequel
la praxis, du moins la bonne praxis, serait elle-mme sa propre fin, tout
en visant une fin ultrieure. Le paradoxe serait rsolu si l'on trouvait un
principe de hirarchie tel que les finalits soient en quelque sorte
incluses les unes dans les autres, le suprieur tant comme l'excs de
l'infrieur. Or la suite des livres de Y thique Nicomaque ne semble pas
offrir une analyse cohrente de cette hirarchie des actions et des fins
correspondantes. Nombreux sont les commentateurs qui voient une
discordance entre le livre III et le livre VI. Les uns la tiennent pour
insurmontable, les autres non. La discordance consiste en ceci : au livre
III, comme on l'a rappel
1. Les premires lignes de Vthique NicomaqueI nous mettent sur la voie :
Tout art [tekhn] et toute investigation [mlhodos] et pareillement toute action
[praxis) et tout choix prfrentiel [prohairsis] tendent vers quelque bien, ce
qu'il semble. Aussi a-t-on dclar avec raison que le Bien est ce quoi toute chose
tend (trad. Tricot modifie, I, 1,1094 a 1-3). Laissons en suspens l'quation
entre bien et bonheur. Attardons-nous l'numration aux contours indcis des
activits ainsi tlologiquement orientes. Tekhnest le premier terme nomm ; il
est mis en couple avec mthodos, le pratique en gnral tant ainsi coordonn avec
le thortique en gnral ; puis tekhnest simplement juxtapos praxis et pro-
hairsissans qu'aucune hirarchie soit propose. En outre, praxis n'est pas encore
oppos poisis. Ce n'est qu'au livre VI que la praxis, plus exactement la science
pratique , sera oppose la science potique : nous apprenons alors que la
praxis est une activit qui ne produit aucune uvre distincte de l'agent et qui n'a
d'autre Tin que l'action elle-mme, l' eupraxie , la bonne pratique tant
elle-mme sa propre fin (trad. Tricot, VI, S, 1140 b 6), tandis que la poisis (et la
science potique qui lui correspond) a une fin autre qu'elle-mme (ibid.j.
202
203
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
dans la quatrime tude, tout repose sur le lien entre choix prfrentiel
et dlibration. Or le mme livre propose un modle de dlibration qui
semble exclure celle-ci de Tordre des fins. Cette limitation de la
dlibration aux moyens est rpte trois fois : nous dlibrons non
pas sur les fins elles-mmes [remarquez le pluriel], mais sur les moyens
d'atteindre les fins [ta pros to tlos) (III, 5, 1112 b 12). Certes, on
comprend que soit limin du champ de la dlibration tout ce qui
chappe notre pouvoir : d'un ct les entits ternelles, de l'autre tous
les vnements qui ne sauraient tre produits par nous. Mais de l
rduire les choses qui dpendent de nous des moyens, il y a un pas qui
est franchi dans les exemples qui suivent : le mdecin ne se demande pas
s'il doit gurir, ni l'orateur s'il doit persuader, ni le politique s'il doit
tablir de bonnes lois. Une fois que chacun a pos une fin, il examine
comment et par quel moyen il la ralisera, la dlibration portant sur le
choix du moyen le plus appropri. Restreignant encore la porte de la
dlibration, Aristote se hte d'assimiler ce choix des moyens la
construction d'une figure par le gomtre, la figure construire tenant
lieu de fin pour les oprations intermdiaires.
Certes, on comprend la prdilection d'Aristote pour ce modle : si
la dlibration doit porter sur les choses qui dpendent de nous, les
moyens de nos fins sont bien ce qui est le plus en notre pouvoir ; la vise
des fins doit alors tre renvoye du ct du souhait (boulsis) qui porte
volontiers sur des choses hors de notre pouvoir. En outre, et cet
argument est peut-tre le plus fort, si on devait toujours dlibrer, on
irait l'infini (th. Nie. ; III, 5, 1113 a 2). Or, n'a-t-on pas dit qu' il
faut s'arrter quelque part [anank stnai] et que le bonheur est en
quelque sorte ce qui met un point d'arrt la fuite en avant du dsir ?
L'argument laisse nanmoins perplexe : Aristote aurait-il ignor qu'un
homme peut tre plac dans la situation de choisir entre devenir
mdecin plutt qu'orateur ou homme politique ? Le choix entre
plusieurs cours d'action n'est-il pas un choix sur les fins, c'est--dire sur
leur conformit plus ou moins troite ou lointaine un idal de vie,
c'est--dire ce qui est tenu par chacun pour sa vise du bonheur, sa
conception de la vie bonne? Cette perplexit, qui alimentera plus
loin notre rflexion, contraint d'avouer que le modle moyen-fin ne
recouvre pas tout le champ de l'action, mais seulement la tekhn, en
tant qu'elle se soustrait une rflexion fondamentale que prcisment
la phronsis du livre VI apportera. Pire, le
modle moyen-fin semble bien conduire sur une fausse route, dans la
mesure o il invite construire tous les rapports entre fins subordonnes
et fin ultime sur une relation qui reste fondamentalement
instrumentale
1
.
Le livre VI, qui, faut-il le rappeler, porte sur les vertus diano-tiques et
non plus sur les vertus du caractre traites aux livres II-V (courage,
modration, libralit, justice) offre, en revanche, un modle de
dlibration plus complexe. La dlibration est ici le chemin que suit la
phronsis, la sagesse pratique (mot que les Latins ont traduit par
prudentia
2
), et, plus prcisment, le chemin que suit l'homme de la
phronsis - le phronimos - pour diriger sa vie \ La question ici pose
semble bien tre celle-ci : qu'est-ce qui
1. Certains commentateurs se sont efforcs d'attnuer la difficult en remettant
en question la traduction classique du grec pros to tlos par moyen ; or l'ex-
pression grecque, qu'il faudrait selon eux traduire par les choses relatives la
fin , laisserait ouverte une pluralit d'interprtations. Selon D. Wiggins ( Dli-
bration and practical reason , in A. O. Rony (d.), Essays on Aristotle's ethics,
University of California Press, 1980, p. 222-225) sont relatifs la fin, non seule-
ment les instruments de l'action, mais les lments constitutifs de la fin
elle-mme. Le tort des exemples choisis par Aristote est de limiter le pros to tlos
un cas typique, celui o la fin est dj fixe, le singulier tant pris au sens
distributif, la Tin du mdecin, celle de l'orateur, celle de l'homme politique. En
somme, le mdecin est dj mdecin et ne se demande pas tous les jours s'il a eu
raison de choisir de le devenir ou de le rester, ce qui serait dlibrer sur la fin et,
craint Aristote, dlibrer sans fin. Un mdecin, un architecte, un homme politique,
transforms en Hamlet, ne seraient plus aux yeux d'Aristote un bon mdecin, un
bon architecte, un bon politicien. Il reste que ces cas typiques ne sauraient puiser
le sens du pros to tlos et laissent la porte ouverte la sorte de dlibration dont
l'enjeu serait celui-ci : qu'est-ce qui va compter pour moi comme une description
adquate de la fin de ma vie ? Si telle est bien la question ultime, la dlibration
prend un tout autre cours qu'un choix entre des moyens : elle consiste plutt
spcifier, rendre plus dtermine pratiquement, faire cristalliser cette nbu-
leuse de sens que nous appelons vie bonne .
2. Pierre Aubenque, La Prudencechez Aristote. Paris. PUF, 1963.
3. Lisons VI. 5, 1140 a 24-28 : Une faon dont nous pourrions apprhender la
nature de la sagesse pratique [Tricot : la prudence], c'est de considrer quelles sont
les personnes que nous appelons sages [prudents]. De l'avis gnral, le propre d'un
homme sage, c'est d'tre capable de dlibrer correctement sur ce qui est bon et
avantageux pour lui-mme, non pas sur un point partiel (comme par exemple
quelles sortes de choses sont favorables la sant ou la vigueur du corps), mais
d'une faon gnrale, quelles sortes de choses par exemple conduisent la vie heu-
reuse. Une preuve, c'est que nous appelons aussi sages ceux qui le sont dans un
domaine dtermin, quand ils calculent avec justesse en vue d'atteindre une fin
particulire digne de prix, dans des questions o il n'est pas question d'art
[tekhn] : il en rsulte que. en un sens gnral aussi, sera un homme sage celui qui
est capable de dlibration (trad. Tricot modifie). Lisons encore VI, S, 1141 b
8-16 : Or la sagesse pratique [prudence] a un rapport aux choses humaines et aux
choses qui admettent la dlibration : car le sage, disons-nous, a pour uvre prin-
cipale de bien dlibrer ; mais on ne dlibre jamais sur les choses qui ne peuvent
204
205
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
compte comme la spcification la plus approprie aux fins ultimes
poursuivies ? A cet gard, l'enseignement le plus fort du livre VI
concerne le lien troit tabli par Aristote entre la phronsis et le
phronimos, lien qui ne prend sens que si l'homme de jugement sage
dtermine en mme temps la rgle et le cas, en saisissant la situation
dans sa pleine singularit. C'est cet usage de la phronsis que nous
reviendrons dans la neuvime tude, lorsque nous suivrons le
mouvement de retour de la norme morale la vise thique dans des
situations singulires indites
1
.
C'est accompagns par ces esquisses de solutions et par ces perplexits
que nous allons chercher dans la rvision du concept d'action propose
dans l'tude prcdente le moyen, sinon de rsoudre les difficults du
texte d'Aristote - en un sens archologique et philologique -, du moins de
leur rpondre avec les ressources de la pense contemporaine.
On se rappelle de quelle manire, sous la pression de la thorie
narrative, nous avons t conduits non seulement largir mais
hirarchiser le concept de l'action de manire le porter au niveau de
celui de praxis : ainsi avons-nous plac, des hauteurs diffrentes sur
l'chelle de la praxis, pratiques et plans de vie, rassembls par
l'anticipation de l'unit narrative de la vie. Nous avons alors fait porter
l'accent sur le principe unificateur propre chacune de ces entits
pratiques. C'est la mme hirarchie de la praxis que nous allons
parcourir nouveau, cette fois du point de vue de son intgration thique
sous l'ide de la vie bonne .
Le principe unificateur d'une pratique - mtier, jeu. art - ne rside
pas seulement dans des relations logiques de coordination, voire de
subordination ou d'enchssement , ni mme dans le rle
tre autrement qu'elles ne sont, ni sur celles qui ne comportent pas quelque Tin
atteindre, fin qui consiste en un bien ralisable. Le bon dlibrateur au sens
absolu est l'homme qui s'efforce d'atteindre le meilleur des biens ralisables pour
l'homme, et qui le fait par raisonnement (trad. Tricot modifie).
1. voquons ds maintenant VI, 9, 1142 a 22-31 : Aristote n'hsite pas rap-
procher la singularit du choix selon la phronsis de ce qu'est la perception
(aisth-sis) dans la dimension thortique. L'argument qui est ainsi joint ne
manquera pas d'tonner: car dans cette direction aussi on devra s'arrter
(ibid). La sagesse pratique parat ainsi avoir deux limites : une limite suprieure, le
bonheur, et une limite infrieure, la dcision singulire.
2. Ce lien entre coordination et subordination dans la connexion logique d'une
pratique autorise une rinterprtation prudente du rapport entre poisiset praxis
chez Aristote. Du point de vue de la coordination linaire, le lien ressemble plus
la poisis d'Aristote, dans lequel l'action a son rsultat l'extrieur de l'agent, en
ce sens que le rsultat est extrieur au segment considr auquel l'agent confie son
pouvoir-faire ; du point de vue de la subordination, le lien ressemble plus la
praxis, en ce sens que labourer est fait pros to tlos. en vue de la fin, tandis
qu'exercer le mtier d'agriculteur est une action faite pour elle-mme , aussi
des rgles constitutives, au sens de la thorie des jeux et de la thorie des
actes de discours, dont la neutralit thique doit tre rappele. C'est
toutefois la dimension significative apporte par la notion de rgle
constitutive qui ouvre l'espace de sens dans lequel peuvent se dployer
des apprciations de caractre valua-tif (et ultrieurement normatif)
attaches aux prceptes du bien faire. La qualification proprement
thique de ces prceptes est assure par ce que Maclntyre appelle
talons d'excellence (standards of excellence), lesquels permettent de
qualifier bons un mdecin, un architecte, un peintre, un joueur d'checs
1
.
Ces talons d'excellence sont des rgles de comparaison appliques des
aboutissements diffrents, en fonction d'idaux de perfection communs
une certaine collectivit d'excutants et intrioriss par les matres et
les virtuoses de la pratique considre. On voit combien est prcieux ce
recours aux talons d'excellence de la pratique pour rfuter
ultrieurement toute interprtation solip-siste de l'estime de soi, sur le
trajet de laquelle nous plaons les pratiques. Les pratiques, avons-nous
observ la suite de Maclntyre, sont des activits coopratives dont les
rgles constitutives sont tablies socialement ; les talons d'excellence
qui leur correspondent au niveau de telle ou telle pratique viennent de
plus loin que l'excutant solitaire. Ce caractre coopratif et traditionnel
des pratiques n'exclut pas, mais bien plutt suscite la controverse,
principalement quant la dfinition des talons d'excellence qui ont eux
aussi leur propre histoire. Il reste vrai, nanmoins, que la comptition
entre excutants et la controverse concernant les talons d'excellence
n'auraient pas lieu s'il n'existait pas dans la culture commune aux
praticiens un accord assez durable sur les critres qui dfinissent les
niveaux de succs et les degrs d'excellence.
De quelle manire ces talons d'excellence se rapportent-ils la vise
thique du bien-vivre ? D'une double manire. D'une part, avant de
qualifier comme bon l'excutant d'une pratique, les talons d'excellence
permettent de donner sens l'ide de biens immanents la pratique. Ces
biens immanents constituent la tlologie interne l'action, comme
l'expriment au plan phno-
longtemps toutefois que l'agriculteur ne met pas en question le choix de son
mtier. Si notre analyse est correcte, aucune action n'est seulement poisisou seu-
lement praxis. Elle doit tre poisisen vue d'tre praxis. Cette remarque te beau-
coup de son intrt la distinction, au reste peu stable chez Aristote, entre poisis
et praxis ; l'pope qui raconte l'action des hros et la tragdie qui la met en scne
ne sont-elles pas des formes de poisis ? 1. A. Maclntyre, A/ter Virtue, op. cit.
206
207
SOI-MME COMME UN AUTRE LE SOI ET LA VISE THIQUE
mnlogique les notions d'intrt et de satisfaction qu'il ne faut pas
confondre avec celles de plaisir. Ce concept de bien immanent, cher
Maclntyre, donne ainsi un premier point d'appui au moment rflexif
de l'estime de soi, dans la mesure o c'est en apprciant nos actions que
nous nous apprcions nous-mmes comme en tant l'auteur. D'autre
part, le concept de biens immanents doit tre tenu en rserve en vue
d'une reprise ultrieure l'intrieur de la conception proprement
normative de la morale, lorsqu'il s'agira de donner un contenu la
forme vide de l'impratif catgorique. En ce sens, l'ide de biens
immanents occupe dans notre entreprise une double position
stratgique.
C'est cette notion de biens immanents la pratique que l'intgration
des actions partielles dans l'unit plus vaste des plans de vie donne une
extension parallle. On se rappelle de quelle manire la thorie
narrative a suscit la prise en compte de ce degr plus lev
d'intgration des actions dans des projets globaux, incluant par exemple
vie professionnelle, vie de famille, vie de loisir, vie associative et
politique. Un second regard jet sur cette notion permet de revenir sur
une des difficults rencontres dans Ythique Nicomaque concernant
la validit du rapport moyen-fin. Selon ce modle, le mdecin est dj
mdecin, il ne se demande pas s'il souhaite le rester ; ses choix sont de
nature purement instrumentale : soigner ou oprer, purger ou tailler.
Mais qu'en est-il du choix de la vocation mdicale ? Ici le modle
moyen-fin ne suffit plus. Il s'agit plutt de spcifier les vagues idaux
concernant ce qui est tenu pour vie bonne au regard de l'homme tout
entier, en usant de cette phronsis dont nous avons montr plus haut
qu'elle chappe au modle moyen-fin. Les configurations d'action que
nous appelons plans de vie procdent alors d'un mouvement de
va-et-vient entre des idaux lointains, qu'il faut maintenant spcifier, et
la pese des avantages et des inconvnients du choix d'un tel plan de vie
au niveau de la pratique. C'est en ce sens que Gadamer interprte la
phronsis aristotlicienne'.
Une remarque encore concernant l'expression plan de vie .
L'apparition du mot vie mrite rflexion. Il n'est pas pris en un sens
purement biologique, mais au sens thico-culturel, bien connu des
Grecs, lorsqu'ils comparaient les mrites respectifs des bioi offerts au
choix le plus radical : vie de plaisir, vie active au sens politique, vie
contemplative. Le mot vie dsigne
1. Vritet Mthode. Paris. d. du Seuil, 1973, deuxime partie, chap. II, 2 : La
pertinence hermneutique d'Aristote .
l'homme tout entier par opposition avec les pratiques fragmentes.
Ainsi Aristote - encore lui ! - demandait-il s'il y a un ergon - une
fonction, une tche pour l'homme en tant que tel, comme il y a une tche
pour le musicien, pour le mdecin, pour l'architecte... Pris comme terme
singulier, le mot vie reoit la dimension apprciative, valuative,
de Vergon qui qualifie l'homme en tant que tel. Cet ergon est la vie,
prise dans son ensemble, ce qu'est l'talon d'excellence une pratique
particulire.
C'est ce lien entre Vergon de l'homme - ce que nous appelons plan
de vie - et les talons d'excellence spcifis par chaque pratique qui
permet de rpondre la difficult de Vthique Nicomaque voque
plus haut : comment, demandions-nous, peut-on soutenir la fois que
chaque praxis a une fin en elle-mme et que toute action tend vers
une fin ultime ? C'est dans le rapport entre pratique et plan de vie
que rside le secret de l'embotement des finalits ; une fois choisie, une
vocation confre aux gestes qui la mettent en uvre ce caractre de fin
en elle-mme ; mais nous ne cessons de rectifier nos choix initiaux ;
parfois nous les renversons entirement, lorsque la confrontation se
dplace du plan de l'excution des pratiques dj choisies la question
de l'adquation entre le choix d'une pratique et nos idaux de vie, aussi
vagues soient-ils et pourtant plus imprieux parfois que la rgle du jeu
d'un mtier que nous avons tenue jusque-l pour invariable. Ici la
phronsis suscite une dlibration fort complexe, o le phronimos n'est
pas moins impliqu qu'elle.
Je ne reviendrai pas ici sur la place assigne par Maclntyre l' unit
narrative d'une vie entre les pratiques et plans de vie et ce qu'Aristote
dsigne du terme de bien-vivre. Le terme de vie qui figure trois fois
dans les expressions plan de vie , unit narrative d'une vie , vie
bonne , dsigne la fois l'enracinement biologique de la vie et l'unit
de l'homme tout entier, en tant qu'il jette sur lui-mme le regard de
l'apprciation. C'est dans la mme perspective que Socrate a pu dire
qu'une vie non examine n'est pas digne de ce nom. Quant au terme
unit narrative , c'est moins la fonction de rassemblement, exerce par le
rcit au sommet de l'chelle de la praxis, que nous soulignons ici, que la
jonction que le rcit opre entre les estimations appliques aux actions et
l'valuation des personnages eux-mmes. L'ide d'unit narrative d'une
vie nous assure ainsi que le sujet de l'thique n'est pas autre que celui
qui le rcit assigne une iden-
208 209
SOI-MME COMME UN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
tit narrative. En outre, tandis que la notion de plan de vie met
l'accent sur le ct volontaire, voire volontariste, de ce que Sartre
appelait projet existentiel, la notion d'unit narrative met l'accent
sur la composition entre intentions, causes et hasards, que l'on
retrouve en tout rcit. L'homme y apparat d'emble comme
souffrant autant qu'agissant et soumis ces alas de la vie qui font
parler l'excellente hellniste et philosophe Martha Nussbaum de la
fragility ofgoodness, qu'il faudrait traduire par la fragilit de la
qualit bonne de l'agir humain.
La srie d'intermdiaires que nous venons de parcourir trouve,
sinon un achvement, du moins un horizon, ou si l'on prfre une
ide limite, dans la notion plusieurs fois voque de vie bonne .
Mais il ne faut pas se mprendre sur le contenu et le statut de cette
notion dans la thorie de la praxis.
Concernant le contenu, la vie bonne est, pour chacun, la
nbuleuse d'idaux et de rves d'accomplissement au regard de
laquelle une vie est tenue pour plus ou moins accomplie ou inac-
complie. C'est le plan du temps perdu et du temps retrouv. En ce
sens, c'est le ce en vue de quoi tendent ces actions dont nous
avons dit pourtant qu'elles ont leur fin en elles-mmes. Mais cette
finalit dans la finalit ne ruine pas la suffisance soi des pratiques,
aussi longtemps que leur fin est dj pose et reste pose ; cette
ouverture, qui fracture des pratiques qu'on aurait dites closes sur
elles-mmes, lorsque le doute nous saisit concernant l'orientation de
notre vie, maintient une tension, le plus souvent discrte et tacite,
entre le clos et l'ouvert dans la structure globale de la praxis. Ce qui
est ici penser, c'est l'ide d'une finalit suprieure qui ne cesserait
pas d'tre intrieure l'agir humain.
Quant au statut pistmique de cet horizon ou de cette ide limite,
il met en jeu de faon dcisive le lien voqu plus haut entre la
phronsis et le phronimos. Dans un langage plus moderne, nous
dirions que c'est dans un travail incessant d'interprtation de l'action
et de soi-mme que se poursuit la recherche d'adquation entre ce
qui nous parat le meilleur pour l'ensemble de notre vie et les choix
prfrentiels qui gouvernent nos pratiques. Il y a plusieurs faons
d'introduire ce stade final le point de vue hermneutique. D'abord,
entre notre vise de la vie bonne et nos choix particuliers, se
dessine une sorte de cercle hermneutique en vertu du jeu de
va-et-vient entre l'ide de vie bonne et les dcisions les plus
marquantes de notre existence (carrire, amours, loisirs, etc.). Il en
est ainsi comme d'un texte dans lequel le tout et la partie se
comprennent l'un par l'autre. Ensuite, l'ide
d'interprtation ajoute, la simple ide de signification, celle de
signification pour quelqu'un. Interprter le texte de l'action, c'est
pour l'agent s'interprter lui-mme. Je rejoins ici un thme important
de Ch. Taylor dans ses Philosophical Papers : l'homme, dit-il, est un
self-interpreting animal'. Du mme coup, notre concept du soi sort
grandement enrichi de ce rapport entre interprtation du texte de
l'action et auto-interprtation. Au plan thique, l'interprtation de
soi devient estime de soi. En retour, l'estime de soi suit le destin de
l'interprtation. Comme celle-ci, elle donne lieu la controverse,
la contestation, la rivalit, bref au conflit des interprtations, dans
l'exercice du jugement pratique. Cela signifie que la recherche
d'adquation entre nos idaux de vie et nos dcisions, elles-mmes
vitales, n'est pas susceptible de la sorte de vrification que l'on peut
attendre des sciences fondes sur l'observation. L'adquation de
l'interprtation relve d'un exercice du jugement qui peut au mieux
se prvaloir, au moins aux yeux des autres, de la plausibilit, mme
si, aux yeux de l'agent, sa propre conviction confine la sorte
d'vidence exprientielle qui, au terme du livre VI de Y thique
Nicomaque, faisait comparer la phronsis Yaisthsis. Cette
vidence expriencielle est la nouvelle figure que revt
Vat-testation, quand la certitude d'tre l'auteur de son propre
discours et de ses propres actes se fait conviction de bien juger et de
bien agir, dans une approximation momentane et provisoire du
bien-vivre.
2. ... avec et pour l'autre...
C'est d'une seule traite, sans solution apparente de continuit, qu'a
t prononce au dbut de cette tude la dfinition de la perspective
thique : viser la vraie vie avec et pour l'autre dans des
institutions justes. Au second stade de notre mditation, la question
pose est celle-ci : comment la seconde composante de la vise
thique, que nous dsignons du beau nom de sollicitude,
enchane-t-elle avec la premire ? La question prend un tour para-
doxal qui suscite la discussion, ds lors que 1 on caractrise par
l'estime de soi l'aspect rflexif de cette vise. La rflexivit sem-
1. Ch. Taylor, Philosophical Papers. 2 vol., Cambridge University Press, 1985, 1.1,
Human Agencyand Language. chap. II, p. 45.
210
211
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA VISE THIQUE
ble en effet porter en elle la menace d'un repli sur soi, d'une fermeture,
au rebours de l'ouverture sur le grand large, sur 1l'horizon de la vie
bonne . En dpit de ce pril certain, ma thse est que la sollicitude ne
s'ajoute pas du dehors l'estime de soi, mais qu'elle en dplie la
dimension dialogale jusqu'ici passe sous silence. Par dpli, comme il a
t dj dit dans un autre contexte, j'entends, certes, une rupture dans la
vie et dans le discours, mais une rupture qui cre les conditions d'une
continuit de second degr, telle que l'estime de soi et la sollicitude ne
puissent se vivre et se penser l'une sans l'autre.
Que la solution ici esquisse du paradoxe ne soit pas impensable,
c'est tout ce que l'on peut affirmer au terme de la prcdente analyse.
Observons d'abord que ce n'est pas un hasard s'il a t
constamment parl d'estime de soi et non d'estime de moi. Dire soi
n'est pas dire moi. Certes, la miennet est implique d'une certaine faon
dans l'ipsit, mais le passage de l'ipsit la miennet est marqu par la
clause chaque fois (allemand Je), que Heidegger prend soin de
joindre la position de miennet. Le soi, dit-il, est chaque fois mien '. Or,
sur quoi se fonde ce chaque fois , sinon sur la rfrence non dite
l'autre ? Sur la base de ce chaque fois , la mienne possession de mes
expriences est en quelque sorte distribue sur toutes les personnes
grammaticales. Mais quelle condition cet autre sera-t-il, non une
rduplication du moi, un autre moi. un alter ego, mais vritablement un
autre que moi ? A cet gard, la rflexivitc d'o procde l'estime de soi
reste abstraite, en ce sens qu'elle ignore la diffrence entre moi et toi.
Autre observation prliminaire : si l'on demande quel titre le soi est
dclar digne d'estime, il faut rpondre que ce n'est pas principalement
au titre de ses accomplissements, mais fondamentalement celui de ses
capacits. Pour bien entendre ce terme de capacit, il faut revenir au je
peux de Merleau-Ponty et l'tendre du plan physique au plan thique.
Je suis cet tre qui peut valuer ses actions et, en estimant bons les buts
de certaines d'entre elles, est capable de s'valuer lui-mme, de s'estimer
bon. Le discours du je peux est certes un discours en je. Mais
l'accent principal est mettre sur le verbe, sur le pouvoir-faire, auquel
correspond au plan thique le pouvoir-juger. La question est alors de
savoir si la mdiation de l'autre n'est pas requise sur le trajet de la
capacit Peffectuation.
I. Heidegger, treet Temps. 25.
La question n'est aucunement rhtorique. Sur elle, comme l'a soutenu
Charles Taylor, se joue le sort de la thorie politique. Ainsi maintes
philosophies du droit naturel prsupposent un sujet complet dj
bard de droits avant l'entre en socit. Il en rsulte que la participation
de ce sujet la vie commune est par principe contingente et rvocable,
et que l'individu - puisqu'il faut appeler ainsi la personne dans cette
hypothse - est fond attendre de l'tat la protection de droits
constitus en dehors de lui, sans que pse sur lui l'obligation intrinsque
de participer aux charges lies au perfectionnement du lien social. Cette
hypothse d'un sujet de droit, constitu antrieurement tout lien
socital, ne peut tre rfute que si on en tranche la racine. Or, la racine,
c'est la mconnaissance du rle mdiateur de l'autre entre capacit et
effectuation.
C'est trs exactement ce rle mdiateur qui est clbr par Aris-tote
dans son trait de l'amiti (philia - th. Nie, VIII-IX) '. Il ne me dplat
pas de faire route un moment avec Aristote dans une tude dont le ton
est de bout en bout aristotlicien. Mais les raisons de ce choix sont plus
topiques. D'abord, chez Aristote lui-mme, l'amiti fait transition entre
la vise de la vie bonne , que nous avons vue se rflchir dans
l'estime de soi, vertu solitaire en apparence, et la justice, vertu d'une
pluralit humaine de caractre politique. Ensuite, l'amiti ne ressortit
pas titre premier une psychologie des sentiments d'affection et
d'attachement pour les autres (ce que le trait aristotlicien est aussi bien
des gards), mais bien une thique : l'amiti est une vertu - une
excellence -, l'uvre dans des dlibrations choisies et capable de
s'lever au rang d'habitus, sans cesser de requrir un exercice effectif,
sans quoi elle cesserait d'tre une activit. Enfin, et surtout, le trait, qui
semble longtemps faire la part belle ce qui parat bien tre une forme
raffine d'gosme, sous le titre de phi-lautia, finit par dboucher, de
faon presque inattendue, sur l'ide que l'homme heureux a besoin
d'amis (ibid., IX, 9). L'altrit retrouve ainsi les droits que la
philautia paraissait devoir occulter. Or, c'est en liaison avec les notions
de capacit et d'effectuation, c'est--dire finalement de puissance et
'acte
1
, que
1. Sur la place de la philosophie aristotlicienne de l'amiti dans la philosophie
antique, cf. J.-C. Fraisse, Philia. La notion d'amitidans la philosophieantique.
Paris. Vrin, 1984, p. 189-286.
2. On verra en ix, 9, l'analyse de l'amiti ctoyer le difficile problme de la
puissance et de l'acte, de l'activit (nergia) et de l'acte au sens fort (entlchiia).
que nous prendrons le risque d'affronter directement dans la dixime tude,
deuxime section.
212
213
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
place est faite au manque, et par la mdiation du manque Vautre.
La fameuse aporie, consistant savoir s'il faut s'aimer soi-mme pour
aimer un autre que soi, ne doit donc pas nous aveugler. C'est elle en fait
qui conduit directement au cur de la problmatique du soi et de l'autre
que soi '. Nous n'attaquerons toutefois pas directement cette question
dispute, suscite tant par les dictons populaires et les souvenirs
littraires (Homre, Thucydide, les Tragiques...) que par les querelles
d'cole, ouvertes ds le Lysis de Platon et envenimes par les successeurs
de ce dernier la direction de l'Acadmie. Deux thses doivent au
pralable tre mises en place.
Il faut d'abord prendre un solide appui sur la dfinition par laquelle
Aristote entend se distinguer, au plan thique prcisment, de ses
prdcesseurs et concurrents : l'amiti, dclare Aristote d'entre de jeu,
n'est pas d'une seule espce ; c'est une notion essentiellement quivoque,
que l'on ne peut tirer au clair qu'en interrogeant la sorte de choses qui lui
donnent naissance, son objet, en ce sens, les philta. Ainsi faut-il
distinguer trois sortes d'amitis : selon le bon , selon l' utile ,
selon l' agrable . On ne saurait trop souligner, dans la perspective de
la fameuse aporie de l'gosme, cette distinction entre trois
objets-motifs. Le ct objectif de l'amour de soi fera prcisment que
la philautia - qui fait de chacun l'ami de soi-mme - ne sera jamais
prdilection non mdiatise de soi-mme, mais dsir orient par la
rfrence au bon.
Seconde thse pralable : quoi qu'il en soit de la place de la philautia
dans la gense de l'amiti, celle-ci se donne d'emble comme une
relation mutuelle. La rciprocit appartient sa dfinition la plus
lmentaire et enveloppe ds lors la question dispute du primat de la
philautia. Celui-ci ne sera jamais qu'un aspect relevant de la gense de
sens plutt que de la chronologie des sentiments de mutualit. Cette
rciprocit, on le verra, va jusqu' la mise en commun d'un
vivre-ensemble (suzn) - bref, jusqu' l'intimit.
Ce second trait importe autant que le premier notre propre
investigation ; non seulement l'amiti relve effectivement de l'thique,
comme tant le premier dpli du souhait de vivre bien ; mais, surtout,
elle porte au premier plan la problmatique de la
1. Nous serons particulirement attentifs cet gard au jeu subtil, et parfaite-
ment contrl, entre le pronom autos (lui), et sa forme rflchie hauton. hautou,
haut (soi-mme, de soi-mme, soi-mme), toujours dcline l'accusatif et
aux cas indirects.
rciprocit, nous autorisant ainsi rserver pour une dialectique de
second degr, hrite de la dialectique platonicienne des grands
genres - le Mme et l'Autre -, la question de l'altrit en tant que telle'.
L'ide de mutualit a en effet des exigences propres que n'clipseront
ni une gense partir du Mme, comme chez Husserl, ni une gense
partir de l'Autre, comme chez Lvinas. Selon l'ide de mutualit,
chacun aime l'autre en tant que ce qu'il est (VIII, 3, 1156 a 17). Ce n'est
prcisment pas le cas dans l'amiti utilitaire, o l'un aime l'autre en
raison de l'avantage attendu, moins encore dans l'amiti plaisante. On
voit ainsi s'imposer, ds le plan thique, la rciprocit, qui, au plan
moral, l'heure de la violence, sera requise par la Rgle d'Or et
l'impratif catgorique du respect
2
. Ce en tant que (en tant que ce
que l'autre est) prvient toute drive gologique ultrieure : il est
constitutif de la mutualit. Celle-ci, en retour, ne se laisse pas penser
sans le rapport au bon, dans le soi, dans l'ami, dans l'amiti, si bien que la
rflexivit du soi-mme n'est pas abolie, mais comme ddouble, par la
mutualit, sous le contrle du prdicat bon , appliqu aussi bien aux
agents qu'aux actions
3
. Ajoutons que par la mutualit l'amiti jouxte la
justice ; le vieil adage amiti-galit dsigne exactement la zone
d'intersection : chacun des deux amis rendant l'autre l'gal de ce qu'il
reoit. L'amiti n'est toutefois pas la justice, dans la mesure o celle-ci
rgit les institutions, et celle-l les rapports interpersonnels. C'est
pour cette raison que la justice enveloppe de
1. La dfinition provisoire qu'on lit en VIII, 2, 1156 a 2-5 marque bien la
combinaison des deux traits de l'amiti au plan thique : primat de l'amiti ver-
tueuse sur l'amiti utilitaire et agrable, mutualit des sentiments de bienveillance
( quoi Aristote ajoute la non-ignorance, que nous retrouverons plus loin en rap-
port avec le concept technique de conscience) : Il faut donc qu'il y ait bienveil-
lance mutuelle, chacun souhaitant le bien de l'autre ; que cette bienveillance ne
reste pas ignore des intresss ; et qu'elle ait pour cause l'un des objets dont nous
avons parl (trad. Tricot, p. 387).
2. Il est remarquable cet gard que le premier usage du pronom rflchi soit
li la mutualit mdiatise par le bon : Ainsi donc, ceux dont l'amiti rci-
proque a pour source l'utilit ne s'aiment pas l'un l'autre pour eux-mmes
[kath-'hautous], mais en tant qu'il y a quelque bien qu'ils retirent l'un de l'autre
[autois par'alllln] (VIII, 3, 1156 a 10-12). Ce jeu entre le terme non rflchi
(autos) et les formes rflchies (hauton...) court travers les livres VIII et IX.
3. Mais la parfaite amiti est celle des hommes vertueux et qui sont sem-
blables en vertus : car ces amis-l se souhaitent pareillement du bien les uns aux
autres en tant qu'ils sont bons, et ils sont bons par eux-mmes [kath'hautous]
(VIII, 4, 115 6b 7-9) ; et un peu plus loin : Et en aimant leur ami ils aiment ce qui
est bon pour eux-mmes [hautois], puisque l'homme bon, en devenant un ami,
devient un bien pour celui qui est son ami (VIII, 7, 1157 b 31-32).
214
215
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA VISE THIQUE
nombreux citoyens, alors que l'amiti ne tolre qu'un trs petit nombre
de partenaires ; en outre, dans la justice l'galit est pour l'essentiel
galit proportionnelle, compte tenu de l'ingalit des contributions,
alors que l'amiti ne rgne qu'entre des gens de bien de rang gal ; en ce
sens, l'galit est prsuppose par l'amiti alors que, dans les cits, elle
demeure une cible atteindre. C'est pourquoi seule l'amiti peut viser
l'intimit - la sunthia -(VIII, 7, 1158 a 15) d'une vie partage
(suzn).
On voit ainsi se prparer de longue main la rponse nuance la
question dispute de savoir s'il faut tre l'ami de soi-mme pour tre
l'ami de l'autre. Le traitement de cette difficult hrite de la tradition
est entirement subordonn la rfrence au bon dans les souhaits que
les amis formulent l'un l'gard de l'autre. Car, le soi-mme que l'on
aime, c'est le meilleur de soi, appel plusieurs fois pense ou intellect
(nous), ou mme me, savoir ce qui en soi-mme est le plus durable, le
plus stable, le moins vulnrable au changement des humeurs et des
dsirs, ainsi qu'aux accidents de la fortune. Bien avant d'en venir (en IX,
4 et 8) la fameuse question dispute, Aristote dclare que le plus
grand bien que l'ami dsire son ami, c'est qu'il demeure ce qu'il est, et
non par exemple un dieu ; quoi il ajoute : peut-tre mme ne lui
souhaitera-t-il pas tous les plus grands biens, car c'est surtout pour
soi-mme [haut] que tout homme souhaite les choses qui sont bonnes
(VIII, 9. 1159 a 11-12). L'amour de l'homme bon pour lui-mme
contredit d'autant moins le dsintressement prn par Platon dans le
Lysis que ce qu'on aime en soi-mme n'est pas la partie dsirante qui
motive l'amiti utilitaire ou agrable, mais la meilleure part de
soi-mme
1
.
Cette solidit de l'tre raisonnable, qui met le soi l'abri mme du
regret, de la pnitence, peut nous paratre bien loigne de la fragilit et
de la vulnrabilit que notre rflexion sur l'identit personnelle a
soulignes. Nous verrons tout l'heure la limite de cette prtention,
quand nous voquerons le besoin, donc le manque, qui portent le soi
vers l'autre. C'est du moins cette stabilit de la meilleure part de
soi-mme que nous devons la belle formule selon laquelle l'ami est un
autre soi (allos autos) (IX,
1. Je laisse de ct la casuistique de l'amiti qui traverse sans interruption les
deux traits que l'thique Nicomaqueconsacre l'amiti. Le philosophe joue
constamment sur les limites, qu'il s'agisse d'amiti entre gaux ou entre ingaux
ou qu'il s'agisse de situations la frontire du dsintressement, de l'intrt et du
plaisir. M'intresse seule la dialectique de soi-mme et de l'autre dans le manie-
ment des concepts qui structurent l'amiti entre gens de bien.
4, 1166 a 32) '. Cela devient ds lors une simple question d'cole,
qu'Aristote joint d'autres questions disputes, de savoir s'il faut s'aimer
soi-mme plutt que l'autre. Son verdict est clair : les adversaires de la
philautia ont raison, si celle-ci relve de l'espce utilitaire ou plaisante de
l'amiti ; mais ils ont tort, s'ils feignent d'ignorer que, ce qui est aimable
en chacun, c'est le meilleur du soi, la partie pensante, l'intellect. Ce
qu'Aristote suggre ici, mais ne semble pas mettre en question, c'est que
la rflexivit adhre au raisonnable, s'il est vrai que toujours
l'intellect choisit ce qu'il y a de plus excellent pour lui-mme [haut]
(IX, 8 1169a 18) ; l'argument demande seulement que cette rflexivit
soit partage titre gal entre soi-mme et l'autre. De cette faon, elle
n'empche pas que l'amiti soit dsintresse et ce, jusqu'au sacrifice
(IX, 8), car le dsintressement est dj enracine dans le rapport de soi
soi, en vertu du lien originaire entre intellect, excellence et rflexivit. On
peut seulement se plaindre de ce qu'Aristote ait laiss en suspens la
question de savoir s'il peut y avoir amiti entre soi et soi-mme ; cette
question, dit Aristote, nous pouvons la laisser de ct pour le moment
(IX, 4, 1166 a 32). La vritable rponse est chercher au dtour de
l'examen d'une question plus fondamentale que toutes les prcdentes,
savoir si l'homme heureux aura ou non besoin d'amis (IX, 9). La
question ici pose est si peu secondaire que c'est la rsoudre
qu'Aristote dploie la plus impressionnante batterie d'arguments de tout
le trait double sur l'amiti
2
. Avec le besoin et le manque, c'est l'altrit
de l' autre soi (htros autos) (IX, 9, 1169 b 6 - 7 et 1170 b 6) qui
passe au premier plan. L'ami, en tant qu'il est cet autre soi, a pour rle de
pourvoir ce qu'on est incapable de se procurer par soi-mme (di'hautou)
(IX, 9, 1169 b 6-7). La possession des amis, lit-on avec tonnement, est
tenue d'ordinaire pour le plus grand des biens extrieurs (ibid, b 10). Il
est remarquable que, pour dnouer ce nud, Aristote soit contraint de
jouer les atouts majeurs de sa mtaphysique, savoir la distinction enttre
acte et puissance, quoi ressortit la notion de possession qui est en jeu
ici.
1. On notera encore une fois le jeu subtil entre autos non rflchi et hauton
rflchi que l'on rencontre dans la formule : il faut tre l'ami de soi-mme
(deiphi-lauton einai, IX, 8, 1169 a 12).
2. Tricot (op. cit.. p. 464-465) et Gauthier-Jolif (op. cit.. t. II, Commentaires,
deuxime partie, p. 757-759) ne dnombrent pas moins d'une dizaine de proto-
syllogismes et d' arguments - ou de raisonnements (G.-J.) - dans la partie du
chapitre o Aristote dit qu'il serrera de plus prs la nature mme des choses
(phusiktron - trad. Tricot ; G.-J. traduisent : aller plus au fond de notre
nature ).
216 217
SOI-MME COMME UN AUTRE LE SOI ET LA VISE THIQUE
Si l'homme bon et heureux a besoin d'amis, c'est que l'amiti est une
activit (nergia), laquelle est videmment un devenir , et donc
seulement l'actualisation inacheve de la puissance. Par l, elle est en
dfaut par rapport l'acte, au sens fort du terme (entlchia). La porte
est ainsi ouverte une rectification de la conception intellectualiste de
l'amiti dveloppe jusqu'ici. Sous l'gide du besoin, un lien se noue
entre activit et vie, enfin entre bonheur et plaisir. C'est donc aux
conditions d'effectuation de la vie, considre dans sa bont intrinsque
et son agrment foncier, que l'amiti concourt. Il faut aller plus loin : aux
notions de vie et d'activit, il faut joindre celle de conscience
1
. La
conscience n'est pas seulement conscience de la perception et de
l'activit, mais conscience de la vie. Dans la mesure ds lors o la
conscience de la vie est agrable, on peut dire que le sens profond de la
philautia est dsir : la propre existence de l'homme de bien est pour
lui-mme dsirable ; ds lors, c'est aussi l'existence de son ami qui est
galement dsirable pour lui. Ayant ainsi joint dans une gerbe unique
l'activit et la vie, le dsirable et l'agrable, la conscience d'exister et la
joie de la conscience d'exister, Aristote peut poser, titre de conclusion
partielle de son raisonnement compliqu : Dans ces conditions, de
mme que pour chacun de nous sa propre existence est une chose
dsirable, de mme est dsirable pour lui au mme degr, ou peu de
chose prs, l'existence de son ami (IX, 9, 1170 b 7-8). Et l'argument
peut rebondir : Mais nous avons dit que ce qui rend son existence
dsirable c'est la conscience qu'il a de sa propre bont, et une telle
conscience est agrable par elle-mme. Il a besoin, par consquent, de
participer aussi la conscience qu'a son ami de sa propre existence (IX,
9, 1170 b 9-11). Ce qui ne peut se raliser que dans le vivre-ensemble
(suzn, ibid., 1. 11).
En quoi ce raisonnement tortueux rpond-il la question pose de
savoir en quel sens un homme peut tre ami de lui-mme ? La rponse,
au moins partielle, est dans l'affirmation profre plus haut : la propre
existence de l'homme de bien est pour lui-mme dsirable . Ce dsirable
propre, si l'on peut ainsi parler, n'est pas tranger au besoin d'amis
qu'prouve l'homme heureux. Ce besoin tient non seulement ce
qu'il y a d'actif et d'inachev dans le vivre-ensemble, mais la sorte de
carence ou de manque qui tient au rapport mme du soi sa propre
existence. Du mme coup, l'assurance de stabilit sur laquelle repose
l'amiti comprise
1. Le verbe sunaisthesthai, ici employ (IX, 9, 1170 b 4), prfigure trs exacte-
ment le latin con-scientia.
comme un partage purement intellectuel d'opinions et de penses se voit
secrtement menace par cette rfrence au dsirable et l'agrable,
l'existence et la conscience d'exister, dont se soutient le
vivre-ensemble. C'est ainsi que le manque habite le cur de l'amiti la
plus solide.
On accordera volontiers qu'il n'y a pas place pour un concept franc
d'altrit chez Aristote. Vagap chrtienne suffira-t-elle lui faire plein
droit ? Ou faut-il attendre que l'ide de lutte reflue du champ politique
dans le champ interpersonnel, rendant, comme chez Hegel dans la
Phnomnologie de l'esprit, le conflit contemporain du ddoublement
de la conscience en deux consciences de soi ? Ou n'est-ce que de nos
jours qu'un penseur comme Lvinas ose renverser la formule : pas
d'autre que soi sans un soi , pour lui substituer la formule inverse : pas
de soi sans un autre qui le convoque la responsabilit ? Ce n'est que
dans la dixime tude, quand nous aurons clos notre enqute
thico-morale, que nous aurons les moyens de porter le dbat au niveau
de ce que j'appellerai, en souvenir de Platon, les grands genres du
Mme et de l'Autre.
D'Aristote, je ne veux retenir que l'thique de la mutualit, du
partage, du vivre-ensemble. Ce thme de l'intimit, sur lequel se conclut
son analyse en IX, 12, tient en suspens les deux interprtations adverses
que nous opposerons le moment venu. Quant l'ide que seul un soi peut
avoir un autre que soi ', elle me parat
1. Je rejoins ici certaines des analyses de Rmi Brague dans Aristote et la question
du monde (Paris, PUF, 1988), livre sur lequel je reviendrai longuement dans la
dixime tude. L'auteur, soucieux de porter au jour le non-dit de l'ontologie
aristotlicienne sous la conduite d'une thmatique heideggrienne, reconnat au soi
une fonction d'ouverture par rapport la structure englobante de
l'tre-dans-le-monde. Tout est l'affaire du soi. Cette centralit du soi, R. Brague la
retrouve prcisment dans de nombreux textes d'Aristote en dehors de ceux que je
commente ici, non sans qu'il dplore la confusion du soi. thme
phnomnologique, avec l'homme, thme anthropologique. Je dirai le moment
venu pourquoi je ne suis pas R. Brague dans cette dichotomie, contraire au rle
mdiateur que j'accorde toutes les objectivits (prdicats discursifs, pratiques,
narratifs, prescrip-tifs) dans le procs rflexif du soi. Cela dit, je rends un vif
hommage aux analyses prcises et aux traductions superbes qu'il fait, entre autres,
de fragments qui mettent en scne le soi-mme (op. cit., p. 132, 137, 142, 171, 173,
183, 187). En exergue de son interprtation, il cite le : Je sais moi-mme (autos
oida) de Xnophane (op. cit., p. Il), o le terme non rflchi autos veut dire en
personne ou personnellement, comme dans l'allemand Selbstgegebenheit,
autodonation . Pour qu'il y ait monde, il faut que je sois l en personne, sans que le
soi fasse nombre avec les choses qui meublent le monde. C'est en ce sens que le
rflchi hauton vient accentuer cette non-totalisation du soi et des choses du
monde. A cet gard le trait sur l'amiti est rapprocher de celui sur la phron-sis
(th. Nie, VI). C'est dans son cadre qu'on rencontre l'expression : le fait de
218 219
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA VISE THIQUE
cohrente avec toutes nos tudes antrieures ; elle trouve sa lgitimation
la plus proche dans l'ide que l'estime de soi est le moment rflexif
originaire de la vise de la vie bonne. A l'estime de soi, l'amiti ajoute
sans rien retrancher. Ce qu'elle ajoute, c'est l'ide de mutualit dans
l'change entre des humains qui s'estiment chacun eux-mmes. Quant
au corollaire de la mutualit, savoir l'galit, il met l'amiti sur le
chemin de la justice, o le partage de vie entre un trs petit nombre de
personnes cde la place une distribution de parts dans une pluralit
l'chelle d'une communaut politique historique.
Au terme de ce parcours en compagnie d'Aristote, la question se pose
de savoir quels traits nous accordons la sollicitude qui ne se trouvent
pas dj dcrits l'enseigne de l'amiti.
Je ne m'attarderai pas ceux des caractres de la philia antique qui
relvent plus de l'histoire des mentalits que de l'analyse conceptuelle,
tels que le lien entre amiti et loisir - tributaire lui-mme de la condition
de citoyen libre, dont sont exclus les esclaves, les mtques, les
femmes et les enfants -, et la rduction du vivre-ensemble un
penser-ensemble, lui-mme orient vers la contemplation du sage,
selon le dernier livre de Ythique Nicomaque. C'est du rapport entre
autos et hauton que je partirai pour laborer un concept englobant de
sollicitude, bas fondamentalement sur l'change entre donner et
recevoir
1
. L'amiti, mme dgage des limitations socioculturelles de la
philia, me parat constituer seulement un point fragile d'quilibre o le
don-
savoir [ce qui est bon] pour soi... (VI, 8. 1141 b 33). La phronsis est un tel
savoir soi (to haut eidnai de VI, 9, 1141 b 34), qui se laisse interprter par :
savoir que c'est soi de... . C'est pourquoi R. Brague ne parat aucunement
choqu de ce que l'amiti soit btie, chez Aristote, sur cet intressement de soi,
parfaitement compatible avec le dsintressement au sens moral du terme.
L'autre, finalement, n'est autre que soi que parce qu'il est un autre soi,
c'est--dire. comme nous-mme, soi : Nous dsirons que ce qu'il y a de bon soit
nous, parce que nous sommes, de faon dfinitive et incontournable, un "
nous-mme " (Brague, op. cit.. p. 141). Et pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu'il
nous est impossible d'tre autrui et de mconnatre ce fait primitif. * Je est un
autre " est pour Aristote une formule impossible (ibid., p. 134). J'accorde R.
Brague qu'Aristote ne donne pas les moyens de comprendre en quel sens
l'intellect est Vipse, voire mme Vipsissimumde l'homme (ibid., p. 173), ou,
plus grave encore, de dire que l'homme est lui-mme le plus proche, au point
d'tre son propre ami. J'ai cru. pour ma part, trouver une rponse partielle cette
difficult dans l'ide que le soi est structur par le dsir de sa propre existence. Et si
Aristote n'a pas de rponse complte ces questions, est-ce vritablement parce
que le concept, anthropologique, d'homme touffe celui, phnomnologique, de
soi, concept que seule une ontologie du souci permettrait de constituer ? 1. Peter
Kemp. thiqueet Mdecine, op. cit.
ner et le recevoir sont gaux par hypothse. A vrai dire, c'est cette galit
qu'Aristote a en vue lorsqu'il dfinit le caractre mutuel de l'amiti. Or ce
point d'quilibre peut tre considr comme le milieu d'un spectre dont
les extrmes opposs sont marqus par des disparits inverses entre le
donner et le recevoir, selon que l'emporte, dans l'initiative de l'change,
le ple du soi ou celui de l'autre.
Plaons-nous d'abord dans la premire hypothse. Toute la
philosophie d'E. Lvinas repose sur l'initiative de l'autre dans la relation
intersubjective. A vrai dire, cette initiative n'instaure aucune relation,
dans la mesure o l'autre reprsente l'extriorit absolue au regard d'un
moi dfini par la condition de sparation. L'autre, en ce sens, s'ab-sout
de toute relation. Cette irrelation dfinit l'extriorit mme
1
.
En vertu de cette irrelation, l' apparoir de l'Autre dans son visage
se soustrait la vision des formes et mme l'coute des voix. En vrit,
le visage n'apparat pas, il n'est pas phnomne, il est epiphanie. Mais de
qui est ce visage ? Je ne pense pas limiter indment la porte des
analyses au reste admirables de Totalit et Infini, pour ne rien dire ici
d'Autrement qu'tre ou au-del de l'essence, en disant que ce visage est
celui d'un matre de justice, d'un matre qui instruit et n'instruit que sur
le mode thique : il interdit le meurtre et commande la justice. Qu'en
est-il du rapport entre cette instruction, cette injonction, et l'amiti ? Ce
qui frappe immdiatement, c'est le contraste entre la rciprocit de
l'amiti et la dissymtrie de l'injonction. Certes, le soi' est assign
responsabilit par l'autre. Mais, l'initiative de l'injonction revenant
l'autre, c'est Yaccusatif seulement que le soi est rejoint par
l'injonction. Et l'assignation responsabilit n'a pour vis--vis que la
passivit d'un moi convoqu. La question est alors de savoir si, pour
tre entendue et reue, l'injonction ne doit pas faire appel une rponse
qui compense la dissymtrie du face--face. Prise la lettre, en effet,
une dissymtrie non compense romprait l'change du donner et du
recevoir et exclurait l'instruction par le visage du champ de la
sollicitude. Mais comment pareille instruction s'inscrirait-elle dans la
dialectique du donner et du recevoir, si une capacit de donner en
change n'tait libre par l'initiative mme de l'autre ? Or de quelles
res-
1. Je n'exprimerai ici qu'une faible partie de ma dette l'gard de Lvinas,
rservant pour la dixime tude la discussion du thme immense de l'altrit. qui
relve, comme je le suggre plus haut, d'une investigation des grands genres du
discours philosophique, la jointure de l'thique et de l'ontologie.
220 221
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
sources peut-il bien s'agir, sinon de ressources de bont qui ne
sauraient jaillir que d'un tre qui ne se dteste pas soi-mme au
point de ne plus entendre l'injonction de l'autre ? Je parle ici de
bont: il est, en effet, remarquable que, dans de nombreuses
langues, la bont se dit la fois de la qualit thique des buts de
l'action et de l'orientation de la personne vers autrui, comme si
une action ne pourrait tre estime bonne, si elle n'tait faite en
faveur d'autrui, par gard pour lui. C'est cette notion d'gard qui
doit maintenant nous arrter.
Pour la cerner, il faut revenir l'hypothse de travail qui rgit
cette tude et la suivante, savoir le primat de l'thique sur la
morale. De ce point de vue, le vocabulaire de l'assignation, de
l'injonction, est peut-tre dj trop moral et, cela admis, juste
titre hant par la Guerre, par le Mal ' ; c'est pourquoi l'Autre, sous la
figure du matre de justice, et mme sous celle du perscuteur, qui
passe au premier plan dans Autrement qu'tre ou au-del de
l'essence, doit forcer les dfenses d'un moi spar. Mais on est dj
dans l'ordre de l'impratif, de la norme. Notre pari, c'est qu'il est
possible de creuser sous la couche de l'obligation et de rejoindre un
sens thique qui n'est pas ce point enfoui sous les normes qu'il ne
puisse tre invoqu comme recours lorsque ces normes deviennent
leur tour muettes face des cas de conscience indcidables. C'est
pourquoi il nous importe tant de donner la sollicitude un statut plus
fondamental que l'obissance au devoir
2
. Ce statut est celui d'une
spontanit bienveillante, intimement lie l'estime de soi au sein
de la vise de la vie bonne . C'est du fond de cette spontanit
bienveillante que le recevoir s'gale au donner de l'assignation
responsabilit, sous la guise de la reconnaissance par le soi de la
supriorit de l'autorit qui lui enjoint d'agir selon la justice
3
. Cette
galit n'est certes pas celle de l'amiti, o le donner et le recevoir
s'quilibrent par hypothse. Elle compense plutt la dissymtrie
initiale, rsultant du primat de l'autre dans la situation d'instruction,
par le mouvement en retour de la reconnaissance.
Quelle est alors, l'autre extrmit du spectre de la sollicitude,
1. Le mot de Guerre est prononc ds ta premire page de la prface de Totalit
et I nfini.
2. Dans l'tude suivante, nous interprterons la Rgle d'Or comme la structure
de transition entre la sollicitude et l'impratif catgorique qui impose de traiter
l'humanit dans ma personne et dans celle d'autrui comme une fin en soi et non
pas seulement comme un moyen.
3. Sur ce rapport entre autorit et reconnaissance de supriorit, cf. H.G.
Gadamer, Vritet Mthode, op. cit., p. 118, suiv.
la situation inverse de celle de l'instruction par l'autre sous la figure
du matre de justice ? Et quelle ingalit nouvelle se donne-t-elle l
compenser ? La situation inverse de l'injonction est la souffrance.
L'autre est maintenant cet tre souffrant dont nous n'avons cess de
marquer la place en creux dans notre philosophie de l'action, en
dsignant l'homme comme agissant et souffrant. La souffrance n'est
pas uniquement dfinie par la douleur physique, ni mme par la
douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la
capacit d'agir, du pouvoir-faire, ressenties comme une atteinte
l'intgrit du soi. Ici, l'initiative, en termes prcisment de
pouvoir-faire, semble revenir exclusivement au soi qui donne sa
sympathie, sa compassion, ces termes tant pris au sens fort du
souhait de partager la peine d'autrui. Confront cette bienfaisance,
voire cette bienveillance, l'autre parat rduit la condition de
seulement recevoir. En un sens, il en est bien ainsi. Et c'est de cette
faon que le souffrir-avec se donne, en premire approximation,
pour l'inverse de l'assignation responsabilit par la voix de l'autre.
Et, d'une autre manire que dans le cas prcdent, une sorte
d'galisation survient, dont l'autre souffrant est l'origine, grce
quoi la sympathie est prserve de se confondre avec la simple piti,
o le soi jouit secrtement de se savoir pargn. Dans la sympathie
vraie, le soi, dont la puissance d'agir est au dpart plus grande que
celle de son autre, se retrouve affect par tout ce que l'autre souffrant
lui offre en retour. Car il procde de l'autre souffrant un donner qui
n'est prcisment plus puis dans sa puissance d'agif et d'exister,
mais dans sa faiblesse mme. C'est peut-tre l l'preuve suprme de
la sollicitude, que l'ingalit de puissance vienne tre compense
par une authentique rciprocit dans l'change, laquelle, l'heure de
l'agonie, se rfugie dans le murmure partag des voix ou l'treinte
dbile de mains qui se serrent. C'est peut-tre en ce point
qu'Aristote, trop proccup par la distinction entre l'amiti vertueuse
et le couple de l'amiti utile et de l'amiti plaisante - distinction
insparable de l'attention presque exclusive qu'il porte l'amiti
intellectuelle voue la recherche de la sagesse -, est pass ct
d'une autre dissymtrie que celle sur laquelle E. Lvinas difie son
thique, celle qui oppose le souffrir au jouir. Partager la peine du
souffrir n'est pas le symtrique exact de partager le plaisir
1
. A cet
gard, la philosophie ne doit
1. Aristote, il est vrai, inclut dans le vivre-ensemble le partage des joies et des
peines (th. Nie, IX, 9). Il crit mme que l'amiti consiste plutt aimer qu'
tre aim (VIII, 8, 1159 a 27).
222
223
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
pas cesser de se laisser enseigner par la tragdie. La trilogie purification
(catharsis), terreur (phobos), piti (los) ne se laisse pas
enfermer dans la sous-catgorie de l'amiti plaisante. L'avers de la
fragilit de la bont - selon la formule heureuse de Martha C.
Nussbaum laquelle nous reviendrons plus loin ' vient corriger, sinon
dmentir, la prtention de la phitautia la stabilit, la dure. Un soi
rappel la vulnrabilit de la condition mortelle peut recevoir de la
faiblesse de l'ami plus qu'il ne lui donne en puisant dans ses propres
rserves de force. Ici, la magnanimit - autre vertu grecque, encore
clbre par Descartes
- doit baisser pavillon. Nous aurons l'occasion, dans la dixime tude,
de revenir sur la catgorie de l'tre-affect dans son rapport avec le
grand genre de l'Autre. Au niveau phnomnologique o nous nous
tenons encore ici, les sentiments sont considrer comme des affections
incorpores au cours de la motivation ce niveau de profondeur
qu'Aristote dsignait du terme de disposition, terme qui reviendra sous
une autre guise - la Gesinnung
- chez Kant lui-mme. Bornons-nous ici souligner la part que prennent
les sentiments - qui sont en dernier ressort des affections - dans la
sollicitude. Ce que la souffrance de l'autre, autant que l'injonction
morale issue de l'autre, descelle dans le soi, ce sont des sentiments
spontanment dirigs vers autrui
2
. C'est cette union intime entre la vise
thique de la sollicitude et la chair affective des sentiments qui m'a paru
justifier le choix du terme sollicitude .
Tentons, pour conclure, de prendre une vue d'ensemble de l'ventail
entier des attitudes dployes entre les deux extrmes de l'assignation
responsabilit, o l'initiative procde de l'autre, et de la sympathie pour
l'autre souffrant, o l'initiative procde
1. M.C. Nussbaum, Thefragilityofgoodness. Luck and ethics in Greek tragedy
and philosophy. Cambridge University Press, 1986.
2. A cet gard, les sentiments de piti, de compassion, de sympathie, jadis exalts
par la philosophie de langue anglaise, mritent rhabilitation. Sur cette lance, les
analyses de Max Scheler consacres la sympathie, la haine et l'amour,
restent ingales, concernant principalement la distinction majeure entre la sym-
pathie et la fusion ou confusion affective, ainsi que le jeu de la distance et de la
proximit dans l'amour (Max Scheler, Zur Phnomenologieder Sympathiegefiihle
und von Liebe und Hasse, Halle, Niemeyer, 1913; trad. fr. de M. Lefebvre,
Natureet Formes dela sympathie. Paris. Payot, 1928 ; nlle d., Petite Biblio-
thque Payot , 1971). Soit dit en passant, on peut regretter qu' l'exception de
Stephan Strasser, dans son grand livre Dos Gemttt (Utrecht, Vitgeverijet
Spec-trum. 1956), les phnomnologues aient trop dlaiss la description des
sentiments, comme par peur de tomber dans quelque affectivefallacy. C'est oublier
que les sentiments ont t aussi puissamment travaills par le langage, et portes
aussi haut que les penses la dignit littraire.
du soi aimant, l'amiti apparaissant comme un milieu o le soi et l'autre
partagent galit le mme souhait de vivre-ensemble. Alors que dans
l'amiti l'galit est prsuppose, dans le cas de l'injonction venue de
l'autre elle n'est rtablie que par la reconnaissance par le soi de la
supriorit de l'autorit de l'autre ; et, dans le cas de la sympathie qui va
de soi l'autre, l'galit n'est rtablie que par l'aveu partag de la
fragilit, et finalement de la mortalit
1
.
C'est cette recherche d'galit travers l'ingalit, que celle-ci rsulte
de conditions culturelles et politiques particulires comme dans l'amiti
entre ingaux, ou soit constitutive des positions initiales du soi et de
l'autre dans la dynamique de la sollicitude, qui dfinit la place de la
sollicitude sur la trajectoire de l'thique. A l'estime de soi, entendue
comme moment rflexif du souhait de vie bonne , la sollicitude
ajoute essentiellement celle du manque, qui fait que nous avons
besoin d'amis ; par choc en retour de la sollicitude sur l'estime de soi, le
soi s'aperoit lui-mme comme un autre parmi les autres. C'est le sens
du l'un l'autre (alllous) d'Aristote, qui rend l'amiti mutuelle. Cette
aperception s'analyse en plusieurs lments : rversibilit,
insubs-tituabilit, similitude. De la rversibilit, nous avons un premier
modle dans le langage sous le couvert de l'interlocution. L'change
des pronoms personnels est cet gard exemplaire ; quand je dis tu
un autre, il comprend je pour lui-mme. Quand il s'adresse moi
la seconde personne, je me sens concern la premire personne ; la
rversibilit porte simultanment sur les rles d'allocuteur et
d'allocutaire, et sur une capacit de se dsigner soi-mme prsume
gale chez le destinataire du discours et son destinateur. Mais ce sont
seulement des rles qui sont rversibles. Seule l'ide 'insubstituabilit
prend en compte les personnes qui tiennent ces rles. En un sens,
l'insubstituabilit est galement prsuppose dans la pratique du
discours, mais d'une autre faon que dans l'interlocution savoir en
rapport l'ancrage du je en emploi
2
. Cet ancrage fait que je ne quitte
pas mon lieu et que je n'abolis pas la distinction entre ici et l-bas, lors
mme qu'en imagination et en sympathie je me mets la
1. Werner Marx, EthosundLebenswelt. Mitleidenknnen alsMass. Hambourg,
Flix Meiner Verlag, 1986. On a pu dire aussi que c'est seulement dans l'uvre
thtrale que peut s'exercer cette justice suprieure qui reconnat chacun des
protagonistes sa part de vrit et du mme coup lui assigne sa part gale d'estime
(G. Fessard, Thtreet Mystre, prface Gabriel Marcel, La Soif, Paris, Descle
de Brouwer, 1938).
2. Cf. ci-dessus, deuxime tude, p. 65.
224 225
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
place de l'autre. Ce que le langage enseigne en tant prcisment que
pratique, toutes les pratiques le vrifient. Les agents et les patients d'une
action sont pris dans des relations d'change qui comme le langage
conjuguent rversibilit des rles et insubsti-tuabilit des personnes. Ce
que la sollicitude ajoute, c'est la dimension de valeur qui fait que chaque
personne est irremplaable dans notre affection et dans notre estime. A
cet gard, c'est dans l'exprience du caractre irrparable de la perte de
l'autre aim que nous apprenons, par transfert d'autrui sur nous-mme,
le caractre irremplaable de notre propre vie. C'est d'abord pour l'autre
que je suis irremplaable. En ce sens, la sollicitude rpond l'estime de
l'autre pour moi-mme. Mais, si cette rponse n'tait pas d'une
certaine faon spontane, comment la sollicitude ne se rduirait-elle
pas un morne devoir ?
Au-dessus enfin des ides de rversibilit des rles et
d'insubs-tituabilit des personnes - cette dernire ide leve jusqu'
celle d'irremplaabilit -, je placerai la similitude, qui n'est pas seule-
ment l'apanage de l'amiti, mais, de la faon qu'on a dite, de toutes les
formes initialement ingales du lien entre soi-mme et l'autre. La
similitude est le fruit de l'change entre estime de soi et sollicitude pour
autrui. Cet change autorise dire que je ne puis m'estimer moi-mme
sans estimer autrui comme moi-mme. Comme moi-mme signifie : toi
aussi tu es capable de commencer quelque chose dans le monde, d'agir
pour des raisons, de hirarchiser tes prfrences, d'estimer les buts de
ton action et, ce faisant, de t'estimer toi-mme comme je m'estime
moi-mme. L'quivalence entre le toi aussi et le comme moi-mme
repose sur une confiance qu'on peut tenir pour une extension de
l'attestation en vertu de laquelle je crois que je peux et que je vaux.
Tous les sentiments thiques voqus plus haut relvent de cette
phnomnologie du toi aussi et du comme moi-mme . Car ils
disent bien le paradoxe inclus dans cette quivalence, le paradoxe de
l'change au lieu mme de l'irremplaable. Deviennent ainsi
fondamentalement quivalentes l'estime de Vautre comme un soi-mme
et l'estime de soi-mme comme un autre
1
.
1. Est-ce l le secret du paradoxal commandement : Tu aimeras ton prochain
comme toi-mme ? Ce commandement relverait de l'thique plus que de la
morale, si l'on pouvait, la suite de Rosenzweig dans L'toiledela rdemption,
tenir le commandement Aime-moi que l'amant adresse l'aim dans l'esprit
du Cantique des Cantiques pour antrieur et suprieur toutes les lois (Franz
Rosenzweig, Der Stern der Erlsung, La Haye, Martinus Nijhoff, 1976, p. 210;
trad. fr. de A. Derczanski et J.L. Schlegel, L'Etoiledela rdemption, Paris, d.
du Seuil, 1982).
3. ... dans des institutions justes
Que la vise du bien-vivre enveloppe de quelque manire le sens de
la justice, cela est impliqu dans la notion mme de l'autre. L'autre,
c'est aussi l'autre que le tu . Corrlativement, la justice s'tend plus
loin que le face--face.
Deux assertions sont ici en jeu : selon la premire, le vivre-bien ne se
limite pas aux relations interpersonnelles, mais s'tend la vie des
institutions. Selon la seconde, la justice prsente des traits thiques qui
ne sont pas contenus dans la sollicitude, savoir pour l'essentiel une
exigence d'galit. L'institution comme point d'application de la justice
et l'galit comme contenu thique du sens de la justice, tels sont les
deux enjeux de l'investigation portant sur la troisime composante de la
vise thique. De cette double enqute rsultera une dtermination
nouvelle du soi, celle du chacun : chacun son droit.
Par institution, on entendra ici la structure du vivre-ensemble d'une
communaut historique - peuple, nation, rgion, etc. -, structure
irrductible aux relations interpersonnelles et pourtant relie elles en
un sens remarquable que la notion de distribution permettra tout
l'heure d'clairer. C'est par des murs communes et non par des rgles
contraignantes que l'ide d'institution se caractrise fondamentalement.
Nous sommes par l ramens Ythos d'o l'thique tire son nom. Une
manire heureuse de souligner la primaut thique du vivre-ensemble
sur les contraintes lies aux systmes juridiques et l'organisation poli-
tique est de marquer, avec Hannah Arendt, l'cart qui spare le
pouvoir-en-commun de la domination. On se souvient que Max Weber,
dans sa mise en ordre des concepts majeurs de la sociologie au dbut
d'conomie et Socit, avait spcifi l'institution politique parmi toutes
les institutions par la relation de domination, qui distingue les
gouvernants et les gouverns
1
. Cette relation marque la fois une scission
et une rfrence la violence qui l'une et l'autre relvent du plan moral sur
lequel s'tablira la prochaine tude
2
. Plus fondamentale que la relation
de domination
1. Op. cit., chap. I, 16, Macht, Herrschaft.
2. Dans Le mtier et la vocation d'homme politique , (in LeSavant et le
Politique, trad. fr. de J. Freund, Paris, Pion, 1959; rd., UGE, coll. 10/18,
1963), confrence adresse de jeunes pacifistes allemands tents par la
non-violence l'issue dsastreuse de la Premire Guerre mondiale, Max Weber
dfinit
226
227
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
est celle de pouvoir-en-commun. Selon Arendt, le pouvoir procde
directement de la catgorie d'action en tant qu'irrductible celles de
travail et d'oeuvre : cette catgorie revt une signification politique, au
sens large du mot, irrductible tatique, si l'on souligne d'une part la
condition de pluralit
1
, d'autre part de concertation
2
.
Par l'ide de pluralit est suggre l'extension des rapports
interhumains tous ceux que le face--face entre le je et le tu
laisse en dehors au titre de tiers. Mais le tiers est, sans jeu de mots,
d'emble tiers inclus par la pluralit constitutive du pouvoir. Ainsi est
impose une limite toute tentative pour reconstruire le lien social sur
la seule base d'une relation dialogale strictement dyadique. La pluralit
inclut des tiers qui ne seront jamais des visages. Un plaidoyer pour
l'anonyme, au sens propre du terme, est ainsi inclus dans la vise la plus
ample de la vraie vie
3
. Cette inclusion du tiers, son tour, ne doit pas tre
limite l'aspect instantan du vouloir agir ensemble, mais tal dans la
dure. C'est de l'institution prcisment que le pouvoir reoit cette
dimension temporelle. Or celle-ci ne concerne pas seulement le pass, la
tradition, la fondation plus ou moins mythique, toutes
ainsi l'tat : un rapport de domination [Herrschaft] de l'homme sur l'homme
fond sur le moyen de la violence lgitime (c'est--dire sur la violence qui est
considre comme lgitime) (op. cit., p. 101).
1. L'action, la seule activit qui mette directement les hommes en relation
sans l'intermdiaire des objets ni de la matire, correspond la condition
humaine de la pluralit , La Condition del'hommemoderne, op. cit., p. 15.
2. Le pouvoir correspond l'aptitude de l'homme agir, et agir de faon
concerte. Le pouvoir n'est jamais une proprit individuelle ; il appartient un
groupe et continue lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas
divis (Du mensonge la violence, trad. fr. de G. Durand, Paris, Calmann-Lvy,
1972, p. 153). Et d'voquer dans la suite du texte Visonomie selon Pricls, la
civi-tas romaine, mais aussi l'exprience des soviets, des conseils ouvriers,
l'insurrection de Budapest, le printemps de Prague et les multiples exemples de
rsistance l'occupation trangre. Rien donc de nostalgique dans cette
rhabilitation du pouvoir de tous, rencontre non seulement de la violence, mais
mme de la relation de domination. Importe seul le caractre non hirarchique et
non instrumental de la relation de pouvoir : C'est le soutien populaire qui donne
leur pouvoir aux institutions d'un pays et ce soutien n'est que la suite naturelle du
consentement {consent] qui a commenc par donner naissance aux lois
existantes (ibid. p. 150).
3. Cette inclusion du lointain dans le projet thique pouvait tre anticipe sur
la base de ce qui a t dit plus haut des pratiques (mtiers, jeux, arts) ; ce sont,
avons-nous dit, des interactions rgles ; en ce sens, des institutions. Les talons
d'excellence qui situent ces pratiques sur l'chelle de la praxis, et ainsi sur la tra-
jectoire du vivre-bien, comportent d'emble une dimension corporative , ins-
parable de la dimension de traditionalit corrlative de celle d'innovation.
choses qu'Arendt place sous le titre de l'Autorit, en souvenir de
Yauctoritas romaine - potestas in populo, auctoritas in senatu -, elle
concerne plus encore l'avenir, l'ambition de durer, c'est--dire non de
passer mais de demeurer. C'tait dj le propos de Machiavel:
comment arracher les rpubliques l'phmre? C'est encore un souci
de Arendt '. Comment la vita activa riposte-t-elle la dure condition
temporelle d'tre mortel ? L'action, dans sa dimension politique,
constitue la tentative la plus haute pour confrer l'immortalit, dfaut
de l'ternit, des choses prissables. Certes, le pouvoir a sa propre
fragilit, puisqu'il existe aussi longtemps que les hommes agissent
ensemble, et qu'il s'vanouit ds qu'ils se dispersent. En ce sens, le
pouvoir est le modle d'une activit en commun qui ne laisse aucune
uvre derrire elle et, comme la praxis selon Aristote, puise sa
signification dans son propre exercice. Toutefois, la fragilit du pouvoir
n'est plus la vulnrabilit brute et nue des mortels en tant que tels, mais la
fragilit au second degr des institutions et de toutes les affaires
humaines qui gravitent autour d'elles.
L'ide de concertation est plus difficile fixer, si l'on ne veut pas
entrer trop vite dans le dtail des structures institutionnelles propres aux
diffrentes sphres d'activit en commun, comme on le fera avec
prudence et parcimonie au terme de la prochaine tude. H. Arendt se
borne parler de l'action publique comme d'un tissu (web) de relations
humaines au sein duquel chaque vie humaine dploie sa brve histoire.
L'ide d'espace public et celle de publicit qui s'y rattache nous sont
familires depuis l'poque des Lumires. C'est elles qu'Arendt
reprend sous le titre d' espace public d'apparition au sein duquel les
activits que
1. Dans une prface La Condition del'hommemoderne, crite en 1983, je
propose d'interprter le passage du premier grand ouvrage d'Arendt, LesOrigines
du totalitarisme, La Condition del'hommemoderne, partir de la thse que le
totalitarisme repose sur le mythe selon lequel tout est permis, tout est possible -
selon lequel, donc, le matre peut fabriquer un homme nouveau. La tche est
alors de penser les conditions d'un univers non totalitaire : le critre le mieux
appropri la nouvelle enqute peut alors consister dans une valuation des dif-
frentes activits humaines du point de vue temporel de leur durabilit (Hannah
Arendt. La Condition del'hommemoderne, op. cit.. prface de Paul Ricur. p.
15). Cette approche ne concerne pas seulement le politique, mais toutes les
catgories de l'ouvrage, y compris la triade travail, uvre, action Le caractre
consomptible des produits du travail en dnonce la prcarit. La fonction de l'arti-
fice rsume dans l'uvre est d'offrir aux mortels un sjour plus durable et plus
stable qu'eux-mmes (cf. La Condition del'hommemoderne, op. cit., p. 171). En ce
sens le temps du travail est passage, celui de l'uvre est dure. L'action trouve
enfin sa stabilit dans la cohrence d'une histoire raconte qui dit le qui de
l'action.
228
229
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
nous avons appeles des pratiques viennent au jour. Mais la
publicit prise en ce sens est, nous le savons bien, une tche plus
qu'une donne. Il faut bien avouer, avec H. Arendt elle-mme, que
cette strate du pouvoir caractrise par la pluralit et la concertation
est d'ordinaire invisible, tant elle est recouverte par les relations de
domination, et qu'elle n'est porte au jour que lorsqu'elle est sur le
point d'tre ruine et laisse le champ libre la violence, comme il
arrive dans les grandes dbcles historiques. C'est pourquoi il est
peut-tre raisonnable d'accorder cette initiative commune, ce
vouloir vivre ensemble, le statut de Y oubli
1
. C'est pourquoi ce
fondamental constitutif ne se laisse discerner que dans ses
irruptions discontinues au plus vif de l'histoire sur la scne
publique. C'est pourquoi aussi ne se souvient-on. dans l'ordinaire
des jours, que de cette augmentation que constitue l'autorit, dont
nous ne parlons peut-tre plus aujourd'hui qu'au pass .
Aussi vasif que soit le pouvoir dans sa structure fondamentale,
aussi infirme qu'il soit sans le secours d'une autorit qui l'articule sur
une fondation toujours plus ancienne, c'est lui, en tant que vouloir
agir et vivre ensemble, qui apporte la vise thique le point
d'application de son indispensable troisime dimension : la justice.
Est-ce bien encore du plan thique et tlologique, et non moral et
dontologique, que relve le sens de la justice ? L'uvre de Rawls,
que nous discuterons dans la prochaine tude, n'est-elle pas de bout
en bout la vrification que c'est dans une ligne kantienne, donc
foncirement dontologique, et en opposition une tradition
tlologique. incarne par l'utilitarisme, que l'ide de justice peut
tre repense ? Que la reconstruction par Rawls de l'ide de justice
s'inscrive dans une perspective antitlologique n'est pas
contestable. Mais c'est une autre tlologie que celle des
utilitaristes de langue anglaise que l'ide de justice se rattache. Une
tlologie que vient opportunment rappeler l'emploi du terme
vertu dans la dclaration liminaire de Thorie de la justice selon
laquelle : La justice est la premire vertu des institu-
1. P. Ricur, Pouvoir et violence , in Ontologieet Politique. Hannah Arendt,
Paris, Tierce. 1989, p. 141-159.
2. Dans l'essai consacr au concept d'autorit (in La Crisedela culture, trad. fr.
de Between past and future. Paris, Gallimard, 1972), H. Arendt rappelle que
celle-ci renvoie quelques vnements fondateurs plus ou moins mythifis. Mais,
dire vrai, on ne connat gure de socit qui ne se rfre de tels vnements
fondateurs. Ainsi l'auctoritas constitue-t-elle encore de nos jours l'augmentation
(augere) que le pouvoir tire de l'nergie transmise de ces commencements.
tions sociales comme la vrit est celle des systmes de pense '.
Le juste, me semble-t-il, regarde de deux cts : du ct du bon,
dont il marque l'extension des relations interpersonnelles aux ins-
titutions ; et du ct du lgal, le systme judiciaire confrant la loi
cohrence et droit de contrainte
2
. C'est sur le premier versant
exclusivement que nous nous tiendrons dans cette tude.
Deux raisons lgitiment l'entreprise. D'une part, l'origine quasi
immmoriale de l'ide de justice, son mergence hors du moule
mythique dans la tragdie grecque, la perptuation de ses conno-
tations divines jusque dans les socits scularises attestent que le
sens de la justice ne s'puise pas dans la construction des systmes
juridiques qu'il ne cesse pourtant de susciter. D'autre part, l'ide de
justice est mieux nomme sens de la justice au niveau fondamental
o nous restons ici. Sens du juste et de l'injuste, vaudrait-il mieux
dire ; car c'est d'abord l'injustice que nous sommes sensibles :
Injuste ! Quelle injustice ! nous crions-nous. C'est bien sur le
mode de la plainte que nous pntrons dans le champ de l'injuste et
du juste. Et, mme au plan de la justice institue, devant les cours de
justice, nous continuons de nous comporter en plaignants et de
porter plainte . Or le sens de l'injustice n'est pas seulement plus
poignant, mais plus perspicace que le sens de la justice ; car la
justice est plus souvent ce qui manque et l'injustice ce qui rgne. Et
les hommes ont une vision plus claire de ce qui manque aux
relations humaines que de la manire droite de les organiser. C'est
pourquoi, mme chez les philosophes, c'est l'injustice qui la
premire met en mouvement la pense. En tmoignent les
Dialogues de Platon et l'thique aristotlicienne, et leur souci gal
de nommer ensemble l'injuste et le juste.
Aristote ! peut-tre objectera-t-on notre tentative pour l'enrler
notre cause que, s'il a pu placer la justice dans le champ des vertus,
et donc de l'thique au sens tlologique que nous attachons ce
terme, c'est parce qu'il applique aux transactions directes d'homme
homme sa dfinition initiale - son esquisse, comme il dit -
emprunte au sens commun et aux ides reues (endoxa) : Nous
observons que tout le monde entend signifier par justice cette sorte
de disposition [hexis] qui rend les hommes
1. J. Rawls, A Theoryof J ustice. Harvard University Press. 1971 ; trad. fr.
C. Audard, Thoriedela justice. Paris, d. du Seuil, 1987, p. 29.
2. Le mot droit , en franais, couvre les deux usages ; nous parlons d'un
homme droit et de sa droiture, en un sens non juridique, mais nous parlons aussi
du droit comme d'une discipline qui s'appelle ailleurs loi (lawschool).
230
231
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
aptes accomplir les actions [praxeis] justes et qui les fait agir justement
et vouloir les choses justes (thique Nicomaque, trad. Tricot, V, 1,
1129 a 6-9). Et, pour mieux ancrer la justice dans le plan des vertus, il
cherche quelle mdit - quelle juste mesure, quel moyen terme -,
quelle msots entre deux extrmes assigne la justice une place parmi
les vertus philosophiquement rflchies. Or la msots est le trait
raisonnable commun toutes les vertus de caractre priv ou
interpersonnel.
Mais, faut-il rpondre, ce sont les traits propres la msots, par
quoi le juste se distingue de l'injuste, qui font passer sans transition du
plan interpersonnel au plan institutionnel. La dcision mthodologique
la plus importante prise par Aristote, au dbut de son chapitre sur la
justice (ibid, V), est en effet de dcouper dans la vaste polysmie du
juste et de l'injuste'.
L'intersection entre l'aspect priv et l'aspect public de la justice
distributive se laisse reconnatre tous les stades de l'analyse.
D'abord, Aristote tient le domaine qu'il circonscrit pour une
partie (mros) du champ total (holos) des actions prescrites par les
lois (nomima). A ce niveau englobant, le relais institutionnel est hors de
doute dans la mesure o c'est la loi positive qui dfinit la lgalit. Ici,
thique et politique se recroisent
2
.
1. Or, semble-t-il bien, la justice est prise en plusieurs sens, et l'injustice aussi,
mais, du fait que ces diffrentes significations sont voisines, leur homonymie
chappe et il n'en est pas comme pour les notions loignes l'une de l'autre o
l'homonymie est plus visible (th. Nie. V, 2, 1129a26-27). L'homonymie de
l'injuste est d'abord prise pour guide : on considre gnralement comme tant
injuste la fois celui qui viole la loi, celui qui reprend plus que son d, et enfin
celui qui manque l'galit (ibid.. 1. 32). Mais, quand on passe de l'injuste au
juste, il ne reste plus que l'observation de la loi et le respect de l'galit. Passant en
outre de l'agent a l'action, on dira : le juste, donc, est ce qui est conforme la loi
et ce qui respecte l'galit, et l'injuste, ce qui est contraire la loi et ce qui manque
l'galit (ibid., a 35 - b I). Ainsi, prendre plus que son d et manquer l'galit
ont une partie commune qui est prcisment Vanisots - l'ingalit - du plo-nokts
- de l'avide, du cupide. De l'avide, il est dit qu'il manque aussi l'galit, car
l'ingalit est une notion qui enveloppe les deux choses la fois et leur est
commune (ibid., 1129 b 10). Reste donc l'homonymie de la conformit la loi et
de l'galit.
2. Or les lois prononcent sur toutes sortes de choses, et elles ont en vue l'utilit
commune (...) ; par consquent, d'une certaine manire, nous appelons actions
justes toutes celles qui tendent produire ou conserver le bonheur avec les l-
ments qui le composent, pour la communaut politique (V, 3, 1129 b 14-18). Il
est en outre remarquable qu'Aristote appelle justice totale la conformit la
loi. en ce sens que la loi commande aussi d'accomplir les actes conformes toutes
les autres vertus ; la justice devient ainsi le proshtron, le rapport autrui, de
toutes les vertus (ibid., 1. 26-31).
La vertu partielle laquelle Aristote se limite ne saurait, en
consquence, tre moins thico-politique que la vertu totale qui
l'englobe.
Autre raison de tenir la mdiation institutionnelle pour indispensable
: c'est toujours par rapport des biens extrieurs et prcaires, en rapport
la prosprit et l'adversit, que le vice de vouloir avoir toujours plus
- la plonexia - et l'ingalit se dterminent. Or ces maux et ces biens
adverses sont prcisment des biens partager, des charges rpartir.
C'est ce partage qui ne peut pas ne pas passer par l'institution. De fait,
la premire espce de la justice particulire se dfinit trs exactement par
une opration distributive qui implique la communaut politique,
qu'il s'agisse de distribuer des honneurs, ou des richesses, ou des
autres avantages qui se rpartissent entre les membres de la
communaut politique (V, 5, 1130 b 30-33) '.
Reprochera-t-on Aristote d'avoir trop limit le champ de la justice
en la dfinissant comme justice distributive ? Il faut mon sens, ce
stade de notre analyse, garder au terme de distribution sa plus grande
souplesse, savoir d'apporter l'lment de distinction qui manque la
notion de vouloir agir ensemble
2
. C'est cet aspect de distinction qui passe
au premier plan avec le concept de distribution qui, d'Aristote aux
mdivaux et John Rawls, est troitement li celui de justice. Ce
concept ne doit pas tre limit au plan conomique, en complment
celui de production. Il dsigne un trait fondamental de toutes les
institutions, dans la mesure o celles-ci rglent la rpartition de rles, de
tches, d'avantages, de dsavantages entre les membres de la socit. Le
terme mme de rpartition mrite attention : il exprime l'autre face de
l'ide de partage, la premire tant le fait de prendre part une institution
; la seconde face serait celle de la distinction des parts assignes chacun
dans le systme de distribution. Avoir part est une chose, recevoir une
part en est une autre. Et les deux se tiennent. Car c'est en tant que les
parts distribues sont coordonnes entre elles que les porteurs de parts
peuvent tre dits
1. On ne dira rien ici de la justice corrective, dont Aristote dit qu'elle se rap-
porte aux transactions prives, soit volontaires (achat, vente, prt), soit involon-
taires (torts de toutes sortes et actes de vengeance). La mdiation institutionnelle
n'est pas absente mais indirecte, soit que la loi dtermine le tort, soit que les tribu-
naux tranchent les conflits. Ainsi le rapport autrui est le lien fort qui demeure
malgr l'homonymie des termes juste et injuste (V, 5, 1130 b 1).
2. Nous avions dj rencontr ce danger de cder la pente fusionnelle du rap-
port autrui lorsque nous avions oppos au plan interpersonnel l'ide de sympa-
thie celle de fusion motionnelle, la suite de Max Scheler.
232
233
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA VISE THIQUE
participer la socit considre, selon l'expression de Rawls,
comme une entreprise de coopration. Il fallait mon sens intro-
duire ce stade de notre analyse le concept de distribution, afin
d'assurer la transition entre le niveau interpersonnel et le niveau
socital l'intrieur de la vise thique. L'importance du concept de
distribution rside en ceci qu'il renvoie dos dos les protagonistes
d'un faux dbat sur le rapport entre individu et socit. Dans la ligne
du sociologisme la faon de Durkheim, la socit est toujours plus
que la somme de ses membres ; de l'individu la socit, il n'y a pas
continuit. Inversement, dans la ligne de l'individualisme
mthodologique, les concepts cls de la sociologie ne dsignent rien
de plus que la probabilit que des individus se comporteront d'une
certaine faon '. Par l'ide de probabilit est lude toute
chosification, et finalement toute ontologie des entits sociales. La
conception de la socit comme systme de distribution transcende
les termes de l'opposition. L'institution en tant que rgulation de la
distribution des rles, donc en tant que systme, est bien plus et
autre chose que les individus porteurs de rles. Autrement dit, la
relation ne se rduit pas aux termes de la relation. Mais une relation
ne constitue pas non plus une entit supplmentaire. Une institution
considre comme rgle de distribution n'existe que pour autant que
les individus y prennent part. Et cette participation, au sens de prise
de part, se prte aux analyses probabilistes qui n'ont pas d'autre
point d'application que les comportements individuels. Ce n'est pas
l'objet de la prsente tude de s'avancer plus avant dans la
discussion pistmo-logique. Cette brve incursion dans un
domaine qui n'est pas le mien n'avait pour but que de conforter la
seule ide qui importe ntre enqute, savoir que la prise en
considration de l'institution appartient la vise thique prise selon
son amplitude entire. Il ne fallait pas qu'un mur s'lve entre
l'individu et la socit, empchant toute transition du plan
interpersonnel au plan socital. Une interprtation distributive de
l'institution contribue abattre ce mur et assure la cohsion entre les
trois composantes individuelles, interpersonnelles et socitales de
notre concept de vise thique. Le cadre thico-juridique de
l'analyse tant prcis, un nom
1. On a dj rencontr plus haut (p. 227) la dfinition de la domination concen-
tre dans l'tat par Max Weber : un rapport de l'homme sur l'homme fond sur
le moyen de la violence lgitime (c'est--dire sur la violence qui est considre
comme lgitime) . Elle s'inscrit dans une suite de dfinitions o l'ide de proba-
bilit (chanceen allemand) dispense chaque fois d'introduire des entits distinctes
des individus.
peut tre donn au noyau thique commun la justice distributive et
la justice rparatrice. Ce noyau commun c'est Vgalit (isots).
Corrlativement, l'injuste, souvent cit avant le juste, a pour
synonyme Yingal. C'est l'ingal que nous dplorons et
condamnons. Aristote continue ainsi une grande tradition grecque,
et plus prcisment athnienne, marque par Solon et Pricls. Mais
le trait de gnie - trait double, vrai dire -, c'est d'avoir donn un
contenu philosophique l'ide reue de la tradition. D'un ct,
Aristote retrouve dans l'gal le caractre de mdit entre deux
extrmes, qu'il transporte de vertu en vertu. En effet, l o il y a
partage, il peut y avoir du trop et du pas assez. L'injuste est celui qui
prend trop en termes d'avantages (et l'on retrouve la plonexia, le
vouloir avoir plus) ou pas assez en termes de charges '. D'un autre
ct, il dlimite avec soin la sorte de mdit. savoir Vgalit
proportionnelle, qui dfinit la justice distributive. Que l'galit
arithmtique ne convienne pas tient, selon lui, la nature des
personnes et des choses partages. D'un ct les personnes ont, dans
une socit antique, des parts ingales (axia), li des mrites
ingaux, que d'ailleurs les diverses constitutions dfinissent
diffremment ; de l'autre, les parts sont elles-mmes hors justice
ingales, on devrait dire susceptibles d'un partage sauvage, comme
dans la guerre et le pillage. La justice distributive consiste alors
rendre gaux deux rapports entre chaque fois une personne et un
mrite. Elle repose donc sur un rapport de proportionnalit quatre
termes : deux personnes et deux parts
2
.
Aristote posait ainsi le redoutable problme, que Rawls reprendra
nouveaux frais, de justifier une certaine ide de l'galit sans
cautionner l'galitarisme. Notre problme n'est pas de savoir si
l'galit peut toujours tre dfinie en termes de mdit, et si l'ide
d'galit proportionnelle n'est pas un nid de difficults
inextricables; il est plutt de recueillir la force convaincante et
durable de la liaison entre justice et galit. Mdit et galit
proportionnelle ne sont cet gard que des procds secondaires
pour sauver philosophiquement et thiquement l'galit.
1. La mdit est l'gal, car en toute espce d'action admettant le plus et le
moins il y a aussi l'gal. Si donc l'injuste est ingal, le juste est gal, et c'est l, sans
autre raisonnement, une opinion unanime (th. Nie. V, 6, 1131 a 12-13). Le
recours l'opinion commune reste une constante chez Aristote. Il ne sera pas
moindre chez Kant, comme on le dira dans l'tude suivante. C'est pourquoi nous
parlons du sens de la justice.
2. Le juste est, par suite, une sorte de proportion (...) la proportion tant une
galit de rapports et supposant quatre termes au moins (ibid., V, 6, 1131a 29-32).
234
235
SOI-MME COMME UN AUTRE
L'galit, de quelque manire qu'on la module, est la vie dans les
institutions ce que la sollicitude est aux relations interpersonnelles. La
sollicitude donne pour vis--vis au soi un autre qui est un visage, au
sens fort qu'Emmanuel Lvinas nous a appris lui reconnatre.
L'galit lui donne pour vis--vis un autre qui est un chacun. En quoi le
caractre distributif du chacun passe du plan grammatical, o nous
l'avons rencontr ds la prface, au plan thique. Par l, le sens de la
justice ne retranche rien la sollicitude ; il la suppose, dans la mesure o
elle tient les personnes pour irremplaables. En revanche, la justice ajoute
la sollicitude, dans la mesure o le champ d'application de l'galit est
l'humanit entire.
^ Qu'une certaine quivoque, dj aperue avec l'introduction de l'ide
de distribution, affecte profondment l'ide de justice, ce n^est pas
douteux. L'ide de parts justes renvoie d'un ct celle d'une
appartenance qui va jusqu' l'ide d'un infini endettement mutuel, qui
n'est pas sans rappeler le thme lvinassien de l'otage ; d'un autre
ct, l'ide de parts justes conduit, dans la meilleure hypothse, l'ide
qu'on retrouvera chez Rawls d'un mutuel dsintrt pour les intrts les
uns des autres : au pire, elle reconduit l'ide - lvinassienne elle aussi -
de sparation.
HUITIME TUDE
Le soi et la norme morale
De la thse propose au dbut de l'tude prcdente, seule la premire
des trois propositions qui la composent a t dveloppe avec quelque
ampleur, savoir l'affirmation de la primaut de l'thique sur la morale.
On a ainsi construit sur la base du seul prdicat bon les trois phases
d'un discours allant de la vise de la vie bonne au sens de la justice en
passant par la sollicitude. A cette structure tripartite du prdicat bon
appliqu aux actions, a correspondu, par voie rflexive, la structure
homologue de Yes-time de soi. A la prsente tude revient la tche de
justifier la seconde proposition, savoir qu'il est ncessaire de soumettre
la vise thique l'preuve de la norme. Restera montrer de quelle
faon les conflits suscits par le formalisme, lui-mme troitement
solidaire du moment dontologique, ramnent de la morale l'thique,
mais une thique enrichie par le passage par la norme, et investie
dans le jugement moral en situation. C'est sur le lien entre obligation et
formalisme que va se concentrer la prsente tude, non pour dnoncer
la hte les faiblesses de la morale du devoir, mais pour en dire la
grandeur, aussi loin que pourra nous porter un discours dont la structure
tripartite doublera exactement celle de la vise thique.
Dans la premire tape de notre nouveau parcours, la vise de la vie
bonne sera soumise l'preuve de la norme sans gard pour la structure
dialogique de la norme elle-mme. Cette structure sera au centre de la
seconde tape, en cho la sollicitude qui dsigne le rapport originaire,
au plan thique, de soi l'autre que soi. C'est au cours de la troisime
tape que nous donnerons une suite notre investigation du sens de la
justice, au moment o celui-ci devient rgle de justice, sous l'gide du
formalisme moral tendu des rapports interpersonnels aux rapports
sociaux et aux institutions qui sous-tendent ces derniers. Il en rsulte que
le respect de soi, qui rpond au plan moral l'estime de soi du plan
thique, n'atteindra sa pleine signification qu'au terme de la troi-
237
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
sime tape, lorsque le respect de la norme se sera panoui en respect
d'autrui et de soi-mme comme un autre , et que celui-ci se sera
tendu quiconque est en droit d'attendre sa juste part dans un partage
quitable. Le respect de soi a la mme structure complexe que l'estime
de soi. Le respect de soi, c'est l'estime de soi sous le rgime de la loi
morale. C'est pourquoi sa structure triadique est homologue celle de
l'estime de soi.
1. La vise de la vie bonne et l'obligation
Que nous ajournions l'examen du moment dialogique de la norme
ne signifie pas que nous fassions prcder la rciprocit des personnes
par un quelconque solipsisme moral. Le soi, est-il besoin de le rappeler,
n'est pas le moi. Il s'agit plutt d'isoler le moment d'universalit qui,
titre d'ambition ou de prtention -on en discutera dans la prochaine
tude -, marque la mise l'preuve par la norme du souhait de vivre
bien. Ce sera, corrlativement, de la mme universalit que s'autorisera
le soi au plan rflexif. On a de bonnes raisons d'objecter son caractre
abstrait une requte de la norme qui ne fait pas acception des personnes
: c'est prcisment cette abstraction qui nous poussera de la premire la
deuxime configuration de la norme. En revanche, on ne saurait rendre
cette abstraction solidaire de quelque point de vue gologique que ce
soit. L'universel ce stade n'est proprement parler ni vous, ni moi.
Sans nier aucunement la rupture opre par le formalisme kantien par
rapport la grande tradition tlologique et eudmo-niste, il n'est pas
inappropir de marquer, d'une part, les traits par lesquels cette dernire
tradition fait signe en direction du formalisme et, d'autre part, ceux par
lesquels la conception dontologique de la morale reste rattache la
conception tlologique de l'thique.
S'agissant des anticipations de l'universalisme implicites la
perspective tlologique, ne peut-on pas dire que l'tablissement par
Aristote d'un critre commun toutes les vertus - savoir la msots, le
terme moyen, la mdit - prend rtrospectivement le sens d'une amorce
d'universalit ? Et quand nous-mme avons, dans le sillage encore
d'Aristote, donn pour objet l'estime de soi des capacits telles que
l'initiative de l'action, le choix par des raisons, l'estimation et l'valuation
des buts de l'action, n'avons-nous pas implicitement donn un sens
universel ces capacits,
LE SOI ET LA NORME MORALE
comme tant ce en vertu de quoi nous les tenons pour estimables, et
nous-mmes par surcrot ' ? D'une faon semblable, quand nous
avons, la suite de Heidegger, reconnu dans la miennet un caractre
assign chaque fois au soi, cet chaque fois ne dsigne-t-il pas
le trait qu'on peut dire universel grce auquel on peut crire : das Dasein,
das Selbst ? Que l'aspect universel de ce que nous appelons nanmoins
des existentiaux ne remette pas en question la distinction entre deux
identits, celle de Yipse et celle de Yidem, cela n'est pas contestable : en
vertu de ces universaux que sont les existentiaux, nous disons
prcisment en tant que quoi Yipse se distingue de Videm ou,
quivalemment, en tant que quoi le qui ? est digne d'estime.
Or, si l'thique fait signe vers l'universalisme par les quelques traits
qu'on vient de rappeler, l'obligation morale n'est pas non plus sans
attaches dans la vise de la vie bonne . Cet ancrage du moment
dontologique dans la vise tlologique est rendu manifeste par la place
qu'occupe chez Kant le concept de bonne volont au seuil des
Fondements de la mtaphysique des murs : De tout ce qu'il est
possible de concevoir dans le monde, et mme en gnral hors du
monde, il n'est rien qui puisse sans restriction [ohne Einschrnkung] tre
tenu pour bon, si ce n'est une bonne volont
2
.
Dans cette dclaration liminaire sont incluses deux affirmations qui,
l'une et l'autre, prservent une certaine continuit entre le point de vue
dontologique et la perspective tlologique, en dpit de la rupture
significative qu'on va dire plus loin. Il est d'abord entendu que bon
moralement signifie bon sans res-
1. La thorie morale d'Alan Gewirth dans Reason and Morality (Chicago
Uni-versity Press, 1978) repose sur l'explicitation de la dimension universelle
attache la reconnaissance de ces capacits en chacun. S'il parle ici de traits
gnriques , ce n'est pas eu gard la classification par genres et espces, mais
pour dsigner le caractre universel des capacits en raison desquelles nous nous
reconnaissons membres du genre humain - ou de l'espce humaine -, en un sens
unique des termes genre et espce .
2. Fondements dela mtaphysique des murs, (Ak.393, trad. fr. de V. Delbos
revue et modifie par F. Alqui in E. Kant, uvres philosophiques, op. cit., t. II,
1985, p. 250). On voudra bien noter les multiples occurrences des termes
estime , estimer , estimable dans la premire section des Fondements,
toujours en relation avec la bonne volont. Ce n'est pas seulement l'ancrage dans
la tradition tlologique que ces termes expriment, mais l'ancrage dans l'exp-
rience morale ordinaire ; comme chez Aristote, la philosophie morale, chez Kant,
ne part pas de rien ; sa tche n'est pas d'inventer la morale, mais d'extraire le sens
du fait de la moralit, comme . Weil le dit de la philosophie kantienne dans son
ensemble ; cf. ric Weil, Problmes kantiens, Paris, Vrin, 1970, Sens et fait,
p. 56-107.
238 239
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LANORMEMORALE
triction , c'est--dire sans gard pour les conditions intrieures et les
circonstances extrieures de l'action ; tandis que le prdicat bon
conserve l'empreinte tlologique, la rserve sans restriction
annonce la mise hors jeu de tout ce qui peut retirer l'usage du prdicat
bon sa marque morale
1
. Deuxime affirmation : le porteur du prdicat
bon est dsormais la volont. Ici aussi, une certaine continuit avec la
perspective thique est prserve : on peut homologuer le concept
kantien de volont avec le pouvoir de poser un commencement dans le
cours des choses, de se dterminer par des raisons, pouvoir qui,
avons-nous dit, est l'objet de l'estime de soi. Mais la volont prend en
morale kantienne la place que le dsir raisonnable occupait en thique
aristotlicienne ; le dsir se reconnat sa vise, la volont son rapport
la loi
2
; elle est le lieu de la question : Que dois-je faire ? Dans un
vocabulaire plus proche de nous, on dirait que le vouloir s'exprime dans
des actes de discours relevant de la famille des impratifs, alors que les
expressions verbales du dsir - y compris le bonheur - sont des actes de
discours de type optatif.
Nous sommes entrs dans la problmatique kantienne par le porche
royal de l'universalit. Mais cette problmatique elle seule ne suffit
pas caractriser une morale de l'obligation. A l'ide de l'universalit
est indissociablement lie celle de la contrainte, caractristique de
l'ide de devoir; et ceci, en vertu des limitations qui caractrisent une
volont finie. Par sa constitution fondamentale, en effet, la volont n'est
autre que la raison pratique, commune en principe tous les tres
rationnels ; par sa
1. Otfried Hffe, dans son Introduction ta philosophiepratiquedeKant (la
morale, ledroit et la religion) (trad. fr. de F. Riiegg et S. Gillioz, Fribourg,
Albeuve, Suisse, d. Castella, 1985), qualifie de mta-thique cette premire
affirmation qui fait du concept du bien sans restriction la condition ncessaire et
suffisante pour dterminer dfinitivement la question du bien (p. 59). J'appelle-
rai simplement thique cette dclaration liminaire, afin d'en souligner le lien avec
la vise thique. En outre, O. Hffe a raison de souligner que l'ide normative de
bon sans restriction est d'une ampleur telle qu'elle couvre les deux domaines jux-
taposs de la praxis personnelle, laquelle se limitent les Fondements et la Cri-
tiquedela Raison pratique, et de la praxis publique, dont il est trait seulement
dans la partie de la Mtaphysique des murs consacre la Doctrinedu droit. On y
reviendra dans la section justice de cette tude.
2. La dfinition par Kant de la volont, en son sens le plus gnral, porte la
marque de cette rfrence la norme ; la diffrence des phnomnes naturels qui
exemplifient des lois, la volont est la facult d'agir d'aprs la reprsentation des
lois (Fondements... trad. Delbos [IV, 412], p. 274); la dfinition est caractris-
tique du style lgislatif qui traverse l'uvre entire de Kant, comme l'observe
Simone Goyard-Fabre au dbut de son ouvrage Kant et leProblmedu droit,
Paris, Vrin, 1975.
constitution finie, elle est empiriquement dtermine par des
inclinations sensibles. Il en rsulte que le lien entre la notion de bonne
volont - porte d'accs la problmatique dontologique -et la notion
d'une action faite par devoir est si troit que les deux expressions en
deviennent substituables l'une l'autre*. Une volont bonne sans
restriction est titre initial une volont constitutionnellement soumise
des limitations. Pour celle-ci le bon sans restriction revt la forme du
devoir, de l'impratif, de la contrainte morale. Toute la dmarche
critique est de remonter de cette condition finie de la volont la raison
pratique conue comme autolgislation, comme autonomie. A ce stade
seulement, le soi aura trouv la premire assise de son statut moral, sans
prjudice de la structure dialogique qui, sans s'y ajouter du dehors, en
dploie le sens dans la dimension interpersonnelle.
En de de ce sommet, la rflexion morale est une patiente mise
l'preuve des candidats au titre de bon sans restriction et, par
implication, en vertu du statut d'une volont finie, au titre de
catgoriquement impratif. Le style d'une morale de l'obligation peut
alors tre caractris par la stratgie progressive de mise distance,
d'puration, d'exclusion, au terme de laquelle la volont bonne sans
restriction sera gale la volont autolgislatrice, selon le principe
suprme d'autonomie.
Si l'on aborde cette stratgie du point de vue de ce qui est ainsi mis
l'cart, plusieurs stades doivent tre distingus. Au premier stade,
l'inclination, signe de finitude, n'est mise l'cart qu'en raison de son
inadquation purement pistmique au regard du critre d'universalit.
Il est important, pour la discussion ultrieure, de sparer l'impuret
empirique de l'inclination, de la
1. Afin de dvelopper le concept d'une volont souverainement estimable en
elle-mme, d'une volont bonne indpendamment de toute intention ultrieure ,
il faut examiner le concept du devoir, qui contient celui d'une bonne volont,
avec certaines restrictions, il est vrai, et certaines entraves subjectives ; mais qui,
bien loin de le dissimuler et de le rendre mconnaissable, le font plutt ressortir
par contraste et le rendent d'autant plus clatant (Fondements..., trad. Delbos
[IV, 397], p. 255). C'est ici que se fait la rupture entre la critique et le sens moral
ordinaire : Il y a nanmoins dans cette ide de la valeur absolue de la simple
volont, dans cette faon de l'estimer sans faire entrer aucune utilit en ligne de
compte, quelque chose de si trange que, malgr mme l'accord complet qu'il y a
entre elle et la raison commune, un soupon peut cependant s'veiller : peut-tre
n'y a-t-il l au fond qu'une transcendante chimre, et peut-tre est-ce comprendre
faux l'intention dans laquelle la nature a dlgu la raison au gouvernement de
notre volont. Aussi allons-nous, de ce point de vue, mettre cette ide l'preuve
[Priijung] (Fondements..., trad. Delbos [IV, 394-395], p. 252). Cette ide de mise
l'preuveva tre le fil conducteur de notre reconstruction de la morale de l'obli-
gation.
240 241
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LANORMEMORALE
rcalcitrance et donc de la dsobissance virtuelle, qui rendent compte
du caractre de contrainte de l'impratif moral. Les deux
problmatiques de l'universalit et de la contrainte sont sans doute
difficiles distinguer en raison de la constitution finie de la volont. Mais
on peut au moins concevoir un mode de dtermination subjective qui ne
porterait pas la marque de l'antagonisme entre la raison et le dsir.
Aucune rprobation ne serait alors attache la mise hors circuit de
l'inclination : seule son empiricit la disqualifierait. Ce stade peut
parfaitement tre isol dans la dmarche kantienne. Il correspond la
soumission des maximes de l'action la rgle d'universalisation
1
. C'est
en effet uniquement par le truchement de ces maximes, c'est--dire de
propositions renfermant une dtermination gnrale de la volont dont
dpendent plusieurs rgles pratiques
2
, que les inclinations peuvent
tre mises l'preuve. En effet, comment pourrais-je savoir si, au cours
de l'action, l'estime d'une chose est adquate l'estime absolue de la
bonne volont, sinon en posant la question : la maxime de mon action
est-elle universalisable ? La mdiation offerte ici par la maxime suppose
que, dans la position par la volont d'un projet de quelque ampleur,
soit potentiellement incluse une prtention l'universalit que la rgle
d'universalisation vient prcisment mettre l'preuve
3
. Il faut avouer
qu'ainsi caractrise, la notion de maxime est sans prcdent dans la tra-
dition tlologique, en dpit des traces d'universalisme que nous avons
repres plus haut. Ce n'est pas en effet la prtention l'universalit,
mais la tlologie interne qui, chez Aristote, d'abord, caractrisait la
notion de dsir rationnel , puis, dans nos propres analyses de la
praxis, les notions de pratiques, de plans de vie et d'unit narrative
d'une vie. Ces dernires notions peuvent certes tre retranscrites dans
le vocabulaire de la maxime, la faveur de leur parent avec le caractre
de gnralit de la maxime au plan d'une phnomnologie de la praxis ;
mais c'est Vpreuve d'universalisation qui donne la maxime sa signifi-
cation spcifique, en mme temps que cette preuve dfinit pour
1. Selon l'expression heureuse de O. Hffe, dans sa remarquable analyse de la
maxime en tant qu' objet de l'universalisation (op. cit.. p. 82-102), les maximes
sont les rgularits que l'agent constitue lui-mme en les faisant siennes.
2. Critiquedela Raison pratique, trad. fr. de F. Picavet, Paris, PUF, 1943, 4'
d., 1965 [V, 19], p. 17. Nous citerons C.R.Pr. cf. galement Kant, uvres philo-
sophiques, d. AJqui, op. cit., t. II, p. 627.
3. Sur la notion kantienne de maxime, cf., outre O. Hffe, B. Carnois, La coh-
rencedela doctrinekantiennedela libert. Paris, d. du Seuil, 1973, p. 137-139 et
passim.
la premire fois le formalisme, comme en tmoigne la formulation la
plus gnrale de l'impratif catgorique : Agis uniquement d'aprs la
maxime qui fait que tu peux vouloir en mme temps qu'elle devienne
une loi universelle {Fondements..., trad. Delbos [IV, 421], p. 285). A ce
stade, aucune rcalcitrance de l'inclination n'est prise en considration ;
seul le critre d'universalisation rend manifeste l'inadquation de la
prtention l'universalit attache la maxime, au regard de l'exigence
d'universalit inscrite dans la raison pratique
1
.
C'est avec le deuxime et le troisime degr de la scission qu'une
morale de l'obligation revt les traits qui l'opposent le plus radicalement
une thique fonde sur la vise de la vie bonne . Dans l'analyse
qui prcde, on a isol l'aspect universel de l'aspect contraignant du
devoir, en dpit de leur liaison troite dans la structure d'une volont
finie, c'est--dire empiriquement dtermine. L'aspect contraignant
mrite son tour un examen distinct, dans la mesure o c'est lui qui
dtermine la forme de Y impratif que revt la rgle de
l'universalisation. Or, considr du point de vue de la thorie des actes
de discours, l'impratif pose un problme spcifique : outre des
conditions de succs (un commandement a-t-il t effectivement mis en
accord avec les conventions qui l'autorisent ?), les actes de discours sont
soumis des conditions de satisfaction (ce commandement a-t-il t
suivi d'obissance ou non?)
2
. Cette relation entre commandement et
obissance marque une diffrence nouvelle entre la norme morale et la
vise thique. Or il est remarquable que, dans le langage ordinaire, cette
espce d'acte de discours requiert un locuteur et un allocutaire
distincts: l'un commande, l'autre est contraint d'obir en vertu de la
condition de satisfaction de l'impratif. C'est cette situation que Kant a
intriorise en plaant dans le mme sujet le pouvoir de commander et
celui d'obir ou de dsobir. L'inclination se trouve ds lors dfinie par
son pouvoir de dsobissance. Ce pouvoir, Kant l'assimile la passivit
inhrente l'inclination, qui lui fait appeler pathologique le dsir
3
.
1. Nous mettrons en question dans l'tude suivante ce privilge accord par
Kant la rgle d'universalisation et la version troite qu'il en donne en termes
exclusifs de non-contradiction.
2. Sur la distinction entre conditions de succs et conditions de satisfaction, cf.
Daniel Vanderveken, Les Actes dediscours, Lige, Bruxelles, Mariaga, 1988.
3. Dans la volont affecte pathologiquement d'un tre raisonnable, il peut y
avoir conflit [Widerstreil] entre les maximes et les lois pratiques reconnues par
l'tre lui-mme (C.R.Pr., trad. F. Picavet, chap. I, 1, scolie [V, 19], p. 17 ; cf.
d. Alqui, t. II, p. 627-628).
242 243
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA NORME MORALE
Il est difficile, en ce point, de ne pas reprendre l'accusation classique
de rigorisme, selon laquelle Kant tiendrait le dsir pour intrinsquement
hostile la rationalit'. On peut rsister jusqu' un certain point cette
accusation en faisant passer, comme Kant, la ligne de partage
l'intrieur mme de la famille des impratifs, et en distinguant, comme il
est bien connu, entre l'impratif catgorique et les impratifs
simplement hypothtiques, ceux de l'habilet et ceux de la prudence.
Cette distinction s'avre tre l'homologue exact, dans l'ordre de la
contrainte, de celle qu'introduit le critre d'universalisation. Si l'on
admet que la forme imprative est requise par la structure d'une volont
finie, alors l'impratif catgorique est l'impratif qui a pass avec succs
l'preuve de l'universalisation.
La nouveaut introduite par le caractre de contrainte de l'obligation
n'est pleinement explicite que par les premiers Thormes et les deux
Problmes de Y Analytique de la Raison pure pratique. Ce qui est ici
thoris, c'est prcisment ce que l'impratif catgorique exclut, savoir
la motivation propre aux autres impratifs
2
. Un second seuil de
formalisme est ainsi franchi : la mdiation par les maximes n'est pas
oublie, mais les maximes subjectives sont ramenes en bloc leur
source unique, la facult de dsirer , et les maximes objectives la
simple (blosse) forme d'une lgislation
3
.
1. Kant parat en effet prs de Platon, distinguant entre la partie de l'me qui
commande, parce qu'irrationnelle, et celle qui, parce qu'irrationnelle, est capable
de rbellion. Il n'est pas jusqu'au thumos platonicien, plac au milieu, qui n'ait
son parallle dans l'analyse kantienne de l'acte volontaire, qui lui-mme se divise
entre la volont dtermine par la loi (Wille) et la volont capable d'hsiter entre
la loi et le dsir, et. ce titre, place dans la position d'arbitre entre les deux : ce
que signifie exactement Varbitrium, devenu chez Kant Willkuhr, qu'il faudrait tra-
duire simplement par arbitre .
2. Le ThormeI nonce qu'un principe qui ne se fonde que sur la capacit de
sentir du plaisir ou de la peine peut servir de maxime mais non de loi. Le rle de
la dsobissance possible - du conflit - est rigoureusement dfini par l'tat ter-
minal de ce qu'on a nomm jusqu'ici inclination, savoir le plaisir et la peine ri-
gs en principes dterminants de l'arbitre. Le ThormeII aligne sur le plaisir et la
peine des affects aussi diffrents au point de vue phnomnologique que l'agr-
ment, la satisfaction, le contentement, la flicit (le vocabulaire des affects est
cet gard d'une richesse insouponne). La facult de dsirer est ainsi unifie en
vertu de sa position antagoniste, l'amour de soi et le bonheur personnel tombant
sous la mme rubrique.
3. Toutes les rgles pratiques matriellesplacent le principe dterminant de la
volont dans la facultinfrieurededsirer, et s'il n'y avait aucune loi simplement
formelle de la volont, qui la dtermint suffisamment, il n'y aurait lieu d'ad-
mettre aucune facultsuprieurededsirer ( 3, ThormeII, Corollaire, trad.
Picavet, p. 21 ; cf. d. Alqui, t. II, p. 633).
Le seuil dcisif de la scission est franchi avec l'ide d'autolgis-lation
ou autonomie*. Ce n'est plus seulement de volont qu'il s'agit, mais de
libert. Ou plutt, la libert dsigne la volont (Wille) dans sa structure
fondamentale, et non plus selon sa condition finie (Willkuhr). De cette
libert, la Dialectique de la Critique de la Raison pure n'avait pu tablir
que le caractre simplement pensable. Voici la libert justifie
pratiquement: d'abord, en termes ngatifs, par l'indpendance totale
l'gard de la loi naturelle des phnomnes dans leur rapport mutuel,
c'est--dire de la loi de la causalit (Problme I, C.R.Pn, trad. Picavet,
p. 28 ; cf. d. Alqui [V, 29], p. 641), puis, positivement, en tant
qu'autodonation de la loi (Thorme IV). Avec l'autonomie, la scission
dont nous suivons le destin de degr en degr, atteint son expression la
plus radicale : l'autonomie s'oppose Vhtro-nomie de l'arbitre, en vertu
de quoi la volont se donne seulement le prcepte d'une obissance
raisonnable une loi pathologique (Thorme IV, trad. Picavet, p. 33 ;
cf. d. Alqui [V, 33], p. 648). Avec cette opposition - ce Widerstreit -
entre autonomie et htronomie, le formalisme est port son comble ;
Kant peut en effet proclamer : la morale rside l o la simple forme
lgislative des maximes est elle seule le principe suffisant de dter-
mination de la volont (C.R.Pr., trad. Picavet, p. 28; cf. d. Alqui [V,
28], p. 640). Certes, nous n'avons pas quitt le vocabulaire de l'impratif ;
mais nous l'avons en quelque sorte sublim : quand l'autonomie substitue
l'obissance l'autre l'obissance soi-mme, l'obissance a perdu tout
caractre de dpendance et de soumission. L'obissance vritable,
pourrait-on dire, c'est l'autonomie.
La reconstruction qui prcde du concept kantien de moralit a t
rduite aux lments qui suffisent caractriser le point de vue
dontologique face la conception tlologique de l'thique : bonne
volont en tant que dtermination du bon sans restriction, critre
d'universalisation, lgislation par la forme seule, enfin
I. O. Hffe caractrise juste titre l'autonomie comme le mta-critre , afin
de la distinguer de la rgle d'universalisation, critre unique du bon sans restric-
tion (op. cit., p. 127). Il note l'origine chez Rousseau de l'ide d'autolgislation :
L'obissance la loi qu'on s'est prescrite est libert (Contrat social, livre I,
chap. VIII, cit par Hffe, p. 128). L'autonomie devient ainsi l'quivalent d'un
contrat pass avec soi-mme : Une volont laquelle la pure forme lgislative de
la maxime peut servir de loi est une volont libre (ProblmeI, p. 28). Ce lien du
formalisme moral avec la tradition contractualiste nous intresse d'autant plus
que nous retrouverons cette dernire quand nous traiterons de la rgle formelle de
justice. Concernant la place de l'autonomie sur l' arbre gnalogique des diff-
rents concepts de libert chez Kant, cf. B. Carnois, op. cit.. p. lOsg. et 191-193.
244 245
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LANORMEMORALE
autonomie. Les antagonismes caractristiques de la fondation kantienne
ont t ordonns selon les degrs d'une logique d'exclusion. L'opposition
entre autonomie et htronomie est ainsi apparue comme constitutive
de l'ipsit morale. Dans l'esprit du kantisme, la position du soi
lgislateur ne doit pas tre confondue avec une thse gologique. Comme
il a t dit plus haut en termes gnraux, le caractre abstrait de ce
premier moment de la structure triadique de la moralit est
proportionnel au degr d'universalit atteint par le jugement moral en
gnral. En consquence, le principe d'autonomie prtend chapper
l'alternative du monologue et du dialogue. Selon la formule de Kant
dans les Fondements, on observera une progression d'un genre trs
particulier lorsque l'on passera de la formulation gnrale de l'impratif
catgorique la seconde et la troisime formulation, qui rgiront la
seconde et la troisime tape de notre propre itinraire. La progression,
dit Kant, se fait de la forme, qui consiste dans l'universalit , la
matire , o les personnes sont apprhendes comme des fins en
elles-mmes, et de l la dtermination complte de toutes les
maximes, avec la notion de rgne des fins
1
. Le progrs, ajoute Kant,
se fait ici en quelque sorte selon les catgories, en allant de Y unit de la
forme de la volont (son universalit) la pluralit de la matire (des
objets, c'est--dire des fins) et de l la totalit ou intgralit du systme
{Fondements... [IV, 436], p. 304)
2
. Unit, pluralit, totalit sont certes
des catgories de la quantit. Mais c'est seulement en quelque sorte
que Y unit de la forme est distingue de la pluralit de la matire. Cette
unit n'est pas celle d'un ego solitaire. C'est celle de Yuniversalit de
vouloir, saisie en ce moment abstrait o elle ne s'est pas encore
distribue entre la pluralit des personnes. Cette progression
seulement pdagogique ou psychagogique
1. Fondements... [IV, 436] p. 303-304. Kant souligne avec insistance que
chaque formule contient en elle par elle-mme les deux autres (ibid.): il
ajoute : Il y a cependant entre elles une diffrence, qui vrai dire est plutt sub-
jectivement qu'objectivement pratique, et dont le but est de rapprocher (selon une
certaine analogie) une ide de la raison de l'intuition et par la du sentiment
(ibid. [IV, 436), p. 303).
2. La prminence de la premire formule n'en demeure pas moins : on fait
mieux de procder toujours, quand il s'agit de porter un jugement moral, selon la
stricte mthode, et de prendre pour principe la formule universelle de l'impratif
catgorique : Agis selon la maximequi peut en mmetemps s'riger elle-mmeen
loi universelle. Pourtant, si l'on veut en mme temps mnager la loi morale l'accs
des mes, il est trs utile de faire passer la mme action par les trois concepts
indiqus et de la rapprocher par l, autant que possible, de l'intuition (ibid. [IV,
436-437], p. 304).
( mnager la loi morale Yaccs des mes !) fera l'objet d'une
discussion en rgle lorsque nous aurons achev le parcours entier des
formulations de la moralit.
Avant de passer de l'autonomie du soi, dans sa dimension universelle,
au rgime de pluralit qui caractrisera notre seconde tape, dsignons
trois lieux qui, avant toute critique dirige du dehors contre la
moralit kantienne, sont points par le texte kantien lui-mme comme
des lieux de virtuelle aporie
1
.
Le premier de ces lieux a affaire avec la nature de la
dduction que Kant dclare avoir faite du principe de l'autonomie.
Si, comme il se doit, on entend par dduction, au sens juridique de la
quaestio juris, la remonte des prsuppositions dernires, il faut
avouer que, dans le cas de l'autonomie, cette remonte s'arrte
l'attestation d'un fait, le fameux Factum der Vernunft - le fait de la
raison -, qui a suscit tant de commentaires. Certes, Kant ne parle de
fait qu' propos de la conscience (Bewusstsein) que nous prenons de la
capacit autolgislatrice du sujet moral (C.R.Pr., trad. Picavet, p. 31 ; d.
Alqui [V, 31], p. 645). Mais cette conscience est le seul accs que nous
ayons la sorte de relation synthtique que l'autonomie instaure entre la
libert et la loi. En ce sens, le fait de la raison n'est autre que la
conscience
1. C'est dessein qu'il n'a pas t fait tat, dans une reconstruction soucieuse
de situer avec prcision le moment de plus grand cart entre le point de vue don-
tologique et la perspective tlologique, de l'apport original de la Dialectiquedela
Raison purepratique. Celle-ci ouvre, si l'on peut dire, un nouveau chantier, avec le
thme du souverain bien. Sous l'gide de ce terme, Kant s'interroge sur ce qu'il
convient d'appeler l'objet entier d'une raison pure pratique (trad. Picavet,
p. 117 ; d. Alqui, [V, 109], p. 741), ou encore la totalit inconditionne de
cet objet. On pourrait dire que cette nouvelle interrogation ramne Kant dans les
eaux de la tlologie aristotlicienne. Certaines expressions telles que celle-ci : le
bien complet et parfait en tant qu'objet de la facult de dsirer d'tres raison-
nables et finis (trad. Picavet. p. 119 ; d. Alqui [V, 119], p. 742), donnent quel-
que crdit cette interprtation. Mais, outre le fait que la conjonction de nature
non analytique mais synthtique entre vertu et bonheur pose en elle-mme un
problme spcifique, lequel son tour dbouche sur celui plus considrable encore
des Postulats de la raison pratique, il importe de rpter aprs Kant que la Dialec-
tiquene dfait pas ce que l'Analytiquea construit : c'est seulement pour une
volont autonome que s'ouvre la carrire de cette nouvelle problmatique du sou-
verain bien et du bonheur. Il est en outre frappant qu'en se concentrant sur la
nature du lien identitaire ou non, entre vertu et bonheur , Kant n'avait pas de
raison de croiser Aristote sur son chemin ; il ne rencontrait parmi ses devanciers
que l'picurisme et le stocisme (ibid., trad. Picavet, p. \20sq., d. Alqui [V, 1
\2sq.], p. 145sq.). Le formalisme de la moralit lui interdisait de poser le problme
du souverain bien en termes de dynamique et de vise, en dpit des expressions en
apparence si proches d'Aristote voques l'instant.
246
247
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA NORME MORALE
que nous prenons de cette liaison originaire. Pour ma part, je reconnais
volontiers dans cette conscience la forme spcifique que revt
l'attestation du qui ? dans sa dimension morale ; autrement dit, le
tmoignage port sur le statut pratique de la volont libre '. Le
vocabulaire de Kant le confirme : dans cefactum, dit-il, la raison pure
se manifeste [sich beweist) comme rellement pratique en nous
(C.R.Pr., trad. Picavet, p. 41 ; d. Alqui [V, 42], p. 658) ; c'est en ce
sens trs particulier que l'autonomie est appele elle-mme un fait
apodictiquement certain (C.R.Pr., trad. Picavet, p. 47 ; d. Alqui [V,
47], p. 664)
2
. Le rapport entre modle et copie, archtype et ectype,
monde de l'entendement pur et monde sensible, justifie l'usage
analogique de la nature dans la premire formulation secondaire de
l'impratif catgorique, comme si un ordre naturel devait tre enfant
par notre volont (trad. Picavet, p. 44; cf. d. Alqui [V, 44], p. 661)
3
.
Nous retrouvons, au terme de la mise l'preuve et du criblage des
concurrents du devoir, la confiance place initialement dans
l'exprience morale commune. Mais cette auto-attestation peut-elle tre
assimile une autoposition ? N'y a-t-il pas plutt l, dissimul sous la
fiert de l'assertion d'autonomie, l'aveu d'une certaine rceptivit, dans
la mesure o la loi, en dterminant la libert, l'affecte ?
1. Mon interprtation est proche de celle de O. Hffe : Avec le terme " fait de
la raison pratique ", Kant veut indiquer que la morale existe effectivement (op.
cit., p. 136). Plus loin : Kant parle d'un fait [factum] parce qu'il considre la
conscience de la loi morale comme une ralit, comme quelque chose de rel et
non pas de fictif, de simplement admis (op. cit., p. 137).
2. La premire occurrence du terme fait de la raison se lit ici : cependant,
pour ne pas se mprendre, en admettant cette loi commedonne, il faut bien
remarquer qu'elle n'est pas un fait empirique, mais le fait unique de la raison, qui
s'annonce par l comme originairement lgislative (sic volo, sicjubeo) (C.R.Pr..
trad. Picavet, p. 31 ; d. Alqui [V, 31], p. 645). On notera d'autres expressions :
lettre de crance [Creditiv] de la loi morale , garantie [Sicherung] de son pro-
blmatique concept de libert (trad. Picavet, p. 49 ; d. Alqui [V, 49], p. 667). Il
est dit encore que ce fait a une signification purement pratique (trad. Picavet,
p. 50 ; d. Alqui [V, 50], p. 668) et qu'il est inexplicable par toutes les donnes
du monde sensible (trad. Picavet, p. 42 ; cf. Alqui [V, 43], p. 659). H est vrai
que Kant parat identifier cette attestation pratique une vritable perce dans
l'ordre noumnal jusqu' la nature supra-sensible des tres raisonnables en gn-
ral (ibid., cf. Alqui [V, 43], p. 659). Mais la rserve qui suit ne doit pas tre
omise : une nature sensible qui n'est connue que par des lois de caractre pratique
n'est qu'une naturesousl'autonomiedela raison purepratique (trad. Picavet, p.
43 ; cf. d. Alqui [V, 43], p. 660).
3. Sur ces textes difficiles, cf. D. Henrich, Der Begriff der sittlichen Einsicht
und Kants Lehre von Faktum der Vernunft (in G.P. Prauss [d.], Kant. Cologne,
Kieperheuer und Witsch, 1973, p. 223-224; cf. galement B. Carnois, op. cit.,
p. 93-117).
Ce soupon trouve quelque renfort dans le traitement qui est rserv
par la Critique de la Raison pratique au respect. En un sens, il peut
paratre prmatur de parler du respect avant de l'avoir dploy lui
aussi selon la triple membrure de la moralit, selon la distinction qui
vient d'tre faite entre unit (ou universalit), pluralit et totalit. Le
respect, dont nous avons fait le titre emblmatique de la doctrine entire
de la moralit, n'aura reu sa signification plnire que lorsque sa
structure triadique aura t assure. Nanmoins, c'est au niveau du
principe d'autonomie, dans la nudit du rapport de la libert la loi,
lorsqu'il n'a pas encore t fait acception des personnes en tant que fins
en elles-mmes, que le respect rvle son trange nature . Celle-ci tient
la place du respect, en tant que sentiment, parmi les mobiles de la
raison pure pratique (Analytique, chap. III). Le respect est un mobile en
ceci qu'il incline, sur le mode d'une affection passivement reue,
faire une maxime de la loi elle-mme (trad. Picavet, p. 80 ; d.
Alqui [V, 76], p. 701)
2
.
Or il est remarquable que Kant ne se soit pas pos le problme du
rapport entre le caractre de quasi-position de soi par soi de l'autonomie
et le caractre virtuel d'affection par l'autre impliqu par le statut du
respect en tant que mobile. Il a pens que la difficult pouvait en quelque
sorte tre rsolue, avant d'tre formule dans ces termes, en scindant en
deux l'affectivit elle-mme, et en consacrant tous ses efforts cette
scission. L'ide d'un sentiment imprim dans le cur humain par la
raison seule est suppose teindre le feu avant qu'il ait t allum. Tout
se joue a partir de l sur le dpartage, au sein des affects, entre ceux qui
continuent de relever de la pathologie du dsir et ceux qui peuvent
tre
1. Que le respect puisse tre considr indiffremment sous l'angle de la for-
mule gnrale de l'impratif catgorique, qui n'est autre que la rgle d'universali-
sation rige en principe, ou sous celui de la seconde formulation de ce principe,
o la pluralit des personnes est prise en compte, cela est confirm par la juxta-
position de textes o c'est la loi morale qui est l'objet du respect et ceux o ce sont
les personnes ; ainsi lit-on que le respect s'applique toujours uniquement aux
personnes, jamais aux choses (C.R.Pr., trad. Picavet, p. 80 ; d. Alqui [V, 76],
p. 701), alors que l'expression respect pour la loi morale est celle qui revient le
plus frquemment. Cette oscillation apparente s'explique par le fait que l'enjeu
vritable n'est pas ici l'objet du respect, mais son statut en tant que sentiment,
donc affection, par rapport au principe d'autonomie.
2. Notre insistance, la suite de O. Hffe, sur la notion de maxime trouve ici
une justification supplmentaire. L'quation entre maxime et mobile est presque
parfaite dans l'expression : un principe subjectif de dtermination, c'est--dire
un mobile pour cette action par l'influence qu'elle exerce sur la moralit du sujet
et par le sentiment qu'elle provoque, sentiment favorable l'influence de la loi sur
la volont (trad. Picavet, p. 79 ; d. Alqui [V, 75], p. 699-700).
248
249
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA NORME MORALE
tenus pour la marque mme de la raison dans le sentiment : savoir,
sur le mode ngatif, l'humiliation de l'amour-propre, et, sur le mode
positif, la vnration pour la puissance de la raison en nous.
Cette scission qui brise en deux l'affectivit ne peut pas ne pas
concerner notre investigation sur le lien - jamais rompu selon nous -
entre norme morale et vise thique. Si l'estime de soi est bien, comme
nous l'avons admis, l'expression rflexive de la vise de la vie bonne ,
elle semble tomber sous le couperet kantien qui la rejette du mauvais
ct de la ligne de partage
1
. Mais la question n'a jamais t pour nous
d'harmoniser le ton kantien et le ton aristotlicien. En vrit, la
vritable question n'est pas l. Car il est parfaitement lgitime de voir
dans le respect kantien la variante de l'estime de soi qui a pass avec
succs l'preuve du critre d'universalisation. Anticipant ce que nous
dirons plus loin sur la place du mal dans une conception dontologique
de la moralit, on peut dire que ce qui est terrass , humili , c'est
cette variante de l'estime de soi que Kant appelle Selbstliebe et qui en
constitue la perversion toujours possible et, de fait, ordinaire
2
. En ce
sens, la mise hors circuit de l' amour de soi
1. La condamnation morale de l'amour de soi (Selbstliebe) atteint ce dernier
sous sa double forme d'amour-propre (Eigenliebe), au sens de bienveillance exces-
sive pour soi-mme, et de prsomption (Eigendiinkel), ou complaisance soi
(Wohlgefallen). Le texte le plus prcis cet gard est celui-ci : On peut nommer
cette tendance se faire soi-mme, d'aprs les principes subjectifs de dtermina-
tion de son libre arbitre [Willkiinr], principe objectif de dtermination de la
volont [ Willen] en gnral, l'amour de soi qui, s'il se donne pour lgislateur et
comme principe pratique inconditionn, peut s'appeler prsomption {C.R.Pr..
trad. Picavet, p. 78 : d. Alqui [V, 74], p. 698). Ce que nous avons appel estime
de soi ne semble pas chapper cette condamnation : Toutes les prtentions
l'estime de soi-mme [Selbstschtzung] qui prcdent l'accord avec la loi morale
sont nulles et illgitimes (trad. Picavet, p. 77 ; d. Alqui [V, 73], p. 697).
2. Une expression de Kant rend plausible cette interprtation : voquant le sen-
timent d'lvation (Erhebung), face positive inverse du sentiment de coercition
(Zwang) dans la constitution contraste du respect, il propose d'appeler l'effet
subjectif sur le sentiment (...) relativement cette lvation, simplement approba-
tion desoi-mme[Selbstbilligung] (trad. Picavet, p. 85 ; d. Alqui [V, 81], p.
706). Une raison de penser que la critique du Selbstliebene rompt pas tout lien
possible avec une valuation positive de soi en tant que titulaire de l'autonomie
est fournie par les nombreuses considrations finalistes, si prsentes dans la Cri-
tiquedela facultdjuger, se rapportant au plein exercice des inclinations consti-
tutives de la nature humaine : or la personnalit est place au sommet de la hirar-
chie de ces inclinations, comme il sera rappel plus loin propos de VEssai sur le
mal radical. Dans le chapitre de la Critiquedela Raison pratiqueconsacr aux
mobiles, on lit ceci : ce qui lve l'homme au-dessus de lui-mme n'est pas autre
chose que la personnalit, c'est--dire la libert et l'indpendance l'gard du
mcanisme de la nature entire, considr cependant comme un pouvoir d'un tre
exerce l'gard de l'estime de soi une fonction critique et, par rfrence
au mal, une fonction purgative. L'amour de soi, me ris-querai-je dire,
c'est l'estime de soi pervertie par ce que nous appellerons tout l'heure
le penchant au mal '. Et le respect, c'est l'estime de soi passe au crible de
la norme universelle et contraignante, bref, l'estime de soi sous le rgime
de la loi. Cela dit, le problme le plus redoutable que pose le respect
en tant que mobile est l'introduction d'un facteur de passivit au cur
mme du principe de l'autonomie. C'est cette conjonction dans le res-
pect entre l'autoposition et l'auto-affection qui nous autorisera mettre
en question, dans l'tude suivante, l'indpendance du principe de
l'autonomie - fleuron de la conception dontologique de la moralit - par
rapport la perspective tlologique, autrement dit, mettre en doute
l'autonomie de l'autonomie.
Le troisime lieu de virtuelle aporie, par rapport la place
minente confre l'autonomie dans Y Analytique, est chercher dans Y
Essai sur le mal radical sur lequel s'ouvre La Religion dans les limites de
la simple raison. Tout ce qui, dans cet essai, tend disculper le dsir,
l'inclination, reporte du mme coup sur le (libre) arbitre lui-mme la
source de toutes les scissions dont nous avons suivi plus haut la
progression : inadquation de l'inclination en tant qu'empirique passer
l'preuve de la rgle d'universalisation, opposition du dsir pathologique
l'impratif catgorique, rsistance du penchant l'htronomie au
principe d'autonomie. Si le dsir est innocent
2
, c'est au niveau de la for-
mation des maximes qu'il faut situer le mal, avant de s'interroger - en
vain sans doute - sur son origine, et la dclarer inscrutable. Le mal est,
au sens propre du mot, perversion, savoir renversement de l'ordre qui
impose de placer le respect pour la loi au-dessus de l'inclination. Il
s'agit ici d'un usage mauvais du (libre) arbitre, et non de la malfaisance
du dsir (ni non plus, d'ailleurs,
qui est soumis des lois spciales, c'est--dire aux lois pures pratiques donnes
par sa propre raison, de sorte que la personne, comme appartenant au monde sen-
sible, est soumise sa propre personnalit, en tant qu'elle appartient en mme
temps au monde intelligible (trad. Picavet, p. 91 ; d. Alqui [V, 87], p.
713-714).
1. On remarquera que Kant parle ici, comme dans l'Essai sur lemal radical, de
l'amour de soi comme d'un penchant, d'une propension (Hang), faire des incli-
nations la condition pratique suprme.
2. Le principe du mal ne peut tre plac dans la sensibilit et dans les inclina-
tions qui en dcoulent car celles-ci n'ont pas mme de rapport direct avec le
mal (La Religion dans les limites dela simpleraison, trad. fr. de Gibelin, Paris,
Vrin, 1968, p. 559; cf. E. Kant, uvres philosophiques, op. cit., t. III, 1986 [VI,
34], p. 48).
250
251
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LANORMEMORALE
de la corruption de la raison pratique elle-mme, ce qui rendrait
l'homme diabolique et non pas simplement - si l'on ose dire
-mchant)
1
.
Une fois de plus, tout se joue au plan des maximes. Mais il s'agit
cette fois de faire place une maxime mauvaise qui serait le fondement
subjectif de toutes les maximes mauvaises. En cette maxime
primordiale consiste la propension (Hang) au mal. Certes, Kant prend
bien soin de distinguer cette propension au mal de la disposition
(Anlage) au bien, laquelle il tient pour inhrente la condition d'une
volont finie, et, en consquence, d'affirmer la contingence de cette
propension l'chelle de l'histoire humaine. Il reste nanmoins que la
propension au mal affecte l'usage de la libert, la capacit agir par
devoir, bref la capacit tre effectivement autonome. L est pour nous
le vritable problme. Car cette affection de la libert, mme si elle
n'atteint pas le principe de la moralit, qui reste l'autonomie, met en cause
son exercice, son effectuation. C'est cette situation insolite qui ouvre
d'ailleurs la religion un espace distinct de celui de la morale - la
religion, selon Kant, n'ayant pas d'autre thme que la rgnration de la
libert, c'est--dire la restauration de l'empire sur elle du bon principe.
En outre, avec cette considration de la capacit - perdue et retrouver -
de la libert, revient au premier plan celle du bien et du mal, qu'une
version strictement dontologique de la moralit avait fait reculer un
rang subsidiaire (Analytique, chap. II). Autrement dit, la question du
bien et du ma! revient avec la question du fondement subjectif de
l'usage de la libert
2
.
1. La diffrence entre l'homme bon et l'homme mauvais doit ncessairement
se trouver non dans la diffrence des motifs qu'ils admettent dans les maximes
(non dans la matire de celles-ci), mais dans leur subordination (leur forme) (La
Religion... trad. Gibelin, p. 57 ; cf. d. Alqui [VI, 36], p. 50). Il est remarquable
que Kant ne s'attarde pas la litanie des plaintes concernant la mchancet
humaine, mais va droit la figure la plus subtile du mal, celle o l'amour de soi
devient le mobile d'une conformit tout extrieure la loi morale, ce qui dfinit
trs exactement la lgalitpar opposition la moralit. Quand il se loge dans la
malice d'un cur humain qui se dupe sur la nature vritable de ses intentions, le
mal apparat plus retors que s'il s'identifiait simplement la nature sensible en
tant que telle.
2. En portant la question du mal au niveau des dispositions (Gesinnungen),
Kant renoue avec la tlologie de la Critiquedela facultdejuger. Il parcourt
d'ailleurs les degrs de cette tlologie applique la nature humaine au dbut de
l'Essai sur lemat radical : disposition Vanimalit, l'humanit, la personnalit
(op. cit.. p. 45 ; cf. d. Alqui [VI, 26]. p. 37). Dans la mesure o le concept de dis-
position relve de la tlologie, le vocabulaire du bon et du mauvais revient dans le
prsent contexte, il est vrai en un sens tout autre que celui qui a t cart de la
Critique, au chapitre II de l'Analytique. C'est en effet au niveau de la troisime
Ce problme concerne directement le statut de l'autonomie, par la
sorte d'affection qui parat coextensive son effectuation. Deux ides
sont ici retenir. La premire est l'ide, si fortement souligne par
Nabert, que le mal, rapport la formation des maximes, est penser
dans les termes d'une opposition relle, au sens de l'Essai pour introduire
en philosophie le concept de grandeur ngative
1
. Or c'est au plan o la loi
morale est elle-mme motif que le penchant au mal se dresse comme
rpugnance relle , selon l'expression de Nabert, savoir en tant que
motif contraire influant sur le libre arbitre (La Religion..., trad. Gibe-
lin, p. 42). Il faut donc admettre que le penchant au mal affecte le libre
arbitre au plan mme o le respect est lui-mme l'affection spcifique
qu'on a dite, l'affection de la libert par la loi. C'est bien ce titre que le
mal est radical (et non originaire) : Ce mal est radical parce qu'il
corrompt le fondement de toutes les maximes, de plus, en tant que
penchant naturel, il ne peut tre extirp par les forces humaines (La
Religion..., trad. Gibelin, p. 58 ; cf. d. Alqui [VI, 37], p. 51)
2
.
disposition que la propension au mal s'exerce, disposition dfinie ici comme
l'aptitude ressentir le respect de la loi morale en tant quemotif en soi suffisant du
librearbitre (ibid., p. 47 ; cf. d. Alqui [VI, 27], p. 39). Or il est rappel que
toutes ces dispositions dans l'homme ne sont pas seulement (ngativement)
bonnes (elles ne s'opposent pas la loi morale), mais sont aussi des dispositions au
bien (en avancent l'accomplissement). Elles sont originelles en tant que faisant
partie de la possibilit de la nature humaine (ibid. ; cf. d. Alqui [VI, 28], p. 40).
C'est sur ce terrain dispositionnel - haute finalit ! - que la notion de propension
au mal vient se placer : par propension (penchant), j'entends le fondement sub-
jectif de la possibilit d'une inclination (...) en tant que contingente pour l'huma-
nit en gnral (ibid., p. 48 ; cf. d. Alqui [VI, 28], p. 40). La propension au mal
s'inscrit donc dans la thorie plus gnrale des dispositions, comme une sorte de
disposition au deuxime degr, une disposition profondment enracine former
des maximes qui s'cartent de celles de la loi morale. C'est pourquoi on n'en peut
parler qu'en termes defondement subjectif.
1. Jean Nabert, Note sur l'ide du mal chez Kant , Essai sur lemal, Paris,
PUF, 1955, p. 159-165. Nabert commente ici la note de Kant qu'on lit dans La
Religion..., trad. Gibelin, p. 41, n. 1 (cf. d. Alqui [VI, 22-24], p. 33-34).
2. Je ne prends pas ici en considration ce qui, dans l'Essai sur lemal radical,
concerne l'origine historique ou rationnelle de ce penchant. Cette question
ramne Kant dans les parages d'une discussion ancienne, dlimite par le conflit
entre Augustin et Pelage. On voit en effet Kant soucieux de prserver quelque
chose de la tradition augustinienne - en faisant du penchant au mal une
quasi-nature, au point de pouvoir dclarer innle penchant au mal - tout en
assumant une position dlibrment plagienne ! Le mal, d'une certaine faon,
commence et recommence avec chaque acte mauvais, bien que, d'une autre faon,
il soit toujours dj l. Cette emphase sur la question de l'origine est responsable
de la rception gnralement hostile de l'Essai, et a empch d'en reconnatre la
vritable grandeur comme ont magnifiquement russi le faire Karl Jaspers (
Le
252 253
SOI-MME COMME UN AUTRE
LE SOI ET LA NORME MORALE
Seconde ide importante : en radicalisant le mal, en introduisant
l'ide difficile d'une maxime mauvaise de toutes les maximes, Kant a
radicalis aussi l'ide mme du (libre) arbitre, du seul fait qu'il en a fait
le sige d'une opposition relle la source de la formation des maximes.
En cela, le mal est le rvlateur de la nature ultime du (libre) arbitre.
Le (libre) arbitre humain apparat porteur d'une blessure originaire qui
atteint sa capacit se dterminer pour ou contre la loi ; l'nigme de
l'origine du mal se reflte dans celle qui affecte l'exercice actuel de la
libert ; que ce penchant soit toujours dj l en chaque occasion de
choisir, mais qu'il soit nanmoins une maxime du (libre) arbitre, voil
ce qui n'est pas moins inscrutable que l'origine du mal.
De la runion de ces deux ides rsulte la supposition qui dsormais
rgira le parcours entier des moments de la conception dontologique de
la moralit : n'est-ce pas du mal, et de l'inscru-table constitution du
(libre) arbitre qui en rsulte, que dcoule la ncessit pour l'thique
d'assumer les traits de la morale ? Parce qu'il y a le mal, la vise de la
vie bonne doit assumer l'preuve de l'obligation morale, que l'on
pourrait rcrire dans les termes suivants : Agis uniquement d'aprs la
maxime qui fait que tu peux vouloir en mme temps que ne soit pas ce
qui ne devrait pas tre, savoir le mal.
2. La sollicitude et la norme
De la mme faon que la sollicitude ne s'ajoute pas du dehors
l'estime de soi, de mme le respect d aux personnes ne constitue pas un
principe moral htrogne par rapport l'autonomie du soi, mais en
dploie, au plan de l'obligation, de la rgle, la structure dialogique
implicite.
La justification de cette thse se fera en deux temps : on montrera
d'abord par quel lien la norme du respect d aux personnes demeure
rattache la structure dialogale de la vise thique, c'est--dire
prcisment la sollicitude. On vrifiera ensuite que le respect d aux
personnes est, au plan moral, dans le mme rapport l'autonomie que la
sollicitude l'est la vise de la vie bonne au plan thique. Cette
procdure indirecte rendra plus
mal radical chez Kant , in K. Jaspers, Bilan et Perspectives, trad. fr. de H. Naef et J.
Hersch, Descle de Brouwer, 1956, p. 189-215) et Jean Nabert (op. cit.).
comprhensible la transition, abrupte chez Kant, de la formulation
gnrale de l'impratif catgorique la notion de la personne comme fin
en elle-mme, dans la deuxime formulation secondaire de
l'impratif.
De la mme manire que l'estimation de la bonne volont comme
bonne sans restriction nous avait paru assurer la transition entre la vise
de la vie bonne et sa transposition morale dans le principe de
l'obligation, c'est la Rgle d'Or qui nous parat constituer la formule de
transition approprie entre la sollicitude et le second impratif kantien.
Comme c'tait le cas pour l'estime que nous portons la bonne volont,
la Rgle d'Or parat faire partie de ces endoxa dont se rclame l'thique
d'Aristote, de ces notions reues que le philosophe n'a pas inventer,
mais clair-cir et justifier. Or, que dit la Rgle d'Or ? Lisons-la chez
Hillel, le matre juif de saint Paul (Talmud de Babylone, Shabbat, p.
31a) : Ne fais pas ton prochain ce que tu dtesterais qu'il te soit fait.
C'est ici la loi tout entire ; le reste est commentaire. La mme
formule se lit dans l'vangile : Ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le semblablement pour eux (Le 6,31) '. Les
mrites respectifs de la formule ngative (ne fais pas...) et de la formule
positive (fais...) s'quilibrent ; l'interdiction laisse ouvert l'ventail des
choses non dfendues, et ainsi fait place l'invention morale dans
l'ordre du permis ; en revanche, le commandement positif dsigne plus
clairement le motif de bienveillance qui porte faire quelque chose en
faveur du prochain. A cet gard, la formule positive se rapproche du
commandement qu'on lit en Lvitique 19,18 et qui est repris en Mt
22,39 : Tu aimeras ton prochain comme toi-mme ; cette dernire
formule marque peut-tre mieux que les prcdentes la filiation entre la
sollicitude et la norme. En revanche, la formule de Hillel et ses
quivalents vangliques expriment mieux la structure commune
toutes ces expressions, savoir renonciation d'une norme de
rciprocit.
Mais le plus remarquable, dans la formulation de cette rgle, c'est que
la rciprocit exige se dtache sur le fond de la prsupposition d'une
dissymtrie initiale entre les protagonistes de l'action - dissymtrie qui
place l'un dans la position d'agent et l'autre dans celle de patient. Cette
absence de symtrie a sa projection grammaticale dans l'opposition entre
la forme active du faire et la
1. De mme chez Matthieu: ainsi, tout ce que vous dsirez que les autres
fassent pour vous, faites-le vous-mmes pour eux : voil la Loi et les Prophtes
(Mt7,12).
254 255
SOI-MME COMME UN AUTRE LE SOI ET LA NORME MORALE
forme passive du tre fait, donc du subir. Or, le passage de la sollicitude
la norme est troitement solidaire de cette dissymtrie de base, dans la
mesure o c'est sur cette dernire que se greffent toutes les drives
malfiques de l'interaction, commenant avec l'influence et s'achevant
dans le meurtre. Au terme extrme de cette drive, la norme de
rciprocit parat se dtacher de l'lan de la sollicitude pour se
concentrer dans l'interdiction du meurtre, Tu ne tueras pas ; le lien
entre cette interdiction et la Rgle d'Or y parat mme compltement
oblitr. C'est pourquoi il n'est pas inutile de reconstituer les formes
intermdiaires de la dissymtrie dans l'action prsuppose par la Rgle
d'Or, dans la mesure o l'itinraire de la sollicitude l'interdiction du
meurtre double celui de la violence travers les figures de la
non-rciprocit dans l'interaction.
L'occasion de la violence, pour ne pas dire le tournant vers la violence,
rside dans le pouvoir exerc sur une volont par une volont. Il est
difficile d'imaginer des situations d'interaction o l'un n'exerce pas un
pouvoir sur l'autre du fait mme qu'il agit. Insistons sur l'expression
pouvoir-sur . Il importe, vue l'extrme ambigut du terme pouvoir ,
de distinguer l'expression pouvoir-sur de deux autres emplois du
terme pouvoir auquel il nous est arriv de recourir dans les tudes
prcdentes. Nous avons appel pouvoir-faire, ou puissance d'agir, la
capacit qu'a un agent de se constituer en auteur de son action, avec
toutes les difficults et apories adjacentes. Nous avons aussi appel pou-
voir-en-commun la capacit que les membres d'une communaut
historique ont d'exercer de faon indivisible leur vouloir-vivre
ensemble, et nous avons distingu avec soin ce pouvoir-en-commun
de la relation de domination o se loge la violence politique, aussi bien
celle des gouvernants que celle des gouverns. Le pouvoir-sur, greff sur
la dissymtrie initiale entre ce que l'un fait et ce qui est fait l'autre -
autrement dit, ce que cet autre subit -, peut tre tenu pour l'occasion par
excellence du mal de violence. La pente descendante est ais jalonner
depuis l'influence, forme douce du pouvoir-sur, jusqu' la torture, forme
extrme de l'abus. Dans le domaine mme de la violence physique, en
tant qu'usage abusif de la force contre autrui, les figures du mal sont
innombrables, depuis le simple usage de la menace, en passant par tous
les degrs de la contrainte, jusqu'au meurtre. Sous ces formes diverses,
la violence quivaut la diminution ou la destruction du pouvoir-faire
d'autrui. Mais il y a pire encore : dans la torture, ce que le bourreau
cherche atteindre et parfois - hlas ! - russit
briser, c'est l'estime de soi de la victime, estime que le passage par la
norme a port au rang de respect de soi. Ce qu'on appelle humiliation -
caricature horrible de l'humilit - n'est pas autre chose que la
destruction du respect de soi, par-del la destruction du pouvoir-faire. Ici
semble tre atteint le fond du mal. Mais la violence peut aussi se
dissimuler dans le langage en tant qu'acte de discours, donc en tant
qu'action ; c'est l'occasion d'anticiper l'analyse que nous ferons plus loin
de la promesse : ce n'est pas un hasard si Kant compte la fausse promesse
parmi les exemples majeurs de maximes rebelles la fois la rgle
d'universalisation et au respect de la diffrence entre la
personne-fin-en-soi et la chose-moyen. La trahison de l'amiti, figure
inverse de la fidlit, sans galer l'horreur de la torture, en dit long sur la
malice du cur humain. C'est en prenant une vue large du langage
qu'ric Weil, au seuil de son grand uvre Logique de la philosophie,
opposait globalement la violence au discours. Une opposition semblable
se retrouverait aisment dans l'thique de la communication chez J.
Habermas ou chez K.O. Apel, sous la figure de ce qu'on pourrait
appeler le refus du meilleur argument. Dans un sens diffrent, la
catgorie de l'avoir dsigne un immense domaine o le tort fait
autrui revt des guises innombrables. Dans la Mtaphysique des murs,
Kant a esquiss une configuration du tort sur la base de la distinction
entre le mien et le tien ; cette insistance peut tre particulire une
poque o le droit de proprit occupe une place excessive dans
l'appareil juridique et surtout o le viol de ce droit suscite une raction
dmesure qui s'exprime dans l'chelle des punitions. Mais on ne connat
pas de rgime politique ou social o la distinction du mien et du tien dis-
paratrait, ne serait-ce qu'au plan de Yhabeas corpus. En ce sens, la
catgorie de l'avoir reste un repre indispensable dans une typologie du
tort. Une combinaison remarquable entre la trahison au plan verbal et le
tort au plan de l'avoir serait la ruse, forme vicieuse la fois de l'ironie et
de l'habilet. La confiance d'autrui y est deux fois abuse. Que dire
encore de la persistance ttue des formes de violence sexuelle, depuis le
harclement des femmes jusqu'au viol, en passant par le calvaire des
femmes battues et des enfants maltraits ? Dans cette intimit du
corps--corps s'insinuent les formes sournoises de la torture.
Ce parcours sinistre - et non exhaustif - des figures du mal dans la
dimension intersubjective instaure par la sollicitude a sa contrepartie
dans l'numration des prescriptions et des interdictions issues de la
Rgle d'Or selon la varit des comparti-
256 257
SOI-MME COMME UN AUTRE
LE SOI ET LA NORME MORALE
ments de l'interaction : tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne
tueras pas, tu ne tortureras pas. A chaque fois la morale rplique la
violence. Et, si le commandement ne peut manquer de revtir la
forme de l'interdiction, c'est prcisment cause du mal : toutes
les figures du mal rpond le non de la morale. L rside sans doute
la raison ultime pour laquelle la forme ngative de l'interdiction est
inexpugnable. La philosophie morale en fera d'autant plus
volontiers l'aveu que, au cours de cette descente en enfer, le primat
de l'thique sur la morale n'aura pas t perdu de vue. Au plan de la
vise thique, en effet, la sollicitude, en tant qu'change mutuel des
estimes de soi, est de part en part affirmative. Cette affirmation,
qu'on peut bien dire originaire, est l'me cache de l'interdiction.
C'est elle qui, titre ultime, arme notre indignation, c'est--dire
notre refus de Yindignit inflige autrui.
Abordons maintenant la deuxime phase de notre argument,
savoir que le respect d aux personnes, pos dans la deuxime
formule de l'impratif kantien', est, au plan moral, dans le mme
rapport par rapport l'autonomie que la sollicitude l'tait, au plan
thique, la vise de la vie bonne . Or ce dernier lien avait ceci de
particulier que la continuit entre le premier et le second moment de
la vise thique tait au prix d'un vritable saut, l'al-trit venant
briser ce que Lvinas appelle la sparation du moi ; c'est ce
prix seulement que la sollicitude a pu apparatre aprs coup comme
le dpli de la vise de la vie bonne . Or, chez Kant, il parat en
tre tout autrement : la seconde formule de l'impratif catgorique
est traite explicitement comme un dveloppement de la formule
gnrale de l'impratif : Agis de telle sorte que la maxime de ta
volont puisse toujours valoir en mme temps comme principe
d'une lgislation universelle
2
. A la lumire de la dialectique intime
de la sollicitude, le second impratif kantien se rvle tre le sige
d'une tension entre les deux termes cls : celui d'humanit et celui
de personne comme fin en soi. L'ide d'humanit, en tant que terme
singulier, est introduite dans le prolongement de l'universalit
abstraite qui rgit le prin-
1. Nous lisons la formule kantienne : Agis de telle sorte que tu traites l'humanit
aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en mme
temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen (trad. Del-bos [IV,
429], p. 295).
2. On a voqu plus haut les textes des Fondements... selon lesquels l'explica-
tion suivrait le fil des catgories : De la forme de la volont (de son universalit)
la pluralit de la matire (des objets, c'est--dire des fins) et de l la totalit ou
l'intgralit du systme (ibid. [IV, 436], p. 304).
cipe d'autonomie, sans acception des personnes ; en revanche, l'ide
des personnes comme fins en elles-mmes demande que soit prise
en compte la pluralit des personnes, sans toutefois que l'on puisse
conduire cette ide jusqu' celle d'altrit. Or, tout dans
l'argumentation explicite de Kant vise privilgier la continuit,
assure par l'ide d'humanit, avec le principe d'autonomie, aux
dpens de la discontinuit inavoue que marque l'introduction
soudaine de l'ide de fin en soi et des personnes comme fins en
elles-mmes.
Afin de porter au jour cette tension dissimule dans l'nonc
kantien, il a paru opportun de prendre appui sur la Rgle d'Or, dans
la mesure o elle reprsente la formule la plus simple qui fasse
transition entre la sollicitude et le second impratif kantien. En
plaant la Rgle d'Or dans cette position intermdiaire, nous nous
donnons la possibilit de traiter l'impratif kantien comme la
formalisation de la Rgle d'Or.
C'est la Rgle d'Or en effet qui impose au dpart le terrain nou-
veau sur lequel le formalisme va chercher s'imposer. Ce que Kant
appelle matire ou pluralit, est trs exactement ce champ
d'interaction o une volont exerce un pouvoir-sur une autre et o la
rgle de rciprocit rplique la dissymtrie initiale entre agent et
patient. Appliqu cette rgle de rciprocit qui galise agent et
patient, le processus de formalisation tend rpter, dans ce champ
nouveau de la pluralit, la mise l'preuve par la rgle
d'universalisation qui avait assur le triomphe du principe d'au-
tonomie. C'est ici qu'entre en jeu la notion d'humanit superpose
la polarit de l'agent et du patient. A cet gard, la notion d'humanit
peut tre tenue pour l'expression plurale de l'exigence d'universalit
qui prsidait la dduction de l'autonomie, donc pour le
dploiement plural du principe mme d'autonomie. Introduite
comme terme mdiateur entre la diversit des personnes, la notion
d'humanit a pour effet d'attnuer, au point de l'vacuer, l'altrit qui
est la racine de cette diversit mme et que dramatise la relation
dissymtrique de pouvoir d'une volont sur une autre, laquelle la
Rgle d'Or fait face.
Cette intention formalisante qu'exprime l'ide mdiatrice d'hu-
manit apparat clairement quand on prend la mesure de la distance
que Kant prend l'gard de la Rgle d'Or (laquelle est d'ailleurs
rarement cite par lui et chaque fois avec quelque ddain). Cette
mfiance s'explique par le caractre imparfaitement formel de la
Rgle. Celle-ci peut sans doute tre tenue pour partiellement
formelle, en ceci qu'elle ne dit pas ce qu'autrui aimerait ou dtes-
258
259
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LANORMEMORALE
terait qu'il lui soit fait. En revanche, elle est imparfaitement formelle,
dans la mesure o elle fait rfrence l'aimer et au dtester : elle
introduit ainsi quelque chose de l'ordre des inclinations. L'preuve
d'universalisation opre ici plein : elle limine tout candidat qui ne
passe pas son test. Tous les degrs du procs d'puration men plus haut
en faveur du principe d'autonomie se retrouvent ici. Amour et haine
sont les principes subjectifs de maximes qui, en tant qu'empiriques,
sont inadquates l'exigence d'universalit ; d'autre part, l'amour et la
dtestation sont virtuellement des dsirs hostiles la rgle, et donc
entrent dans le conflit entre principe subjectif et principe objectif. En
outre, si l'on tient compte de la corruption de fait de ces affections, il
faut avouer que la rgle de rciprocit manque d'un critre discriminant
capable de trancher dans le vif de ces affections et de distinguer entre
demande lgitime et demande illgitime. Il rsulte de cette critique que
nul lien direct entre soi et l'autre que soi ne peut tre tabli sans que
soit nomm ce qui, dans ma personne et dans celle d'autrui, est digne de
respect. Or l'humanit, prise, non au sens extensif ou numratif de la
somme des humains, mais au sens comprhensif ou principiel de ce qui
rend digne de respect, n'est pas autre chose que l'universalit considre
du point de vue de la pluralit des personnes : ce que Kant appelle
objet ou matire '.
A cet gard, l'intention kantienne n'est pas douteuse : qui objecterait
que l'ide d'humanit fait cran dans le face--face direct entre
soi-mme et l'autre, il faudrait rpondre, dans l'esprit de Kant : si vous
admettez que la rgle d'universalisation est une condition ncessaire du
passage de la vise thique la norme morale au niveau de sa premire
composante, il faut trouver pour
1. Cette inflexion de l'unit la pluralit trouve un appui dans la tlologie de
la Critiquedela facultdejuger, rappele plus haut l'occasion des dveloppe-
ments sur le mal radical, qui placent la disposition la personnalit en tant
qu'tre raisonnable et responsable au-dessus de la disposition de l'homme en tant
qu'tre vivant l'animalit (leReligion..., trad. Gibelin, p. 45 ; cf. d. Alqui [VI,
26], p. 37). Cette tlologie. base sur la notion de disposition originelle au bien
dans la nature humaine, n'est pas facile dissocier entirement de la tlologie de
style aristotlicien qui reste ancre dans une anthropologie du dsir. A cet gard.
la rupture kantienne n'est peut-tre pas aussi radicale que Kant a voulu et a cru la
raliser. Notre critique de la Critique trouvera ici un de ses points d'application.
Ce sera un des effets de la crise ouverte par le formalisme moral de rintroduire au
niveau des conditions d'effectuation de la libert et des principes moraux qui la
rglent quelque chose comme des biens gnriques , des biens sociaux . Sans
cette adjonction de concepts nettement tlologiques, on ne voit pas ce que l'ide
matrielle d'humanit ajoute l'ide formelle d'universalit.
sa deuxime composante l'quivalent de l'universel requis pour la
premire; cet quivalent n'est autre que l'ide d'humanit: celle-ci
prsente la mme structure dialogique que la sollicitude, mais en
limine toute altern radicale, se bornant conduire le principe
d'autonomie de l'unit, qui ne fait pas acception des personnes, la
pluralit. Ce faisant, cette pluralisation, interne l'universel, vrifie
rtrospectivement que le soi impliqu rflexi-vement par l'impratif
formel n'tait pas de nature monologique, mais simplement indiffrent
la distinction des personnes et, en ce sens, capable d'une inscription
dans le champ de la pluralit des personnes. Or, c'est prcisment cette
inscription qui fait problme. S'il se suffisait lui-mme, l'argument en
faveur du primat de l'impratif catgorique, dans sa formulation
gnrale, par rapport la seconde formulation de l'impratif aboutirait
retirer toute originalit au respect d aux personnes dans leur diversit.
C'est ici que la notion de personne en tant que fin en elle-mme vient
quilibrer celle d'humanit, dans la mesure o elle introduit dans la
formulation mme de l'impratif la distinction entre ta personne et
la personne de tout autre . Avec la personne seulement vient la
pluralit. Cette subtile tension l'intrieur d'une formule qui parat
homogne reste dissimule du fait que l'preuve d'universalisation,
essentielle la position d'autonomie, se poursuit avec l'limination de
la maxime oppose : ne traiter l'humanit jamais simplement comme un
moyen. Le principe d'utilit n'tait-il pas le premier candidat au poste de
bon sans restriction limin ds les premires pages des Fonde-
ments ? Mais le paralllisme de l'argument masque la secrte dis-
continuit introduite par l'ide mme de personne comme fin en
elle-mme. Quelque chose de neuf est dit lorsque les notions de
matire , d' objet du devoir sont identifies celles de fin en soi. Ce
qui est dit ici de neuf, c'est exactement ce que la Rgle d'Or nonait au
plan de la sagesse populaire, avant d'tre passe au crible de la critique.
Car c'est bien son intention profonde qui ressort ici clarifie et purifie.
Qu'est-ce en effet que traiter l'humanit dans ma personne et dans
celle d'autrui comme un moyen, sinon exercer sur la volont d'autrui ce
pouvoir qui, plein de retenue dans l'influence, se dchane dans toutes les
formes de la violence et culmine dans la torture? Et qu'est-ce qui donne
l'occasion de ce glissement de la violence du pouvoir exerc par une
volont sur une autre, sinon la dissymtrie initiale entre ce que l'un fait
et ce qui est fait l'autre ? La Rgle d'Or et l'impra-
260 261
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA NORME MORALE
tif du respect d aux personnes n'ont pas seulement le mme terrain
d'exercice, ils ont en outre la mme vise : tablir la rciprocit l o
rgne le manque de rciprocit. Et, l'arrire de la Rgle d'Or refait
surface l'intuition, inhrente la sollicitude, de l'altrit vritable
la racine de la pluralit des personnes. A ce prix, l'ide unifiante et
unitaire d'humanit cesse d'apparatre comme un doublet de
l'universalit l'uvre dans le principe d'autonomie, et la seconde
formulation de l'impratif catgorique retrouve son originalit
entire.
Ce faisant, avons-nous fait violence au texte kantien ? L'origi-
nalit que nous revendiquons pour l'ide de personne comme fin en
elle-mme est ratifie par les textes des Fondements de la
mtaphysique des murs qui donnent une dmonstration
indpendante de la corrlation entre personne et fin en soi : Mais
supposer qu'il y ait quelque chose dont l'existence en soi-mme ait
une valeur absolue, quelque chose qui, comme fin en soi, pourrait
tre un principe de lois dtermines, c'est alors en cela, et en cela
seulement, que se trouverait le principe d'un impratif catgorique
possible, c'est--dire d'une loi pratique. Or, je dis : l'homme, et en
gnral tout tre raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas
simplement comme moyen dont telle ou telle volont puisse user
son gr ; dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le
concernent lui-mme que dans celles qui concernent d'autres tres
raisonnables, il doit toujours tre considr en mme temps comme
fin (trad. Delbos [IV, 428], p. 293). Un trange paralllisme est
ainsi cr entre le principe d'autonomie et celui du respect des
personnes ; non plus au niveau des contenus, mais au niveau de la
dmonstration . C'est de la mme manire que s'attestent
directement l'autonomie et la notion de personne comme fin en soi.
La conscience de l'autonomie, avons-nous observ plus haut, est
appele un fait de la raison , savoir le fait que la morale existe.
Or, il est dit maintenant que la morale existe parce que la personne
elle-mme existe (existiert) comme fin en soi '. Autrement dit, nous
avons ds toujours su la diffrence entre la personne et la chose : on
peut se procurer la seconde, l'changer, l'employer ; la manire
d'exister pour la personne consiste prcisment en ceci qu'elle ne
peut tre
1. Kant revient sur ce point avec insistance : Voici le fondement de ce principe
: la nature raisonnable existe comme fin en soi. L'homme se reprsente nces-
sairement ainsi sa propre existence [sein eignes Dasein] , trad. Delbos [IV, 429], p.
294).
obtenue, utilise, change '. L'existence revt ici un caractre la
fois pratique et ontologique : pratique, en ce sens que c'est dans la
manire d'agir, de traiter l'autre, que se vrifie la diffrence entre les
modes d'tre ; ontologique : en ce sens que la proposition la nature
raisonnable existe comme fin en soi est une proposition
existentielle. Si elle ne dit pas l'tre, elle dit l'tre-ainsi. Cette pro-
position, qu'on peut dire de nature ontico-pratique, s'impose sans
intermdiaire. On objectera que cette proposition se trouve dans la
seconde section des Fondements..., donc avant la conjonction
opre dans la troisime section entre monde noumnal et libert
pratique ; c'est pourquoi Kant observe en note : Cette proposition,
je l'avance ici comme un postulat. On en trouvera les raisons dans la
dernire section (ibid. [IV, 429], p. 294). Mais l'appartenance des
tres raisonnables un monde intelligible, n'tant l'objet d'aucune
connaissance, n'ajoute aucun complment la conjonction ici
postule entre le statut de personne et l'existence comme fin en soi :
En s'introduisant ainsi par la pense dans un monde intelligible, la
raison pratique ne dpasse en rien ses limites ; elle ne les dpasserait
que si elle voulait, en entrant en ce monde, s'y apercevoir, s'y sentir
(ibid. [IV, 458], p. 330).
Au total, Kant a-t-il russi distinguer, au plan dontologique o
il se tient, le respect d aux personnes de l'autonomie ? Oui et non.
Oui, dans la mesure o la notion d'exister comme fin en soi reste
distincte de celle de se donner soi-mme une loi ; en consquence,
la pluralit, qui faisait dfaut l'ide d'autonomie, est introduite
directement avec celle de personne comme.fin en soi. Non, dans la
mesure o, dans des expressions telles que l'homme , tout tre
raisonnable , la nature rationnelle , l'altrit est comme
empche de se dployer par l'universalit qui l'enserre, par le biais
de l'ide d'humanit
2
.
Afin de porter au jour cette subtile discordance au sein de l'im-
pratif kantien, n'tait-il pas lgitime de voir dans cet impratif la
1. ... les tres raisonnables sont appels des personnes, parce que leur nature
les dsigne dj comme des fins en soi, autrement dit comme quelque chose qui ne
peut tre employ simplement comme moyen {ibid. [IV, 428], p. 294).
2. On remarquera l'alternance du singulier et du pluriel dans les formules kan-
tiennes. Singulier : la nature raisonnable existe comme fin en soi . Pluriel : les
tres raisonnables sont appels des personnes, parce que leur nature les dsigne dj
comme des fins . A ce second registre ressortit l'ide d'irremplaabilit des
personnes, directement drive de l'opposition entre fin et moyen : les personnes
sont esfins objectives, c'est--dire des choses dont l'existence est une fin en
soi-mme, et mme une fin telle qu'elle ne peut tre remplace par aucune autre, au
service de laquelle les fins objectives devraient se mettre, simplement comme
moyens {ibid. [IV, 428]. p. 294).
262
263
SOI-MME COMME UN AUTRE
formalisation de la Rgle d'Or, laquelle dsigne obliquement la
dissymtrie initiale d'o procde le processus de victimisation auquel la
Rgle oppose l'exigence de rciprocit ? Et n'tait-il pas non moins
lgitime de faire entendre, l'arrire de la Rgle d'Or, la voix de la
sollicitude, qui demande que la pluralit des personnes et leur altrit
ne soient pas oblitres par l'ide englobante d'humanit ?
3. Du sens de la justice aux principes de justice
Que la rgle de justice exprime au plan des institutions la mme
exigence normative, la mme formulation dontologique que
l'autonomie au niveau pr-dialogique, et que le respect des personnes au
niveau dialogique et interpersonnel, cela ne surprendra pas, tant la
lgalit parat rsumer la vision morale du monde. En revanche, la
filiation d'une conception dontologique de la justice - que nous
appellerons avec Ch. Perelman rgle de justice - partir d'un sens de la
justice relevant encore de la vise de l'thique appelle une justification
distincte. Cette filiation doit tre fortement argumente, si l'on doit
pouvoir ultrieurement comprendre quelle sorte de recours le sens de
la justice demeure, quand la dontologie s'embarrasse dans les conflits
qu'elle suscite.
Rappelons l'acquis des pages consacres au sens de la justice dans
l'tude prcdente. C'est aux institutions, disions-nous, que s'applique
d'abord la vertu de justice. Et par institutions nous avons entendu les
structures varies du vouloir vivre ensemble, qui assurent ce dernier
dure, cohsion et distinction. Un thme en,est rsult, celui de
distribution, que l'on trouve impliqu dans Ythique Nicomaque au
titre de la justice distributive. C'est ce concept de distribution que l'on va
montrer plac la charnire de la vise thique et du point de vue
dontologique. C'est encore la vise thique qu'appartiennent les ides
de partage juste et de juste part sous l'gide de l'ide d'galit. Mais, si
l'ide de juste part est le legs que l'thique fait la morale, ce legs est
charg de lourdes ambiguts qu'il appartiendra au point de vue
dontologique de tirer au clair, quitte les renvoyer ultrieurement au
jugement en situation avec une acuit accrue. La premire ambigut
concerne l'ide mme de juste part, selon que l'accent est mis sur la
sparation entre ce qui appartient l'un l'exclusion de l'autre, ou sur le
lien de coopration que le partage instaure ou
LE SOI ET LA NORME MORALE
renforce. Nous avons pu conclure nos rflexions sur le sens de la justice
en disant qu'il tendait la fois vers le sens de l'endettement mutuel et
celui de l'intrt dsintress. On va voir le point de vue normatif faire
prvaloir le second sens, qui penche vers l'individualisme, sur le
premier, qu'on peut dire plus volontiers communautaire. Autre
ambigut : si l'galit est le ressort thique de la justice, comment
justifier le ddoublement de la justice en fonction de deux usages de
l'galit, l'galit simple ou arithmtique, selon laquelle toutes les parts
sont gales, et l'galit proportionnelle, selon laquelle l'galit est une
galit de rapports supposant quatre termes et non une galit de parts ?
Mais rapport entre quoi et quoi ? Que pouvons-nous dire aujourd'hui
pour justifier certaines ingalits de fait au nom d'un sens plus complexe
de l'galit ? Ici encore la norme peut trancher, mais quel prix ? Ne
sera-ce pas encore au bnfice d'un calcul pruden-tiel dont le sens de
l'appartenance sera la victime ? Mais le legs principal de l'thique la
morale, c'est l'ide mme du juste, laquelle dsormais regarde de deux
cts : du ct du bon en tant qu'extension de la sollicitude au
chacun des sans visage de la socit ; du ct du lgal , tant le
prestige de la justice parat se dissoudre dans celui de la loi positive.
C'est le souci de tirer au clair cette ambigut majeure qui anime les
tentatives pour retirer toute assise tlologique l'ide de justice et lui
assurer un statut purement dontologique. C'est par une formalisation
trs semblable celle que nous avons vu applique dans la section
prcdente la Rgle d'Or qu'une interprtation purement
dontologique de la justice a pu tre propose. C'est de cette
formalisation qu'il va tre exclusivement question dans les pages qui
suivent.
Anticipant notre argument final, nous pouvons annoncer que c'est
dans une conception purement procdurale de la justice qu'une pareille
formalisation atteint son but. La question sera alors de savoir si cette
rduction la procdure ne laisse pas un rsidu qui demande un certain
retour un point de vue tlologique, non au prix d'un reniement des
procdures formalisantes, mais au nom d'une demande laquelle ces
procdures mmes donnent une voix, de la faon qu'on dira le moment
venu. Mais il faut conqurir le droit de cette critique en accompagnant
aussi loin que possible le processus de formalisation de l'ide de justice
d'o le point de vue dontologique tire sa gloire.
L'approche dontologique n'a pu prendre pied dans le champ
institutionnel o s'applique l'ide de justice qu' la faveur d'une
264
265
SOI-MME COMME UN
AUTRE
LE SOI ET LA NORME MORALE
conjonction avec la tradition contractualiste, plus prcisment avec la
fiction d'un contrat social grce auquel une certaine collection d'individus
russissent surmonter un tat suppos primitif de nature pour accder
l'tat de droit. Cette rencontre entre une perspective dlibrment
dontologique en matire morale et le courant contractualiste n'a rien
de contingent. La fiction du contrat a pour but et pour fonction de
sparer le juste du bon, en substituant la procdure d'une dlibration
imaginaire tout engagement pralable concernant un prtendu bien
commun. Selon cette hypothse, c'est la procdure contractuelle qui est
suppose engendrer le ou les principes de justice.
Si c'est bien l l'enjeu principal, la question ultrieure sera de savoir si
une thorie contractualiste est susceptible de substituer une approche
procdurale toute fondation de l'ide de justice, quelque conviction
que ce soit concernant le bien commun du tout, de la politia, de la
rpublique ou du Commonwealth. On pourrait dire que le contrat
occupe, au plan des institutions, la place que l'autonomie occupe au
plan fondamental de la moralit. A savoir : une libert suffisamment
dgage de la gangue des inclinations se donne une loi qui est la loi
mme de la libert. Mais, alors que l'autonomie peut tre dite un fait de
raison, c'est--dire le fait que la moralit existe, le contrat ne peut tre
qu'une fiction, une fiction fondatrice certes, comme on va le dire, mais
nanmoins une fiction, parce que la rpublique n'est pas un fait, comme
l'est la conscience qui nat du savoir confus mais ferme que seule une
volont bonne est le bon sans restriction - et qui a toujours compris et
admis la Rgle d'Or qui galise l'agent et le patient de l'action. Mais les
peuples asservis pendant des millnaires savent-ils, de ce savoir qui
relve de l'attestation, qu'ils sont souverains ? Ou bien le fait est-il que la
rpublique n'est pas encore fonde, qu'elle est encore fonder et qu'elle
ne le sera jamais vraiment ? Reste alors la fiction du contrat pour gaier
une conception dontologique de la justice au principe moral de l'au-
tonomie et de la personne comme fin en soi.
L'nigme non rsolue de la fondation de la rpublique transpire
travers la formulation du contrat tant chez Rousseau ' que chez Kant
2
.
Chez le premier, il faut recourir un lgislateur pour sor-
1. LeContrat social, livre II. chap. vu.
2. On lit au 46 de la Doctrinedu droit : Le pouvoir lgislatif nt peut apparte-
nir qu' la volont unifie du peuple. En effet, comme c'est d'elle que doit pro-
cder tout droit, elle ne doit par sa loi pouvoir faire, absolument, d'injustice qui-
conque. Et plus loin au 47 : L'acte par lequel un peuple se constitue lui-mme
en Etat, proprement parler l'Ide de celui-l, qui seule permet d'en penser la
lgalit, est le contrat originaire, d'aprs lequel tous [omnes et singuli] aban-
tir du labyrinthe du politique. Chez le second, le lien est prsuppos,
mais non justifi, entre l'autonomie ou autolgislation et le contrat social
par lequel chaque membre d'une multitude abandonne sa libert
sauvage en vue de la recouvrer sous forme de libert civile en tant que
membre d'une rpublique.
C'est ce problme non rsolu que Rawls a tent de donner une
solution, une des plus fortes qui ait t offerte l'poque
contemporaine
1
. Si le terme fairness, qu'on a traduit par quit, est
propos comme cl du concept de justice, c'est parce que la fairness
caractrise la situation originelle du contrat dont est cense driver la
justice des institutions de base. Rawls assume donc entirement l'ide
d'un contrat originel entre des personnes libres et rationnelles soucieuses
de promouvoir leurs intrts individuels. Contractualisme et
individualisme avancent ainsi la main dans la main. Si la tentative
russissait, une conception purement procdurale de la justice, non
seulement se librerait de toutes prsuppositions concernant le bien,
mais librerait dfinitivement le juste de la tutelle du bien, d'abord au
niveau des institutions, puis par extension celui des individus et des
tats-nations considrs comme de grands individus. Pour prendre une
juste mesure de l'orientation antitlologique de la thorie rawlsienne de
la justice, il faut dire que sa thorie n'est dirige explicitement que contre
une version tlologique particulire de la justice, savoir celle de
l'utilitarisme, qui a prdomin pendant deux sicles dans le monde de
langue anglaise et trouv chez John Stuart Mill et Sidgwick ses avocats
les plus loquents: Platon et Aristote ne donnent gure lieu qu'
quelques notes en bas de page. L'utilitarisme est en effet une doctrine
tlologique, dans la mesure o il dfinit la justice par la maximisation du
bien pour le plus grand nombre. Quant ce bien, appliqu des
institutions, il n'est que l'extrapolation d'un principe de choix construit
au niveau de l'individu, selon lequel un plaisir simple, une satisfaction
immdiate, devraient tre sacrifis au bnfice d'un plai-
donnent dans le peupleleur libert extrieure, pour la retrouver derechef comme
membre d'une rpublique, c'est--dire d'un peuple considr comme tat
[uni-versi] et l'on ne peut pas dire que l'homme dans l'tat ait sacrifi une partiede
sa libert extrieure inne une fin, mais il a entirement abandonn la libert
sauvage et sans loi, pour retrouver sa libert en gnral dans une dpendance
lgale, c'est--dire dans un tat juridique, donc entire, car cette dpendance
procde de sa propre volont
-
lgislatrice (La Mtaphysiquedesmoeurs, premire
partie, Doctrinedu droit, trad. fr. d'A. Philonenko, Paris, Vrin, 1971, p. 196-198 ; cf.
E. Kant, uvres philosophiques, d.'Alqui. op. cit., t. III, 1986, [VI, 313], D. 578, et
[VI, 315-316], p. 581).
1. J. Rawls, Thoriedela justice, op. cit.
266
267
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA NORME MORALE
sir ou d'une satisfaction plus grands quoique loigns. La premire
ide qui vient l'esprit est qu'il y a un foss entre la conception
tlologique de l'utilitarisme et la conception dontologique en gnral :
en extrapolant de l'individu au tout social comme le fait l'utilitarisme, la
notion de sacrifice prend une tournure redoutable : ce n'est plus un
plaisir priv qui est sacrifi mais toute une couche sociale ;
l'utilitarisme, comme un disciple franais de Ren Girard, Jean-Pierre
Dupuy
1
, le soutient, implique tacitement un principe sacrificiel qui
quivaut lgitimer la stratgie du bouc missaire. La riposte kantienne
serait que le moins favoris dans une division ingale d'avantages ne
devrait pas tre sacrifi, parce qu'il est une personne, ce qui est une
faon de dire que, dans la ligne du principe sacrificiel, la victime
potentielle de la distribution serait traite comme un moyen et non
comme une fin. En un sens, c'est l aussi la conviction de Rawls comme
je m'efforcerai de le montrer plus loin. Mais, si c'est sa conviction, ce
n'est pas son argument. Or c'est celui-ci qui compte. Le livre entier est
une tentative pour dplacer la question de fondation au bnfice d'une
question d'accord mutuel, ce qui est le thme mme de toute thorie
contractualiste de la justice. La thorie rawlsienne de la justice est sans
aucun doute une thorie dontologique, en tant qu'oppose l'approche
tlologique de l'utilitarisme, mais c'est une dontologie sans fondation
trans-cendantale. Pourquoi ? Parce que c'est la fonction du contrat
social de driver les contenus des principes de justice d'une procdure
quitable (fatr) sans aucun engagement l'gard de critres
prtendument objectifs du juste, sous peine, selon Rawls, de rintroduire
ultimement quelques prsuppositions concernant le bien. Donner une
solution procdurale la question du juste, tel est le but dclar de
Thorie de la justice. Une procdure quitable en vue d'un arrangement
juste des institutions, voil ce qui est exactement signifi par le titre du
chapitre i, La justice comme quit [fairness] .
Ces considrations prliminaires acheves, considrons les rponses
que Rawls apporte aux trois questions suivantes : qu'est-ce qui
assurerait l'quit de la situation de dlibration d'o pourrait rsulter
un accord concernant un arrangement juste des institutions ? Quels
principes seraient choisis dans cette situation fictive de dlibration ?
Quel argument pourrait convaincre les parties dlibrantes de choisir
unanimement les principes
1. J.-P. Dupuy, Les paradoxes de Thoriedela justice(John Rawls) , Esprit,
nl, 1988, p. 12sq.
rawlsiens de la justice plutt que, disons, une variante quelconque
de l'utilitarisme ?
A la premire question correspond la supposition de la position
originelle et la fameuse allgorie qui l'accompagne, le voile d'ignorance.
On ne saurait trop insister sur le caractre non historique, mais
hypothtique de cette position '. Une part norme de spculation est
dpense par Rawls concernant les conditions auxquelles la situation
originelle peut tre dite quitable tous gards. C'est faire le compte
de ces contraintes qu'est destine la fable du voile d'ignorance
2
. Le
paralllisme, mais aussi le manque de similitude signal plus haut
entre la fondation kantienne de l'autonomie et le contrat social,
expliquent la complexit des rponses que Rawls donne la question de
savoir ce que les individus doivent connatre sous le voile d'ignorance,
afin que de leur choix dpende une distribution d'avantages et de
dsavantages dans une socit relle o, derrire des droits, des intrts
sont en jeu. D'o la premire contrainte : que chaque partenaire ait une
connaissance suffisante de la psychologie gnrale de l'humanit en ce
qui concerne les passions et les motivations fondamentales
3
. Seconde
contrainte: les partenaires doivent savoir ce que tout tre raisonnable
est prsum souhaiter possder, savoir les biens sociaux primaires sans
lesquels l'exercice de
1. En fait, ta position originelle est substitue l'tat de nature dans la mesure
o c'est une position d'galit. On se souvient que chez Hobbes l'tat de nature
tait caractris par la guerre de tous contre tous et, comme le- souligne Lo
Strauss, comme un tat o chacun est motiv par la crainte de la mort violente. Ce
qui est donc en jeu chez Hobbes, ce n'est pas la justice, mais la scurit. Rousseau
et Kant, sans partager l'anthropologie pessimiste de Hobbes, dcrivent l'tat de
nature comme sans loi, c'est--dire sans aucun pouvoir d'arbitrage entre revendi-
cations opposes. En revanche les principes de la justice peuvent devenir le pro-
pos d'un choix commun si et seulement si la position originelle est quitable,
c'est--dire gale. Or, elle ne peut tre quitable que dans une situation
hypothtique.
2. L'ide est la suivante : Parmi les traits essentiels de cette situation, il y a le
fait que personne ne connat sa place dans la socit, sa position de classe ou son
statut social, pas plus que personne ne connat le sort qui lui est rserv dans les
rpartitions des capacits et des dons naturels, par exemple l'intelligence, ta force,
etc. J'irai moi-mme jusqu' poser que les partenaires ignorent leurs propres
conceptions du bien ou leurs tendances psychologiques particulires (John
Rawls, Thoriedela justice, op. cit., p. 38).
3. Rawls reconnat franchement que son anthropologie philosophique est trs
proche de celle de Hume dans le Traitdela naturehumaine, livre III, en ce qui
concerne besoins, intrts, fins, revendications conflictuelles, y compris les int-
rts d'un moi qui considre que sa conception du bien mrite d'tre reconnue et
qui avance des revendications en sa faveur demandant tre satisfaites (Thorie
dela justice, op. cit., p. 160). Rawls appelle ces contraintes le contexte d'applica-
tion [circumstances] de la justice (ibid.. p. 22).
268 269
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LANORMEMORALE
la libert serait une revendication vide. A cet gard, il est important de
noter que le respect de soi appartient cette liste des biens primaires
1
.
Troisime contrainte : le choix tant entre plusieurs conceptions de la
justice, les partenaires doivent avoir une information convenable
concernant les principes de justice en comptition. Ils doivent connatre
les arguments utilitaires et, bien entendu, les principes rawlsiens de la
justice, puisque le choix n'est pas entre des lois particulires, mais entre
des conceptions globales de la justice
2
. La dlibration consiste trs
prcisment donner un rang aux thories alternatives de la justice.
Autre contrainte : tous les partenaires doivent tre gaux en informa-
tion ; c'est pourquoi la prsentation des alternatives et des arguments
doit tre publique \ Autre contrainte encore : ce que Rawls appelle la
stabilit du contrat, c'est--dire l'anticipation qu'il sera contraignant
dans la vie relle, quelles que soient les circonstances prvalentes.
Tant de prcautions tmoignent de la difficult du problme
rsoudre, savoir tablir une procdure quitable [fair] de telle sorte
que tous les principes sur lesquels un accord interviendrait soient justes.
L'objectif est d'utiliser la notion de justice procdurale pure, comme
base de la thorie. Ce que la situation originelle doit plus que tout
annuler, ce sont les effets de contingence, dus tant la nature qu'aux
circonstances sociales, le prtendu mrite tant mis par Rawls au
nombre de ces effets de contingence. L'attente du thoricien est alors
immense : puisque les partenaires ignorent ce qui les diffrencie, et
qu'ils sont tous galement rationnels et placs dans la mme situation, il
est clair qu'ils seront tous convaincus par la mme argumentation
( 24, p. 171)\
Se pose maintenant la seconde question : quels principes seraient
choisis sous le voile d'ignorance ? La rponse cette
1. En ce sens, des considrations tlologiques sont prises en compte, mais du
point de vue des partenaires entrant en dlibration, non au titre des clauses du
contrat lui-mme ; cf. 1 S, Les biens sociaux premiers comme bases des
attentes . On reviendra dans les tudes suivantes sur cette notion d'expectation.
2. C'est une des raisons pour lesquelles, dans Thoriedela justice, les principes
de la justice sont dcrits et interprts avant le traitement systmatique de la posi-
tion originelle.
3. Rawls parle cet gard des contraintes formelles du concept du juste
( 23) pour dsigner les contraintes qui valent pour le choix de tout principe moral
et non seulement pour ceux de la justice.
4. Et encore : Si quelqu'un, aprs mre rflexion, prfre une conception de la
justice une autre, alors tous la profreront et on parviendra un accord unanime
(ibid.).
question se trouve dans la description des deux principes de justice et
dans leur mise en ordre correcte. Ces principes, il faut le dire avant de
les noncer, sont des principes de distribution. L'tude prcdente nous
a familiariss avec cette notion de distribution et ses implications
pistemologiques concernant la fausse alternative entre la transcendance
de la socit et l'individualisme mthodologique : la notion de partenaire
social satisfait l'une et l'autre exigence, dans la mesure o la rgle de
distribution dfinit l'institution comme systme et o cette rgle n'existe
qu'autant que les titulaires de parts pris ensemble font de l'institution
une aventure de coopration (cooprative venture). Rawls non seulement
assume cette prsupposition, mais l'tend en la diversifiant. La justice en
tant que distributive s'tend, en effet, toutes les sortes d'avantages
susceptibles d'tre traits comme des parts distribuer : droits et
devoirs, d'une part, bnfices et charges, d'autre part. Il est clair que,
pour Rawls, l'accent ne doit pas tre mis sur la signification propre des
choses partager, sur leur valuation en tant que biens distincts, sous
peine de rintroduire un principe tlologique et, sa suite, d'ouvrir la
porte l'ide d'une diversit de biens, voire celle de conflits
irrductibles entre biens. Le formalisme du contrat a pour effet de
neutraliser la diversit des biens au bnfice de la rgle de partage. Ce
primat de la procdure n'est pas sans rappeler la mise entre parenthses
des inclinations dans la dtermination kantienne du principe
d'universalisation. Une fois encore, nous sommes rappels la
diffrence entre la problmatique de l'autonomie et celle du contrat. Si
la premire peut s'autoriser d'un fait de raison - quel qu'en soit le sens -,
il n'en est rien du second, dans la mesure mme o il a pour enjeu une
allocation de parts. En tant mme que la socit se prsente comme
systme de distribution, tout partage est problmatique et ouvert des
alternatives galement raisonnables ; puisqu'il y a plusieurs manires
plausibles de rpartir avantages et dsavantages, la socit est de part en
part un phnomne consensuel-conflictuel ; d'un ct, toute allocation de
parts peut tre conteste, spcialement, comme nous allons le voir,
dans le contexte d'une rpartition ingale ; d'un autre ct, pour tre
stable, la distribution requiert un consensus concernant les procdures
en vue d'arbitrer entre revendications concurrentes. Les principes que
nous allons maintenant considrer portent exactement sur cette
situation problmatique engendre par l'exigence d'une rpartition
quitable et stable. Rawls est en effet confront, comme Aristote l'avait
t, avec le
270
271
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA NORME MORALE
paradoxe central introduit par l'quation entre justice et galit. Il est
remarquable, cet gard, que, chez Rawls comme chez Aris-tote et sans
doute tous les moralistes, c'est le scandale de l'ingalit qui met en
mouvement la pense. Rawls pense d'abord aux ingalits qui affectent
les chances initiales l'entre de la vie, ce qu'on peut appeler les
positions de dpart (the starting places). Il pense, bien entendu
aussi aux ingalits lies la diversit des contributions des individus
la marche de la socit, aux diffrences de qualification, de
comptence, d'efficacit dans l'exercice de la responsabilit, etc. :
ingalits dont nulle socit connue n'a pu ou voulu se dpartir. Le
problme est alors, comme chez Aristote, de dfinir l'galit de telle
sorte que soient rduites leur minimum inluctable ces ingalits.
Mais, l encore, de mme que la procdure unique de dlibration dans
la situation originelle fait passer au second plan la diversit des biens
attachs aux choses partages, l'galit des contractants dans la
situation fictive confre l'avance aux ingalits consenties par les
termes du contrat le sceau de la fairness caractristique de la condition
originelle.
Cette gide de la fairness n'empche pas que l'ide de justice doive
donner naissance deux principes de justice, et que le second
comporte lui-mme deux moments. Le premier assure les liberts gales
de la citoyennet (liberts d'expression, d'assemble, de vote,
d'ligibilit aux fonctions publiques). Le second principe s'applique aux
conditions inluctables d'ingalit voques plus haut ; il pose dans sa
premire partie les conditions sous lesquelles certaines ingalits
doivent tre tenues pour prfrables la fois des ingalits plus grandes,
mais aussi une rpartition galitaire ; dans sa seconde partie, il
galise autant qu'il est possible les ingalits lies aux diffrences
d'autorit et de responsabilit : d'o le nom de principe de diffrence
2
.
Aussi
1. Il n'est pas sans importance de noter que, ds le dbut, le mrite (ment or
dsert) est cart, soit comme une varit de chance initiale, soit comme une justi-
fication indue des ingalits affectant les positions de dpart.
2. La premire prsentation des deux principes est la suivante : En premier
lieu : chaquepersonnedoit avoir un droit gal au systmeleplus tendu deliberts
debasegales pour tous qui soit compatibleavec lemmesystmepour les autres.
En second lieu : les ingalits sociales et conomiques doivent treorganises de
faon ceque, la fois, (a) l'on puisseraisonnablement s'attendre cequ'elles
soient l'avantagedechacun, et (b) qu 'elles soient attaches des positions et des
fonctions ouvertes tous (Rawls, Thoriedela justice, op. cit., p. 91). Et plus
loin : Le second principe s'applique, dans la premire approximation, la rpar-
tition des revenus et de la richesse et aux grandes lignes des organisations qui uti-
lisent des diffrences d'autorit et de responsabilit [d'o le nom de principe de
diffrence). Si la rpartition de la richesse et des revenus n'a pas besoin d'tre
importante que le contenu de ces principes est la rgle de priorit qui les
lie l'un l'autre. Rawls parle ici d'ordre sriel ou lexical ', heurtant de
front le marxisme aussi bien que l'utilitarisme. Appliqu aux principes
de justice, l'ordre sriel ou lexical signifie que des atteintes aux
liberts de base gales pour tous qui sont protges par le premier
principe ne peuvent tre justifies ou compenses par des avantages
sociaux ou conomiques plus grands (Rawls, p. 92). En outre, l'ordre
lexical s'impose entre les deux parties du second principe : les moins
favoriss en termes conomiques doivent tre lexicalement prioritaires
l'gard de tous les autres partenaires. C'est ce que J.-P. Dupuy ( Les
paradoxes de Thorie de la justice (John Rawls) ) dsigne comme
l'implication antisacrificielle du principe de Rawls : celui qui pourrait
tre la victime ne devrait pas tre sacrifi mme au bnfice du bien
commun. Le principe de diffrence slectionne ainsi la situation la plus
gale compatible avec la rgle d'unanimit
2
.
Cette dernire assertion conduit la troisime question : pour quelles
raisons les partenaires placs sous le voile d'ignorance pr-
gale, elle doit tre l'avantage de chacun et, en mme temps, les positions d'auto-
rit et de responsabilit doivent tre accessibles tous. On applique le second
principe en gardant les positions ouvertes, puis, tout en respectant cette
contrainte, on organise les ingalits conomiques et sociales de manire que cha-
cun en bnficie (op. cit., p. 92). On peut s'interroger sur le poids des considra-
tions familires une conomie de march dans la formulation du second prin-
cipe. Au niveau conomique, admettons, la somme partager n'est pas fixe
l'avance, mais dpend de la faon dont elle est partage. En outre, des diffrences
de productivit rsultent de la manire dont la distribution est ordonne. Dans un
systme d'galit arithmtique, la productivit pourrait tre si basse que mme le
plus dfavoris le serait plus encore. Il existerait donc un seuil o les transferts
sociaux deviendraient contre-productifs. C'est ce moment que le principe de dif-
frence entre en jeu.
1. Cet ordre lexical ou lexicographique est facile commenter : la premire
lettre d'un mot quelconque est lexicalement premire, en ce sens qu'aucune
compensation au niveau des lettres ultrieures ne pourra effacer l'effet ngatif qui
rsulterait de la substitution de toute autre lettre cette premire place ; cette
impossible substitution donne la premire lettre un poids infini. Nanmoins,
l'ordre suivant n'est pas dnu de poids, puisque les lettres ultrieures font la dif-
frence entre deux mots ayant mme commencement. L'ordre lexical donne tous
les constituants un poids spcifique sans les rendre mutuellement substituables.
2. Il rsulte de cette distinction entre deux principes de justice que Rawls se
trouve pris entre deux groupes d'adversaires. Sur sa droite, il est accus
d'galita-risme (priorit aux plus dfavoriss) ; sur sa gauche, il est accus de
lgitimer l'ingalit. Au premier groupe, il rpond : dans une situation d'ingalit
arbitraire les avantages des plus favoriss seraient menacs par la rsistance des
pauvres ou simplement par le manque de coopration de leur part. Au second
groupe : une solution plus galitaire serait rejete unanimement, parce que tous
seraient perdants.
272
273
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
freraient-ils ces principes dans leur ordre lexical plutt que n'importe
quelle version de l'utilitarisme? L'argument, qui occupe une place
considrable dans Thorie de la justice, est emprunt la thorie de la
dcision dans un contexte d'incertitude ; il est dsign du terme de
maximin, pour la raison que les partenaires sont censs choisir
l'arrangement qui maximise la part minimale. L'argument a toute sa
force dans la situation originelle sous le voile d'ignorance. Nul ne sait
quelle sera sa place dans la socit relle. Il raisonne donc sur de simples
possibilits. Or les contractants sont engags l'gard les uns des
autres en vertu d'un contrat dont les termes ont t publiquement dfinis
et unanimement accepts. Si deux conceptions de la justice sont en
conflit et si l'une d'entre elles rend possible une situation que quelqu'un
pourrait ne pas accepter tandis que l'autre exclurait cette possibilit, alors
la seconde prvaudra. La question est ainsi pose de savoir jusqu' quel
point un pacte anhistorique peut lier une socit historique. Le
seul fait que cette question se pose confirme combien le contrat social
prsum, par lequel une socit est cense se donner ses institutions de
base, diffre de l'autonomie en vertu de laquelle une libert personnelle
est cense se donner sa loi. Ici, point de fait de raison assumer, mais le
recours laborieux la thorie de la dcision dans un contexte
d'incertitude. Ce sont les difficults lies cette situation sans parallle
dans la thorie de la moralit qui posent la question de principe - qu'on
appellerait mieux question de confiance -, celle de savoir si ce n'est pas
au sens thique de la justice que d'une certaine faon la thorie
dontologique de la justice fait appel. En d'autres termes : une conception
purement procdurale de la justice russit-elle rompre ses amarres
avec un sens de la justice qui la prcde et l'accompagne de bout en
bout ?
Ma thse est que cette conception fournit au mieux la formalisation
d'un sens de la justice qui ne cesse d'tre prsuppos
1
. De
1. Dans un article spcialement consacr au Cercle de la dmonstration dans
Thoriedela justice(John Rawls) (Esprit, n 2, 1988, p. 78), j'observe que l'ou-
vrage dans son ensemble n'obit pas l'ordre lexical prescrit par l'nonc des
principes, mais un ordre circulaire. Ainsi les principes de la justice se trouvent
dfinis et mme dvelopps ( 11 et 12) avant l'examen des circonstances du choix
( 20 25), par consquent avant le traitement thmatique du voile d'ignorance
( 24) et, de faon plus significative, avant la dmonstration que ces principes sont
les seuls rationnels ( 26, 30). De fait, il est annonc trs tt ( 3) que les principes
de justice sont ceux que des personnes libres et rationnelles, dsireuses de favo-
riser leurs propres intrts et places dans une position initiale d'galit, accepte-
raient, et qui dfiniraient, selon elles, les termes fondamentaux de leur associa-
tion (J. Rawls, Thoriedela justice, op. cit., p. 37). Ce n'est pas seulement le
critre de la situation originelle qui est ainsi anticip, mais ses caractristiques
LE SOI ET LA NORME MORALE
l'aveu mme de Rawls, l'argument sur lequel s'appuie la conception
procdurale ne permet pas d'difier une thorie indpendante mais
repose sur une prcomprhension de ce que signifie l'injuste et le juste,
qui permet de dfinir et d'interprter les deux principes de justice avant
qu'on puisse prouver - si jamais on y arrive - que ce sont bien les
principes qui seraient choisis dans la situation originelle sous le voile
d'ignorance. A vrai dire, Rawls ne renie jamais son ambition de donner
une preuve indpendante de la vrit de ses principes de justice, mais,
de faon plus complexe, revendique pour sa thorie ce qu'il appelle un
quilibre rflchi entre la thorie et nos convictions bien peses
(consi-dered convictions) '. Ces convictions doivent tre bien peses, car,
si dans certains cas flagrants d'injustice (intolrance religieuse,
discrimination raciale) le jugement moral ordinaire parat sr, nous
avons bien moins d'assurance quand il s'agit de rpartir quitablement la
richesse et l'autorit. Il nous faut, dit Rawls, chercher un moyen de
dissiper nos doutes. Les arguments thoriques jouent alors le mme rle
de mise l'preuve que Kant assigne la rgle d'universalisation des
maximes
2
. Tout l'appareil de l'argumentation peut ainsi tre considr
comme une rationalisation progressive de ces convictions, lorsque
celles-ci sont affectes par des prjugs ou affaiblies par des doutes. Cette
rationalisation consiste dans un processus complexe d'ajustement
mutuel entre la conviction et la thorie
3
.
principales, savoir l'ide que les partenaires ont des intrts mais ne savent pas
lesquels, et en outre qu'ils ne prennent pas intrt aux intrts les uns des autres
(ibid.). De cette faon la thorie est pose comme un tout, indpendamment de
tout ordre sriel enchanant, comme nous l'avons tent dans notre reconstitution,
la situation originelle, la formulation des principes soumis l'examen, enfin l'ar-
gument rationnel en leur faveur.
1. On peut, cependant, justifier d'une autre faon une description particulire
de la position originelle. C'est en voyant si les principes qu'on choisirait s'ac-
cordent avec nos convictions bien peses sur ce qu'est la justice ou s'ils les pro-
longent d'une manire acceptable (Rawls, op. cit., p. 46).
2. Nous pouvons (...) tester la valeur d'une interprtation de la situation ini-
tiale par la capacit des principes qui la caractrisent s'accorder avec nos convic-
tions bien peses et nous fournir un fil conducteur, l o il est ncessaire
(ibid.).
3. Par un processus d'ajustement, en changeant parfois les conditions des cir-
constances du contrat, dans d'autres cas en retirant des jugements et en les adap-
tant aux principes, je prsume que nous finirons par trouver une description de la
situation initiale qui, tout la fois, exprime des conditions pralables raisonnables
et conduise des principes en accord avec nos jugements bien pess, dment la-
gus et remanis. Je qualifie cet tat final d'quilibre rflchi [reflective
equili-brium) (op. cit., p. 47). Le livre entier peut tre considr comme la
recherche de cet quilibre rflchi. Notre critique prendra son point de dpart l
o Thoriede
274
275
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA NORME MORALE
Au terme de ce parcours, deux conclusions se dessinent. D'une part,
on peut montrer en quel sens une tentative de fondation purement
procdurale de la justice applique aux institutions de base de la socit
porte son comble l'ambition d'affranchir le point de vue
dontologique de la morale de la perspective tlo-logique de l'thique.
D'autre part, il apparat que c'est aussi avec cette tentative qu'est le
mieux souligne la limite de cette ambition.
L'affranchissement du point de vue dontologique de toute tutelle
tlologique a son origine dans la position par Kant d'un critre de la
moralit dfini comme exigence d'universalit. En ce sens, l'impratif
kantien, sous sa forme la plus radicale : Agis uniquement d'aprs la
maxime qui fait que tu peux vouloir en mme temps qu'elle devienne
une loi universelle , ne concerne pas seulement la constitution d'une
volont personnelle rationnelle, ni mme la position de la personne
comme fin en soi, mais la rgle de justice sous sa formulation
procdurale.
Dans les trois moments de l'analyse, l'ambition universaliste de la
rgle a eu pour premier corollaire le formalisme du principe ; celui-ci
signifie qu'aucun contenu empirique ne passe avec succs l'preuve du
critre d'universalisation ; le formalisme quivaut ainsi une mise
l'cart dont on peut suivre l'expression dans chacune des trois sphres du
formalisme : mise l'cart de l'inclination dans la sphre de la volont
rationnelle, du traitement d'autrui simplement comme un moyen dans la
sphre dialogique, de l'utilitarisme enfin dans la sphre des institutions.
A cet gard, on ne saurait trop souligner que l'exclusion de l'utilitarisme
dans la situation originelle a mme signification que les deux exclusions
qu'on vient d'voquer et se construit en quelque sorte sur la base de ces
deux exclusions pralables. Enfin, le point de vue dontologique est par
trois fois fond sur un principe qui s'autorise de lui-mme : l'autonomie
dans la premire sphre, la position de la personne comme fin en soi
dans la seconde, le contrat
la justiceparat trouver son propre quilibre. Situons sans attendre le lieu du
dbat : la sorte de circularit que la recherche de l'quilibre rflchi semble pr-
sumer parat menace par les forces centrifuges exerces par l'hypothse contrac-
tualiste laquelle l'approche dontologique a li son sort. Ds l'hypothse du voile
d'ignorance, tout le cours de l'argument obit une tendance artificialiste et
constructiviste que renforce la revendication d'autonomie en faveur de l'argument
thorique. Est-il possible de concilier la complte autonomie de l'argument avec le
vu initial de prserver la relation d'ajustement [fitness] entre thorie et convic-
tion ? Ce peut tre le fardeau incommode de toute thorie contractualiste de dri-
ver d'une procdure agre par tous les principes mmes de justice qui, de faon
paradoxale, motivent dj la recherche d'un argument rationnel indpendant.
social dans la troisime. Ici encore, il faut affirmer avec force que
l'autonomie rgit les trois sphres ; l'ide de la personne comme fin en
soi est cense en tre l'expression dialogale ; et le contrat en est
l'quivalent au plan des institutions.
Quant aux limites inhrentes une telle entreprise d'affran-
chissement du point de vue dontologique, elles se lisent dans les
difficults croissantes que rencontre la sorte d'autofondation que
suppose un tel affranchissement. Ces difficults me paraissent
atteindre un point critique remarquable avec la version contractualiste
de la justice. Il faut revenir au point de dpart : le principe d'autonomie.
Celui-ci ne s'autorise que de lui-mme. D'o le statut difficile, dans la
Critique de la Raison pratique, du fameux fait de la raison . Si on
admet avec certains commentateurs que ce fait de la raison signifie
seulement que la moralit existe, qu'elle jouit de la mme autorit dans
l'ordre pratique que l'exprience dans l'ordre thorique, alors il faut dire
que cette existence ne peut tre qu'atteste, que cette attestation renvoie
la dclaration qui ouvre les Fondements..., savoir que de tout ce
qu'il est possible de concevoir dans le monde, et mme en gnral hors du
monde, il n'est rien qui puisse sans restriction tre tenu pour bon, si ce
n'est seulement une bonne volont . Or cet aveu renracine le point de
vue dontologique dans la perspective tlologique. Mme problme
et mme difficult avec l'affirmation que la personne existe comme
fin en soi, que ce mode d'tre appartient la nature des tres
raisonnables. Nous savons ds toujours qu'on ne se procure pas une
personne comme une chose, que celle-ci a un prix et celle-l une valeur.
Cette prcomprhension pratique est l'exact parallle de l'attestation du
fait de la raison au plan dialogique de la raison pratique. C'est ici que
la comparaison de l'hypothse contractualiste, d'o s'autorise la
thorie de la justice, avec les deux modalits prcdentes d'attestation,
s'avre instructive. Le contrat se trouve occuper au plan des institutions
la place que l'autonomie revendique au plan fondamental de la
moralit. Mais, alors que l'autonomie peut tre dite un fait de la
raison , le contrat social parat ne pouvoir s'autoriser que d'une
fiction, une fiction fondatrice certes, mais nanmoins une fiction.
Pourquoi en est-il ainsi ? Est-ce parce que l'autofondation du corps
politique manque de l'attestation de base dont s'autorise la bonne
volont et la personne fin en soi ? Est-ce parce que les peuples, asservis
pendant des millnaires un principe de domination
transcendant leur vouloir-vivre-ensemble, ne savent pas qu'ils
sont souverains, autrement qu'en
276 277
SOI-MME COMME UN AUTRE
vertu d'un contrat imaginaire, mais en vertu du
vouloir-vivre-ensemble qu'ils ont oubli ? Une fois cet oubli
accompli, il ne reste que la fiction pour galer le contrat au
principe d'autonomie et celui de la personne fin en soi. Si
maintenant, par un mouvement rebours, on reporte ce doute
affectant la fiction du contrat sur le principe d'autonomie, ce
dernier ne risque-t-il pas lui aussi de se dcouvrir comme une
fiction destine combler l'oubli de la fondation de la
dontologie dans le dsir de vivre bien avec et pour les autres dans
des institutions justes ?
NEUVIME TUDE
Le soi et la sagesse pratique :
La conviction
Nous abordons ici le troisime volet de la thse qui gouverne les
tudes que nous consacrons la dimension thique du soi : une
morale de l'obligation, avons-nous annonc, engendre des situations
conflictuelles o !a sagesse pratique n'a d'autre ressource, selon
nous, que de recourir, dans le cadre du jugement moral en situation,
'.'intuition initiale de l'thique, savoir la vision ou la vise de la
vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Cela
dit, deux malentendus sont viter.
D'abord, il ne s'agit pas d'ajouter la perspective thique et au
moment du devoir une troisime instance, celle de la Sittlichkeit
hglienne ; ceci, en dpit des emprunts ponctuels que nous ferons
aux analyses hgliennes concernant prcisment l'effec-tuation
concrte de l'action sense. En effet, le recours une telle instance,
dclare suprieure la moralit, met en jeu un concept d'esprit -
Geist - qui, en dpit de la vigueur avec laquelle il conjugue une
conceptualit suprieure avec un sens aigu de l'ef-fectivit. a paru
superflu dans une investigation centre sur l'ip-sit. Le passage des
maximes gnrales de l'action au jugement moral en situation ne
demande, selon nous, que le rveil des ressources de singularit
inhrentes la vise de la vraie vie. Si le jugement moral dveloppe
la dialectique qu'on va dire, la conviction reste la seule issue
disponible, sans jamais constituer une troisime instance qu'il
faudrait ajouter ce que nous avons appel jusqu'ici vise thique et
norme morale.
Second malentendu dissiper : il ne faudrait pas attacher ce
renvoi de la morale l'thique la signification d'un dsaveu de la
morale de l'obligation. Outre que celle-ci ne cesse pas de nous
apparatre comme la mise l'preuve des illusions sur nous-mmes
et sur le sens de nos inclinations qui obscurcissent la vise
279
SOI-MME COMME UN AUTRE
de la vie bonne, ce sont les conflits mmes suscits par la rigueur du
formalisme qui confrent au jugement moral en situation sa vritable
gravit. Sans la traverse des conflits qui branlent une pratique guide
par les principes de la moralit, nous succomberions aux sductions d'un
situationnisme moral qui nous livrerait sans dfense l'arbitraire. Il n'y
a pas de plus court chemin que celui-l pour atteindre ce tact grce
auquel le jugement moral en situation, et la conviction qui l'habite, sont
dignes du titre de sagesse pratique.
INTERLUDE
Le tragique de l'action
pour Olivier encore
*
Afin de restituer au conflit la place que toutes les analyses conduites
jusqu'ici ont vit de lui accorder, il nous a paru appropri dfaire
entendre une autre voix que celle de la philosophie -mme morale ou
pratique -, une des voix de la non-philosophie : celle de la tragdie
grecque. De cette irruption intempestive, nous attendons le choc
susceptible d'veiller notre mfiance Vencontre non seulement des
illusions du cur, mais aussi des illusions nes de /"hubris de la raison
pratique elle-mme. Nous dirons dans un moment pourquoi, comme
Hegel, nous avons choisi Antigone plutt, disons, <jrw dipe roi pour
guider cette instruction insolite de l'thique par le tragique '.
L'irruption du tragique, en ce point de notre mditation, doit son
caractre intempestif sa dimension non philosophique. Celle-ci ne
saurait tre occulte par ce qui vient d'tre appel l'instruction par le
tragique. Bien au contraire, faute de produire un enseignement direct et
univoque, la sagesse tragique renvoie la sagesse pratique l'preuve du
seul jugement moral en situation.
Que le tragique rsiste une rptition intgrale dans le discours de
l'thique et de la morale, ce trait doit tre rappel avec brivet, mais avec
fermet, de peur que la philosophie ne soit tente de traiter la tragdie la
faon d'une carrire exploiter, d'o elle tirerait les plus beaux blocs
qu'elle retaillerait ensuite sa guise souveraine. Certes, la tragdie a
bien pour thme l'action, comme on entendra plus loin Hegel le
souligner. Elle est ainsi l'uvre des agissants eux-mmes et de leur
individualit. Mais, comme /"Antigone de Sophocle en tmoigne, ces
agissants sont au service de grandeurs spirituelles qui, non seulement les
dpassent, mais, leur tour, fraient la voie des nergies archaques et
mythiques qui sont aussi les sources immmoriales du malheur.
1. Sophocle, Antigone, trad. fr. de P. Mazon, Paris, Les Belles Lettres, 1934.
281
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
Ainsi, l'obligation qui contraint Antigone assurer son frre une
spulture conforme aux rites, bien qu'il soit devenu l'ennemi de la cit, fait
plus qu'exprimer les droits de la famille face ceux de la cit. Le lien de la
sur au frre, qui ignore la distinction politique entre ami et ennemi, est
insparable d'un service des divinits d'en bas, qui transforme le lien
familial en un pacte tnbreux avec la mort. Quant la cit, la dfense
de laquelle Cron subordonne les liens familiaux qui sont aussi les siens
en privant de spulture l'ami devenu ennemi, elle reoit de sa fondation
mythique, et de sa structure religieuse durable, une signification plus que
politique. Pour ne s'arrter qu' un symptme du tragique, manifeste dans
la surface du texte et de l'action elle-mme, la faon totalement dis-
cordante dont les deux protagonistes tirent la ligne entre ami et ennemi,
entre philos et ekhthros, est tellement surcharge de sens que cette
dtermination pratique ne se laisse pas rduire une simple modalit du
choix et de la dlibration, telle que dcrite par Aristote et par Kant. Et la
passion qui pousse chacun des deux protagonistes aux extrmes plonge
dans un fond tnbreux de motivations que nulle analyse de l'intention
morale n'puise : une thologie, inavouable spculativement, de
l'aveuglement divin se mle de faon inextricable la revendication non
ambigu, que chacun lve, d'tre l'auteur seul responsable de ses actes
1
. Il
en rsulte que la finalit du spectacle tragique dborde infiniment toute
intention directement didactique. Comme on sait, la catharsis, sans man-
quer d'tre une clarification, un claircissement, que l'on peut lgitimement
rapporter la comprhension de l'intrigue, ne laisse pas d'tre une
purification proportionne la profondeur des arrire-fonds de l'action
qu'on vient de sonder brivement ; ce titre, elle ne peut tre dpouille
de son cadre cultuel sous l'gide de Dionysos, invoqu dans une des
dernires odes lyriques du chur. C'est pourquoi, si le tragique peut
s'adresser indirectement notre pouvoir de dlibrer, c'est dans la mesure
o la catharsis 5'est adresse directement aux passions qu'elle ne se borne
pas susciter, mais qu'elle est destine purifier. Cette mtaphorisation
du phobos et de /'los - de la terreur et de la piti - est la condition de
toute instruction proprement thique.
1. Erreurs [hamartmata] de mon insense sagesse (v. 1261), s'crie trop
tard Cron. Et pourtant, plus loin : Hlas ! ces malheurs, j'en suis bien l'auteur et
ils ne pourront jamais tre rejets sur un autre (v. 1317-1318). Sur cette tholo-
gie qui ne peut tre que montre, cf. mon analyse ancienne du tragique dans La
Symboliquedu Mal. Philosophiedela volont, t. II, Finitudeet Culpabilit. Paris,
Montaigne, 1960, 1988.
Tels sont les traits qui marquent le caractre non philosophique de la
tragdie : puissances mythiques adverses doublant les conflits identifiables
de rles ; mlange inanalysable de contraintes destintes et de choix
dlibrs ; effet purgatif exerc par le spectacle lui-mme au cur des
passions que celui-ci engendre
1
.
Et pourtant la tragdie enseigne. Si, en effet, j'ai choisi Antigone, c'est
parce que cette tragdie dit quelque chose d'unique concernant le
caractre inluctable du conflit dans la vie morale, et en outre esquisse une
sagesse - la sagesse tragique dont parlait Karl Jaspers
2
-, capable de
nous orienter dans les conflits d'une tout autre nature que nous
aborderons plus loin dans le sillage du formalisme en morale.
Si la tragdie d'Antigone peut encore nous enseigner, c'est parce que le
contenu mme du conflit - en dpit du caractre perdu et non rptable
du fond mythique dont il merge et de l'environnement festif qui entoure la
clbration du spectacle - a conserv une permanence ineffaable
3
. La
tragdie rf'Antigone touche ce que, la suite de Steiner, on peut
appeler le fond agonistique de l'preuve humaine, o s'affrontent
interminablement l'homme et la femme, la vieillesse et la jeunesse, la
socit et l'individu, les vivants et les morts, les hommes et le divin. La
reconnaissance de soi est au prix d'un dur apprentissage acquis au cours
d'un long voyage travers ces conflits persistants, dont l'universalit est
insparable de leur localisation chaque fois indpassable.
L'instruction de l'thique par le tragique se borne-t-elle l'aveu, en
forme de constat, du caractre intraitable, non ngociable, de ces conflits
? Une voie moyenne est tracer entre le conseil direct, qui s'avrera bien
dcevant, et la rsignation l'insoluble. La tra-
1. Cette tranget du tragique, non rptable en rationalit, est fortement rap-
pele par J.-P. Vemant dans Tensions et ambiguts dans la tragdie grecque ,
in J.-P. Vemant et P. Vidal-Naquet, Mytheet Tragdieen Grceancienne, Paris,
La Dcouverte, 1986,1.1, p. 21-40, et George Steiner au dbut et tout au long de
son grand livre Antigones, Oxford, Clarendon Press, 1984 (trad. fr., LesAntigones,
Paris, Gallimard, 1986).
2. K. Jaspers, Von der Wahrheit, Munich, Piper Verlag, 1947, p. 915-960. P.
Aubenque, dans La Prudencechez Aristote(op. cit., p. 155-177), est attentif la
source tragique de la phronsis chez Aristote, que rappelle le phronein d'An-
tigone.
3. Ce contraste suscite l'tonnement insistant de G. Steiner dont une grande
partie de la mditation porte sur les rappropriations $Antigone, en particulier au
xix* sicle, avant que Freud ne donne la prfrence dipe roi. Simone Fraisse
avait fait un travail comparable dans le domaine franais : LeMythed'Antigone,
Paris, Colin, 1973.
282 283
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
gdie est comparable cet gard ces expriences limites, gnra-
trices d'apories, auxquelles n'a chapp aucune de nos tudes pr-
cdentes. Essayons donc.
Ce gw'Antigone enseigne sur le ressort tragique de l'action a t
bien aperu par Hegel dans la Phnomnologie de l'esprit et dans
les Leons sur l'esthtique, savoir l'troitesse de l'angle d'en-
gagement de chacun des personnages. Peut-tre faut-il, avec
Mar-tha Nussbaum ', aller plus loin, dans un sens qui, on le verra,
n'est pas aussi anti-hglien qu'elle le croit, et discerner chez les
deux principaux protagonistes une stratgie d'vitement l'gard
des conflits internes leurs causes respectives. C'est sur ce second
point, plus encore que sur le premier, que pourra se greffer la
sagesse tragique capable d'orienter une sagesse pratique.
La conception que Cron se fait de ses devoirs l'gard de la
cit, non seulement n'puise pas la richesse de sens de la polis
grecque, mais ne prend pas en compte la varit et peut-tre l'ht-
rognit des tches de la cit. Pour Cron, on y a dj fait allusion,
l'opposition ami-ennemi est enferme dans une catgorie politique
troite et ne souffre ni nuance, ni exception. Cette troi-tesse de
vues se reflte dans son apprciation de toutes les vertus. N'est
bien que ce qui sert la cit, mal que ce qui lui nuit ; n'est
juste que le bon citoyen et la justice ne rgit que l'art de
gouverner et d'tre gouvern. La pit , vertu considrable, est
rabattue sur le lien civique, et les dieux somms de n 'honorer que
les citoyens morts pour la patrie. C'est cette vision appauvrie et
simplifie de sa propre cit qui mne Cron sa perte. Son retour-
nement tardif fait de lui le hros qui apprend trop tard
2
.
Il faut accorder Hegel que la vision du monde d'Antigone n'est
pas moins rtrcie et soustraite aux contradictions internes que
celle de Cron. Sa manire de trancher entre philos et ekhthros n
'est pas moins rigide que celle de Cron ; seul compte le lien familial,
d'ailleurs magnifiquement concentr dans la sororit. Encore ce
lien
3
est-il priv de cet ros qui se rfugie en Hmon et
1. M.C. Nussbaum, TheFragilityofGoodness. op. cit.
2. Le coryphe : Hlas ! c'est bien tard, il me semble que tu vois ce qui est
juste [ln dikn] . On reviendra plus loin sur le sens d'une leon qui ne peut gu-
rir, ni mme soigner.
3. On notera cet gard l'trange lien entre roset les lois [thesmn] suprmes
du monde , qui introduit le conflit au coeur mme du divin ( car irrsistible se
joue de nous la desse Aphrodite - v. 795-799).
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
que le chur clbre dans une de ses plus belles odes lyriques (v.
781-801). A la limite, seul le parent mort est philos. Antigone se
tient en ce point limite. Les lois de la cit sont ds lors dcouronnes
de leur aurole sacre : Car ce n 'est pas Zeus qui a promulgu
pour moi cette dfense, et Dik, celle qui habite avec les dieux
souterrains, n 'a pas tabli de telles lois parmi les hommes (v. 450
sq.). Or, c'est une autre Dik, non moins tnbreuse, que clbre le
coryphe : Tu t'es porte un excs d'audace et tu t'es heurte avec
violence, ma fille, contre le trne lev de Dik : tu expies quelque
faute paternelle (V. 854-856). Ce sont bien deux visions partielles
et univoques de la justice qui opposent les protagonistes. La
stratgie de simplification, comme dit Nussbaum, que scelle
l'unique allgeance aux morts - tombeau, chambre nuptiale...
(v. 892) - ne rend pas Antigone moins inhumaine que Cron.
Finalement, la compagnie des morts la laissera sans concitoyens,
prive du secours des dieux de la cit, sans poux et sans
descendance, et mme sans amis pour la pleurer (v. 880-882). La
figure qui s'loigne de nous ne souffre pas seulement : elle est la
souffrance (v. 892-928).
Pourquoi notre prfrence va-t-elle nanmoins Antigone?
Est-ce la vulnrabilit en elle de la femme qui nous meut ? Est-ce
que parce que, figure extrme de la non-violence face au pouvoir,
elle seule n'a fait violence personne ? Est-ce parce que la sororit
rvle une qualit de philia que n'altre pas /'ros? Est-ce parce
que le rituel de la spulture atteste un lien entre les vivants et les
morts, o se rvle la limite du politique, plus prcisment celle de ce
rapport de domination qui, lui-mme, n 'puise pas le lien politique
? Cette dernire suggestion trouve un appui dans les vers qui ont le
plus marqu la tradition, et que Hegel cite par deux fois dans la
Phnomnologie : Je ne croyais pas non plus que ton dit et assez
de force pour donner un tre mortel le pouvoir d'enfreindre les
dcrets divins, qui n 'ont jamais t crits et qui sont immuables : ce
n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier qu'ils existent ; ils sont ternels et
personne ne sait quel pass ils remontent ('Antigone, v. 452-455).
En un sens, Antigone elle-mme a rtrci leur exigence funbre ces
lois non crites. Mais, en les invoquant pour fonder son intime
conviction, elle a pos la limite qui dnonce le caractre humain,
trop humain de toute institution.
L'instruction de l'thique par le tragique procde de la
reconnaissance de cette limite. Mais la posie ne procde pas
conceptuellement. C'est principalement travers la succession des
Odes lyriques du chur (et aussi des paroles prtes Hmon et
284
285
SOI-MME COMME UN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
Tirsias) que s'esquisse, non point un enseignement au sens le plus
didactique du terme, mais une conversion du regard, que l'thique
aura pour tche de prolonger dans son discours propre. La clbra-
tion du soleil, dans la premire Ode, est celle d'un il - il du jour
ruisselant - moins partial que celui des mortels*. Vient un peu plus
loin, prononce sur le mode gnomique, la fameuse dclaration qui
ouvre l'Ode sur l'homme : Nombreux sont les deina de la nature,
mais de tous le plus deinon, c'est l'homme (v. 332-333). Faut-il,
avec Mazon, traduire deinon par merveille ? En fait, le deinon,
voqu maintes fois dans la pice, a le sens que l'expression
formidable a parfois en franais : oscillant entre l'admirable et le
monstrueux
2
. Plus deinon que tout homme est, en ce sens ambigu du
mot, le hros tragique. Plus tard encore, quand le destin des
protagonistes sera scell, le chur, laiss sans ressource d'avis, ne
peut que gmir : Lorsque les dieux branlent une maison, le
malheur s'acharne sans rpit sur la multitude de ses descendants (v.
584-585). Et encore : Dans la vie des mortels, aucune prosprit
excessive n'arrive sans que le malheur s'y mle (v. 612-613). Ici le
tragique se rvle dans la dimension non philosophique qu'on a dite.
Face au dsastre, les vieillards du chur ne feront plus qu'osciller
d'un parti l'autre, inclinant plutt du ct d'Hmon et de Tirsias.
S'adressant Cron : Prince, il convient, s'il donne un avis
opportun [il s'agit d'Hmon] de l'couter, et toi fais-en autant pour
lui : des deux cts [dipl] vous avez bien parl (v. 724-726). Seule
l'loge d'ros donne la lamentation une hauteur de vues
comparable celle atteinte dans l'hymne au soleil. Mais cette
hauteur ne sauraient se maintenir ceux qui se savent eux-mmes
mortels et issus de mortels (v. 835). C'est seulement la mmoire
des dfaites immmoriales que le chur saura chanter :
1. Nussbaum souligne une expression que le chur applique Polynice et que
Mazon traduit par querelleuses discordes ; or le grec, serr de plus prs, suggre
i'ide d' arguments deux cts (amphilogon, v. p. 111). C'est pour un il non
humain que la querelle de Polynice recle pareille amphibologie (Nussbaum, The
Fragility ofGoodness. op. cit.. p. 71).
2. Nussbaum, qui je dois cette suggestion, observe combien est finalement
ambigu l'loge de l'homme ; dou dans son industrie d'une ingniosit inespre,
il va tantt vers le mal, tantt vers le bien, confondant les lois de la terre et le droit
[dikari] qu'il a jur par les dieux d'observer, quand il est la tte d'une cit (v.
365-369). On notera quelques autres occurrences du terme deinon : mais la
puissance du destin est deina (v. 951). En tmoigne l'preuve de Lycurgue, sou-
mis au joug de la ncessit: Ainsi tomba la fureur terrible [deinon] de sa folie
(v. 959). Cron vaincu avoue : Cder est deinon, mais rsister et se heurter contre
le malheur n'est pas moins deinon (v. 1096-1097).
Dana, Lycurgue, la jeune fille sans nom, tous paralyss, immobi-
liss, ptrifis, jets hors praxis (v. 944-987). Le seul conseil qui soit
encore disponible, sera, en cho l'objurgation de Tirsias : Cde
au mort, ne frappe pas un cadavre (v. 1029). Le Coryphe aura tout
de mme un mot, qui sera pour nous une cl ; Cron qui s'est cri
: Cder est dur, mais rsister et se heurter contre le malheur ne Test
pas moins , il rpliquera : Il faut de la prudence [euboulias] - fils
de Mnce, Cron (v. 1098). Et aprs une invocation Bacchus.
dans le ton de l'Ode au soleil et de l'Ode ros, qui prserve la
hauteur du sacr dans l'indigence du conseil, le chur retombe la
vaine dploration : C'est bien tard, il me semble, que tu vois ce qui
est juste [tn dikn] (v. 1270). Le dernier mot du chur est d'une
navrante modestie : La sagesse [to phronein] est de beaucoup la
premire source de bonheur : il ne faut pas tre impie envers les
dieux. Les paroles hautaines, par les grands coups dont les paient les
gens orgueilleux, leur apprennent [didaxan], mais seulement quand
ils sont vieux, tre sages [to phronein] (v. 1347-1353).
Quelle instruction, alors
?
Ce dernier appel to phronein fournit
cet gard un fil qui mrite qu'on le remonte '. Un appel bien
dlibrer (euboulia) traverse obstinment la pice: comme si
penser juste tait la rplique cherche souffrir le terrible
(pathein to deinon) (v. 96)
2
.
De quelle manire la philosophie morale rpondra-t-elle cet
appel penser juste , bien dlibrer ? Si l'on attendait de
l'instruction tragique l'quivalent d'un enseignement moral, on se
tromperait du tout au tout. La fiction forge par le pote est celle de
conflits que Steiner a raison de tenir pour intraitables, non
1. Martha C. Nussbaum, s'appuyant sur le Lexicon Sophocleum de Ellendt,
dnombre dans la seule pice 'Antigone cinquante occurrences (sur les cent
quatre-vingts des sept pices de Sophocle) de termes relatifs la dlibration
partir des racines bout, phren/phron. Il faudrait ajouter manthanein, apprendre,
rapproch de phronein en 1031-1032.
2. Cron ne veut pas tre enseign phronein par un jeune homme comme
Hmon (v. 727), qui ose lui dire qu'il a perdu le sens du euphronein (v. 747). C'est
prcisment du penser juste (euphronein) que Cron se croit aussi le matre. A
Tirsias, qui vient de demander combien la sagesse [euboulia] l'emporte sur les
autres biens , Cron rpond : Autant, je pense, que l'imprudence [m phronein] est
le plus grand des maux (v. 1051). Trop tard, Cron avoue sa folie (dus-bouliais)
(v. 1269). Reste au chur prononcer la sentence : la sagesse [to phronein] est de
beaucoup la premire source de bonheur , mais c'est au vieillard bris que les
coups du sort ont appris tre sage [to phronein] (v. 1353). Le cycle du
phronein est clos.
286 287
SOI-MME COMME UN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
ngociables. La tragdie, prise comme telle, engendre une aporie
thico-pratique qui s'ajoute toutes celles qui ont jalonn notre qute de
l'ipsit ; elle redouble en particulier les apories de l'identit narrative
accumules dans une tude prcdente. A cet gard, une des fonctions de
la tragdie l'gard de l'thique est de crer un cart entre sagesse
tragique et sagesse pratique. En refusant d'apporter une solution aux
conflits que la fiction a rendus insolubles, la tragdie, aprs avoir
dsorient le regard, condamne l'homme de la praxis rorienter l'action,
ses propres risques et frais, dans le sens d'une sagesse pratique en
situation qui rponde le mieux la sagesse tragique. Cette rponse,
diffre par la contemplation festive du spectacle, fait de la conviction
l'au-del de la catharsis.
Reste dire comment la catharsis tragique, en dpit de l'chec du
conseil direct, ouvre la voie au moment de la conviction.
Cette transition de la catharsis la conviction consiste pour l'essentiel
dans une mditation sur la place invitable du conflit dans la vie morale.
C'est sur ce chemin que notre mditation croise celle de Hegel. Une
premire chose est ici dire : si l'on doit quelque part renoncer Hegel
, ce n'est pas l'occasion de son traitement de la tragdie ; car la
synthse qu 'on reproche volontiers Hegel d'imposer toutes les
divisions que sa philosophie a le gnie de dcouvrir ou d'inventer, ce n'est
prcisment pas dans la tragdie qu'il la trouve. Et, si quelque conciliation
fragile s'annonce, elle ne reoit sens que des conciliations vritables que la
Phnomnologie de l'esprit ne rencontre qu' un stade considrablement
plus avanc de la dialectique. A cet gard, nous ne saurions manquer de
remarquer que la tragdie n 'est voque qu 'au dbut du vaste parcours qui
occupe tout le chapitre vi, intitul Geist (signalant ainsi que ce chapitre est
homologue la totalit de l'uvre) : la vritable rconciliation n'advient
qu' la toute fin de ce parcours, l'issue du conflit entre la conscience
jugeante et l'homme agissant ; cette rconciliation repose sur un
renoncement effectif de chaque parti sa partialit et prend valeur d'un
pardon o chacun est vritablement reconnu par l'autre. Or c'est
prcisment une telle conciliation par renoncement, un tel pardon par
reconnaissance, que la tragdie - du moins celle d'Antigone - est
incapable de produire. Pour que les puissances thiques que les
protagonistes servent subsistent ensemble, la disparition de leur existence
particulire est le prix entier payer. Ainsi les hros-victimes du drame
1
ne bnfi-
I. Dans la Phnomnologie de l'esprit, le tragique est ce moment de l'esprit o
l'unit harmonieuse de la belle cit est rompue par une action (Handlung), l'action
cient pas de la certitude de soi qui est l'horizon du procs ducatif
dans lequel la conscience de soi est engage.
Le traitement de la tragdie dans les Leons sur l'esthtique confirme
et renforce ce diagnostic. Ici, la tragdie n'est pas place sur la trajectoire
qui, dans la Phnomnologie, conduit l' esprit certain de lui-mme ;
elle est simplement oppose la comdie au plan des genres potiques.
Or, en tant que l'un des genres de la posie dramatique, la tragdie se
distingue de la comdie en ce que, dans la premire, les individualits
qui incarnent les puissances spirituelles (die geistige Mchte), et sont
entranes dans une collision invitable en vertu de l'unilatralit qui les
dfinit, doivent disparatre dans la mort ; dans la comdie, l'homme reste,
par le rire, le tmoin lucide de la non-essentialit des buts qui se dtruisent
rciproquement '. Si l'on doit prendre un autre chemin que celui de Hegel,
le point de sparation n est pas l o on le situe trop souvent, comme si
Hegel avait impos une solution thorique au conflit, et comme si le conjlit
devait tre salu comme facteur subversif l'gard de la tyrannie d'une
raison totalitaire . Pour
d'individualits particulires, d'o procde le conflit entre les caractres. Cette
F.ntzweiung - ce partage en deux - a pour effet de scinder les puissances thiques
qui les surplombent : le divin contre l'humain, la cit contre la famille, l'homme
contre ia femme. A cet gard, les plus belles pages sont celles qui assignent la
sur - la femme qui n'est ni fille, ni mre, ni pouse - la garde du lien familial qui
runit les morts et les vi\ants. Par la spulture accorde au frre. Antigone lve la
mort au-dessus de la contingence naturelle. Mais, s'il y a un sens tout cela, il n'est
pas pour eux , mais pour nous . Pour eux , la disparition dans la mort ;
pour nous , la leon indirecte de ce dsastre. La calme rconciliation chante par le
chur ne saurait tenir heu de pardon. L'unilatralit de chacun des caractres, y
compris celui d'Antigone, exclut une telle reconnaissance mutuelle. C'est pourquoi
Hegel passe 6'Antigone dipe roi. o il voit la tragdie de l'ignorance et de la
reconnaissance de soi, concentre dans la mme individualit tragique. La
conscience de soi fait ici un pas de plus, mais sans accder encore la sorte de
rconciliation que la fin du chapitre vi propose. Il faudra auparavant traverser le
conflit li la culture (Bildung), qui est celui de l' esprit alin soi-mme (der
sich enlfremdete Geist). pour apercevoir cette issue. C'est pourquoi Hegel ne pouvait
attendre de la tragdie qu'elle tire de soi la solution des conflits qu'elle engendre.
1. Alors que la tragdie met en relief le substantiel ternel et le montre dans
son rle d'agent de conciliation dont il s'acquitte en dbarrassant les individualits
qui se combattent de leur fausse unilatralit et en les rapprochant par ce qu'il y a de
positif dans le vouloir de chacun, c'est, au contraire, la subjectivit qui, dans son
assurance infinie, constitue l'lment dominant de la comdie {Esthtique, trad. fr.
de S. Janklvitch, Paris, Flammarion, coll. Champs, t. IV, 1979, p. 267).
2. M. Gellrich, Tragedy and Theory, the Problem of Conflict since Aristotle,
Princeton University Press, 1988.
288
289
SOI-MME COMME UN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
nous qui sommes partis d'une thique de style aristotlicien et avons
assum ensuite les rigueurs d'une morale de style kantien, la
question est d'identifier les conflits que la moralit suscite au niveau
mme de ces puissances spirituelles que Hegel semble tenir pour non
contamines par le conflit, seule l'unilatralit des caractres tant
source de tragique. Le tragique, au stade que notre investigation a
atteint, n 'est pas chercher seulement l'aurore de la vie thique,
mais au contraire au stade avanc de la moralit, dans les conflits
qui se dressent sur le chemin conduisant de la rgle au jugement
moral en situation. Cette voie est non hglienne en ce sens qu'elle
prend le risque de se priver des ressources d'une philosophie du
Geist. Je me suis expliqu plus haut sur les raisons de cette
rticence. Elles tiennent la mfiance prouve l'gard de la
Sittlichkeit, qu'une philosophie du Geist exige dplacer au-dessus
de la moralit, et l'gard de la philosophie politique, et plus
spcifiquement de la thorie de l'tat, quoi tous ces
dveloppements aboutissent. Mon pari est que la dialectique de
l'thique et de la moralit, au sens dfini dans les tudes pr-
cdentes, se noue et se dnoue dans le jugement moral en situation,
sans l'adjonction, au rang de troisime instance, de la Sittlichkeit,
fleuron d'une philosophie du Geist dans la dimension pratique.
Deux questions restent ainsi poses, au point d'inflexion de la
catharsis tragique la conviction morale : qu'est-ce qui rend invi-
table le conflit thique ? Et quelle solution l'action est-elle suscep-
tible de lui apporter ? A la premire question, la rponse propose
sera celle-ci: non seulement l'unilatralit des caractres, mais
celle mme des principes moraux confronts la complexit de la
vie est source de conflits. A la seconde question pose, la rponse
esquisse sera : dans les conflits que suscite la moralit, seul un
recours au fond thique sur lequel la morale se dtache peut susciter
la sagesse du jugement en situation. Du phronein tragique la
phronsis pratique : telle serait la maxime susceptible de soustraire
la conviction morale l'alternative ruineuse de l'univocit ou de
l'arbitraire.
*
1. Institution et conflit
C'est le tragique de l'action, jamais illustr par VAntigone de
Sophocle, qui reconduit le formalisme moral au plus vif de
l'thique. Le conflit est chaque fois l'aiguillon de ce recours en
appel, dans les trois rgions dj deux fois sillonnes : le soi uni-
versel, la pluralit des personnes et l'environnement institutionnel.
Plusieurs raisons m'ont persuad de refaire ce parcours dans
l'ordre inverse. Premire raison : en portant le fer du conflit d'abord
au plan de l'institution, nous sommes sans tarder confronts au
plaidoyer hglien en faveur de la Sittlichkeit, cette morale effective
et concrte qui est cense prendre la relve de la Moralitt, de la
morale abstraite, et qui trouve prcisment son centre de gravit
dans la^sphre des institutions et dans celle, les couronnant toutes,
de l'tat. Si l'on russissait montrer que le tragique de l'action
dploie prcisment dans cette sphre quelques-unes de ses figures
exemplaires, on lverait par l mme l'hypothse hglienne quant
la sagesse pratique instruite par le conflit. La Sittlichkeit ne
dsignerait plus alors une troisime instance suprieure l'thique
et la morale, mais dsignerait un des lieux o s'exerce la sagesse
pratique, savoir la hirarchie des mdiations institutionnelles que
cette sagesse pratique doit traverser pour que la justice mrite
vritablement le titre d'quit. Une seconde raison a guid le choix
de l'ordre ici suivi. Notre problme n'tant pas d'ajouter une
philosophie politique la philosophie morale, mais de dterminer
les traits nouveaux de 'ip-sit correspondant la pratique
politique, les conflits relevant de cette pratique ont servi de toile de
fond pour l
es
conflits engendrs par le formalisme lui-mme au plan
interpersonnel entre la
291
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
norme et la sollicitude la plus singularisante. C'est seulement
lorsque nous aurons travers ces deux zones conflictuelles que nous
pourrons nous confronter avec l'ide d'autonomie qui reste en
dernire analyse la pice matresse du dispositif de la morale
kantienne : c'est l que les conflits les plus dissimuls dsignent le
point d'inflexion de la morale une sagesse pratique qui n'aurait pas
oubli son passage par le devoir.
Reprenons la rgle de justice au point o nous l'avons quitte au
terme de la prcdente tude. La possibilit du conflit nous avait
dj paru inscrite dans la structure quivoque de l'ide de
distribution juste. Vise-t-elle dlimiter des intrts individuels
mutuellement dsintresss ou renforcer le lien de coopration ?
Les expressions de part et de partage nous ont paru trahir cette
quivoque au niveau mme du langage. Loin de rsoudre cette
quivocit, la formalisation opre par Rawls la confirme et risque
mme de la renforcer. La faille entre les deux versions de l'ide de
distribution juste nous a paru seulement masque par l'ide d'un
quilibre rflchi entre la thorie qui donne son titre au livre et nos
convictions bien peses '. Selon la thorie, en effet, les individus
placs dans la situation originelle sont des individus rationnels
indpendants les uns des autres et soucieux de promouvoir leurs
intrts respectifs sans tenir compte de ceux des autres. Aussi le
principe de maximin, considr seul, pourrait-il se rduire une
forme raffine de calcul utilitaire. Ce serait le cas s'il n'tait
prcisment quilibr par des convictions bien peses o le point de
vue du plus dfavoris est pris pour terme de rfrence. Or cette
prise en considration repose en dernire analyse sur la rgle de
rciprocit, proche de la Rgle d'Or, dont la finalit est de redresser
la dissymtrie initiale lie au pouvoir qu'un agent exerce sur le
patient de son action et que la violence transforme en exploitation.
Cette fine dchirure interne la rgle de justice n'indique encore
que le lieu possible du conflit. Une situation rellement
conflictuelle apparat lorsque, creusant sous la pure rgle de pro-
cdure, on met nu la diversit entre les biens distribus que tend
oblitrer la formulation des deux principes de justice. On l'a dit, la
diversit des choses partager disparat dans la procdure de
distribution. On perd de vue la diffrence qualitative entre choses
distribuer, dans une numration qui met bout bout les revenus et
les patrimoines, les avantages sociaux et les charges corres-
pondantes, les positions de responsabilit et d'autorit, les hon-
1. Cf. ci-dessus, huitime tude, p. 275.
neurs et les blmes, etc. Bref la diversit des contributions
individuelles ou collectives qui donnent lieu un problme de
distribution. Aristote avait rencontr ce problme dans sa dfinition
de la justice proportionnelle, o l'galit ne se fait pas entre des parts
mais entre le rapport de la part de l'un sa contribution et le rapport
de l'autre sa contribution diffrente. Or, l'estimation de la valeur
respective de ces contributions est tenue par Aristote pour variable
selon les rgimes politiques
1
. Si l'on dplace l'accent de la procdure
de distribution sur la diffrence entre les choses distribuer, deux
sortes de problmes sont soulevs, qui, dans la littrature
postrieure au grand livre de Rawls, ont t le plus souvent traits en
mme temps, mais qu'il importe de bien distinguer. Le premier
marque le retour en force de concepts tlologiques qui relient
nouveau le juste au bon, par l'ide de biens sociaux premiers. Rawls
n'y voit pas malice et parat l'aise avec cette ide qu'il relie sans
scrupules apparents aux attentes de personnes reprsentatives
2
.
Mais, si l'on demande ce qui qualifie comme bons ces biens sociaux,
on ouvre un espace conflictuel, ds lors que ces biens apparaissent
relatifs des significations, des estimations htrognes. Un
second problme est pos, non plus seulement par la diversit des
biens partager, mais par le caractre historiquement et
culturellement dtermin de l'estimation de ces biens. Le conflit est
ici entre la prtention universaliste (je prends prtention au sens
positif de revendication, la faon du daim de langue anglaise) et
les limitations contextualistes de la rgle de justice. Je renvoie ce
second problme la dernire partie de cette tude, dans la mesure
o le conflit entre universalisme et contextualisme affecte au mme
degr toutes les sphres de la moralit. C'est donc la seule question
de la relle diversit des biens partager que nous nous attacherons
dans la discussion qui suit.
Chez un auteur comme Michael Walzer
3
, la prise en compte de
cette relle diversit des biens, appuye sur celle des estimations ou
valuations qui dterminent les choses partager comme des biens,
aboutit un vritable dmembrement de l'ide unitaire de justice au
bnfice de l'ide de sphres de justice . Constituent une sphre
distincte les rgles qui rgissent la citoyennet (mem-
1. Cf. la note de Tricot concernant la notion aristotlicienne d'axia (in Aristote,
thique Nicomaque. op. cit.. 1131 a 24, trad. p. 228, n. 1).
2. Rawls, Thoriedela justice, op. cit., p. 95.
3. M. Walzer, Sphres of J ustice, a Dfenseof Pturalismand Equaltty, New
York, Basic Books, 1983.
292 293
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
bership) et traitent par exemple des conditions de son acquisition ou
de sa perte, du droit des rsidents trangers, des migrs, des exils
politiques, etc. Maints dbats en cours, jusque dans les dmocraties
avances, attestent que des problmes ne cessent de surgir qui
renvoient finalement des prises de position de nature thique sur la
nature politique desquelles on reviendra plus loin. Autre est la
sphre de la scurit et de l'assistance publique (wel-fare), qui
rpond des besoins (needs) estims tels, dans nos socits, qu'ils
appellent de droit la protection et le secours de la puissance
publique. Autre est encore la sphre de l'argent et des marchandises,
dlimite par la question de savoir ce qui, par sa nature de bien, peut
tre achet ou vendu. Il ne suffit donc pas de distinguer
massivement les personnes qui ont une valeur et les choses qui ont
un prix ; la catgorie de marchandises a ses exigences propres et ses
limites. Autre est encore la sphre des emplois (office) dont la
distribution repose non sur l'hrdit ou la fortune mais sur des
qualifications dment values par des procdures publiques (on
retrouve ici la question de l'galit des chances et de l'ouverture
tous des places ou positions, selon le second principe de justice de
Rawls).
Notre problme n'est pas ici de proposer une numration
exhaustive de ces sphres de justice, ni mme de prciser le destin
de l'ide d'galit dans chacune d'elles. Il est celui de l'arbitrage
requis par la concurrence de ces sphres de justice et par la menace
d'empitement de l'une sur l'autre qui donne son vritable sens la
notion de conflit social '.
C'est ici que l'on peut tre tent par une issue hglienne du
conflit, dans la mesure mme o les questions de dlimitation et de
priorit entre sphres de justice relvent d'un arbitrage ala-
1. La thorie des biens de Walzer se rsume dans les quelques propositions qui
suivent : tous les biens auxquels la justice distributive a affaire sont des biens
sociaux ; les hommes et les femmes doivent leurs identits concrtes la
manire dont ils reoivent et crent, donc possdent et emploient les biens
sociaux ; on ne peut concevoir un unique ensemble de biens premiers ou de
base qui engloberait tous les mondes moraux et matriels ; mais c'est la signifi-
cation des biens qui dtermine leurs mouvements ; les significations sociales
sont historiques par nature; ds lors les distributions - justes et injustes
-changent avec le temps ; quand les significations sont distinctes, les distribu-
tions doivent tre autonomes (op. cit., p. 6-10 [trad. de l'auteur]). Il en rsulte
qu'il n'est d'talon valable que pour chaque bien social et chaque sphre de distri-
bution dans chaque socit particulire ; et, comme ces talons sont souvent vio-
ls, les biens usurps, les sphres envahies par des hommes et des femmes dots de
pouvoir, ces phnomnes inluctables d'usurpation et de monopole font de la dis-
tribution un lieu de conflit par excellence.
toire qui est l'quivalent au plan institutionnel de la sagesse pratique
qu'Aristote appelait phronsis. La solution n'est-elle pas de reporter
dans la sphre politique, et singulirement tatique, le traitement de
conflits poss jusqu'ici en termes de justice ? On demandera alors de
placer l'arbitrage du conflit entre sphres de justice sous la catgorie
hglienne de Sittlichkeit plutt que sous la catgorie
aristotlicienne de phronsis.
Je l'ai dit, mon problme n'est pas de proposer ici une philosophie
politique digne de celle d'ric Weil, de Cornlius Castoria-dis ou de
Claude Lefort. Il est seulement de savoir si la pratique politique fait
appel aux ressources d'une moralit concrte qui ne trouvent leur
exercice que dans le cadre d'un savoir de soi que l'tat en tant que tel
dtiendrait. C'est l prcisment ce qu'enseigne Hegel dans les
Principes de la philosophie du droit
1
.
Rappelons auparavant que le concept hglien de droit, qui
enveloppe toute l'entreprise, dborde de toutes parts celui de justice
: Le systme du droit, est-il dit dans l'introduction, est le royaume
de la libert effectivement ralise, le monde de l'esprit, monde que
l'esprit produit partir de lui-mme comme une seconde nature (
4, p. 71), et encore : Qu'une existence empirique en gnral soit
existence empirique de la volont, c'est cela qui est le droit. Le droit
est donc la libert en gnral, en tant qu'Ide ( 2, p. 88). Cette
problmatique de la ralisation, de l'effectuation de la libert, est
aussi la ntre dans cette tude. Mais, exige-t-elle la restriction
drastique du domaine de la justice qu'on va dire, et surtout
l'lvation du domaine politique bien au-dessus de la sphre o
l'ide de justice est valide ? En ce qui concerne la limitation du
champ d'exercice de la justice, elle concide avec celle du droit
abstrait, lequel a pour fonction majeure d'lever la prise de
possession au rang de proprit lgale dans un rapport triangulaire
entre une volont, une chose et une autre volont : rapport
constitutif du contrat lgal. Le champ de ce dernier s'en trouve
d'autant rduit, rencontre de la tradition contractualiste laquelle
se rattache Rawls, qui fait sortir l'ensemble des institutions d'un
contrat Fictif. Il en rsulte que le concept de justice subit une
contraction identique. Il est remarquable, en effet, qu'il soit introduit
sous le titre ngatif de l'injustice, sous les aspects de la fraude, du
parjure, de la violence et du crime (82-103); en retour, le droit
abstrait se rsout dans la contre-violence, qui rplique la violence
(Zwang) dans le
J. Hegel, Principes dela philosophiedu droit ou Droit naturel et Sciencede
l'tat en abrg, op. cit.
294
295
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
domaine o la libert s'extriorise dans des choses possdes : Le
droit abstrait est un droit de contrainte [Zwangsrecht], parce que la
ngation du droit est une violence exerce contre l'exis-tance de ma
libert dans une chose extrieure ( 94, p. 139) '. Ce qui fait
fondamentalement dfaut au droit abstrait, au contrat et l'ide de
justice qui en est solidaire, c'est la capacit de lier organiquement
les hommes entre eux ; le droit, comme l'avait admis Kant, se borne
sparer le mien du tien
2
. L'ide de justice souffre essentiellement
de cet atomisme juridique. En ce sens la faille que nous venons de
rappeler, et qui affecte la socit entire en tant que systme de
distribution - faille que prsuppose la situation originelle dans la
fable de Rawls -, devient chez Hegel infirmit insurmontable. La
personne juridique reste aussi abstraite que le droit qui la dfinit.
C'est prcisment l'oppos de ce lien contractuel externe entre
individus rationnels indpendants, et au-del de la moralit
simplement subjective, que la Sittlichkeit se dfinit comme le lieu
des figures de l' esprit objectif selon le vocabulaire de VEncy-
clopdie... Et c'est parce que la socit civile, lieu des intrts en
comptition, ne cre pas non plus de liens organiques entre les
personnes concrtes que la socit politique apparat comme le seul
recours contre la fragmentation en individus isols.
Les raisons de renoncer Hegel au plan de la philosophie
politique ne sont pas comparables celles qui se sont imposes
moi au plan de la philosophie de l'histoire
3
. Le projet philosophique
de Hegel dans les Principes de la philosophie du droit me reste trs
proche, dans la mesure o il renforce les thses diriges dans la
septime tude contre l'atomisme politique. Nous avons alors admis
que c'tait seulement dans un milieu institutionnel spcifique que
les capacits et dispositions qui distinguent l'agir humain peuvent
s'panouir ; l'individu, disions-nous alors, ne devient humain que
sous la condition de certaines institutions ; et
1. Il est vrai que la catgorie du tribunal rapparat dans le cadre de la vie
thique (Sittlichkeit). mais dans les limites de la socitcivile; la section Admi-
nistration de la justice (ibid., 209-229) se trouve ainsi encadre par la thorie
de la socit civile comme systme des besoins et par celle de la police et la
corporation .
2. La Doctrinedu droit, qui constitue la premire partie de la Mtaphysiquedes
murs, construit le droit priv sur la distinction du mien et du tien en gnral :
Lemien selon ledroit [meumjuris] est ce quoi je suis tellement li, que l'usage
qu'un autre en ferait sans mon agrment me lserait. La possession [Besitz] est la
condition subjective de la possibilit de l'usage en gnral (trad. Philonenko,
p. 119 ; cf. d. Alqui [VI, 245], p. 494).
3. Temps et Rcit, t. III, op. cit., II, chap. vi.
nous ajoutions : s'il en est bien ainsi, l'obligation de servir ces ins-
titutions est elle-mme une condition pour que l'agent humain
continue de se dvelopper. Ce sont l autant de raisons d'tre
redevable au travail de hirarchisation des modalits d'effectua-tion
de la libert labores par Hegel dans les Principes de la phi-
losophie du droit. Dans cette mesure, et dans cette mesure seule-
ment, la notion de Sittlichkeit, entendue d'une part au sens de
systme des instances collectives de mdiation intercales entre
l'ide abstraite de libert et son effectuatioh comme seconde nature
, et d'autre part comme triomphe progressif du lien organique entre
les hommes sur l'extriorit du rapport juridique -extriorit
aggrave par celle du rapport conomique -, cette notion de
Sittlichkeit n'a pas fini de nous instruire. Ajouterais-je que
j'interprte, la suite d'ric Weil, la thorie hglienne de l'tat
comme une thorie de l'tat libral, dans la mesure o la pice
matresse en est l'ide de constitution ? En ce sens, le projet
politique de Hegel n'a pas t dpass par l'histoire et pour l'es-
sentiel n'a pas encore t ralis. La question, pour nous, est plutt
celle-ci : l'obligation de servir les institutions d'un tat consti-
tutionnel est-elle d'une autre nature que l'obligation morale, voire
d'une nature suprieure ? Plus prcisment, a-t-elle un autre fon-
dement que l'ide de justice, dernier segment de la trajectoire de la
vie bonne ? Et a-t-elle une autre structure
normative-dontologique que la rgle de justice ?
L'opposition entre Sittlichkeit et Moralitt perd de sa force et
devient inutile - sinon mme nuisible, comme je le dirai plus loin -,
si, d'une part, on donne la rgle de justice, par l'intermdiaire de
celle de distribution, un champ d'application plus vaste que celui
que lui assignaient la doctrine kantienne du droit priv et la doctrine
hglienne du droit abstrait, et si, d'autre part, on dissocie, autant
qu'il est possible, les admirables analyses de la Sittlichkeit de
l'ontologie du Geist - de l'esprit - qui transforme la mdiation
institutionnelle de l'tat en instance capable de se penser elle-mme
'. Spare de l'ontologie du Geist, la phnomnologie de la
Sittlichkeit cesse de lgitimer une instance de jugement suprieure
la conscience morale dans sa structure tria-
1. L'tat est la ralit effective de l'Ide thique en tant que volont substan-
tielle. rvle, claire elle-mme, qui se pense et se sait, qui excute ce qu'elle sait
et dans la mesure o elle le sait. Il a son existence immdiate dans les murs, son
existence mdiatise dans la conscience de soi, dans le savoir et l'activit de l'indi-
vidu, de mme que, par sa conviction, l'individu possde sa libert substantielle
en lui [l'tat] qui est son essence, son but et le produit de son activit (Principes
dela philosophiedu droit, op. cit., 257, p. 258).
296
297
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
dique : autonomie, respect des personnes, rgle de justice
1
. Ce qui donne
la Sittlichkeit l'apparence d'une transcendance par rapport la moralit
formelle, c'est son lien avec des institutions dont on a admis plus haut
le caractre irrductible par rapport aux individus. Seulement, une
chose est d'admettre que les institutions ne drivent pas des individus
mais toujours d'autres institutions pralables, une autre est de leur
confrer une spiritualit distincte de celle des individus. Ce qui
finalement est inadmissible chez Hegel, c'est la thse de l'esprit objectif
et son corollaire, la thse de l'tat rig en instance suprieure dote
du savoir de soi. Le rquisitoire est certes impressionnant, que Hegel a
dress contre la conscience morale lorsqu'elle s'rige en tribunal suprme
dans l'ignorance superbe de la Sittlichkeit o s'incarne l'esprit d'un
peuple. Pour nous, qui avons travers les vnements monstrueux du xx
e
sicle lis au phnomne totalitaire, nous avons des raisons d'couter le
verdict inverse, autrement accablant, prononc par l'histoire elle-mme
travers la bouche des victimes. Quand l'esprit d'un peuple est perverti
au point de nourrir une Sittlichkeit meurtrire, c'est finalement dans la
conscience morale d'un petit nombre d'individus, inaccessibles la peur
et la corruption, que se rfugie l'esprit qui a dsert des institutions
devenues criminelles
2
. Qui oserait railler encore la belle me, quand elle
seule reste tmoigner contre le hros de l'action ? Certes, le
dchirement entre la conscience morale et l'esprit du peuple n'est pas
toujours aussi dsastreux ; mais il garde toujours une valeur de rappel
et d'avertissement. Il atteste de faon paroxystique l'indpassable
tragique de l'action, auquel Hegel lui-mme a rendu justice dans ses belles
pages sur Antigone.
La meilleure manire de dmystifier l'tat hglien et, par l mme, de
librer ses ressources inpuisables au plan de la philosophie politique,
c'est d'interroger la pratique politique elle-mme et d'examiner les formes
spcifiques qu'y revt le tragique de l'action.
Or, pourquoi la pratique politique serait-elle le lieu de conflits
spcifiques ? Et de quelle faon ceux-ci renvoient-ils au sens thique
de la justice ?
Il faut partir ici de la diffrence sur laquelle nous avons si forte-
1. Ce que fait Hegel au 258 des Principes dela philosophiedu droit : ce but
final [Endzweck] possde le droit le plus lev l'gard des individus dont le
devoir suprme est d'tre membres de l'tat (ibid, p. 258).
2. Vclav Havel, Le pouvoir des sans-pouvoir , in Essais politiques, Paris,
Calmann-Lvy, 1989.
ment insist dans la troisime section de la septime tude entre
pouvoir et domination. Le pouvoir, avons-nous admis la suite de
Hannah Arendt, n'existe qu'autant et aussi longtemps que le vouloir
vivre et agir en commun subsiste dans une communaut historique. Ce
pouvoir est l'expression la plus haute de la praxis aristotlicienne qui ne
fabrique rien hors d'elle-mme, mais se donne pour fin son propre
entretien, sa stabilit et sa durabilit. Mais, avons-nous aussi admis, ce
pouvoir est oubli en tant qu'origine de l'instance politique, et
recouvert par les structures hirarchiques de la domination entre
gouvernants et gouverns. A cet gard, rien n'est plus grave que la
confusion entre pouvoir et domination ou, pour voquer le vocabulaire
de Spinoza, dans le Trait politique, entre potentia et potestas
1
. La vertu
de justice, au sens de Visots de Pricls et d'Aristote, vise prcisment
galiser ce rapport, c'est--dire remettre la domination sous le
contrle du pouvoir en commun. Or cette tche, qui dfinit peut-tre la
dmocratie, est une tche sans fin, chaque nouvelle instance de
domination procdant d'une instance antrieure de mme nature, du
moins dans nos socits occidentales
2
.
Cet cart entre domination et pouvoir se marque, au sein mme de
la structure tatique, par la dialectique que j'ai jadis rsume sous le
vocable du paradoxe politique o ne cessent de s'affronter au sein de la
mme instance la forme et la force
3
. Tandis que la forme a son
expression dans l'approximation par la constitution du rapport de
reconnaissance mutuelle entre les individus et entre ceux-ci et
l'instance suprieure, la force a sa marque dans toutes les cicatrices
qu'a laisses la naissance dans la violence de tous les tats devenus des
tats de droit ; force et forme se conjuguent dans l'usage lgitime de la
violence, dont Max Weber rappelle la valeur de critre dans la
dfinition du politique
4
.
C'est partir de cet cart entre domination et pouvoir, constitutif du
politique, qu'il est possible de dfinir la politique comme l'ensemble des
pratiques organises relatives la distribution du pouvoir politique,
mieux appel domination. Ces pratiques
1. M. Revault d'Allonnes, Amor Mundi : la persvrance du politique , in
Ontologieet PolitiqueHannah Arendt, op. cit..
2. Il faudrait considrer ici les recherches en sociologie sur l'existence d'un lien
politique sans tat dans certaines socits encore existantes.
3. Le paradoxe politique, Esprit, n mai 1957, repris in Histoireet Vrit,
Paris, d. du Seuil, 1964, 3* d. augmente, 1987.
4. Le mtier et la vocation d'homme politique , in LeSavant et lePolitique,
op. cit.
298
299
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
concernent aussi bien le rapport vertical entre gouvernants et gouverns
que le rapport horizontal entre groupes rivaux dans la distribution du
pouvoir politique. Les conflits propres ces sphres de la praxis
peuvent tre rpartis entre trois niveaux de radicalit.
A un premier niveau, celui de la discussion quotidienne dans un tat
de droit dont les rgles du jeu font l'objet d'un assentiment large, le
conflit est de rgle dans les activits de dlibration mettant en jeu les
priorits tablir entre ces biens premiers auxquels la thorie rawlsienne
de la justice a fait une maigre part et que ses adversaires libertariens ou
communautariens ont ports au centre de leur rflexion ; la menace
d'usurpation de monopole lie la pluralit des sphres de justice
dtermine le premier niveau o la dlibration politique a pour objet
l'tablissement provisoire et toujours rvisable d'un ordre de priorit
entre les requtes concurrentes de ces sphres de justice. La dlibration
et la prise de position relatives ces conflits ordinaires constituent la
premire occasion qui nous est offerte d'inflchir la Sittlichkeit
hglienne en direction de la phronsis aristotlicienne. Dans l'Etat de
droit, la notion aristotlicienne de dlibration concide avec la
discussion publique, avec ce statut public (ffentlich-keit) rclam
avec tant d'insistance par les penseurs des Lumires ; son tour, la
phronsis aristotlicienne a pour quivalent le jugement en situation qui,
dans les dmocraties occidentales, procde de l'lection libre. A cet
gard il est vain - quand il n'est pas dangereux - d'escompter un
consensus qui mettrait fin aux conflits. La dmocratie n'est pas un
rgime politique sans conflits, mais un rgime dans lequel les conflits
sont ouverts et ngociables selon des rgles d'arbitrage connues. Dans
une socit de plus en plus complexe, les conflits ne diminueront pas
en nombre et en gravit, mais se multiplieront et s'approfondiront. Pour
la mme raison, le pluralisme des opinions ayant libre accs
l'expression publique n'est ni un accident, ni une maladie, ni un malheur ;
il est l'expression du caractre non dcidable de faon scientifique ou
dogmatique du bien public. Il n'existe pas de lieu d'o ce bien puisse tre
aperu et dtermin de faon si absolue que la discussion puisse tre
tenue pour close. La discussion politique est sans conclusion, bien qu'elle
ne soit pas sans dcision. Mais toute dcision peut tre rvoque selon
les procdures acceptes et elles-mmes tenues pour indiscutables, du
moins au niveau dlibratif o nous nous tenons encore ici. De
nombreuses prtentions s'affrontent alors qui manifestent un premier
degr
d'indtermination dans l'espace public de la discussion. Ces prtentions
sont en dernier ressort relatives la priorit accorder, dans une culture
et une conjoncture historique dtermines, tel ou tel des biens premiers
qui dfinissent les sphres de justice, et finalement aux prfrences
prsidant la mise en relation de ces sphres de justice en l'absence d'un
ordre lexical aussi impratif que celui des principes formels de justice.
Dans ce jugement en situation, que les dmocraties avances identifient
pour l'essentiel au vote majoritaire, le seul quivalent de Veuboulia - la
bonne dlibration - recommande par le chur dans les Odes lyriques
(Antigone, c'est le jugement clair qu'on peut attendre du dbat public.
A un second niveau de discussion, le dbat porte sur ce qu'on peut
appeler les fins du bon gouvernement ; c'est une discussion plus
long terme, susceptible d'affecter la structure mme de l'espace de
discussion ; les politologues empiriques ou positivistes ont tendance
tenir ce dbat pour le terrain privilgi de l'idologie, au sens pjoratif du
terme
1
. Bien au contraire, le dbat sur le bon gouvernement fait
partie intgrante de la mdiation politique travers laquelle nous
aspirons une vie accomplie, la vie bonne . C'est pourquoi nous
rencontrons ce dbat sur le trajet de retour de la morale l'thique dans
le cadre du jugement politique en situation.
La controverse se joue autour de mots cls tels que scurit,
prosprit, libert, galit, solidarit, etc. Ce sont l les termes
emblmatiques qui dominent de haut la discussion politique. Leur
fonction est de justifier, non pas l'obligation de vivre dans un tat en
gnral, mais la prfrence pour une forme d'tat. Le dbat se joue ainsi
mi-chemin entre les rgles de dlibration l'intrieur d'une forme
dj consentie de constitution et les principes de lgitimation dont on
parlera plus loin. Que ces grands mots aient une charge motionnelle
suprieure leur teneur de sens, et soient ainsi la merci de la
manipulation et de la propagande, cette situation rend d'autant plus
ncessaire la clarification qui est une des tches de la philosophie
politique. Aussi bien ont-ils une histoire respectable chez les plus grands
penseurs politiques: Platon, Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke,
Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville, Mill. Replaces dans leur
his-
1. Pour une apprciation plus nuance de la polysmie et de la polyvalence du
concept d'idologie, cf. mes essais sur le sujet dans Du texte l'action, op. cit.,
troisime partie, et dans mes cours publis sous le titre Lectures on Ideologyand
Vtopia, d. G. H. Taylor, New York, Columbia University Press, 1986.
300 301
SOI-MMECOMMEUNAUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
toire conceptuelle, ces expressions rsistent l'arbitraire des pro-
pagandistes qui voudraient leur faire dire n'importe quoi. Les rejeter
purement et simplement du ct des valuations motionnelles
irrcuprables pour l'analyse, c'est consentir prcisment au msusage
idologique au pire sens du mot. La tche est au contraire de dgager
leur noyau de sens, en tant prcisment que termes apprciatifs relatifs
aux fins du bon gouvernement. Ce qui a pu faire croire que ces concepts
ne sauraient tre sauvs, c'est que l'on n'a pas pris en compte deux
phnomnes majeurs qu'une philosophie de l'action de type
hermneutique est prpare reconnatre : savoir, premirement, que
chacun de ces termes a une pluralit de sens insurmontable ;
deuximement, que la pluralit des fins du bon gouvernement est
peut-tre irrductible, autrement dit que la question de la fin du bon
gouvernement est peut-tre indcidable
1
.
L'irrductible pluralit des fins du bon gouvernement implique
que la ralisation historique de telles valeurs ne peut tre obtenue sans
faire tort telle autre, bref que l'on ne peut servir toutes les valeurs la
fois. Il en rsulte, une nouvelle fois, la ncessit d'inflchir la Sittlichkeit
hglienne du ct de la phro-nsis d'Aristote, leve cette fois au
niveau de la recherche de la bonne constitution, quand les accidents
de l'histoire crent prcisment un vide constitutionnel. C'est dans une
conjoncture (gographique, historique, sociale, culturelle) contingente, et
pour des motifs non transparents aux acteurs politiques du moment,
que ceux-ci peuvent prtendre offrir leur peuple une bonne
constitution. Ce choix est un nouvel exemple du jugement politique en
situation, o Yeuboulia n'a d'autre appui que la conviction des
constituants, finalement leur sens de la justice - vertu des institutions -
dans le moment d'un choix historique .
Une indcision plus redoutable que celle qui rsulte de l'ambigut des
grands mots de la pratique politique atteint un troisime niveau les
choix plus fondamentaux que ceux de telle
1. Un exercice remarquable de clarification du terme libert est d Isaiah
Berlin dans Four Essays on Liberty(Londres, 1969 ; trad. fr., logedela libert,
Paris, Calmann-Lvy, 1988). Au reste, la polysmie caractristique de ce que j'ap-
pelle les grands mots de la politique est reconnue par Aristote en ce qui concerne
la justice elle-mme, ds les premires lignes de Vthique Nicomaque, V. Si la
polysmie des termes emblmatiques de la politique est aussi fondamentale
qu'Aristote le dit de la justice, il n'y a rien d'tonnant ce que telle signification
particulire du terme libert recouvre telle signification partielle de l'galit,
tandis que telle autre rpugne entirement une autre signification partielle du
terme adverse.
constitution dmocratique. Elle concerne le procs de lgitimation
mme de la dmocratie sous la varit de ses guises. On parle juste titre
de crise de lgitimation pour dsigner le manque de fondement qui
parat affecter le choix mme d'un gouvernement du peuple, pour le
peuple et par le peuple. Nos rflexions sur la distinction entre
domination et pouvoir prennent ici leur pleine signification. Si le
pouvoir est la source oublie de la domination, comment faire driver
visiblement la domination du vouloir vivre ensemble ? C'est ici que la
fiction du contrat social, porte un degr suprieur de raffinement par
la fable rawlsienne d'une situation originelle caractrise par la jairness,
se rvle combler un vide, savoir, comme il a t suggr plus haut,
l'absence pour le contrat social de la sorte d'attestation en vertu de
laquelle l'autonomie est pour l'individu un fait de raison et le respect
des personnes une implication de leur nature rationnelle. L'absence
de paralllisme est flagrant entre l'autonomie morale et ce que serait pour
un peuple l'autolgislation par laquelle la domination ne ferait
qu'arracher l'oubli le vouloir vivre et l'agir ensemble d'un peuple. Je
rejoins ici, par une autre voie, une analyse que Claude Lefort fait de la
dmocratie par contraste avec le totalitarisme. Ce fut prcisment
l'erreur - plutt le crime - du totalitarisme de vouloir imposer une
conception univoque de ce qu'il croyait tre un homme nouveau et
d'luder par ce moyen les ttonnements historiques de la comprhension
de soi de l'homme moderne. Le penseur de la dmocratie commence
par.avouer une indtermination dernire quant aux fondements du
Pouvoir, de la Loi et du Savoir, et au fondement de la relation de Y un
avec l'autre sur tous les registres de la vie sociale ' . La dmocratie,
selon Claude Lefort, nat d'une rvolution au sein du symbolisme le plus
fondamental d'o procdent les formes de socit ; c'est le rgime qui
accepte ses contradictions au point d'institutionnaliser le conflit
2
. Cette
indtermination dernire ne saurait constituer le dernier mot : car les
hommes ont des raisons de prfrer au totalitarisme un rgime aussi
incertain du fondement de sa lgitimit. Ces raisons sont celles mmes
qui sont constitutives du vouloir vivre ensemble et dont une des
manires de prendre
1. Claude Lefort, Essais sur lepolitique, Paris, d. du Seuil, 1986, p. 29.
2. La dmocratie se rvle ainsi la socit historique par excellence, socit
qui, dans sa forme, accueille et prserve l'indtermination en contraste remar-
quable avec le totalitarisme qui, s'difiant sous le signe de la cration de l'homme
nouveau, s'agence en ralit contre cette indtermination, prtend dtenir la loi de
son organisation et de son dveloppement et se dessine secrtement dans le
monde moderne comme socit sans histoire (op. cit., p. 25).
302
303
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
conscience est la projection de la fiction d'un contrat social anhis-torique.
Ces raisons mlent des prtentions l'universalit et des contingences
historiques dans ce que Rawls appelle, dans un essai postrieur de prs de
quinze annes Thorie de la justice, over-lapping consensus ' .
Celui-ci entrecroise plusieurs hritages culturels : outre le projet de
VAuflcIrung, qu'Habermas estime juste titre inachev
2
, les formes
rinterprtes des traditions juives, grecques et chrtiennes qui ont subi
avec succs l'preuve critique de YAujklrung. Il n'y a rien de mieux
offrir, pour rpondre la crise de lgitimation (qui, mon sens, frappe
l'ide de domination plus que celle de pouvoir, en tant que vouloir
vivre et agir d'un peuple), que la rminiscence et l'entrecroisement dans
l'espace public d'apparition des traditions qui font une place la
tolrance et au pluralisme, non par concession des pressions externes
mais par conviction interne, celle-ci ft-elle tardive. C'est en faisant
mmoire de tous les commencements et de tous les recommencements,
et de toutes les traditions qui se sont sdimentes sur leur socle, que le
bon conseil peut relever le dfi de la crise de lgitimation. Si, et dans
la mesure o ce bon conseil prvaut, la Sittlichkeit hglienne - qui
elle aussi s'enracine dans les Sitten, dans les murs - s'avre tre
l'quivalent de la phronsis d'Aristote : une phronsis plusieurs, ou
plutt publique, comme le dbat lui-mme.
Ne serait-ce pas le lieu de rappeler la distinction qu'Aristote fait, au
terme de son tude de la vertu de justice, entre justice et quit ?Ay
regarder avec attention, il apparat que la justice et l'quit ne sont ni
absolument identiques, ni gnriquement diffrentes (...) En effet,
l'quitable[pieiks], tout en tant suprieur une certaine justice, est
lui-mme juste, et ce n'est pas comme appartenant un genre diffrent
qu'il est suprieur au juste. Que la diffrence qui fait la supriorit de
l'quit par rapport la justice ait un rapport avec la fonction
singularisante de la phronsis. Aristote lui-mme le suggre : La raison
en est que la loi est toujours quelque chose de gnral, et qu'il y a des cas
d'espce pour lesquels il n'est pas possible de poser un nonc gnral
qui s'y applique avec rectitude. L'quit remdie la justice l o le
lgislateur a omis de prvoir le cas et a pch par esprit de simplification
. En corrigeant l'omission, le dcideur public se fait
1. John Rawls, Un consensus par recoupement , Revuedemtaphysiqueet
demorale. n 1, 1988, p. 3-32.
2. J. Habermas, La modernit : un projet inachev , Critique, n" 413, octobre
1981.
l'interprte de ce qu'et dit le lgislateur lui-mme s'il avait t prsent
ce moment, et de ce qu'il aurait port dans sa loi s'il avait connu le cas
en question. Et Aristote de conclure : Telle est la nature de l'quitable
: c'est d'tre un correctif de la loi, l o la loi a manqu de statuer cause
de sa gnralit '. Quand nous relisons aujourd'hui ces lignes d'Aristote,
nous sommes enclins penser que le dbat public et la prise de dcision
qui en rsulte constituent la seule instance habilite corriger
l'omission que nous appelons aujourd'hui crise de lgitimation .
L'quit, conclurons-nous, c'est un autre nom du sens de la justice
quand celui-ci a travers les preuves et conflits suscits par l'application
de la rgle de justice.
2. Respect et conflit
Une seconde rgion conflictuelle est dcoupe par les applications du
second impratif kantien : traiter l'humanit dans sa propre personne
et dans celle d'autrui comme une fin en soi et non pas seulement
comme un moyen. L'ide qui va guider notre critique procde de la
suggestion faite dans l'tude prcdente selon laquelle une fine ligne de
partage tendrait sparer le versant universaliste de l'impratif, figur
par l'ide d'humanit, et le versant qu'on peut dire pluraliste, figur par
l'ide des personnes comme des fins en elles-mmes. Selon Kant, il n'y
a l nulle opposition, dans la mesure o l'humanit dsigne la dignit en
tant que quoi les personnes sont respectables, en dpit - si l'on ose dire -
de leur pluralit. La possibilit d'un conflit surgit toutefois ds lors que
l'altrit des personnes, inhrente l'ide mme de pluralit humaine,
s'avre tre, dans certaines circonstances remarquables,
incoordonnable avec l'universalit des rgles qui sous-tendent l'ide
d'humanit ; le respect tend alors se scinder en respect de la loi et
respect des personnes. La sagesse pratique peut dans ces conditions
consister donner la priorit au respect des personnes, au nom mme de
la sollicitude qui s'adresse aux personnes dans leur singularit
irremplaable.
Avant d'entrer dans le vif de l'argument, il importe de le dis-
1. Cf. Aristote, thique Nicomaque. trad. Tricot, V, 14, 1137 b 19-27 ; V, 14,
1137 a 31 - 1138 a 3. Il est remarquer que Gauthier-Jolif, dans leur com-
mentaire de Vthique Nicomaque(op. cit., t. II, p. 431-434), considrent ce cha-
pitre XIV comme la conclusion du livre V.
304 305
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
tinguer de l'objection trop souvent faite au formalisme d'tre vide, en
quelque sorte par dfinition. C'est au contraire parce que l'impratif
catgorique engendre une multiplicit de rgles que l'universalisme
prsum de ces rgles peut entrer en collision avec les requtes de
l'altrit, inhrentes la sollicitude.
La fausset de l'quation entre formel et vide tient la
mconnaissance du rle des maximes chez Kant
1
. Deux points sont ici
rappeler : d'abord la rgle d'universalisation s'applique des maximes
multiples qui sont dj des rgularits de comportement ; sans elles, la
rgle d'universalisation n'aurait, si l'on peut dire, rien moudre , rien
mettre l'preuve. Ensuite, et la remarque est plus nouvelle, il existe
des maximes qui passent avec succs l'preuve de l'universalisation ; ce
sont celles-l que Kant appelle prcisment des devoirs (au pluriel)
2
. Ces
devoirs ne sont pas dduits, au sens logique du terme, mais drivs, dans
la mesure o ce qu'on pourrait appeler les propositions de sens issues de la
pratique quotidienne - supporter l'insulte sans en tirer vengeance,
rsister la tentation de se suicider par dgot de la vie, ne pas cder
aux attraits d'une fausse promesse, dvelopper ses talents plutt que
cder la paresse, porter secours autrui, etc. -satisfont l'preuve
d'universalisation. La pluralit des devoirs rsulte du fait que c'est la
pluralit des maximes, rpondant elles-mmes une diversit de
situations, que la rgle formelle est applique. Une certaine productivit
du jugement moral est ici porte au jour.
C'est prcisment sur la voie de cette productivit que le conflit peut
apparatre. Kant ne lui fait pas place, parce qu'il ne considre qu'un
seul trajet possible dans la mise l'preuve de la maxime : le trajet
ascendant de subsomption de la maxime sous
1. C'est en partie dans la perspective de cette discussion que j'ai tant insist,
la suite de Bernard Carnois et de Otfried Hoffe, sur le rle des maximes dans la
morale kantienne.
2. Sans cela il serait inconcevable que Kant ait pu crire dans les Fonde-
ments... : Nous allons maintenant numrer quelques devoirs, d'aprs la division
ordinaire en devoirs envers nous-mmes et devoirs envers les autres hommes, en
devoirs parfaits et en devoirs imparfaits (trad. Delbos [IV, 421 ], p. 285). Ces
devoirs ne sont pas au sens prcis du mot des exemples (en dpit de la note
dans laquelle Kant annonce les dveloppements plus complets et mieux argu-
mentes de la Mtaphysiquedes moeurs encore crire (ibid). L'ide d'une morale
base sur des exemples a t carte un peu plus haut par Kant, si l'on entend par
l, comme dans la morale populaire, un enseignement direct faisant l'conomie de
principes purs . A propos de ces exemples , Kant parle un peu plus loin de
dduction (ibid. [IV, 424], p. 288), si toutefois il faut corriger Abteilung (qu'on
lit dans l'dition de l'Acadmie) par Ableitung (ibid.).
la rgle. Or c'est sur un second trajet, celui de l'application la situation
concrte, o l'altrit des personnes demande tre reconnue, que le
conflit peut apparatre.
Sur le premier trajet, le caractre moral des maximes est vrifi dans
une preuve en deux temps : on labore d'abord la maxime dans des
termes tels qu'on puisse se demander par aprs si, ainsi formule, elle
subit avec succs l'preuve d'universalisation. Quant au deuxime
temps, celui de la mise l'preuve proprement dite, il est strictement
limit une preuve de contradiction interne la maxime elle-mme.
Nous reviendrons, dans la dernire section de cette tude, sur cet usage
limit de la notion kantienne d'universalit.
Vrifions-le sur l'exemple de la fausse promesse qui, dans la classe
des devoirs stricts, illustre la sous-classe des devoirs envers autrui et nous
place ainsi au cur de notre problme des rapports entre respect et
sollicitude. Suivons de prs l'argumentation de Kant ; elle consiste en
une exprience de pense dans laquelle nous imaginons l'agent
raisonnant ainsi : Je convertis (...) l'exigence de l'amour de soi en une
loi universelle et j'institue la question suivante : qu'arriverait-il si ma
maxime devenait une loi universelle? (Fondements..., trad. Delbos
[IV, 422], p. 288.) Tombe le couperet : une telle maxime ne pourrait
s'accorder avec elle-mme , mais devrait ncessairement se contredire
(ibid.)
1
. La contradiction, on le voit, n'apparat que si l'agent a accept
l'exprience de pense propose. Une contradiction, qu'on peut
peut-tre classer parmi les contradictions performa-tives, prcde cette
dernire preuve : elle consiste en la libert
1. Que la non-contradiction soit le seul ressort de la rfutation est difficile
admettre, suivre Kant dans son argument : ce serait mme, dit-il, rendre
impossible le fait de promettre avec le but qu'on peut se proposer par l, tant
donn que personne ne croirait ce qu'on lui promet, et que tout le monde rirait
de pareilles dmonstrations, comme de vaines feintes (ibid., p. 287). Le fait de la
dfiance suscite par la promesse ne constitue-t-il qu'une confirmation extrieure,
mettant en jeu les consquences de la fausse promesse, au regard de la contradic-
tion internecontenue dans l'ide d'une promesse qu'on est dcid ne pas tenir ?
Aussi bien, la non-contradiction est plus difficile faire apparatre dans les deux
exemples qui suivent : le devoir de se cultiver et le devoir de porter secours
autrui ; en quoi l'oisivet rige en rgle de vie contredit-elle logiquement la
volont, suppose commune tous les tres raisonnables, de dvelopper leurs
propres facults ? Quant au secours d au prochain aux prises avec de grandes dif-
ficults. Kant accorde volontiers que l'espce humaine n'est pas menace de dis-
paratre si un malheureux de plus n'est pas secouru. Mais alors en quoi la maxime
entre-t-elle en contradiction avec elle-mme ? A vrai dire, la contradiction n'appa-
rat que si l'agent a fait l'hypothse que sa maxime devenait une loi universelle, ce
que prcisment il ne fait pas.
306 307
SOI-MME COMME UN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
que l'agent se donne de faire une exception en sa faveur, donc dans le
refus de vouloir rellement que sa maxime devienne une loi universelle
(Fondements..., trad. Delbos [IV, 424], p. 288). En bref la contradiction
est celle d'une volont qui se soustrait l'preuve d'universalisation.
Elle s'insre, si l'on peut dire, entre la rgle et l'exception, et consiste en
ceci qu'une rgle qui admet des exceptions n'est plus une rgle. Mais on
aura remarqu que, dans tous les exemples traits par Kant dans les
Fondements et dans la Mtaphysique des murs, la seule exception prise
en considration est celle qui est revendique au bnfice de l'agent, au
titre de l'amour de soi. Qu'en est-il de l'exception faite au bnfice
d'autrui ?
Cette nouvelle question ne se pose que sur le second trajet, celui que
Kant n'a pas considr, le trajet de l'application des situations
singulires, o autrui se dresse dans sa singularit irremplaable. C'est
sur ce second trajet que peut prendre corps la suggestion, faite dans
l'tude prcdente, selon laquelle la considration des personnes comme
des fins en elles-mmes introduit un facteur nouveau, potentiellement
discordant, par rapport l'ide d'humanit, laquelle se borne
prolonger l'universalit dans la pluralit au dtriment de l'altrit.
Reprenons l'argument qui condamne la fausse promesse : autrui y
est-il vritablement pris en considration ? On peut en douter. Il est
frappant que la condamnation du suicide et celle de la fausse promesse,
bien qu'appartenant aux deux classes diffrentes des devoirs envers
soi-mme et des devoirs envers autrui, tendent se confondre dans la
mesure o c'est l'humanit qui est traite seulement comme moyen, la
premire fois dans la propre personne, la seconde fois dans la personne
d'autrui'. Peut-tre faut-il mme aller plus loin : n'est-ce pas plutt
l'intgrit personnelle qui est en jeu dans les devoirs dits envers autrui
? N'est-ce pas soi-mme qu'on mprise en prononant un faux serment
2
? Le tort fait autrui en tant qu'autre que moi ne pouvait
1. A l'appui de ce soupon, on peut observer que le cas du suicide et celui de la
fausse promesse sont traits deux fois dans les Fondements... : une premire fois
sous l'gide de ta premire formulation secondaire de l'impratif catgorique, o
l'ide analogique de naturesert de pivot l'argument, une deuxime fois dans le
sillage de la seconde formulation, o l'accent est mis sur l'humanitcomme fin en
soi. Ce doublet ne laisse-t-il pas entendre que la considration d'autrui comme fin
en soi n'est pas essentielle l'argument ? Au fond, l'ide d'humanit, comme celle
de nature, tend attnuer, sinon annuler, l'altrit d'autrui.
2. Cette assertion est au centre de la rponse que Kant fait Benjamin
Constant dans son bref essai, Sur un prtendu droit de mentir par humanit
(1797) (trad. fr. de L. Guillermit, in Thorieet Pratique. Droit dementir, Paris,
Vrin, 1988).
peut-tre pas figurer sur le premier trajet remontant de l'action la
maxime et de la maxime au critre qui en prouve la teneur morale. Il
ne le pourrait que sur le second trajet complmentaire du premier, le
trajet descendant de la concrtisation, de l'application au sens fort du
mot '.
Sur ce second trajet, la rgle est soumise une autre sorte de mise
l'preuve, celle par les circonstances et les consquences. Et une autre
sorte d'exception que celle voque plus haut - l'exception la rgle en
faveur de soi-mme - se propose ; l'exception, ici, prend un autre visage,
ou plutt elle devient un visage, pour autant que l'altrit vritable des
personnes fait de chacune de celles-ci une exception.
La promesse cesse alors de se rattacher l'unique souci d'intgrit
personnelle, pour entrer dans l'espace d'application de la rgle de
rciprocit, et plus prcisment de la Rgle d'Or, dans la mesure o
celle-ci prend en compte la dissymtrie initiale de l'agent et du patient,
avec tous les effets de violence ressortissant cette dissymtrie. Traiter
autrui seulement comme un moyen, c'est dj commencer de lui faire
violence. A cet gard, la fausse promesse est une figure du mal de
violence dans l'usage du langage, au plan de l'interlocution (ou de la
communication). Ce lien entre la promesse et la Rgle d'Or, ou rgle de
rciprocit, reste mconnu, si l'on ne prend pas garde de distinguer la
rgle selon laquelle \\faut tenir ses promesses, de la rgle constitutive qui
distingue la promesse des autres actes de discours. La rgle constitutive
de la promesse dit seulement : A se place sous l'obligation de faire X
en faveur de B dans les circonstances Y. En disant cela, A fait
assurment quelque chose : il s'oblige lui-mme ; mais la tenue de la
promesse relve seulement des conditions de satisfaction de la promesse,
non de la condition de succs sans quoi la promesse n'existerait pas
comme acte de discours dtermin. Or, en caractrisant ainsi la
promesse comme acte de discours, nous n'avons pas encore pos le
problme moral, savoir la raison pour laquelle il faut tenir ses
promesses. Promettre est une chose. Etre oblig de tenir ses promesses en
est une autre. Appelons prin-
1. On peut lgitimement se demander si Kant n'a pas t empch de prendre
en considration cette seconde problmatique du fait qu'il transpose au domaine
pratique une problmatique propre au domaine thorique, celle de la dduction
transcendantale, et si le processus d'puration, sparant l'a priori de l'empirique,
ne tend pas casser le ressort de l'action. En ce sens, la question pose par Hegel
de l'effectuation de la libert respecte mieux l'unit de l'agir humain (cf. C.
Tay-lor, Hegel's concept of action as unity of poiesis and praxis in L.S.
Stepelevich et D. Lamb (d.), Hegel's Philosophy of Action, Humanities Press,
1983).
308 309
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
cipe de fidlit l'obligation de tenir ses promesses. C'est de lui qu'il
importe de montrer la structure dialogique sur laquelle peuvent se
greffer les conflits de devoirs que l'on va dire. Cette structure
dialogique doit d'ailleurs s'analyser en structure dya-dique, ou duelle,
mettant en jeu deux personnes - celle qui promet et l'obligataire envers
qui la premire s'engage -, et structure plurielle, mettant en jeu
ventuellement un tmoin devant qui un engagement est pris, puis,
l'arrire de ce tmoin, l'institution du langage que l'on s'engage
sauvegarder, voire la rfrence quelque pacte social au nom duquel peut
rgner entre les membres de la socit considre une confiance
mutuelle pralable toute promesse. Par cette structure plurielle, le
principe de fidlit ne se distingue pas de la rgle de justice discute plus
haut '. C'est pourquoi on se bornera ici la structure dyadique o deux
personnes sont engages.
Il est facile de mconnatre cette structure dyadique de la promesse ;
il n'est pas sr que Kant n'y ait pas contribu par son traitement de la
fausse promesse comme contradiction intime une maxime o une
personne n'engage qu'elle-mme. Une phnomnologie tronque de
l'engagement incline dans le mme sens
2
. Un
1. On sait quel point des institutions injustes peuvent pervertir les rapports
interpersonnels. Quand la peur et le mensonge sont institutionnaliss, mme la
confiance dans la parole de l'ami peut tre subvertie. Il faut avoir fait l'exprience
de ces perversions en chane pour dcouvrir, par la voie du manque, combien la
confiance mutuelle au plan le plus intimement interpersonnel dpend de ce que
saint Thomas appelait la tranquillit de l'ordre .
2. M.H. Robins, dans un livre prcis - Promising, Intending and Moral
Auto-nomy, Cambridge Univcrsity Press, 1984 -, s'emploie driver la force
contraignante de l'obligation de tenir ses promesses de la structure monologique
de l'intention. Cette structure est vue traverser trois stades qui marquent le
renforcement progressif de l'intention. Au plus bas degr, la ferme intention de
faire quelque chose peut tre tenue pour une promesse virtuelle, dans la mesure o
elle pose l'identit entre deux je, celui qui promet et celui qui fera. Un
embryon d'obligation est ainsi contenu dans le maintien de soi travers le temps.
11 suffit pour passer au degr suivant que ce maintien de soi-mme devienne, en
tant que tel, le contenu vis de l'intention, pour que le moment d'obligation
prenne du relief. On peut appeler vu cette intention de maintien que Robins
appelle clause d'exclusivit : je place mon engagement au-dessus des vicissitudes
extrieures et intrieures. Ce faisant, je me lie moi-mme, ce qui est dj m'obli-
ger. On passe au troisime stade, celui de l'obligation au sens fort, lorsque le
contenu de la chose faire rgit le maintien de soi, en dpit non seulement des
vicissitudes intrieures et extrieures, mais des changements ventuels d'inten-
tion. Une relation dialectique s'instaure alors entre l'exigence qui procde de la
chose faire et l'intention qui y souscrit ; d'un ct, l'exigence semble se dtacher
de l'intention et la rgir de manire extrinsque comme un mandat, de l'autre,
celui-ci ne m'oblige que pour autant que j'en fais mon affaire, ma cause . Le
lien qui melie est le mme que celui par lequel jeme lie.
engagement n'a-t-il pas tous les caractres d'une intention ferme ?
N'avons-nous pas nous-mme fait du maintien de soi travers le temps
l'expression la plus haute de l'identit de Yipse, oppose celle de
Vident, c'est--dire la simple permanence ou persvrance d'une chose
(permanence qui ne se retrouve au plan de l'ip-sit que dans celle du
caractre) ? Rien n'est renier de ces analyses. Ce qu'il faut plutt
montrer, c'est la structure dialogique-dyadique du maintien de soi, ds
lors qu'il revt une signification morale. L'obligation de se maintenir
soi-mme en tenant ses promesses est menace de se figer dans la raideur
stocienne de la simple constance, si elle n'est pas irrigue par le vu de
rpondre une attente, voire une requte venue d'autrui. C'est, en
vrit, ds le premier stade, celui de l'intention ferme, que l'autre est
impliqu : un engagement qui ne serait pas de faire quelque chose que
l'autre pourrait choisir ou prfrer pourrait n'tre qu'un pari stupide. Et,
si je nourris le ferme propos de placer la constance moi-mme
au-dessus des intermittences de mes dsirs, dans le mpris des obstacles
et des entraves extrieures, cette constance en quelque sorte
monologique risque d'tre prise dans l'alternative que Gabriel Marcel
dcrivait dans son admirable analyse de la disponibilit : En un
certain sens, disait-il dans tre et Avoir
1
(p. 56 sq.), je ne puis tre fidle
qu' mon propre engagement, c'est--dire, semble-t-il, moi-mme .
Mais en ce point nat l'alternative : Au moment o je m'engage, ou
bien je pose arbitrairement une invariabilit de mon sentir qu'il n'est
pas rellement en mon pouvoir d'instituer ; ou bien j'accepte par
avance d'avoir accomplir un moment donn un acte qui ne refltera
nullement mes dispositions intrieures lorsque je l'accomplirai. Dans le
premier cas, je me mens moi-mme, dans le second, c'est autrui que
par avance je consens mentir (ibid., p. 70). Comment chapper
ce double nud de la constance soi ? On connat la rponse de
Gabriel Marcel : Tout engagement est une rponse (ibid., p. 63).
C'est l'autre que je veux tre fidle. A cette fidlit, Gabriel Marcel
donne le beau nom de disponibilit
2
.
Le rseau notionnel dont la notion de disponibilit est un des nuds
est trs ramifi. Par son contraire, l'indisponibilit, elle ctoie la
dialectique de l'tre et de l'avoir. La disponibilit est cet exode qui ouvre
le maintien de soi sur la structure dialogique ins-
1. Paris, Aubier, 1935.
2. P. Ricur, Entre thique et ontologie, la disponibilit , Actes du Colloque
Gabriel Marcel (1988), Paris, Bibliothque nationale, 1989.
310 311
SOI-MME COMME UN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
titue par la Rgle d'Or. Celle-ci, en tant que rgle de rciprocit pose
dans une situation initiale dissymtrique, tablit l'autre dans la
position d'un obligataire qui compte sur moi et fait du maintien de soi
une rponse cette attente. C'est, dans une large mesure, pour ne pas
dcevoir cette attente, pour ne pas la trahir, que je fais du maintien de
ma premire intention le thme d'une intention redouble : l'intention
de ne pas changer d'intention. Dans les formes de promesses
sanctionnes par le droit - jurement, contrat, etc. -, l'attente d'un autrui
qui compte sur moi devient, de sa part, un droit d'exiger. Nous sommes
alors entrs dans le champ des normes juridiques o la filiation de la
norme partir de la sollicitude est comme oblitre, efface. Il faut
remonter de ces formes de promesses sanctionnes par les tribunaux
celles o le lien du moment normatif la vise thique est encore
perceptible : de toi, me dit l'autre, j'attends que tu tiennes ta parole ;
toi, je rponds : tu peux compter sur moi . Ce compter sur relie le
maintien de soi, dans sa teneur morale, au principe de rciprocit fond
dans la sollicitude. Le principe de fidlit la parole donne ne fait ainsi
qu'appliquer la rgle de rciprocit la classe des actions o le langage
lui-mme est en jeu en tant qu'institution rgissant toutes les formes de la
communaut. Ne pas tenir sa promesse, c'est la fois trahir l'attente de
l'autre et l'institution qui mdiatise la confiance mutuelle des sujets
parlants.
L'analyse sommaire de la promesse laquelle on vient de procder
accentue la csure si soigneusement occulte par Kant entre le respect
pour la rgle et le respect pour les personnes. Cette csure, qui va
devenir une dchirure dans les cas de conflits qu'on va voquer, ne
pouvait sans doute pas apparatre sur le trajet de la subsomption de
l'action sous la maxime et de la maxime sous la rgle. En revanche, la
dchirure ne peut manquer d'attirer l'attention ds lors que l'on s'engage
sur le trajet de retour de la maxime, sanctionne par la rgle, aux
situations concrtes. La possibilit de ces conflits est en effet inscrite
dans la structure de rciprocit de la promesse. Si la fidlit consiste
rpondre l'attente de l'autre qui compte sur moi, c'est cette attente que
je dois prendre pour mesure de l'application de la rgle. Une autre sorte
d'exception se profile que l'exception en ma faveur, savoir l'exception
en faveur de l'autre. La sagesse pratique consiste inventer les conduites
qui satisferont le plus l'exception que demande la sollicitude en
trahissant le moins possible la rgle. Nous prendrons deux exemples,
dont l'un concerne la vie finissante et
l'autre la vie commenante . Le premier exemple est bien connu
sous le titre devenu banal de la vrit due aux mourants. Une brche
semble en effet s'ouvrir entre deux attitudes extrmes. Ou bien dire la
vrit sans tenir compte de la capacit du mourant la recevoir, par pur
respect de la loi suppose ne tolrer aucune exception ; ou bien mentir
sciemment, de peur, estime-t-on, d'affaiblir chez le malade les forces qui
luttent contre la mort et de transformer en torture l'agonie d'un tre
aim. La sagesse pratique consiste ici inventer les comportements
justes appropris la singularit des cas. Mais elle n'est pas pour autant
livre l'arbitraire. Ce dont la sagesse pratique a le plus besoin dans ces
cas ambigus, c'est d'une mditation sur le rapport entre bonheur et
souffrance. Il n'y a pas d'thique sans ide d'une vie heureuse, rappelle
opportunment Peter Kemp dans thique et Mdecine
1
. Encore faut-il
situer le rle du bonheur dans l'thique (p. 63). Or Kant, en
enveloppant dans la Critique de la Raison pratique (Thorme III,
corollaire, et scolie) sous une unique rubrique, celle de la facult
infrieure de dsirer, toutes les formes d'affectivit, a ferm la voie une
investigation diffrencie qui dcomposerait le terme quivoque de
bonheur entre la jouissance de biens matriels et ce que P. Kemp
dsigne comme une pratique commune du donner et recevoir entre
personnes libres (p. 64). Ainsi considr, le bonheur n'entre plus en
contradiction absolue avec la souffrance (p. 67)
2
. C'est faute d'une
telle mditation sur le rapport entre souffrance et bonheur que le souci
de ne faire souffrir aucun prix les malades au terme de leur vie
aboutit riger en rgle le devoir de mentir aux mourants. Jamais la
sagesse pratique ne saurait consentir transformer en rgle l'exception
la rgle. Encore moins devrait-on lgifrer dans un domaine o la
responsabilit de choix dchirants ne saurait tre allge par la loi.
Dans tels cas, il faut peut-tre avoir compassion pour des tres trop
faibles moralement et physiquement pour entendre la vrit. Dans tels
autres cas, il faut savoir doser la communication de cette vrit : une
chose est de nommer la maladie, une autre d'en rvler le degr de
gravit et le peu de chances de survie, une autre d'assener la
1. Op. cit.
2. On lira dans le mme ouvrage de P. Kemp : le bonheur, la souffrance et
l'angoisse devant la mort (ibid.. p. 63 sq). On apprend que l'apprentissage pour
soi-mme de la vieillesse, aussi bien que le respect de la vieillesse chez les autres,
ne sont pas trangers ce bon usage de la sollicitude, lorsqu'elle se meut dans cet
troit intervalle o il reste vrai qu'il n'y a pas d'thique sans bonheur, mais o il
est faux que le bonheur exclue la souffrance.
312
313
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
vrit clinique comme une condamnation mort. Mais il y a aussi
des situations, plus nombreuses qu'on ne croit, o la communication
de la vrit peut devenir la chance d'un partage o donner et
recevoir s'changent sous le signe de la mort accepte
1
.
C'est dans un esprit semblable que l'on peut aborder le problme
du respect de la personne dans la vie commenante . Le
problme, il est vrai, prsente un degr supplmentaire de
complexit, en raison des considrations ontologiques que pose la
vie commenante et que ne posait pas la vie finissante. S'agissant de
l'embryon, puis du ftus humain, il est difficile de ne pas se
demander quelle sorte d'tres ils sont, s'ils ne sont ni choses, ni
personnes. En un sens, la position kantienne concernant la personne
n'tait pas dnue de toute implication ontologique, comme l'a
rappel plus haut la formule clbre : la nature raisonnable existe
comme une fin en soi. Par contraste, la chose, en tant que
manipulable, recevait un mode d'existence oppos, dfini
prcisment par l'aptitude tre manipule. En outre - et cette
remarque prendra ultrieurement tout son poids -, dans cette
opposition bipolaire entre la personne et la chose, la distinction
entre modes d'tres restait insparable de la pratique, c'est--dire de
la manire de traiter personnes et choses. La question nouvelle
pose par la vie commenante est ailleurs : ce que l'embryon et le
ftus humain mettent en question, c'est le caractre dichotomique
de ces considrations thico-ontologiques : pour compliquer les
choses, ce n'est pas seulement l'embryon humain dans l'utrus
maternel, mais l'embryon spar, conu en prouvette, mis au
conglateur et disponible pour la recherche scientifique, qui pose
les questions les plus embarrassantes. Comme l'crit Anne Fagot
2
:
Il y a conflit entre le principe du respect d l'tre humain et
l'instrumentalisation de cet tre aux stades embryonnaire ou ftal -
moins qu'un embryon humain ne soit pas une personne humaine ?
Il est ncessaire d'couter les tenants des thses opposes pour
mieux dterminer le point d'insertion de la sagesse pratique. Selon
les partisans d'un critre biologique de la prsence ou de l'absence
d'une personne humaine, personne et vie sont indissociables, dans
la mesure o celle-ci taye celle-l : or, dit l'argu-
1. C'est dans le mme esprit que devrait tre traites la question de l'acharne-
ment thrapeutique et celle de l'euthanasie passive, voire active.
2. Anne Fagot et Genevive Delaisi, Les droits de l'embryon , Revue de
mtaphysiqueet demorale, 1987, n 3, p. 361-387.
ment, le patrimoine gntique ou gnome qui signe l'individualit
biologique est constitu ds la conception . Sous la forme la plus
modre de la thse dite biologique, la consquence thique est la
suivante : le droit la vie de l'embryon est un droit une
chance de vie : dans le doute, il ne faut pas prendre le risque d'un
homicide. Cette notion de risque, accordons-le, fait entrer
l'argument biologique dans la rgion de la sagesse pratique,
comme il sera dit plus loin. C'est ce titre qu'il mrite d'tre
entendu, lorsqu'il conclut l'interdiction de toute pratique qui ne
sert pas les fins prsumes de l'embryon et du ftus, qui sont de
vivre et de se dvelopper. On peut toutefois se demander si la
sagesse pratique, sans perdre compltement de vue le critre bio-
logique, ne doit pas prendre en compte les phnomnes de seuil et
de stade qui mettent en question l'alternative simple de la personne
et de la chose. Seule l'ontologie substantialiste qui double
l'argument biologique empche que se dveloppe une ontologie du
dveloppement susceptible de situer le jugement prudentiel dans un
domaine typiquement intermdiaire . La distinction que nous
proposons tout au long de ces tudes entre l'identit-mmet et
l'identit-ipsit devrait nous autoriser, sinon ignorer l'argument
biologique, du moins le dissocier de l'ontologie substantialiste
sous-jacente.
La thse oppose appelle des remarques comparables : si l'on
attache l'ide de dignit aux seules capacits pleinement dvelop-
pes, telles que l'autonomie du vouloir, seuls les individus adultes,
cultivs, clairs, sont des personnes. A parler en toute rigueur,
les tres qui sont en de de la capacit d'autonomie " minimale ", la
communaut des personnes peut dcider de les protger (comme on
protge la nature), non de les respecter (comme on respecte
l'autonomie des personnes) (A. Fagot, ibid., p. 372). On ne voit
donc pas comment la thse purement morale
1. En fait, dans la discussion contemporaine, l'argument biologique sert de cau-
tion scientifique une conception ontologique de type substantialiste, elle-mme
lie des considrations thologiques sur le statut de crature de l'tre humain ;
ces considrations sont pour l'essentiel issues du dbat fort ancien portant sur le
moment d'infusion de l'me spirituelle dans l'tre humain. S'ajoute encore la
crainte que la matrise sur les phnomnes relatifs la vie et la mort n'institue
un rapport de toute-puissance sur l'humain, par quoi la technique trangresserait
son champ de lgitime matrise. Le mme argument, note A. Fagot, revt aussi
une forme thologique : Dieu seul est matre de la vie. En ce sens, le critre biolo-
gique fonctionne rarement seul. Cest pour les besoins de notre propre investiga-
tion que nous l'isolons : derrire la rigidit des principes poss, il y a donc une
vision tragique de la vie morale : quand l'homme substitue ses dcisions celles
de la nature, il ne peut que faire le mal (ibid., p. 370).
314
315
SOI-MMECOMMEUNAUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
du respect peut tre entendue dans le prsent dbat, si elle ne s'ac-
compagne pas, elle aussi, d'une ontologie minimum de dveloppement,
qui ajoute l'ide de capacit, relevant d'une logique du tout ou rien,
celle d'aptitude qui admet des degrs d'actualisation'.
Je me permettrai de suggrer que l'ontologie progressive souhaite
n'est peut-tre pas plus autonome l'gard de l'thique que les critres de
la personne et de la chose chez Kant. Certes, l'identification des seuils et
des degrs qui jalonnent l'apparition des proprits de l'tre personnel
relve de la seule science. Mais la teneur ontologique assigne au
prdicat potentiel , dans l'expression personne humaine potentielle
, n'est peut-tre pas sparable de la manire de traiter les tres
correspondant ces divers stades. Manire d'tre et manire de traiter
semblent devoir se dterminer conjointement dans la formation des
jugements prudentiels suscits par chaque avance du pouvoir que la
technique confre aujourd'hui l'homme sur la vie ses dbuts. Encore
une fois, si la science est seule habilite dcrire les seuils de
dveloppement, l'apprciation des droits et des devoirs relatifs chacun
d'eux relve d'une vritable invention morale qui ta-gera, selon une
progression comparable celle des seuils biologiques, des droits
qualitativement diffrents : droit de ne pas souffrir, droit la protection
(cette notion prsentant elle-mme des degrs de force ou d'
insistance ), droit au respect, ds lors que quelque chose comme une
relation mme asymtrique d'change de signes prverbaux s'esquisse
entre le ftus et sa mre. C'est ce va-et-vient entre description des seuils
et apprciation des droits et devoirs, dans la zone intermdiaire entre
chose et personne, qui justifie que Ton classe la bio-thique dans la zone
du jugement prudentiel. En effet, l'apprciation diffrencie et
progressive des droits de l'embryon, puis du ftus, aussi informe soit-elle
par la science du dveloppement, ventuellement enracine dans une
ontologie du dveloppement, ne peut manquer d'in-
1. voquant le point de vue pragmatique, en particulier britannique, selon
lequel la question de savoir comment l'embryon doit tre trait devrait s'affran-
chir de tout critre ontologique, A. Fagot observe : Nous croyons que ce qui se
cherche actuellement sous le couvert du pragmatisme est une thique fonde sur
une ontologie progressive, en accord avec l'intuition simple et commune que l'tre
embryonnaire est un tre en dveloppement et qu' l'gard d'une cellule vivante,
puis d'un ftus de cinq mois, puis d'un enfant de cinq ans, nos obligations
morales ne sauraient tre les mmes (ibid, p. 377). On rejoint ainsi la notion de
personne humaine potentielle invoque par le comit consultatif d'thique en
France et par d'autres commissions de sages ailleurs dans le monde.
corporer des estimations marques par le mme style de traditio-nalit
que les hritages culturels, arrachs leur sommeil dogmatique et
ouverts l'innovation. Dans ce jeu complexe entre science et sagesse, la
pese des risques encourus l'gard des gnrations futures ne peut
manquer de temprer les audaces que les prouesses techniques
encouragent. La crainte du pire, comme l'affirme avec force Hans Jonas
dans son principe responsabilit ' , est une composante ncessaire de
toutes les formes de la responsabilit trs long terme que demande
l'ge technique. En ce sens, la rticence, par exemple en matire de
manipulation des embryons surnumraires, n'est pas forcment
l'apanage des inconditionnels du droit la vie des embryons
humains. Elle fait partie de cette sagesse pratique requise par les
situations conflictuelles issues du respect lui-mme dans un domaine o
la dichotomie entre personne et chose est mise en droute.
La parent entre la part de sagesse pratique incorpore la biothique
et celle que nous avons plus facilement identifie dans l'orbe de la
promesse et dans les cas de conscience poss par la vie finissante se
marque la prsence des trois mmes traits dans les divers cas
considrs. Premirement, il est prudent de s'assurer que les positions
adverses se rclament du mme principe de respect et ne diffrent que
sur l'amplitude de son champ d'application, en particulier dans la zone
intermdiaire entre la chose et la personne moralement dveloppe.
Deuximement, la recherche du juste milieu - de la msots
aristotlicienne ! - parat tre de bon conseil, sans avoir valeur de
principe universel ; ainsi la dtermination de la priode de gestation
pendant laquelle l'avor-tement ne constitue pas un crime demande un
tact moral trs dvelopp. A cette occasion, il est bon de rappeler que le
juste milieu peut tre autre chose qu'un lche compromis, savoir
lui-mme un extrme
2
. D'une faon gnrale, les dcisions morales
les plus graves consistent tirer la ligne de partage entre le permis et le
dfendu dans les zones elles-mmes moyennes , rsistant des
dichotomies trop familires. Troisime trait de la sagesse pratique
commun tous nos exemples : l'arbitraire du
1. Hans Jonas, Dos Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik fur die
tech-nologischeZMlisation, Francfort, Insel Verlag, 1980.
2. c C'est pourquoi dans l'ordre de la substance et de la dfinition exprimant la
quiddit, la vertu est une mdit, tandis que, dans l'ordre de l'excellence et du
parfait, c'est un sommet (thique Nicomaque, trad. Tricot, II, 6, 1107 a 6-7).
Ce remarquable texte d'Aristote est rappel par Peter Kemp au terme de sa conf-
rence thique et technique ; bio-thique , prononce au palais de l'Europe
Strasbourg le 4 novembre 1988.
316 317
SOI-MMECOMMEUNAUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
jugement moral en situation est d'autant moindre que le dcideur -
en position ou non de lgislateur - a pris conseil des hommes et des
femmes rputs les plus comptents et les plus sages. La conviction
qui scelle la dcision bnficie alors du caractre pluriel du dbat.
Le phronimos n'est pas forcment un homme seul '. On peut bien
dire en conclusion que c'est la sollicitude, soucieuse de l'altrit
des personnes, y compris celle des personnes potentielles , que le
respect renvoie, dans les cas o il est lui-mme source de conflits,
en particulier dans les situations indites engendres par les
pouvoirs que la technique donne l'homme sur les phnomnes de
la vie. Mais ce n'est pas la sollicitude en quelque sorte nave de
notre septime tude, mais une sollicitude critique, qui a travers
la double preuve des conditions morales du respect et des conflits
suscits par ce dernier. Cette sollicitude critique est la forme que
prend la sagesse pratique dans la rgion des relations
interpersonnelles.
3. Autonomie et conflit
Notre parcours rebours nous reconduit au pied du bastion de la
morale, au sens kantien du terme : l'affirmation de l'autonomie, de
l'autolgislation, en tant que mta-critre de la moralit. Notre thse
selon laquelle c'est la moralit elle-mme qui, par les conflits qu'elle
suscite sur la base de ses propres prsuppositions, renvoie
l'affirmation thique la plus originaire, trouve ici son dernier point
d'application ; elle s'appuie sur des arguments spcifiques qui ont
t plusieurs fois ctoys ou mme anticips dans les deux sections
prcdentes et qu'il importe maintenant d'expliciter. Sous diverses
guises, ces arguments convergent vers un affrontement entre la
prtention universaliste attache aux rgles se rclamant du
principe de la moralit et la reconnaissance des valeurs positives
affrentes aux contextes historiques et communautaires
d'effectuation de ces mmes rgles. Ma thse est ici qu'il n'y aurait
pas place pour un tragique de l'action si la thse universaliste et la
thse contextualiste ne devaient pas tre maintenues chacune une
place qui reste dterminer, et si la mdia-
1. Citons encore : Ainsi donc, la vertu est une disposition agir de faon dli-
bre, consistant en une mdit relative nous, laquelle est rationnellement
dtermine et comme la dterminerait l'homme prudent [tephronimos] th.
Nie. 11,6, 1106 b 36).
tion pratique susceptible de surmonter l'antinomie n'tait pas
confie la sagesse pratique du jugement moral en situation.
Afin de donner toute sa force l'argument, il faut procder, mon
avis, une rvision tendue du formalisme kantien, dans le dessein
non de le rfuter, mais de mettre nu la prtention universaliste qui
en est le noyau dur et de donner ainsi toute sa force l'antagonisme
sur lequel se terminera notre investigation de l'ipsit morale.
Cette rvision se fera en trois temps. Dans un premier temps, il
faut remettre en question l'ordre de priorit accord par Kant au
principe d'autonomie par rapport au respect appliqu la pluralit
des personnes et au principe de justice pertinent au plan des
institutions. Dans la prcdente tude, nous avons admis titre
d'hypothse de travail la prsupposition non dite selon laquelle le
soi de l'autonomie peut et doit tre prserv de toute contamination
par quelque thse gologique que ce soit. Or toute la discussion qui
prcde - c'est l peut-tre l'avantage majeur de la dmarche
rebours de la prsente tude - tend suggrer que ce statut non
gologique, non monologique, et si l'on peut dire pr-dialogique du
soi autonome ne peut tre sauv qu'au terme d'une dmarche
rgressive partant de l'ide de justice, traversant le principe du
respect d aux personnes dans leur pluralit et dans leur altrit,
pour atteindre in fine le principe qui dit en tant que quoi la catgorie
des plus dfavoriss doit tre prise pour terme de rfrence de toute
distribution juste, et en tant que quoi le rcepteur de mon action - sa
victime potentielle - doit tre respecte l'gal de l'agent que je suis.
Il n'est pas douteux que cette lecture rebours, qui place
l'autonomie la fin et non au commencement de la rflexion
morale, renverse l'ordre mthodique prconis par les
Fondements...: de la forme (unit) la matire (pluralit) et
la dtermination complte (totalit)'. Or c'est le sens mme de
l'autonomie qui se trouve affect par ce renversement de l'ordre qui
la place en fin de parcours. Une approche de l'autonomie travers la
rgle de justice au plan des institutions et la rgle de rciprocit au
plan interpersonnel permet en effet de faire fructifier les apories
laisses en suspens au terme de notre prsentation du principe
kantien de la moralit. Trois lieux aportiques avaient t ainsi
dessins comme en creux par la fire affirmation du principe
d'autonomie. Ce fut, d'abord, l'occasion de la discussion portant
sur le fait de la
1. L'emploi ici du terme mthodique est celui de Kant dans la deuxime
section des Fondements... (d. Alqui, (IV, 436), p. 304).
318
319
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
raison , la reconnaissance d'une certaine rceptivit en vertu de
laquelle la libert est affecte par la loi mme qu'elle se donne, comme
si l'autoposition ne pouvait tre pense sans autoaffection ; ce fut,
ensuite, cette autre affection lie au respect entendu comme mobile, en
vertu de quoi la raison d'un tre fini, en affectant sa propre sensibilit, se
fait raison affecte, selon les modes opposs de l'humiliation et de
l'exaltation ; ce fut, enfin, cette affection radicale, radicale comme le
mal radical, la suite de quoi l'arbitre se trouve ds toujours soumis la
propension au mal, laquelle, sans dtruire notre disposition au bien,
affecte notre capacit agir par devoir.
En quoi l'approche rebours de l'autonomie que nous pratiquons ici
permet-elle de concilier l'ide d'autonomie avec ces marques de
rceptivit, de passivit et mme d'impuissance ? En ceci qu'une
autonomie solidaire de la rgle de justice et de la rgle de rciprocit ne
peut plus tre une autonomie autosuffisante. La dpendance selon l'
extriorit , lie la condition dialogique de l'autonomie, prend en
quelque sorte en charge la dpendance selon F intriorit que ces
trois apories ont rvle.
De cette rinterprtation du principe d'autorit rsulte la ncessit de
remettre en chantier l'opposition entre autonomie et ht-ronomie. Deux
ides diffrentes l'une de l'autre sont dsormais distinguer. La
premire, celle que Kant a en vue en parlant d'h-tronomie, ne se
distingue pas de l'tat de minorit que dnonce le pamphlet
Qu'est-ce que les Lumires? Cet tat de minorit consiste se laisser
mettre sous la tutelle d'autrui de telle faon que le propre jugement
dpende du jugement d'autrui ; par contraste avec cet tat, l'autonomie
prend son sens fort : savoir la responsabilit du jugement propre. Or
Kant n'a pas tenu compte de ce que cette prise de responsabilit est
solidaire de la rgle de rciprocit de la justice qui la place dans le mme
espace de pluralit o svit prcisment l'tat de minorit (en quoi l'au-
tonomie est autant un principe politique qu'un principe moral ; c'est un
principe politique que Kant a moralis). L'autonomie apparat ainsi
tributaire de l'htronomie, mais en un autre sens de l'autre : l'autre de la
libert sous la figure de la loi que pourtant la libert se donne, l'autre du
sentiment sous la figure du respect, l'autre du mal sous la figure du
penchant au mal. A son tour, cette triple altrit, intime au soi, rejoint
l'altrit proprement dialogique qui rend l'autonomie solidaire et
dpendante de la rgle de justice et de la rgle de rciprocit. L'ide
mme d'autrui bifurque selon deux directions opposes en corrlation
avec deux figures
du matre : l'un, le dominateur, ayant pour vis--vis l'esclave, l'autre, le
matre de justice, ayant pour vis--vis le disciple. C'est l' htronomie
de ce dernier qu'il faut intgrer l'autonomie, non pour l'affaiblir, mais
pour renforcer l'exhortation de Kant dans Qu'est-ce que les Lumires ? :
Sapere aude ! Ose apprendre, goter, savourer par toi-mme !
Dans un second temps, il faut remettre en question l'usage restrictif
que Kant fait du critre d'universalisation, par rapport auquel le
principe d'autonomie joue le rle de mta-critre (pour reprendre le
vocabulaire d'Otfried Hffe). Cet usage est restrictif en ce sens que, dans
l'exprience de pense propose l'occasion des fameux exemples ,
une maxime est dclare non morale si, leve par hypothse au rang de
rgle universelle, elle s'avre tre le sige d'une contradiction interne.
La maxime, dit Kant, se dtruit alors elle-mme.
Cette rduction de l'preuve d'universalisation la non-contradiction
donne une ide extraordinairement pauvre de la cohrence quoi peut
prtendre un systme de morale ; ds lors que l'on entreprend de driver
du principe le plus lev de la moralit - disons, du second impratif
catgorique - une pluralit de devoirs, la question n'est plus de savoir si
une maxime considre isolement se contredit ou non, mais si la
drivation exprime une certaine productivit de la pense tout en
prservant la cohrence de l'ensemble des rgles. La question que nous
soulevons ici ne nous gare pas dans une querelle acadmique, car les
conflits les plus significatifs que suscite la prtention l'universalit de la
morale naissent propos de devoirs prtendument drivs qui restent en
mme temps pris dans la gangue contextuelle d'une culture historique. Il
est donc ncessaire d'tre au clair sur la porte et la limite de la
cohrence des systmes de morale '.
1. Le problme se pose l'intrieur mme du kantisme, ds lors que l'on ne se
borne pas l'analyse spare des exemples , mais que l'on s'attache leur mode
de drivation. Celui-ci est esquiss ds les Fondements... et trait explicitement
dans la Mtaphysique des murs. En fait, on a peu prt attention au modle de
cohrence mis en jeu dans la Doctrinedela vertu, dont on a plutt soulign l'as-
pect ennuyeux, banal ou vieillot. Il est vrai que la double partition entre devoirs
stricts et devoirs larges, et entre devoirs envers soi-mme et devoirs envers autrui,
reprsente une classification plutt qu'une drivation, ce qui limite considrable-
ment l'intrt du trait. Il faut nanmoins prter attention l'authentique driva-
tion qui rsulte de la conjonction entre fin et devoir. Tout, dans la Doctrinedela
vertu, repose sur l'ide d'une fin qui est un devoir : Seule une fin qui est en
mme temps un devoir peut tre appele un devoir de vertu (Kant, Mta-
physique des murs, deuxime partie, Doctrine de la vertu, trad. fr. d'A.
Philo-nenko, Paris, Vrin, 1968, p. 53 ; cf. d. Alqui [VI, 383], p. 661). La pluralit
des devoirs procde ainsi de celle des fins susceptibles d'tre drives de la
personne
320
321
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
Une conception plus constructive de la cohrence est propose par le
raisonnement juridique. Chez les auteurs de langue anglaise, qu'ils
soient philosophes du droit ou de la morale, la souplesse et l'inventivit
que permet la common law sont toujours prises en compte'.
Prenons le cas dans lequel une plainte, par exemple une demande
en rparation fonde sur un droit lgal la vie prive (privacy) n'a fait
l'objet d'aucune dcision juridique antrieure. Dans ce cas et dans tous
les cas semblables - appels hard cases -, le juge examinera les
prcdents qui paraissent d'une manire ou d'une autre les plus pertinents
; sans y voir l'exemplification d'intuitions morales comparables des
vidences factuelles, il les traitera comme des spcifications d'un
principe qu'il reste construire et qui englobera prcdents et cas
insolites, au nom de la responsabilit du juge l'gard de la cohrence qui
a prvalu jusqu'alors. On voit dj poindre l'ide d'un conflit entre les
convictions raisonnables investies d'une part dans les prcdents, d'autre
part dans le cas insolite. Le juge peut, par exemple, penser qu'il est
injuste de punir une tentative de meurtre aussi svrement qu'un
meurtre effectivement perptr, et nanmoins prouver quelque
difficult accorder cette position avec son sentiment non moins
raisonn que la culpabilit de l'accus rside dans l'intention plutt que
dans l'action considre comme quelque chose qui seulement arrive. La
prsupposition est que toute conception de la justice requiert une
cohrence qui n'est pas seulement prserver mais construire. La
parent de cette prsupposition avec le critre kantien de
l'universalisation n'est pas douteuse, mais le caractre constructif de
sa mise en uvre est fort diffrent de l'usage kantien canonique : un
concept juridique est d'abord driv d'un groupe de cas apparents, puis il
est appliqu des cas nouveaux, jusqu' ce qu'un cas rebelle apparaisse
comme fin en elle-mme : Ces fins sont : ma perfection propre et le bonheur
d'autrui (trad. Philonenko, p. 56 : cf. d. Alqui [VI, 385], p. 664). Ici le concept
moral de fin en soi, applicable la seule personne, s'articule sur les concepts
tl-ologiques, dj voqus plus haut, reus de la Critiquedela facultdjuger. De
la pluralit de ces concepts tlologiques rsulte celle des devoirs : Aussi n'y
a-t-il qu'une seuleobligation de vertu, alors qu'il y a plusieurs devoirs de vertu.
C'est qu'il y a beaucoup d'objets qui sont pour nous des fins, telles qu'il est de
notre devoir de nous les proposer... (trad. Philonenko, p. 83 ; cf. d. Alqui [VI,
410], p. 696). On ne peut donc pas dire que le formalisme laisse la morale vide.
La question est de savoir si la multiplicit des devoirs forme systme : c'est de l
que part la discussion moderne sur la cohrence d'un systme moral.
1. Cf. R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 1977,
chap. iv, vi et vu.
comme un facteur de rupture qui demande la construction d'un
nouveau concept
1
.
Mais la cohrence d'un systme moral peut-elle tre celle d'un systme
juridique ? Les diffrences sont importantes. D'abord, la notion de
prcdents a un sens bien prcis dans le domaine juridique, dans la
mesure o il s'agit de verdicts prononcs par des cours de justice et
ayant force de loi aussi longtemps qu'ils n'ont pas t amends ou
abrogs ; ensuite, ce sont des instances publiques qui ont autorit pour
construire la nouvelle cohrence requise par les cas insolites ; enfin et
surtout, la responsabilit du juge l'gard de la cohrence exprime la
conviction, commune la socit considre, que la cohrence importe
au gouvernement des hommes. De ces traits propres aux systmes
juridiques, il rsulte qu'ils ne couvrent jamais que cette rgion des
rapports d'interaction o les conflits sont justiciables du verdict des
tribunaux. Aussi la question reste-t-elle entire de savoir si un systme
moral, qui n'a pas le support de l'institution juridique, est susceptible de
cohrence propre. Aussi bien la cohrence des systmes juridiques
renvoie-t-elle celle du systme moral, dans la mesure o l'on peut se
demander si le point de vue public qui est celui du juge, selon
Dworkin, a lui-mme un fondement moral.
A cet gard, la tentative la plus remarquable est celle d'Alan Donagan
dans The Theory of Morality. Celui-ci a entrepris de remettre sur le
mtier l'entreprise kantienne de drivation d'une pluralit de devoirs
partir de l'impratif du respect d aux personnes en tant qu'tres
rationnels, en tenant compte des ressources constructivistes du modle
juridique, mais en subordonnant comme Kant la lgalit la moralit. Je
retiendrai de la reconstruction de Donagan le rle qu'il assigne aux
prmisses additionnelles ou spcifiantes , en raison du rle qu'elles
joueront dans la discussion des objections que le contextualisme oppose
l'universalisme moral. Ces prmisses ont pour fonction de dlimiter
d'abord, de corriger ensuite, voire d'tendre, la classe des actions
laquelle l'impratif formel s'applique. Si la drivation a t
correctement mene, on doit pouvoir dire : nulle action de la sorte
[trad. de l'auteur] prise en tant que telle
1. Alan Donagan, TheTheoryof Morality, University of Chicago Press, 1977,
dveloppe un argument voisin de celui de Dworkin, qui s'appuie son tour sur les
travaux du grand juriste Edward H. Levi, lequel caractrise le mouvement de
va-et-vient entre le niveau du concept construit et celui o se tiennent prcdents
et cas rebelles comme circular motion (cit par Donagan, op. cit., p. 68).
322
323
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
ne manque au respect d tout tre humain en tant qu'tre rationnel
(Donagan, op. cit., p. 67). La tche de la philosophie morale est ici de
redfinir les classes d'action de manire que le contenu de la rgle soit
adquat la forme du principe. Un exemple peu contestable est fourni
par le cas de lgitime dfense : la rgle selon laquelle il est permis de tuer
si l'on est menac de mort, ou s'il n'existe pas d'autre moyen de
protger un tiers menac de mort, limite le champ d'application de
l'interdiction de tuer la classe du meurtre et de l'assassinat. L'exception
apparente l'impratif Tu ne tueras pas est ainsi place sous la
rgle prcise par la prmisse spcifiante.
On peut accorder Donagan que c'est une tche lgitime de la
philosophie morale de pousser aussi loin que possible la
reconstruction du systme moral le plus digne d'lever une prtention
l'universalit
1
. La cohrence d'un tel systme signifie trois choses :
d'abord, que le formalisme n'implique pas la vacuit : on peut
driver une pluralit de devoirs partir de l'unique impratif qui
commande de respecter toutes les personnes en tant qu'tres
raisonnables
2
; ensuite, que ces devoirs, bien que non drivables les uns
des autres, n'engendrent pas de situations telles que pour obir l'un il
faudrait dsobir l'autre, par exemple mentir pour ne pas tuer ou tuer
pour ne pas mentir
3
; enfin, que les rgles de drivation doivent tre
telles que les
1. Ce fut pendant des sicles la tche de la casuistique, qu'on peut tenir pour le
parallle au plan moral de la jurisprudence au plan lgal.
2. Kant, on l'a vu, le fait en prenant appui sur la pluralit des fins justifies par
le jugement rflchissant dans l'esprit de la Critiquedela facultdjuger.
3. En ce sens prcis, un conflit de devoirs est inconcevable si la rgle considre
est vraiment un devoir, c'est--dire si elle est correctement drive du principe.
Donagan (TheTheoryof Morality, op. cit., p. 1435g.) rappelle que saint Thomas
niait la possibilit de la perplexit simpliciter (qui correspondrait au cas o, pour
chapper une action mauvaise, il faudrait en commettre une autre galement
mauvaise) et n'admettait que la perplexit secundumquid, lie aux actions mri-
toires ayant pour condition une faute pralable. Kant ne dit pas autre chose : Un
conflit dedevoirs serait le rapport de ceux-ci, tel que l'un d'eux supprimerait
l'autre (tout entier ou en partie). Mais comme le devoir et l'obligation en gnral
sont des concepts, qui expriment la ncessit objective pratique de certaines
actions, et comme deux rgles opposes ne peuvent tre en mme temps nces-
saires, et que, si c'est un devoir d'agir suivant une rgle, non seulement ce ne peut
tre un devoir d'agir suivant l'autre rgle, mais cela serait mme contraire au
devoir : il s'ensuit qu'une collision desdevoirs et des obligations n'est pas pensable
[obltgationes non colliduntur] (Mtaphysique des murs, premire partie, Doc-
trinedu droit. Introduction gnrale, trad. Philonenko, p. 98 ; cf. d. Alqui [VI,
224], p. 471). On le voit, l'argument chez Kant est logique autant que moral :
deux rgles opposes ne pouvant tre en mme temps ncessaires... .
contenus soient en accord avec la rgle immdiatement suprieure'.
C'est ici que la diffrence entre systme moral et systme juridique
s'affirme. D'un ct, au lieu de prcdents dj dots d'un statut
juridique, on a le plus souvent affaire au plan moral des prmisses
spcifiantes non dites, et le plus souvent restrictives, qui marquent
l'immixtion des relations de domination et de violence, elles-mmes
institutionnalises, au cur des convictions morales tenues pour les plus
proches de la Rgle d'Or. En consquence, outre les procdures
d'interprtation constructive proches du raisonnement lgal, la
philosophie morale doit incorporer une critique acre des prjugs et
des rsidus idologiques son entreprise de reconstruction des prmisses
spcifiantes susceptibles d'assurer la cohrence fragile du systme moral.
C'est ici que le rationalisme recroise de faon inattendue la sagesse tra-
gique : le rtrcissement qui affecte la vision des grandeurs spirituelles
que les deux protagonistes de YAntigone de Sophocle sont censs
servir n'a-t-il pas pour quivalent, au plan de la thorie morale, un usage
pervers des prmisses spcifiantes qu'il revient une critique des
idologies de dmasquer
2
?
Il reste que c'est le plaidoyer pour Y universalit qui donne tout leur
poids aux problmes lis l'historicit de la morale concrte.
Une troisime rinterprtation de l'hritage kantien nous donne
une occasion nouvelle de faire paratre le tragique de l'action dans le
sillage de l'exigence d'universalit qui. en dernire instance, s'identifie
au moment de la moralit. Il s'agit de la reconstruction du formalisme
par K..-0. Apel et J. Habermas, sur
1. L'expression unformalized analytical reasoning revendique par Dona-
gan (op. cit., p. 72) pour sauvegarder la parent entre le raisonnement moral et le
raisonnement lgal tout en soulignant la spcificit du premier dsigne autant un
problme rsoudre qu'une solution absolument convaincante. L'auteur accorde
qu'il ne peut s'agir ici de preuve formelle, ds lors qu'un systme de devoirs ne
peut atteindre la rigueur d'un systme axiomatique. C'est pourquoi l'impossibi-
lit de la contradiction entre devoirs multiples excluant l'exception ne peut tre
formellement prouve ; on peut seulement dire que tous les contre-exemples sont
rfutables, ds lors que le systme moral a t construit avec rigueur et formul de
faon comptente.
2. C'est ici que les analyses anciennes de J. Habermas dans Connaissanceet
Intrt (trad. fr. de G. Clmenon, Paris, Gallimard, 1976) reprennent toute leur
force : entre discours, pouvoir (au sens de domination) et possession, les liens sont si
inextricables qu'une thrapeutique sociale des distorsions systmatiques du lan-
gage doit complter une simple hermneutique incapable de gurir par le seul dis-
cours la mcomprhension dans le discours.
324 325
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
la base d'une morale de la communication
1
. Ma thse est que cette
entreprise atteint son entire lgitimit si on la maintient sur le trajet de
la voie rgressive de la justification, laissant ainsi dcouvert la zone
conflictuelle situe sur le trajet progressif de X efjectuation
1
. Le
paradoxe est que le souci de justification des normes de l'activit
communicationnelle tend occulter les conflits qui reconduisent la
morale vers une sagesse pratique ayant pour site le jugement moral en
situation. C'est mon sens ce paradoxe qui explique la vivacit de la
controverse suscite par la morale de la communication : les avocats d'une
thique contex-tualiste et communautarienne
3
ne font qu'exalter, par
effet de compensation, les conflits que d'une certaine faon la morale de
la communication occulte. En revanche, je tiens que ces situations
conflictuelles seraient dpouilles de leur caractre dramatique si elles
ne se dtachaient pas sur l'arrire-plan d'une exigence d'universalit
laquelle la morale de la communication confre aujourd'hui son
expression la plus adquate.
Ce qui fait fondamentalement la force de la morale de la
communication, c'est d'avoir fusionn dans une seule problmatique les
trois impratifs kantiens : le principe d'autonomie selon la catgorie
d'unit, le principe du respect selon la catgorie de pluralit, et le
principe du royaume des fins selon la catgorie de totalit. Autrement dit
le soi est fond en une fois dans sa dimension d'universalit et dans sa
dimension dialogique, tant interpersonnelle qu'institutionnelle. Dans la
prsente tude, qui n'a pas d'autre dessein que de rendre raison de la
dimension morale de l'ipsit, on se bornera aux seuls aspects de
l'thique de la discussion qui ont trait cette fondation. C'est pourquoi
on ira droit l'argument central de Morale et Communication, dans la
troisime section de cet ouvrage
4
. Que cet argument prenne place sur le
trajet rgressif de la justification et de la fondation, l'ordre suivi par
l'argument l'atteste amplement. D'abord est mis en vidence le lien entre
l'entreprise fondationnelle et les exigences de
1. K.-O. Apcl, Sur leproblmed'unefondation rationnelledel'thique l'ge
dela science: l'a priori dela communautcommunicationnelleet les fondements
del'thique, trad. fr. de R. Lellouche et I. Mittmann, Presses Universitaires de
Lille, 1987. J. Habermas, Moraleet Communication : consciencemoraleet activit
communicationnelle(1983), trad. fr. de C. Bonchindhomme, Paris, d. du Cerf,
1986. J.-M. Ferry, Habermas. L'thiquedela communication, Paris, PUF, 1987,
chap. x, thique et communaut .
2. Sur la distinction entre trajet rgressif de la justification et trajet progressif
de l'effectuation, cf. ci-dessus, p. 307.
3. M. Walzer, M. Sandel, Ch. Taylor, A. Maclntyre.
4. Note problmatique pour fonder en raison une thique de la discussion
[Diskursethik] , Moraleet Communication, op. cit., p. 63-130.
validit que nous mettons lorsque nous produisons des actes de langage
supposant une norme (ou une rgle) (op. cit., p, 64). Ensuite est justifi
le recours la pragmatique formelle pour dgager ces exigences de
validit. Vient enfin la question que Habermas tient pour fondamentale,
savoir : Comment le principe d'universalisation qui est le seul pouvoir
rendre possible l'entente mutuelle par l'argumentation peut-il tre
lui-mme fond en raison ? (ibid., p. 65). C'est cette dernire
question que nous nous attacherons. Nous tiendrons donc pour acquises,
d'une part, la reconnaissance du lien entre attente normative et activit
communicationnelle ', d'autre part, la reconnaissance du lien entre
attente normative et validation par des raisons. Cela dit, l'important
pour nous rside dans la transformation que subit l'exigence de
cohrence du fait de son rattachement une thorie de Y argumentation,
qui ne soit rductible ni au raisonnement dductif ni la preuve
empirique. La logique de la discussion pratique tient ici la place
qu'occupait dans les pages prcdentes l'analyse des conditions de
cohrence des systmes moraux ; alors que celle-ci tait mene sans
gards pour la dimension dialogique du principe de la moralit, chez
Apel et Habermas la thorie de l'argumentation se dploie de bout en
bout dans le cadre de l'activit communicationnelle
2
. Habermas ne nie
point que ce soient les conflits de la vie quotidienne qui suscitent l'attente
normative investie dans la logique de la discussion pratique\ C'est mme
ce souci des argumentations rellement conduites entre participants
diffrents qui loigne Habermas de la fiction rawlsienne d'une situation
originelle et de la fable du contrat hypothtique (ibid., p. 87). La
discussion pratique est une discussion relle*. Ce ne
1. J'appelle communicationnelles les interactions dans lesquelles les partici-
pants sont d'accord pour coordonner en bonne intelligence leurs plans d'action ;
l'entente ainsi obtenue se trouve alors dtermine la mesure de la reconnais-
sance intersubjective des exigences de validit (ibid.. p. 79).
2. Vis--vis des jugements moraux, cette exigence de cohrence implique que
quiconque, avant d'invoquer une norme dfinie pour tayer son jugement, doit
vrifier s'il lui est possible d'exiger que n'importe qui dans une situation compa-
rable fasse appel la mme norme pour mettre un jugement (ibid., p. 85).
3. En entrant dans une argumentation morale, ceux qui y prennent part pour-
suivent, dans une attitude rflexive, leur activit communicationnelle afin de rta-
blir un consensus qui a t troubl. Les argumentations morales servent donc
rsorber dans le consensus des conflits ns dans l'action (ibid-, p. 88).
4. Dans un tel processus, chacun fournit l'autre des raisons par lesquelles il
peut souhaiter qu'une manire d'agir soit rendue socialement obligatoire. Chaque
personne concerne doit donc pouvoir se convaincre que la norme propose est
" galement bonne " pour tous. Or, ce processus, nous l'appelons discussion pra-
tique (ibid.. p. 92).
326 327
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
sont donc pas les conditions historiques d'effectuation de la discussion
pratique que Habermas prend en compte, mais la fondation en raison
du principe d'universalisation qui sous-tend l'thique de la
discussion. Ce qui le pousse, la suite de Apel, dans cette direction, ce
sont les objections que le sceptique oppose l'ide mme d'un accord
moral produit par voie argumentative. C'est par rapport ces objections
qu'il est fait recours aux prsuppositions pragmatiques de
l'argumentation en gnral pour fonder en raison les rgles
argumentatives du discours pratique. La tentative intervient exactement
au point o Kant s'arrte lorsqu'il nonce comme un fait de la raison
la conscience que nous prenons du caractre autolgislatif de la libert.
Chez Karl-Otto Apel, il ne s'agit de rien de moins que d'une fondation
ultime (letzte Begrundung). Celle-ci fait appel l'ide, inaccessible
Kant, de contradiction performative, qui permet de sauver
l'auto-rfrentialit propre l'argumentation transcendantale, de l'ac-
cusation bien connue soit de rgression l'infini, soit d'interruption
arbitraire de la chane de discours, soit de circularit dans
l'argumentation. La pragmatique transcendantale reprend ainsi, dans le
champ pratique, la dduction transcendantale kantienne, en montrant
comment le principe d'universalisation, faisant fonction de rgle
argumentative, est l'tat implicite dans les prsuppositions de
l'argumentation en gnral. La prsupposition d'une communaut
illimite de communication n'a pas d'autre rle que d'noncer, au
plan des prsuppositions, la parfaite congruence entre l'autonomie du
jugement de chacun et l'attente du consensus de toutes les personnes
concernes dans la discussion pratique.
Je ne m'engagerai pas dans la discussion ouverte entre Habermas et
Apel concernant cette prtention de fondation dernire, ultime tape sur
le trajet rgressif, auquel nous allons l'instant donner pour contrepartie
le trajet progressif de la norme son effectuation. Notons seulement que
l'ambition d'Apel est plus considrable que celle de Habermas pour qui
l'ide mme de fondation ultime remet en question le changement de
paradigme par quoi une philosophie du langage a pris le relais d'une
philosophie de la conscience. Le recours la contradiction performative,
pour Habermas, ne signifie pas plus que l'aveu qu'il n'existe pas de
principe de remplacement dans le cadre de la pratique argumentative,
sans que cette prsupposition transcendantale ait pour autant valeur de
justification dernire '. Je me bornerai dire que
1. En fait, dit Habermas, il n'y a aucun prjudice dnier la justification
pragmatico-transcendantale tout caractre de fondation ultime (ibid., p. 119).
c'est prcisment le renoncement l'ide de fondation ultime (que
l'hermneuticien confirmera par son insistance sur la fini-tude de la
comprhension) qui invite suivre le trajet inverse de celui de la
justification. Si en effet l'on admet avec Habermas lui-mme que les
intuitions morales quotidiennes n'ont nul besoin des lumires des
philosophes (ibid., p. 119) et que l'entreprise fondationnelle n'a en
dernire analyse qu'une fonction thrapeutique, au sens de
Wittgenstein, l'gard des contre-arguments sceptiques rigs en
idologie professionnelle (ibid.) - alors l'thique de la discussion ne
doit pas tre seulement l'enjeu d'une tentative de fondation par voie
rgressive de l'exigence d'universalisation, mais aussi celui d'une mise
l'preuve par voie progressive au plan de la pratique effective'.
Les pages qui prcdent n'avaient pas d'autre ambition que de porter
l'exigence d'universalit son plus haut degr de crdibilit et,
corollairement, de porter un niveau gal les objections tires du
caractre contextuel des ralisations de l'thique de discussion. Comme
nous l'avons maintes fois affirm, les conflits qui donnent crdit aux
thses contextualistes se rencontrent sur le trajet de l'effectuation plutt
que sur celui de la justification. Il importe d'tre au clair sur cette
diffrence de site, afin de ne pas confondre les arguments qui
soulignent l'historicit des choix faire sur ce second trajet avec les
arguments sceptiques qui s'adressent l'entreprise de fondation. Cette
remarque est de la plus grande importance pour la discussion de la
thse universaliste que nous tenons pour exemplaire, savoir celle de
l'thique de la discussion de Habermas.
Ce ne sont pas des conflits nouveaux, quant au contenu, que nous
allons faire paratre sous le titre du contextualisme. Ce sont ceux-l
mmes que nous avons croiss en discutant les conditions d'effectuation
de la rgle de justice, puis celles de la rgle de rci-
Cette rticence explique que Habermas puisse rechercher une corroboration
maeutique (ibid., p. 118) du ct de la thorie du dveloppement de la
conscience morale et juridique labore par Lawrence Kohlberg. Cet appui dans
une psycho-sociologie du dveloppement ne sera pas sans effet dans la discussion
qui suit, dans la mesure o le modle de dveloppement propos par Kohlberg
repose sur le progrs du prconventionnel au conventionnel et enfin au post-
conventionnel, stade ultime correspondant l'autonomie kantienne. On dira plus
loin les inconvnients attachs cette mthode de contrle .
1. Ce renversement de perspective ne laisse pas d'tre encourag par l'objection
faite par Habermas Rawls de substituer une argumentation conduite dans une
situation originelle hypothtique aux argumentations relles conduites entre per-
sonnes concernes.
328 329
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
procit. Mais, alors que nous avons jusqu'ici soulign l'quivocit, voire
l'indcidabilit, des situations auxquelles le jugement moral doit faire
face, c'est maintenant le caractre historiquement et culturellement
dtermin des estimations parmi lesquelles le jugement moral doit
s'orienter qui doit tre pris en compte.
Je rappelle la premire occurrence de cette perplexit ; c'tait
l'occasion de l'interprtation purement procdurale des principes de
justice chez Rawls - interprtation qui lgitimait le renvoi de toute
considration tlologique la conscience prive des partenaires du
pacte social. Le concept du juste pouvait ainsi tre entirement dtach
de celui du bon. Or, avec l'ide de biens sociaux premiers - ide
insparable de celle de distribution -, les concepts tlologiques sont
revenus en force, au point de faire clater l'ide unitaire de justice entre
une pluralit de sphres en fonction de la diversit des estimations qui
rgissent la signification attache aux biens considrs (citoyennet,
besoins, marchandises, position de responsabilit ou d'autorit, etc.).
Nous avons alors ajourn jusqu' maintenant le problme pos par le
caractre historique et communautaire de ces significations et de ces
estimations, pour nous concentrer sur le problme pos par la diversit
relle des biens concerns. C'est ce caractre historique et
communautaire qu'il faut maintenant faire passer au premier plan. Or
celui-ci n'atteint pas seulement la signification que revt, dans une
culture donne, chacun de ces biens pris sparment, mais l'ordre de
priorit chaque fois institu entre les sphres de justice et les biens
divers et potentiellement rivaux qui leur correspondent. En ce sens,
toute distribution, au sens large que nous avons attribu ce mot,
apparat problmatique : de fait, il n'existe pas de systme de
distribution universellement valable et tous les systmes connus
expriment des choix alatoires rvocables, lis des luttes qui jalonnent
l'histoire violente des socits.
Il n'est donc pas tonnant que la mme historicit affecte tous les
niveaux de la pratique politique, dans la mesure o celle-ci a prcisment
pour enjeu la distribution du pouvoir d'o dpend la priorit assigne
chaque fois entre les biens distribuer. D'un niveau l'autre de la
pratique politique - de celui du dbat politique institutionnalis dans les
dmocraties pluralistes celui de la discussion portant sur les fins du
bon gouvernement (scurit, prosprit, galit, solidarit, etc.), enfin
celui de la lgitimation de la dmocratie elle-mme - une
indtermination croissante des
fins poursuivies s'est affirme. C'est elle qui nous amne maintenant
souligner l'historicit des choix par lesquels les socits tranchent
pratiquement ces perplexits accumules
1
.
Si de la sphre politique on passe celle des relations inter-
personnelles, de nouvelles sources de conflits sont apparues, drivant
principalement de la scission entre respect de la loi et respect des
personnes. C'tait, dans ce nouveau cadre, la pluralit relle des
personnes plutt que celle des biens qui faisait problme, l'al-trit des
personnes s'opposant l'aspect unitaire du concept d'humanit. On a
insist cette occasion sur quelques cas de conscience
particulirement douloureux, ceux qui touchent la vie finissante
et ceux que suscite la vie commenante l'ge de la technique. Or
ces mmes cas de conscience peuvent tre reformuls en termes de
conflits entre l'exigence universelle, lie au principe du respect d aux
personnes en tant qu'tres rationnels, et la recherche ttonnante de
solutions - qu'on peut dire, en ce sens, historiques - que pose le
traitement d'tres qui ne satisfont plus ou pas encore au critre explicite
d'humanit qui fonde le respect
2
.
Ainsi toutes les discussions menes dans la premire et la deuxime
section de cette tude trouvent leur rplique et, dirait-on, leur point
focal de rflexion dans le conflit entre uni-versalisme et
contextualisme. Cette connexion n'a rien d'inattendu, dans la mesure
o l'exigence d'universalisation, attache au principe d'autonomie qui
dfinit en dernire instance l'ipsit morale, trouve son champ privilgi
de manifestation dans les relations interpersonnelles rgies par le
principe du respect d aux personnes et dans les institutions rgies par la
rgle de justice.
En reformulant sous la forme d'un dilemme entre universa-lisme et
contextualisme les conflits suscits par une conception procdurale de
la justice et par une conception abstraite de l'humanit commune
toutes les personnes, nous avons prpar le terrain pour une discussion
centre sur l'thique de l'argumentation.
1. On se rappelle cet gard la caractrisation par Claude Lefort de la dmocra-
tie comme socit historique par excellence (ci-dessus, p. 303, n. 2).
2. Bien que la discussion de ces cas de conscience touche au plus vif des rap-
ports de personne personne, elle recoupe la discussion prcdente concernant la
pratique politique, dans la mesure o les dcisions du plan interpersonnel
appellent bien souvent un encadrement juridique (concernant la
dcriminalisa-tion ou non des pratiques abortives, par exemple), mais aussi
politique (ne serait-ce que du point de vue de l'affectation des fonds publics aux
institutions de recherche, de protection sociale ou hospitalires).
330
331
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
Celle-ci peut faire valoir que tous les problmes voqus doivent
trouver leur solution par l'thique de l'argumentation, dans la mesure
o celle-ci est d'un rang suprieur la rgle de justice et la rgle du
respect dont les conflits voqus plus haut montrent les limites
d'application. L'adjudication de parts - de quelque nature qu'elle soit -
ne rsulte-t-elle pas finalement d'une confrontation d'arguments, et cela,
non pas seulement dans la situation originelle de la fable rawlsienne,
mais dans les discussions relles ayant pour enjeu la distribution juste de
quoi que ce soit ? On ajoutera : plus une conception de la justice se veut
strictement procdurale, plus elle s'en remet une thique
argu-mentative pour rsoudre les conflits qu'elle engendre. La situation
n'est-elle pas identique pour les cas de conscience suscits par le
principe du respect d aux personnes en tant qu'tres rationnels ? Par
exemple, le recours qui a t fait une ontologie dveloppementale pour
trancher la question de savoir si un ftus est une personne, une chose ou
une entit intermdiaire n'quivaut-il pas la recherche du meilleur
argument dans le dbat concernant les droits du ftus ? Et cette
recherche garde-t-elle un sens hors de la prsupposition des rquisits
universalistes qui justifient l'thique de l'argumentation ?
Je reconnais la force de la thse, et je l'adopte jusqu' un certain point
que je vais dire l'instant, rencontre d'un usage mon sens
dsastreux des objections contextualistes tires de l'observation de la
manire dont sont traits et rsolus les conflits dans des communauts
historiques diffrentes. On voit de nos jours ces objections portes au
crdit de la thse du caractre ulti-mement multiple des cultures , le
terme culture tant pris en un sens ethnographique, fort loign de
celui, venu des Lumires et dvelopp par Hegel, d'ducation la raison
et la libert. On aboutit ainsi une apologie de la diffrence pour la
diffrence qui, la limite, rend toutes les diffrences indiffrentes,
dans la mesure o elle rend vaine toute discussion'.
Ce que je critique dans l'thique de l'argumentation, ce n'est pas
l'invitation rechercher en toutes circonstances et en toutes discussions
le meilleur argument, mais la reconstruction sous ce titre d'une stratgie
d'puration, reprise de Kant, qui rend impensable la mdiation
contextuelle sans laquelle l'thique de la communication reste sans prise
relle sur la ralit. Kant dirigeait sa stratgie d'puration contre
l'inclination, la recherche du plai-
1. Je rejoins ici les craintes exprimes par Alain Finkielkraut dans La Dfaite
dela pense. Paris, Gallimard, 1987.
sir ou du bonheur (toutes modalits affectives confondues). Habermas
dirige la sienne contre tout ce qui peut tre plac sous le titre de
convention '. J'attribue ce rigorisme de l'argumentation l'interprtation
de la modernit en termes quasi exclusifs de rupture avec un pass
suppos fig dans des traditions soumises au principe d'autorit et donc
soustraites par principe la discussion publique. Cela explique que la
convention vienne occuper, dans une thique de l'argumentation, la
place tenue chez Kant par l'inclination. De cette faon, l'thique de
l'argumentation contribue l'impasse d'une opposition strile entre un
universalisme au moins aussi procdural que celui de Rawls et de
Dworkin et un relativisme culturel qui se met lui-mme hors du
champ de la discussion
2
.
Je voudrais suggrer, au terme de ce long priple, une reformulation de
l'thique de l'argumentation qui lui permettrait d'intgrer les
objections du contextualisme, en mme temps que celui-ci prendrait
au srieux l'exigence d'universalisation pour se concentrer sur les
conditions de mise en contexte de cette exigence (c'est pour cette
dernire raison que j'ai prfr le terme de contextualisme ceux
d'historicisme ou de communautarisme).
Ce qu'il faut mettre en question, c'est l'antagonisme entre argu-
1. A cet gard, le recours au modle de psychosociologie dveloppementale de
L. Kohlberg renforce l'antinomie entre argumentation et convention, dans la
mesure o l'chelle du dveloppement est jalonne par les stades prconvention-
nels, conventionnels et postconventionnels. Ainsi il est amusant d'observer que,
selon ce modle, la Rgle d'Or ressortit au modle conventionnel et que la rgle de
justice n'accde pas au niveau suprieur du stade postconventionnel.
2. La mme observation vaut pour l'usage toujours pjoratif que Habermas fait
de l'ide de tradition, dans le sillage d'une longue confrontation avec Gadamer.
J'ai propos ailleurs de distinguer trois usages du vocable tradition : le stylede
traditionalit, dont l'innovation est une composante en quelque sorte antago-
niste ; les traditions d'un peuple, d'une culture, d'une communaut, lesquelles
peuvent tre mortes ou vivantes; et la Tradition, en tant qu'autorit
anti-argumentative. C'est en ce dernier sens seulement que la croisade anti-
traditionaliste de l'thique de l'argumentation est recevable. On touche l, comme
propos de l'ide de convention, un point sensible de l'thique de l'argu-
mentation, savoir sa tendance survaluer la coupure de la modernit, ent-
riner la scularisation non seulement comme un fait mais comme une valeur, au
point d'exclure du champ de la discussion, de faon tacite ou dclare, quiconque
n'accepte pas comme une donne de dpart la profession nietzschenne de la
mort de Dieu . On oublie seulement que, sous le titre des Lumires, on peut
dsigner tantt un style de traditionalit que Koselleck a fort bien dcrit dans les
termes de ses catgories d'espace d'exprience et d'horizon d'attente (cf. Tempset
Rcit, op. cit., t. III, p. 301-313) ; tantt une tradition ou un groupe de traditions,
avec leurs arrire-plans culturels trs typs, comme Hegel dj en traite dans le
chapitre vi de la Phnomnologiedel'esprit ; et tantt une anti-Tradition, ce que
l'apologie des Lumires est effectivement devenue aprs Nietzsche.
332 333
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
mentation et convention et lui substituer une dialectique fine entre
argumentation et conviction, laquelle n'a pas d'issue thorique, mais
seulement l'issue pratique de l'arbitrage du jugement moral en
situation.
Pour entrer dans cette dialectique ardue, il est bon de rappeler que
l'argumentation, considre sur le trajet de l'effectuation, est un jeu de
langage, qui, hypostasi, cesse de correspondre aucune forme de vie,
sinon la professionnaiisation que Habermas lui-mme reproche aux
tenants des objections sceptiques sur le trajet rgressif de la justification
de l'thique de l'argumentation. Dans les discussions relles,
l'argumentation sous forme codifie, stylise, voire institutionnalise,
n'est qu'un segment abstrait dans un procs langagier qui met en uvre
un grand nombre de jeux de langage ayant eux aussi un rapport au choix
thique dans les cas de perplexit ; on recourt par exemple des rcits,
des histoires de vie, suscitant, selon les cas, l'admiration, voire la
vnration, ou le dgot, voire la rpulsion, ou plus simplement la
curiosit pour des expriences de pense o sont explors sur le mode de
la fiction des genres de vie indits
1
. Ces jeux de langage constituent
autant de pratiques communicationnelles o les humains apprennent
ce que signifie vouloir vivre en commun, et cela avant toute mise en
forme argumentative. Certes, l'argumentation n'est pas un jeu de
langage comme les autres, prcisment en raison de son exigence
d'universalisation. Mais cette exigence ne devient oprante que si elle
assume la mdiation des autres jeux de langage qui participent la
formation des options qui sont l'enjeu du dbat. Le but vis est alors
d'extraire des positions en situation de confrontation le meilleur
argument qui puisse tre offert aux protagonistes de la discussion. Mais
cette action corrective de l'thique de l'argumentation prsuppose que
l'on discute sur quelque chose, sur les choses de la vie
2
.
Et pourquoi l'argumentation doit-elle admettre cette mdiation
d'autres jeux de langage et assumer ce rle correctif l'gard de leur
capacit argumentative potentielle ? Prcisment parce que
l'argumentation ne se pose pas seulement comme antagoniste de la
tradition et de la convention, mais comme instance critique oprant au
sein de convictions qu'elle a pour tche non d'li-
1. Sur le rapport entre narrativit et thique, cf. ci-dessus, sixime tude, p.
193*9.
2. Cf. Rdiger Bubner, Moralit et Sittlichkeil - sur l'origine d'une opposi-
tion , Revueinternationaledephilosophie, n 3, 1988, Kant et la Raison pratique,
p. 341-360.
miner, mais de porter au rang de convictions bien peses, dans ce
que Rawls appelle un quilibre rflchi.
C'est un tel quilibre rflchi entre l'exigence d'universalit et la
reconnaissance des limitations contextuelles qui l'affectent qui est
l'enjeu final du jugement en situation dans le cadre des conflits
voqus plus haut.
Ce qui fait de la conviction un partenaire inliminable, c'est le fait
qu'elle exprime les prises de position d'o rsultent les significations, les
interprtations, les valuations relatives aux biens multiples qui
jalonnent l'chelle de la praxis, depuis les pratiques et leurs biens
immanents, en passant par les plans de vie, les histoires de vie, jusqu' la
conception que les humains se font, seuls ou en commun, de ce que
serait une vie accomplie. Car de quoi discute-t-on finalement, mme au
plan de la pratique politique o les biens concerns transcendent les
biens immanents aux pratiques diverses - par exemple dans le dbat sur
les fins du bon gouvernement et sur la lgitimit de la dmocratie -, oui,
de quoi discute-t-on finalement, sinon de la meilleure manire, pour
chaque partenaire du grand dbat, de viser, par-del les mdiations
institutionnelles, une vie accomplie avec et pour les autres, dans des
institutions justes ? L'articulation que nous ne cessons de renforcer entre
dontologie et tlologie trouve son expression la plus haute - et la plus
fragile - dans l'quilibre rflchi entre thique de l'argumentation et
convictions bien peses
1
.
Un exemple d'une telle dialectique fine nous est fourni par la
discussion actuelle sur les droits de l'homme. Pour l'essentiel, ceux-ci,
pris au niveau de textes dclaratifs et non proprement lgislatifs,
peuvent tre tenus pour des drivs bien argumentes de l'thique mme
de l'argumentation. Aussi bien ont-ils t ratifis par la quasi-unanimit
des tats : et pourtant le soupon demeure qu'ils sont seulement le fruit
de l'histoire culturelle propre l'Occident, avec ses guerres de religion,
son apprentissage laborieux et jamais termin de la tolrance. Tout se
passe comme si l'universalisme et le contextualisme se recouvraient
imparfaitement autour de valeurs peu nombreuses, mais fondamentales,
telles que celles qu'on lit dans la Dclaration universelle des droits de
l'homme et du citoyen. Mais, qu'en est-il des lgislations prcises qui
garantissent l'exercice de ces droits? Celles-ci sont bel et bien le produit
d'une histoire singulire qui
1. J'aime rappeler que conviction se dit en allemand Uberzeugung, terme
apparent par sa racine la Bezeugung qui signifie attestation. Attestation : mot
de passe de tout ce livre.
334 335
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
est en gros celle des dmocraties occidentales. Et, dans la mesure o les
valeurs produites dans cette histoire ne sont pas partages par d'autres
cultures, l'accusation d'ethnocentrisme rejaillit sur les textes dclaratifs
eux-mmes, pourtant ratifis par tous les gouvernements de la plante.
Il faut, mon avis, refuser cette drive, et assumer le paradoxe suivant :
d'une part, maintenir la prtention universelle attache quelques
valeurs o l'universel et l'historique se croisent, d'autre part offrir cette
prtention la discussion, non pas un niveau formel, mais au niveau
des convictions insres dans des formes de vie concrte. De cette
discussion il ne peut rien rsulter, si chaque partie prenante n'admet pas
que d'autres universels en puissance sont enfouis dans des cultures
tenues pour exotiques. La voie d'un consensus ventuel ne peut procder
que d'une reconnaissance mutuelle au plan de la recevabilit,
c'est--dire de l'admission d'une vrit possible, de propositions de
sens qui nous sont d'abord trangres.
Cette notion d'universels en contexte ou d'universels potentiels ou
inchoatifs est, mon avis, celle qui rend le mieux compte de l'quilibre
rflchi que nous cherchons entre universalit et historicit
1
. Seule une
discussion relle, o les convictions sont invites s'lever au-dessus
des conventions, pourra dire, au terme d'une longue histoire encore
venir, quels universels prtendus deviendront des universels reconnus
par toutes les personnes concernes (Habermas), c'est--dire
dsormais par les personnes reprsentatives (Rawls) de toutes les
cultures. A cet gard, un des visages de la sagesse pratique que nous
traquons tout au long de cette tude est cet art de la conversation o
l'thique de l'argumentation s'prouve dans le conflit des convictions.
1. L'expression valeur , dont on n'a pas fait usage jusqu' prsent, corres-
pond dans la discussion publique ces universels inchoatifs dont seule l'histoire
ultrieure du dialogue entre les cultures vrifiera la teneur morale vritable. En ce
sens, je tiens le quasi-concept de valeur pour un terme de compromis, au point o
se recroisent la prtention l'universalit et l'aveu d'historicit de certains devoirs
drivs auxquels correspond de la part d'autrui un droit d'exiger. En ce sens, la
notion de valeur n'est pas un concept moral vritable, mais un concept de
compromis, justifi par les cas o universalit et historicit se confortent mutuel-
lement plutt qu'elles ne se dissocient : condamnation de la torture, de la xno-
phobie, du racisme, de l'exploitation sexuelle des enfants ou des adultes non
consentants, etc. C'tait dj en ce sens mi-transcendantal, mi-empirique - mi-a
pnorique, rai-historique - que Jean Nabert prenait le terme de valeur dans ses
lments pour unethique(Paris, Montaigne, 1962), chap. vu, L'ascse par les
fins, p. 121-138.
Notre dernier mot, dans cette petite thique qui couvre les
septime, huitime et neuvime tudes, sera pour suggrer que la sagesse
pratique que nous recherchons vise concilier la phron-sis selon
Aristote, travers la Moralitt selon Kant, et la Sittlichkeit selon Hegel.
De la phronsis nous retenons qu'elle a pour horizon la vie bonne ,
pour mdiation la dlibration, pour acteur le phronimos et pour points
d'application les situations singulires '. Mais, si au terme de ces trois
tudes le cycle parat boucl, c'est, si l'on peut dire, une autre altitude
que nous passons au-dessus de notre point de dpart : entre la phronsis
nave de nos premires pages (septime tude) et la phronsis
critique de nos dernires pages, s'tend d'abord la rgion de l'obli-
gation morale, du devoir (huitime tude), qui demande que ne soit pas
ce qui ne doit pas tre, savoir le mal, et plus particulirement que
soient abolies les souffrances infliges l'homme par l'homme - et, au
sortir de cette rgion aride, celle des conflits relatifs au tragique de
l'action (neuvime tude). C'est ainsi que la phronsis critique tend,
travers ces mdiations, s'identifier la Sittlichkeit. Mais celle-ci est
dpouille de sa prtention marquer la victoire de l'Esprit sur les
contradictions que celui-ci se suscite lui-mme. Rduite la modestie,
la Sittlichkeit rejoint la phronsis dans le jugement moral en situation. En
retour, parce qu'elle a travers tant de mdiations et tant de conflits, la
phronsis du jugement moral en situation est l'abri de toute tentation
d'anomie. C'est travers le dbat public, le colloque amical, les
convictions partages, que le jugement moral en situation se forme. De
la sagesse pratique qui convient ce jugement, on peut dire que la
Sittlichkeit y rpte la phronsis, dans la mesure o la Sittlichkeit
mdiatise la phronsis.
Au terme des septime, huitime et neuvime tudes, il importe
de dsigner les dterminations nouvelles du soi qui s'ajoutent celle du
soi parlant, agissant et personnage-narrateur
1. Il nous plat de rappeler les grands textes du livre VI de Y thique
Nicomaquecits ci-dessus, p. 205-206. Au sommet de tous ces textes, nous pla-
ons celui qui identifie la phronsis au jugement moral en situation, en raison de
sa fonction singularisante comparable celle de l'intuition sensible (th. Nie, VI,
12, 1143 a 25 -b 13).
336
337
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
de sa propre histoire. Comme, en outre, ces tudes achvent le cycle
phnomnologique-hermneutique que composent ensemble les
neuf tudes qui trouvent leur aboutissement ici, il a paru appropri
de prendre pour guide les trois problmatiques fondamentales
nonces au dbut de la prface (p. 11-15) : dtour de la rflexion
sur le qui ? par l'analyse du quoi-pourquoi-comment?; concordance
et discordance entre l'identit-/em et lidentit-ipse ; dialectique du
soi et de l'autre que soi.
S'il est vrai que les quatre premires tudes donnent la priorit
la premire problmatique, et les deux suivantes la seconde, c'est
sur la troisime que nos tudes thico-morales mettent l'accent
principal. Toutefois, une relecture de ces tudes autorise dire
qu'elles ont fait progresser d'un mme pas les trois problmatiques.
C'est ce que nous allons maintenant montrer, en choisissant pour
chacune d'elles un terme emblmatique emprunt la philosophie
morale ancienne et moderne et que nos investigations permettent
peut-tre d'enrichir et de prciser.
De la premire problmatique relve en fait le dtour entier par
les dterminations des prdicats bon et obligatoire , dont les
articulations ponctuent le cours de ces trois tudes ; ce dtour
correspond celui par les structures de l'action et du rcit dans les
tudes antrieures ; les prdicats bon et obligatoire sont, en
effet, d'abord appliqus aux actions en tant que faites ou faire.
Nous avons amorc le mouvement du retour vers soi en faisant
correspondre l'estimation des buts de l'action l'estime d'un soi
capable de hirarchiser ses prfrences et d'agir en connaissance de
cause. Il manque nanmoins un terme pour marquer la corrlation
entre l'apprciation thique et morale des actions et les formes de
plus en plus complexes que revt l'estime de soi au cours des
dveloppements qui suivent la premire section de la septime
tude, o la notion d'estime de soi a t mise en place. Le terme
classique d'' imputabilit m'a paru rpondre cette requte, au prix
d'une ractualisation que nos investigations suggrent
1
. L'avantage
du choix de ce terme est qu'il permet de reprendre l'analyse de la
notion description au point o nous l'avons laisse la fin de la
quatrime tude, dont on se rappelle le tour aportique.
L'imputabilit, dirons-nous, c'est l'ascription de l'action son agent,
sous la condition des prdicats thiques et moraux qui qualifient
l'action comme bonne, juste, conforme au devoir, faite par devoir, et
finalement comme tant la plus sage dans le cas de situations
conflictuelles.
1. Nous avons rencontr une premire fois cette notion dans le cadre de la dis-
cussion de la troisime antinomie cosmologique, quatrime tude, p. 12S sq.
Que l'imputabilit s'inscrive dans le prolongement de l'ascription,
c'est ce que prsupposent les dfinitions comme celle du
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, publi nagure
par A. Lalande : Imputable, y lit-on, signifie primitivement : qui
peut tre mis au compte de telle personne. Seul caractriserait
l'imputabilit le rapport de l'acte l'agent, abstraction faite, d'une
part, de la valeur morale de celui-ci, et, d'autre part, des
rcompenses, chtiments ou dommages-intrts qui peuvent
s'ensuivre ' . En fait, cette dfinition n'ajoute rien ce que nous
avons appel ascription, et qui concerne la causalit spcifique de
l'agent de l'action. On comprend, certes, le souci des auteurs de cette
dfinition, qui tait de ne pas confondre imputer et incriminer
2
.
C'est le risque inverse qu'assumerait une dfinition de l'imputabilit
qui s'appuierait sur la distinction que propose A. Donagan
5
entre
deux sortes de prceptes moraux : les prceptes qu'il appelle
prceptes de premier ordre, et qui sont relatifs aux actions humaines
considres en tant qu'accomplissements (deeds), et les prceptes
dits de second ordre, qui sont relatifs aux tats d'esprit des agents.
Tandis que les premiers se dfinissent par rapport l'opposition
permis/non permis, les seconds le font par rapport l'opposition
coupable/non coupable
4
. Mais les
1. A. Lalande, Vocabulairetechniqueet critiquedela philosophie, Paris, PUF,
i960, p. 484.
2. Je laisse pour l'instant de ct la notion de comptedans l'expression porter
au compte ; j'y reviendrai dans le cadre de la seconde problmatique, celle de
l'ipsit et de la mmet.
3. A. Donagan, TheTheoryofMorality, op. cit., chap. iv.
4. Que les deux sortes de prceptes ne se recouvrent pas, est attest par les cas
o le non-permis n'entrane pas la culpabilit ; ce cas est celui o des excuses,
pralablement dfinies et reconnues, contribuent l'attnuation ou l'annulation
du jugement dclarant l'agent coupable. Inversement, l'intention d'un agent peut
tre condamne comme coupable, alors qu'aucune violation efliective d'une rgle
n'a t commise, un obstacle ayant empch que soit excute l'intention dlibre
de mal agir. On aperoit la richesse d'analyses que cette distinction entre prceptes
de premier ordre et prceptes de second or Jre tient en rserve. Aristote avait
ouvert la voie cette casuistique fort lgitime en introduisant la clause
d'ignorancecomme susceptible de faire tenir pour involontaires (ou faites malgr
soi), des actions pourtant choisies aprs dlibration (th. Nie, III, 2 ; trad. Tricot,
p. 122-126). Si une casuistique est ici mise enjeu, c'est parce que l'on doit dis-
tinguer entre ignorance portant sur les faits (le fils ne savait pas que l'homme qu'il
frappait tait son pre) et ignorance portant sur le droit (il ne savait pas qu'il est
mal de dshonorer son pre) ; or, si l'ignorance du droit constitue difficilement
une excuse, l'ignorance des faits n'est pas non plus toujours accepte comme
excuse : l'agent n'a peut-tre pas voulu savoir, ou a vit de s'informer, alors qu'il
le pouvait, etc. L'ide de ngligence coupable est d'une grande importante dans ce
genre de dbat, auquel les tragiques vnements de la Seconde Guerre mondiale
ont donn un cho fracassant...
338
339
SOI-MMECOMMEUN AUTRE LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
seconds comme les premiers prtendent l'universalit. Une dfinition
de Pimputabilit peut rsulter de cette distinction entre prceptes
objectifs et subjectifs ; sa fonction serait de coordonner les
catgories du permis/non permis et celle du coupable/non coupable.
Imputer serait non seulement porter une action au compte de quelqu'un,
mais encore porter une action, en tant que susceptible de tomber sous
la catgorie permis/non permis, au compte de quelqu'un susceptible
d'tre jug coupable/non coupable. Cette manire d'inscrire dans la
dfinition de l'imputabilit la distinction des deux sortes de prceptes,
en soulignant la subordination des prceptes de second ordre ceux de
premier ordre, se reflte dans les dfinitions plus populaires de l'imputa-
tion qui font rfrence au blme et la louange', expressions qui
combinent (et aux yeux de l'analyste confondent) les deux ordres de
prceptes : permis/non permis pour les actions, coupable/non coupable
pour les agents.
Il y a quelque chose de juste, mon avis, dans le souci de dissocier
l'imputabilit de l'incrimination - et aussi dans celui, en apparence
inverse, de faire rfrence au blme et la louange. La distinction que je
fais entre le plan thique et le plan moral ouvre la voie une dfinition
qui ferait droit aux deux scrupules. Les prceptes de Donagan relvent,
en effet, d'une thorie de la moralit, qui ignore la distinction qui rgit
nos trois tudes thico-morales : ainsi la Rgle d'Or y est d'emble
rinterprte dans les termes de l'impratif kantien.
Si l'on admet notre distinction, c'est au plan thique le plus profond
qu'il faut assigner le noyau formateur du concept de l'imputable. Nous
sommes ainsi renvoys l'estime de soi, mais en tant que mdiatise par
le parcours entier des dterminations du juste, du bon, de l'obligatoire,
du juste procdural, enfin du jugement moral en situation. A qui une
action est-elle alors imputable ? Au soi, en tant que capable de parcourir
le cours entier des dterminations thico-morales de l'action, cours au
terme duquel l'estime de soi devient conviction. Dans la conviction se
rencontrent les prceptes de premier ordre et les prceptes de second
1. Le Robert, au mot imputation, propose: 1" Action, fait d'imputer, de
mettre sur le compte de quelqu'un (une action blmable, une faute...) (p. 448).
Au mot imputer, il propose : I. Imputer : mettre (quelque chose) sur le compte
de quelqu'un ; 1" Attribuer ( quelqu'un) une chose digne de blme ; 2 Vx (langue
classique) : En bonne part : Attribuer ( quelqu'un) quelque chose de louable, de
favorable (p. 449). Aristote ne manque pas de faire rfrence au blme et la
louange dans une perspective thique o l'valuation des actions se rgle sur les
excellences reconnues dans l'ordre de l'agir humain.
ordre, selon Donagan, c'est--dire les objectivits thico-morales de
l'action et la subjectivit de l'agent qui fait retour sur soi partir de, et
travers, ces objectivits. C'est ce prix que l'imputation peut tre tenue
pour l'expression thico-morale de l'ascrip-tion d'une action un agent,
sans que l'incrimination soit tenue pour la forme canonique de
l'imputabilit. Il suffit que l'action et son agent apparaissent justiciables
conjointement de la louange et du blme. Mais c'est d'une certaine faon
la louange qui prend le pas sur le blme dans l'estime de soi.
Replaons maintenant nos considrations thico-morales dans la
perspective de la seconde problmatique dans laquelle la notion du
soi est engage par le rapport conflictuel entre ipsit et mmet. C'est le
concept de responsabilit, plus rcent, semble-t-il, que celui
d'imputabilit - du moins en philosophie morale -, qui va nous servir de
rfrence, tout en recevant, lui aussi, de nos analyses un enrichissement
et une prcision supplmentaires. Partons de ce qui fut l'enjeu dans
l'tude de l'identit narrative, savoir cette composante de l'identit qui
a rapport au temps, sous la guise de la permanence dans le temps. Nous
avons vu deux acceptions de cette catgorie s'affronter au plan narratif,
selon que le maintien de soi et la persistance empirique se recouvrent
ou se disjoignent. C'est la mme dialectique que la notion de res-
ponsabilit reprend et porte un degr plus avant.
Pour le montrer, dployons les relations entre responsabilit et
temporalit dans les trois directions que la temporalit implique. C'est
avec la troisime que le rapport entre ipsit et mmet rvle son
extrme complexit.
C'est sous l'angle du futur que notre rflexion engrne le plus aisment
sur celle du sens commun. Selon une de ses significations usuelles, la
responsabilit implique que quelqu'un assume les consquences de ses
actes, c'est--dire tienne certains vnements venir comme des
reprsentants de lui-mme, en dpit du fait qu'ils n'ont pas t
expressment prvus et voulus ; ces vnements sont son uvre, malgr
lui. Il est vrai que cette signification a pris corps, d'une part, dans le
cadre du droit civil, en rapport avec l'obligation de rparer les
dommages que l'on a causs par sa faute (ou dans certains autres cas
dtermins par la loi : responsabilit, par exemple, du propritaire ou du
gardien d'animaux), d'autre part, dans le cadre du droit pnal, en
rapport avec l'obligation de supporter le chtiment. Cette double
priorit du droit dans l'usage du concept de responsabilit n'empche pas
que l'on puisse attacher un sens moral, et non plus simplement
juridique,
340 341
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
LE SOI ET LA SAGESSE PRATIQUE
l'ide d'accepter ou de supporter les consquences de ses propres
actes, dans une mesure que l'on ne peut dterminer l'avance. C'est
sur cette base que H. Jonas a tent de reconstruire le principe
responsabilit ' , en prenant en compte les consquences longue
porte des dcisions de la puissance publique et aussi des citoyens
l'ge de la technique. Il pense ainsi susciter une rvolution dans
notre concept de responsabilit, en l'levant au rang d'un nouvel
impratif catgorique, celui d'agir de telle sorte qu'une humanit
future existe encore aprs nous, dans l'environnement d'une terre
habitable. 11 s'agit d'une rvolution, dans la mesure o, en mettant
l'accent sur les consquences de nos actes, le moraliste oriente le
regard en sens inverse de la recherche des intentions les plus
caches, comme y incline la notion d'imputabilit. La consquence
est paradoxale : avec cette dernire, il peut y avoir culpabilit sans
excution, sans effectua-tion ; avec la responsabilit, il peut y avoir
culpabilit sans intention ; la porte de nos actes, concept que nous
avons voqu plus haut, excde celle de nos projets.
Mais la notion de responsabilit a aussi une face tourne vers le
pass, dans la mesure o elle implique que nous assumions un pass
qui nous affecte sans qu'il soit entirement notre uvre, mais que
nous assumons comme ntre. L'ide de dette, qui a tenu une grande
place dans certaines de nos rflexions de Temps et Rcit III, relve
de cette dimension rtrospective de la responsabilit. Elle recevra
un dveloppement appropri dans la dixime tude, dans le cadre
d'une rflexion sur la passivit et l'altrit. Disons ds maintenant
que reconnatre son propre tre en dette l'gard de qui a fait que
l'on est ce qu'on est, c'est s'en tenir responsable.
Ces deux acceptions prospective et rtrospective de la respon-
sabilit se rejoignent et se recouvrent pour la responsabilit dans le
prsent. Mais ce prsent n'est pas Finstant-coupure, l'instant
ponctuel du temps chronologique. Il a l'paisseur que lui donne
prcisment la dialectique de la mmet et de l'ipsit, propos de
la permanence dans le temps. Se tenir responsable maintenant, c'est,
d'une manire qui reste prciser, accepter d'tre tenu pour le mme
aujourd'hui que celui qui a fait hier et qui fera demain. Comme dans
le cas de l'identit narrative sur laquelle l'identit morale prend
appui, les deux acceptions de l'identit entrent en concurrence : d'un
ct, un certaine continuit physique ou psy-
l. H. Jonas, Dos Prinzip Verantwortung, op. cit.
chologique, donc une certaine mmet, quoi nous avons identifi
plus haut le caractre, sous-tend la reconnaissance d'identit morale,
en particulier dans les cas de responsabilit qui intressent le droit
civil et le droit pnal ; d'un autre ct, il est des cas limites,
comparables aux puzzling cases de l'identit narrative, o
l'identification par les critres corporels ou psychologiques usuels
devient douteuse, au point que l'on en vient dire que l'inculp - s'il
s'agit de droit pnal - est devenu mconnaissable. C'est dans ces cas
limites que le maintien de soi, synonyme de ridentit-//we, est
seulement assum par un sujet moral qui demande tre tenu pour
le mme que cet autre qu'il parat tre devenu. Mais cette
responsabilit au prsent suppose que la responsabilit des
consquences venir et celle d'un pass l'gard duquel le soi se
reconnat endett soient intgres ce prsent non ponctuel et en
quelque sorte rcapitules en lui.
Ce maintien de soi-mme, irrductible toute persistance
empirique, contient peut-tre la cl du phnomne que nous avons
plus haut ctoy et mis l'cart, bien qu'il soit incorpor une
dfinition courante de l'imputation, savoir qu'imputer c'est mettre
quelque chose au compte de... Tout se passe comme si nos actes
s'inscrivaient dans un grand livre de comptes, pour y tre enregistrs
et y faire archive. Peut-tre cette mtaphore de l'inscription et de
l'enregistrement expnme-t-elle l'objectivation de ce que nous
venons d'appeler rcapitulation dans le prsent de la responsabilit
des consquences et de celle de l'endettement. Le maintien de soi,
ainsi objectiv dans l'image d'un enchanement de tous nos actes
hors de nous-mme, revt l'apparence d'un destin qui fait du Soi
l'ennemi de soi-mme
1
.
Je serai plus bref quant la contribution des trois dernires tudes
la dialectique du soi-mme et de l'autre que soi. D'une certaine
faon, celle-ci a t explicitement prsente tous les
dveloppements antrieurs. En outre, elle sera reprise dans la pro-
chaine tude au titre du Mme et de l'Autre. S'il fallait nanmoins
nommer la catgorie qui, au niveau de la troisime problmatique
mise en mouvement pour le retour sur soi, correspondrait aux
catgories prcdentes d'imputabilit et de responsabilit, je
choisirais le terme si cher Hegel dans la prio-
1 C'est ici qu'une confrontation avec la pense orientale sur l'enchanement des
actes dans le Kharma s'avrerait fructueuse, comme a commenc de le montrer T.
Hisashige dans Phnomnologie de la conscience de culpabilit. Essai de pathologie
thique, prsentation de P. Ricur, Tokyo, Presses de l'universit Senshu, 1983.
342
343
SOI-MME COMME UN AUTRE
de de Ina et dans tout le cours ultrieur de son oeuvre, celui de
reconnaissance. La reconnaissance est une structure du soi rflchissant
sur le mouvement qui emporte l'estime de soi vers la sollicitude et
celle-ci vers la justice. La reconnaissance introduit la dyade et la
pluralit dans la constitution mme du soi. La mutualit dans l'amiti,
l'galit proportionnelle dans la justice, en se rflchissant dans la
conscience de soi-mme, font de l'estime de soi elle-mme une figure de
la reconnaissance. Ce que nous dirons dans la prochaine tude sur la
conscience, au sens du Gewissen allemand, a ses racines dans ces
conjonctions du mme et de l'autre dans le for intrieur.
DIXIME TUDE
Vers quelle ontologie ?
Cette tude a, plus qu'aucune, un caractre exploratoire. Elle vise
porter au jour les implications ontologiques des investigations
antrieures places sous le titre d'une hermneutique du soi. Quel mode
d'tre est donc celui du soi, quelle sorte d'tant ou d'entit est-il ? Afin
de diviser la difficult et de lui appliquer la mthode fragmentaire qui a
t constamment la ntre, reprenons le schma des questions
proposes dans la prface. Selon ce schma, l'hermneutique est le lieu
d'articulation de trois problmatiques :
1) approche indirecte de la rflexion par le dtour de l'analyse ;
2) premire dtermination de l'ipsit par la voie de son contraste
avec la mmet ;
3) seconde dtermination de l'ipsit par la voie de sa dialectique
avec l'altrit.
On a pu donner le nom d'hermneutique cet enchanement, en
vertu de l'exacte quivalence entre Y interprtation de soi et le
dploiement de cette triple mdiation.
Il est vrai que la hirarchisation de ces trois problmatiques n'a pas t
le fil conducteur de nos tudes prcdentes, construites plutt sur une
certaine polysmie de la question qui ? (qui parle ? qui agit ? qui se
raconte ? qui est responsable ?). Toutefois, l'ordre suivi jusqu'ici n'a pas
t totalement tranger l'enchanement de ces trois mdiations :
l'articulation entre rflexion et analyse s'est en effet impose ds la
premire tude, et continment dans les suivantes ; la dialectique de
l'ipsit et de la mmet a pris nettement le pas dans la cinquime tude
; enfin, celle de l'ipsit et de l'altrit a rgn plus compltement sur les
trois dernires tudes. Ce sont ces trois problmatiques et ces trois
mdiations qui vont guider, dans l'ordre qu'on vient de dire, l'esquisse
ontologique qui suit. Leur entrecroisement final fera apparatre la
multiplicit des sens de l'tre qui se cachent derrire la question
initialement pose : quelle sorte d'tre est le soi ? A cet gard,
345
SOI-MME COMME UN AUTRE
VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
toute l'tude qui suit est domine par la conception polysmique de
l'tre reue de Platon et d'Aristote.
Une premire question pose concerne l'engagement ontologique
gnral de toutes nos tudes, et peut tre formule partir de la notion
d'attestation sur laquelle nous avons conclu notre prface. La seconde
question concerne la porte ontologique de la distinction entre ipsit et
mmet ; elle procde de la prcdente, dans la mesure o l'attestation
peut tre identifie l'assurance que chacun a d'exister comme un
mme au sens de l'ipsit. La troisime, de loin la plus complexe et la
plus englobante, puisqu'elle engage le titre mme de cet ouvrage,
concerne la structure dialectique spcifique du rapport entre ipsit et
altrit.
Or, la dialectique dans laquelle ces deux derniers termes s'opposent et
se composent relve d'un discours de second degr, qui rappelle celui
tenu par Platon dans le Thtte, le Sophiste, le Phi-lbe, le Parmnide ; ce
discours met en scne des mta-catgories, des grands genres, parents
du Mme et de l'Autre platoniciens, qui transcendent le discours de
premier degr auquel appartiennent encore des catgories ou des
existentiaux tels que personnes et choses, apparus ds notre premire
tude au titre des particuliers de base auxquels sont ultimement attribus
les prdicats tels que ceux d'action. A cet gard, nos trois dernires
tudes, en donnant un statut thique et non plus seulement
analytique-descriptif la distinction entre personne et chose, ne sont pas
sorties du cadre de ce discours de premier degr. Un traitement soigneux
de la mta-catgorie d'altrit, suscit par la troisime dialectique de
notre hermneutique du soi, nous contraindra distinguer nettement ce
discours de second degr des aspects plus manifestement
phnomnologiques de l'hermneutique du soi.
Mais c'est la troisime dialectique qui laisse le mieux apparatre la
dimension spculative d'une investigation de caractre ontologique
portant sur le mode d'tre du soi. Dernire raison de situer ds
maintenant les premires approches ontologiques dans la perspective de
la troisime : ni l'ipsit ni l'altrit, au sens o nous les prendrons, ne se
laisseront simplement reformuler dans le langage fig d'une ontologie
prte tre rpte, au sens le plus plat de la rptition. L'autre que soi
ne sera pas un quivalent strict de l'Autre platonicien, et notre ipsit
ne rptera pas le Mme platonicien. L'ontologie que nous esquissons ici
est fidle la suggestion faite dans notre prface, savoir qu'une
ontologie reste possible de nos jours, dans la mesure o les philosophies
du pass restent ouvertes des rinterprtations et des rappropria-
tions, la faveur d'un potentiel de sens laiss inemploy, voire rprim,
par le processus mme de systmatisation et de scolarisation auquel
nous devons les grands corps doctrinaux que nous identifions
d'ordinaire par leurs matres d'oeuvre : Platon, Aris-tote, Descartes,
Spinoza, Leibniz, etc. A vrai dire, si l'on ne pouvait rveiller, librer ces
ressources que les grands systmes du pass tendent touffer et
masquer, nulle innovation ne serait possible, et la pense au prsent
n'aurait le choix qu'entre la rptition et l'errance. Cette position de
principe concernant les rapports entre la philosophie se faisant et
l'histoire de la philosophie est rapprocher de ce que nous avons dit
ailleurs - dans La Mtaphore vive et dans Temps et Rcit - sur les rapports
entre tradition et innovation. Mais la mise en uvre de cette maxime est
particulirement prilleuse au niveau des grands genres tels que le
Mme et l'Autre, dont l'histoire est pour le moins intimidante ; on ne
va pas tarder s'apercevoir que l'engagement ontologique de
l'attestation et la porte ontologique de l'ipsit en tant que telle ne
rendent pas plus facile notre confrontation avec la tradition.
1. L'engagement ontologique de l'attestation
Nous commenons notre investigation ontologique au point o notre
prface s'est arrte. L'loge que nous avons fait alors de l'attestation en
tant que crance et que confiance tait destin faire pice la fois
l'ambition de certitude autofondatrice issue du Cogito cartsien et
l'humiliation du Cogito rduit l'illusion la suite de la critique
nietzschenne. C'est donc par rapport la querelle du Cogito que notre
premire approche de l'attestation restait situe. Or les tudes qui
constituent le corps de cet ouvrage se sont droules en un lieu que nous
avons pu dire atopos par rapport celui de la position du Cogito, et donc
aussi par rapport celui de sa dposition. C'est pourquoi nous ne
pouvons nous borner la caractrisation que nous avons faite en
commenant de l'attestation en termes de certitude ; ou plutt, en
caractrisant l'attestation du point de vue althique (ou vritatif), nous
avons dj engag, sans le dire, un autre dbat que celui qu'on pourrait
dire purement pistmique, s'il s'y agissait seulement de situer
l'attestation sur une chelle du savoir. Or la caractrisation althique de
l'attestation ne se borne pas une telle dtermination pistmique. Si
l'on accepte de prendre pour guide la polysmie
346
347
SOI-MMECOMMEUNAUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
de l'tre ou plutt de l'tant - qu'Aristote nonce en Mtaphysique E
2, Y tre-vrai et Ytre-faux sont des significations originaires de l'tre,
distinctes et, semble-t-il, de mme rang que l'tre selon les catgories,
que l'tre en puissance et en acte et que l'tre par accident . C'est sous le
signe de l'tre comme vrai que nous rassemblons toutes nos remarques
antrieures sur l'attestation comme crance et comme fiance. Est-ce
dire que la mta-catgorie de l'tre-vrai et de l'tre-faux puisse tre
rpte dans les termes o Aristote l'a une premire fois formule ? C'est
ici la premire occasion de mettre l'preuve notre hypothse de travail
concernant le lien entre innovation et tradition dans la pense
d'aujourd'hui.
L'attestation, en effet, a pour premier vis--vis l'articulation de la
rflexion sur l'analyse, au sens fort que la philosophie analytique a donn
cette notion. C'est l'tre-vrai de la mdiation de la rflexion par
l'analyse qui, titre premier, est attest. Cette situation est bien des
gards sans prcdent. Or, le paradoxe principal consiste en ceci que c'est
le passage par l'analyse, que d'autres auteurs auraient appel
objectivation, en un sens volontiers critique, qui impose au procs entier
un tour raliste. A cet gard, je veux rendre justice la philosophie
analytique pour l'appui que ne cesse d'y trouver mon esquisse
ontologique. Notre toute premire dmarche, en compagnie de Strawson,
a t encourage par l'exigence rfrentielle de la smantique frgenne ;
ainsi le discours tenu sur les corps et les personnes en tant que
particuliers de base est-il d'emble un discours sur... : la personne est
d'abord celle dont on parle ; ce penchant raliste de la philosophie analy-
tique fait ds le dbut srieusement contrepoids aux deux tendances,
respectivement idaliste et phnomniste, issues de Descartes et de
Hume. Par la suite, l'accent raliste mis par Davidson sur la notion
d'vnement, place sur un pied d'galit avec les entits objectives ou
substantielles, m'a t d'un grand renfort, mme si je ne peux suivre
Davidson sur le terrain du physica-lisme vers lequel son ontologie de
l'vnement est finalement entrane. J'en dirai autant de la recherche de
critres objectifs de l'identit personnelle chez Parfit. A son tour, la
notion d'identit
1. Aristote, MtaphysiqueE 2, 1026 a 22 - 1026 b 2 : L'tre proprement dit se
prend en plusieurs acceptions : nous avons vu [A 7] qu'il y avait d'abord l'tre par
accident, ensuite l'tre comme vrai auquel le faux s'oppose comme non-tre ; en
outre il y a les types de catgories, savoir la substance, la qualit, la quantit, le
lieu, le temps, et tous autres modes de signification analogues de l'tre. Enfin il y
a, en dehors de toutes ces sortes d'tres, l'tre en puissance et l'tre en acte (trad.
Tricot, p. 335).
narrative aussi nourrie soit-elle de fiction, doit son rapport -mme
conflictuel - avec celle d'identit personnelle des philosophes
analytiques un sens aigu de la porte ontologique des affirmations sur le
soi, fortement mdiatises par les analyses de Strawson, de Davidson et
de Parfit, pour ne nommer que ceux avec lesquels j'ai tent le plus
systmatiquement de confronter l'hermneutique d'origine
phnomnologique.
Mais le service rendu est rciproque : l'attestation qu'il en est bien
ainsi du soi rejaillit sur l'analyse elle-mme et la met l'abri de
l'accusation selon laquelle elle se bornerait, en raison de sa constitution
linguistique, expliciter les idiotismes de telle ou telle langue naturelle,
ou, pire, les fausses vidences du sens commun. Certes, nous avons
russi assez souvent distinguer, l'intrieur mme du langage
ordinaire, entre des usages contingents lis la constitution particulire
d'une langue naturelle donne et les significations qu'on peut dire
transcendantales, en ce sens qu'elles sont la condition de possibilit de
l'usage des premires. Mais cette distinction toute kantienne entre
transcendan-tal et empirique reste difficile tablir et maintenir, si ne
peut tre affirme la dpendance des dterminations langagires de
l'agir l'gard de la constitution ontologique de cet agir. En ce sens, le
renfort que l'attestation apporte en retour l'analyse linguistique justifie
que celle-ci puisse, tour tour, se prvaloir des usages les plus pertinents
du langage ordinaire, en tant que thsaurus des expressions qui touchent
le plus juste au but - comme le notait Austin - et s'autoriser critiquer le
langage ordinaire en tant que dpt des prjugs du sens commun, voire
des expressions qu'une grammaire trompeuse inclinerait vers une
mauvaise ontologie, comme le suspectait Russell.
Ce n'est pas l le seul service que l'ontologie implicite l'her-
mneutique rend l'analyse linguistique. Celle-ci peut tre accuse
d'un dfaut plus grave que sa dpendance des usages contingents d'une
langue naturelle donne ; paradoxalement, le linguistic turn, en dpit de
la tournure rfrentielle de la smantique philosophique, a bien souvent
signifi un refus de sortir du langage et une mfiance gale celle du
structuralisme franais l'gard de tout l'ordre extralinguistique. Il est
mme important de souligner que l'axiome implicite selon lequel tout
est langage a conduit bien souvent un smantisme clos, incapable de
rendre compte de l'agir humain comme arrivant effectivement dans le
monde, comme si l'analyse linguistique condamnait sauter d'un jeu de
langage dans l'autre, sans que la pense puisse
348 349
SOI-MME COMMEUN AUTRE
jamais rejoindre un faire effectif. A cet gard, une phnomnologie
comme celle de Husserl, selon laquelle la couche du langage est
inefficace par rapport la vie de la conscience intentionnelle, a
valeur de correctif, en vertu mme de son outrance
inverse
1
.
C'est finalement du chiasme entre rflexion et analyse, au plan
mme du mode d'tre du soi, que l'attestation tmoigne.
Je retrouve ici la sorte de vhmence ontologique dont il m'est
arriv ailleurs de me faire l'avocat, au nom de la conviction selon
laquelle, mme dans les usages en apparence les moins rfren-tiels
du langage, comme c'est le cas avec la mtaphore et la fiction
narrative, le langage dit encore l'tre, mme si cette vise ontolo-
gique se trouve comme ajourne, diffre par le dni pralable de la
rfrentialit littrale du langage ordinaire.
Mais, si par tous ces traits la dimension althique (vritative) de
l'attestation s'inscrit bien dans le prolongement de l'tre-vrai
aristotlicien, l'attestation garde son gard quelque chose de
spcifique, du seul fait que ce dont elle dit l'tre-vrai, c'est le soi ; et
elle le fait travers les mdiations objectivantes du langage, de
l'action, du rcit, des prdicats thiques et moraux de l'action. C'est
pourquoi il n'est pas possible de rpter purement et simplement la
distinction aristotlicienne entre tre-vrai et tre-faux, tant celle-ci
reste doublement prisonnire, d'une part de la prminence
prsume du jugement assertif, de Yapophansis, dans l'ordre
vritatif, et d'autre part d'une mtaphysique dont la rappropriation
est, sinon impossible, du moins extrmement difficile et risque. On
en dira quelque chose plus loin.
Je voudrais marquer par un seul trait diffrentiel l'cart qui spare
l'tre-vrai selon l'attestation de l'tre-vrai selon la mtaphysique
d'Aristote. L'attestation, a-t-il t dit ds la prface, a pour contraire
le soupon. En ce sens, le soupon occupe la place de l'tre-faux
dans la paire aristotlicienne. Mais, si le soupon appartient bien au
mme plan althique que l'attestation - donc un plan la fois
pistmique et ontologique -, il se rapporte l'attestation d'une
faon tout fait originale. Il n'est pas simplement son contraire, en
un sens purement disjonctif, comme l'tre-faux l'est par rapport
l'tre-vrai. Le soupon est aussi le chemin vers
1. On trouvera dans la thse encore indite de Jean-Luc Petit (op. cit.) une
apprciation trs critique du smantisme clos qu'il attribue Wittgenstein et dont
toute l'cole post-wittgensteinienne n'aurait pas russi se dgager, naviguant de
phrase en phrase sans retrouver jamais la terre ferme d'un agir effectif. Seule,
selon lui, une phnomnologie de la conscience intentionnelle, considre dans sa
dimension pratique, en relation avec un monde lui-mme praticable, pourrait
soustraire l'analyse linguistique ce smantisme clos.
VERSQUELLEONTOLOGIE?
et la traverse dans l'attestation. Il hante l'attestation, comme le faux
tmoignage hante le tmoignage vrai. Cette adhrence, cette
inhrence du soupon l'attestation a marqu tout le cours de nos
tudes. Ainsi le soupon s'est-il insinu ds la toute premire
occurrence de l'apode de l'ascription ; il a repris vigueur avec les
apories de l'identit personnelle, et encore avec celles de l'identit
narrative ; il a revtu une forme plus insidieuse sous la guise des
hsitations qui ponctuent la conviction dans le jugement moral en
situation, confront aux conflits de devoirs. Une sorte inquitante
d'quilibre entre attestation et soupon s'est ainsi impose, toutes les
fois que la certitude du soi a d se rfugier dans la retraite
inexpugnable de la question qui ?
Il parat alors difficile d'avancer davantage sur la voie de l'en-
gagement ontologique de l'attestation si l'on ne prcise pas sans
tarder que ce qui est attest titre ultime, c'est l'ipsit, la fois dans
sa diffrence l'gard de la mmet et dans son rapport dialectique
avec Yaltrit.
2. Ipsit et ontologie
Comme il vient d'tre suggr, l'attestation est l'assurance - la
crance et la fiance - d'exister sur le mode de l'ipsit. En exposant
ainsi l'enjeu ontologique de l'ipsit, nous ajoutons Une dimension
nouvelle l'ontologie que notre hermneutique du soi appelle dans
son sillage.
Une voie mrite d'tre explore, mme si les difficults y
paraissent plus intraitables que celles rencontres dans la section
prcdente : cette voie relie l'investigation de l'tre du soi la
rappropriation de celle des quatre acceptions primitives de l'tre
qu'Aristote place sous la distinction de Y acte et de la puissance.
Toutes nos analyses invitent cette exploration, dans la mesure
o elles font signe en direction d'une certaine unit de l'agir humain
- rserve tant faite du thme complmentaire du souffrir auquel
nous viendrons dans la section suivante. Cette unit ne
relverait-elle pas de la mta-catgorie de l'tre comme acte et
comme puissance ? Et l'appartenance ontologique de cette
mta-catgorie ne prserve-t-elle pas ce que nous avons appel
plusieurs fois l'unit analogique de l'agir, pour marquer la place de
la polysmie de l'action et de l'homme agissant que souligne le
caractre fragmentaire de nos tudes ? Mieux : n'avons-nous pas, au
cours de nos investigations, tenu bien souvent le terme acte
350
351
SOI-MMECOMMEUNAUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
(acte de discours !) pour synonyme des termes agir et action?
Et n'avons-nous pas, dans les mmes contextes, recouru au terme de
puissance pour dire soit la puissance d'agir de l'agent qui une action
est ascrite ou impute, soit le pouvoir de l'agent sur le patient de son
action (pouvoir-sur, qui est l'occasion de la violence sous toutes ses
formes), soit le pouvoir-en-commun d'une communaut historique
que nous tenons pour plus fondamental que les rapports hirarchiques
de domination entre gouvernants et gouverns ? Bref, le langage de l'acte
et de la puissance n'a cess de sous-tendre notre phnomnologie herm-
neutique de l'homme agissant. Ces anticipations justifient-elles que
nous rattachions l'unit seulement analogique de l'agir humain une
ontologie de l'tre et de la puissance ?
1. Autant la tche parat justifie dans son principe par la pluralit des
acceptions de l'tre qui semblent ouvrir une carrire autonome aux
ides d'acte et de puissance, autant son excution se heurte des
difficults si considrables qu'elles rendent fort aventureuses aussi bien
notre tentative de ractualisation de l'ontologie aristotlicienne que
celles de nos contemporains que j'voquerai le moment venu.
C'est en Mtaphysique A 12 et en 6 1-10, o il est explicitement trait
de la dunamis et de Vnergia, que les rsistances une rappropriation
au bnfice d'une ontologie de l'ipsit s'accumulent. A 12, qui traite de
la dunamis et de notions apparentes, dans le cadre d'un livre en forme
de glossaire philosophique, confronte d'emble le lecteur avec la
polysmie d'un terme dont nous attendions qu'il sous-tende l'unit
analogique de l'agir. Il y a bien dans cette polysmie une signification
dominante (quelquefois appele simple), savoir le principe du
mouvement ou du changement qui est dans un autre tre ou dans le
mme tre en tant qu'autre (Met. A 12, 1019 a 15^., trad. Tricot, p.
283-284) '. Mais, outre que le rapport de la puissance l'acte n'est pas
pris en considration, la place de la praxis humaine par rapport
1. Les autres significations de la dunamis n'induisent pas, il est vrai, de trop
grands carts dans l'usage du terme : qu'il s'agisse de la puissance activede pro-
duire changement ou mouvement, de la puissance passivede les recevoir ou de les
subir, ou de la facult de mener quelque chose bonne fin ou de l'accomplir
librement. En outre, les significations multiples de puissant, capable
(dunaton), correspondent assez bien celles de la dunamis. Seul l'impossible (ce
dont le contraire est ncessairement faux) et le possible (ce dont le contraire n'est
pas ncessairement faux) conduisent sur un terrain connexe mais diffrent, la
frontire du logiquement possible et de l'ontologiquement possible.
au changement fait immdiatement problme, les exemples donns - art
de construire, art de gurir - penchant du ct de la poi-sis, tandis que
bien faire (sens n 3 qui reviendra en 6 2) se dit plus volontiers de la
praxis.
Si l'on passe de cet exercice de dfinition au traitement systmatique
de la paire dunamis-nergia en Met. 6, les perplexits s'accumulent.
D'abord, il semble bien que les deux termes se dfinissent l'un par
l'autre, sans que l'on puisse arrter le sens de l'un indpendamment de
l'autre, sous peine que la polysmie reconnue en A 12 ne les voue
sparment la dispersion. Mais, peut-on dfinir des notions que rien
ne prcde ' ?
En outre, Aristote est moins avare de mots lorsqu'il s'agit de montrer
ce que ces notions radicales permettent de penser. Une autre dispersion
prvaut alors, celle des champs d'application. Ainsi l'tre en tant que
puissance (par quoi on commence en 0 1-5) permet d'inscrire dans
l'tre, rencontre de l'interdit de Par-mnide. le changement et plus
prcisment le mouvement local. Parce que la puissance est un vritable
mode d'tre, le changement et le mouvement sont des tres de plein
droit. Mais, si l'on demande quelle sorte d'tre le mouvement est, on est
renvoy la troublante dfinition du mouvement selon Physique III,
1,201 a 10-11, savoir Tentlchie de ce qui est en puissance en tant
que tel (op. cit., trad. H. Carteron, Paris, Les Belles Lettres, 1961).
On peroit bien l'intention : assurer au mouvement un statut ontologique
part entire ; mais au prix de quelle bizarrerie : l'entlchie de la
puissance ! Voil pour le premier champ d'application, celui de l'tre
comme puissance.
1. Le livre 6 commence par l'ide de puissance dans son rapport au mouve-
ment et n'introduit l'acte qu'en 0 6 : L'acte, donc, est le fait pour une chose
d'exister en ralit et non de la faon dont nous disons qu'elle existe en puissance,
quand nous disons par exemple qu'Herms est en puissance dans le bois, ou la
demi-ligne dans la ligne entire parce qu'elle en pourrait tre tire, ou quand nous
appelons savant en puissance celui qui mme ne spcule pas, s'il a la facult de
spculer : eh bien ! l'autre faon d'exister est l'existence en acte (Mi. 6 6, 1048
a 30 ; trad. Tricot, p. 499). A la circularit apparente, s'ajoute, faute de dfinition
directe, le recours l'induction et l'analogie : La notion d'acte que nous propo-
sons peut tre lucide par l'induction, l'aide d'exemples particuliers, sans qu'on
doive chercher tout dfinir, mais en se contentant d'apercevoir l'analogie : l'acte
sera alors comme l'tre qui btit est l'tre qui a la facult de btir, l'tre veill
l'tre qui don, l'tre qui voit celui qui a les yeux ouverts mais possde la vue, ce
qui a t spar de la matire la matire, ce qui est labor ce qui n'est pas la-
bor. Donnons le nom d'acte aux premiers membres de ces diverses relations,
l'autre membre, c'est la puissance (ibid, 1048 a 35 - b 5 ; trad. Tricot, p.
499-500).
352 353
SOI-MMECOMMEUN AUTRE VERS QUELLE ONTOLOGIE .'
Si l'on se porte maintenant l'autre bout de la chane des tres, il est
demand la notion d'acte sans puissance de caractriser le statut
ontologique du ciel des fixes, au prix d'une audacieuse assimilation,
opre au livre A, entre un tel acte pur et la pense de la pense . dont
il sera dit par surcrot qu'elle est une nergia akinsias
1
!
Plus grave encore : en dpit des titres de noblesse que l'ide de
puissance tire de sa fonction que l'on peut dire transcendantale l'gard
de la physique, cette notion ne se conoit qu' partir de celle d'acte : rien
ne peut tre dit potentiel sans rfrence quelque chose qui est dit rel,
au sens d'effectif, d'accompli ; en ce sens, l'acte a priorit sur la
puissance tant selon la notion que selon l'essence (6 8, 1049 b 10 ;
trad. Tricot, p. 508) (ceci, pour distinguer cette priorit de l'antriorit
temporelle) et mme sur le rapport la substance : ce qui n'est pas sans
importance pour notre propos ; en effet l'entrecroisement des deux
significations primitives de l'tre, celle de l'tre selon les catgories
{ousia que les latins ont traduit par substantia, etc.) et celle de l'tre en
tant qu'acte et puissance, aboutit, semble-t-il, attnuer la conqute si
prcieuse de l'ide d'acte et de puissance
2
.
La thorie de la substance ne tend-elle pas ds lors amortir le
bnfice de la distinction entre deux significations primitives de l'tre,
l'tre selon les catgories et l'tre en tant que puissance et acte ? Sans
aller aussi loin, il faut bien avouer qu'il serait vain de s'autoriser de la
pluralit des acceptions de la notion d'tre pour opposer une ontologie
de l'acte une ontologie de la substance, comme nous n'avons cess de le
faire. Certes, ce que nous avons attaqu, l'occasion de l'opposition entre
ipsit et mmet, c'est davantage le substantialisme de la tradition (
laquelle Kant continue d'appartenir par le biais de la premire Analogie
de l'exprience) que Y ousia aristotlicienne, qui ne s'y laisse pas rduire.
Reste que, quoi qu'il en soit de la possibilit de librer galement Y ousia
aristotlicienne des chanes de la tradition scolaire issue de sa traduction
latine par substantia, Aristote parat plus soucieux d'entrecroiser que
de dissocier les significations
1. Met. 0 rejoint en ce point Phys. III : Le terme acte que nous posons tou-
jours avec celui d'entlchie a t tendu des mouvements d'o il vient principale-
ment aux autres choses : il semble bien, en effet, que l'acte par excellence c'est le
mouvement (Met. 9 3, 1047 a 32 ; trad. Tricot, p. 493).
2. L'acte est une fin, et c'est en vue de l'acte que la puissance est conue (...)
De plus, la matire n'est en puissance que parce qu'elle peut aller vers sa forme et,
lorsqu'elle est en acte, alors elle est dans sa forme (6 8, 1950 a 9,13-16 ; trad.
Tricot, p. 510 et 511).
354
attaches respectivement au couple nergia-dunamis et la srie des
acceptions ouverte par la notion d'ousia (et Yousia elle-mme
laquelle sont consacrs les livres de la Mtaphysique prcdant le livre
6)
1
.
A ces trois sources de perplexit - dtermination circulaire de l'acte et
de la puissance, cartlement de leurs champs respectifs d'application
(physique du mouvement d'une part, cosmothologie du repos et de la
pense de la pense d'autre part), primat de l'acte sur la puissance en
liaison avec la thorie de la substance - s'ajoute une perplexit
spcifique concernant le rapport de cette acception primitive de l'tre
avec l'agir humain. C'est en ce point que toute notre d'entreprise est
directement concerne. En un sens, on peut dire, en effet, que les
exemples tirs d'oprations humaines - voir, comprendre, bien vivre,
fabriquer, agir (au sens o les thiques entendent la praxis) - ont
valeur paradigmatique
2
-
1. C'est ainsi que s'tablissent entre la morphde la substance et ['nergia des
changes fort subtils : d'un ct, l'actualit, rflectivit n'est plnire que dans la
forme accomplie de la substance ; de l'autre, Yousia est confirme dans son dyna-
misme par l'application elle de la signification nergia ; en ce sens, ce ne serait
pas faire violence au texte d'Aristote que d'affirmer que la substance a -tre ce
qu'elle est, selon une analyse de F. Calvo dans Socrate. Platone. Aristotele, Cer-care
l'uomo. Gnes, d. Marietti, 1989, pour lequel il a bien voulu me demander une
prface. Si cette interprtation de Yousia n'est pas excessive, il n'est pas tonnant
que ce soit chez l'homme, s'agissant de l'me, que Yousia soit interprte en terme
& nergia-dunamis, tout autant sinon plus que l'inverse. Cet change entre
significations distinctes de l'tre est patent dans la dfinition de l'me dans le
Traitdel'me: l'me, est-il dit. est substance [ousia] comme forme [eidos] d'un
corps naturel ayant la vie en puissance . Rmi Brague, dans Aristoteet la question
du monde, Paris, PUF, 1988, montre de quelle faon Aristote substitue au premier
mot de sa dfinition le terme d'entlchie (Aristote, Del'Ame, II, 1, 412 a 2l.s<7.) et
celui d'organikos la seconde moiti de la dfinition, de telle sorte que l'me est
en fin de compte la premire entlchie d'un corps physique organique (ibid..
412 b Ssq. ; Rmi Brague, op. cit., p. 333) Je reviendrai plus longuement l'im-
mense travail de Rmi Brague lorsque j'examinerai les tentatives de rinterprta-
tion heideggrienne de la philosophie d'Aristote.
2. Ds 0 1, enilchia et ergon sont mis en couple (1045 b 33-34) : 9 8 conclut
l'argument qui tablit la priorit de l'acte sur la puissance en mettant en srie les
trois termes nergia, entlchia, ergon : or, c'est dans le cas o l'action est vrai-
ment praxis que l'on peut vraiment dire : l'uvre est, en effet, ici la fin, et l'acte
est l'uvre [ergon]. De ce fait aussi le mot " acte ", qui est driv d'" uvre ", tend
vers le sens d'entlchie {Met. 9 8, 1050 a 21). C'est ce qui autorisera Rmi
Brague traduire nergia pa
f
tre-en-uvre (op. cit., p. 335). Et cette proximit
entre nergia et ergon n'a-t-elle pas encourag maints commentateurs donner un
modle artisanal la srie entire : enilchia. nergia. ergon ? Ce qui, en
banalisant le propos, rendrait peu prs inutile toute entreprise de rappropria-
tion de l'ontologie de l'acte-puissance au bnfice de l'tre du soi.
355
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
En un autre sens, les exemples relevant de la sphre humaine
d'activit ne paraissent pas devoir tre rigs en modles, sous peine de
rendre vaine l'entreprise mtaphysique d'Aristote, sous le double aspect
voqu plus haut : d'une part, assurer au mouvement la dignit
ontologique que les parmnidiens lui refusent ; d'autre part, s'appuyer
sur la notion d'acte pur pour donner dignit ontologique aux entits de
la cosmothologie
1
.
Il existe pourtant un fragment de 6 6 (1048 b 18-35) o, en dpit de
son caractre isol (ce fragment a tout l'air d'une feuille volante, et les
commentateurs mdivaux ne l'ont pas tous connu), la notion d'acte
est franchement dissocie de celle de mouvement et ajuste de faon
prfrentielle celle d'action, au sens de praxis. Ce qui rend ce texte
remarquable, c'est que la disjonction entre l'acte et le mouvement est
soutenue par un critre grammatical concernant le fonctionnement des
temps verbaux : savoir la possibilit de dire la fois, ensemble
(hama) : il a vu et il voit, il a vcu bien et il vit bien, il a t heureux et il
l'est encore
2
. On peut certes monter en pingle ce texte tonnant, mais
1. La distinction introduite en 6 2 et 5 entre puissances rationnelles (meta
logou) et irrationnelles (alogoi) semble circonscrire le champ o les exemples
tirs des oprations humaines sont pertinents ; la distinction est mme soutenue
par des traits diffrentiels prcis : ainsi, seule la puissance rationnelle est puis-
sance des contraires, savoir l'effectuation ou sa privation (0 2) ; d'autre part, le
passage de la puissance l'acte dans la production se ralise sans rencontrer d'obs-
tacle, tandis que, dans l'ordre naturel, des intermdiaires sont requis ; ainsi la
semence n'est homme en puissance que si elle est dpose dans un autre tre et par
l subit un changement (6 7).
2. Rmi Brague consacre une analyse brillante ce fragment (op. cit., p.
454-474). L'argument appuy sur la grammaire des temps verbaux est le suivant :
le critre permettant de faire le dpart entre mouvement et acte est chercher du
ct du tlos et de sa relation l'action, relation d'inhrence ou d'extriorit selon
qu'on a, respectivement, une nergia ou un mouvement (ibid., p. 467). Le jeu
des temps verbaux qui s'articule sur cette diffrence, rvle un phnomne fonda-
mental qui touche la temporalit propre l'agir humain : Le fait que le parfait
et le prsent soient " ensemble " implique que tout ce que le parfait contient de
pass est rcapitul dans le prsent [ibid, p. 473). Alors, l'action survit sa
propre fin et le mot acte , substitu entlchia, dsigne plutt une libra-
tion de l'activit remise elle-mme (...) que son aboutissement achev (ibid..
p. 471). R. Brague n'a pas tort de souligner la place du eu zn, du bien-vivre ( il a
eu et a la belle vie . prfre-t-il traduire) et de son rapport avec le bonheur parmi
les exemples d'actes qui ne sont pas des mouvements. Qu'Aristote n'ait eu nan-
moins en vue que le contenu du bonheur et son lien avec la contemplation, forme
suprieure de la vue, et qu'il ait laiss non thmatis l'acte d'tre heureux en tant
qu'acte, dans son accomplissement, cette rserve majeure de Brague tient trop
son interprtation d'ensemble de la philosophie d'Aristote pour que nous en
disions davantage ici.
on ne voit pas comment, lui seul, il pourrait lever la masse des
ambiguts que nous avons numres.
Reste alors transformer en appui l'obstacle que ces ambiguts
opposent notre avance, qu'il s'agisse de la dfinition circulaire de la
puissance et de l'acte, de l'cartement extrme des champs respectifs
d'application de ces notions, de l'incertitude concernant la centralit
ou non des exemples tirs de l'agir humain. Je propose mme de partir
de cette dernire quiyocit pour esquisser la rappropriation que je
suggre. N'est-il pas essentiel, pour un approfondissement
ontologique de l'agir humain, que les exemples tirs de ce dernier
registre apparaissent tour tour comme centraux et dcentrs ? Je
m'explique : si Ynergia-dunamis n'tait qu'une autre manire de dire
praxis (ou, pire, d'extrapoler de faon mtaphysique quelque modle
artisanal de l'action), la leon d'ontologie serait sans porte : c'est plutt
dans la mesure o Ynergia-dunamis irrigue d'autres champs
d'application que l'agir humain, que sa fcondit se manifeste. Il
importe peu que, dans le texte d'Aristote, ce soit tantt au bnfice de la
physique du mouvement que la dunamis soit mobilise, tantt au bnfice
de la cosmothologie que l'acte pur soit invoqu. L'essentiel est le
dcentrement lui-mme - vers le bas et vers le haut, chez Aristote -, la
faveur duquel Ynergia-dunamis fait signe vers un fond d'tre, la fois
puissant et effectif sur lequel se dtache l'agir humain. En d'autres termes,
il apparat galement important que l'agir humain soit le lieu de lisibilit
par excellence de cette acception de l'tre en tant que distincte de
toutes les autres (y compris celles que la substance entrane sa suite) et
que l'tre comme acte et comme puissance ait d'autres champs
d'application que l'agir humain. Centralit de l'agir et dcentrement
en direction d'un fond d'acte et de puissance, ces deux traits sont
galement et conjointement constitutifs d'une ontologie de l'ipsit en
termes d'acte et de puissance. Ce paradoxe apparent atteste que, s'il est
un tre du soi, autrement dit si une ontologie de l'ipsit est possible,
c'est en conjonction avec un fond partir duquel le soi peut tre dit
agissant.
2. Qu'il me soit permis de prciser ce que j'entends par fond d'tre
la fois puissant et effectifs travers une comparaison entre ma tentative de
reconstruction et quelques-unes de celles qui se rclament de Heidegger
l'poque de gestation de Etre et Temps. Je rappellerai d'abord les
thmes de ce grand livre avec lesquels mon hermneutique de l'ipsit
est en rsonance, avant de dire
356
357
SOI-MME COMME UN AUTRE
quelques mots sur les rinterprtations d'Aristote que ces thmes
ont inspires et de marquer, pour finir, la petite diffrence qui
subsiste entre ma tentative de reconstruction de Ynergia-dunamis
et les reconstructions inspires par Heidegger.
Sans m'astreindre suivre l'ordre dans lequel apparaissent, dans
tre et Temps, les thmes avec lesquels je me sens dans la plus
grande affinit, j'aimerais commencer par le rle assign par
Heidegger au Gewissen - mot que l'on traduit regret par
conscience (ou conscience morale, pour la distinguer de la
conscience, Bewusstsein, au sens de la phnomnologie
husser-lienne). La manire dont la notion est introduite vaut la peine
d'tre souligne ; la question pose avec insistance est de savoir si
les analyses menes au chapitre prcdent, centres sur
l'tre-pour-la-mort (ou mieux Ftre-envers-la-mort) sont bien,
comme elles le prtendent, originaires. L'attestation de la
conscience, ou mieux la conscience comme attestation, est le gage
cherch de l'originarit de cette analyse et de toutes celles qui
prcdent. L'ide que le Gewissen, avant de dsigner au plan moral
la capacit de distinguer le bien et le mal et de rpondre cette
capacit par la distinction entre bonne et mauvaise
conscience, signifie attestation (Bezeugung) est pour moi d'un grand
secours. Elle confirme mon hypothse de travail, selon laquelle la
distinction entre ipsit et mmet ne porte pas seulement sur deux
constellations de significations, mais sur deux modes d'tre.
Cette quation entre conscience et attestation fait une heureuse
transition entre les rflexions de la section prcdente de tre et
Temps et celles qui ressortissent plus proprement l'ontologie de
l'ipsit. C'est cette dernire que Heidegger instaure en tablissant
une relation de dpendance immdiate entre l'ipsit -Selbstheit - et
le mode d'tre que nous sommes chaque fois, en tant que pour cet
tre il y va de son tre propre, savoir le Dasein. C'est au titre de
cette dpendance entre une modalit d'apprhension du soi et une
manire d'tre dans le monde que l'ipsit peut figurer parmi les
existentiaux. En ce sens, elle est au Dasein ce que les catgories (au
sens rigoureusement kantien) sont aux tants que Heidegger range
sous le mode d'tre de la Vorhandenheit (terme que Martineau
traduit par tre-sous-la-main et Vezin par tre-l-devant ). Le
statut ontologique de l'ipsit est ainsi solidement fond sur la
distinction entre les deux modes d'tre que sont le Dasein et la
Vorhandenheit. A cet gard, il existe, entre la catgorie de mmet
de mes propres analyses et la notion de Vorhandenheit chez
Heidegger, le mme
VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
genre de corrlation qu'entre l'ipsit et le mode d'tre du Dasein
1
.
A son tour, la jonction entre ipsit et Dasein se fait, dans tre et
Temps, par la mdiation de la notion de souci (Sorge). qui est
l'existential le plus fondamental susceptible d'assurer l'unit th-
matique de l'ouvrage, du moins jusqu' l'entre en scne de la
temporalit dans la deuxime section. On peut cet gard suivre le fil
qui court, dans tre et Temps, depuis l'assertion du caractre chaque
fois mien du Dasein ( 5 et 9), en passant par la question existentiale
du qui ? du Dasein ( 25), puis par l'quation entre l'tre du Dasein et
le souci (41), pour aboutir la jonction entre souci et ipsit ( 64).
Le souci apparat ainsi comme le fondement de l'anthropologie
philosophique d'tre et Temps, avant que l'ontologie ne soit oriente
au-del de toute anthropologie philosophique par la notion de
temporalit. Or le souci ne se laisse capter par aucune interprtation
psychologisante ou socio-logisante, ni en gnral par aucune
phnomnologie immdiate, comme ce serait le cas pour les notions
subordonnes de Besorgen (proccupation ou souci pour les choses)
et de Fursorge (sollicitude ou souci des personnes). Cette place
minente accorde au souci ne peut nous laisser indiffrents. La
question peut tre lgitimement pose de savoir si l'agir n'occupe pas,
dans toute notre entreprise, une place comparable celle assigne
la Sorge dans tre et Temps : dans la mesure o, pour nous aussi,
aucune dtermination ni linguistique, ni praxique, ni narrative, ni
thico-morale de l'action, n'puise le sens de l'agir. C'est de cette
faon que nous nous sommes risqus, dans la prface, parler de
Vunit analogique de l'agir ; mais c'tait alors pour faire pice
l'ambition de fondation dernire du Cogito. Il nous faut y revenir en
rapport avec les dterminations multiples de l'action que nos tudes
prcdentes ont prsentes de faon fragmentaire. Le souci, pris dans
sa dimension ontologique, serait-il l'quivalent de ce que nous
appelons unit analogique de l'agir ? On ne peut rpondre
directement cette question sans avoir au
1. Cette parent trouve une importante confirmation dans la distinction que
Heidegger fait entre deux manires de persister dans le temps, l'une proche de la
permanence substantielle (que Kant attache la premire catgorie de la relation
dans la premire Analogie de l'exprience), l'autre manifeste par le phnomne du
maintien de soi (Selbsindigkeit), terme que Heidegger dcompose, comme nous
l'avons dit plus haut, en Selbst-Stndigkeit. Nous ne sommes pas loin ici de
l'opposition suscite par notre notion d'identit narrative entre le caractre
(nous-mme comme idem) et la constance morale illustre par la promesse
(nous-mme comme ipse).
358
359
SOI-MMECOMMEUN AUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
pralable replac la Sorge elle-mme dans le cadre plus vaste encore de
Ytre-dans-le-monde qui est assurment l'englobant dernier de l'analytique
du Dasein. Tout se joue, comme on sait, sur le sens de la prposition
dans , qui n'a pas d'quivalent du ct du rapport entre les tants
ressortissant la mta-catgorie de la Vorhandenheit. Seul un tant qui
est un soi est dans le monde ; corrlativement, le monde dans lequel il
est n'est pas la somme des tants qui composent l'univers des choses
subsistantes ou porte de main. L'tre du soi suppose la totalit d'un
monde qui est l'horizon de son penser, de son faire, de son sentir - bref,
de son souci.
Qu'en est-il de la place de ce concept de monde ou d'un concept
quivalent dans notre hermneutique du soi ' ? Si le concept n'y a pas
t thmatis en tant que tel, en raison pour l'essentiel de son statut
ontologique qui est au mieux rest implicite, on peut admettre qu'il est
appel par cette hermneutique, dans la mesure o le dtour par les
choses a constitu la rgle constante de notre stratgie. Ds lors qu'il
n'est rpondu la question qui ? que par le dtour de la question quoi ?,
de la question pourquoi ?, l'tre du monde est le corrlat oblig de l'tre
du soi. Pas de monde sans un soi qui s'y trouve et y agit, pas de soi sans
un monde praticable en quelque faon.
Reste que le concept - si l'on ose encore parler ainsi - d'tre du monde
se dit lui-mme de multiples faons, et que c'est ensemble que soi-mme,
souci et tre-dans-le-monde doivent tre dtermins.
C'est dans cet effort pour articuler correctement ces trois termes
qu'une certaine rappropriation d'Aristote sous la conduite de
concepts heideggriens peut conduire en retour une meilleure
apprhension des concepts directeurs d'tre et Temps
2
.
Cette rappropriation, il faut l'avouer, est pour moi pleine
d'embches, car il s'agit d'interprter ontologiquement ma propre
1. Le concept d'horizon, venu de Husserl, ou celui de monde au sens de Hei-
degger, n'ont pas t trangers mon uvre passe. Dans La Mtaphorevive, je
plaide pour l'ide de vrit mtaphorique, qui a pour horizon le monde dans
lequel nous avons la vie, le mouvement et l'tre. Dans un esprit voisin, Temps et
Rcit confronte le monde du texte au monde du lecteur.
2. On sait aujourd'hui que, dans la dcennie qui a prcd la publication d'tre
et Temps. Heidegger s'est confront longuement avec Aristote au point que Rmi
Brague a pu dire que l'uvre majeure de Heidegger est le substitut d'un livre sur
Aristote qui ne vit pas le jour (op. cit., p. 55). Tout se passe en effet - ajoute-t-il
- comme si (les concepts labors par Heidegger dans Sein und Zeit] avaient t
taills la mesure mme d'Aristote - la mesure d'un Aristote en creux (ibid..
P- 56).
hermneutique du soi, en me servant de la rappropriation
hei-deggrienne d'Aristote
1
. Cette voie contourne me parat, dans l'tat
actuel de ma recherche, la plus courte, vu la vanit d'une rptition
scolastique de l'ontologie d'Aristote en gnral et plus prcisment de sa
distinction entre l'tre comme acte/puissance et l'tre en termes de
catgories rattaches la substance.
La rappropriation d'Aristote travers Heidegger ne va pas sans un
important remaniement conceptuel ; elle va mme parfois jusqu'
reconstruire un non-dit implicite que le texte d'Aristote recouvrirait. On
peut se borner, il est vrai, comparer un groupe limit de concepts
aristotliciens leurs homologues heideggriens et les interprter les
uns en fonction des autres. Ainsi le rapprochement entre la Sorge selon
Heidegger et la praxis selon Aristote peut donner lieu une intelligence
approfondie de l'un et l'autre concept. J'y suis pour ma part d'autant plus
attentif que c'est le concept aristotlicien de praxis qui m'a aid largir
le champ pratique au-del de la notion troite d'action dans les termes
de la philosophie analytique ; en retour, la Sorge heidegg-rienne donne
la praxis aristotlicienne un poids ontologique qui ne parat pas avoir t
le propos majeur d'Aristote dans ses thiques. Ainsi Franco Volpi
peut-il attribuer la Sorge un effet global d'ontologisation l'gard de la
praxis
2
. Sa tentative nous
1. De Heidegger lui-mme, le texte le plus important, dans l'tat prsent de
publication de la Gesamtausgabe. est l'interprtation de Mtaphysique 0 1-3 :
Aristoteles, Metaphysik 0 1-3. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft, GA 33,
Francfort, Vittorio KJostermann, 1981.
2. Franco Volpi, dj auteur de Heidegger eAristotele(Padoue, Daphni, 1984),
publie dans un volume collectif des Phaenomenologica (Dordrecht, Boston,
Londres, Kluwer Acadmie Publ., 1988) un article intitul * Dasein comme
praxis: l'assimilation et la radicalisation heideggrienne de la philosophie pra-
tique d'Aristote . Il y est montr d'abord que ce fut bien dans la perspective des
autres significations de l'tant selon Aristote partir plus prcisment du privilge
confr l'tre-vrai, que Heidegger a pu entreprendre de reconstruire la philo-
sophie pratique d'Aristote dans les annes vingt. L'auteur ne dissimule pas le
caractre audacieux de la corrlation qu'il tablit entre Sorgeet praxis, dont le
prix serait l'ontologisation de la praxis, leve au-dessus des actions de niveau
simplement ontique. Ainsi serait confre la praxis une fonction dcouvrante
capable de transcender la distinction entre thorique et pratique , et surtout
d'lever la praxis au-dessus des autres termes de la triade : poisis - praxis
th-ria. Cette corrlation de base entre praxis et Sorgegouvernerait toute une srie
de corrlations connexes. Ainsi, la tlologie du concept de praxis correspondrait
l'avoir--tre (zu-sein) du Dasein ; la phronsisd'Aristote rpondrait le Gewissen
de Heidegger (cette corrlation est atteste par Gadamer dans ses souvenirs
concernant Heidegger: Heideggers Wege. Tubingen, Mohr, 1983, p. 31-32, et
Erinnerungen an Heideggers Anfange, I tinerari, vol. XXV, n 1-2, 1986, p.
10); aux passions (path) rpondrait la Befindlichkeit ; au nous praktikos, le
Verstehen ; l'orexis dianotikla Rede; la prohairsis. VEntschlossenheit. O se
360 361
SOI-MME COMME UN AUTRE
VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
aide assurment consolider le jalon que nous tentons de mettre en
place entre l'ipsit et l'tre en tant qu'acte/puissance. L'agir est ainsi
lev au rang de concept de second degr par rapport aux versions
successives de l'action que nous donnons dans les tudes qui prcdent,
ou encore par rapport notre ternaire, plus pist-mologique
qu'ontologique : dcrire, raconter, prescrire.
Faut-il, pour autant, confrer la praxis aristotlicienne et notre
propre concept de puissance d'agir une fonction unitaire pour tout le
champ de l'exprience humaine ? Si Volpi a raison de reporter sur la
temporalit le principe unitaire qui manquerait finalement la praxis
aristotlicienne, peut-tre ne faut-il pas charger ce dernier concept
d'une fonction qu'il n'a pas. Aussi bien, la sorte de pluralit qu'Aristote
prserve en laissant cte cte thria, praxis, poisis, me parat-elle
mieux en accord avec la sorte de philosophie laquelle vont mes
prfrences, qui ne se hte pas d'unifier par le haut le champ de
l'exprience humaine, comme le font prcisment les philosophies dont
je me suis loign dans la prface. Et, mme si l'agir peut tre dit
englober la thorie, en tant qu'activit thorique, il faut corriger la
tendance hgmonique ainsi accorde l'agir par l'aveu de sa
polysmie qui n'autorise gure plus que l'ide d'une unit analogique
de l'agir
1
.
ferait alors, selon Volpi, le dcrochage dcisif de Heidegger par rapport Aristote
? Aristote n'aurait pas russi voir la temporalit originaire comme le fondement
ontologique unitaire des dterminations de la vie humaine, que cependant il saisit
et dcrit, parce qu'il demeurerait dans l'horizon d'une comprhension naturaliste,
chronologique et non kairologique du temps (art. cit, p. 33). Faute de pouvoir lier
praxis et temporalit originaire, la praxis aristotlicienne resterait une des attitudes
fondamentales ct de la thria et de la poisis, en dpit des indices qui
suggrent que la praxis est la dtermination unitaire dont les deux autres drivent.
1. Il est remarquable que J. Taminiaux, qui se donne lui aussi pour tche la
rappropriation de Y thique Nicomaque (in Lectures de l'ontologie fonda-
mentale. Essais sur Heidegger. Grenoble, Jrme Millon, 1989, p. 147-189), n'ait
pas pris pour fil conducteur la Sorge de Heidegger, mais la paire authenticit
(Eigentlichkeit) - inauthenticit (Uneigentlichkeit), qu'il met en couple avec la
paire grecque poisis-praxis. Ainsi la poisis devient le modle du rapport de
l'homme au monde quotidien, et, par extension, de la Vorhandenheit, dans la
mesure o mme les choses non immdiatement maniables se rfrent une
manipulation ventuelle. Mais il ne va pas jusqu' faire de la praxis le principe
unitaire, bien qu'il affirme la supriorit thique et politique de la praxis sur la
poisis. En outre, le rapprochement entre Heidegger et Aristote ne va pas sans une
critique assez vive de Heidegger, qui il est reproch, d'une part, d'avoir perdu le
lien de la praxis avec une pluralit d'acteurs et une opinion (doxa), rversible et
fragile - lien raffirm au contraire avec force par Hannah Arendt - d'autre part,
d'avoir rendu la thria philosophique une prminence dans le champ mme de
la politique, revenant ainsi de la modestie aristotlicienne la haute prtention
Qu'il me soit permis de terminer ce tour d'horizon de quelques
rinterprtations ou rappropriations heideggriennes d'Aristote par
celle de Rmi Brague, laquelle j'ai dj fait quelques emprunts
partiels ; celle-ci est cet gard fort complexe : ce n'est pas ce que dit
Aristote qui est pris pour thme, mais ce qui, dans ce qu'il dit, reste
impens, savoir, fondamentalement, l'interprtation de Ynergia
aristotlicienne dans les termes de l'tre-dans-le-monde heideggrien.
L'impens d'Aristote doit ds lors tre reconstruit, dans la mesure o
l'anthropologie, la cosmologie, la thologie d'Aristote sont agences de
telle faon que cet impens ne puisse venir la parole. Je veux dire ici
jusqu'o je peux suivre Rmi Brague, et o prcisment commencent mes
rticences.
Que le soi et l'tre-dans-le-monde soient des corrlatifs de base ne me
parat pas discutable. Le soi-mme devient ainsi le non-dit de la thorie
aristotlicienne de l'me, et plus gnralement de toute l'anthropologie
aristotlicienne. Mais est-il acceptable de dire que la vigueur de sens du
terme autos est mousse par la confusion entre le soi, concept
phnomnologique, et Yhomme, concept anthropologique ? Le rle que
nous faisons jouer l'analyse implique que le dtour par Pobjectivation
est le plus court chemin de soi soi-mme. En ce sens, le concept
anthropologique d'homme me parat justifi. Certes, en dpit de
l'affirmation de l'intriorit de la vie elle-mme, le soi est
essentiellement ouverture sur le monde et son rapport au monde est bien,
comme le dit Brague, un rapport de concernement total : tout me
concerne. Et ce concernement va bien de Ptre-en-vie la pense
militante, en passant par la praxis et le bien-vivre. Mais comment
rendrait-on justice cette ouverture mme, si l'on n'apercevait pas dans
l'initiative humaine une coordination spcifique avec les mouvements
du monde et tous les aspects physiques de l'action ? C'est le dtour de la
rflexion par l'analyse qui est ici en jeu. Or, la fonction dcouvrante
reconnue au Dasein non seulement ne me parat pas substituable ce
dtour objectivant, mais me parat plutt le supposer ou l'exiger.
platonicienne : dans l'ontologie fondamentale, tout se passe comme si le bios
thrtikos dvorait et rgissait la praxis tout entire (op. cit., p. 17S). En
revanche, la reprise de Ynergia dans l'analytique du Dasein est considre avec
faveur (ibid., p. IS9, 163-164, 166). Finalement, Taminiaux admet qu' l'poque de
l'ontologie fondamentale du Dasein la phusis aristotlicienne n'est pas encore
comprise selon la dimension qui la soustraira la critique de la Vorhandenheit et
de son inauthenticit, ce qui vaudra une rhabilitation de la poisis. le statut de
dchance tant rserv la seule technique moderne (ibid., p. 171).
362
363
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE.'
Mais c'est la notion mme d'tre-dans-le-monde, tenue pour l'impens
de Ynergia, qui me pose le plus problme. Non que je conteste la
distinction entre le concept phnomnologique de monde et le concept
cosmologique d'univers (distinction qui n'exclut pas non plus des
dtours plus grands encore que ceux qui relient la phnomnologie du
soi l'anthropologie de l'homme). Ma rticence porte sur un seul point,
mais essentiel. Faut-il faire de la prsence le nexus fondamental entre
l'tre soi-mme et l'tre-au-monde ? Certes, prsence ne doit pas tre
spar de concernement, dont je viens de rappeler l'ampleur de sens.
Mais si le concernement n'est pas l'englobant de la prsence, com-
ment la prsence pourra-t-elle tre tenue pour l'impens le plus plausible
de Ynergia aristotlicienne ' ? La prsence de l'tre-soi-au-monde se
trouve finalement tire du ct de \?i facticit hei-deggrienne
2
. Or, je
doute que la facticit soit la meilleure cl pour rinterprter Ynergia
et Yentlchia d'Aristote
3
. J'entends bien que Ynergia, que les Latins
ont traduit par actualitas, dsigne de faon globale ce dans quoi nous
sommes effectivement. Mais, en mettant l'accent principal sur le
toujours dj et sur l'impossibilit de sortir de ce lien de prsence, bref
sur la facticit, n'attnue-t-on pas la dimension de Ynergia et de la
dunamis en vertu de laquelle Y agir et le ptir humains sont enracins
dans l'tre ? C'est pour rendre compte de cet enracinement que j'ai
propos la notion de fond la fois effectif et puissant. J'insiste sur les deux
adjectifs. Une tension existe entre puissance et effectivit, qui me parat
essentielle l'ontologie de l'agir et qui
1. On lira le remarquable chapitre qui clt l'ouvrage de Rmi Brague, L'tre
en acte > (op. cit., p. 463-509). J'ai dit plus haut ce que je dois l'exgse du frag-
ment de Mtaphysique8 6, 1048 b 18-35, prsent comme un arolithe aristot-
licien (ibid., p. 4545^). Cette exgse occupe dans le chapitre une position strat-
gique, en ceci que les exemples sur lesquels Aristote base la distinction prcieuse
entre acte et mouvement ramnent, travers l'exprience dcisivedu bonheur,
l'exprience fondamentalede la vie humaine. Celle-ci engloberait la perception,
comprise elle-mme partir du contact, la veille, ou mieux l'tre veill. De l
on passerait l'ide que la perception est livre elle-mme (ibid., p. 490), en
mme temps qu'au monde lui-mme : La vie est pour nous un domaine dont il
ne nous est pas possible de nous vader, et dans lequel nous ne sommes pas
entrs (ibid., p. 491).
2. La prsence dans le monde est telle que nous nous trouvons dans un int-
rieur dans lequel nous ne sommes jamais entrs, dans un intrieur sans extrieur.
Cest pourquoi cet intrieur est dfini par la continuit, par l'impossibilit d'at-
teindre, partir du dedans, quelque limite que ce soit {ibid., p. 492).
3. On notera que, en dpit de la proximit entre nergia et ergon. et entre
ent-lchia et tlos. ce soit finalement le prfixe commun en (dans) qui attire le
plus la curiosit de Brague {ibid., p. 492-493).
me parat efface dans l'quation entre nergia et facticit. La difficile
dialectique entre les deux termes grecs est menace de disparatre dans
une rhabilitation apparemment unilatrale de Ynergia. C'est pourtant
de cette diffrence entre nergia et dunamis, autant que du primat de la
premire sur la seconde, que dpend la possibilit d'interprter
conjointement l'agir humain et l'tre comme acte et comme puissance.
3. La relative dception sur laquelle se clt notre attentive coute
des interprtations heideggriennes visant une rappropriation de
l'ontologie aristotlicienne nous invite chercher un autre relais entre la
phnomnologie du soi agissant et souffrant et le fond effectif et
puissant sur lequel se dtache l'ipsit.
Ce relais, c'est pour moi le conatus de Spinoza.
Je n'ai gure crit sur Spinoza, bien qu'il n'ait cess d'accompagner
ma mditation et mon enseignement. Je partage avec Sylvain Zac la
conviction selon laquelle on peut centrer tous les thmes spinozistes
autour de la notion de vie
1
. Or qui dit vie, dit aussitt puissance,
comme l'atteste de bout en bout Y thique
1
. Puissance, ici, ne veut pas
dire potentialit, mais productivit, qui n'a donc pas lieu d'tre oppos
acte au sens d'ef-fectivit, d'accomplissement. Les deux ralits sont des
degrs de la puissance d'exister. En rsultent, d'une part, la dfinition de
l'me comme ide d'une chose singulire existant en acte (thique,
II, prop. xi)
3
, d'autre part, l'affirmation que ce pouvoir d'animation est
tout fait gnral et n'appartient pas plus aux hommes qu'aux autres
individus (thique, II, prop. xn, scolie) .
C'est sur cet arrire-plan, trop rapidement voqu, que se dtache
l'ide du conatus, en tant qu'effort pour persvrer dans
1. Sylvain Zac, L'Idedeviedans la philosophiedeSpinoza, Paris, PUF, 1963, p.
15-16. .
2. Ce n'est pas la thologie de Spinoza qui m'importe ; l'accusation, soit de
panthisme, soit d'athisme, est sans pertinence pour la reprise de la notion de
conatus qui importe seule ici. Une seule formule, d'apparence thologique, suffit
mon propos : il nous est aussi impossible de concevoir Dieu n'agissant pas que
Dieu n'existant pas (thique. Il, prop. m, scolie, cit Zac, op. cit., p. 18). Ainsi
est pos d'emble que les propres de Dieu expriment la proprit fonda-
mentale de celui-ci d'tre une essenlia actuosa. Sur le sens, chez Spinoza, de la for-
mule Dieu est la vie , cf. Zac, ibid.. p. 24sq. L'essentiel pour nous est qu' un
Dieu-artisan, s'efforant de raliser une uvre conforme un modle, il soit subs-
titu une puissance infinie, une nergieagissante. C'est en ce point que Spinoza
rencontre saint Paul affirmant qu'en Dieu nous avons l'tre et le mouvement
(Lettre 73 H. Oldenburg, cite par Zac, ibid.. p. 86).
3. Spinoza, thique, op. cit., p. 139.
4. Ibid., trad. Appuhn modifie.
364
365
SOI-MMECOMMEUNAUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
l'tre, qui fait l'unit de l'homme comme de tout individu. J'aime citer
ici la proposition vi du livre III : Chaque chose, autant qu'il est en
elle, s'efforce de persvrer dans son tre ' (la dmonstration renvoie
pour l'essentiel directement au livre I, o il est montr que les choses
singulires en effet sont des modes par o les attributs de Dieu
s'expriment d'une manire certaine et dtermine (...), c'est--dire (...) des
choses qui expriment la puissance de Dieu, par laquelle il est et agit,
d'une manire certaine et dtermine
2
.
Je n'ignore pas que ce dynamisme du vivant exclut toute initiative
rompant avec le dterminisme de la nature, et que persvrer dans l'tre
n'est pas se dpasser vers autre chose, selon quelque intention qu'on
puisse tenir pour la fin de cet effort. Cela est exclu par la proposition
vu qui suit immdiatement la dfinition du conatus : l'effort par lequel
chaque chose s'efforce de persvrer dans son tre n'est rien en dehors
de l'essence actuelle de cette chose (thique, III, trad. Appuhn, p.
261). La dmonstration voque aussitt l'ide de ncessit que le livre
I attache celle d'expression, de sorte que la puissance d'une chose
quelconque, ou l'effort [...] par lequel [une chose] s'efforce de persvrer
dans son tre n'est rien en dehors de l'essence donne ou actuelle de la
chose (ibid., trad. Appuhn, p. 263). Mais on ne saurait oublier que le
passage des ides inadquates, que nous nous formons sur nous-mmes
et sur les choses, aux ides adquates signifie pour nous la possibilit
d'tre vritablement actifs. En ce sens, la puissance d'agir peut tre dite
accrue par le recul de la passivit lie aux ides inadquates (cf. thique,
III, proposition i, dmonstration et corollaire). C'est cette conqute de
l'activit sous l'gide des ides adquates qui fait de l'ouvrage entier une
thique. Ainsi restent troitement lis le dynamisme interne, qui mrite
le nom de vie, et la puissance de l'intelligence, qui rgle le passage des
ides inadquates aux ides adquates. En ce sens, nous sommes
puissants lorsque nous comprenons adquatement notre dpendance en
quelque sorte horizontale et externe l'gard de toutes choses, et notre
dpendance verticale et immanente l'gard du pouvoir primordial
que Spinoza nomme encore Dieu.
M'importe finalement, plus qu'aucune, l'ide vers laquelle la
discussion prcdente de Vnergia selon Aristote s'est oriente, savoir,
d'une part, que c'est dans l'homme que le conatus, ou
1. Ibid, p. 261.
2. Ibid.
puissance d'tre de toutes choses, est le plus clairement lisible, et, d'autre
part, que toute chose exprime des degrs diffrents la puissance ou la
vie que Spinoza appelle vie de Dieu. Je rejoins ainsi, au terme de cette
traverse trop rapide de Vthique de Spinoza, l'ide que la conscience
de soi, loin d'tre, comme chez Descartes, au point de dpart de la
rflexion philosophique, suppose, au contraire, un long dtour (Zac,
op. cit., p. 137). C'est prcisment la priorit du conatus par rapport la
conscience -que Spinoza appelle ide de l'ide - qui impose la
conscience adquate de soi-mme ce long, trs long dtour, qui ne
s'achve qu'au livre V de Vthique.
Bienvenu serait le penseur qui saurait porter la rappropriation
spinoziste de Vnergia aristotlicienne un niveau comparable
celui qu'ont ds maintenant atteint les rappropriations
heideggriennes de l'ontologie aristotlicienne. Car, si Heidegger a su
conjuguer le soi et l'tre-dans-le-monde, Spinoza - de provenance, il est
vrai, plus juive que grecque - est le seul avoir su articuler le conatus sur
ce fond d'tre la fois effectif et puissant qu'il appelle essentia
actuosa.
3. Ipsit et altrit
Du lien dialectique entre ipsit et altrit, il tait dit, au dbut de
cette tude, qu'il est plus fondamental que l'articulation entre rflexion
et analyse, dont l'attestation rvle cependant l'enjeu ontologique, et
mme que le contraste entre ipsit et mmet, dont la notion d'tre
comme acte et comme puissance marque la dimension ontologique. Le
titre mme de cet ouvrage est le rappel permanent de la primaut de
cette dialectique.
Que l'altrit ne s'ajoute pas du dehors l'ipsit, comme pour en
prvenir la drive solipsiste, mais qu'elle appartienne la teneur de
sens et la constitution ontologique de l'ipsit, ce trait distingue
fortement cette troisime dialectique de celle de l'ipsit et de la
mmet, dont le caractre disjonctif restait dominant.
Pour nous guider dans la dernire tape de cette investigation
ontologique, nous prendrons appui sur les remarques que nous avons
jointes plus haut l'affirmation de la primaut de cette dialectique.
Nous avons d'abord soulign son appartenance au mme discours de
deuxime degr que la dialectique du Mme et de l'Autre ouverte par
Platon dans les Dialogues dits mta-
366 367
SOI-MME COMME UN AUTRE VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
physiques. Le caractre qu'on peut dire spculatif de la dialectique de
l'ipsit et de l'altrit s'est annonc le premier et s'est ensuite projet
rtrospectivement sur les deux autres moments de l'investigation
ontologique. Nous surprenons donc ici ce caractre en son lieu
d'origine. Nous avons ensuite annonc par anticipation le caractre
polysmique de l'altrit, lequel, disions-nous, implique que l'Autre ne
se rduise pas, comme on le tient trop facilement pour acquis,
l'altrit d'un Autrui. Ce second point mrite explication. Il rsulte de
l'inflchissement de la dialectique fameuse du Mme et de l'Autre au
contact de l'hermneutique du soi. En fait, c'est le ple du Mme qui a le
premier perdu son univocit, en se fracturant en mme temps que
l'identique tait travers par la ligne de partage qui spare Yipse de Y
idem. Le critre temporel de cette division, savoir la double valence
de la permanence dans le temps, selon qu'elle dsigne l'immutabilit de
Yidem ou le maintien de soi de Yipse, mrite d'tre rappel une dernire
fois. La polysmie de l'ipsit, la premire remarque, sert en quelque
sorte de rvlateur l'gard de la polysmie de l'Autre, qui fait face au
Mme, au sens de soi-mme.
Or, comment rendre compte du travail de l'altrit au cur de l'ipsit
? C'est ici que le jeu entre les deux niveaux de discours -discours
phnomnologique et discours ontologique - se rvle le plus fructueux,
en vertu de la force dcouvrante que ce jeu suscite sur les deux plans la
fois. Pour fixer le vocabulaire, posons que le rpondant
phnomnologique de la mta-catgorie d'altrit, c'est la varit des
expriences de passivit, entremles de faons multiples l'agir humain.
Le terme altrit reste alors rserv au discours spculatif, tandis que
la passivit devient l'attestation mme de l'altrit.
La vertu principale d'une telle dialectique est d'interdire au soi
d'occuper la place du fondement. Cet interdit convient parfaitement la
structure ultime d'un soi qui ne serait ni exalt, comme dans les
philosophies du Cogito, ni humili comme dans les philosophes de
Yanli-Cogito. J'ai parl dans la prface de cet ouvrage de Cogito bris
pour dire cette situation ontologique insolite. Il faut maintenant ajouter
qu'elle fait l'objet d'une attestation elle-mme brise, en ce sens que
l'altrit jointe l'ipsit, s'atteste seulement dans des expriences
disparates, selon une diversit de foyers d'altrit.
A cet gard, je suggre titre d'hypothse de travail ce qu'on pourrait
appeler le trpied de la passivit, et donc de l'altrit.
D'abord, la passivit rsume dans l'exprience du corps propre, ou
mieux, comme on dira plus loin, de la chair, en tant que mdiatrice
entre le soi et un monde lui-mme pris selon ses degrs variables de
praticabilit et donc d'trang(r)et. Ensuite, la passivit implique par
la relation de soi Y tranger, au sens prcis de l'autre que soi, et donc
l'altrit inhrente la relation d'intersubjectivit. Enfin, la passivit la
plus dissimule, celle du rapport de soi soi-mme qu'est la conscience,
au sens de Gewis-sen plutt que de Bewusstsein. En plaant ainsi la
conscience en tiers par rapport la passivit-altrit du corps propre et
celle d'autrui, nous soulignons l'extraordinaire complexit et la densit
relationnelle de la mta-catgorie d'altrit. En retour, la conscience
projette aprs coup sur toutes les expriences de passivit places avant
elle sa force d'attestation, dans la mesure o la conscience est aussi de
part en part attestation.
Une dernire remarque avant d'esquisser les investigations que
chacun de ces trois champs de gravitation appelle : il ne s'agit pas
d'ajouter un, deux ou trois niveaux ceux qui ont dj t parcourus -
linguistique, praxique. narratif, thique -, mais de dgager le degr de
passivit vcue propre ces divers niveaux d'exprience et ainsi
d'identifier la sorte d'altrit qui lui correspond au plan spculatif.
a. Le corps propre ou la chair
C'est avec cette premire figure de passivit-altrit que le renvoi de la
phnomnologie l'ontologie est le plus ais mettre en jeu. Le
caractre nigmatique du phnomne du corps propre a t aperu en
trois occasions au moins au cours de nos tudes antrieures.
Ce fut d'abord au cours de l'analyse par Strawson de ce particulier de
base qu'est la personne : comment, demandions-nous, des prdicats
psychiques et physiques disparates peuvent-ils tre ascrits une seule et
mme entit, si le corps humain n'est pas la fois un des corps et mon
corps ? Nous nous sommes alors borns tenir l'assertion selon laquelle
les personnes sont aussi des corps pour une contrainte du langage
quand nous parlons des choses comme nous le faisons. Nous n'avons pas
manqu d'observer que, si les personnes sont aussi des corps, c'est dans la
mesure o chacune est pour soi son propre corps. Rendre compte de cette
prsupposition exige que nous appuyions l'organisation du lan-
368 369
SOI-MMECOMMEUN AUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
gage sur la constitution ontologique de ces entits appeles des
personnes.
La double appartenance du corps propre au rgne des choses et celui
du soi s'est une seconde fois impose dans la discussion avec Davidson
: comment l'action peut-elle en mme temps constituer un vnement
du monde, en tant que celui-ci est la somme de tout ce qui arrive, et
dsigner de faon auto-rfrentielle son auteur, si celui-ci
n'appartient pas au monde selon un mode o le soi est constitutif du
sens mme de cette appartenance ? Le corps propre est le lieu mme - au
sens fort du terme - de cette appartenance grce quoi le soi peut mettre
sa marque sur ces vnements que sont les actions.
La question de l'identit personnelle, porte son point extrme
de raffinement par Parfit, a enfin remis sur le chantier cette mme
problmatique du corps propre, quand il a fallu relier les critres
corporels et psychiques de l'identit - continuit du dveloppement,
permanence du caractre, des habitus, des rles et des identifications -
au maintien d'un soi qui trouve son ancrage dans le corps propre.
Mais la phnomnologie de la passivit ne dpasse le stade implicite
o nous l'avons plusieurs fois voque que lorsque, dans ce phnomne
global d'ancrage, on souligne un trait marquant que nos analyses
antrieures n'ont pas assez pris en compte, savoir la souffrance. Le
subir, le ptir, est en quelque sorte rvl selon son intgrale dimension
passive lorsqu'il devient un souffrir. On n'a certes jamais cess, tout au
long de ces tudes, de parler de l'homme agissant et souffrant. On a
mme mis plusieurs fois sur la voie de cette corrlation originaire entre
agir et souffrir. Ainsi, traitant de l'identit narrative, on a observ que
c'est la vertu du rcit de conjoindre agents et patients dans l'enchevtre-
ment de multiples histoires de vie. Mais il faudrait aller plus loin et
prendre en compte des formes plus dissimules du souffrir : l'incapacit
de raconter, le refus de raconter, l'insistance de l'innarrable,
phnomnes qui vont bien au-del de la priptie, toujours rcuprable
au bnfice du sens par la stratgie de mise en intrigue. Discutant, dans
une tude antrieure, de la place de la Rgle d'Or en thique, on a pris la
mesure de la dissymtrie fondamentale, inhrente l'interaction,
rsultant du fait qu'un agent, en exerant un pouvoir-^wr un autre, traite
celui-ci comme le patient de son action. Mais il faudrait, ici encore,
aller plus loin, jusqu'aux formes de msestime de soi et de dtestation
d'au-trui, o la souffrance excde la douleur physique. Avec la diminu-
tion du pouvoir d'agir, ressentie comme une diminution de l'effort pour
exister, commence le rgne proprement dit de la souffrance. La plupart
de ces souffrances sont infliges l'homme par l'homme. Elles font que
la part la plus importante du mal dans le monde rsulte de la violence
exerce entre les hommes. Ici, la passivit ressortissant la
mta-catgorie du corps propre recoupe la passivit ressortissant celle
d'autrui : la passivit du souffrir soi-mme devient indiscernable de la
passivit de l'tre-victime de l'autre que soi. La victimisation apparat
alors comme l'envers de passivit qui endeuille la gloire de l'action.
Pour articuler spculativement la modalit d'altrit qui correspond
cette passivit, il faudrait accorder la mta-catgorie du corps propre
une ampleur comparable celle que le souffrir donne au subir. Dans
une dialectique acre entre praxis et pathos, le corps propre devient le
titre emblmatique d'une vaste enqute qui, au-del de la simple
miennet du corps propre, dsigne toute la sphre de passivit intime,
et donc de l'altrit, dont il constitue le centre de gravit. Il faudrait,
dans cette perspective, parcourir le travail conceptuel qui s'est fait
depuis les Traits classiques des passions, en passant par Maine de
Biran, jusqu' la mditation de Gabriel Marcel, de Merleau-Ponty et de
Michel Henry, sur l'incarnation, la chair, l'affectivit et l'auto-affection.
Je ne le ferai pas ici et me bornerai planter quelques repres.
J'aimerais, au dbut de ce bref survol, rendre justice celui qui a
ouvert ce chantier du corps propre, savoir Maine de Biran : il a
vritablement donn une dimension ontologique approprie sa
dcouverte phnomnologique, en dissociant la notion d'existence de
celle de substance, et en la rattachant celle d'acte. Dire je suis, c'est
dire je veux, je meus, je fais
1
. Or Fapercep-
1. G. Roineyer-Dherbey, dans MainedeBiran ou lePenseur del'immanence
radicale(Paris, Seghers, 1974), prsente une vue synthtique de la rvolution de
pense opre par Maine de Biran. Le dplacement de la problmatique ontolo-
gique qui en rsulte est en effet plus considrable qu'il ne parat. L'identification
ancienne de l'tre avec la substance, que Descartes n'a aucunement remise en
cause, reposait sur un privilge exclusif de la reprsentation quasi visuelle qui
transforme les choses en spectacle, en images saisies distance. Le doute de Des-
cartes est un doute portant sur le spectacle des choses. Et, si Descartes peut douter
qu'il a un corps, c'est parce qu'il s'en fait une image que le doute rduit aisment
en songe. Il n'en va plus de mme si l'aperception de soi est tenue pour
l'apercep-tion d'un acte et non pour la dduction d'une substance. Si une telle
aperception est indubitable, c'est dans la mesure o elle n'est pas une vision
simplement retourne vers le dedans, une intro-spection, laquelle, aussi proche
qu'on la veuille de son objet, comporte la distance minimum d'un redoublement.
Le sens intime, faut-il dire, n'a pas d'objet. Une telle opposition entre aperception
(immanente) et
370 371
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
tion, distincte de toute reprsentation objectivante, englobe dans l'orbe
de la mme certitude le moi agissant et son contraire, qui est aussi son
complment, la passivit corporelle. Maine de Biran est ainsi le premier
philosophe avoir introduit le corps propre dans la rgion de la certitude
non reprsentative. Cette inclusion du corps propre prsente des degrs
croissants de passivit. Au premier degr, le corps dsigne la rsistance
qui cde l'effort. C'est l pour Maine de Biran l'exemple
paradigmatique, l'effort venant occuper la place de l'impression et de la
sensation chez Hume et Condillac. La structure relationnelle du moi
lui-mme y est tout entire contenue, effort et rsistance formant une
unit indivisible. Le corps y reoit la signification indlbile d'tre mon
corps avec sa diversit intime, son tendue irrductible toute
extension imagine ou reprsente, sa masse et sa gravit. Telle est
l'exprience princeps, celle du corps actif, qu'illustrent le bonheur et
la grce du corps dansant, docile la seule musique. Un second degr
de passivit est reprsent par les alles et venues des humeurs
capricieuses - impressions de bien-tre ou de mal-tre, dont Maine de
Biran guette avec anxit les mouvements dans son Journal: la
passivit, ici, se fait trangre et adverse '. Un troisime degr de
passivit est marqu par la rsistance des choses extrieures ; c'est par le
tact actif, dans lequel se prolonge notre effort, que les choses attestent
leur existence aussi indubitable que la ntre ; ici. exister, c'est rsister ;
c'est ainsi le mme sens qui donne la plus grande certitude d'existence
propre et la plus grande certitude d'existence extrieure. Avec la varit
de ces degrs de passivit, le corps propre se rvle tre le mdiateur
entre l'intimit du moi et l'extriorit du monde
2
.
reprsentation (transcendante) n'est pas sans parallle dans la philosophie analy-
tique postwittgensteinienne : E. Anscombe caractrise comme connaissance sans
observation le savoir de ce que nous pouvons faire, de la position de notre corps...
De mme, la notion d'action de base, chez A. Danto et chez H. von Wright, repose
sur une telle apprhension non objectivante de soi-mme. Ce qui est propre
Maine de Biran, c'est d'avoir aperu le lien fort qui existe entre l'tre comme acte
et une telle aperception sans distance.
1. Les commentateurs ont not que, chez Maine de Biran lui-mme, l'exp-
rience des impressions passives est mal accorde avec celle de la rsistance qui
cde. Michel Henry, dans Philosophieet Phnomnologiedu corps. Essai sur l'on-
tologiebiranienne(Paris, PUF, 196S), a cherch dans la thorie husserlienne des
synthses passives la cl du rapport entre ce que Maine de Biran appelle corps
actif et corps passif. La thorie biranienne de l'habitude donne du crdit cette
solution.
2. On se demandera plus loin si cette extriorit des choses matrielles est
complte sans le tmoignage d'autres que moi, qui dcentre le monde et l'arrache
cette sorte de miennet par lequel le tact annexe les choses elles-mmes mon
effort.
Le second jalon et le plus important sur la voie qui conduit de la
philosophie de l'effort de Maine de Biran aux trois grandes phi-losophies
du corps propre que j'ai nommes plus haut et auxquelles je me borne
renvoyer le lecteur, se trouve incontestablement dans la
phnomnologie de Husserl. En un sens, sa contribution ce qu'il
faudrait appeler une ontologie de la chair est plus importante que celle
de Heidegger. Cette affirmation est premire vue paradoxale. A un
double titre : d'abord la distinction dcisive entre leib et krper, qu'il
faut bien rendre par chair et corps, occupe dans les Mditations
cartsiennes une position stratgique, en vertu de laquelle elle ne devrait
tre qu'une tape en direction de la constitution d'une nature
commune, c'est--dire intersubjectivement fonde. Ainsi la notion de
chair n'est-elle labore que pour rendre possible l'ap-pariement
(Paarung) d'une chair une autre chair, sur la base de quoi une nature
commune peut se constituer : finalement, cette problmatique reste,
quant sa vise fondamentale, celle de la constitution de toute ralit
dans et par la conscience, constitution solidaire des philosophies du
Cogito dont nous avons pris cong ds la prface de cet ouvrage. On
pourrait alors penser que la philosophie de l'tre-dans-le-monde (S'tre
et Temps offre un cadre plus appropri pour une ontologie de la chair,
en vertu mme de sa rupture avec la problmatique de la constitution
base sur l'intentionnalit de la conscience ; or, c'est ici la seconde
face du paradoxe, pour des raisons qu'il faudra dire, tre et Temps n'a
pas laiss se dployer une ontologie de la chair, et c'est chez Husserl,
dans l'ouvrage le plus ouvertement ddi au renouveau de l'idalisme
transcendantal, que l'on trouve l'esquisse la plus prometteuse de
l'ontologie de la chair qui marquerait l'inscription de la phnomnologie
hermneutique dans une ontologie de l'altrit.
C'est prcisment sa position stratgique dans l'argumentation des
Mditations cartsiennes que la polarit chair/corps doit la radicalit
de sa diffrence '. Nous sommes dans une golo-gie dcide, et non dans
une philosophie du soi. Et ce sont prci-
1. Remontant en de des Mditations cartsiennes, Didier Franck, dans Chair
et Corps. Sur la phnomnologiedeHusserl (Paris, d. de Minuit, 1981 ), voit dans
le thme de la donation incarne (Leibhaft), ds les Ides... I . l'antcdent
oblig de la problmatique de la chair : La donation incarne qui dfinit l'vi-
dence en gnral (avant toute critique et donc tout problme d'apodicticit, par
exemple) ne doit pas tre prise pour une mtaphore, une manire de dire, un trait
propre au style de Husserl {op. cit., p. 19). Le thme de l'incarnation aurait ainsi
prcd celui de la chair.
372
373
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
sment les difficults d'une telle gologie qui confrent toute son urgence
la distinction entre chair et corps. Il faut ajouter que ce n'est pas en
liaison avec quelque je peux ou je meus que le thme s'impose,
bien que cette dimension ne soit pas absente, mais au plan de la
perception. En cela, le thme de la chair, dans les Mditations
cartsiennes, reste dans la ligne du leibhaft selbst (du donn soi-mme en
chair) des crits antrieurs. Si le mouvoir est pris en compte, c'est dans la
mesure o je peux changer ma perspective percevante et ainsi me
mouvoir.
Je ne discute pas ici la question de savoir si la notion de l'tranger,
celui que Husserl nomme l'tranger en soi premier, savoir l'autre moi,
ne hante pas ds le dbut la qute d'un propre que l'ultime rduction
opre dans la quatrime Mditation prtend avoir isol
1
. Nous
retrouverons cette difficult quand nous nous porterons au second ple
d'altrit, celui prcisment de l'autre en tant qu'tranger. Ce qui doit
retenir maintenant notre attention, c'est la ncessit de distinguer entre
chair et corps, s'il doit pouvoir tre procd la drivation d'un genre
unique de Valter ego partir de Y ego. En d'autres termes, ce qui fait
sens pour nous, c'est la production mme de cette distinction en ce
moment crucial de l'entreprise de constitution de la nature objective sur
la base de l'intersubjectivit. Qu'une phnomnologie de la constitution
choue rendre compte de celle de Paltrit de l'tranger est une chose.
En revanche, que, pour constituer une subjectivit trangre, il faille
former l'ide d'un propre qui soit prcisment la chair dans sa diffrence
d'avec le corps, est une autre chose : et c'est cette dernire qui nous
intresse ici.
Moi comme chair, avant la constitution de Yalter ego, c'est ce que la
stratgie de la constitution intersubjective de la nature commune exige
de penser. Que nous devions une impossible entreprise la formation du
concept ontologique de chair, voil la divine surprise. Comme on sait,
la dcision mthodologique rside dans la rduction au propre d'o
seraient exclus tous les prdicats objectifs redevables
l'intersubjectivit. La chair s'avre ainsi tre le ple de rfrence de tous
les corps relevant de cette nature propre*.
1. Cf. mon analyse de la cinquime Mditation cartsiennedans A l'coledela
phnomnologie, Paris, Vrin, 1980.
2. Je cite dans la traduction propose par D. Franck le texte dcisif : Parmi les
corps proprement saisis de cette nature, je trouve, dans une distinction unique en
son genre, ma chair [meinen Leib], savoir comme l'unique corps qui n'est pas
simplement corps mais prcisment chair, l'unique objet l'intrieur de ma
couche abstraite de monde auquel, conformment l'exprience, j'ajoute des
champs de sensations, et ce sous divers modes d'appartenance (champ des sensa-
Laissons de ct la drivation de Yalter ego par appartement d'une
chair l'autre ; arrtons-nous au trait phnomnologique de la chair qui
la dsigne comme paradigme d'altrit. Que la chair soit le plus
originairement mien et de toutes choses la plus proche, que son aptitude
sentir se rvle par privilge dans le tact, comme chez Maine de Biran,
ces traits primordiaux rendent possible que la chair soit l'organe du
vouloir, le support du libre mouvement ; mais on ne peut pas dire qu'ils
sont l'objet d'un choix, d'un vouloir. Je, en tant que cet homme : voil
'altrit prime de la chair au regard de toute initiative. Altrit signifie ici
primordialit au regard de tout dessein. A partir de cette altrit, je peux
rgner sur. Mais la primordialit n'est pas rgne. La chair prcde
ontologiquement toute distinction entre le volontaire et l'involontaire.
On peut certes la caractriser par le je peux; mais prcisment je
peux ne drive pas de je veux, mais lui donne racine. La chair est le
lieu de toutes les synthses passives sur lesquelles s'difient les
synthses actives qui seules peuvent tre appeles des uvres
(Leistungen) : elle est la matire (hyl), en rsonance avec tout ce qui
peut tre dit hyl en tout objet peru, apprhend. Bref, elle est l'origine
de toute altration du propre . De celles-ci rsulte que l'ipsit
implique une altrit propre , si l'on peut dire, dont la chair est le
support
2
. En ce sens, si mme 'altrit de l'tranger pouvait - par
impossible - tre drive de la sphre du propre, 'altrit de la chair lui
serait encore pralable.
La question se pose ds lors de savoir si la grande dcouverte de
Husserl, que sanctionne la distinction entre chair et corps, peut tre
dissocie de ce qu'on a appel plus haut son rle stratgique dans la
phnomnologie transcendantale l'poque des Mditations
cartsiennes. Je le crois. Outre le problme, sur lequel nous reviendrons
plus loin, de la drivation du statut d'tranger partir de la sphre du
propre sur la base de la synthse passive hors pair que constitue l'
appariement entre Y ego et Yalter ego, on peut trouver dans les Indits
des investigations et des dveloppements concernant la diffrence (et la
relation) entre chair et corps, relativement indpendants de la
problmatique de la
lions tactiles, champ du chaud et froid, etc.), l'unique objet sur lequel je rgneet
domineimmdiatement, et en particulier dont je domine chaque organe, op. cit..
p. 93-94.
1. L'altration du propre: c'est le titre de l'un des chapitres de Didier
Franck, ibid.. p. \09sq.
2. Le terme d'ipsit apparat en liaison avec celui de donation propre au 46
des Mditations cartsiennes (cit par D. Franck, ibid., p. 111).
374 375
SOI-MMECOMMEUN AUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
constitution intersubjective de la nature commune. Ce qui est dit de la
distinction entre Y ici et le l, en tant qu'irrductibles toute localisation
par reprage objectif, relve par excellence de cette ontologie
phnomnologique de la chair. On trouve dans ces textes consacrs la
non-spatialit objective de la chair un cho inattendu aux rflexions de
Wittgenstein sur la non-appartenance du sujet au systme de ses objets et
sur les implications de ce paradoxe concernant la notion d'ancrage que
nous avons rencontre trs tt sur le trajet de nos tudes. Dire que la
chair est ici absolument, donc htrogne tout systme de coordonnes
gomtriques, c'est dire quivalemment qu'elle n'est nulle part en terme
de spatialit objective. Et le l-bas o je pourrais tre si je m'y
transportais - en dehors de la question de savoir en quel sens le l-bas
pour moi peut ressembler l'ici pour autrui - a le mme statut
d'htrognit que l'ici dont il est le corrlat. Sur le modle du problme
de la localisation de la chair, d'autres problmes relatifs la spatialit
originaire de la chair pourraient tre poss. Parmi ceux-ci, je retiendrai
ceux qui ont rapport au monde ambiant, en tant que corrlat du
corps-chair. Ce que l'on peut lire dans les Indits sur le monde en tant
que praticable complte heureusement ce qui vient d'tre dit sur la
spatialit en quelque sorte interne de la chair. Aussi bien, les notations sur
le contact en tant que forme primordiale du sentir, redonnent vie toute
la problmatique biranienne de l'existence-rsistance et invitent
dplacer l'accent sur le ple monde de la spatialit de la chair. C'est,
comme l'tablit Jean-Luc Petit dans l'ouvrage que nous avons maintes
fois cit, sur ce rapport prlinguistique entre ma chair localise par soi
et un monde accessible ou non au je peux que doit finalement
s'difier une smantique de l'action qui ne se perde pas dans l'change
sans fin entre jeux de langage. C'est seulement lorsque l'ontologie de la
chair s'affranchit autant qu'il est possible de la problmatique de la
constitution qui l'a paradoxalement requise, que l'on peut faire face au
paradoxe inverse de celui pos par la thorie strawsonienne des parti-
culiers de base : savoir, non pas ce que signifie qu'un corps soit mon
corps, c'est--dire chair, mais que la chair soit aussi un corps parmi les
corps. C'est l que la phnomnologie trouve sa limite, du moins celle
qui entend driver les aspects objectifs du monde d'une exprience
primordiale non objectivante, par le biais de l'intersubjectivit
principalement. Le problme que nous avons appel, dans Temps et
Rcit, celui de la rinscription du temps phnomnologique dans le
temps cosmologique, trouve ici une
srie d'quivalents : de mme qu'il faut inventer le calendrier pour
corrler le maintenant vcu avec un instant quelconque, et la carte
gographique pour corrler le ici charnel avec un lieu quelconque, et
inscrire le nom propre - le mien - sur les registres de l'tat civil, de mme
faut-il, comme le dit lui-mme Husserl, mondaniser la chair pour
qu'elle apparaisse comme corps parmi les corps. C'est ici que l'altrit
d'autrui en tant qu'tranger, autre que moi, parat devoir tre, non
seulement entrelace avec l'altrit de la chair que je suis, mais tenue
sa faon pour pralable la rduction au propre. Car ma chair n'apparat
comme un corps parmi les corps que dans la mesure o je suis
moi-mme un autre parmi tous les autres, dans une apprhension de
la nature commune, tisse, comme le dit Husserl, dans le rseau de
l'intersubjectivit - elle-mme, la diffrence de ce que concevait Hus-
serl, instauratrice sa faon de l'ipsit. C'est parce que Husserl a pens
seulement l'autre que moi comme un autre moi, et jamais le soi comme
un autre, qu'il n'a pas de rponse au paradoxe que rsume la question :
comment comprendre que ma chair soit aussi un corps ?
N'est-ce pas alors du ct d'tre et Temps qu'il faudrait se tourner pour
laborer une ontologie de la chair qui tienne galement compte de
l'intimit soi de la chair et de son ouverture sur le monde ? C'est ici la
seconde face du paradoxe voqu plus haut, savoir que c'est Husserl et
non Heidegger qui a ouvert la voie cette ontologie, en dpit du fait que
le cadre gnral de pense d'Etre et Temps parat plus appropri une
telle entreprise ; en substituant la structure englobante de
l'tre-dans-le-monde au problme de la constitution d'un monde dans
et par la conscience, en appelant Dasein, tre-l, l'tant qui n'appartient
pas l'ensemble des tants tout donns et maniables, Heidegger n'a-t-il
pas libr en principe la problmatique du corps propre de l'preuve
d'une rduction au propre, l'intrieur de la rduction gnrale de tout
tre allant de soi ? En progressant rgressive-ment du sens de la
mondanit englobante au sens du dans, n'a-t-il pas point le
lieu philosophique de la chair? Bien plus, n'a-t-il pas fait place
l'affection (Befindlichkeit), au-del de toute psychologie des affects, dans
la constitution existen-tiale du l ( 29) ' ? Et n'a-t-il pas aperu, au cur
de toute affec-
1. En un sens, la thorie heideggnenne de l'affection peut tre interprte
comme un couronnement de l'entreprise biranienne. L'analytique du Dasein se
porte d'emble ce qui, pour Maine de Biran, restait la priphrie de l'analyse
de l'effort, savoir la reconnaissance de l'existence extrieure comme rsistance
des choses dans l'exprience du tact actif. Chez Maine de Biran, en effet, il fallait
passer d'abord par le lien de l'effort la rsistance, avant de poser, en quelque
376
377
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
tion, le fait massif de l'impossibilit de sortir d'une condition dans
laquelle nul n'est jamais entr, dans la mesure o la natalit elle-mme,
dont parle si bien Hannah Arendt, n'est pas proprement parler
l'exprience d'entrer dans le monde, mais celle d'tre dj n, et de se
trouver dj l ?
De ces prliminaires on pourrait conclure que, s'il est une catgorie
existentiale particulirement approprie une investigation du soi
comme chair, c'est celle d'tre-jet, jet-l. Si l'on veut bien admettre que
pareille expression ne suggre aucune chute partir d'un ailleurs, la
faon gnostique, mais la facticite partir de laquelle le Dasein devient
charge pour lui-mme - alors le caractre de fardeau de l'existence
signifie immdiatement remise soi-mme, donc ouverture, en vertu de
quoi toutes les tonalits affectives disent la fois l'intimit soi de
l'tre-l et des manires d'apparatre du monde. La notion d'un
projet-jet, voire dchu - ou chu , selon la traduction propose par
Mar-tineau pour dire le Verfallen heideggrien -, porte en effet au
concept l'tranget de la finitude humaine, en tant qu'elle est scelle par
l'incarnation, donc ce que nous appelons ici l'altrit prime, pour la
distinguer de l'altrit de l'tranger. On pourrait mme dire que la
jonction, dans le mme existential de l'affection, du caractre de fardeau
de l'existence et de la tche d'avoir -tre exprime au plus prs le
paradoxe d'une altrit constitutive du soi et donne ainsi une premire
fois toute sa force l'expression : soi-mme comme un autre .
Et pourtant, en dpit de la mise en place d'un appareil notion-nel qui
parat si appropri l'laboration d'une ontologie de la chair, on doit
constater que Heidegger n'a pas labor la notion de chair titre
d'existential distinct. A ce silence, je vois plusieurs raisons. La premire
concerne ce qu'on pourrait appeler l'incitation phnomnologique de
l'ontologie du Dasein. A trop mettre l'accent sur la peur (tre et Temps,
30) et finalement sur l'angoisse ressortissant l'tre-pour-la-mort, ne
nglige-t-on pas les instructions qu'une phnomnologie du
souffrir serait plus
sorte la lisire de l'exprience du corps actif, immanent au moi voulant,
l'preuve tactile de la ralit. En donnant pour cadre toute l'analyse l'existential
tre-dans-le-monde , Heidegger ouvre la voie une ontologie de la chair, o
celle-ci se donnerait penser non seulement comme incarnation du je suis,
mais comme mdiation pratique de cet tre-au-monde que nous sommes chacun
chaque fois. Cette conjonction entre chair et monde permettrait de penser les
modalits proprement passives de nos dsirs et de nos humeurs, comme le signe,
le symptme, l'indication du caractre contingent de notre insertion dans le
monde.
propre dispenser? C'est seulement chez Michel Henry qu'on trouve
celle-ci mise en uvre. Ensuite, si Ton reste dans le cadre trac par
l'ontologie de l'tre-dans-le-monde, on peut se demander si la
phnomnologie de la spatialit, bien amorce chez Husserl, reoit chez
Heidegger l'attention qu'elle mrite. Certes, le paragraphe 24 d'tre et
Temps est spcifiquement consacr la spatialit du Dasein et souligne
l'irrductibilit de cette spatialit l'espace gomtrique en tant que
systme de places quelconques. Pourquoi, alors, Heidegger n'a-t-il pas
saisi cette occasion pour rinterprter la notion husserlienne de chair
(Leib), qu'il ne pouvait pas ignorer, dans les termes de l'analytique du
Dasein ? La rponse qu'on peut donner cette question touche
peut-tre l'essentiel : comme le suggrent les paragraphes antrieurs
consacrs la spatialit du monde - l' ambiance du monde ambiant
(Martineau) -, c'est principalement aux formes inauthentiques du souci
que semble ressortir la dimension spatiale de l'tre-dans-le-monde ; la
spatialit du Dasein n'est certes pas celle d'un tre-sous-la-main, ni
mme d'un tre--porte-de-la-main, mais c'est sur le fond de la
spatialit des choses disponibles et maniables que la spatialit du Dasein
se dtache grand-peine. Si le thme de l'incarnation apparat comme
touff, sinon refoul, dans tre et Temps, c'est sans doute parce qu'il
a d paratre trop dpendant des formes inauthentiques du souci,
disons de la proccupation, qui nous incline nous interprter
nous-mmes en fonction des objets de notre souci '. On peut se
demander, ds lors, si ce n'est pas le dploiement de la problmatique de
la temporalit, triomphante dans la seconde section d'Etre et Temps,
qui a empch que ne soit donne sa chance une phnomnologie de
la spatialit authentique, et donc une ontologie de la chair; comme si
la temporalit tait le thme exclusif d'une mditation sur l'existence
authentique, et comme si les caractres authentiques de la spatialit
devaient tre finalement drivs de ceux de la temporalit. On peut enfin
se demander si Heidegger a aperu les ressources que pouvait receler
une philosophie de l'tre qui mettrait le transcendantal de l'acte la
1. Ce qui est dit de la rinterprtation des pathau livre II de la Rhtorique
d'Aristote, va dans ce sens: Ce n'est point un hasard si la premire inter-
prtation traditionnelle systmatique des affects ne s'est pas dploye dans le
cadre de la " psychologie ". Aristote tudie les pathau livre II de sa Rhtorique.
Celle-ci doit tre envisage - rencontre de l'orientation traditionnelle du
concept de rhtorique sur l'ide de " discipline scolaire " - comme la premire
hermneutique systmatique de la quotidiennet de rtre-l'un-avec-l'autre (tre
et Temps {139], trad. Martineau, p. 116 ; cf. trad. Vezin, p. 183).
378
379
SOI-MME COMME UN AUTRE VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
place de celui de la substance, comme le demande une phnomnologie
de l'agir et du ptir. Cette dernire remarque jette un pont entre les
rflexions de la prsente section et celles de la section prcdente de
cette tude. C'est le front entier de l'ontologie de l'ipsit qui doit bouger
selon les trois dimensions de l'altern.
b. L'altrit d'autrui
La seconde signification que revt la mta-catgorie d'altrit -l'altrit
d'autrui - est troitement soude aux modalits de passivit que
l'hermneutique phnomnologique du soi a croises tout au long des
tudes prcdentes quant au rapport du soi l'autre que soi. Une
nouvelle dialectique du Mme et de l'Autre est suscite par cette
hermneutique qui, de multiples faons, atteste qu'ici l'Autre n'est pas
seulement la contrepartie du Mme, mais appartient la constitution
intime de son sens. Au plan proprement phnomnologique, en effet, les
manires multiples dont l'autre que soi affecte la comprhension de soi
par soi marquent prcisment la diffrence entre Yego qui se pose et le
soi qui ne se reconnat qu' travers ces affections mmes.
Il n'est pas une de nos analyses o cette passivit spcifique du soi
affect par l'autre que soi ne se soit annonce. Ds le plan linguistique, la
dsignation par soi du locuteur est apparue entrelace, pour employer un
terme familier du vocabulaire husserlien, Finterlocution en vertu de
laquelle chaque locuteur est affect par la parole qui lui est adresse.
L'coute de la parole reue fait ds lors partie intgrante du discours
en tant que lui-mme est adress ...
Dans la seconde phase de notre travail, l'autodsignation de l'agent de
l'action est apparue insparable de l'ascription par un autre, qui me
dsigne l'accusatif comme l'auteur de mes actions. Dans cet change
entre ascription la seconde personne et autodsignation, on peut dire
que la reprise rflexive de cet tre-affect par l'ascription prononce par
autrui est entrelace l'ascription intime de l'action soi-mme. Cet
entrelacement s'exprime au plan grammatical par le caractre
omnipersonnel du soi qui circule entre tous les pronoms. L'affection du
soi par l'autre que soi est le support de cet change rgl entre les
personnes grammaticales.
C'est encore le mme change entre le soi affect et l'autre affectant
qui rgit au plan narratif l'assomption par le lecteur du
rcit des rles tenus par des personnages le plus souvent construits
en troisime personne, dans la mesure o ils sont mis en intrigue en
mme temps que l'action raconte. La lecture, en tant que milieu o
s'opre le transfert du monde du rcit - et donc aussi du monde des
personnages littraires - au monde du lecteur, constitue un lieu et un lien
privilgis d'affection du sujet lisant. La catharsis du lecteur, pourrait-on
dire en reprenant librement quelques catgories de l'esthtique de la
rception de H. R. Jauss, ne s'opre que si elle procde d'une aisthsis
pralable, que la lutte du lecteur avec le texte transforme en poisis '. Il
apparat ainsi que l'affection du soi par l'autre que soi trouve dans la
fiction un milieu privilgi pour des expriences de pense que ne
sauraient clipser les relations relles d'interlocution et d'interaction.
Bien au contraire, la rception des uvres de fiction contribue la
constitution imaginaire et symbolique des changes effectifs de parole et
d'action. L'tre-affect sur le mode fictif s'incorpore ainsi l'tre-affect
du soi sur le mode rel .
C'est enfin au plan thique que l'affection de soi par l'autre revt les
traits spcifiques qui relvent tant du plan proprement thique que du
plan moral marqu par l'obligation. La dfinition mme de l'thique que
nous avons propose - bien vivre avec et pour autrui dans des
institutions justes - ne se conoit pas sans l'affection du projet de
bien-vivre par la sollicitude la fois exerce et reue : la dialectique de
l'estime de soi et de l'amiti, avant mme toute considration portant sur
la justice des changes, peut entirement tre rcrite dans les termes
d'une dialectique de l'action et de l'affection. Pour tre ami de soi -
selon la phi-lautia aristotlicienne -, il faut dj tre entr dans une
relation d'amiti avec autrui, comme si l'amiti pour soi-mme tait une
auto-affection rigoureusement corrlative de l'affection par et pour
l'ami autre. En ce sens, l'amiti fait le lit de la justice, en tant que vertu
pour autrui , selon un autre mot d'Aristote. Le passage de l'thique
la morale - de l'optatif du bien-vivre l'impratif de l'obligation - s'est
opr, dans l'tude suivante, sous le signe de la Rgle d'Or, laquelle
nous avons pens rendre pleine justice en lui assignant le mrite de faire
intervenir le commandement la jointure mme de la relation
asymtrique entre le faire et le subir (le bien que tu voudrais qu'il te soit
fait, le mal que tu harais qu'il te soit fait). L'agir et le ptir paraissent
ainsi tre distribus entre deux protagonistes diffrents : l'agent et le
patient,
1. H. R. Jauss, La jouissance esthtique. Les expriences fondamentales de la
poisis, de l'aisthsis et de la catharsis , art. cit.
380 381
SOI-MMECOMMEUNAUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
ce dernier apparaissant comme la victime potentielle du premier. Mais,
en vertu de la rversibilit des rles, chaque agent est le patient de
l'autre. Et c'est en tant qu'affect par le pouvoir-sur lui exerc par
l'autre, qu'il est investi de la responsabilit d'une action d'emble
place sous la rgle de rciprocit, que la rgle de justice transformera en
rgle d'galit. C'est, en consquence, la cumulation en chaque
protagoniste des rles d'agent et de patient qui fait que le formalisme de
l'impratif catgorique requiert la matire d'une pluralit
d'agissants affects chacun par une violence rciproquement exerce.
La question ici pose est de savoir quelle figure nouvelle de l'al-trit
est convoque par cette affection de Yipse par l'autre que soi ; et, par
implication, quelle dialectique du Mme et de l'Autre rpond au rquisit
d'une phnomnologie du soi affect par l'autre que soi.
Je voudrais montrer essentiellement qu'il est impossible de construire
de faon unilatrale cette dialectique, soit que l'on tente avec Husserl
de driver Y aller ego de Yego, soit qu'avec E. Lvinas on rserve
l'Autre l'initiative exclusive de l'assignation du soi la responsabilit.
Une conception croise de l'altrit reste ici concevoir, qui rende
justice alternativement au primat de l'estime de soi et celui de la
convocation par l'autre la justice. L'enjeu, on va le voir, c'est une
formulation de l'altrit qui soit homogne la distinction fondamentale
entre deux ides du Mme, le Mme comme idem, et le Mme comme
ipse, distinction sur laquelle s'est fonde toute notre philosophie de
l'ipsit.
Nous ne reprendrons pas l'examen de la cinquime Mditation
cartsienne, au point o nous l'avons laisse avec la rduction la sphre
du propre, rduction laquelle nous devons l'amorce d'une ontologie
de la chair, sans nous tre au pralable inquits de savoir si la rduction
au propre se laisse penser non dialec-tiquement, c'est--dire sans
l'interfrence simultane de l'tranger. Certes, Husserl sait comme
tout le monde que nous ne sommes pas seuls et que nous nions notre
solitude transcendan-tale du seul fait que nous la nommons et
l'adressons quelque partenaire du discours des Mditations. Comme
chacun, il comprend, avant toute philosophie, le mot autrui comme
signifiant autre que moi. Cela dit, la cinquime Mditation procde du
coup d'audace accompli dans la Mditation prcdente, coup par lequel
Yego mditant rduit ce savoir commun au statut de prjug, donc le
tient pour non fond
1
. Vego mditant commencera
1. La quatrime Mditation dit de Yego que actif ou passif, [il] vit dans tous
les tats vcus de la conscience et (...) travers ceux-ci, se rapporte tous les ples-
donc par suspendre, donc par rendre entirement problmatique, tout ce
que l'exprience ordinaire doit autrui, afin de discerner ce qui, dans
cette exprience rduite la sphre du propre, requiert la position
d'autrui comme position aussi apodictique que la sienne. Ce
mouvement de pense est tout fait comparable au doute hyperbolique
de Descartes, sauf qu'il ne s'appuie sur l'hypothse d'aucun malin gnie ;
mais il consiste dans une opration trangre toute suspicion
quotidienne : c'est un acte philosophique de la famille des actes
fondateurs. Or, on le verra plus loin, c'est par une hyperbole
comparable, mais de sens oppos, qu'E. Lvinas inaugurera sa
conception de l'altrit radicale. Quant elle, Ypoch pratique ici par
Husserl, l'intrieur de Ypoch gnrale qui inaugure la
phnomnologie, est suppose laisser un reste qui ne doit rien autrui,
savoir la sphre du propre, laquelle ressortit l'ontologie de la chair
dont nous avons parl plus haut. Il faut insister : cette sphre du propre
est entirement tributaire, quant son sens, du coup de force de la
rduction dans la rduction. La seule voie qui reste ds lors ouverte est
de constituer le sens autrui dans (in) et partir (aus) du sens
moi. On dira dans un instant quelle trouvaille phnomnologique nous
devons ce coup d'audace, trouvaille qui quivaut une vritable
rbellion l'gard de tout projet de constitution, si constitution signifie
fondation dans et par moi. Mais il faut dire auparavant que tous les
arguments qui ambitionnent de constituer autrui dans et partir de
la sphre du propre sont circulaires, sans doute parce que la constitution
de la chose demeure tacitement le modle de cette constitution.
Que l'autre soit ds le dbut prsuppos, Ypoch par laquelle
l'analyse dbute le prouve une premire fois : d'une manire ou d'une
autre, j'ai toujours su que l'autre n'est pas un de mes objets de pense,
mais, comme moi, un sujet de pense ; qu'il me peroit moi-mme
comme un autre que lui-mme ; qu'ensemble nous visons le monde
comme une nature commune ; qu'ensemble,
objets (Husserl, Mditations cartsiennes, trad. fr. de E. Lvinas, Paris, Vrin,
1" d. 19S3, p. 56). C'est donc la dtermination des penses comme des actes et le
jeu qui en rsulte entre passivit et activit qui singularisent par principe Yego. De
plus, Yego de la quatrime Mditation s'avre le substrat de ses dispositions, de ses
convictions, de ses proprits permanentes, bref de ce que, depuis Aristote, on
appelle hexis, habitus ; par l Yego a un style, savoir le caractre d'une personne.
Plus fondamentalement encore, Yego est ce quoi appartiennent toutes les pen-
ses, au sens le plus large du mot, et fait de toutes les transcendances des modalits
de son intriorit. L'ego se laisse alors penser comme monadeet la phnom-
nologie comme gologie transcendantale.
382 383
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
encore, nous difions des communauts de personnes susceptibles
de se comporter leur tour sur la scne de l'histoire comme des
personnalits de degr suprieur. Cette teneur de sens prcde la
rduction au propre. Puis, la prsupposition de l'autre est une
deuxime fois - et plus secrtement - contenue dans la formation
mme du sens : sphre du propre. Dans l'hypothse o je serais seul,
cette exprience ne serait jamais totalisable sans le secours de l'autre
qui m'aide me rassembler, m'affermir, me maintenir dans mon
identit
1
. Encore moins, dans cette sphre du propre, la
transcendance ainsi rduite l'immanence mriterait-elle d'tre
appele un monde ; monde ne signifie encore rien avant la
constitution d'une nature commune. Enfin, et surtout, mon propre
corps, ma chair, ne peut servir de premier analogon un transfert
analogique s'il n'est pas dj tenu pour un corps parmi les corps.
Husserl lui-mme parle ici, comme on l'a not prcdemment, d'une
mondanisation par quoi je m'identifie l'une des choses de la
nature, savoir un corps physique. Cette mondanisation consiste
dans un authentique entrelacs (Verflech-tung) par quoi je m'aperois
comme chose du monde. Tout n'est-il pas par l mme dj jou ?
Que ma chair soit aussi corps, cela n'impique-t-il pas qu'elle
apparaisse telle aux yeux des autres ? Seule une chair (pour moi) qui
est corps (pour autrui) peut jouer le rle de premier analogon au
transfert analogique de chair chair.
Et pourtant, par un paradoxe semblable celui que nous vo-
quions dans la section prcdente, l'chec de la constitution
d'au-trui. en tant que constitution ressortissant l'ambition de
fondation caractristique d'une phnomnologie transcendantale de
caractre ultimement gologique, a t l'occasion d'une authentique
dcouverte, parallle celle de la diffrence entre chair et corps, et
d'ailleurs coordonne celle-ci, savoir celle du caractre
paradoxal du mode de donation d'autrui : les intentionnalits qui
visent autrui en tant qu'tranger, c'est--dire autre que moi, excdent
la sphre du propre dans laquelle pourtant elles s'enracinent.
Husserl a donn le nom d'apprsentation cette donation pour
1. Une conception psychanalytique comme celle de Heinz Kohut, appele pr-
cisment self-analysis, le confirme amplement ; sans le soutien des self-objects (au
sens psychanalytique du terme) le self manquerait de cohsion, de confiance en
soi, d'estime de soi - bref, lui ferait dfaut le narcissisme vrai. Autrement dit,
la chair menace de fragmentation a besoin du secours de l'autre pour s'identifier.
Il en rsulte que la chair reste jamais incompltement constitue (D. Franck,
op. cit., p. 130).
dire, d'une part, qu' la diffrence de la reprsentation par signe ou
par image la donation d'autrui est une authentique donation, d'autre
part, qu' la diffrence de la donation originaire, immdiate, de la
chair elle-mme la donation d'autrui ne permet pas de vivre les
vcus d'autrui, et en ce sens n'est jamais convertible en prsentation
originaire. Cela a t dit par ailleurs de la mmoire : la suite des
souvenirs d'autrui ne prendra jamais place dans la suite de mes
propres souvenirs. En ce sens, l'cart ne peut tre combl entre la
prsentation de mon vcu et l'apprsentation de ton vcu.
A cette double caractrisation ngative, Husserl ajoute le trait
positif qui constitue sa vritable trouvaille. L'apprsentation, dit-il,
consiste en un transfert aperceptif issu de ma chair (Mditations
cartsiennes, 50), plus prcisment en une saisie analogisante
qui a pour sige le corps d'autrui peru l-bas : saisie analogisante
en vertu de laquelle le corps d'autrui est apprhend comme chair,
au mme titre que la mienne. On peut demander, avec D. Franck,
en vertu de quoi un corps l-bas qui, en tant que tel, se prsente
comme transcendance immanente, peut recevoir le sens de chair et,
grce ce sens, apprsenter un autre ego dont la transcendance est
d'ordre suprieur (op. cit., p. 125). A vrai dire, la saisie du corps
l-bas comme chair est l'apprsentation elle-mme. Si on cherche l
un argument, on ne trouve qu'un cercle : l'apprsentation se
prsuppose elle-mme, ce en quoi elle constitue non seulement un
paradoxe par rapport toute constitution de chose, mais une nigme
que l'on ne peut que tourner en tous sens. Avance-t-on d'un degr en
caractrisant comme appartement (Paarung) la saisie du corps
l-bas comme chair? Une ide nouvelle est certes introduite,
savoir celle d'une formation en couple d'une chair avec l'autre. On
comprend bien que seul un ego incarn, c'est--dire un ego qui est
son propre corps, peut faire couple avec la chair d'un autre ego.
Mais que signifie faire couple ? Insistera-t-on sur la ressemblance
incluse dans la notion d'appariement ? Cela est parfaitement lgi-
time, mais condition de distinguer le transfert analogique de tout
usage discursif de la comparaison ; cet gard, l'apprsentation ne
diffre pas seulement de la saisie par signe ou par image et de
l'intuition originaire, mais encore de toute infrence par quoi on
conclurait par exemple d'une ressemblance objective entre
expressions une ressemblance entre vcus psychiques ' ; c'est
1. A cet gard, le rle que Husserl assigne la saisie concordanted'esquisses
n'est pas comprendre dans les termes d'un raisonnement concluant de la concor-
dance des prsentations celle des apprsentations ; il s'agit plutt d'une relation
384
385
SOI-MME COMME UN AUTRE
VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
plutt des synthses passives qu'il faudrait rapprocher la saisie
analogisante, si celle-ci ne doit pas tre une infrence ; le transfert par
quoi ma chair forme paire avec une autre chair est une opration
prrflexive, antprdicative ; mais il s'agit alors d'une synthse passive
hors pair - la plus primitive peut-tre, et que l'on retrouverait
entrelace toutes les autres synthses passives . En outre,
l'assimilation d'un terme l'autre, que parat impliquer la saisie
analogisante, doit tre corrige par l'ide d'une dissymtrie
fondamentale, lie l'cart qu'on a dit plus haut entre apprsentation
et prsentation originaire ; jamais l'apparie-ment ne fera franchir la
barrire qui spare l'apprsentation de l'intuition. La notion
d'apprsentation combine ainsi de faon unique similitude et
dissymtrie.
Alors, demandera-t-on, qu'a-t-on gagn introduire ces notions
d'apprsentation, de saisie analogisante, d'appariement ? Si elles ne
peuvent tenir lieu d'une constitution dans et partir de l'ego, elles
servent du moins cerner une nigme que l'on peut localiser : la sorte de
transgression de la sphre du propre que constitue l'apprsentation ne
vaut que dans les limites d'un transfert de sens : le sens ego est
transfr un autre corps qui, en tant que chair, revt lui aussi le sens
ego. De l l'expression parfaitement adquate d'alter ego au sens de
seconde chair propre (l'expression est de D. Franck, op. cit., p. 135).
Ressemblance et dissymtrie portent sur le sens ego et sur le sens aller
ego. Tenue dans ces bornes, la dcouverte de Husserl est ineffaable.
On verra plus loin qu'elle ne porte tous ses fruits que coordonne avec le
mouvement venant d'autrui vers moi. Mais si ce second mouvement a
priorit dans la dimension thique, le mouvement de Y ego Yal-ter ego
garde une priorit dans la dimension gnosologique. Dans cette
dimension, le transfert analogique que pointe Husserl est une
opration authentiquement productive, dans la mesure o elle
transgresse le programme mme de la phnomnologie, en transgressant
l'exprience de la chair propre. Si elle ne cre pas l'altrit, toujours
prsuppose, elle lui confre une signification spcifique, savoir
l'admission que l'autre n'est pas condamn rester un tranger, mais
peut devenir mon semblable, savoir quelqu'un qui, comme moi, dit je
. La ressemblance fonde sur l'appariement de chair chair vient
rduire une distance,
indiciaire, o l'interprtation se fait de manire immdiate, comme une lecture de
symptmes. Le style de confirmation quoi ressortit cette lecture d'indices relve
du mme discours en ni..., ni..., caractristique de l'apprsentation : ni intuition
donatrice originaire, ni infrence discursive.
combler un cart, l mme o il cre une dissymtrie. Ce que signifie
l'adverbe comme : comme moi, l'autre pense, veut, jouit, souffre. Si l'on
objecte que le transfert de sens ne produit pas le sens aller de Val ter
ego, mais le sens ego, il faut rpondre qu'il en est bien ainsi dans la
dimension gnosologique. Le sens ego, dans aller ego, c'est celui que
nous avons prsuppos dans toutes nos tudes portant sur
l'autodsignation de toute autre personne que moi, dans le langage,
l'action, le rcit et l'imputation morale. A la limite, ce transfert de sens
peut revtir la forme d'une citation, en vertu de laquelle il pense ,
elle pense signifie : il/elle dit dans son cur : je pense . Voil la
merveille du transfert analogique.
C'est ici que le transfert analogique de moi autrui recroise le
mouvement inverse d'autrui moi. Il le recroise, mais ne l'abolit pas, si
mme il ne le prsuppose.
Ce mouvement d'autrui vers moi est celui qu'inlassablement dessine
l'uvre d'E. Lvinas. A l'origine de ce mouvement, une rupture. Et cette
rupture survient au point d'articulation de la phnomnologie et de
l'ontologie des grands genres , le Mme et l'Autre. C'est pourquoi
nous avons rserv la prsente tude la rencontre avec l'uvre
d'Emmanuel Lvinas. Sous son angle critique, en effet, cette uvre est
dirige contre une conception de l'identit du Mme, laquelle est
polairement oppose l'altrit de l'Autre, mais cela un plan de
radicalit o la distinction que je propose entre deux sortes d'identit,
celle de Y ipse et celle de Y idem, ne peut tre prise en compte : non
certes par un effet de ngligence phnomnologique ou hermneutique,
mais parce que, chez E. Lvinas, l'identit du Mme a partie lie avec une
ontologie de la totalit que ma propre investigation n'a jamais assume,
ni mme rencontre. Il en rsulte que le soi, non distingu du moi,
n'est pas pris au sens de dsignation par soi d'un sujet de discours,
d'action, de rcit, d'engagement thique. Une prtention l'habite, qui est
plus radicale que celle qui anime l'ambition fichtenne, puis
husserlienne, de constitution universelle et d'au-tofondation radicale ;
cette prtention exprime une volont de fermeture, plus exactement un
tat de sparation, qui fait que l'altrit devra s'galer Y extriorit
radicale.
De quelle manire Husserl est-il concern par cet effet de rupture ? En
ceci que la phnomnologie, et son thme majeur l'in-tentionnalit,
relvent d'une philosophie de la reprsentation qui, selon Lvinas, ne
peut qu'tre idaliste et solipsiste. Se reprsenter quelque chose, c'est
l'assimiler soi, l'inclure en soi, donc en
386
387
SOI-MMECOMMEUNAUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
nier l'altrit. Le transfert analogique, qui est l'apport essentiel de la
cinquime Mditation cartsienne, n'chappe pas ce rgne de la
reprsentation. C'est donc sous un rgime de pense non gno-sologique
que l'autre s'atteste. Ce rgime est fondamentalement celui de K thique.
Quand le visage d'autrui s'lve face moi, au-dessus de moi, ce n'est
pas un apparatre que je puisse inclure dans l'enceinte de mes
reprsentations miennes ; certes l'autre apparat, son visage le fait
apparatre, mais le visage n'est pas un spectacle, c'est une voix '. Cette
voix me dit : Tu ne tueras pas. Chaque visage est un Sina qui interdit
le meurtre. Et moi ? C'est en moi que le mouvement parti de l'autre
achve sa trajectoire : l'autre me constitue responsable, c'est--dire
capable de rpondre. Ainsi la parole de l'autre vient-elle se placer
l'origine de la parole par laquelle je m'impute moi-mme l'origine de
mes actes. L'auto-imputation, thme central de nos trois tudes pr-
cdentes, s'inscrit maintenant dans une structure dialogale asymtrique
dont l'origine est extrieure moi.
La question souleve par cette conception de l'Autre ne se pose pas au
niveau des descriptions, d'ailleurs admirables, qui relvent encore de ce
qu'on pourrait appeler une phnomnologie alternative, une
hermneutique autre, que l'on pourrait la rigueur placer dans le
prolongement de l'thique kantienne. En un sens, en effet, Lvinas
rompt avec la reprsentation, comme Kant soustrait la raison pratique
au rgne de la raison thorique. Mais, alors que Kant mettait le respect
de la loi au-dessus du respect des personnes, avec Lvinas le visage
singularise le commandement : c'est chaque fois pour la premire fois
que l'Autre, tel Autre, me dit : Tu ne tueras pas. La philosophie de
Lvinas, comme on l'a suggr plus haut, procde plutt d'un effet de
rupture qui survient au point o ce que nous venons d'appeler une
phnomnologie alternative s'articule sur un remaniement des
grands genres du Mme et de l'Autre. Parce que le Mme signifie
totalisation et sparation, l'extriorit de l'Autre ne peut plus dsormais
tre exprime dans le langage de la relation. L'Autre s'absout de la
relation, du mme mouvement que l'Infini se soustrait la Totalit.
Mais comment penser l'irrelation qu'implique une telle altrit dans
son moment d'ab-solution ?
Il me parat que l'effet de rupture attach cette pense de l'altrit
ab-solue procde d'un usage de hyperbole, digne du doute
hyperbolique cartsien et diamtralement oppos l'hyperbole
1. Le visage parle (Totalitet Infini ; essai sur l'extriorit, La Haye, M.
Nij-hoff, 1961, p. 37) ; de mme : L'il ne luit pas, il parle (op. cit., p. 38).
par laquelle nous avons caractris plus haut la rduction au propre
chez Husserl. Par hyperbole, il faut le souligner avec force, il ne faut pas
entendre une figure de style, un trope littraire, mais la pratique
systmatique de Vexcs dans l'argumentation philosophique.
L'hyperbole apparat ce titre comme la stratgie approprie la
production de l'effet de rupture attach l'ide d'extriorit au sens
d'altrit ab-solue.
L'hyperbole atteint en fait simultanment les deux ples du Mme et
de l'Autre. Il est remarquable que Totalit et Infini mette d'abord en
place un moi livr la volont de faire cercle avec lui-mme, de
s'identifier. Plus encore que dans Le Temps et l'Autre, qui parlait du moi
encombr de soi (p. 37), le moi d'avant la rencontre de l'autre, on
dirait mieux d'avant l'effraction du moi par l'autre, est un moi
obstinment ferm, verrouill, spar. Ce thme de la sparation, tout
nourri qu'il soit de phnomnologie - d'une phnomnologie, dirait-on,
de l'gotisme -, est dj marqu du sceau de l'hyperbole : hyperbole qui
s'exprime dans la virulence d'une dclaration telle que celle-ci : dans
la sparation le moi ignore Autrui (Totalit et Infini, p. 34). Pour un tel
moi, incapable de l'Autre, Vpiphanie du visage (thme encore
phnomnologique) signifie une extriorit ab-solue, c'est--dire non
relative (thme relevant de la dialectique des grands genres ).
A l'hyperbole de la sparation, du ct du Mme, rpond l'hyperbole
de l'piphanie, du ct de l'Autre. Epiphanie dit autre chose que
phnomne. L' apparoir du visage se soustrait la vision des formes
et mme l'coute sensible des voix. C'est que l'Autre, selon Totalit et
Infini, n'est pas un interlocuteur quelconque, mais une figure
paradigmatique du type d'un matre de justice. Hyperbolique, en ce sens,
est l'assertion que la parole est toujours enseignante (ibid., p. 70).
L'hyperbole est la fois celle de la Hauteur et celle de l'Extriorit.
Hauteur : le visage de l'Autre, on l'a dit, m'interpelle comme du Sina.
Extriorit : l'instruction du visage, la diffrence de la maeutique du
Mnon de Platon, n'veille aucune rminiscence. La sparation a rendu
l'intriorit strile. L'initiative revenant intgralement l'Autre, c'est
l'accusatif - dsinence bien nomme - que le moi est rejoint par
l'injonction et rendu capable de rpondre, l'accusatif encore : Me
voici ' ! L'hyperbole, dans Totalit et Infini, culmine dans
l'affirmation que l'instruction par le visage ne res-
1. Hyperbole: accusatif qui n'est modification d'aucun nominatif (ibid., p.
159).
388
389
SOI-MME COMME UN AUTRE VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
taure aucun primat de la relation sur les termes. Aucun entredeux ne
vient attnuer l'entire dissymtrie entre le Mme et l'Autre.
Autrement qu'tre ou au-del de l'essence renchrit sur l'hyperbole
jusqu' lui donner un tour paroxystique. Tout un travail prparatoire de
dmolition consomme les ruines de la reprsentation , du thme ,
du Dit , pour ouvrir au-del du Dire l're du Ddire . C'est au
nom de ce Ddire que Yassigna-tion la responsabilit se soustrait au
langage de la manifestation, son dit et son thme. C'est en tant que
ddire que Y assignation la responsabilit adopte le tour de l'hyperbole,
dans un registre d'excs encore non atteint. Ainsi l'assignation la
responsabilit est-elle rapporte un pass plus vieux que tout pass
remmorable, donc encore susceptible de reprise dans une conscience
prsente ; l'injonction relve d'un en-de de tout commencement, de
toute arche : le ddit de Xarche se nomme an-archie. Relve encore de
l'hyperbole l'vocation de l'tre assign, qui ne serait l'envers d'aucune
activit, donc d' une responsabilit qui ne se justifie par aucun
engagement pralable (ibid., p. 129). A partir de l, le langage se fait
toujours plus excessif: obsession de l'Autre , perscution par
l'Autre , enfin et surtout substitution du moi l'Autre . Ici est atteint
le point paroxystique de toute l'uvre : sous l'accusation de tous, la
responsabilit pour tous va jusqu' la substitution. Le sujet est otage
(ibid., p. 142). Et encore : l'ipsit, dans sa passivit sans arche de
l'identit, est otage (ibid., p. 145). Cette expression, excessive entre
toutes, est jete l pour prvenir le retour insidieux de Fauto-affirmation
de quelque libert clandestine et dissimule jusque sous la passivit
du soi assign la responsabilit. Le paroxysme de l'hyperbole me parat
tenir l'hypothse extrme - scandaleuse mme - que l'Autre n'est
plus ici le matre de justice, comme c'tait le cas dans Totalit et Infini,
mais l'offenseur, lequel, en tant qu'offenseur, ne requiert pas moins le
geste qui pardonne et qui expie. Que ce soit bien l le lieu o E.
Lvinas voulait conduire son lecteur n'est pas douteux : Que
l'emphase de l'ouverture soit la responsabilit pour l'autre jusqu' la
substitution -le pour l'autre du dvoilement, de la monstration l'autre,
virant en pour l'autre de la responsabilit - c'est en somme la thse du
prsent ouvrage (ibid., p. 152). En effet, ici seulement, l'abme creus
entre altrit et identit est franchi : Il faut parler ici d'expiation,
comme runissant identit et altrit (ibid., p. 151).
Paradoxalement, c'est l'hyperbole de la sparation, du ct du
Mme, qui me parat conduire l'impasse l'hyperbole de l'extriorit, du
ct de l'autre, moins que l'on ne croise le mouvement - thique par
excellence - de l'autre vers le soi avec le mouvement - gnosologique,
on l'a dit - du soi vers l'autre. A vrai dire, ce que l'hyperbole de la
sparation rend impensable, c'est la distinction entre soi et moi, et la
formation d'un concept d'ipsit dfini par son ouverture et sa fonction
dcouvrante.
Or le thme de l'extriorit n'atteint le terme de sa trajectoire, savoir
l'veil d'une rponse responsable l'appel de l'autre, qu'en prsupposant
une capacit d'accueil, de discrimination et de reconnaissance, qui
relve mon sens d'une autre philosophie du Mme que celle laquelle
rplique la philosophie de l'Autre. Si, en effet, l'intriorit n'tait
dtermine que par la seule volont de repli et de clture, comment
entendrait-elle jamais une parole qui lui serait si trangre qu'elle serait
comme rien pour une existence insulaire ? Il faut bien accorder au soi une
capacit d'accueil qui rsulte d'une structure rflexive, mieux dfinie par
son pouvoir de reprise sur des objectivations pralables que par une
sparation initiale. Bien plus, ne faut-il pas joindre cette capacit
d'accueil une capacit de discernement et de reconnaissance, compte
tenu de ce que l'altrit de l'Autre ne se laisse pas rsumer dans ce qui
parat bien n'tre qu'une des figures de l'Autre, celle du matre qui
enseigne, ds lors que l'on doit prendre en compte celle de l'offenseur
dans Autrement qu'tre? Et que dire de l'Autre, quand il est le
bourreau? Et qui donc distinguera le matre du bourreau ? le matre qui
appelle un disciple, du matre qui requiert seulement un esclave ? Quant
au matre qui enseigne, ne demande-t-il pas tre reconnu, dans sa
supriorit mme ? Autrement dit, ne faut-il pas que la voix de l'Autre
qui me dit : Tu ne tueras pas , soit faite mienne, au point de devenir
ma conviction, cette conviction qui gale l'accusatif du : Me voici !
avec le nominatif du : Ici je me tiens ? Enfin, pour mdiatiser
l'ouverture du Mme sur l'Autre et l'intriorisation de la voix de l'Autre
dans le Mme, ne faut-il pas que le langage apporte ses ressources de
communication, donc de rciprocit, comme l'atteste l'change des
pronoms personnels tant de fois voqu dans les tudes prcdentes,
lequel reflte un change plus radical, celui de la question et de la rponse
o les rles ne cessent de s'inverser ? Bref, ne faut-il pas qu'une
dialogique superpose la relation la distance prtendument ab-solue
entre le moi spar et l'Autre enseignant ' ?
1. Cf. Francis Jacques, DialogiquesI I . Paris, PUF, 1984.
390 391
SOI-MMECOMMEUN AUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
C'est finalement dans le thme de la substitution, o culmine la force
de l'hyperbole et s'exprime dans sa plus extrme vigueur la philosophie
de Paltrit, que je perois une sorte de renversement du renversement
opr dans Totalit et Infini. L'assignation responsabilit, issue de
l'interpellation par l'Autre, et interprte dans les termes de la
passivit la plus totale
1
, s'inverse dans un lan d'abngation o le soi
s'atteste par le mouvement mme en lequel il se dmet. Qui, en effet,
est obsd par l'Autre ? Qui, l'otage de l'Autre, sinon un Mme qui n'est
plus dfini par la sparation, mais par son contraire, la Substitution
2
?
Je trouve confirmation de cette interprtation du thme de la
substitution dans le rle assign, sous le contrle d'ailleurs de ce mme
thme, la catgorie du tmoignage
3
. On voit bien quoi tmoignage est
rendu : l'absolu, certes, donc la Hauteur, dnomme gloire de
l'infini , et l'Extriorit, dont le visage est comme la trace. En ce sens,
il n'y a de tmoignage (...) que de l'infini... (Autrement qu'tre..., p.
186). Mais qui tmoigne, sinon le Soi, distingu dsormais du moi, en
vertu de l'ide d'assignation responsabilit ? Le Soi, c'est le fait mme
de s'exposer, sous l'accusatif non assumable o le Moi supporte les
autres, l'inverse de la certitude du Moi se rejoignant lui-mme dans
la libert (ibid., p. 151). Le tmoignage, c'est donc le mode de vrit de
cette autoexposition du Soi, inverse de la certitude du Moi. Ce
tmoignage est-il si loign de ce que nous avons constamment
dnomm attestation ? Certes, Lvinas ne parle jamais d'attestation de
soi, tant l'expression serait souponne de ramener la certitude du
Moi . Il reste que, par le biais de l'accusatif, la premire personne est
indirectement concerne, et que l'accusatif ne peut rester non
assumable , pour reprendre l'expression cite plus haut, sous peine
de retirer toute signification au thme mme de
1. Dans le paragraphe consacr au sujet responsable qui ne s'absorbe pas dans
l'tre (Autrement qu'tre..., p. 172-178), on note ceci : Dans la responsabilit, le
Mme, le Moi, c'est moi, assign, provoqu comme irremplaable et ainsi accus
comme unique dans la suprme passivit de celui qui ne peut se drober sans
carence (ibid., p. 172-173).
2. L'trange renversement opr, au plan du mme, par le thme de la substitu-
tion trouve sa conscration dans la formule qui nous a arrts plus haut : il faut
parler ici d'expiation comme runissant identit et altrit (ibid., p. 151).
3. Je consacre une analyse dtaille la catgorie de tmoignage chez . Lvi-
nas par la voie d'une confrontation avec Heidegger et avec Jean Nabert, ce dernier
rapprochement tant assurment le moins attendu des deux dans Emmanuel
Lvinas, penseur du tmoignage , in Rpondred'autrui. Emmanuel Lvinas (col-
lectif), Neuchtel, La Baconnire, 1989.
la substitution sous l'gide duquel celui du tmoignage est rassum
par E. Lvinas.
De cette confrontation entre E. Husserl et E. Lvinas ressort la
suggestion qu'il n'y a nulle contradiction tenir pour dialectique-ment
complmentaires le mouvement du Mme vers l'Autre et celui de
l'Autre vers le Mme. Les deux mouvements ne s'annulent pas dans la
mesure o l'un se dploie dans la dimension gnosologique du sens,
l'autre dans celle, thique, de l'injonction. L'assignation responsabilit,
selon la seconde dimension, renvoie au pouvoir d'autodsignation,
transfr, selon la premire dimension, toute troisime personne
suppose capable de dire je . Cette dialectique croise du soi-mme
et de l'autre que soi n'avait-elle pas t anticipe dans l'analyse de la
promesse ? Si un autre ne comptait sur moi, serais-je capable de tenir ma
parole, de me maintenir ?
c. La conscience
Tenir la conscience - au sens de l'allemand Gewissen - pour le lieu
d'une forme originale de dialectique entre ipsit et altrit constitue
une entreprise hrisse d'embches.
Premier dfi : si la mtaphore de la voix et de l'appel semble ajouter
une dimension indite aux concepts autour desquels se sont organises
nos investigations des concepts de bas de l'thique, ce surplus de sens
ne se concrtise-t-il pas ncessairement dans des notions aussi
suspectes que la mauvaise et la bonne conscience ? Ce dfi
donnera l'occasion de mettre l'preuve la thse selon laquelle
l'attestation de l'ipsit est insparable d'un exercice de soupon.
Second dfi : supposer que l'on puisse la librer du joug des prjugs
lis la bonne et la mauvaise conscience, la conscience
dsigne-t-elle un phnomne distinct de l'attestation de notre
pouvoir-tre ? L'enjeu sera ici, face cette version non morale de la
conscience de prciser les phnomnes tels que Y injonction ou la dette
que la mtaphore de la voix semble dsigner.
Troisime dfi : et si l'injonction ou la dette constituent l'ultime
rquisit de la conscience, la part d'altrit qui s'y laisse discerner
est-elle autre que celle de l'altrit d'autrui, ventuellement sous des
guises auxquelles notre investigation prcdente n'aurait pas su faire
droit ? Bref, qu'est-ce qui lgitime que l'on assigne une place, une place
distincte, au phnomne de la conscience, au plan des grands genres
du Mme et de l'Autre ?
392 393
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
Le premier dfi nous contraint entrer dans la problmatique de la
conscience par la porte du soupon. Il n'y a pas lieu de le regretter, dans
la mesure o le phnomne de la conscience garde une parent certaine
avec l'attestation, dont nous avons dit plus haut qu'elle entremle
Ptre-vrai et l'tre-faux. La conscience est en vrit le lieu par excellence
o les illusions sur soi-mme sont intimement mles la vracit de
l'attestation. Le soupon porte trs prcisment sur le prtendu surplus
de sens que l'ide de conscience parat superposer au concept majeur
de l'thique : vu de vivre-bien (avec les adjonctions que l'on sait),
obligation et conviction. Aprs tout, nos trois tudes consacres
l'thique ont toutes t menes sur la base de notions communes, dont la
Rgle d'Or est l'exemple le plus frappant, sans que l'on ait eu riger la
conscience en instance supplmentaire. Il y a nanmoins problme, dans
la mesure o la conscience, sans rien ajouter la teneur de sens des
concepts directeurs de l'thique, rinscrit ces concepts dans la
dialectique de Mme et de l'Autre, sous la guise d'une modalit
spcifique de passivit. C'est de cette passivit hors pair que la
mtaphore de la voix, la fois intrieure moi et suprieure moi, est
le symptme ou l'indice.
Dans le chapitre d'tre et Temps, intitul prcisment Gewis-sen,
l'analyse duquel nous reviendrons plus longuement quand nous
prendrons en compte le second dfi voqu l'instant, Heidegger a
parfaitement dcrit ce moment d'altrit qui distingue la conscience. Or
cette altrit, loin d'tre trangre la constitution de l'ipsit, est
troitement lie son mergence, dans la mesure o, sous l'impulsion de
la conscience, le soi est rendu capable de se reprendre sur l'anonymat du
on . Cette implication de la conscience dans l'opposition entre le soi
et le on , n'exclut pas une autre sorte de rapport entre tre-soi et
tre-avec, dans la mesure o, d'une part, le on est dj une modalit
inauthentique de l'tre-avec et o, d'autre part, ce retrait dans le for
intrieur offre autrui le vis--vis qu'il est en droit d'attendre, savoir
prcisment le soi-mme. Or, comment le soi s'arrache-t-il au on ? Ici
s'annonce le trait qui spcifie le phnomne de la conscience, savoir la
sorte de cri (RuJ), d'appel (AnruJ), que signale la mtaphore de la voix.
Dans cet intime colloque, le soi apparat interpell et, en ce sens, affect
de faon singulire. A la diffrence du dialogue de l'me avec
elle-mme, dont parle Platon, cette affection par une voix autre prsente
une dissymtrie remarquable, qu'on peut dire verticale, entre
l'instance qui appelle et le soi appel. C'est la verticalit de l'appel,
gale son intriorit, qui fait l'nigme du phnomne de la
conscience.
Or, l'authenticit de ce phnomne ne peut tre que pniblement
reconquise, non pas vraiment aux dpens de la mta-phoricit en tant
que telle de l'expression voix de la conscience - la mtaphore
n'tant pas selon nous exclusive d'une vritable capacit dcouvrante
1
-, mais contre-courant des interprtations moralisantes qui en
dissimulent prcisment la force dcouvrante.
C'est ici que l'preuve de soupon s'avre bnfique, pour recouvrer
la capacit dcouvrante de la mtaphore de la voix. Pour ce faire, on
mobilisera la force de dnonciation qui rsonne, avant le coup de
tonnerre nietzschen, dans le coup de semonce hglien.
C'est en effet une virulente critique de la msinterprtation de la
conscience qu'on peut lire dans les pages que la Phnomnologie de
l'esprit consacre la vision morale du monde
2
; que le phnomne
authentique de la conscience ne soit pas entran dans la chute de la
vision morale du monde, la suite du chapitre vi auquel la fameuse
critique appartient l'atteste : le Gewis-sen est solidaire d'une dialectique
de degr suprieur o s'affrontent la conscience agissante et la
conscience jugeante : le pardon , issu de la reconnaissance l'un par
l'autre des deux antagonistes confessant la limite de leurs points de vue
et renonant leur partialit, dsigne le phnomne authentique de la
conscience. C'est sur le chemin de cette reconnaissance que prend place
la critique de la vision morale du monde.
Il est remarquable que cette critique acerbe s'attaque des
postulats entirement construits pour les besoins de la cause, et dans
lesquels il est difficile de reconnatre non seulement ce que Kant
appelle postulat dans la Dialectique de la Raison pratique, mais plus
encore les traits du formalisme kantien, ramen, comme nous l'avons
fait plus haut, la mise en uvre de l'preuve d'universalisation. Il ne
faut pourtant pas regretter l'artifice de la construction hglienne de
cette figure ; artifice qui prend place parmi les excs, transgressions,
hyperboles de toutes sortes dont se nourrit la rflexion morale et peut-tre
la rflexion philosophique en gnral. En outre, que ce soit une vision
du monde que le moralisme mobilise est de la plus grande importance.
Le premier postulat est en effet que la moralit, tout en exigeant que le
devoir soit fait, donc devienne rel, frappe d'insignifiance la nature
entire, travers la condamnation du dsir, qui
1. Cf. La Mtaphorevive, septime tude.
2. Phnomnologiedel'esprit, op. cit., t. II, p. 144.
394
395
SOI-MMECOMMEUN AUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
est la nature en nous ; second postulat : faute de savoir produire aucune
harmonie entre le devoir-tre et l'tre, la moralit ajourne l'infini le
moment de la satisfaction que pourtant l'agent cherche dans
l'effectivit de l'action ; enfin, troisime postulat, cet accord de la
forme et du contenu n'tant pas donn ici-bas, il est report dans une
autre conscience, celle d'un saint lgislateur situ hors du monde.
Il importe peu, encore une fois, que Hegel ait travesti Kant ou
probablement Fichte dans la construction de ses postulats
1
. L'essentiel
pour nous est qu'elle ait suscit une stratgie de dmantlement
applique au dplacement quivoque (die Verstel-lung) laquelle
est consacre la section suivante de la phnomnologie. C'est en
effet un jeu d'esquive, que la conscience se livre, traque qu'elle est
d'une position intenable l'autre, pour tenter d'chapper aux
contradictions que dissimulent ces postulats de la vision morale du
monde ; comment en effet l'intention garderait-elle son srieux, si la
satisfaction de l'action est un leurre ? Comment le devoir restera-t-il le
devoir-tre, si l'effectivit s'enfuit sans fin ? Comment l'autonomie
res-tera-t-elle le principe moral souverain, si la rconciliation avec la
ralit est reporte dans un autre monde ? C'est avec mpris que l'on
donnera donc cong une hypocrisie que ne russissent pas dissimuler
les dplacements quivoques. Or, toute cette critique n'a de sens que dans
la perspective du moment ultrieur de l'esprit, dj prsent comme en
ngatif ou en filigrane dans le dplacement quivoque. C'est pourquoi
Hegel a plac les trois moments, de la vision morale du monde, du
dplacement quivoque, de la dialectique de la belle me et du hros de
l'action, culminant dans le moment de la rconciliation et du pardon,
sous le titre de : L'esprit certain de soi-mme. La moralit
1
. C'est cet
acheminement de la critique de la vision morale du monde vers le point
o le Gewissen s'gale la certitude de soi-mme qui fait que chez
Hegel ne retentit encore qu'un coup de semonce, avant qu'clate avec
Nietzsche le coup de tonnerre dcisif
3
.
1. M. Gueroult, Les dplacements (Verstellungen) de la conscience morale
kantienne selon Hegel, in Hommage J ean Hyppolite, Paris, PUF, 1971, p.
47-80.
2. Phnomnologiedel'esprit, trad. Hyppolite, t. II, p. 142.
3. Une critique tout aussi acerbe de la conscience jugeante se lit dans la
deuxime partie des Principes dela philosophiedu droit, op. cit., consacre la
moralit (Moralitt) dont on sait la subordination la vie thique (Sitllichkeit),
laquelle culmine dans la thorie de l'tat. La volont subjective, abstraite, limite
et formelle ( 108), est le thme de cette deuxime partie dont il ne faut pas
accentuer l'excs le tour critique. Car la volont subjective a aussi son droit, qui
est au minimum celui de voir le projet de la volont reconnu comme lemien
De la deuxime dissertation de la Gnalogie de la morale, intitule
La Faute [Schuld], la mauvaise conscience [schlechtes
( 114). La critique de la conscience s'articule au point exact o la revendication
du droit propre de la volont subjective s'autonomise par rapport toute vise
communautaire, que ce soit celle de la famille, de la socit civile ou de l'tat. Il
est remarquable que Hegel ait associ la conscience l'ide du Bien dans la troi-
sime section de cette deuxime partie. C'est certes au Bien que la volont se
dcide dans les limites de sa subjectivit, mais un Bien prcisment biais par la
perspective subjective mme, crible par le sens du devoir (S 133). Reviennent les
antinomies du devoir seulement formel dnonces dans la Phnomnologiedel'es-
prit et auquel les Principes renvoient expressment ( 135). Le seul arbitre du
rem-plissement du devoir formel et abstrait est alors la conscience ( 136), livre
la solitude et l'arbitraire du for interne. On lit dans une addition au 136 :
La conscience est (...) cette profonde solitude avec soi-mme, dans laquelle toute
ralit extrieure, toute limitation a disparu (op. cit., p. 173). C'est l'absence des
contenus que seule la vie thique apporte, qui condamne la conscience cette soli-
tude et cet arbitraire : Ici, au point de vue formel de la moralit, il manque la
conscience ce contenu objectif: elle est donc, pour soi, la certitude [Gewissheit]
formelle infinie de soi-mme, qui, prcisment pour cette raison, est en mme
temps la certitude de ce sujet-ci ( 137). Alors, mme la diffrence entre le bien
et le mal est abolie : En rendant vaines toutes les dterminations en vigueur et en
se rfugiant dans la pure intriorit de la volont, la conscience de soi constitue la
possibilit de prendre pour principe aussi bien l'universel en soi et pour soi que
l'arbitraire ou sa propre particularit, leve au-dessus de l'universel, et de les ra-
liser par son activit. Dans le second cas, elle constitue la possibilit d'tre mau-
vaise. - Remarque : N'tant que subjectivit formelle, la conscience est finale-
ment toujours sur le point de tomber dans le mal. La moralit et le mal ont leur
racine commune dans la certitude de soi-mme, qui est pour soi, qui sait pour soi,
qui dcide pour soi ( 139). Il est noter pourtant que, dans le cadre de cette cri-
tique incisive, une place est rserve la conscience vritable ( 137). Mais
celle-ci n'est pas autre chose que la disposition thique . C'est sans doute l une
des diffrences majeures entre les Principes dela philosophiedu droit et la Phno-
mnologiedel'esprit : dans celle-ci, la conscience se dpassait dans la religiosit du
pardon ; dans les Principes..., la conscience laisse sans critre autre que sa convic-
tion propre, s'absorbe dans le politique qui lui confie les dterminations objec-
tives dont elle est essentiellement dpourvue. Mais qu'arrive-t-il quand la vie
thique d'un peuple est fondamentalement corrompue ? N'est-ce pas alors dans la
conscience de ces rsistants, que le mensonge et la peur ont cess d'intimider, que se
rfugie l'intgrit de la vie thique elle-mme ? Hegel a cru dpasser le temps du
recours la conscience : Le repli vers l'intrieur pour chercher en soi ce qui est
juste et bon, pour le connatre et le dterminer par soi-mme, apparat dans l'his-
toire comme une figure gnrale (chez Socrate, chez les Stociens, etc.) des
poques o ce qui passe pour tre la justice et le Bien dans la ralit et dans les
murs ne peut satisfaire une volont plus exigeante (.Principes..., 138). Le cruel
xx* sicle nous a appris que tel n'est pas le cas. Cela n'empche pas que, renvoye
son seul jugement, la conscience ne sera jamais l'abri de confondre le bien et le
mal, et que cette confusion mme demeure le destin de la conscience livre elle
seule : c'est ce qu'il faut continuer d'entendre dans l'admirable 139 des Principes
dela philosophiedu droit o Hegel ose crire : Cest ainsi que cette intriorit de
la volont est mauvaise. ( 139. Remarque.)
396 397
SOI-MMECOMMEUNAUTRE VERSQUELLEONTOLOGIE?
Gewissen] et ce qui lui ressemble ' , je ne veux retenir qu'un seul point,
le paralllisme avec la critique hglienne du dplacement quivoque
. Certes, on peut opposer le tour gnalogique de la critique
nietzschenne au tour tlologique de la critique hglienne
5
. Mais la
parent profonde entre les deux critiques est avre par Nietzsche
lui-mme lorsqu'il caractrise comme interprtation falsifiante la
mauvaise conscience et comme interprtation authentique sa propre
vision de la grande innocence . C'est d'ailleurs un problme, chez
Nietzsche, de savoir si le renvoi, assur par la mthode gnalogique,
la Vie forte ou faible , atteint le rfrent ultime d'un
dchiffrement terminal, et s'il est vrai qu'il n'y a pas, dans
l'interprtation, de sens littral qu'on puisse opposer au sens figurai.
La dissertation semble laisser une place un concept, en quelque sorte
neutre, de conscience, par l'loge qui y est fait de la promesse, antidote de
l'oubli, tenu pourtant pour une facult d'inhibition active, une facult
positive dans toute sa force
3
.
Mais cette matrise de soi - cette mnmotechnique ! - a derrire
elle une longue histoire de tourments et de tortures qu'elle partage avec
l'asctisme que la troisime dissertation rattachera la malfaisance du
prtre
4
. Et, si la conscience morale comme telle
1. Trad. fr. de C. Heim, I. Hildenbrand et J. Gratien. Paris, Gallimard, 1971,
1987, tablie sur le texte allemand des uvres philosophiques compltes par
G. Colli et M. Montinari, Berlin, W.de Gruyter, 1968, t. VIL
2. La mthode gnalogique, considre pour elle-mme, ne se comprend vrai-
ment que par sa relation avec la mthode philosophique (Philosophenbuch) que
nous avons vue l'uvre dans la critique du Cogito (cf. Prface). Sans la rfrence
ce que j'ai appel alors la rduction tropologique, on risque de rduire la
mthode gnalogique une explication gntique, conduite dans l'esprit d'un
biologisme assez primitif. On oublie alors que la mthode gnalogique opre un
croisement entre une smiologie d'origine textuelle et une symptomatologie d'ori-
gine mdicale. C'est pourquoi on peut y retrouver quelque chose de la dnoncia-
tion du transfert mtaphorique et de l'inversion mtonymique que le Philo-
sophenbuch plaait sous le titre, qui rappelle Hegel, de la Verstellung, du
dplacement-dissimulation.
3 lever un animal qui puissepromettre, n'est-ce pas l cette tche para-
doxale que la nature s'est donne propos de l'homme ? N'est-ce pas le problme
vritable de l'homme? (Gnalogiedela morale, op. cit., p. 251). Une note
inquitante, toutefois, assombrit cet loge : cet animal responsable est aussi un
animal prvisible, donc calculable(ibid., p. 2S2). C'est le prix de la volont libre,
celle d'un individu autonome et supramoral , car autonome et moral
s'excluent (ibid., p. 2S3).
4. Mais comment est venue cette autre [diseandre] " affaire lugubre ", le sen-
timent de culpabilit, toute la " mauvaise conscience " ? (ibid., p. 2S6).
appelle la vigilance, la mauvaise conscience demande, elle, un
dmantlement complet, qui dbute par l'vocation de synonymes
aussi lourds de sens, surtout en allemand, que Schuld - faiblement traduit
par faute -, Schulden - par dette -, Vergeltung -par reprsailles. Monde
clair, en un sens, du crancier et du dbiteur - tnbreux, en un autre sens,
de la colre et de la vengeance. Car, la faon la plus archaque de
recouvrer une crance, c'est de violenter le dbiteur : La compensation
[Ausgleich] reprsente donc une invitation et un droit la cruaut
(Gnalogie de la morale, p. 258). Sans cruaut, pas de fte : voil ce
qu'enseigne la plus vieille et la plus longue histoire de l'homme - et dans
le chtiment aussi, il y a tant de fte ! (ibid., p. 259-260).
Faut-il se laisser impressionner par le ton autoritaire de Nietzsche,
proclamant avoir dcouvert le foyer d'origine , le dbut du monde
des concepts moraux (ibid., p. 258) ? Qu'en est-il de ce Vorzeit, de ces
anciens temps, dont il est dit qu'ils existent d'ailleurs de tout temps, ou
qu'ils sont toujours possibles de nouveau (ibid., p. 263) ? Etrange
archologie proleptique.si l'on ose dire, o la prhistoire et le futur
s'changent ! Et faut-il prendre pour argent comptant l'loge d'une
souffrance que la cruaut du dressage rendrait pleine de sens ' ?
L'important, semble-t-il, est que le dressage de l'animal responsable ne
soit plus port au crdit de la volont libre et de la spontanit
absolue de l'homme dans le bien et dans le mal (ibid), p. 262) -
cette invention si tmraire et si nfaste des philosophes (ibid.): L
est la pointe anticartsienne et antikantienne de toute cette tirade qui
mle la complexit tnbreuse du chtiment la simplicit apparente
du rapport de crancier dbiteur
2
. Ce qui compte dans tout cela, c'est
la pointe polmique, tous les renversements oprs par la mthode
gnalogique visant ruiner la tlologie avec les armes de
l'archologie. Dire l'origine, c'est abolir le but et sa rationalit allgue.
Pas de but intelligible pour le chtiment, mais une origine tnbreuse.
Le pige que tend ici le texte nietzschen, c'est celui d'un nou-
1. Tout mal se justifie, dont le spectacle difie un Dieu, dit l'antdiluvienne
logique du sentiment (ibid., 261).
2. Le message le plus positif de Nietzsche, en ce point, c'est l'apologie des
affects actifs rencontre des affects ractifs comme le ressentiment, auxquels reste
apparent le sens de la justice, ds lors qu'on le rattache la plainte des victimes
plutt qu'au cri de triomphe des vainqueurs. La bonne conscience, c'est celle du
justicier agressif; la mauvaise conscience, celle du plaignant port dprcier la
volont forte qui vise la puissance. C'est ici le fil conducteur de l'interprtation
de la philosophie de Nietzsche par G. Deleuze.
398 399
SOI-MME COMMEUN AUTRE
VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
veau dogmatisme, celui de la volont de puissance nomme au 12
(ibid, p. 270). On ne saurait ngliger pourtant l'observation qui
accompagne, comme en passant, la nomination de la volont de
puissance, savoir que la fluidit de l'origine, oppose la fixit
prtendue du but, de la fin, est l'occasion d'une nouvelle interprtation
(ein Neu-interpretieren), d'un accommodement ( ein
Zurechtmachen) (ibid., 269), qui atteste, en retour, quel point taient
surajoutes les significations tardives assignes au chtiment
1
. Nietzsche
s'offre mme le luxe de proposer une douzaine de manires dont le
chtiment peut tre interprt (gedeutet) et arrang (zurechtgemacht)
des fins tout fait diffrentes. Or, cette surcharge (berladen) (p.
272) d'utilits de toutes sortes - vritable surdtermination au sens
freudien du terme - ne se retournerait-elle pas contre le dogmatisme
biologi-sant que Nietzsche impose au lecteur dans les 16 25 de cette
deuxime dissertation de la Gnalogie de la morale
1
?
Je ne me prononcerai pas dans le cadre de cette tude sur le sens et
les chances de la seconde innocence, proclame la fin de la
dissertation, et laquelle concourt l'uvre entire de Nietzsche. Seule
m'importe ici la force d'interpellation du soupon, implicite chez Hegel,
explicite chez Nietzsche, que conscience gale mauvaise conscience .
La pire solution, pour briser cette quation, serait d'en appeler de la
mauvaise la bonne conscience. Ce renversement du pour au contre
resterait captif de la mme problmatique vicieuse, celle de la
justification, le jugement d'indignit cdant seulement la place
l'autojustification, la glorification de soi.
1. Je dtache volontiers la remarque que Nietzsche met entre parenthses : il
est aujourd'hui impossible de dire avec certitude pourquoi on punit : tous les
concepts o se rsume significativement [semiotisch] un long processus,
chappent la dfinition ; on ne peut dfinir ce qui n'a pas d'histoire (Gnalogie
de la morale, p. 271).
2. L'inimiti, la cruaut, le plaisir de perscuter, d'attaquer, de transformer, de
dtruire - tout cela tourn contre les possesseurs dots de tels instincts : voil
l'origine de la "mauvaise conscience" (ibid., p. 276). Avec [la mauvaise
conscience] est apparue la maladie la plus grave et la plus inquitante, dont l'hu-
manit n'est pas encore gurie, l'homme souffrant de l'homme, de soi-mme
(ibid.). Mais, dit Nietzsche, c'est l sa propre hypothse qui a elle-mme sa
prsupposition (ibid., 16-17). Ainsi, le ton autoritaire d'une rvlation ne cesse
dans les dernires pages d'alterner avec le ton hypothtique d'une archologie
aventureuse, pour ne rien dire de l'espce d'eschatologie dans laquelle cette
archologie se renverse : Comme si l'homme n'tait pas un but, mais seulement
un chemin, un pisode, un pont, une grande promesse... (ibid., 16), et encore :
Point de doute, c'est une maladie que la mauvaise conscience, c'est une maladie
comme la grossesse en est une (ibid., p. 279).
400
Il est alors tentant, pour sortir du cercle empoisonn de la bonne
et de la mauvaise conscience, de rattacher le phnomne de la
conscience, sans autre qualification de caractre moral, au phnomne
central de Y attestation, dont le soupon est prcisment l'autre face. La
question devient alors de savoir par quel trait, jusqu'ici non remarqu,
l'attestation de l'ipsit, dont nous sommes partis, contribue de faon
indite la dialectique du Mme et de l'Autre. C'est ici que notre
investigation rencontre le second dfi annonc plus haut, et que l'on
pourrait placer sous le sigle de la d-moralisation de la conscience.
Cet arrachement de la conscience la fausse alternative de la
bonne et de la mauvaise conscience trouve chez Heidegger, dans le
chapitre Conscience (Gewissen) de la seconde partie d'tre et Temps,
sa formulation la plus radicale, que rsume cette seule phrase :
L'attestation d'un pouvoir-tre authentique, c'est la conscience qui la
donne ([234] trad. Martineau, p. 175 ; trad. Vezin, p. 287). Nous
sommes d'autant plus attentifs l'analyse de Heidegger que nous lui
devons la mise en route de toute cette discussion, lance par la mtaphore
de la voix. Ce pouvoir-tre que la conscience atteste n'est initialement
marqu par aucune comptence distinguer le bien du mal. La
conscience, pourrait-on dire, est sa faon par-del bien et mal ; on
surprend l un des effets de la lutte mene contre le penser-valeur des
nokantiens et, plus encore, contre celui de Max Scheler dans son thique
matriale [non formelle] des valeurs. Tout se passe comme si, souligner
Sein dans Dasein, on se retenait de reconnatre quelque force
originairement thique l'appel, l'ad-vocation (selon la traduction
propose par E. Martineau) de YAn-ruf. En effet, que l'on considre le
contenu ou l'origine de l'appel, rien ne s'annonce qui n'ait t dj
nomm sous le titre de pouvoir-tre ; la conscience ne dit rien : pas de
vacarme, ni de message, mais un appel silencieux. Quant l'appelant, il
n'est autre que le Dasein lui-mme : Dans la conscience, le Dasein
s'appelle lui-mme ([275] trad. Martineau, p. 199; cf. trad. Vezin, p.
332). C'est l sans doute le moment le plus surprenant de l'analyse : c'est
dans l'immanence intgrale du Dasein lui-mme que Heidegger
reconnat une certaine dimension de supriorit: l'appel ne vient
incontestablement pas d'un autre qui est au monde avec moi. L'appel
vient de moi et pourtant il me dpasse [aus mir und doch tiber mich]
(ibid.) '.
t. Ce n'est pas que la rfrence autrui fasse entirement dfaut : mais l'autre
n'est impliqu qu'eu gard au on et au plan inauthentique de la proccupa-
401
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
Si l'on se borne ces formules, on ne voit pas ce que l'analyse de la
conscience ajoute celle du pouvoir-tre, sinon le sceau d'originarit et
d'authenticit que la conscience met sur l'attestation. La nouveaut
rside dans Pexplicitation du trait d'tran-g(r)et (j'adopte la graphie
d'E. Martineau) par quoi la conscience s'inscrit dans la dialectique du
Mme et de l'Autre. Un subtil rapprochement se fait entre
Ftrang(r)et de la voix et la condition dchue (ou chue ?) de
l'tre-jet. C'est en effet dans l'existence que le Dasein est jet. L'aveu de
la passivit, de la non-matrise, de l'affection, lies l'tre-convoqu,
s'oriente vers une mditation sur la nantit, c'est--dire sur le
non-choix radical qui affecte l'tre dans le monde, considr sous
l'angle de son entire facticit
1
.
L'introduction tardive de la notion de Schuld - dette , selon la
traduction de Martineau - ne restitue nullement cette tran-gret
quelque connotation thique que ce soit. L'accent est fortement mis sur
Sein dans Schuldigsein : L'essentiel ici est que le "en dette" surgit
comme prdicat du "je suis" ([281] trad. E. Martineau, p. 203 ; cf.
trad. Vezin, p. 338). Par cette insistance sur l'ontologie de la dette,
Heidegger se dissocie de ce que le sens commun attache prcisment
l'ide de dette, savoir qu'elle soit envers quelqu'un - que l'on soit
responsable en tant que dbiteur - enfin, que l'tre l'un avec l'autre soit
public. C'est bien cela que Heidegger entend rduire la portion
congrue. L'ontologie veille sur le seuil de l'thique. Heidegger martle
son exigence : d'abord s'enqurir fondamentalement de l'tre en
dette du Dasein ([283] ; trad. Martineau, p. 204 ; cf. trad. Vezin, p. 340)
; donc d'abord sur un mode d'tre. Ainsi sont mis hors jeu les ph-
nomnes vulgaires de dette, d'endettement, qui sont relatifs 1'"
tre-avec " proccup avec autrui (ibid.). L'tre en dette ne
tion : C'est le on-mme [das Man-Selbst] de l'tre-avec proccup avec autrui
qui est atteint par l'appel ([272] trad. E. Martineau, 198 ; cf. trad. Vezin, p. 329).
La dominante demeure l'arrachement du soi au on : La conscience convoque
!e soi-mme du Dasein hors de la perte dans le on. Nous reviendrons, sous
l'angle du troisime dfi, sur cette absence, dans treet Temps, d'un dveloppe-
ment consacr aux formes authentiques de l'tre-avec, sur lesquelles pourrait se
greffer une approche diffrente de l'altrit de la conscience.
1. Et qu'est-ce qui pourrait tre plus tranger au on, perdu qu'il est dans la
diversit du " monde ", de sa proccupation, que le Soi-mme isol sur soi dans
l'trangret, jet dans le rien ? ([277] trad. E. Martineau, p. 200 ; cf. trad.
Vezin, p. 331). C'est pourquoi l'appelant n'est pas non plus quelqu'un, puisque
l'appel vient de l'trang(r)et mme de la condition jete et dchue : Appel
venu de l'trang(r)et ([280] trad. Martineau, p. 202 ; cf. trad. Vezin, p. 337),
c'est--dire de l' isolement jet (ibid.).
rsulte donc pas de l'endettement (Verschuldung) - mais l'inverse. Si
quelque dfaillance est ici dvoile, ce n'est pas le mal - la guerre, dirait
Lvinas -, mais un trait ontologique pralable toute thique :
L'tre-fondement d'une nullit (Grundsein einer Nichtigkeit) ([283]
trad. Martineau, p. 204 ; cf. trad. Vezin, p. 341)'. On ne peut plus
clairement conduire le primat de l'thique: Si l'tre-en-dette
originaire ne peut tre dtermin par la moralit, c'est que celle-ci le
prsuppose dj pour elle-mme ([286] trad. Martineau, p. 206 ; cf.
trad. Vezin, p. 344). Malheureusement, Heidegger ne montre pas
comment on pourrait parcourir le chemin inverse : de l'ontologie vers
l'thique. C'est pourtant ce qu'il semble promettre dans le paragraphe 59
o il entre en dbat avec l' explicitation vulgaire de la conscience . En
ce sens, l'attestation engendre une certaine critriologie, au moins titre
de critique du sens commun. En rsulte une critique des notions de
bonne et de mauvaise conscience dans des termes voisins de ceux
que nous avons employs. C'est d'abord la notion de mauvaise
conscience qui est frappe de vulgarit : elle vient en effet trop tard,
aprs coup (elle est ractive, dirait Nietzsche); il lui manque donc le
caractre pro-spectif inhrent au souci. Rien donc tirer du re-mords,
du re-pentir. Quant la bonne conscience, elle se voit carte comme
pha-risienne : car qui peut dire je suis bon? Heidegger ne veut
mme pas entendre parler de la conscience comme admonition,
avertissement, au nom de ce curieux argument que la conscience
redeviendrait ainsi prisonnire du on [292]. En tout ceci, la critique
par Heidegger du sens commun est manifestement rapprocher de la
Gnalogie de la morale de Nietzsche. Du coup sont rejets en bloc le
point de vue dontologique de Kant, la thorie schlrienne des valeurs
et, dans le mme mouvement, la fonction critique de la conscience. Tout
cela reste dans la dimension de la proccupation, quoi manque le
phnomne central, l'appel aux possibilits les plus propres. En cela,
l'attestation est bien une sorte de comprhension, mais irrductible un
savoir quelque chose. Le sens de l'attestation est maintenant scell :
Convocation pro-vocante l'tre-en-dette ([295] trad. Martineau, p.
211 ; cf. trad. Vezin, p. 353-354).
Il est vrai que le dernier mot n'est pas dit sur la conscience. La liaison
affirme entre attestation et rsolution semble ramener la
1. Et encore : Le Dasein est comme tel en dette, si tant est que demeure la
dtermination existentiale formelle de la dette comme tre-fondement d'une nul-
lit ([285] trad. Martineau, p. 205 ; cf. trad. Vezin, p. 343).
402
403
SOI-MMECOMMEUN AUTRE VERS QUELLE ONTOLOGIE ?
notion de conscience dans le champ de l'thique. On connat cet gard
le lien entre rsolution et tre-pour-la-mort (ou tre-envers-la-mort). Ce
que la rsolution apporte en propre, c'est en effet la vise de l'tre-tout
scell par Ftre-pour-la-mort. La transition de l'une l'autre notion se fait
par l'expression : vouloir avoir conscience ([295] trad. Martineau,
p. 211; cf. trad. Vezin, p. 354). D'o la dernire formule : le se-projeter
rticent et prt l'angoisse vers l'tre-en-dette le plus propre - nous
l'appelons la rsolution ([297] trad. Martineau, p. 212; cf. trad.
Vezin, p. 355). On remarque quel point Heidegger se garde ici du
vocabulaire de l'agir, qui lui parat appeler soit une opposition au
ptir, que l'tre-jet rcuse galement, soit une opposition au
thortique, qui briserait l'unit totale du Dasein entre des
comportements distincts . En revanche, la conscience-attestation
s'inscrit dans la problmatique de la vrit, en tant qu'ouverture et
dvoilement : dsormais, ce qui est conquis avec la rsolution, c'est la
vrit la plus originaire, parce qu''authentique, du Dasein ([297] trad.
Martineau, p. 212 ; cf. trad. Vezin, p. 355). Mais, coupe de la requte
d'autrui et de toute dtermination proprement morale, la rsolution
demeure tout aussi indtermine que l'appel auquel elle semble
rpondre. Revient la formule : se laisser convoquer hors de la perte
dans le On ([299] trad. Martineau, p. 213 ; cf. trad. Vezin, p. 357).
Quant l'orientation dans l'action, l'ontologie fondamentale se garde de
toute proposition : Dans la rsolution, il y va pour le Dasein de son
pouvoir-tre le plus propre, lequel, en tant que jet, ne peut se projeter
que vers des possibilits factices dtermines ([299] trad. Martineau,
p. 213-214 ; cf. trad. Vezin, p. 358). Tout se passe comme si le philosophe
renvoyait son lecteur un situationnisme moral destin combler le
silence d'un appel indtermin
1
.
A cette d-moralisation de la conscience, j'aimerais opposer une
conception qui associe troitement le phnomne de Y injonction celui
de l'attestation. L'tre-enjoint constituerait alors le moment d'altrit
propre au phnomne de la conscience, en
1. C'est bien ce que semblent suggrer le texte suivant et la note sur Karl Jas-pers
auxquels il renvoie : Prsenter les possibilits existentielles factices en leurs traits
capitaux et leurs connexions, les interprter en leur structure existentiale, cette
tche s'inscrit dans les cadres de l'anthropologie existentiale thmatique ([301]
trad. Martineau, p. 214-215; cf. trad. Vezin, p. 359). Et la note: Cest Karl Jaspers
qui a pour la premire fois expressment saisi et excut, dans le sens de cette
problmatique, la tche d'une doctrine des visions du monde : cf. sa Psychologie
der Weltanschauungen [Psychologie des visions du monde) ([301] trad.
Martineau. p. 215 ; cf. trad. Vezin, p. 359).
conformit avec la mtaphore de la voix. couter la voix de la
conscience signifierait tre-enjoint par l'Autre. Ainsi serait fait droit la
notion de dette, que Heidegger a trop vite ontologise aux dpens de la
dimension thique de l'endettement. Mais comment ne pas retomber
dans le pige de la mauvaise et de la bonne conscience, dont
nous gardent chacun sa faon Hegel, Nietzsche et Heidegger ? Une
remarque faite plus haut propos de la mtaphore du tribunal nous met
sur la voie. N'est-ce pas parce que le stade de la moralit a t dissoci
de la triade thique-moralit-conviction, puis hypostasi la faveur de
cette dissociation, que le phnomne de la conscience s'est trouv cor-
rlativement appauvri et que la mtaphore dcouvrante de la voix a
t clipse par celle touffante du tribunal ? En fait, c'est la triade
entire mise en place dans nos trois tudes prcdentes qui se donne ici
tre rinterprte en termes d'altrit. Je suis appel vivre-bien avec
et pour autrui dans des institutions justes : telle est la premire
injonction. Mais, selon une suggestion voque plus haut et emprunte
F. Rosenzweig dans L'Etoile de la Rdemption (Deuxime livre), il est
une forme de commandement qui n'est pas encore une loi : ce
commandement, si on peut dj l'appeler ainsi, se fait entendre dans la
tonalit du Cantique des Cantiques, dans la supplication que l'amant
adresse l'aime : Toi, aime-moi ! . C'est parce que la violence
entache toutes les relations d'interaction, la faveur du pouvoir-sur
exerc par un agent sur le patient de son action, que le commandement se
fait loi et la loi interdiction : Tu ne tueras pas. C'est alors que se
produit la sorte de court-circuit entre conscience et obligation, pour ne
pas dire entre conscience et interdiction, d'o rsulte la rduction de la
voix de la conscience au verdict d'un tribunal. Il ne faut pas alors cesser
de remonter la pente qui ramne de cette injonction-interdiction
l'injonction du bien-vivre. Ce n'est pas tout : il ne faut pas arrter la
trajectoire de l'thique l'impratif-interdiction, mais en poursuivre la
course jusqu'au choix moral en situation. L'injonction rejoint alors le
phnomne de la conviction* que nous avons vu Hegel cantonner dans
la sphre de la moralit subjective. Ce n'est pas faux, si l'on veut bien
noter que c'est toujours seul que, dans ce que nous avons appel le
tragique de l'action, on se dcide. En s'galant ainsi la conviction, la
conscience en dit le ct de passivit : Ici je me tiens ! Je ne puis
autrement ! Mais, si l'on a bien voulu suivre
1. Faut-il rappeler qu'en allemand conviction se dit Ueberzeugung, terme de la
mme famille que le tmoin (Zeuge) et que l'attestation (Bezeugung) ?
404 405
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
notre argumentation concernant l'thique de la dcision en situation, le
moment de conviction ne se substitue pas l'preuve de la rgle ; il
survient au terme d'un conflit, qui est un conflit de devoirs. En outre, le
moment de conviction marque, selon moi, un recours aux ressources
encore inexplores de l'thique, en de de la morale, mais travers elle.
C'est pourquoi nous avons cru pouvoir invoquer les traits les plus
singularisants de la phronsis aristotlicienne pour souligner le lien qui
rattache la conviction au fond thique, travers la couche des
impratifs. Comment alors ne pas faire cho l'exclamation de
Heidegger, rapporte par Gadamer, l'poque o le premier
commentait l'thique d'Aristote : Mais phronsis, c'est Gewissen ' !
Or, si l'on garde en mmoire la dfinition de la phronsis, qui inclut la
rgle droite dans le choix du phronimos, on ne peut plus dire, avec le
Heidegger d'tre et Temps, que la voix ne dit rien et se borne renvoyer
le Dasein son pouvoir-tre le plus propre. La conscience, en tant
qu'attestation-injonction, signifie que ces possibilits les plus propres
du Dasein sont originairement structures par l'optatif du bien-vivre,
lequel gouverne titre secondaire l'impratif du respect et rejoint la
conviction du jugement moral en situation. S'il en est ainsi, la passivit
de Ftre-enjoint consiste dans la situation d'coute dans laquelle le sujet
thique se trouve plac par rapport la voix qui lui est adresse la
seconde personne. Se trouver interpell la seconde personne, au cur
mme de l'optatif du bien-vivre, puis de l'interdiction de tuer, puis de
la recherche du choix appropri la situation, c'est se reconnatre enjoint
de vivre-bien avec et pour les autres dans des institutions justes et de
s'estimer soi-mme en tant que porteur de ce vu. L'al-trit de l'Autre est
alors la contrepartie, au plan de la dialectique des grands genres , de
cette passivit spcifique de l'tre-enjoint.
Maintenant, que dire de plus concernant l'altrit de cet Autre ?
C'est ici que nous sommes confronts au troisime dfi formul au
dbut de cette mditation : cet Autre n'est-il pas, d'une manire ou
d'une autre, autrui ? Alors que Heidegger rabat l'altrit de l'appel
l'trang(re)t et la nullit de l'tre-jet, chu ou dchu, et rduit en
fin de compte l'altrit de la conscience celle englobante de
l'tre-dans-le-monde que nous avons recentr plus haut sur la chair, la
tentation est forte de rapprocher, par contraste, l'altrit de l'injonction
de celle d'autrui.
Que la conscience soit la voix de l'Autre au sens d'autrui, Hegel
1. Cf. ci-dessus, p. 361, n. 2.
en un sens le donne penser, ds lors que le sort de la conscience est li
la rconciliation encore deux figures partielles de l'esprit : la conscience
jugeante et la conscience agissante. Ainsi, le phnomne du doublement
de la conscience traverse-t-il toute la Phnomnologie de l'esprit, depuis
le moment du dsir de l'autre, en passant par la dialectique du matre et
de l'esclave, jusqu' la figure double de la belle me et du hros de
l'action. Mais il est important que l'ultime rconciliation nous laisse
perplexe quant l'identit de cet autre dans la confession exprime par
la vision de soi-mme dans l'Autre (trad. Hyppolite, t. II, p. 198). Le
pardon ne marque-t-il pas dj l'entre dans la sphre de la religion ?
Hegel laisse son lecteur en suspens en crivant : Le mot de la
rconciliation est l'esprit tant-l qui contemple le pur savoir de
soi-mme comme essence universelle dans son contraire, dans le pur
savoir de soi comme singularit qui est absolument au-dedans de soi
- une reconnaissance rciproque qui est Vesprit absolu (ibid.) '. Hegel,
philosophe de l'esprit, nous laisse ici dans l'indcision, mi-chemin d'une
lecture anthropologique et d'une lecture thologique.
Cette ultime quivocit quant au statut de l'Autre dans !e phnomne
de la conscience est peut-tre ce qui demande tre prserv en dernire
instance. Elle est tranche dans un sens clairement et univoquement
anthropologique dans la mtapsychologie freudienne : la conscience
morale est un autre nom du surmoi, lequel se ramne aux
identifications (sdimentes, oublies, et pour une large part refoules)
avec les figures parentales et ances-trales. La psychanalyse rejoint, mais
un plan de scientificit, maintes croyances populaires selon lesquelles la
voix des anctres continue de se faire entendre parmi les vivants et
assure ainsi, non seulement la transmission de la sagesse, mais sa
rception intime chaque tape. Cette dimension, qu'on peut dire
gnra-tionnelle, est une composante indniable du phnomne de l'in-
jonction et plus encore de celui de la dette
2
.
A cette explication gntique - lgitime dans son ordre -, on
1. Et encore: Le Oui de la rconciliation, dans lequel les deux Moi se
dsistent de leur tre-l oppos, et 'tre-l du Moi tendu jusqu' la dualit, Moi
qui en cela reste gal soi-mme et qui dans sa complte alination et dans son
contraire complet a la certitude de soi-mme ; - il est le Dieu se manifestant au
milieu d'eux qui se savent comme le pur savoir (Phnomnologiedel'esprit,
trad. Hyppolite, t. II, p. 200).
2. Je me permets de renvoyer aux pages de Tempset Rcit consacres la cat-
gorie de la dette en tant que structure de l'historicit (Temps et Rcit, t. III, op.
cit.. p. 204, 227-228, 275-279).
406
407
SOI-MMECOMMEUN AUTRE
VERSQUELLEONTOLOGIE?
peut objecter qu'elle n'puise pas le phnomne de l'injonction et
encore moins celui de la dette. Si, d'une part, le soi n'tait pas
constitu originairement en structure d'accueil pour les sdi-
mentations du surmoi, l'intriorisation des voix ancestrales serait
impensable et le moi, en tant qu'instance primitive, ne pourrait
mme pas exercer la fonction de mdiateur, ou mieux d'entremet-
teur, que Freud lui reconnat entre les trois matres qui se disputent
son obdience, le a, le surmoi et la ralit extrieure ' ; l'aptitude
tre-affect sur le mode de l'injonction parat bien constituer la
condition de possibilit du phnomne empirique d'identification
qui est loin d'avoir la transparence qu'on lui assigne trop aisment.
D'autre part, le modle gnrationnel de la conscience recle une
autre nigme plus indchiffrable : la figure de l'anctre, par-del
celle des parents bien et mal connus, amorce un mouvement de
rgression sans fin, o l'Autre perd progressivement - de gnration
en gnration ! - sa familiarit initiale prsume. L'anctre s'excepte
du rgime de la reprsentation, comme le vrifie sa capture par le
mythe et le culte . Une pietas d'un genre unique unit ainsi les vivants
et les morts. Cette pietas reflte le cercle dans lequel nous tournons
finalement : d'o l'anctre tire-t-il l'autorit de sa voix, sinon de son
lien prsum privilgi avec la Loi, immmoriale comme lui ? Ainsi
l'injonction se prcde-t-elle elle-mme, par l'entremise de l'anctre,
figure gnrationnelle de l'Autre.
Ce qui vient d'tre dit du surmoi freudien, en tant que parole des
anctres rsonnant dans ma tte, constitue une bonne prface pour
les remarques sur lesquelles je terminerai cette mditation
consacre l'altrit de la conscience. Je les rserverai la rduc-
tion, qui me parat rsulter de l'ensemble de l'uvre d'Emmanuel
Lvinas, de l'altrit de la conscience l'altrit d'autrui. A la
rduction, caractristique de la philosophie de M. Heidegger, de
l'tre en dette l'trang(r)et lie la facticit de l'tre dans le
monde, E. Lvinas oppose une rduction symtrique de l'altrit de
la conscience l'extriorit d'autrui manifeste dans son visage. En
ce sens, il n'y a pas chez E. Lvinas une autre modalit d'altrit que
cette extriorit. Le modle de toute altrit, c'est autrui. A
l'alternative : soit l'trang(r)et selon Heidegger, soit l'extriorit
selon E. Lvinas, j'opposerai avec obstination le caractre original
et originaire de ce qui m'apparat constituer la
i. Le moi et le a , in Essais depsychanalyse, trad. fr. de J. Laplanche, Paris,
Payot, 1981.
2. F. Wahl, c Les anctres, a ne se reprsente pas , in L'Interdit dela reprsen-
tation, colloque de Montpellier 1981, Paris, d. du Seuil, 1984, p. 31-62.
troisime modalit d'altrit, savoir l'tre-enjoint en tant que
structure de l'ipsit.
Pour justifier le caractre irrductible de cette troisime modalit
d'altrit, je reprendrai, en tenant compte de la diffrence des
contextes, les objections que je viens d'opposer l'explication
gntique que Freud donne de l'instance du surmoi. D'une part, si
l'injonction par l'autre n'est pas solidaire de l'attestation de soi, elle
perd son caractre d'injonction, faute de l'existence d'un tre-enjoint
qui lui fait face la manire d'un rpondant. Si l'on limine cette
dimension d'auto-affection, on rend la limite la mta-catgorie de
conscience superftatoire ; celle d'autrui suffit la tche. A M.
Heidegger j'objectais que l'attestation est originairement injonction,
sous peine que l'attestation perde toute signification thique ou
morale ; E. Lvinas j'objecterai que l'injonction est originairement
attestation, sous peine que l'injonction ne soit pas reue et que le soi
ne soit pas affect sur le mode de l'tre-enjoint. L'unit profonde de
l'attestation de soi et de l'injonction venue de l'autre justifie que soit
reconnue dans sa spcificit irrductible la modalit d'altrit
correspondant, au plan des grands genres , la passivit de la
conscience au plan phnomnologique.
D'un autre ct, partageant avec E. Lvinas la conviction
qu'autrui est le chemin oblig de l'injonction ', je me permettrai de
souligner, plus qu'il ne le voudrait sans doute, la ncessit de
maintenir une certaine quivocit au plan purement philosophique
du statut de l'Autre, surtout si l'altrit de la conscience doit tre
tenue pour irrductible celle d'autrui. Certes, E. Lvinas ne
manque pas de dire que le visage est la trace de l'Autre. La catgorie
de la trace parat ainsi corriger autant que complter celle
'piphanie. Peut-tre le philosophe, en tant que philosophe, doit-il
avouer qu'il ne sait pas et ne peut pas dire si cet Autre, source de
l'injonction, est un autrui que je puisse envisager ou qui puisse me
dvisager, ou mes anctres dont il n'y a point de reprsentation, tant
ma dette leur gard est constitutive de moi-mme, ou Dieu - Dieu
vivant. Dieu absent - ou une place vide. Sur cette aporie de l'Autre,
le discours philosophique s'arrte.
1. A cet gard, la distance est moins grande qu'il n'y parat entre le thme du
pardon la fin du chapitre Geist (Esprit) de Phnomnologiedel'esprit et celui
de la substitution dans Autrement qu'tre, cette diffrence prs, vrai dire consi-
drable, que chez Hegel la rciprocit l'emporte, alors que chez Lvinas c'est l'asy-
mtrie au bnfice de l'autre.
408
409
SOI-MME COMME UN AUTRE
On me permettra de conclure sur le ton de l'ironie socratique.
Faut-il laisser dans un tel tat de dispersion les trois grandes exp-
riences de passivit, celle du corps propre, celle d'autrui, celle de la
conscience, qui induisent trois modalits d'altrit au plan des
grands genres ? Cette dispersion me parat au total convenir
l'ide mme d'altrit. Seul un discours autre que lui-mme, dirai-je
en plagiant le Parmnide, et sans m'aventurer plus avant dans la
fort de la spculation, convient la mta-catgorie de l'altrit,
sous peine que l'altrit se supprime en devenant mme
qu'elle-mme...
Ouvrages cits
Anscombe (G.E.M.), Intention, Oxford, Basic Blackwell, 1979.
Apel (K.O.), Sur le problme d'une fondation rationnelle de l'thique
l'ge de la science. L'a priori de la communaut communicationnelle et
les fondements de l'thique, trad. fr. de R. Lellouche et I. Mittmann,
Presses universitaires de Lille, 1987 (dernier article de Transformation
der Philosophie, Francfort, Suhrkamp, 1973).
Arendt (H.), La Condition de l'homme moderne, trad. fr. de G. Fradier,
prf. de P. Ricur, Paris, Calmann-Lvy, 1961 et 1983; repris par
Agora, Paris, Presses Pocket, 1988.
- La Crise de la culture, huit exercices de pense politique, trad. fr. sous
la direction de P. Lvy, Paris, Gallimard, 1972 [titre original : Between
past and future].
- Du mensonge la violence trad. fr. de G. Durand, Paris,
Calmann-Lvy, 1972 [titre original : Crises ofthe Republic].
- Les Origines du totalitarisme, trad. fr., 3 vol. : Sur l'antismitisme,
Paris, Calmann-Lvy, 1973; d. du Seuil, coll. Points, 1984;
L'Imprialisme, Paris, Fayard, 1982; d. du Seuil, coll. Points,
1984 ; Le Systme totalitaire, d. du Seuil, coll. Points, 1972.
Aristote, De l'me, trad. fr. de J. Tricot, Paris, Vrin, 1965.
- thique Eudme, intr., trad. et notes de V. Dcarie, R. Houde-Sauv,
Paris, Vrin, Montral, Presses de l'universit de Montral, 1978.
- thique Nicomaque, intr., trad. et commentaire de R.-A. Gauthier et
J.-Y. Jolif, Louvain, Publications universitaires de Louvain, Paris,
Batrice Nauwelaerts, 1958.
- thique Nicomaque, nlle trad. avec intr. et notes de J. Tricot, Paris,
Vrin, 6* d., 1987.
- thique Nicomaque, trad., prf. et notes de J. Voilquin, Paris,
Gar-nier 1963, Garnier-Flammarion, 1965.
- Mtaphysique, trad. fr. de J. Tricot, Paris, Vrin, 1964.
- Physique, trad. fr. de H. Carteron, Paris, Les Belles Lettres, 3* d.,
1961.
- La Potique, texte, trad. et notes de R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris,
d. du Seuil, 1980.
- Rhtorique, texte tabli et traduit par M. Dufour, Paris, Les Belles
Lettres, 1960.
Aubenque (P.), La Prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963.
411
OUVRAGES CITS
OUVRAGES CITS
Augustin (saint), Confessions, Paris, Les Belles Lettres, 1969-1977.
Austin (J.L.), How to do things with words, Harvard University Press,
1962.
- Quand dire, c'est faire, intr. et trad. fr. de G. Lane, Paris, d. du Seuil,
1970.
Beauchamp (P.), L'Un et l'AutreTestament : Essai delecture, Paris, d.
du Seuil, 1977.
Benjamin (W.), Der Erzhler. Betrachtungen zum Werk Nicolaj
Less-kows, in Illuminationen, Francfort, Suhrkamp, 1969; trad. fr. de
M. de Gandillac, Le narrateur , in Posie et Rvolution, Paris,
Denol, 1971 ; repris in Rastelli raconte et autres rcits, Paris, d. du
Seuil, 1987.
Benveniste (.), Problmes de linguistique gnrale, Paris, Gallimard,
1966.
- Le langage et l'exprience humaine, in Problmes du langage,
Paris, Gallimard, coll. Diogne , 1966 ; repris in Problmes de lin
guistique gnrale II, Paris, Gallimard, 1974.
Berlin (I.), Four Essays on Liberty, Londres, 1969 ; trad. fr. de J. Car-naud
et J. Lahana, loge de la libert, Paris, Calmann-Lvy, 1988.
Brague (R.), Aristote et la question du monde, Paris, PUF, 1988.
Braudel (F.), L'Identit de la France, Paris, Arthaud, 1986.
Bremond (C), Logique du rcit, Paris, d. du Seuil, 1973.
Bubner (R.), Moralit et Sittlichkeit - sur l'origine d'une opposition ,
Revueinternationaledephilosophie, n 3, 1988, Kant et la Raison pra-
tique.
Butler (J.), Of Personal Identity [extrait de l'appendice I de J. Butler,
TheAnalogy of Religion, 1736], cit in J. Perry (d.), Personal identity,
Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1975,
p. 99-105.
Calvo (F.), Socrate. Platone. Aristotele. Cercarel'uomo. Gnes, Marietti,
1989.
Carnois (B.), La Cohrencedela doctrinekantiennedela libert, Paris,
d. du Seuil, 1973.
Chisholm (R.), Person and Object, a metaphysical study, Londres, G.
Allen and Unwin, 1976.
Coquet (J.-C.), LeDiscours et son Sujet : 1. Essai degrammairemodale,
2. Pratiquede la grammairemodale, Paris, Klincksieck, 1984-1985.
Danto (A.), Analytical Philosophy of Action, Cambridge University Press,
1973.
- a Basic Actions, in American Philosophical Quarterly, n 2, 1965.
Davidson (D.), Essays on Actions and Events, Oxford, Clarendon Press,
1980.
Delaisi (G) et Fagot (A.), Les droits de l'embryon , in Revue de mta-
physique et de morale, n 3, 1987, p. 361-387.
Deleuze (G.), Nietzsche et la Philosophie, Paris, PUF, 2
e
d., 1967.
Descartes (R.), Discours de la mthode, d. C. Adam et P. Tannery, Paris,
Vrin, t. VI, 1982.
- Meditationes deprima philosophia, d. C. Adam et P. Tannery, Paris,
Vrin, t. VII, 1983 ; trad. fr., Paris, Vrin, t. IX', 1973. Voir galement :
- Mditations de philosophie premire dans lesquelles sont montres
l'existencedeDieu et la distinction del'meet du corps dites Mdita-
tions mtaphysiques, Paris, Garnier-Flammarion, 1979.
- Les Passions de l'me, intr. et notes par G. Rodis-Lewis, Paris, Vrin,
1964.
- Les Passions de l'me, d. Adam-Tannery, t. XI, Paris, Vrin, 1974.
Diels (H.), Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1903: 6
e
d. de W.
Kranz, 1951 ; trad. fr. de J.-P. Dumont, D. Delattre et J.-L. Poirier, Les
Prsocratiques, Paris, Gallimard, coll. Bibliothque de La Pliade,
1988.
Donagan (A.), The Theory of Morality, University of Chicago Press, 1977.
Dupuy (J.-P.), Les paradoxes de Thorie de la justice (John Rawls) ,
Esprit, n 1, 1988, p. 72 sq.
Dworkin (R.), Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 1977.
Ellendt (F.), Lexicon Sophocleum, Berlin, Borntrger, 1834-1835 et
1867-1872.
Fagot (A.) et Delaisi (G.), Les droits de l'embryon , in Revue de mta-
physique et de morale, n" 3, 1987, p. 361-387.
Fay (B.) et al, L. Mink, Historical Understanding, Cornell University
Press, 1987.
Ferry (J.-M.), Habermas. L'thiquedela communication, Paris, PUF,
1987.
Fessard (G.), Thtre et Mystre, prf. G. Marcel, La Soif, Paris,
Des-cle de Brouwer, 1938.
Finkielkraut (A.), La Dfaite de la pense, Paris, Gallimard, 1987.
Foucault (M.), Le Souci de soi, t. III d'Histoire de la sexualit, Paris, Gal-
limard, 1984.
Fraisse (J.-C), Philia. La notion d'amiti dans la philosophie antique,
Paris, Vrin, 1984.
Fraisse (S.), Le Mythe d'Antigone, Paris, Colin, 1973.
Franck (D.), Chair et Corps. Sur la phnomnologiedeHusserl, Paris, d.
de Minuit, 1981.
Freud (S.), Le moi et le a , in Essais de psychanalyse, trad. fr. de J.
Laplanche, Paris, Payot, 1981.
Frye (N.), LeGrand Code. La Bibleet la littrature, prf. de T. Todorov,
trad. fr. de C. Malamoud, Paris, d. du Seuil, 1984.
Gadamer (H.-G.), Vritet Mthode. Les grandes lignes d'unehermneu-
tique philosophique, Paris, d. du Seuil, 1973.
- Heideggers Wege: Studien zumSptwerk, Tbingen, J.C.B. Mohr,
1983.
- Erinnerungen an Heideggers Anfange, Itinerari, vol. XXV, n 1-2,
1986.
Gagnebin (J.-M.), Histoire, Mmoireet Oubli chez Walter Benjamin (in-
dit).
412 413
OUVRAGES CITS
OUVRAGES CITES
Gellrich (M.), Tragedy and Theory, the Problem of Conflict since Aris-
totle, Princeton University Press, 1988. Gewirth (A.), Reason and
Morality, Chicago University Press, 1978. Goyard-Fabre (S.), Kant et le
Problmedu droit, Paris, Vrin, 1975. Granger (G.G.), Langages et
pistmologie, Paris, Klincksieck, 1979. Greimas JA.J.), Maupassant : la
smiotique du texte, exercices pratiques,
Paris, Ed. du Seuil, 1976. Greisch (J.), L'Age hermneutique de la
raison, d. du Cerf, 1985. Grice (H.P.), Meaning, in The Phil. Rev.,
vol. LXVI, 1957, p. 377-
388.
- Utterer's Meaning and Intentions , in ThePhil. Rev., vol. LXXVIII,
1969, p. 147-177.
- Utterer's Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning , in J.R.
Searle (d.), The Philosophy of Language, Oxford University Press,
1977, p. 54-70.
Gueroult (M.), Les " dplacements " (Verstellungen) de la conscience
morale kantienne selon Hegel , in Hommage J ean Hyppolite, Paris,
PUF, coll. pimthe, 1971, p. 47-80.
- Descartes selon l'ordre des raisons, 2 vol., Paris, Aubier-Montaigne,
1953.
Guillaume (G.), Temps et Verbe, Paris, Champion, 1965. Habermas (J.),
Connaissanceet Intrt, trad. fr. de G. Clmenon, Paris, Gallimard,
1976.
- Morale et Communication ; conscience morale et activit
communica-tionnelle, trad. fr. de C. Bouchindhomme, Paris, d. du
Cerf, 1986.
- La modernit: un projet inachev, in Critique, n 413, octobre
1981.
Hamon (P.), Statut smiologique du personnage , in R. Barthes et al.,
Potique du rcit, Paris, d. du Seuil, 1977.
Hampshire (S.), Thought and Action, nlle d., Notre Dame (Ind.), Uni-
versity of Notre Dame Press, 1983.
Hardie (W.F.R.), Aristotle's Ethical Theory, Oxford University Press,
2
e
d., 1981, p. 177-181.
Hait (H.L.A.), The Ascription of Responsability and Rights , in
Pro-ceedings of the Aristotelian Society, n 49, Londres, 1948, p.
171-194.
- et Honor (A.M.), Causation in theLaw, Oxford, Clarendon Press,
1959.
Havel (Vclav), Essais politiques, textes runis par Roger Errera et Jan
Vladislav, prface de Jan Vladislav, Paris, Calmann-Lvy, 1989.
Hegel (G. W.F.), Encyclopdie des sciences philosophiques en abrg, trad.
fr. de M. de Gandillac, Paris, Gallimard, 1970.
- Esthtique, trad. fr. de S. Janklvitch, t. IV, La Posie, Paris, Flam-
marion, coll. Champs , 1979.
- Phnomnologie de l'Esprit, trad. fr. de J. Hyppolite, Paris,
Aubier-Montaigne, 1947.
- Principes de la philosophie du droit ou Droit naturel et Science de l'tat
en abrg, trad. fr. de R. Derath, Paris, Vrin, 1989.
414
Heidegger (M.), Sein und Zeit, 1927, Tiibingen, Max Niemeyer, 1984,
15
e
d.
- tre et Temps, trad. fr. de E. Martineau, Authentica, dition hors
commerce, 1989.
- tre et Temps, trad. fr. de F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986.
- Aristoteles, Metaphysik Ql-3 : von Wesen und Wirklichkeit der Kraft,
GA 33, Francfort, Vittorio Klostermann, 1981.
Henrich (D.), Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre von
Faktum der Vernunft, in G.P. Prauss (d), Kant, Cologne,
Kieper-heuer und Witsch, 1973.
Henry (M.), Philosophie et Phnomnologie du corps. Essai sur l'ontologie
biranienne, Paris, PUF, 1965.
Hintikka (M.B.), Essays on Davidson Actions and Events, d. par B.
Ver-mazen, Oxford, Clarendon Press, 1985.
Hisashige (T.), Phnomnologie de la conscience de culpabilit. Essai de
pathologiethique, prsentation de P. Ricur, Tokyo, Presses de l'uni-
versit Senshu, 1983.
Hffe (O.), Introduction la philosophie pratique de Kant (la morale, le
droit et la religion), trad. fr. de F. RUegg et S. Gillioz, Albeuve, Suisse,
d. Castella, 1985.
Hume (D.), Enqute sur l'entendement humain, trad. fr. d'A. Leroy,
Aubier-Montaigne, 1947.
- A TreatiseofHuman Nature, 2
e
d. par P.H. Nidditch, Oxford, Claren-
don Press, 1978.
- Trait de la nature humaine, trad. fr. d'A. Leroy, Paris,
Aubier-Montaigne, 1968.
- Of personal Identity [extrait de A TreatiseofHuman Nature, livre
I, partie IV, section 6 (1739)], in J. Perry (d.), Personal Identity, Ber-
keley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1975, p.
161-172.
- Of Skepticism with Regard to the Senss [extrait de A Treatiseof
Human Nature, livre I, partie IV, section 2 (1739)], cit sous le titre
Our Idea of Identity , in J. Perry (d.), Personal Identity, Berkeley, Los
Angeles, Londres, University of California Press, 1975, p. 159-160.
- extrait de l'appendice de l'dition de 1740 de A Treatise of Human
Nature, dit par J. Perry sous le titre Second Thoughts , in Personal
Identity, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California
Press, 1975, p. 173-176.
Husserl (E.), Cartesianische Meditationen und pariser Vortrge, d. S.
Strasser, Husserliana, I, 1950 ; trad. fr. de G. Peiffer et E. Lvinas,
Mditations cartsiennes, introduction la phnomnologie, Paris,
Vrin, 1953, 1966.
- Ideen zu einer reinen Phaenomenologie und phaenomenologischen Phi
losophie, Jahrbuch fur Philosophie und phnomenologische Forschung,
1.1, Halle, M. Niemeyer, 1913 ; d. W. Biemel, Husserliana, III, 1950 ;
trad. fr. de P. Ricur, Ides directrices pour une phnomnologie,
Paris, Gallimard, 1950, 1985.
415
OUVRAGES CITS OUVRAGES CITS
Jacques (F.), Diffrenceet Subjectivit, Paris, Aubier, 1982.
- Dialogiques II, Paris, PUF, 1984.
- L'EspacelogiquedeTinterlocution, Paris, PUF, 1985.
Jaspers (K.), Von der Wahrheit, Munich, Piper Verlag, 1947.
- Le mal radical chez Kant , in Bilan et Perspectives, trad. fr. de
H. Naef et J. Hersch, Descle de Brouwer, 1956, p. 189-215.
Jauss (H.R.), La jouissance esthtique. Les expriences fondamentales
de la poisis, de Yaisthsis et de la catharsis , in Potique, n 39, Paris,
d. du Seuil, septembre 1979. Jonas (H.), Dos Prinzip Verantwortung.
Versuch einer Ethik fiir dietech-
nologischeZivilisation, Francfort, Insel Verlag, 1980. Jngel (E.), Gott
als Geheimnis der Welt, Tiibingen, Mohr, 1977. Trad.
fr. de Horst Hombourg, Dieu lemystredu monde, 2 vol., Paris, d. du
Cerf, 1983. Kant (E.), Critiquedela facultdejuger, trad. fr. d'A.
Philonenko, Paris,
Vrin, 1982 ; et in uvres philosophiques, t. H, d. F. Alqui, trad. fr.
de J.-R. Ladmiral, M.-B. de Launay et J.-M. Vaysse, Paris, Gallimard,
coll. Bibliothque de la Pliade , 1985.
- Critique de la Raison pratique, trad. fr. de F. Picavet, PUF, 1949, 4
e
d. 1965 ; et in uvres philosophiques, t. II, d. F. Alqui, trad. fr. de
L. Ferry et H. Wismann, Paris, Gallimard, coll. Bibliothque de la
Pliade, 1985.
- Critiquedela Raison pure, trad. fr. d'A. Tremesaygues et B. Pacaud,
Paris, PUF, 1963 ; et in uvres philosophiques, t. I, sous la direction
de F. Alqui, trad. fr. de J.-L. Delamarre et F. Marty, Paris, Gallimard,
coll. Bibliothque de la Pliade , 1980.
- Essai pour introduireen philosophieleconcept degrandeur ngative, in
uvres philosophiques, 1.1, Paris, Gallimard, coll. Bibliothque de la
Pliade, 1986.
- Essai sur le mal radical , in La Religion dans les limites dela simple
raison (1793), trad. fr. de J. Gibelin, Paris, Vrin, 1968 ; et in uvres
philosophiques, t. III, sous la direction de F. Alqui, trad. fr. d'A. Phi-
lonenko, Paris, Gallimard, coll. Bibliothque de la Pliade, 1986.
- Fondements de la mtaphysique des murs, trad. fr. de V. Delbos
revue et modifie par F. Alqui ; in uvres philosophiques, t. Il, Paris,
Gallimard, coll. Bibliothque de la Pliade, 1985; et trad. fr. d'A.
Philonenko, Paris, Vrin, 1980.
- La Mtaphysique des murs, l" partie, Doctrine du droit, trad. fr.
d'A. Philonenko, Paris, Vrin, 1971 ; T partie, Doctrine de la vertu,
trad. fr. d'A. Philonenko, Paris, Vrin, 1968; et in uvres philo-
sophiques, t. III, sous la direction de F. Alqui, trad. fr. de J. et O.
Mas-son, Paris, Gallimard, coll. Bibliothque de la Pliade , 1986.
- Rponse la question : qu'est-cequeles Lumires ?, in uvres philo-
sophiques, t. II, sous la direction de F. Alqui, trad. fr. de H. Wismann,
Paris, Gallimard, coll. Bibliothque de la Pliade , 1985.
- Sur un prtendu droit de mentir par humanit (1797), trad. fr. de L.
Guillermit, in Thorie et Pratique. Droit de mentir, Paris, Vrin,
1988 ; et in uvres philosophiques, t. III, trad. fr. de L. Ferry, Paris,
Gallimard, coll. Bibliothque de la Pliade, 1986.
Kapstein (M.), Collins, Parfit and the Problem of Personal Identity in
two Philosophical Traditions. A Review of Selfless Persons , in
Fea-tureBook Review(tir part communiqu l'auteur).
Kemp (P.), thiqueet Mdecine, Paris, Tierce-Mdecine, 1987.
- Ethics and Narrativity , in Aquinas, Revista Internazionaledi Filo-
sofia, Rome, Publications de l'Universit du Latran, 1987.
Kenny (A.), Action, Emotion and Will, Londres, Routledge and Kegan
Paul, 1963. Kermode (F.), TheGenesis ofSecrecy, On theInterprtation
of Narrative,
Cambridge, Harvard University Press, 1979.
- TheSensof an Ending. Studies in theTheory of Fiction, Londres,
Oxford, New York, Oxford University Press, 1966.
Koselleck (R.), Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher
Zei-ten, Francfort, Suhrkamp, 1979.
Lalande (A.), Vocabulairetechniqueet critiquedela philosophie, Paris,
PUF, 1960.
Lefort (C), Essai sur lepolitique, Paris, d. du Seuil, coll. Esprit ,
1986.
Lejeune (P.), LePacteautobiographique, Paris, d. du Seuil, 1975.
Lvinas (E.), LeTemps et l'Autre, Paris, Arthaud, 1947 ; rimp. Mont-
pellier, Fata Morgana, 1979 ; Paris, PUF, 1983-1985.
- Totalitet Infini. Essai sur l'extriorit, La Haye, M. Nijhoff, 1961,
1965, 1968, 1971, 1974.
- Autrement qu'treou au-del del'essence, La Haye, M. Nijhoff, 1974.
Lewis (D.), Survival and Identity , in A.O. Rorty (d.), TheIdentities
of Persons, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California
Press, 1976, p. 17-40. Locke (J.), An Essay concerning Human
Understanding (1690), d. P.H. Nidditch, Oxford, 1975.
- Essai philosophique concernant l'entendement humain, trad. fr. de
P. Coste, Paris, Vrin, 1972.
- Of Identity and Diversity [extrait du chapitre XXVII de J. Locke,
Essay concerning Human Understanding], in J. Perry (d.), Personal
I dentity, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California
Press, 1975, p. 33-52.
Maclntyre (A.), After Virtue, a study in moral theory. Notre Dame (Ind.),
University of Notre Dame Press, 1981. Maine de Biran, J ournal, d.
int. pub. par H. Gouhier, Neuchtel, d. de
la Baconnire ; Amsterdam, Imp. de Holland, 1954. Man (P. de),
Rhetoric of Tropes , in Allgories ofReading : figurai lan-
guagein Rousseau, Nietzsche, Rilkeand Proust, New Haven, Londres,
Yale University Press, 1979. Mansion (A.), Introduction la physique
aristotlicienne, Louvain, 1946 ;
Paris, Vrin, 1973.
416 417
OUVRAGES CITS
OUVRAGES CITS
Marcel (G.), treet Avoir, Paris, Aubier, 1935.
- Actes du colloqueGabriel Marcel (28-30 septembre1988). Paris, Biblio
thque nationale, 1989.
Marx (W.), Ethos und Lebenswelt. Mitleidenknnen als Mass. Hambourg,
Flix Meiner Verlag, 1986.
Melden (A.I.), FreeAction, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1961.
Mink (L.O.), History and Fiction as Modes of Comprhension , in
New Literary History I , 1979.
Musil (R.), L'Hommesans qualits, 2 vol., trad. fr. de P. Jaccottet, Paris,
d. du Seuil, 1979.
Nabert (J.), lments pour unethique, prf. de P. Ricur, Paris, Mon-
taigne, 1962, chap. vu, L'ascse, p. 121-138.
- Essai sur le mal, Note sur l'ide de mal chez Kant , Paris, PUF,
1955, p. 159-165.
Nietzsche (F.), Cours de rhtorique, profess Ble, trimestre d'hiver
1872-1873 ; t. V de l'd. Krner-Musarion, trad. et prsent en franais
par P. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, in Potique, n 5, 1971 ; et en
anglais par C. Blair, in Philosophy and Rhetoric, 1983, p. 94-129.
- Fragments posthumes, in uvres philosophiques compltes, t. IX
XIV, d. G. Colli et M. Montinari, Paris, Gallimard.
- Gnalogiedela morale, in uvres philosophiques compltes, t. VII,
textes et variantes tablis par G. Colli et M. Montinari, trad. fr. de
C. Heim, I. Hildenbrand, J. Gratien, Paris, Gallimard, 1971, 1987.
- Le Livre du philosophe. Dos Philosophenbuch, d. bilingue, trad. fr.
d'A.K. Marietti, Paris, Aubier-Flammarion, 1969.
- La Naissancedela tragdie, in uvres philosophiques compltes, t. I,
sous la direction de G. Colli et M. Montinari, trad. fr. de M. Haar,
P. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, Paris, Gallimard, 1977.
- Vrit et Mensonge au sens extra-moral, in uvres philosophiques
compltes, 1.1, vol. 2, crits posthumes 1870-1873, sous la direction de
G. Colli et M. Montinari, Paris, Gallimard, 1975.
- La Volontdepuissance, trad. fr. de G. Bianquis, Paris, Gallimard,
1948.
Nussbaum (M.C.), Thefragility ofgoodness, Luck andethics in Greek
tra-gedy and philosophy, Cambridge University Press, 1986.
Parfit (D.), Personal Identity , in J. Perry (d.), Personal Identity, sec-
tion V, Personal Identity and Survival, Berkeley, Los Angeles,
Londres, University of California Press, 1975, p. 199-223.
- Reasons and Persons, Oxford University Press, 1986.
Pariente (J.-C), LeLangageet l'Individuel, Paris, Colin, 1973.
Peirce (C.S.), Collected Papers, Harvard University Press, 5 vol.,
1931-1935.
- crits sur lesigne, rassembls, traduits et comments par G. Deledalle,
Paris, d. du Seuil, 1978.
Perry (J.), Personal identity. Berkeley, Los Angeles, Londres, University
of California Press, 1975. Petit (J.-L.), La Smantiquedel'action,
indit, Paris I - Sorbonne.
Platon, Dialogues, Paris, Les Belles Lettres.
Propp (W.), Morphologiedu conte, Paris, d. du Seuil, 1965, 1970.
Proust (M.), A la Recherchedu temps perdu, 3 vol., Paris, Gallimard, coll.
Bibliothque de la Pliade, 1954, 1956, 1963. Ravaisson (F.), De
l'habitude. Corpus des uvres de philosophie en
langue franaise, Paris, Fayard, 1984. Rawls (J.), A Theory of J ustice,
Harvard University Press, 1971, Thorie
dela justice, trad. fr. de C. Audard, Paris, d. du Seuil, 1987.
- Un consensus par recoupement , in Revuedemtaphysiqueet de
morale, n 1, 1988, p. 3-32.
Rcanati (F.), La Transparence et l'nonciation, Paris, d. du Seuil,
1979.
Revault d'Allonnes (M.), Amor Mundi : la persvrance du politique ,
in Ontologieet Politique. Hannah Arendt, Paris, Tierce, 1989.
Rey (G.), Survival , in A.O. Rorty (d.), TheIdentities of Persons, Ber-
keley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1976, p.
41-66.
Richter(J.P.), dit Jean Paul, Vorschule der Aesthetik, nebsteinigen
Vorle-sungen in Leipzig ber die Parteien der Zeit, Hambourg, F.
Perthes, 1804 ; trad. fr., A. Buchner et L. Dumont, Potique ou
Introduction l'esthtique, Paris, Durand, 1862.
Ricur (P.), A l'coledela phnomnologie, Paris, Vrin, 1980.
- Lectures on Ideology and Utopia, d. G.H. Taylor, New York,
Colum-bia University Press, 1986.
- Le cercle de la dmonstration dans Thorie de la justice (John
Rawls) , in Esprit, n 2, 1988, p. 78 et sq.
- Emmanuel Lvinas, penseur du tmoignage , in Rpondred'autrui,
Emmanuel Lvinas (collectif), Lausanne, La Baconnire, 1989.
- Entre thique et ontologie, la disponibilit , ColloqueGabriel Mar-
cel (1988), Paris, Bibliothque nationale, 1989.
- Le paradoxe politique , in Esprit, n 5, mai 1957, repris in Histoire
et Vrit. Paris, d. du Seuil, 3
e
d. augmente, 1987.
- Pouvoir et violence, in Ontologie et Politique. Hannah Arendt,
Paris, Tierce, 1989, p. 141-159.
- Le rcit interprtatif. Exgse et thologie dans les rcits de la Pas-
sion , Recherches de science religieuse, 1985.
- Le sujet convoqu. A l'cole des rcits de vocation prophtique ,
Revue de l'I nstitut catholique de Paris, octobre-dcembre 1988, p.
88-89.
Riedel (M.), Fur eine zweite Philosophie. Vortrgeund Abhandlungen,
Francfort, Suhrkamp, 1988. Robins (M.H.), Promising, Intending,
and Moral Autonomy, Cambridge
University Press, 1984. Romains (J.), Les Hommes debonnevolont, 4
vol., Paris, Flammarion,
1973. Romeyer-Dherbey (G.), Mainede Biran ou le Penseur de
l'immanence
radicale, Paris, Seghers, 1974.
418
419
OUVRAGES CITES OUVRAGES CITS
Rorty (A.O.) (d.), The Identifies of Persons. Berkeley, Los Angeles,
Londres, University Press of California, 1976. Rosenzweig (F.),
L'Etoile de la rdemption, trad. fr. d'A. Derczanski et
J.-L. Schlegel, Paris, d. du Seuil, 1982. Rousseau (J.-J.), Du
Contrat social, in uvres compltes, t. III, sous la
direction de B. Gagnebin et M. Raymond, Paris, Gallimard, coll.
Bibliothque de la Pliade , 1964. Ryle (G.), The Concept ofMind,
Londres, New York, Hutchinson's University Library, 1949 ; trad. fr. de
S. Stern-Gillet, La Notion d'esprit,
Paris, Payot, 1978. Schapp (W.), In Geschichten verstrickt,
Wiesbaden, B. Heymann, 1976. Scheler (M.), Der Formalismusin der
Ethik unddiematerialeWertethik ;
neueVersuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, 1954;
nlle d., Berne, 1966.
- LeFormalismeen thiqueet l'thiquematerialedes valeurs, essai nou-
veau pour fonder un personnalisme thique, trad. fr. de M. de
Gandil-lac, Paris, Gallimard, 1955.
- Zur Phanomenologieder Sympathiegefuhleundvon LiebeundMasse,
Halle, Niemeyer, 1913.
- Nature et Formes de la sympathie, trad. fr. de M. Lefebvre, Paris,
Payot, 1928 ; nlle d., Petite bibliothque Payot , 1971.
Searle (J.R.), Les Actes de langage, Paris, Hermann, 1972.
- The Philosophy of Language, Oxford University Press, 5' d., 1977.
Shoemaker (S.), Self-knowledge and self-identity, Ithaca, Cornell Univer
sity Press, 1963.
Spinoza (B.), thique, texte et trad. fr. de C. Appuhn, Paris, Vrin, 1977.
- Trait politique, texte et trad. fr. de S. Zac, Paris, Vrin, 1968.
Steiner (G.), Antigones, Oxford, Clarendon Press, 1984.
- Les Antigones, trad. fr. de P. Blanchard, Paris, Gallimard, 1986.
Strasser (S.), Dos Gemt, Grundgedanken zu einer phnomenologischen
Philosophieund Thoriedes menschlichen Gefuhlslebens, Utrecht,
Uit-geverijet Spectrum, 1956. Strawson (P.F.), lndividuals, Londres,
Methuen and Co, 1959 ; trad. fr. d'A. Shalom et P. Drong, Les
Individus, Paris, d. du Seuil, 1973.
- Essays on Davidson Actions andEvents , in B. Vermazen et M. Hin-
tikka (d.), Causation and Explanation, Oxford, Clarendon Press,
1985.
Taminiaux (J.), Lectures del'ontologiefondamentale. Essais sur Heideg-
ger, Grenoble, Jrme Millon, 1989.
Taylor (Ch.), The Explanation of Behaviour, Londres, Routledge and
Kegan Paul, 1964.
- Hegel's Concept of Action as Unity of Poiesis and Praxis , in L.S.
Stepelevitch et D. Lamb (d.), Hegel's Philosophy of Action, Humani-
ses Press, 1983.
- Philosophical Papers, 2vol. : Human AgencyandLanguage, et Philo-
sophy and the Human Sciences, Cambridge University Press, 1985.
Vanderveken (D.), Les Actes de discours, Lige, Bruxelles, Mariaga, 1988.
Vernant (J.-P.) et Vidal-Naquet (P.), Mythe et Tragdie en Grce
ancienne, t. I, Paris, La Dcouverte, 1986. Volpi (F.),
Heidegger e Aristotele, Padoue, Daphni, 1984.
- Dasein comme praxis : l'assimilation et la radicalisation heidegg-
rienne de la philosophie d'Aristote, in Phaenomenologica, Dor-
drecht, Boston, Londres, KJuwer Acadmie Publ., 1988.
Wahl (F.), Les anctres, a ne se reprsente pas, in L'Interdit de la
reprsentation, colloque de Montpellier 1981, Paris, d. du Seuil,
1984, p.31-62. Walzer (M.), Sphres of J ustice. A Dfenseof
Pluralismand Equality,
New York, Basic Books, 1983. Weber (M.), Wirtschaft und
Gesellschaft, 5
e
d. rvise, Tubingen, J.B.C.
Mohr et P. Siebeck, Studienausgabe, 1972 ; trad. fr. de J. Freund et al,
conomieet Socit, Paris, Pion, 1971.
- Le mtier et la vocation d'homme politique , in Le Savant et le Poli
tique, trad. fr. de J. Freund, Paris, Pion, 1959, p. 99-185.
Weil (t.), Hegel et l'tat, Paris, Vrin, 1966.
- Logiquedela philosophie, Paris, Vrin, 1950.
- Problmes kantiens, Paris, Vrin, 1970.
Wiggins (D.), Dlibration and practical reason , in A.O. Rorty (d.),
Essays on Aristotle's Ethics, University of California Press, 1980.
Williams (B.), Problems ofthe Self, Cambridge University Press, 1973.
- The Self and the Future , in J. Perry (d.), Personal Identity, section
V, Personal Identity and Survival , Berkeley, Los Angeles, Londres,
University of California Press, 1975, p. 179-198.
Wittgenstein (L.), Tractatus logico-philosophicus, trad. fr. de P.
Klos-sowski, Paris, Gallimard, 1961. The Blue and Brown Books.
d. R. Rhees, Oxford, Basil Blackwell, 1958.
- Le Cahier bleu et le Cahier brun, trad. fr. de G. Durand, Paris, Galli
mard, 1965, repris en coll. Tel, Paris, Gallimard, 1988.
- Investigations philosophiques, trad. fr. de P. Klossowski, Paris, Galli
mard, 1961.
Wright (G.H. von), Explanation and Understanding, Londres, Routledge
and Kegan Paul, 1971. Zac (S.), L'Idedeviedans la philosophiede
Spinoza, Paris, PUF, 1963.
420
Index
Anscombe, G.E.M.. 80, 86-94. 100,
102, 126, 129, 182, 372.
Apcl, K.O. : 257, 325-328.
Arendt, H.: 76, 227-230. 299, 362,
378.
Aristote: 31, 32, 88, 90, 91, 110-117.
119, 121, 123-125, 133, 146,
168-171. 180-181, 186, 189, 192,
194, 201, 203-221, 223, 225,
231-233, 235, 238, 242, 255, 267,
271-272, 282, 283, 293, 295,
299-302. 304-305, 317-318, 339,
340, 346, 347, 348, 350, 352-358,
360-366, 379, 381, 383, 406.
Aron, R. : 97, 131.
Aubenque, P. : 205, 283.
Augustin (saint) : 103, 110, 253.
Austin J.L. : 57-58, 105, 349.
Beauchamp, P. : 36.
Benjamin, W. : 169, 192, 193.
Benveniste, . : 58, 62, 65.
Bergson, H. : 39.
Berlin, 1. : 302.
Bernanos, G. : 36.
Brague, R. : 219-220, 355, 356, 360,
363-364. Braudel, F. : 148.
Bremond, Cl. : 172, 173.
Bubner, R. : 334. Butler, J. :
152.
Calvo, F. : 355.
Camois, B. : 242, 245, 248, 306.
Castoriadis, C. : 295. Chisholm,
R. : 104, 154. Coleridge, S.T. :
188. CoUingwood, R.G. : 124.
Condillac, . Bonnot de : 372.
Constant, B. : 308.
Coquet, J.-C. : 196.
Danto, A. : 79, 126-127, 129, 136, 139,
181, 372. Davidson, D. : 67, 86,
93-97. 99-108.
126, 157, 169,348,349,370. Delaisi,
G. : 314. Deleuze, G. : 399. Descartes,
R.: 15-22. 24-27. 33-35.
110, 119, 124, 224, 347, 348, 367,
371, 383. Diels, H. : 144.
Dilthey, W. : 139, 168. Donagan,
A. : 323-325. 339, 341.
Dostoevski, F.M. : 176. Dupuy,
J.-P. : 268, 273. Durkheim, . :
234. Dworkin, R. : 322, 323, 333.
Ellendt, F. : 287.
Fagot, A. : 314-316.
Fay, B.: 188.
Ferry, J.-M. : 326.
Fessard, G. : 225.
Fichte, J.G. : 15,21, 396.
Finkielkraut, A. : 332.
Foucault, M. : 12.
Fraisse, J.-C. : 213.
Fraisse, S. : 283.
Franck, D. : 373-375, 384-386.
Frege, G. : 41, 106.
Freud, S. : 283, 407, 408, 409.
Frye, N. : 35, 37.
Gadamer, H.G. : 187, 208, 222, 333,
361, 406. Gagnebin,
J.-M. : 169.
423
INDEX INDEX
Gellrich, M. : 289.
Gewirth, A. : 239.
Girard, R. : 268.
Goyard-Fabre, S. : 240.
Granger, G.G. : 63, 65, 66, 67, 68.
Greimas, A.J. : 173, 174, 196.
Grice, H.P. : 59.
Greisch, J. : 38.
Gueroult, M.: 19, 396.
Guillaume, G. : 11.
Habermas, J. : 257, 304, 325-329, 333,
334, 336. Hamon, P. : 174. Hardie,
W.F.R. : 116. Hart, H.L.A. : 121-122,
130. Havel Vclar : 298 n.2. Hegel,
G.W.F. : 110, 122, 185, 219,
281, 284, 285, 288-290, 295-298,
300, 301. 309, 332, 333, 337, 343-
344, 395-398, 399, 400, 405, 406-
407, 409. Heidegger, M. : 76,
148-149, 178, 212,
239, 357-365. 367, 373,
377-379,
392, 394, 401-406. 408, 409.
Henrich, D. : 248. Henry, M.:
371, 372, 379. Herder, J.G. : 22.
Hillel : 255. Hintikka, M.B. : 96.
Hisashige, T. : 343. Hobbes, T. : 269,
301. Hfle, O. : 240, 242, 245, 248,
249,
306,321. Homre : 214. Hume, D. :
81, 84, 150, 152-155. 156,
157, 164, 199, 269,348,372. Husserl,
E. : 15, 21, 65-67, 71, 86, 178,
215, 350, 360, 373-375, 377, 379,
382-387, 389, 393.
Jacques, F. : 391. Jaspers, K. :
253-254, 283, 404. Jauss, H.R.:
189, 381. Jonas, H. : 317, 342.
Jiingel, E. : 38.
Kant, E. : 15, 21, 44, 69, 110, 122,
125-129. 131-133, 136, 141-143,
148, 150, 153, 155, 201, 224, 235,
238-255, 257-260, 262-263, 266,
267, 268, 275-277, 282, 296, 297,
301, 305-310, 312-314, 316,
319-324,
326, 328, 332, 333, 337, 340, 349,
354, 359, 388, 395, 396, 403.
Kapstein, M. : 166.
Kemp, P. : 195,220, 313,317.
Kenny, A. : 105.
Kermode, F. : 171, 177, 190, 192.
Kohut, H. : 384.
Kolhberg, L. : 329, 333.
Koselleck, R. : 191, 333.
Kranz, W. : 144.
Lalande, A. : 339.
Landsberg, P.: 198.
Lefort, Cl. : 295, 303, 331.
Leibniz, G.W. : 40, 347.
Lejeune, P.: 189.
Leiris, M.: 177.
Levi, E.H. : 323.
Lvi-Strauss, Cl. : 196.
Lvinas, E. : 35, 195, 198, 215, 219,
221-223, 236, 382, 383, 387-393,
403, 408, 409. Lewis, D. : 163.
Locke, J. : 150-153, 155, 156,161, 170,
301.
Machiavel: 229, 301.
Maclntyre, A. : 186-190, 194, 207-209,
326. Maine de Biran : 150,
371-373, 375,
377-378. Malebranche, N. de :
21. Man, P. de : 25. Mann, T. :
190. Mansion, A. : 112, 113.
Marcel, G.: 198,225,311,371.
Marx, W. : 225. Matthieu (saint)
: 255. Melden, A.I. : 79.
Merleau-Ponty, M. : 212, 371.
Mill, J.S. : 267,301. Mink,
L.O.:188. Musil, R. : 177, 196.
Nabert, J. : 198,253,336, 392.
Nietzsche, F. : 22-27. 33, 35, 154, 178,
333, 398-400, 403, 405. Nussbaum,
M.C. : 210, 224, 284-287.
Parfit, D. : 67, 156-166, 168, 175, 178-
180, 197, 198, 348, 349, 370.
Pariente, J.-C. : 39-43. Pascal, B. :
37.
Paul (saint): 161, 255.
Peirce, C.S. : 65-66.
Pelage : 253.
Perelman, Ch. : 264.
Pricls : 235, 299.
Perry, J. : 152, 155, 163.
Petit, J.-L. : 86, 350, 376.
Platon: 24, 214, 216, 219, 231, 244,
267, 346, 347, 367-368, 389, 394.
Propp, W. : 171, 173, 174. Proust, M. :
203.
Quine, W. van Orman : 41.
Ravaisson, F. : 146.
Rawls, J. : 230, 233, 235, 236, 267-276,
292-296. 304, 329, 330, 333, 335,
336. Rcanati, F. : 56-57, 60, 63. 65,
67. Revault d'Allonnes, M. : 299. Rey,
G. : 163. Ricur, P. : 35, 36, 76, 82,
229, 230,
311. Riedel, M. : 31. Robins,
R.H. : 310. Romains, J. : 190.
Romeyer-Dherbey, G. : 371.
Rorty, A.O.: 155, 163,205.
Rosenzweig, F. : 226, 405.
Rousseau, J.-J. : 245,266, 301.
Russell, B. : 42, 124,349. Ryle,
G. : 97, 148.
Sandel, M. : 326. Sartre,
J.-P. : 191,210. Schapp, W. :
130, 190. Scheler, M.:
224,233,401. Searle, J.R.:
57,58, 59, 183. Shoemaker, S.
: 155. Sidgwick, H. : 267.
Socrate : 209, 397.
Solon : 235.
Sophocle : 281-289. 291,325.
Spinoza, B. : 21, 119, 299, 347,
365-367.
Steiner, R. : 283, 287.
Strasser, S. : 224.
Strauss, L. : 269.
Strawson, P.F. : 39, 40, 43-54, 75-77,
85, 96-97, 104, 107, 109-110, 116,
118, 120, 135, 160,348, 349, 369.
Taminiaux, J. : 362-363.
Taylor, Ch. : 98, 211, 213, 309, 326.
Thalberg, 1. : 101.
Thomas (saint) : 119, 310, 324.
Thucydide: 214.
Tocqueville, A. de : 301.
Tolsto, L. : 176.
Vanderveken, D. : 243.
Vermazen, B. : 96.
Vernant, J.-P. : 283.
Vidal-Naquet, P. : 283.
Volpi, F. : 361-362.
Wahl, F. : 408.
Walzer, M. : 293-294, 326.
Weber, M.: 97, 131, 184-185,
227,
234, 299. Weii, . 198, 239. 257,
295, 297. Wiggins, D. : 205. Williams,
B.: 155, 163. Wittgenstein, L. : 62.
67-65, 70-71. 83,
329, 350, 376. Wright, G.H.
von : 134, 182, 372.
Xnophane: 219.
Zac, S. : 365, 367.
424
^
Table
Remerciements 9
Prface. La question de l'ipseit 11
1. Le Cogito se pose 15
2. Le Cogito bris 22
3. Vers une hermneutique du soi 27
Premire tude. La personne et la rfrence identifiante.
Approche smantique 39
1. Individu et individualisation 39
2. La personne comme particulier de base 43
3. Les corps et les personnes 46
4. Le concept primitif de personne 49
Deuxime tude. L'nonciation et le sujet parlant. Approche prag
matique 55
1. nonciation et actes de discours (speech-acts) 56
2. Le sujet de renonciation 60
3. La conjonction des deux voies de la philosophie du langage 68
Troisime tude. Une smantique de l'action sans agent 73
1. Le schma conceptuel de l'action et la question qui ? 75
2. Deux univers de discours : action contre vnement, motif contre
cause 79
3. L'analyse conceptuelle de l'intention 86
4. Smantique de l'action et ontologie de l'vnement 93
Quatrime tude. De l'action l'agent 109
1. Un problme ancien et un problme nouveau 110
2. Les apories de l'ascription 118.
Cinquime tude. L'identit personnelle et l'identit narrative 137
1. Le problme de l'identit personnelle 140
2. Les paradoxes de l'identit personnelle 150
Sixime tude. Le soi et l'identit narrative 167
1. L'identit narrative et la dialectique de l'ipseit et de la mmet 167
2. Entre dcrire et prescrire : raconter 180
3. Les implications thiques du rcit 193
Septime tude. Le soi et la vise thique 199
1. Viser la vie bonne ... 202
2. ...avec et pour l'autre... 211
3. ...dans des institutions justes 227
Huitime tude. Le soi et la norme morale 237
1. La vise de la vie bonne et l'obligation 238
2. La sollicitude et la norme 254
3. Du sens de la justice aux principes de justice 264
Neuvime tude. Le soi et la sagesse pratique : la conviction 279
Interlude : Le tragique de l'action 281
1. Institution et conflit 291
2. Respect et conflit 305
3. Autonomie et conflit 318
Dixime tude. Vers quelle ontologie ? 345
1. L'engagement ontologique de l'attestation 347
2. Ipsit et ontologie 351
3. Ipsit et altrit 367
Ouvrages cits 411
Index 423
DU MME AUTEUR
AUX MMES DITIONS
Karl Jaspers
et la Philosophie de l'existence
en collaboration avec M. Dufrenne, 1947
Gabriel Marcel et Karl Jaspers
Philosophie du mystre et
philosophie du paradoxe, 1948
Histoire et Vrit
troisime dition
augmente de quelques textes
coll. Esprit , 1955,1964,1990
De l'interprtation
Essai sur Freud
coll. Uordre philosophique , 1965
coll. Points Essais , 1995
Le Conflit des interprtations
Essais d'hermneutique I
coll. L'ordre philosophique , 1969
La Mtaphore vive coll.
L'ordre philosophique , 1975
Temps et Rcit, t. 1
coll. L'ordre philosophique , 1983
coll. Points Essais , 1991
Temps et Rcit, t. 2
La configuration dans le rcit de fiction
coll. L ordre philosophique , 1984
coll. Points Essais , 1991
Temps et Rcit, t. 3
Le temps racont
coll. L'ordre philosophique , 1985
coll. Points Essais , 1991
Du texte l'action
Essais d'hermneutique II
coll. Esprit , 1986
Lectures 1
Autour du politique
coll. La couleur des ides , 1991
Lectures 2
La contre des philosophes
coll. La couleur des ides , 1992
Lectures 3
Aux frontires de la philosophie
coll. La couleur des ides , 1994
CHEZ D'AUTRES DITEURS
Philosophie de la volont I. Le
volontaire et l'involontaire
Aubier, 1950,1988 II.
Finitude et culpabilit
1. L'homme faillible 2.
La symbolique du mal
Aubier, 1960,1988
Ides directrices pour une
phnomnologie d'Edmond Husserl
traduction et prsentation
Gallimard, 1950-1985
Quelques figures contemporaines
Appendice /'Histoire de la
philosophie allemande, de E. Brhier
Vrin, 1954,1967
A l'cole de la phnomnologie
Vrin, 1986
Le mal. Un dfi la philosophie
et la thologie
Genve, Labor et Fides, 1986
Amour et justice. Liebe und Gerechtigkeit J.
C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, 1990
Rflexion faite : autobiographie intellectuelle
ditions Esprit, 1995
Le Juste Editions
Esprit, 1995
La Critique et la Conviction
entretiens avec Franois Azouvi et Marc de Launay
Calmann-Lvy, 1995
COMPOS.TION: ,MPR,MER.EHR.SSEYAVREUX(EURE.
1MPRESS,ON . NORMAND ROTO-M P^AU (6-96)
DPT LGAL MARS 1990. N 1 1458-4 (96-1206)
Vous aimerez peut-être aussi
- Cap Maths CP Guide Peda-2021Document356 pagesCap Maths CP Guide Peda-2021John Paluku100% (5)
- TRIACDocument23 pagesTRIACAHIANTAPas encore d'évaluation
- Corrige TP05Document3 pagesCorrige TP05Mouad1993Pas encore d'évaluation
- La SarcoïdoseDocument27 pagesLa SarcoïdoseghofranePas encore d'évaluation
- Diagrammes Comportementaux DUML 2 - Diagramme Détats de Séquence Diagramme de CommunicationDocument32 pagesDiagrammes Comportementaux DUML 2 - Diagramme Détats de Séquence Diagramme de CommunicationÀmi NaPas encore d'évaluation
- Broschuere Kundenratgeber F WebDocument36 pagesBroschuere Kundenratgeber F Webkarijoseph02Pas encore d'évaluation
- (TP FAO Tournage Corrig - 351) PDFDocument7 pages(TP FAO Tournage Corrig - 351) PDFDPO PRPas encore d'évaluation
- 3 Funiculaire Réactions Et MomentsDocument6 pages3 Funiculaire Réactions Et MomentsstafePas encore d'évaluation
- Operation ArithmètiqueDocument5 pagesOperation ArithmètiqueAhmed BelhadjPas encore d'évaluation
- 640Document22 pages640dknewsPas encore d'évaluation
- DENDANE Mourad AhmedDocument131 pagesDENDANE Mourad AhmedKader MilanoPas encore d'évaluation
- Belco PDFDocument96 pagesBelco PDFDenonPas encore d'évaluation
- CatalogueDocument136 pagesCataloguekéba CAMARAPas encore d'évaluation
- PAYS BAS Regime de Securite Sociale Pour Salaries - Version n2Document18 pagesPAYS BAS Regime de Securite Sociale Pour Salaries - Version n2URSULA MUSSOPas encore d'évaluation
- Ch1 Les Ondes ProgressivesDocument17 pagesCh1 Les Ondes ProgressivesMed Mehdi SAIDIPas encore d'évaluation
- Modul Maths f1Document9 pagesModul Maths f1Nur Fatihah100% (1)
- CG2Document87 pagesCG2misbah mohamedPas encore d'évaluation
- Td-Formules Ration Monogastres - 2021Document5 pagesTd-Formules Ration Monogastres - 2021Kayi Romaine AwounonPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Evaluation Des Performances Sur Les RéseauxDocument26 pagesChapitre 1 Evaluation Des Performances Sur Les Réseauxoussama100% (1)
- Constantin V. GheorghiuDocument43 pagesConstantin V. GheorghiuGiorgosby17Pas encore d'évaluation
- Domaines D'applicationDocument4 pagesDomaines D'applicationdidoPas encore d'évaluation
- Rapport de Satge FinDocument49 pagesRapport de Satge FinNisrine LachhabPas encore d'évaluation
- Ms FR 1996 - La Doctrine Et L'industrie Du Noble Jeu de La Hache Et La Maniere de BattaillierDocument24 pagesMs FR 1996 - La Doctrine Et L'industrie Du Noble Jeu de La Hache Et La Maniere de BattaillierSteve PlanchinPas encore d'évaluation
- Protection Transformateur de Puissance 1651076878Document43 pagesProtection Transformateur de Puissance 1651076878Carlos CastellonPas encore d'évaluation
- 2 Chapitre 1 Culture Sous SerreDocument9 pages2 Chapitre 1 Culture Sous SerreBenfreha Sidali0% (1)
- These Hugues Goma VFDocument274 pagesThese Hugues Goma VFalexnianga39Pas encore d'évaluation
- Blondel - La Patience de NietzscheDocument8 pagesBlondel - La Patience de NietzscheSherlock DestinyPas encore d'évaluation
- Debyser Analyse ContrastiveDocument32 pagesDebyser Analyse ContrastiveMichèle MichèlePas encore d'évaluation
- Comment Décongeler Du Fromage - Recherche GoogleDocument5 pagesComment Décongeler Du Fromage - Recherche GoogleChahdae BakhatPas encore d'évaluation
- Cycles BiogéochimiquesDocument9 pagesCycles BiogéochimiquesHoussam ChebliPas encore d'évaluation