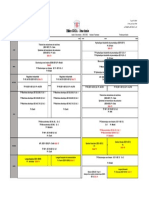Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Moulins À Eau en Europe Occidentale (IX - Xii Siècle) - Aux Origines D'Une Économie Institutionnelle de L'Énergie Hydraulique
Les Moulins À Eau en Europe Occidentale (IX - Xii Siècle) - Aux Origines D'Une Économie Institutionnelle de L'Énergie Hydraulique
Transféré par
Jean-Pierre MolénatTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Moulins À Eau en Europe Occidentale (IX - Xii Siècle) - Aux Origines D'Une Économie Institutionnelle de L'Énergie Hydraulique
Les Moulins À Eau en Europe Occidentale (IX - Xii Siècle) - Aux Origines D'Une Économie Institutionnelle de L'Énergie Hydraulique
Transféré par
Jean-Pierre MolénatDroits d'auteur :
Formats disponibles
MATHIEU ARNOUX
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
(IXe-XIIe SICLE). AUX ORIGINES DUNE
CONOMIE INSTITUTIONNELLE DE LNERGIE
HYDRAULIQUE *
En plaant ce rapport dans la section Aspetti economici
dellacqua de notre rencontre, les organisateurs de cette
Semaine suggraient de faire sortir la question de la diffusion
et de lusage du moulin eau dans le haut Moyen ge du
chapitre transition entre lAntiquit et le monde mdival
auquel on rserve traditionnellement son examen, depuis
larticle fameux publi par Marc Bloch en 1935 1. Sur ce
point, la tche naurait pas t trs difficile: la bibliographie
consacre cette question est vaste et de qualit et elle
prsente souvent un caractre synthtique qui en rend le
compte-rendu ais. Mais un rapport sur ce point, surtout de
ma part, aurait eu quelque difficult renouveler une
problmatique aussi bien tablie et aller au-del de la
confirmation de certains points largement acquis. Sans
droger lobligation den faire linventaire, prliminaire
indispensable la poursuite dune enqute sur les moulins, il
ma paru plus utile et plus conforme la suggestion lance
par les organisateurs de dplacer le questionnement vers
laval, en minterrogeant sur le lien entre diffusion du moulin
eau et dveloppement des structures seigneuriales, un
* Extrait de L'Aqua nei secoli altomedievali. Atti della LV Settimana di studio
(Spoleto, 12-17 aprile 2007), Spolte, 2008, p.693-746.
(1) M. BLOCH, Avnement et conqute du moulin eau, dans Annales dhistoire
conomique et sociale, 7 (1936), p. 538-563, repris dans Mlanges historiques, Paris,
1963 (2e dition, 1983), t. 2, p. 800-821.
694
MATHIEU ARNOUX
thme qui reste curieusement moins tudi que celui des
origines antiques de linnovation mdivale. Cet expos
sarticulera donc en deux moments de longueurs ingales:
dans un premier temps, linterrogation dune bibliographie
qui reste essentielle pour notre question, puis ltude dune
transition mal connue, o construction seigneuriale,
croissance dmographie et urbanisation jouent un rle
important, et qui voit, au terme de notre priode, la mise en
place partout en Europe dune infrastructure technique et
dun ensemble dusages et de rgles appels marquer
lconomie europenne jusquau milieu du XIXe sicle.
RELIRE MARC BLOCH
Larticle publi en 1935 dans les Annales est aujourdhui
lun des crits les plus connus de lhistorien. La publication
rcente de sa correspondance avec Lucien Febvre permet de
comprendre mieux la gense de ce texte important, labor
en 1934 et 1935 sous la forme dun long article, la fois tude
monographique sur la question du moulin eau dans
lAntiquit et le haut Moyen ge et programme de recherches
sur les techniques dans le monde mdival 2. Cest sur la
suggestion de Lucien Febvre que Marc Bloch se dcida le
scinder en deux volets indpendants, qui furent tous deux
publis dans le numro de novembre 1935 de la revue: le
premier, Avnement et conqute du moulin eau , dans la
rubrique Articles reprenait la partie monographique du
texte initial; le second, Les inventions mdivales ,
dveloppant lintroduction de la premire version, figurait
(2) M. BLOCH, L. FEBVRE, Correspondance, d. B. MLLER, t. 2, Paris, 2003, p. 193 (11
dcembre 1934), 226 (13 avril 1935), p. 246 (5 juin 1935), p. 249 (6 juin 1935), p. 251
(6-11 juin 1935), p. 253 (11 juin 1935).
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
695
dans la partie Problmes densemble du numro 3. Il nest
pas sans importance de signaler que les 120 pages de ce
numro, publies sour le titre gnral Les techniques,
lhistoire et la vie constituaient le premier numro
thmatique de la revue 4. Outre les deux articles dj cits, y
figuraient pas moins de quatre contributions de Lucien
Febvre, ainsi quun article important du sociologue Georges
Friedmann sur Taylor et le taylorisme , un article ainsi que
des contributions plus courtes de lhistorien et anthropologue
marxiste Charles Parain et du gographe Jules Sion. Volontiers
polmiques dans leur ton, les diverses contributions
affirmaient laffinit de la revue lgard dune approche
marxiste non dogmatique de lhistoire des sciences et des
techniques. Elle traduisaient aussi la volont de ne pas
abandonner le terrain de lhistoire de linnovation celui qui
en tait alors lhistorien le plus connu en France, le
commandant Lefebvre des Nottes, dont Marc Bloch avait
salu les premires publications pour leur caractre pionnier,
mais dont il critiquait dans ses deux articles le caractre
excessivement dterministe, et ses yeux insuffisamment
historique. Dans cette perspective, cest un autre
autodidacte historien des techniques, le marin Guilleux La
Rorie, quavait t demand un article sur lhistoire du
gouvernail, dont la perspective trs internaliste et
lattention la complexit des problmes techniques servaient
le propos des directeurs de la revue.
Il convient donc pour une lecture actuelle des deux textes
de Marc Bloch de ne pas oublier leur aspect programmatique
et polmique et leur place dans une stratgie doccupation de
(3) M. BLOCH, Les inventions mdivales, dans Annales dhistoire conomique et
sociale, 7 (1936), p. 634-644, repris dans Mlanges historiques, Paris, 1963 (2e dition,
1983), t. 2, p. 822-832.
(4) La revue peut tre consulte en ligne: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k10035t>
696
MATHIEU ARNOUX
champs auparavant ignors par la discipline historique. De
fait, le caractre volontairement frontalier de lenqute
mene sur les moulins, dont la problmatique est autant
conomique et sociologique que proprement historique, lui a
valu dtre plus et mieux lu dans un premier temps par des
spcialistes de sciences sociales que par des historiens. Dune
certaine manire, Marc Bloch lui-mme donne lexemple en
ne le citant pas dans la bibliographie de sa Socit fodale, o
il ne consacre dailleurs que quelques lignes au problme de
la banalit du moulin. Son disciple Andr Dlage, qui cite
larticle dans sa thse sur la Vie rurale en Bourgogne, ny
donne gure dimportance ce thme 5. Curieusement, lune
des premires rfrences dans la littrature anglo-saxonne
provient de larticle publi en 1939 par une enseignante du
dpartement de sociologie de lUniversit de Berkeley,
Margaret Trabue Hodgen, sur les moulins eau dans le
Domesday Book 6. Aprs elle, dautres spcialistes des
techniques continurent approfondir les questions poses
par Bloch. Dans son premier article paru en 1940 sous le titre
Technology and invention in the Middle Ages , Lynn White,
faisait largement usage des contributions publies en 1935
par les Annales, sans donner pour autant une place
particulire larticle de Bloch 7. Mais cest lhistorien
franais quil ddia en 1963 son livre Technologie mdivale et
transformations sociales 8. Dans lhistoriographie franaise
daprs-guerre, cest deux marginaux clbres, Bertrand Gille
et Charles Parain que lon doit la rouverture du dossier sur
(5) A. DLAGE, La vie rurale en Bourgogne jusquau dbut du XIe sicle, Macon,
1941, p. 691.
(6) M. TRABUE HODGEN, Domesday Water Mills, Antiquity, 13 (1939), p. 261-279.
(7) L. WHITE, JR, Technology and invention in the Middle Ages, Speculum, 15 (1940),
pp. 141-159; larticle de Bloch est cit p. 155, n. 4.
(8) L. WHITE, JR, Medieval technology and Social change, Oxford, 1963; trad. fr.
Technologie mdivale et transformations sociales, Paris, 1969.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
697
le moulin eau, le premier partir de 1953 dans une srie
darticles prparatoires son Histoire des techniques, parue
en 1978, confrontait les sources crites une iconographie
compltement absente de larticle de Bloch 9. Le second
reprit lessentiel de son analyse dans un article de rflexion
paru en 1965 dans le mensuel du Parti communiste franais,
La Pense, en y introduisant la question des spcificits et de
lvolution des crales panifiables. Il y reprochait curieusement
Bloch demeur encore trop historien de cabinet de
sous-estimer les capacits et laction des producteurs
directs [et] des masses populaires dans lhistoire 10.
Jusquau dbut des annes 1970, la contribution de Bloch
et le thme des moulins semblent donc tre rests peu prs
ignors des historiens de la socit mdivale, particulirement
en France. Dans sa thse de 1953 sur le Mconnais, Georges
Duby, tout en citant larticle en bibliographie, ne mentionne
les moulins ni dans la table des matires ni dans lindex. Ils
sont mme absents du chapitre remarquable quil consacre
au dveloppement de la seigneurie banale et la concurrence
des banalits 11. Dans la vaste bibliographie de sa synthse de
1967 sur Lconomie rurale et la vie des campagnes, larticle
de Bloch ne figure pas: cest ceux de Lynn White en 1940 et de
Bertrand Gille en 1953 qui font rfrence pour la question.
En 1973, dans Guerriers et Paysans, qui fait une large place
au facteur technique parmi les causes de la croissance
europenne, le texte de Bloch nest pas cit et ce sont les
(9) B. GILLE, Le moulin eau, une rvolution technique mdivale, Techniques et
civilisations, 3 (1954), p. 1-15; Histoire des techniques (Encyclopdie de la Pliade),
Paris, 1978.
(10) Ch. PARAIN, Rapports de production et dveloppement des forces productives,
dans La Pense, n 119, fvrier 1965, repris dans Outils, Ethnies et dveloppement
historique, Paris, 1979, pp. 305-327.
(11) G. DUBY, La socit aux XIe et XIIe sicles dans la rgion mconnaise, Paris,
1953, 2e d., Paris, 1971.
698
MATHIEU ARNOUX
thses culturalistes et fortement diffusionnistes de Lynn
White qui servent de base son argumentation 12.
Il faut attendre la premire crise de lnergie et les annes
1980 pour voir des historiens de la socit mdivale
reprendre leur compte le questionnaire de Marc Bloch et
faire de lapprovisionnement nergtique et du moulin un
thme dtude de plein droit. Les deux noms qui simposent
sont ceux de Luisa Chiapa Mauri, dont le livre de 1984 sur les
moulins de la rgion de Milan se place directement sous
linvocation de lhistorien franais, et de Dietrich Lohrmann,
qui entame alors une srie denqutes explicitement places
dans le prolongement de larticle de 1935 13. Les recherches
sur ce thme se sont multiplies depuis, portant sur les
diverses priodes du Moyen ge, sur diverses rgions
europennes sur divers aspects de la question des moulins.
Dans notre perspective, sont particulirement retenir les
contributions de Georges Comet sur la transformation des
crales et dtienne Champion sur les moulins dans les
polyptyques carolingiens 14. la diffrence des priodes
prcdentes, ces enqutes sont toutes construites partir du
questionnaire labor par Bloch, dont elles soulignent
(12) G. DUBY, Lconomie rurale et la vie des campagnes dans lOccident mdival
(France, Angleterre, Empire, IXe-XVe sicles), Paris, 1962; Guerriers et paysans,
VIIIe-XIIe. Premier essor de lconomie europenne, Paris, 1973.
(13) L. CHIAPA MAURI, I mulini ad cqua nel Milanese (secoli X-XV), Roma (Biblioteca
della Nuova Rivista Storica , 36), 1984; pour les nombreux articles de D. LOHRMANN, cf.
la bibliographie rassemble dans larticle Mhle, historisch , du Reallexikon der
germanischen Altertumskunde, t. 20 (2002), pp. 281-287; on retiendra en particulier:
Travail manuel et machines hydrauliques avant lan mil, J. HAMESSE et C. MURAILLESAMARAN (d.), Le Travail au Moyen Age. Une approche interdisciplinaire, (Actes du
colloque international de Louvain-la-Neuve, 21./23. Mai 1987), Louvain-la-Neuve,
1990, pp. 35-48; Le moulin eau, avant et aprs Marc Bloch, dans H. ATSMA et A.
BURGUIRE (d.), Marc Bloch aujourdhui. Histoire compare et sciences sociales, Paris,
1990, pp. 339-348.
(14) G. COMET, Le paysan et son outil. Essai dhistoire technique des crales (France,
VIIIe-XVe sicle), Rome (Collection de lcole franaise de Rome, 165), 1992; . CHAMPION,
Moulins et meuniers carolingiens dans les polyptyques entre Loire et Rhin, Paris, 1996.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
699
globalement la pertinence tout en nuanant les conclusions.
Un volume collectif rcemment paru sous la direction de
Paola Galletti et Pierre Racine a permis de confronter ces
diverses approches et den valuer les acquis 15.
Ces contributions rcentes illustrent dabord les lectures
trs diverses et parfois contradictoires auxquelles se prte le
texte de Bloch. Lune de ses propositions essentielles est que
le moulin constitue une invention antique, sans doute
attribuable aux Romains, mais quil reviendrait aux hommes
du Moyen ge davoir fait de lui un lment essentiel de leur
systme conomique. Aux dires de Dietrich Lohrmann, une
telle approche ressort valide pour lessentiel des recherches
ultrieures. Il y a eu une meunerie antique dont, ds 1940,
ltude par F. Benoit du site de Barbegal avait montr le
dveloppement et dont la lecture attentive des sources du
trs haut Moyen ge et de nombreuses dcouvertes
archologiques montrent que lhritage ne fut pas perdu
aprs la disparition de lEmpire 16. Le mantien de la capacit
des villes moudre est affirm par des sources nombreuses et
les inventaires domaniaux montrent les moulins prsents en
nombre apprciable dans les grands domaines ds la fin du
VIIIe sicle. Mentionnons seulement, pour sa date prcoce et
parce quil ne figure gnralement pas parmi les polyptyques
utiliss, linventaire en 787 des domaines de labbaye de
Fontenelle, qui mentionne un total de 67 moulins pour prs
(15) P. GALETTI et P. RACINE (d.), I mulini nellEuropa medievale, Bologne, 2003; cf.
galement le volume des colloques de Flaran consacr aux moulins mdivaux et
modernes: M. MOUSNIER (d.), Moulins et meuniers dans les campagnes europennes
(IXe-XVIIIe sicle), Toulouse (Journes internationales dhistoire de labbaye de Flaran,
21), 2002.
(16) F. BENOIT, Lusine de meunerie hydraulique de Barbegal (Arles), dans Revue
Archologique, 6e srie, 15 (1940), pp. 19-80. Sur les moulins dans le monde romain, cf.
en dernier lieu . WIKANDER, Archaeological evidence for early water-mills - an interim
report, dans History of Technology, 10 (1985), pp. 151-79 et The water-mill dans ID. (d.)
Handbook of Ancient Water Technology, Leiden (Technology and Change in History, 2),
2000, pp. 371-400.
700
MATHIEU ARNOUX
de 3000 manses: beaucoup en quantit, mais peu en
proportion 17. Revenant sur le texte de Bloch lors dun colloque
tenu la mmoire de lhistorien en 1990, D. Lohrmann estimait
que sa propre recherche confirmait pour lessentiel ses
hypothses et intuitions, citant pour lapprouver la conclusion
bien connue: Sans doute faut-il, dans les premiers sicles du
Moyen ge, tenir compte de la lenteur propre lexpansion
de toute nouveaut, du maintien autour des grands dquipes
serviles encore considrables, des habitudes enfin que les
conqurants barbares apportaient de leur pays dorigine [...].
Assez rapidement cependant, du moins dans lancienne
Romania et les contres germaniques limitrophes, partout o
les conditions naturelles ne sopposaient point cette
mtamorphose, meules bras et chevaux disparurent des
grands domaines: ctait chose faite en Gaule au temps des
polyptyques carolingiens et du Capitulare de villis; en
Angleterre au temps du Domesday Book: textes, qui sait
couter, tout bruissants de la chanson des roues 18 .
Si sa problmatique densemble parat valide par les
recherches suscites par larticle, ses conclusions nen sont
pas moins fortement discutes, nuances ou remises en cause.
En insistant sur limportance des machines hydrauliques et
de la meunerie eau dans le monde romain, certains
historiens de lAntiquit sinterrogent sur le lien entre
esclavage et refus de linnovation technique 19. La prcision
croissante de nos connaissances en matire de technologie
(17) Gesta Sanctorum Patrum Fontanellensis Coenobii, d. J. LAPORTE et F. LOHIER,
Rouen (Socit de lHistoire de Normandie), 1936, pp. 82-83; conclusions analogues pour
la Rhnanie par D. LOHRMANN, Remarques sur les moulins mdivaux en Rhnanie, dans
M. MOUSNIER (d.), Moulins et meuniers cit. p. 79-95, aux pp. 90-94.
(18) M. BLOCH, Avnement et conqute cit., pp. 811-812; D. LOHRMANN, Le moulin
eau, avant et aprs Marc Bloch cit. p. 348.
(19) M.-C. AMOURETTI et G. COMET, La meunerie antique et mdivale, dans Archives
Internationales dHistoire des Sciences, 50 (2000), pp. 18-29; A. SCHIAVONE, Lhistoire
brise. La Rome antique et lOccident moderne, Paris, 2003, pp. 154-188.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
701
nous a permis de ne plus voir dans lusage de roues verticales
ou horizontales le signe dune plus ou moins grande avance
dans la voie du progrs technologique, mais un choix
rationnel des acteurs, quil faut mettre en relation avec les
conditions et les objectifs de ltablissement dun moulin 20.
Par ailleurs, ltude de lvolution ultrieure des moulins a
conduit les historiens des techniques rvaluer les
potentialits de la roue horizontale, dont procde la turbine
des usines hydrauliques du XIXe sicle 21.
Le problme de limportance de lquipement domanial a
fait lobjet de nombreuses recherches, qui mettent en vidence
une situation complexe, o chaque cas doit tre examin
minutieusement 22. Cest ce qua fait tienne Champion sur
les polyptyques dentre Loire et Rhin, montrant au terme
dune analyse serre [qu]au sein du grand domaine
carolingien une nette majorit des terres disposait dun
moulin au sein de leur propre villa. De plus, si lon tient
compte de la distance communment parcourue [...] la trs
grande majorit, parfois la quasi totalit des paysans pouvaient
moudre leur grain au moulin 23 . tendant lespace
germanique une enqute mene auparavant pour lessentiel
sur des sources de Francie occidentale, Dietrich Lohrmann
conclut sans quivoque: La thse qui attribue au XIe sicle
(20) Les deux formes dutilisation de lnergie hydraulique peuvent parfaitement
coexister sur les mmes sites: en 1147, labbaye de San Salvatore di Messina possde
ainsi deux moulins: lun dt, horizontal, lautre dhiver, vertical; H. BRESC, P. DI SALVO,
Mulini ad acqua in Sicilia, I mulini, i paratori, le cartiere e altre applicazioni, Palerme,
2001, p. 30.
(21) COMET, Le paysan et son outil cit. pp. 427-445; Pour un tat de la question
lpoque moderne et contemporaine, A. STOWERS, Watermills, c. 1500-c. 1850, pp.
199-213, dans Ch. SINGER, A history of technology, t. 4, Oxford, 1957.
(22) Cf. les pages prcises et nuances consacres aux moulins par J.-P. DEVROEY,
conomie rurale et socit dans lEurope franque (VIe-IXe sicles), Paris, 2003, pp.
134-140, en particulier p. 138; Il est clair quau IXe sicle, le moulin eau ntait pas
un lment oblig de toute seigneurie. Ctait toutefois un investissement recherch et
profitable, qui relevait toujours de la rserve
(23) . CHAMPION, Moulins et meuniers carolingiens, cit. p. 41.
702
MATHIEU ARNOUX
seulement la premire grande vague de construction des
moulins eau en Europe devient de moins en moins
probable. La Rhnanie sest couverte de moulins eau ds le
VIIIe-IXe sicle, partiellement bien avant 24... . La prise en
compte des sources mditerranennes invite pousser plus
loin la remise en cause des ides prconues sur le sujet. Cest
ce que font, partir des sources de lEspagne chrtienne,
Jean Gautier Dalch 25 et Pierre Bonnassie, pour qui ces
installations sont frquentes dans toute lEspagne du Nord
ds avant le IXe sicle: Pour aussi longtemps que permette
de remonter la documentation, crit ce dernier, la Catalogne
apparat dote de moulins hydrauliques 26 . Sappuyant sur
lensemble de ces contributions, Pierre Toubert conclut donc
logiquement dans une synthse rcente sur la question
domaniale: contrairement aux vues exposes par Marc
Bloch dans son article fameux de 1935 sur les conqutes
mdivales du moulin eau, le haut Moyen ge na ignor ni
la diffusion du moulin eau ni, par consquent, une capacit
non ngligeable dinvestissement seigneurial dans la construction et la maintenance de dispositifs techniques assez
complexes et coteux, comme les moulins et les brasseries 27 .
Pour le trs haut Moyen ge et lpoque carolingienne, il
semble donc acquis que Marc Bloch, dans les limites de la
documentation disponible en 1935, avait su poser les justes
questions, mme si la relecture des sources amne leur
(24) LOHRMANN, Remarques sur les moulins mdivaux en Rhnanie cit. p. 95.
(25) J. GAUTIER DALCH, Moulin eau, seigneurie, communaut rurale dans le nord de
lEspagne, IXe-XIIe sicles, dans tudes de civilisation mdivale (IXe-XIIe sicles).
Mlanges offert Edmond-Ren Labande, Poitiers, 1974, pp. 337-349; repris dans
conomie et socit dans les pays de la couronne de Castille, Londres (Collected Studies
Series, 149), 1982.
(26) P. BONNASSIE, La Catalogne du milieu du Xe la fin du XIe sicle. Croissance et
mutation dune socit, Toulouse, 1975, t. 1, pp. 459-464.
(27) P. TOUBERT, LEurope dans sa premire croissance de Charlemagne lan mil,
Paris, 2004, p. 70.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
703
donner aujourdhui dautres rponses que les siennes.
Curieusement, la seconde partie de son article, qui traite des
liens entre moulins et seigneurie et de la naissance des
banalits na pas fait lobjet de la mme attention ni suscit le
mme type de synthse. Il me parat donc pertinent de faire
porter lessentiel de mon enqute sur le problme quelle
soulve, qui est vritablement celui de la naissance dune
conomie institutionnelle de lnergie hydraulique.
MOULINS, PAYSANS ET SEIGNEURS
Ltude des rapports entre moulins et seigneurie banale
est construite sur deux dossiers de sources produits lappui
dune hypothse expressment mutationniste de gense de la
fodalit. Le premier dossier, qui expose comment fonctionne
la banalit du moulin est curieusement dpourvu de sources
relatives aux Xe-XIIe sicles: les rfrences dates remontent
au plus tt au XIIIe sicle, et Bloch nhsite pas utiliser des
sources du XVIIIe sicle (crits des feudistes et cahiers de
dolances de 1789) voire plus tardives (tmoignages du XIXe
sicle relatifs aux territoires germaniques ou la seigneurie
qubcoise). Le deuxime dossier, qui constitue lun des apports
les plus intressants de larticle, est consacr linterdiction
de lusage des meules mains par les paysans. lexception
dun texte normand de 1207, il est exclusivement anglais et
concerne pour lessentiel des vnements survenus au XIVe
sicle. La narration qui sappuie sur cet ensemble de preuves
est construite avec une grande clart, et constitue une des
descriptions les plus drastiques de la mutation fodale ,
telle quelle a fait lobjet de dbats rcents parmi les
historiens franais:
partir du Xe sicle, une profonde transformation se fit dans la
structure conomique et juridique du monde rural. Usant de leurs
704
MATHIEU ARNOUX
pouvoirs de commandement quon appelait le ban, les appuyant
sur ces pouvoirs de justice dont la carence des tats favorisait alors
le dveloppement, les seigneurs ou du moins un grand nombre
dentre eux parvienrent instituer leur profit certains monopoles:
du four, du pressoir; du verrat ou du taureau; de la vente du vin ou
de la bire, au moins durant certains mois; de la fourniture des
chevaux pour le dpiquage des grains, l o cette pratique tait en
usage; enfin le plus ancien de tous probablement et, sans conteste, le
plus rpandu celui du moulin 28 .
Pour lessentiel, ce rcit reprend le schma dj mis en
uvre en 1931 dans Les caractres originaux de lhistoire rurale
franaise 29. Dans les deux textes, le plus surprenant est
labsence de corroboration par des sources contemporaines.
Dans larticle de 1935, la nouveaut est constitue par la
rvlation du conflit relatif lusage des meules mains,
dont Bloch fait un moment essentiel de lhistoire de la lutte
des classes, sans pour autant dissimuler limpossibilit o il
est de le fonder sur des tmoignages:
De cette longue querelle, malheureusement, en ce qui concerne la
plus grande partie de la France, et peut-tre aussi de lAllemagne, le
rcit sera toujours impossible crire par le menu [...]. Labsence de
tmoignage parat nanmoins certaine. Aussi bien, pour la France
en particulier, le silence des documents est-il aisment explicable.
Notre pays fut la terre dlection des banalits. Elles ne sy
tendirent pas seulement un nombre dactivits plus quailleurs
lev; elles y triomphrent aussi dans toute leur rigueur
remarquablement tt. Or, en raison de cette prcocit mme, la
priode de leur tablissement qui couvrit en gros les Xe et XIe sicles,
se trouve concider avec la plus grande pauvret dcrits quait
connue le Moyen ge. Lorsque les sources redevinrent abondantes,
la phase dcisive de la lutte tait dj passe 30 .
(28) BLOCH, Avnement et conqute du moulin eau cit., p. 814.
(29) M. BLOCH, Les caractres originaux de lhistoire rurale franaise, Paris, 1988, pp.
122-123.
(30) BLOCH, Avnement et conqute du moulin eau cit., p. 815.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
705
On ne peut qutre surpris de la dsinvolture avec laquelle
un historien aussi rigoureux manie ici largument a silentio.
Il le justifie cependant en sexcusant, juste titre, par la
sotte habitude qui autorise les diteurs de chartes priver
leurs lecteurs de tout index par matires, comme si ces
recueils ntaient au monde que pour favoriser, grce aux
tables de noms propres, les jeux des gnalogistes . Il y a l
une suggestion faite au lecteur de poursuivre et dtendre
lenqute entame par Marc Bloch, dont larticle de 1935 doit
sans doute tre considr la fois comme un tat provisoire
de la question et un programme de recherches venir.
Celles-ci ne sont pas venues: dans les nombreuses monographies rgionales portant sur les Xe-XIIIe sicles, en France
ou hors de France, la question de la banalit des moulins
suscite le plus souvent une rserve prudente, soit parce
quaucun document ne fait tat dune telle institution, soit
parce que les sources rvlent une situation trop complexe et
nuance pour sinscrire dans le schma propos par Bloch. De
plus, dans la plupart des cas, les dossiers sont trop minces, en
particulier pour le XIe sicle, pour permettre de construire
une argumentation solide. Aussi bien des enqutes doivent-elle
se rduire au commentaire de quelques tmoignages particulirement intressants mais isols, et la mise en srie des
premires mentions de moulins, ou des allusions des moulins
rcemment construits, pour en tirer les indices dun
mouvement dquipement des campagnes. Dans la plupart
des cas, le rcit qui rsulte de lenqute fait lhypothse dun
dmarrage de lquipement au Xe sicle et constate une
acclration la fin du XIIe sicle, ce qui pose, comme Bloch
lavait dj soulign, le problme de la sous-estimation de
lquipement prexistant ds que la documentation domaniale
carolingienne fait dfaut. Le principal problme rside en fait
dans lchelle danalyse du phnomne: les processus dinnovation technique et les changements conjoncturels sont des
706
MATHIEU ARNOUX
phnomnes continentaux. Une approche strictement
rgionale ne peut les dcrire de manire adquate 31.
Les recherches menes en Angleterre partir du Domesday
Book permettent dillustrer ce dilemme. Les problmes sy
prsentent en effet avec une nettet particulire. Alors que
les chartes anglo-saxonnes antrieures 1066 ne font que
rarement mention de moulins 32, le recensement des tenures
fait en 1086 sur ordre du roi Guillaume en numre environ
6000, dont une bonne partie tait dj prsente pendant le
rgne ddouard le Confesseur. Dans son article publi en
1936, Margaret Trabue Hodgen avait soulign ltonnante
disparit rgionale que rvlaient la mise en relation du
nombre des moulins et de leur revenu avec le nombre des
manoirs, ou celui des tenures, ou encore la rpartition des
manoirs quips de plusieurs moulins et des sites de moulins
multiples, en quoi elle proposait de voir, sans doute juste
titre, les premiers centres de meunerie hydraulique. Une
telle analyse de gographie statistique mettait en vidence
des zones caractrises par une forte densit de population,
allie un dveloppement remarquable de lquipement
hydraulique, quon rapporte celui-ci la structure manoriale
ou la rpartition de la population 33. Elle signalait par
ailleurs que dans un nombre non ngligeable de cas, le
manoir et les moulins qui lui taient associs ne relevaient
pas du mme tenant. Ltude ultrieure des procdures
(31) Malgr la faiblesse des sources, certains dossiers peuvent tre particulirement
bien mis en valeur dans un cadre rgional: cf. par exemple R. FOSSIER, La terre et les
hommes en Picardie jusqu la fin du XIIIe sicle, Paris, 1968, t. 1, pp. 382-389; A.
DEBORD, La socit laque dans les pays de la Charente (Xe-XIIe sicles), Paris, 1984, pp.
322-324; A. CHDEVILLE, Chartres et ses campagnes, XIe-XIIIe sicles, Paris, 1973, pp.
194-197; P. RACINE, Plaisance du Xe la fin du XIIIe sicle. Essai dhistoire urbaine,
Lille-Paris, 1979, t. 1, pp. 259-273.
(32) Ph. RAHTZ et D. BULLOUGH, The parts of an Anglo-saxon mill, Anglo-Saxon
England, 6, Cambridge, 1972, pp. 15-37.
(33) TRABUE HODGEN, Domesday Water Mills cit.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
707
denqute a permis de montrer que les moulins constituaient
souvent des tenures autonomes recenses part des lments
manoriaux 34. Lextraordinaire varit des revenus associs
lexploitation des moulins, grains, farines, poissons, btes ou
fer, a conduit enfin les replacer dans le cadre dune conomie
dchange: pour Richard Britnell, la prolifration des moulins
et leur insertion dans des rseaux dchanges largement
montariss sont autant dindices rvlateurs de la commercialisation prcoce de la socit anglaise 35. Parmi des
centaines dautres exemples, deux cas suggrent des pistes
de recherches susceptibles dtre poursuivies sur dautres
terrains. Le premier est celui des trois moulins rcemment
construits Cambridge par le shrif Picot, pour lesquels il
sest empar de la pture commune des bourgeois de la ville
et a dtruit les moulins de lvque dly et du comte Alain de
Bretagne, sans doute placs en amont. Lautre cas est celui
des 7 moulins tablis sur la rive sud de la Tamise
Battersea, qui rapportent en 1086 la somme considrable de
42 livres 9 s. 8 d. leur tenant, labb de Westminster 36. Cet
quipement considrable constitue sans doute ds ce moment
(34) D. ROFFE, Domesday, the Inquest and the Book, Oxford, 2000, p. 140, n. 152: It
must be noted, however, that mills are often separately valued in Great Domesday Book
and in Little Domesday Book, and they may therefore have been considered discrete
unity of tenure ; dans le cas des manoirs de labbaye de Glastonbury, qui ont fait lobjet
de plusieurs tudes classiques, un inventaire de 1189 fait tat de 31 moulins (dont 23
dentre eux figuraient dj dans le Domesday Book) pour 35 manoirs; un seul dentre
eux appartient la rserve de labbaye, tous les autres tant concds sous diverses
forme, sans que les coutumiers fassent tat dobligation particulires des tenants de
labbaye leur gard, et aucune forme de banalit du moulin ne semble stre
dveloppe sur les domaines de Glastonbury; R. HOLT, Whose were the profits of corn
milling? An aspect of the changing relationship between the abbots of Glastonbury and
their tenants, 1086-1350, dans Past and Present, 116 (aot 1987), p. 3-23, aux pp. 7-8.
(35) R. H. BRITNELL, The Commercialisation of English Society (1000-1500),
Cambridge, 1993, pp. 43-44.
(36) R. LENNARD, Rural England, 1086-1135. A study of social and agrarian
conditions, Oxford, 1959, pp. 278-287; Domesday Book. A complete translation, d. A.
WILLIAMS, G. MARTIN, Londres, 1992, pp. 76-77 (fol. 32, Surrey) et p. 519 (fol. 189,
Cambridgeshire).
708
MATHIEU ARNOUX
un lment cl de lquipement hydraulique de la capitale
anglaise. Dans un cas, cest lambigut de la notion de
seigneurie banale qui apparat. Dans lun comme lautre cest
aussi le rle essentiel des villes dans lquipement des cours
deau qui est en cause. Ce sont deux thmes qui permettent
de poser concrtement et de faon efficace les problmes
signals auparavant.
MOULINS ET BANALITS DANS LES SOURCES DES Xe-XIIe SICLES
Mme sil reste difficile daccder des corpus scientifiquement tablis et indexs dactes des Xe-XIIe sicles, ce qui
exclut toute prtention lexhaustivit en ce domaine, les
moyens informatiques permettent aujourdhui linterrogation
de bases de donnes qui nexistaient pas lpoque de Marc
Bloch. En loccurrence, la base de donne des actes originaux
antrieurs 1121 conservs dans les archives et bibliothques
franaises, constitue par le laboratoire ARTEM de Nancy, a
fait lobjet dune recherche pour les mots molendinum et
farinarium, qui a permis le rassemblement de plusieurs
centaines 37 dactes postrieurs 680 dans lesquels apparat
lun ou lautre de ces mots 38. Lexistence de deux mots ne pose
pas de problme: dans la plupart des actes o farinarium
apparat, molendinum est galement prsent. Le premier,
qui na pas laiss de trace en langue vulgaire, nest donc
(37) La difficult dinterprter les listes dappendices domaniaux et lexistence de
doublons entre les deux sries, dactes faux ou dactes multiples rendant compte de la
mme transaction rendent trs difficile ltablissement de chiffres exacts pour le corpus
ainsi rassembl, dont une exploitation statistique naurait dailleurs gure de sens.
(38) Je tiens remercier Benoit-Michel Tock et Jean-Baptiste Renault pour mavoir
donn accs si aisment aux ressources de lARTEM. Sur la base de donnes des actes
originaux cf. B. M. TOCK (dir.), M. COURTOIS et M.-J. GASSE-GRANDJEAN, et P. DEMONTY, La
diplomatique franaise du Haut Moyen Age. Inventaire des chartes originales
antrieures 1121 conserves en France, Turnhout, 2001.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
709
quun doublet cultiv du second. Le dpouillement des actes a
par ailleurs contraint renoncer lexploitation dune large
majorit dentre eux: le mot molendinum, en effet, nest
prsent le plus souvent que comme lun des lments des
listes dappendices domaniaux prsents dans la plupart des
actes sous la forme bien connue: ... hanc vero villam cum
omni integritate sua et cum omnibus adjacentis et finibus
suis et cum villaribus, domibus, aedificiis, terris cultis et incultis, vineis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, molendinis, exitibus et regressibus... , encore largement
atteste au cours du XIIe sicle 39. On peut simplement noter
que le moulin, alatoirement mentionn dans les listes des
actes les plus anciens, y figure presque systmatiquement
aprs le milieu du Xe sicle, signe de sa large diffusion dans
les domaines. Il nest pourtant pas possible dans nombre de
cas de trancher entre la prsence effective et la simple
ventualit dune installation partir de la seule occurrence
du mot dans une liste formalise.
Une autre recherche est possible, qui sest rvle la fois
plus aise et de valeur plus gnrale, malgr et en raison
aussi du corpus beaucoup plus limit quelle a permis de
slectionner: il sagit de ne retenir que les actes mis propos
dinstallations hydrauliques identifies. Ces documents livrent
une ample moisson de formules et de procdures lies la
construction et lexploitation des moulins; par leur
rpartition dans le temps et dans lespace, ils permettent de
considrer le moulin autrement que comme un appendice du
domaine et donc de comprendre comment saccomplit le
passage de lun lautre et la naissance de la seigneurie
(39) Le mme problme se pose pour les actes normands et anglo-normands des XIe
et XIIe sicles o le mot molendinum figure le plus souvent dans des numrations
dappendices du genre: ecclesiam de [...] cum decima et appendicitiis suis [...] tam in
bosco quam in plano, molendinis etiam et aqua qui sinscrivent dans la postrit des
listes carolingiennes.
710
MATHIEU ARNOUX
banale . Cette enqute, mene dans un premier temps sur le
seul corpus des actes conservs en original, a pu dans un
deuxime temps tre poursuivie dans dautres corpus rgionaux
en utilisant le questionnaire pralablement labor.
Sur la question des actes les plus anciens consacrs une
installation hydraulique particulire, lexamen des actes
originaux conservs en France a permis de mettre en
vidence une aire de prcocit particulire stendant de la
rgion parisienne aux confins de lAquitaine. Apparemment,
les actes les plus anciens concernent Paris: dans le premier,
en 894, le roi Eudes donne labbaye Saint-Denis, le manse
de Sarcelles avec un moulin et son bief, ainsi quun autre
moulin tabli sur un pont proche de labbaye sur la rivire du
Crou 40. Le second concerne un moulin tabli au bord de la
Seine, sur les prs de labbaye Saint-Germain, que le custos
de labbaye, Abbon, concde en 914 un couple de tenants,
moyennant un cens mensuel de trois deniers payable durant
les mois o le moulin sera en fonction 41. Les documents
poitevins livrent ensuite quatre actes du Xe sicle, qui
montrent une prcision croissante des transactions lies aux
quipements hydrauliques. Poitiers, en 922, le droit de
ripaticum sur un cours deau proche de Thouars, quEbles
comte de Poitou concde Rotard, abb de Nouaill, semble
bien comprendre un moulin, dont le bief est dcrit avec
prcision; un cens de deux deniers annuels sera vers au
rector qui possde ce bien in regimine 42. En 942, le mme
abb reoit en don un manse situ sur le cours de la Vienne,
avec cluse, pcherie et ripaticum, ainsi quun emplacement
(40) Recueil des actes dEudes, roi de France, d. R.-H. BAUTIER et G. TESSIER, Paris,
1967, pp. 154-156, n 36.
(41) Recueil des chartes de labbaye Saint-Germain-des-Prs, d. R. POUPARDIN, t. 1,
Paris, 1909, pp. 67-68.
(42) Chartes de labbaye de Nouaill de 678 1200, P. de MONSABERT (d.), Poitiers,
1936 (Archives historiques du Poitou, 49), pp. 71-73, n 40.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
711
pour y construire un moulin 43. En 958, cest Guillaume comte
de Poitiers, agissant comme abb de Saint-Hilaire de
Poitiers, qui donne son homme Hubert un moulin avec les
droits sur le cours deau qui lalimente, dont le cours et les
confronts sont dcrits et borns 44. Dans une autre donation
comtale faite au nom de labbaye en 997, son successeur
Guillaume duc dAquitaine concde au sous-doyen de labbaye
un moulin avec sa portion du cours deau soigneusement
dcrite: unum farinarium consistentem sub latere montis
ac super fluvium Biberim cum prato sive ascensu aque et
decursu, plus minusve superius perticas centum, et inferius
similiter perticas centum, vocaturque Tentenonus 45 . La
donation faite en 978 par le comte dAnjou Geoffroy Grisegonelle
dune aulnaie avec un moulin, dont les droits deau sont
minutieusement dfinis, suivie en 1007 dune autre donation
de moulin la mme abbaye, ouvre la srie considrable des
chartes et notices tourangelles et angevines, notre principale
documentation jusque dans les premires annes du XIIe
sicle 46. Les autres rgions livrent des actes plus tardifs et
isols: 1026, 1038, 1087 pour le duch de Normandie 47, 1050,
1058 et 1066 pour la Provence 48, seulement 1030 et 1090
(43) Chartes poitevines: 925-950, E. CARPENTIER (d.), Poitiers, 1999, pp. 117-118, n
72.
(44) Documents pour lhistoire de Saint-Hilaire de Poitiers, L. REDET (d.), Mmoires
de la socit des Antiquaires de lOuest, 14 (1847), pp. 30-32, n 26.
(45) REDET, Documents pour lhistoire de Saint-Hilaire de Poitiers, cit., pp. 71-72, n
62.
(46) Fragments de chartes de Saint-Julien de Tours, Ch. de GRANDMAISON (d.),
Bibliothque de lcole des chartes, 47 (1886), pp. 238-240, n 26; J. DELAVILLE LE ROULX,
Notice sur les chartes originales relatives la Touraine antrieures lan mil, Tours,
1879, pp. 41-42.
(47) Recueil des actes des ducs de Normandie, M. FAUROUX (d.), Caen (Mmoires de
la Socit des Antiquaires de Normandie, t. 36), 1961, pp. 145-146, n 41, pp. 242-244, n
92; F. LOT, tudes critiques sur labbaye de Saint-Wandrille, Paris, (Bibliothque de
lEcole des Hautes-Etudes, 204), 1913, p. 96-97, n 42.
(48) Archives dpartementales des Bouches du Rhne, 1H; d. P. AMARGIER, Chartes
indites (XIe sicle) du fond de Saint-Victor de Marseille (thse de lUniversit
dAix-en-Provence), 1967, n 32; Cartulaire de labbaye de Saint-Victor de Marseille, B.
712
MATHIEU ARNOUX
pour la Bourgogne, malgr labondance des actes de Cluny 49,
aucun acte avant les dernires annes du XIe sicle pour la
Flandre ou la Picardie 50, ni pour les confins de lEmpire,
lexception dune carta traditionis de 1014, relative un serf
de Saint-Arnoul de Metz 51.
Le biais de la source, qui ne retient que les originaux et
exclut tous les actes parvenus en copie, est vident: certains
tablissements, pour lesquels nous ne disposons que de
cartulaires sont absents de notre liste. Prendre en compte le
cartulaire de Saint-Pre de Chartres, par exemple, nous
aurait permis dajouter la courte liste des actes du Xe sicle
les deux chartes de 968 et 971, relatives lachat des deux
moulins de Falaise, sur lEure 52. Par ailleurs, le choix de
GURARD (d.), Paris, 1857, t. 1, p. 563, n 571; Cartulaire de labbaye Saint-Honorat de
Lrins, H. MORIS et E. BLANC (d.), Paris, 1883, t. 1, pp. 35-36, n 36.
(49) Recueil des chartes de labbaye de Cluny, A. BERNARD, A. BRUEL (d.), t. 4, (Coll.
De Documents indits), 1888, p. 44-45; Chartes et documents de Saint-Bnigne de Dijon,
prieurs et dpendances des origines 1300, G. CHEVRIER, M. CHAUME (d.), Dijon, 1986, t.
1, pp. 151-152, n 373.
(50) Dans cette rgion, le cas de Corbie est particulirement significatif. Labbaye
possdait lpoque carolingienne un important patrimoine de moulins, voqus dans
les Statuts de labb Adalhard; trois abbs du Xe sicle et un prvt de labbaye sont
flicits dans un document des annes 986-989 pour avoir construit des moulins
Corbie dans deux domaines tablis sur le cours de la Somme (L. MORELLE, La liste des
repas commmoratifs offerts aux moines de labbaye de Corbie (vers 986/989): une
nouvelle pice au dossier du Patrimoine de saint Adalhard?, dans Revue belge de
philologie et dhistoire, t. 69, 1991, pp. 279-299). On ne trouve pourtant dans son
important dossier de chartes des Xe-XIe sicles quun seul acte relatif un moulin, qui
ne concerne dailleurs pas labbaye; il sagit dun accord (989-1015) conclu par
lintermdiaire de labb Maingaudus entre lvque Adalbron de Laon et les moines de
Saint-Vincent de Laon, sur la concession cens dune pice de terre avec moulin et
cluse appartenant aux moines: Paris, Bib. nat. de France, ms coll. Picardie 255, fol. 46;
coll. Moreau 233, fol. 129, d. L. MORELLE, Les chartes de labbaye de Corbie (988-1196):
prsentatoin et dition critique, thse de IIIe cycle de lUniversit Paris IV, 1988, 5 vol.
dactyl., XXXVI-*136-831 p., t. II/1, n 3, pp. 68-73, de mavoir amicalement transmis
cette information).
(51) Metz, Archives Municipales, II 148, n 9.
(52) Cartulaire de Saint-Pre de Chartres, B. GURARD (d.), Paris (Collection de
documents indits, 2), 1840, t. 1, p. 57 (De area duorum molendinorum Falesiae ab
Adrado canonico censualiter empta) et 58 (Item qualiter eadem area ad monachos
Sancti petri devenerit).
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
713
laisser de ct les diplmes gnraux (confirmations royales,
impriales ou piscopales, bulles) pour ne retenir que les
actes particuliers conduit sous-estimer les sources de
certaines rgions, o ces derniers sont moins bien conservs.
Cest le cas pour le duch de Normandie, o la prise en
compte des cartulaires aurait livr des actes de 1010,
1000-1015, 1035-1061, 1055-1066 et 1096 53; si on y ajoute les
mentions de moulins nombreuses et souvent trs prcises
que contiennent les confirmations ducales, les informations
disponibles pour la premire moiti du XIe sicle saccroissent
considrablement. Il nen reste pas moins que les actes
slectionns parmi les originaux mettent en vidence des
disparits rgionales relles; ils fournissent par ailleurs une
information prcieuse, si lon considre le nombre et la
qualit des notices provenant des rgions ligriennes, qui
tmoignent de lavance institutionnelle et technique acquise
alors par ces rgions en matire dquipement hydraulique.
Le dossier en question comprend en particulier un ensemble
de prs dune quarantaine de notices dates du milieu du XIe
sicle aux annes 1110, provenant de la Touraine, lAnjou, de
la Bretagne et du Poitou. La moiti dentre elles manent des
prieurs (obedientiae) de labbaye Saint-Martin de Marmoutier,
et concernent toutes ces rgions. Les autres, tout fait
cohrentes avec ce premier ensemble tant dans leur objet que
(53) L. MUSSET, Actes indits du XIe sicle (III). Les plus anciennes chartes
normandes de labbaye de Bourgueil, dans Bulletin de la socit des Antiquaires de
Normandie, 54 (1957-1958), pp. 15-54, texte dit p. 50, III (vers 1010, accord sur les
moulins de lAvre, daprs le cartulaire de Saint-Pierre de Bourgueil); The Cartulary of
the abbey of Mont-Saint-Michel, K. KEATS-ROHAN (d.), Donington, 2006, pp. 193-194,
Appendix, II, 2 (1000-1015: donation au Mont de trois moulins dans le suburbium du
Mans), et n. 6, pp. 83-85 (notice de plaid de 1061 relative lalination du moulin de
Vain par labb Suppo peu aprs 1035); FAUROUX, Recueil des actes des ducs de
Normandie cit., 213, pp. 401-402 (1055-1066: donation Jumiges dun moulin sur la
Risle); E. ZACK-TABUTEAU, Transfers of Property in eleventh century Norman Law,
Chapell Hill, 1988, p. 50 et 69, et p. 297, n. 45, p. 310, n. 190 (1096, accord entre
Saint-Martin de Ses et Guillaume de Sivilly sur le moulin et la pcherie du Val).
714
MATHIEU ARNOUX
dans leur style, voquent des institutions monastiques
prestigieuses mais de moindre rayonnement: Saint-Hilaire
de Poitiers, Nouaill, Saint-Julien de Tours, Saint-Aubin et
Saint-Serge-et-Saint-Bach dAngers, Saint-Florent et SaintPierre de Bourgueil. Toutes ont pour objet de rgler ou de
prvenir un conflit un conflit propos dun moulin dun
moulin ou dun site hydraulique. Lensemble met en lumire
la conflictualit lie ces installations, qui sexprime en
particulier lors des changements survenus dans leur statut
par mutation, que ce soit par vente, totale ou partielle, legs
testamentaire, don, concession viagre, bail emphytotique
ou autre. Survenant le plus souvent aprs ce changement, les
revendications (calumniae) semblent lies la prise de
conscience par les ayant droit de la valeur leve de ces biens.
Elles prennent des formes variables, souvent passes sous
silence dans le texte, mais peuvent aller jusqu la violence
ouverte: meurtre du meunier, incendie de linstallation,
blocus de ses voies daccs, vol du grain, de la farine ou des
animaux, ou mise hors dusage du mcanisme.
Les dtails donns par les parties narratives de ces actes
et les clauses de leurs dispositifs permettent de composer en
un ensemble articul les pratiques, usages et rgles qui rendent
possibles la construction, le fonctionnement et le dveloppement
des moulins eau. Ils dfinissent dune part les principes
daccs lnergie hydraulique, qui permettent lquipement
optimal des cours deau, et rgulent dautre part le march de
la mouture des grains, condition de lquilibre conomique
des entreprises de meunerie. Les conditions dapplication de
ces rgles mettent en vidence deux ensembles de problmes
associs, relatifs dun ct aux investissements ncessaires
la construction et lentretien des installations et de lautre
la rpartition des revenus provenant de leur exploitation.
Une enqute rapide sur des sources du XIIe sicle provenant
dautres rgions europennes montre que lexprience dont
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
715
tmoignent les notices ligriennes vaut ultrieurement pour
bien dautres espaces.
COEXISTENCE DES MOULINS
Le problme de la coexistence dtablissements construits
sur le mme cours deau est lun des plus souvent poss au
rdacteur dacte. Dans un pays de relief modr, o les
rivires ont le plus souvent atteint leur profil dquilibre, les
sites sont en nombre fini. Les actes montrent quils sont
connus danciennet, beaucoup ayant dj t quips, ltant
encore ou attendant de recevoir une nouvelle installation. Les
nombreuses mentions, ds le Xe sicle pour certaines, demplacements pour construire un moulin (aream ad construendum
molendinum) ou siges de moulins, tmoignent dune gographie des cours deau dj largement tablie, qui rpartit de
lieu en lieu les sites possibles de moulins. Dans cette perspective, lexistence ancienne dun moulin et son fonctionnement
effectif prouvent une lgitimit fonctionner, que des
installations postrieures ne sauraient mettre mal. Il est
donc ncessaire que soit donne une dfinition gographique
prcise des moulins voqus dans les actes, faisant mention
de sa capacit fonctionner et de la portion de cours deau qui
lui est affecte: molendino uno et ductu aque ex utraque
parte supra et subtus super fluvio Rodono, sicut antiquitus
stetit est-il prcis ds 894 propos de lun des moulins
donns Saint-Denis 54. Toute modification arbitraire du site
constitue donc une atteinte aux droits qui lui sont
naturellement attachs: molendinum qui erat in terra
Sancti Juniani naturaliter constitutus , comme lcrit en
(54) Recueil des actes dEudes, roi de France cit., Paris, 1967, p. 154-156, n 36.
716
MATHIEU ARNOUX
1078 un moine de Nouaill pour dfinir le moulin de son
abbaye, dont un chevalier avait entrepris de dtourner le cours
deau au profit des moines de Saint-Martial de Limoges 55.
Ds la fin du XIe sicle, le niveau de saturation semble
atteint sur de nombreux affluents de la Loire et toute
modification du systme tel quil est tabli se fait aux
dpens de moulins dj existants. Les moulins dtruits,
dserts ou ruins voqus par nos sources portent sans
doute les marques de cette volont de la part de certains de
faire une place sur les cours deau. Il est souvent possible
daccrotre le rendement nergtique des rivires en dplaant
les installations et en les regroupant pour quiper au mieux
les sites les plus favorables. Cest ce que montre une notice de
Saint-Aubin dAngers, antrieure 1096 56. Elle rgle le sort
du moulin construit ad complantum par deux associs
Ingenaud et Hildebert 57 sur la terre dIngenaud. Les deux
propritaires en donnrent la tierce partie aux moines de
Saint-Aubin, moyennant le dplacement de linstallation vers
le bief de Fossart, o se trouvait dj un autre moulin,
construit par les paysans du lieu, qui y avaient dj accueilli
les moines ( qui primum monachos in molendinum suum
adoptaverunt ). La nouvelle installation fut divise en trois
parts, une pour Ingenaud et Hildebert, une pour les rustici,
une pour les moines de Saint-Aubin, chaque part donnant
droit au tiers de lannone, des poissons capturs dans le bief
et du junioragium du meunier, en contrepartie du paiement
dun tiers du ripagium. Lune des conditions de laccord tait
lengagement des parties de ne jamais construire de moulin
(55) Poitiers, Archives dpartementales de la Vienne, C 10 n 93.
(56) Cartulaire de Saint-Aubin dAngers, d. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, Paris,
1903, t. 1, n. 259, pp. 300-301.
(57) On ne sait quasiment rien de ces deux personnages: ils nappartiennent
srement pas aux familles chtelaines de la rgion (renseignements amicalement
communiqus par Chantal Sensby, que je remercie).
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
717
entre ceux de Fossart et celui du Merle; au cas o il serait
possible dajouter un troisime moulin sur le mme site, il
serait tenu de la mme manire par les trois parties. Le texte
ne semble pas dcouler dun procs, dune calumnia ou dune
situation de conflit, mais plutt de la volont commune des
propritaires daccrotre la rentabilit dune portion de
rivire dj compltement quipe. Placs sur le mme site,
les deux moulins pourront disposer dune hauteur deau accrue,
qui permettra peut-tre ltablissement dune troisime roue.
La mention du ripagium acquitter par les trois parties
montre par ailleurs que le statut public du cours deau et
lautorit comtale sur son affectation subsistent. Par la
multiplicit des partenaires concerns, la prcision de son
dispositif et la complexit des rgles mises en application, ce
texte est rvlateur dun jeu bien accept par les diffrents
acteurs qui cooprent sa russite.
Il ne serait pas difficile de trouver la mme priode pour
dautres rgions des textes qui montrent la mise en
application de rgles analogues, dans des cas diffrents. Pour
lAngleterre des annes 1109-1114, un texte valeur
testamentaire du Normand Nel dAubigny prescrit son
frre Guillaume la restitution des moulins construits sur un
tang par labb de Notre-Dame dYork, quil avait usurps.
Et au cas o les moulins nouveaux quil a lui-mme fait
difier leur nuiraient, il ordonne de prendre sur leur revenu
pour ddommager les moines, reformant ainsi in extremis
leur profit lunit dun site hydraulique sans doute devenu
plus productif 58. Le mme mouvement se constate dans le
(58) Charters of the Honour of Mowbray, d. D. E. GREENWAY, Londres et Oxford
(Records of Social and economic history, n. s. 1), 1972, p. 6, n 2: ( et abbatie Sancte
Marie de Eboraco molendinos illos quos abbas fecerat super stagnum et si ipsi
molendini deteriorantur propter nouos molendinos meos, uolo ut frater meus restauret
illud damnum abbatie de redditibus molendinorum meorum ; clause analogue dans
une charte de Bauduin de Reviers au prieur Saint-James dExeter (1146-1149) relative
718
MATHIEU ARNOUX
monde germanique. Le dossier des chartes de labbaye de
Stavelot est particulirement instructif cet gard: dans ce
fond trs important, de nombreux moulins sont voqus aux
IXe et Xe sicles, en particulier dans les descriptions de
domaines concds en prcaire 59. Il faut attendre les
premire annes du XIIe sicle pour voir apparatre des actes
lis la gestion des moulins de labbaye. Dans un rglement
de 1105, labb Fulmar restitue aux moines de Stavelot les
deux moulins de Chanly et Ocquier, cartant les prtentions
leur sujet dun sous-avou de labbaye et prcisant les
modalits de leur concession et de leur entretien 60. Si cet
acte, pass en prsence du comte de Namur, advocatus maior
de labbaye, tmoigne dabord dune volont de reprise en
main du patrimoine de la communaut, celle-ci saccompagne
clairement dune politique de construction de nouveaux
moulins et de renforcement des installations existantes, dont
tmoigne une charte des annes 1105-1119, dtaillant les
donations faites la mense conventuelle par labb Poppon
II. Celui-ci concde aux religieux un moulin nouvellement
construit sur le cours de lAmblve, quil a acquis des
constructeurs en le leur cdant en viager pour un cens annuel
de 40 sous. Pour assurer long terme le fonctionnement de
linstallation, il affecte son entretien la dme de quatre
villages voisins. Par ailleurs, pour suppler linsuffisance de
deux moulins de la villa de Leignon, que le faible dbit des
entre autre la donation de droits Topsham: concessi etiam prefatis monachis ut
nova molendina faciant in terra sua ubi voluerint, amotis molendinis meis de
Toppesham, ita quod de cetero nec michi nec heredibus meis nec alicui infra
Scutebrocam et Toppesham aliquod molendinum facere licebit ; Charters of the
Redvers family and the Earldom of Devon (1090-1217), d. R. BEARMAN, Exeter (Devon
and Cornwall Record Society, n. s. 37), 1994, n 28, pp. 77-78.
(59) J. HALKIN, C.-G. ROLAND, Recueil des chartes de labbaye de Stavelot-Malmdy,
Bruxelles, 1909, t. 1; cf. par exemple p. 127, n 53 (prcaire, 915), p. 140, n 58 (prcaire,
930-931), p. 154, n 66 (prcaire, 943), p. 159, n 68 (prcaire, 947).
(60) Ibid., pp. 279-281.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
719
eaux rendait inutilisables une partie de lanne, contraignant
les moines recourir des moulins extrieurs, il avait
lui-mme construit lorsquil tait prvt un nouveau moulin
in quodam palustri loco , en dtournant les eaux de
plusieurs sources voisines. Par le mme acte, il affecte son
entretien les 20 sous de cens verss annuellement pour les
deux anciens moulins et, pour assurer lunit du revenu, fait
don aux moines du nouveau moulin, crant ainsi un site
complexe de trois moulins tablis sur plusieurs cours deaux.
Enfin, pour ddommager loffice du prvt de la perte de son
moulin, il lui donne un autre moulin tabli sur un site
nouveau, qui ne portera donc pas atteinte aux autres et
naura pas souffrir de leur proximit 61. Les mmes rgles
sont luvre quelques dcennies plus tard dans la partie
orientale de la Germanie, par exemple dans lacte par lequel
en 1172, larchevque Wichmann de Magdebourg concde
aux moines du monastre Neuwerk de Halle le site o les
bourgeois de la ville ont difi un moulin sur la Saale, en aval
de celui quils possdaient dj, interdisant quiconque
dtablir un moulin tant en amont quen aval des deux
installations 62.
Il serait ais de trouver en grand nombre les textes
analogues, qui tmoignent la fois de lquipement de plus
(61) Quod ne forte scandalizet vel moveat futuri temporis prepositos vel ministros,
loco istius concedimus a nobis constructum ubi nunquam antea fuerat molendinum :
Ibid., pp. 286-287, n 141.
(62) Urkundenbuch des Erzstifts Magdeburg, d. F. ISRAEL, W. MLLENBERG, Halle
(Hrsg. von der Historischen Kommission fr die Provinz Sachsen und fr Anhalt, n. r.
18), 1937, pp. 447-448, n 339: locum molendino apto in lacu Sale fluvii iuxta pontem
in cuius edificatione cives Hallenses convenerant [...] perpetuo iure possidendum
tradidimus eo tenore ut nec ibi nec infra terminum molendini eorum superioris, quod in
eodem lacu situm est, usque ad villam Gumniste, non fiat molendinum ex utraque
parte littoris nullusque in posterum preter eos molendinum statuere presumat . On ne
trouve pas dans les actes archipiscopaux de Magdebourg de documents consacrs des
moulins avant le milieu du XIIe sicle: Ibid., p. 328, n 259 (mention dans un ncrologe
de la donation dun moulin aux religieux de Saint-Maurice de Halle, 1145) et p. 344, n
274 (donation dun moulin aux prmontrs de Gottesgnaden, 1142-1152).
720
MATHIEU ARNOUX
en plus dense des rivires europennes et, dans le mme
temps, de la mise au point et de lapplication dune rgulation
de lusage des eaux, visant protger les installations
lgitimement tablies des dommages qui leur seraient
infligs par des constructions abusives sur les mmes cours
deaux. Dans la plupart des cas, cest la dlimitation de
segments protgs en amont et en aval des roues qui vise
cet effet, mais elle peut aussi faire obstacle lamlioration
des installations, en interdisant lquipement de biefs
construits en parallle sur le mme site. De fait, on trouve
ds le milieu du XIIe sicle des rfrences des hauteurs
deaux, tablies lors de procdures prcises et compliques,
qui rendent possible un amnagement plus dense, en fixant
comme condition le maintien pour les moulins voisins de la
hauteur deau compatible avec la prsence dune roue 63.
(63) Cf. en particulier laccord pass en 1156 par les moines de labbaye de Josaphat,
dans le diocse de Chartres, avec le seigneur voisin Milon de Lves, au sujet des moulins
possds par chacune des parties sur la mme portion du cours de lEure; ce rglement
trs dtaill prcise que Milon concessit ut, ex sua elemosina, juxta duos predictos
molendinos [...] si vellent etiam tertium construerent ad modum duorum, ita scilicet
quod omnia molendinorum illorum exclusoria justo modo adaquarentur altitudini
cuiusdam magni ligni quod in capite calceate a parte vinearum quasi pro custode
condicte pactionis utriusque partis positum fuit ; cette procdure de mesure de la
hauteur de leau permet aux parties de saccorder sur un calendrier de gestion du site,
qui prvoit de faire varier dans lanne le nombre de moulins tournants ou de biefs
aliments en fonction de labondance des eaux, de faon pouvoir faire actionner de
deux quatre moulins simultanment: Monachi vero omnem controversie curam
inter se et Milonem cupientes eradere [...] pacti sunt quod a festo Sancti Remigii usque
ad festum sancti Johannis, vel per tria exclusoria vel per tres molendinos molentes, et a
festo sancti Johannis usque ad festum sancti Remigii, vel per duo exclusoria vel per
duos molendinos molentes aquas emitterent nec retente essent impedimento
molendinorum Milonis; si vero inter festum sancti Johannis et festum sancti Remigii
Audura intumesceret et tres aut quatuor de molendinis Milonis ex aque copia molere
possent, concorditer concessum fuit ut ex quo molendinarius monachorum hoc per se
vel per alium perciperet, sine dilatione per tot exclusoria vel per tot molendinos
molentes aquas inferius effluere permitteret per quot superius ingrederentur, ne
rotatum tollerent molendinis Milonis , Cartulaire de Notre-Dame de Josaphat, d. Ch.
MTAIS, Chartres, 1911, t. 1, p. 273, n 230 (1156); le remarquable dossier des chartes de
labbaye de Waltham (Essex) relatives au moulin de Netteswell permet de voir
comment, la fin du XIIe sicle, la mesure de la hauteur deau dans la retenue permet
de trancher le litige portant sur deux moulins tablis sur le mme cours deau: The
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
721
LA MOTURE: UN MARCH BIEN RGL?
Compatibles entre eux du point de vue de leur approvisionnement en eau, les moulins doivent ltre galement du
point de vue de leur frquentation par les usagers locaux: si
les paysans ne viennent pas, les investissements raliss pour
leur construction resteront sans objet. Il convient donc de
trouver des rgles qui permettent la fois la satisfaction des
besoins locaux et la rpartition des usagers entre les moulins
voisins, ou entre moulins anciens et neufs. Lhabitude des
historiens est de ranger lensemble de ces usages, lorsquils
apparaissent dans nos documents, sous le titre gnral de
seigneurie banale, prjugeant ainsi que toute dfinition de
laire de chalandise dun moulin renvoie lexistence dun ban
chtelain dont elle serait lune des consquences. De la mme
manire, linscription de la moltura au nombre des redevances
seigneuriales caractristiques, empche de mener de linstitution une analyse proprement conomique, qui est pourtant
lune des cls de la comprhension de son tablissement et de
son dveloppement.
Ici encore, lanalyse de Bloch fournit un point de dpart
utile, mais des rponses trs contestables. Il ne fait pas de
doute que le service rendu par le moulin aux paysans permet
une conomie considrable de travail et de temps pass
prparer la nourriture. Ce service se paye, dautant que la
machine qui le rend possible est coteuse: la moltura est
avant tout salaire pour le meunier et provision pour
lentretien et la rparation du moulin. En temps de relative
raret des installations, leur frquentation est dtermine
par les paysans eux-mmes, qui dcident, en fonction du temps
et de la peine pargns et de ceux qui seront occasionns par
Early Charters of Waltham Abbey, d. R. RANSFORD, Woodbridge, 1989, pp. 155-170, en
particulier pp. 160-161, n 244 (1184-1201?).
722
MATHIEU ARNOUX
le dplacement et par lattente, de renoncer une part de la
rcolte. Les meules bras pourvoient au reste des besoins. Il
nest donc besoin daucune rglementation pour organiser
laccs un service qui nest pas partout disponible.
La croissance de la demande et la multiplication des installations perturbent les usages anciens, et peuvent susciter
tensions et conflits. Certains propritaires de moulins
nhsitent pas en effet recourir la contrainte ou la
violence pour instituer leur profit une aire de chalandise
dcoupe sur celles des moulins prexistants. Dtruire un
moulin concurrent, provisoirement ou dfinitivement, peut
tre une bonne solution, et bon nombre des installations
dsertes ou en ruine que citent nos sources tmoignent de
ces actes de violence. Un autre choix est dinterdire aux
usagers laccs aux moulins voisins: cest ce que fait en 1084
Geoffroy de Brure, dans le but de rcuprer les clients du
moulin de Divette, que son pre Roger avait donn aux
moines de Marmoutier: Filius vero Rotgerii aliquandiu
calumniatus est eam [donationem] et voluit auferre viam
quae ducit ad predictum molendinum per terram suam 64 .
Linstitution dune fiscalit particulire prleve sur les
hommes du fief et du voisinage qui vont moudre dans
dautres moulins a le mme but. Cest ce que fait en 1087
Lger, voyer de Robert des Roches, aux dpens des usagers
des moulins de Marmoutier: caepit igitur prendere annonas
et asinos venientium ad molendinos nostros et mancipia
famulorum nostrorum qui de pane nostro vivunt, sive etiam
filias et filios facere vicariales, quae duo, ante Letgerium,
nullus vicarius fecerat. Lors du plaid tenu cette occasion,
tous les tmoins ayant protest contre ces extorsions sans
prcdent, Lger, de faon rvlatrice, dixit quia per
(64) Angers, Archives Dpartementales du Maine-et-Loire 38 H 1 n 7.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
723
inopiam facebat et proposa une formule de modration de
ses exigences qui laissait libre le travail des serfs de labbaye,
mais restreignait de manire efficace la capacit de dplacement des autres usagers: affirmavit etiam coram omnibus
quod si aliquis [...] mitteret annonam suam ad molendinos
nostros per mancipium suum, numquam caperetur; ipse
tamen si per se adduceret, caperetur solus asinus vero, et
annona numquam Bien quil ne soit fait nulle part mention
dans lacte de ses propres moulins, Lger espre en menaant
les btes de bt inciter les usagers choisir ses moulins,
probablement plus proches 65.
Ces entreprises de contrainte, opres aux dpens des
usagers, ne sont cependant pas les plus frquentes et il nest
pas dit quelles furent toutes couronnes de succs. Des textes
postrieurs insistent en effet sur leur caractre trs coteux,
puisquelles impliquent de maintenir en permanence plusieurs
sergents cheval affects au contrle du territoire, tche
partiellement voue lchec si les moulins sont nombreux
dans les alentours et si les paysans disposent eux-mmes de
chevaux 66. De fait, dans la plupart des cas, lindication de la
banalit du moulin prend un style beaucoup moins tyrannique,
se contentant dobliger les paysans continuer de venir au
moulin o ils avaient auparavant leurs habitudes. En 1060
Hamelin fils dArchenulf vend ainsi labb de Saint-Aubin
dAngers le moulin de la Vergne eo tenore ut similiter eant
homines terre illius ad molendinum sicut antequam vendidisset
Sancto Albino 67 . De telles clauses, se trouvent ds le dbut
du XIIe sicle dans de nombreuses rgions europennes, des
(65) Tours, Archives Dpartementales de lIndre-et-Loire H 201 n 3.
(66) M. ARNOUX, Moulins seigneuriaux et moulins royaux en Normandie: march de
lnergie et institutions (XIe-XVe sicles), Economia e energia (secc. XIII-XVIII), atti della
trentaquattresima settimana di studi delIstituto internazionale di storia economica F.
Datini di Prato, S. CAVACIOCCHI (d.), Florence, 2003, p. 505-520, aux pp. 517-519.
(67) Tours, Archives dpartementales dIndre-et-Loire, H 1002 n 2.
724
MATHIEU ARNOUX
les britanniques jusqu la Sicile et la Pouille 68. Elles nont
pas pour objet principal la mise en tutelle des populations
paysannes. Dans le cas cit, comme dans bien dautres, elles
sont le corollaire de linterdiction de construire un nouveau
moulin proximit de celui qui vient dtre cd: elles
constituent une part essentielle de lengagement de nonconcurrence qui accompagne toutes les mutations dinstitutions
hydrauliques. En 1140, labbaye Saint-Jean des Vignes
Soisson reoit le moulin du Nouveau Manse, prs de la
Fert-Milon eo pacto ut omnes qui erant consuetudinarii ibi
molere tempore Savarici et predecessorum ejus, consuetudinem
antiquam ibi molendi teneant mais ce rappel du caractre
obligatoire de la coutume, elle ajout une ouverture tous les
usagers voisins, insuper et omnes qui ibi molere voluerint
nullum impedimentum ab Adam sive a Philippo fratre ejus
sustineant , dans les limites cependant du respect de la zone
dexclusivit des autres moulins du donateur: exceptis
hospitibus vel hominibus ejusdem Adam qui Marrolis
morantur . La suite de lacte montre quil convient, dans la
mesure du possible de ne pas modifier les conditions de
fonctionnement qui ont fait jusquici le succs de linstallation:
Item ut idem molendinum habeat processus et exitus suos
liberos sicut prius, et in cespitibus evellendis ad clusam
faciendam et in omnibus commoditatibus sicut olim quando
sibi predictus Philippus retinebat et in silva succidenda ad
opus ejusdem molendini ecclesia Sancti Johannis jus et
(68) Pour la Pouille, J.-M. MARTIN, La Pouille du VIe au XIIe sicle, Rome (Collection
de lcole franaise de Rome, 179), 1993, p. 310: cf en particulier la concession en 1098
par le comte (normand) de Conversano labbaye S. Benedetto di Conversano du droit
de faire trappetum atque furnum etiam et molinum ut ibi omnes sui homines et nostri
qui voluerint coquant et macinent ; cf. aussi P. DITCHFIELD, La culture matrielle
mdivale. LItalie mridionale byzantine et normande, Rome (Collection de lcole
franaise de Rome, 373), 2007, pp. 273-287; pour la Sicile les actes sont plus tardifs,
1154 Mazarino, et 1201 Gratteri, o la concession dun moulin aux chanoines
prmontrs prcise: et sicut homines Gratterii et totius tenimenti eius in ipso
molendino solebant molere, sic de cetero molant nec audeant ad alia molendina ire ad
molendum BRESC, DI SALVO, Mulini ad acqua in Sicilia cit., p. 29.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
725
licitum in id ipsum habeat, et hoc totum bona fide, exclusa
omni subreptione 69 .
Au total, ces rgles de bon fonctionnement des
installations et de bon voisinage de leurs propritaires et de
leurs usagers combinent deux principes fondamentaux: dune
part, pour les installations dont la longvit dmontr
lutilit, la lgitimit continuer leur service; dautre part,
pour fournir aux communauts voisines un service de
meunerie efficace, lincitation quiper les cours deau de la
manire la plus intensive. Pour comprendre comment
sappliquent ces rgles, il convient aussi de ne pas oublier que
les moulins sont des machines fragiles, quil faut rparer
souvent, et qui, pour cette raison, sont frquemment hors
dusage, et que les cours deaux ont aussi leurs caprices.
Pannes en tout genre, scheresses dt, crues dautomne ou
gels dhiver peuvent donc paralyser les roues, contraignant
les usagers, seigneurs comme paysans, se rendre dans un
moulin voisin, ou remettre en usage les meules bras. La
logique des fiefs et des seigneuries doit alors seffacer devant
une contrainte de subsistance qui remet en cause les droits
acquis. Entre tant dautres, deux actes dHenri II
Plantagent dans les annes 1170, autorisant les moines de
Saint-vroul reporter sur un moulin en service les droits
dun moulin dfaillant et, en cas de scheresse, retenir dans
leur tang leau ncessaire au fonctionnement de lune des
installations montrent que cette logique nchappait pas aux
contemporains 70. Un acte des annes 1140 organisant un
(69) Paris, Archives nationales, L 1007 n. 2 (acte communiqu amicalement par
Ghislain Brunel).
(70) Acte d Henri II Plantagent en faveur de labbaye Saint-vroult (1172-1178),
rapportant un accord pass entre labb et un des ses vassaux propos dun moulin
tabli sur la Charentone: idem abbas concessit ut, si forte molendinum illud caderet
vel molere non possit, quod tota supradicta moltura ad alia molendina Sancti Ebrulfi
veniret et medietatem illius haberet Rogerius donec abbas et monachi molendinum
suum il illo loco vel alibi in foesta Brit., et reedificare licebit quandocumque et
726
MATHIEU ARNOUX
village neuf en co-seigneurie entre le chapitre de Chartres et
les seigneur de Courtalain montre comment sont tablies,
dans ces conditions les obligations des tenants du nouvel
habitat: ad molendina que fient ibi molent hospites, quamdiu
poterunt; cum autem non poterunt, molent ad mea molendina,
videlicet ad molendinum Fontium vel ad molendinum
Cortalani, et ibi expectabunt per diem et noctem; et si tunc
non poterunt molere, eant quo voluerint 71 .
RPARTIR DPENSES ET PROFITS
Bien situ, bien construit et bien entretenu, un moulin
peut tre profitable son propritaire. La chose ne va pas
sans intermdiaires: dans leurs aspects proprement techniques
en effet, les moulins relvent de la comptence des laboratores,
alors que leurs propritaires appartiennent le plus souvent
aux groupes des oratores ou des bellatores. Il convient donc de
fixer par crit la contribution et la rmunration des uns et
des autres, dont le dtail remplit lessentiel des actes les plus
anciens. Ici encore, lapproche conomique, trop souvent
nglige au profit de la seule tude des rapports sociaux,
fournit des cls essentielles la comprhension du mouvement
densemble. La complexit des montages juridiques et
financiers qui accompagnent la construction dun moulin est
lun des aspects les plus frappants. Cest souvent elle qui
ubicumque voluerint super aque Carentone ; cest sans doute au mme problme que
fait allusion un autre acte pratiquement contemporain du mme souverain qui autorise
les moines retenir en cas de ncessit leau de la rivire: et quia molendina
eorumdem abbatis et monachorum multotiens pro penuria aque cessant et molere non
possunt, eis concessi auctoritate regia ut aquam in suis vivariis integre teneant et
conservent quociens viderint expedire ad opus molendinorum suorum DELISLE, Recueil
des actes dHenri II Plantagent, t. 2, p. 72 et 102.
(71) GURARD, Cartulaire de Saint-Pre de Chartres cit., t. 1, pp. XXXVIII-XXXIX,
n. 4.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
727
occupe les rdacteurs de notice. En effet, il est frquent que
cette construction prenne la forme dune societas destine la
construction et la gestion dun difice, regroupant le ou les
propritaires, et le ou les constructeurs. Les uns apporteront
le site et les droits du moulin, les berges du cours deau, les
biefs et les matires premires, les droits de pcherie, les
autres fourniront un capital montaire ou mettront son
service leur travail et leurs comptences de constructeurs. Le
fonctionnement et lentretien de linstallation seront loccasion
dautres dpenses, qui seront nouveau rparties, les
constructeurs fournissant usuellement le bois ncessaire au
mcanisme, les usagers fournissant souvent les forces ncessaires au transport et la mise en place des meules. Les actes
fournissent ce sujet des dtails dune prcision surprenante,
comme la division des dpenses de bois pour le chauffage des
clients du moulin et du salaire de lhomme qui le transporte
dans un moulin beauceron en 1119 72.
Les formes de rtributions de ces apports sont multiples
et peuvent tre dissocies en multiples fractions, chacun
recevant du meunier le revenu, fixe ou proportionnel affrant
sa part de linstallation. Dans certains cas, tous les associs
entrent dans la composition du capital de la socit et
reoivent le droit de participer aux profits et aux pertes 73.
Sagissant de mcanismes complexes exigeant une matrise
technique particulire, les constructions de moulins semblent
(72) Chartres, Archives dpartementales dEure-et-Loir, H 2382: Et ad
calefaciendum molentes, et ad molendinos reficiendos, et ad sclusas reficiendas, et ad
portas reficiendas dabit monacus de luco Sancti Martini, si ea que necessaria fuerint, in
luco poterint inveniri, et si in luco non poterint inveniri, querent inter Odonem et
monacos. [...] Et de mercede quam habebit mercenarius qui portabit ligna ad
calefaciendum molentes, dabunt monachi medietatem, et Odo alteram medietatem .
(73) La notice du cartulaire de Saint-Pre de Chartres relative la gestion des
moulins dAlluyes, partags un tiers aux moine et les deux autres la famille du
donataire montre la complexit de tels montages lorsque la confiance nexiste pas entre
les associs (GURARD, Cartulaire de Saint-Pre de Chartres, t. 2 p. 404).
728
MATHIEU ARNOUX
avoir suscit lapparition de techniciens de la construction et
de lentretien, qui peuvent dans certain cas prendre en
charge gestion de lensemble. Certains dentre eux sont de
statut servile, comme Hardouin, serf de Saint-Arnoul de
Metz, dont un acte de 1014 rappelle comment il fit acqurir
par change par son abbaye le moulin quil avait difi sur le
territoire aux communauts voisines de Bouxires et
Agincourt 74. Dautres ont sans doute un statut de ministrial,
comme ce Geoffroy le Cochon, charpentier, qui le prieur de
Chemill en 1101 remet en viager la meunerie de deux
moulins, comme rtribution de son service de charpentier au
service des moines 75.
La mise en valeur de terres nouvelles offre loccasion de
telles constructions. Deux notices relatives au val de Loire
proprement dit en donnent lillustration. En 1085 un certain
Geoffroy fils dOtton, avec lassentiment de son pouse
Guibourg et de leurs enfants, cde Saint-Julien de Tours
divers biens et terres pour construire un bourg proche de la
Loire. Il y joint aquas de duobus ductis ad molendinum
faciendum, in Ligerim unam sclusam, et boscum de sua
insula ad molendinum faciendum la construction duquel
il ne participera pas (sine parte illius) ainsi quune pcherie
o il prendra la moiti: et aliam sclusam ad piscandum; in
hac ipse Gosfridus mittet medietatem et monachi alteram et
pisces divident 76 . Il nest pas sr que la mise en valeur de
(74) Metz Archives municipales, II 148 n 9.
(75) Angers, Archives dpartementales du Maine-et-Loire, 39 H 2 n 102:
Radulfum priorem Camiliacensem dedisse et concessisse assensu et concessione
tocius capituli sui Gaufredo Cochioni molendinariam de duobus molendini Salomonis
tantummodo in vita sua. Ita tamen ut aliquis heredum suorum post mortem suam
nichil posset reclamare, in predicta molendinaria, sed ad jus monachorum et
proprietatem deveniret sicut antea fuerat. Ipse vero promisit propter hoc omnen
carpentariam monachorum facere et nichil inde accipere preter procuracionem sibi et
carpentariis suis .
(76) Tours, Archives dpartementales dIndre-et-Loire, H 498 n 1.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
729
ces biens soit lie lendiguement du fleuve, qui commence
alors. Les turcies sont en revanche bien prsentes dans lacte
par lequel, vers 1100, un certain Hugues fait don labbaye
de Bourgueil de terrae meae et aquae superfluentes in
fluvio Ligeri sitae, tantum quantum ad unam exclusam
faciendam in qua duo aut tres molendini si necesse fuerit
aedificari possint, sub censu VI denariorum, qui michi et
posteris meis in sancti Maximi festo reddentur . La suite du
texte montre quil sagit dune terre rcupre sur le cours de
la Loire, hors de la curtis de Choisay: Est autem terra ipsa
et aqua sita super Choziaci vicum, ad turseiam quae vocatur
Frogerii. Sunt autem maetae ejusdem terrae et aquae sub
prefato censu datae, a fraxino quadam quae super predictam
turseiam est, usque ad hulmum majorem quae terram meam
et curtis Choziaci ab illa inferiori parte pene dividit 77 .
Une fois le moulin construit, il convient de lexploiter ou
plutt de sen partager les revenus, laissant au meunier le
soin de le faire fonctionner. Une premire possibilit,
prsente trs tt et largement rpandue consiste dabord
sassurer de pouvoir jouir gratuitement de son service. Pour
plus de sret et de commodit, sachant que linstallation
nest active que par intermittence et quil faut profiter sans
dlai des moments o elle fonctionne, il est possible de se
faire reconnatre le droit de moudre sans attendre, son tour.
Ds 1080 Galois de Montreuil obtient ainsi des moines de
Saint-Florent de Saumur en change du droit faire passer
sur ses terres le bief de leur moulin de Danzay que cum
annona illius propria ad molendinum allata fuerit, si cujus
alterius annona prius ingranata fuerit, prius moli permittetur,
et mox annona illius nulla alia interposita moletur 78
(77) Ibid., H 24 n 22.
(78) Angers, Archives dpartementales du Maine-et-Loire H 3108 n 1.
730
MATHIEU ARNOUX
inaugurant une longue srie dactes semblables rpandus
dans lOuest de la France et dans les les britanniques 79.
Au-del de ce droit dusage largement rpandu, non
ngligeable lorsquil sagit de garnir la table seigneuriale, il
reste les diverses formes de revenus que peut offrir un
moulin: grain, farine, poissons, porcs, fer ou largent. Rien ou
presque ne nous est dit sur la faon dont ces diverses valeurs
arrivent entre les mains du meunier. Le prlvement opr
sur le grain apport en rtribution de la mouture est fix par
la coutume et ne saurait tre chang par le meunier 80: il sagit
dun juste prix, non susceptible de variations arbitraires, qui,
ds les premires annes du XIe sicle, fait lobjet du
paiement dune dme spcifique 81. Seuls laccroissement du
nombre de clients, laugmentation des performances du
moulin ou lallongement de sa dure de fonctionnement
permettent donc den augmenter les revenus lis lannone.
Les crales que le meunier reoit rentrent aussitt dans le
rseau commercial dont le moulin, dpositaire des mesures
de grain, constitue lun des points nodaux, comme Marc
(79) Cf. par exemple la donation aux moines de Lyre du moulin Anzer par Mathieu
du Bois-Anzer (fin XIIe sicle), la condition quil pourra moudre son bl quand il le
dsirera aussitt aprs quon aura moulu le bl dj vers dans la trmie (vreux,
Archives dpartementales de lEure, H 473): molendinum quoque de Veteri Lira quod
uocabatur molendinum Ansereii concessi et confirmaui eisdem monachis cum omnibus
molturis suis [...] salua autem michi et heredibus meis de Bosco Ansereii libertate
molendi bladum meum proprium de mensa mea proximo scilicet loco post bladum quod
erit in tremoia nisi hoc fuerit bladum monachorum ; mme clause dans une charte
dHenri II Plantagent concdant la charge de panetier Odoin de Malpalu
(1172-1189), d. DELISLE, Recueil des actes dHenri II Plantagent cit. t. 2, p. 329.
(80) Depuis la fin de lantiquit des actes publics, attests dans toutes les rgions
dEurope, fixent le poids du pain en vente pour un prix fix en fonction du prix constat
sur le march pour le grain; lexistence de telles tables de correspondances implique une
complte stabilit de la mouture.
(81) J. TARDIF, Monuments historiques, Paris, 1866, pp. 153-154, n 245 (1004:
donation labbaye de Dols du monastre Saint-Donatien et Saint-Rogatien de
Nantes): ...item dono decimam de molendinis et de piscibus qui sunt in Tonu ;
FAUROUX, Recueil des actes des ducs de Normandie cit. p. 41 n 145 (1012-1026, donation
Saint-Ouen de Rouen de la dme des 8 moulins fiscaux tablis sur le Robec).
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
731
Bloch lavait signal dans son article, soulignant les
analogies unissant ces deux institutions essentielles des
socits rurales de lEurope du Nord et du Nord-Ouest que
sont les moulins et les marchs. Le moulin fournit aussi des
produits drivs, tels les cochons, nourris avec le son
provenant de la moute 82, ou les poissons capturs dans le bief
du moulin, qui semblent constituer une part non ngligeable
de ses revenus, si lon considre les trs nombreux cas o le
propritaire se contente deux pour sa part.
Une chose est sre: sil existe des installations particulirement rentables, parce que linvestissement li leur
construction est amorti depuis longtemps, parce quils se
trouvent sur un site particulirement favorable, bien irrigu
et bien quip, parce que les usagers sy pressent, il existe
aussi un grand nombre de petits moulins la rentabilit
incertaine quun incendie ou une crue suffisent mettre en
faillite. Il est rare que nos sources nous permettent les
diffrencier, mme si quelques installations particulirement
importantes se distinguent par le nombre des sources
relatives leur construction. Pour les uns comme pour les
autres, la multiplicit des intervenants est la rgle, pour
diminuer la prise de risque, ou parce que limportance des
investissements dpasse les possibilits dun acteur unique.
Fragiles, complexes et souvent menacs dans leur
quilibre conomique, les moulins des Xe-XIIe sicles sont des
proies faciles pour un groupe seigneurial en pleine ascension,
pourvu de moyens montaires croissants et nhsitant pas
devant la violence pour se faire servir une rente sur les
revenus des installation, mettre la main sur elles, ou les
(82) Mainzer Urkundenbuch, ed M. STIMMING, Darmstadt, 1972, t. 1 p. 296 (fondation
de la collgiale Notre-Dame et Saint-Pierre par larchevque Liupold, 1055), in
Roriberch molendinum sub hac concessione dedi ut in festo sancti Michaelis ex parte
prepositi in eodem molendino porcus immissus in Natale Domini pinguis reddatur .
732
MATHIEU ARNOUX
liminer si elles font concurrences leurs propres moulins.
Lun des moyens les plus simples et les moins violents
consiste semparer du fer, qui assure lancrage de larbre du
moulin sur la meule tournante, interdisant tout mouvement
de celle-ci. Dlit svrement puni par la loi salique 83, le vol du
fer ou dune autre partie du moulin lors dune guerre
seigneuriale est lun des risques pris en compte dans les
notices, qui spcifient les prcautions prendre pour viter
limmobilisation du moulin ou prvoient les ddommagements
auxquels elle donne droit 84. La multiplication des installations
rend sans doute une telle violence socialement acceptable
car, dans la Normandie du XIIIe sicle la captura ferri est
devenue lun des recours admis pour contraindre le
propritaire du moulin sacquitter des rentes assises sur
son installation 85. La violence suscite par la cupidit ne se
(83) Lex salica, ed. K. A. ECKHARDT, Hanovre (M.G.H., Legum S. 1, t. 4,2), 1969, p.
222 (version S, LVI, 2 [24, 2]), p. 222: Si quis ferramentum in molino alieno furauerit,
MDCC denarios qui faciunt solidos XLV culpabilis iudicetur .
(84) Liber testamentorum Sancti Martini de Campis, Paris, 1905, n 18, p. 24
(moulin de Dugny, avant 1094): aliud fuit additamentum quod debet essere notum hoc
videlicet quod, si cum dominis suis aut cum quibuslibet aliis viris guerram habuerint
qui partem suam a molendino rapere velint, si, ut determinatum est, in molendino
parata fuerit, et praevalens hostis eam rapuerit, aliquis eorum a monachis nullam
redditionem exigebit . Dans une notice de Saint-Pre de Chartres (XIIe sicle), il est
prvu de dfaire le moulin pour viter ce genre de pril: Si pro nostro forisfacto,
quod vel nolimus vel non possimus emendare, destructa fuerit molendina, nos de nostro
reficiemus ea; eodem modo, comparticipes nostri si pro eorum forisfacto destructa
fuerint, quod vel nolint emendare vel non possint, de suo ea reficient; si alio modo
destructa fuerint, communiter ea reficiemus eo modo quo predictum est;si quando
tamen ipsi submonuerint nos ut deficiamus molendina propter aliquam guerram de
qua timeant, si nos noluerimus ea deficere et postmodum per illam guerram ea destrui
contingerit, nos de nostro ea reficiemus , Cartulaire de Saint-Pre de Chartres, d. B.
GURARD, cit. p. 406.
(85) Cf. par exemple Arch. nat. L 973 n 762 (donation aux moniales de lAbbaye
Blanche de Mortain dune rente sur un moulin la Meurdraquire, juillet 1246): nisi
persoluta fuerit... poterint ferrum molendini capere et tenere usque ad persolutionem ;
Bib. nat. de France, ms nouv. acqu. lat. 264 (Cartulaire du prieur de Friardel): n4, f 2
(septembre 1263): volo etiam et concedo [...] quod dicti canonici et eorum successores
possint et debeant pro XXti solidis supradictis in molendino dOrbiquet in parrochia de
Auribecco, super quod molendinum assigno eisdem canonis dictos XXti solidos, suam
plenariam justiciam exercere per capturam ferri dicti molendini ; autres exemples
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
733
limite pas toujours aux parties du moulin, comme le montre
lexemple du seigneur vendmois Constant de Ranay et de
ses fils: contraignant les moines de Marmoutier en 1061 et
1067 organiser un duel judiciaire pour obtenir le versement
dun palaticum (droit dancrage sur la rive) sur un moulin
dont il tiraient dj un motaticum (en change du droit
dextraire la terre pour renforcer les chausses dtang), ils
iront pour parvenir leurs fins jusqu assassiner le meunier
des religieux, mais en vain 86.
Bien que nos sources prsentent le plus souvent de tels
conflits comme rsultant de rivalits locales, leur multiplication
est la marque dun processus beaucoup plus gnral dexpropriation des premiers propritaires ou des constructeurs
au profit du groupe seigneurial. Leffacement progressif dans
nos sources des moulins possds par des paysans ou par des
communauts sexplique ce mouvement qui constitue un vnement dimportance majeure pour lhistoire de lconomie
europenne. Pierre Bonnassie en dcrit la disparition des
cours deau catalans dans les annes 1040-1070 87. La transition
parat entame auparavant dans les rgions septentrionales:
le commercium acque dont la revendication fut, avec les
droit dusage en fort, lorigine de la rvolte des paysans
normands de 996 dsigne sans doute lexploitation des
moulins 88. Il est certain en tout cas que les sources normandes
dans le mme ms, n 3, 5, 6, 23, 24, 42, 192; pour lAngleterre, entre autres exemples
The cartulary of the Tutbury priory, d. Avrom SALTMAN, Londres (Historical
manuscripts Commission, JP2), 1962, n 91, p. 88-89 ((vers 1260): et si contingerit
aliquo tempore firmarios vel ballivos [...] cessare de solucione predicte firme, liceat
plenarie predictis monachis et eorum successoribus quotienscumque aliquid a retro
fuerit de predicta firma distringere per ballivos suos predicta molendina per omnia
ferramenta in eisdem inventa ut predicta molendina cessent ab omnimoda moltura .
(86) Cartulaire vendmois de Marmoutier, d. A de TRMAULT, Vendme, 1893, pp.
136-138 n 87.
(87) BONNASSIE, La Catalogne du milieu du Xe la fin du XIe sicle cit. pp. 594-595.
(88) GUILLAUME DE JUMIGES, Gesta Normannorum ducum, d. E. M. C. VAN HOUTS,
Oxford (Oxford Medieval Texts), 1992-1995, t. 2, pp. 8-9; cf. M. ARNOUX, Classe agricole,
734
MATHIEU ARNOUX
postrieures ne font pas mention dinstallations possdes
par des paysans, en dehors peut-tre du moulin extorqu par
usure un pauvre homme par le seigneur de Glos,
Barnon, forfait qui valut celui-ci derrer aprs sa mort avec
la Mesnie Hellequin , portant dans sa bouche le fer du
moulin quil avait saisi cette occasion 89. Moins puissants,
peut-tre moins bien grs, ces moulins ne pouvaient gure
rsister la monte des quipements seigneuriaux, qui
partir du XIIe sicle semblent subsister seuls sur les cours
des rivires.
PRIODES, RGIONS,
LHYDRAULIQUE
MARCHS: POUR UNE HISTOIRE EUROPENNE DE
Si la diffusion des moulins le long des cours deau est un
phnomne largement europen, constatable ds avant lan
Mil, on doit se demander si la dynamique dintensification
rurale dont tmoignent les notices de lOuest de la France
constitue la marque de choix conomiques et sociaux
spcifiques cette rgion ou si elle sest tendue au reste de
lEurope. Faute dune enqute globale souhaitable, mais sans
doute irralisable vue lnormit de la documentation, on se
contentera ici de souligner certains problmes et dindiquer
quelques pistes de recherche.
pouvoir seigneurial et autorit ducale. Lvolution de la Normandie fodale daprs le
tmoignage des chroniqueurs, dans Le Moyen Age, 1992, t. 98, pp. 35-60.
(89) ORDERIC VITAL, Ecclesiastical History, d. M. CHIBNALL, Oxford (Oxford Medieval
Texts), 1969-1980, t. 6 p. 244; Praeiudiciis et rapinis inter mortales anhelaui
multisque facinoribus plus quam referri potest peccaui. Ceterum super omnia me
cruciat usura. Nam indigenti cuidam pecuniam meam erogaui et quoddam
molendinum eius pro pignore recepi, ipsoque censum reddere non valente tota uita mea
pignus retinui et legitimo herede exheredato heredibus meis reliqui. Ecce candens
ferrum molendini gesto in ore quod sine dubio michi uidetur ad ferendum grauius
Rotomagensi arce .
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
735
Une premire prcaution indispensable pour la priode
considre est videmment de prendre garde au caractre
trompeur que peuvent revtir dans cette perspective aussi
bien un changement dans la documentation, dont lapparition
dactes relatifs des moulins identifis, que la permanence
de formes diplomatiques anciennes qui ne leur donne pas de
place particulire. Le maintien de structures domaniales
fortes a pu empcher la production dune documentation
propre relative aux installations hydrauliques. Pour les
rgions germaniques, labsence de sources spcifiques jusqu
la fin du XIe sicle, et leur raret pour le XIIe sexpliquent
probablement en partie par la prdominance des sources
domaniales, peu loquaces sur les procdures de rglement des
conflits ou sur les contrats. Les recherches de CharlesEdmond Perrin sur la Lorraine ont dailleurs montr lexistence
de nombreux moulins dans les curtes et le dveloppement
aux XIe et XIIe sicles des rgles relatives leur construction
et leur gestion. Un document messin de 1074 cite ainsi un
molendinum infra curtem cum banno, montrant que le domaine
a pu tre un espace pertinent pour lorganisation du march
de la meunerie 90. Il nen reste pas moins que dans un
contexte de croissance conomique, le maintien de ce cadre
domanial a pu tre en lui-mme un obstacle la
concentration des capitaux et la coopration des acteurs,
qui sont une des spcificits du dynamisme des rgions
ligriennes 91. Au total, il existe un dcalage dun demi-sicle,
voire plus, pour les phnomnes mis en vidence entre ces
(90) Ch.-E. PERRIN, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine daprs les plus
anciens censiers (IXe-XIIe sicle), Paris, 1935, pp. 668-669, n. 3.
(91) Cf. ce sujet les rflexions de C. DUSSAIX, Les moulins Reggio dmilie aux XIIe
et XIIIe sicles, Mlanges de lcole franaise de Rome, Moyen ge, 91 (1979), pp. 113-147,
p. 115: Il faut attendre le XIe sicle pour quapparaisse dans notre documentation le
moulin, non plus insr dans une curtis, mais extrieur elle .
736
MATHIEU ARNOUX
rgions et les pays germaniques, une partie des les
britanniques ou les rivages de la Mditerrane.
Il nest pas ais dexpliquer pour quelles raisons le
Chartrain et le Val de Loire, en particulier, semblent avoir
choisi avant les autres rgions dquiper leurs rivires de
moulins nombreux et rapprochs, au point de devoir mettre
en place de manire particulirement prcoce des usages
raffins de rgulation. Comme dans tous les processus
complexes, il faut envisager une multiplicit de causes. La
multiplication du nombre des acteurs sociaux, qui est lune
des caractristique des changements intervenus au cours du
XIe sicle, est sans doute responsable de lapparition dune
documentation de type nouveau. Mais la mutation
documentaire 92 ne sexplique pas sans lapparition dobjets
nouveaux ncessitant cette documentation: celle-ci traduit
aussi une augmentation du nombre des moulins. Celle-ci doit
aussi se comprendre comme un symptme particulier dun
changement conomique beaucoup plus gnral. Lune des
innovations que rvlent ces actes consiste dans la mise au
point doutils juridiques et conomiques de coordination
entre les diffrentes parties. La croissance des marchs, des
changes et des instruments montaires ont leur part dans ce
processus: ds le XIe sicle, dans tout lOuest de la France, les
rentes assises sur les moulins, montaires ou en grains,
tiennent une place de choix dans dans le march du crdit
comme dans les sources 93.
On peut faire lhypothse que cette multiplication des
lieux de mouture dcoula en premier lieu du choix agraire et
alimentaire dune craliculture intensive fonde sur le
(92) D. BARTHLEMY, La socit dans le comt de Vendme de lan mil au XIVe sicle,
Paris, 1993, surtout pp. 19-83.
(93) R. GNESTAL, Le rle des Monastres comme tablissements de crdit, tudi en
Normandie du XIe la fin du XIIIe sicle, Paris, 1901.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
737
froment, et de la croissance dmographique quil favorisait.
De manire significative, les seules rgions rurales dItalie
dans lesquelles se retrouvent la fin du XIe ou au XIIe sicle
des formes analogues dorganisation des installations
hydrauliques sont aussi celles o se dveloppa trs tt un
rgime de craliculture fonde sur le froment, sans doute
favoris par les Normands: le Tavoliere di Puglia, et plus
tardivement la Sicile 94. Lusage croissant ou ladoption du
froment comme crale panifiable dans la plupart des cits
dEurope saccompagne de la construction ou du renforcement
des quipements urbains de meunerie. Il suffit sans doute
expliquer quune part si importante de nos sources concerne
les cits. Une enqute gnrale sur les premires mentions de
moulins dans les villes ou leur priphrie ne serait pas
facile faire et donnerait sans doute des rsultats ambigus.
Partout en Europe, de telles mentions sont prcoces, mais
elles peuvent tmoigner aussi bien du maintien en fonction
des installations hrites de lAntiquit que dun dynamisme
prcoce de lconomie urbaine. Les partenaires impliqus
dans la construction et la gestion de ces installations parfois
considrables sont dabord les grandes institutions religieuses,
mais les bourgeois 95 et surtout le groupe des boulangers y
jouent trs tt un rle important: ds 1116, le comte
Baudouin VII de Flandre et les chevins dArras doivent ainsi
arbitrer le conflit qui opposait ce sujet les boulangers de la
ville labbaye Saint-Vaast 96. Cest durant la mme priode
que se met en place Toulouse lensemble impressionnant
(94) MARTIN, La Pouille du VIe au XIIe sicle cit., pp. 338-339.
(95) Cf. par exemple, le moulin construit Mayence en 1104 par Wignandus et
Adalheidis, bourgeois de Mayence: STIMMING, Mainzer Urkundenbuch cit. pp. 322-323,
n 418.
(96) F. VERCAUTEREN, Actes des comtes de Flandre (1071-1128), Bruxelles, 1938, pp.
161-162, n 69.
738
MATHIEU ARNOUX
des moulins construits sur le cours de la Garonne au Bazacle
et la Daurade 97.
Le phnomne se retrouve partout avec des dcalages
dans le temps qui constituent sans doute autant dindices de
la croissance de la population urbaine. Dans de nombreuses
rgions, en particulier en Italie centro-septentrionale, le
maintien dans le contado dune consommation base sur
dautres crales rendait peut-tre moins ncessaire laugmentation du nombre des moulins, dont la plupart sont construits,
partir du XIIe sicle la priphrie des cits, mangeuses de
pain blanc 98. Dans dautres rgions, en particulier en Nord et
lEst, la moindre pression dmographique, labondance des
terres dfricher et des cours deau mettre en valeur peuvent
avoir retard jusquau XIIIe sicle les effets densificateurs
de ce choix. Dautres modles de dveloppement, dans lesquels
la gestion des ressources en eau et lutilisation de la puissance
des cours deaux prirent une autre place, expliquent aussi la
trs grande divergence dans la gographie des moulins
europens ds le milieu du XIIe sicle. Cest en particulier le
cas du Nord de lItalie, o le problme ntait pas tant de
retenir les eaux que de les expulser.
Marc Bloch le premier avait attir lattention sur
lexistence dans lAntiquit dapplications industrielles de la
roue motrice, qui ne paraissent pas stre retrouves dans
lconomie du haut Moyen ge. La diversification des usages
du moulin est un bon indice de cette varit des choix en
matire dhydraulique, en mme temps que de lapparition
dune part dnergie disponible pour autre chose que la
mouture du grain. Il faut attendre la deuxime moiti du XIIe
(97) G. SICARD, Aux origines des socits anonymes. Les moulins de Toulouse au
Moyen ge, Paris, 1952, pp. 32-52.
(98) DUSSAIX, Les moulins Reggio dmilie aux XIIe et XIIIe sicles cit.; P. RACINE,
Plaisance du Xe la fin du XIIIe sicle cit. pp. 268-273.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
739
sicle pour trouver en nombre apprciable des moulins
utiliss pour fouler les draps, tanner les cuirs ou rduire le
minerai. La datation des premires occurrences et linterprtation des tmoignages prennent ici une importance
cruciale. Le dossier le plus important concerne les textiles.
Dans un livre stimulant consacr au dveloppement des
moulins fouler les draps de laine, Paolo Malanima avait
propos den dater la premire apparition aux annes prcdant
lan mil, o il apparat sous le nom de valcatura, en langue
vulgaire gualchiere 99. Si on laisse de ct un document des
Abruzzes dat de 962, qui prsente peu de garanties dauthenticit 100, les premires attestations du mot, et probablement
de la chose, renvoient lItalie septentrionale. Une donation
faite en 985 au monastre vronais de Santa Maria in
Organo de plusieurs moulins dans le castrum voisin dIllasi
comprend aussi les walcaturae propre iamdicti molendinis 101 .
Lautre mot utilis est fullo, dorigine antique: on le trouve en
973 dans un acte concernant des biens situs dans lvch de
Parme, comprenant molendinum cum fullone super se
habentem 102 , puis dans des actes de 1023, 1039 et 1052 pour
les rgions lombardes 103. On trouve dautres mots pour
(99) P. MALANIMA, I piedi di legno. Una macchina alle origini dellindustria medievale, Milan, 1988.
(100) Le passage licentiam construendi molendina et balcatoria ubicumque
voluerint per totum comitatum nostrum apparat dans lacte de fondation du
monastre S. Bartolomeo di Carpineto, qui nous est parvenu dans la chronique du
moine Alexandre, compile, en mme temps que le cartulaire du monastre, en 1195:
Alexandri monachi Chronicorum liber monasterii sancti Bartholomei de Carpineto, B.
PIO d., Rome (Fonti per la Storia dItalia (Rerum Italicarum Scriptores, 5), 2001, n 9,
pp. 129-134, la p. 131; selon son diteur il sagit dun documento se non
completamente falso, almeno largamente interpolato (je remercie L. Feller de mavoir
clair sur ce point).
(101) MALANIMA, I piedi di legno cit., p. 45.
(102) Ibidem.
(103) Le pergamene degli archivi di Bergamo, aa. 1002-1058, dir. M. CORTESI et A.
PRATESI, d. C. CARBONETTI VENDITTELLI, R. COSMA et M. VENDITTTELLI, Bergame, 1995, n 65
p. 117 (12 mai 1023; Teoderulfus, archidiacre de lEglise de Bergame, donne divers
biens et revenus lEglise de Bergame, Saint-Vincent, et vasum unum follonis quod
740
MATHIEU ARNOUX
dsigner les installations hydrauliques voues au travail du
textile: bateorium, attest ds la fin du Xe sicle dans le
Dauphin, puis dans la seconde moiti du XIe sicle dans le
Pimont, qui semble alors voquer le traitement du
chanvre 104; en revanche, paratorium, attest en Provence ds
le milieu du XIe sicle, pour dsigner la finition du tissu, peut
sappliquer au travail du lin comme de la laine 105.
Le dossier ainsi rassembl montre une nette antriorit
des rgions alpines et mditerranennes dans lapplication
de lnergie hydraulique au traitement des fibres et la
finition des toffes: il faut en effet attendre 1087 et une charte
de labbaye de Saint-Wandrille, en Basse-Normandie pour
voir se diffuser le moulin fouler dans le Nord de lEurope, en
association avec lessor de la production des draps de laine 106.
Le refus de son usage dans une bonne partie des draperies
urbaines des Flandres a longtemps interdit dapprcier ce
processus sa juste mesure. Exclu pour le traitement des
toffes de luxe, qui se foulent au pied, le moulin est largement
utilis ds le milieu du XIIe sicle dans des centres spcialiss
abere videor super ripa fluminis quod Brebum dicitur ); Codice diplomatico laudense,
d. C. VIGNATI, t. 1, Milan, 1879, pp. 46-50 (Charte de fondation du monastre de S. Vito
prs de Castiglione dAdda, 23 dcembre 1039 et non 1008 : ad Casalis Gausari
decimam portionem de omnibus rebus [...] cum decima tota vel quarta et totum fictum
molendinorum seu fictum ); Le carte cremonesi dei sec. VIII-XII, d. E. FALCONI,
Crmone, 1979, t. 1, p. 478, n 191 (19 aot 1052, investiture de biens situs Crmone
dont un fullum).
(104) A.-M. BAUTIER, Les plus anciennes mentions de moulins hydrauliques industriels et
de moulins vent, Bulletin philologique et historique jusquen 1610 du Comit des
travaux historiques et scientifiques, 2 (1960), pp. 567-626, pp. 572-574: la plus ancienne
occurrence, Romans (molenario et batedorios) semble dater de c. 990; on trouve
ensuite molendinis seu batedoris Vienne en 1025, puis bateorium a Grenoble vers
1040; les actes suivant sont deux chartes dates de 1078 pour Pignerol, qui numres
des molendinis, batenderiis, fullatoriis.
(105) 1066, donation labbaye de Lrins de quantumcumque habemus et habere
debemus in molendino et in paratore et in terra quae juxta eos est , MORIS et BLANC,
Cartulaire de labbaye Saint-Honorat de Lrins cit., t. 1, pp. 35-36, n 36; dans la Sicile
du XIIe sicle, le mme mot dsigne aussi les moulins foulon, BRESC, DI SALVO, Mulini
ad acqua in Sicilia, cit., p. 40.
(106) LOT, tudes critiques sur labbaye de Saint-Wandrille cit., pp. 96-97, n 42.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
741
dans la production de draps de qualit moyenne, et peut tre
aussi dtoffes mixtes, comme les tiretaines, dont on
commence seulement souponner limportance. Lusage du
molendinum foleret dfinit une vaste rgion industrielle
comprenant au XIIe sicle le duch de Normandie et ses
marges picardes et mancelles et la Champagne 107. Linstitution
apparat munie dun droit de banalit, protgeant et
contraignant la fois les tisserands qui y portent leurs
produits finir. La plus ancienne mention semble se trouver
dans une charte des annes 1160 pour le petit centre
normand de la Neuve-Lyre, qui fixe deux deniers et demi
par verge le prix du foulage du drap pour les tisserands du
lieu, ce qui montre lexistence dun march local du travail
des textiles institutionnalis la manire de celui de la
meunerie 108.
(107) Pour Reims, P. VARIN, Archives ecclsiastiques de la ville de Reims, t. 1, Paris,
1839, p. 303, n LXXIX (24 mars 1141): notice ncrologique de larchidiacre Hugues, qui
donna au chapitre une rente de 60 s. sur les moulins foulons, pro eodem etiam
Hugone, debent distribui lx sol. qui accipiuntur in molendinis foleres. Lacte de
fondation de labbaye cistercienne de Perseigne, dans le diocse du Mans, en 1145
(Recueil des actes des comtes de Ponthieu, d. Cl. BRUNEL, Paris, 1930, n 32, p. XX),
prvoit la construction dun ou plusieurs moulins foulons: quod dicti monachi facient
molendinum fullonarium vel plura in terra sua, in quo vel quibus homines eorum
pannos facient fullonari, similiter et homines terre mee de Sagones . Beauvais, un
accord pass en 1173 entre lvque Barthlemy et labb de Saint-Quentin prvoit la
construction de trente moulins foulons (triginta molendina fullonum) dans les cinq
annes venir: L.-H. LABANDE, Histoire de Beauvais et de ses institutions communales
jusquau commencement du XVe sicle, Paris, 1892, pp. 271-272.
(108) Le comte Leicester avait donn aux moines de Lyre molendinum fulerez de
Noua Lira cum tota molta totius feodi mei ex illa parte foreste in qua parte abbatia sita
est molendinum et quod textores manebunt in castellum meum de Lira et operationem
ibidem facient et ad moltam faciendam ibunt ad iam dictum molendinum predictorum
monachorum et quod homines mei de castello meo de Lira non dabunt pro uirga folenda
plus quam duos denarios et obolum de moneta prouincie , d. M. ARNOUX, Les Moines
normands et la technique. Les raisons dune indiffrence (XIe-XIVe sicles), dans
Monachisme et technologie dans la socit mdivale du Xe au XIIIe sicle, Cluny, 1994,
pp. 34-35; cf aussi, la donation faite quelques annes plus tard par Nel de Montbray
aux moines cisterciens de Saint-Andr-en-Gouffern de la dme du moulin foulon de
Bellon, dans le Cotentin: totam decimam molendini mei folerez de Beslon, quo omnes
panni honoris de Moibraio ex debito fullantur , GREENWAY, Charters of the honour of
Mowbray cit., pp. 121-122, n 165 (1170-1190).
742
MATHIEU ARNOUX
Cest dans la mme rgion vreux en 1055-1066 et la
Neuve-Lyre avant 1070 109 quon trouve les plus anciennes
attestations de lusage des moulins pour le travail du cuir:
lexpression molendinum taneret, construite sur le mme
modle que molendinum foleret, peut en effet dsigner le
travail de rduction des corce pour en extraire le tan, ou plus
gnralement lopration de battage des peaux, indispensable
en particulier en mgisserie. Le recensement des moulins
tan na pas encore t fait, mais laire de sa diffusion recouvre
peu prs au XIIe sicle celle du moulin foulon, marquant
lexistence au cur de lespace franco-normand dune vaste
rgion de production et de commercialisation de produits
industriels de qualit moyenne.
Le processus de diffusion des moulins industriels au XIIe
sicle se prte traditionnellement deux types de lectures.
Lune tire parti dune srie importante de tmoignages
commenant au milieu du XIIe sicle pour mettre en vidence
le rle volontariste de lordre de Cteaux, en particulier en
matire mtallurgique et lainire, et y voit un agent de
modernisation conomique de lEurope 110. Lautre sinterroge
sur les processus de spcialisation rgionale luvre au cours
du mouvement de croissance des XIe-XIIIe sicles. Lapparition
dans les dernires annes du XIIe sicle, Trente et peut-tre
(109) FAUROUX, Recueil des actes des ducs de Normandie cit., p. 397, n 208 (charte de
fondation de Saint-Sauveur dvreux, 1055-1066): apud Ebroicas duos molendinos,
unum annonarium et alterum tanetarium, cum terra quae ad eosdem molendinos
pertinet ; pancarte de fondation de labbaye de Lyre, peu aprs 1070: notum sit
omnibus quod Willelmus de Theuraico [...] dedit monachis Lire aream molendini
thaneret de Nova Lira , d. Ch. GURY, Histoire de labbaye de Lyre, vreux, 1917, p.
566.
(110) La bibliographie cistercienne est dmesure, Cf. par exemple Lconomie
cistercienne. Gographie, mutations du Moyen ge et aux Temps modernes (Flaran 2),
Auch, 1983, et L. PRESSOUYRE (dir.), Lespace cistercien, Paris, 1994; cf. aussi ltude de
cas exemplaire de G.G. ASTILL, A medieval industrial complex and its landscape: the
metalworking watermills and workshops of Bordesley Abbey, York, 1993 (mais la
proposition de dater de la fin du XIIe sicle lapplication de la force hydraulique
laction des soufflets de la forge de labbaye parat imprudente).
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
743
aussi en Carinthie, de moulins adapts la rduction en
fourneau des minerais de plomb argentifre incite pencher
pour la deuxime solution, qui donne beaucoup plus
dimportance la mise en place dans la seconde moiti du
sicle de marchs internationaux dont la demande stimule les
producteurs et les pousse innover 111. Laction industrialisante
de Cteaux, indiscutable partir des premires annes du
XIIIe sicle, ne fait que sadapter rgionalement se
processus pour en maximiser les consquences. Elle est
lun des symptmes de ce mouvement, et non lune de ses
causes. lglise de la rforme grgorienne navait pas
beaucoup de tendresse pour la croissance conomique 112, ni
pour les moulins. Une lettre de Bernard de Clairvaux
suggrant son correspondant prmontr de dtruire le
moulin de son abbaye si les femmes quon pouvait y
rencontrer en faisaient une occasion de pch pour les
moines et les convers, montre le peu de cas que le plus
grand des Cisterciens faisait de leur utilit 113.
(111) La sidrurgie italienne (XIIe-XVIIe sicles), Ph. BRAUNSTEIN (dir.), Rome
(Collection de lcole franaise de Rome, 290), 2001; sur lusage de la force hydraulique
dans laffinage du minerai dargent Trente, cf. le rglement de 1208 de lvque
Friedrich von Wangen, Europisches Montanwesen im Hochmittelalter. Das Trienter
Bergrecht, 1185-1214, d. D. HGERMANN et K.-H. LUDWIG, Colgone-Vienne, 1986, p. 74:
omnes werki qui habent rotas et qui ad rotas laborant arzenterie debeant habitare in
civitate et cives Tridentini esse... .
(112) Cf. par exemple les mots de Lothaire de Segni (futur Innocent III), qui
constituent la fois la meilleure description et une condamnation sans appel de la
croissance conomique europenne (De miseria condicionis humane, I, 12): Currunt et
discurrunt mortales per sepes et semitas, ascendunt montes, transcendunt colles,
transvolant rupes, pervolant Alpes, transgrediuntur foveas, in grediuntur cavernas;
rimantur viscera terre, profunda maris, incerta fluminis, opaca nemoris, invia
solitudinis; exponunt se ventis, ymbribus, tonitruis et fulminibus, fluctibus et procellis,
ruinis et precipiciis. Metalla cudunt et conflant, lapides sculpiunt et poliunt, ligna
succidunt et dolant, telas ordiuntur et texunt, vestes incidunt et consuunt, edificant
domos, plantant ortos, excolunt agros, pastinant vineas, succendunt clibanos, extruunt
molendina, piscantur, venantur, et aucupantur. [...] Et hoc quoque labor et mentis
affliccio .
(113) BERNARD DE CLAIRVAUX, Lettres, d. J. LECLERC et H. ROCHAIS, t. 2, Paris (Sources
744
MATHIEU ARNOUX
CONCLUSION
Le parcours accompli dans les pages qui prcdent
soulve plus de problmes quil nen rsout. Le premier est de
chronologie. La seconde moiti du XIIe sicle, choisie comme
terme de lenqute, est un bon observatoire si lon cherche
saisir les dynamiques luvre dans la construction et
lexploitation des moulins. Elle nouvre pourtant, ni ne clt
une priode spcifique. Si lon veut observer le dveloppement
de la meunerie urbaine, il faut attendre le milieu du sicle
suivant pour voir les villes, italiennes en particulier, se doter
de biefs et de roues qui font delles de vritables usines
moudre ou tourner 114. De la mme manire, cest tard dans
le XIIIe sicle que les moulins foulons anglais deviennent,
selon Eleonora Carus-Wilson, les outils dune premire
rvolution industrielle 115. Cest seulement partir des annes
1250, et particulirement aux XIVe et XVe sicles que
lamnagement des forges hydrauliques engendrera les formes
durables de la production sidrurgique europenne, la forge
catalane au Sud, le haut-fourneau wallon au Nord 116. Il en va
de mme pour le rle social des moulins comme instruments
chrtiennes, 458), 2001, pp. 400-404, n. 79, ( labb Luc de Cuissy, 1124-1132): Est
aliud apud vos de quo ea praesumptione, qua soleo, non cunctabor dicere quod sentio.
De molendino illo dico, quod conversi custodientes feminarum pati coguntur
frequentiam. Si mihi creditur, unum e tribus fiet: aut videlicet feminarum accessus
omnimodis a molendino prohibetur; aut molendinum cuicumque extraneo, en non
conversis, custodiendum comittetur; aut idem omnino molendinum relinquetur .
(114) CHIAPPA MAURI, I Mulini ad acqua nel Milanese cit., pp. 32-83; A. LANCONELLI, R.
L. DE PALMA, Terra, acque e lavoro nella Viterbo medievale, Rome, 1992, pp. 3-37; M.
ZACCHIGNA, Sistemi dacqua e mulini in Friuli fra i secoli XIV et XV, Venise, 1996.
(115) E. CARUS-WILSON, An industrial revolution of the thirteenth century, Economic
History Review, 11 (1941), pp. 39-60; repris dans Essays in Economic History, Londres,
1954, t. 1, pp. 41-60 et dans Medieval Merchants Venturers, Londres, 1954, pp. 183-210.
(116) M. ARNOUX, Moulins fer et procd indirect. Innovation technique et conditions
gographiques dans la sidrurgie europenne (XIIIe-XVIe sicles), GALETTI et RACINE (d.),
I mulini nellEuropa medievale cit., pp. 317-328; Matires premires, innovation
technique, march du fer: les logiques de la carte sidrurgique de lEurope (XIIIe-XVIe
sicles), V. GIURA d. Gli insediamenti economici e le loro logiche, Naples, 1998, pp. 1-14.
LES MOULINS EAU EN EUROPE OCCIDENTALE
745
de domination de la paysannerie par le groupe seigneurial:
bien considrer le dossier rassembl par Marc Bloch sur linterdiction des meules main dans le royaume dAngleterre, cest
au XIVe sicle, alors que stend la crise des institutions
manoriales, que lopposition entre paysans et seigneurs se
cristallise sur le problme de la mouture, selon une
dramaturgie qui anticipe les mouvements luddites du XIXe
sicle. Ailleurs en Europe, cest aprs la peste noire, voire au
sicle suivant, que la banalit du moulin devient enfin
linstrument de mise en tutelle des communauts paysannes
prsent par Bloch 117.
Considre dans une perspective comparatiste avec ce
qui la prcde et ce qui la suit, la priode des Xe-XIIe sicles
prend sa vritable personnalit. Comme Bloch lavait bien
montr, elle ne fut pas moment dinvention: cest le monde
romain qui avait su imaginer lusage nergtique de leau.
Elle ne fut par ailleurs que partiellement un moment dinnovation. Les moulins foulon et tan exploitent quelquesunes des possibilits de la roue hydraulique: il appartiendra
aux sicles suivants den explorer les multiples capacits.
Elle fut cependant, et au plus haut point, moment dinvestissement et dexploration conomique. En moins de deux
sicles, au prix dun effort sans quivalent de construction des
paysages, lensemble des cours deaux europens fut mesur,
endigu, dompt et contraint actionner arbres, meules et
battoirs. La gographie des biefs et des chutes qui se mit
alors en place marque encore les paysages ruraux et urbains.
Jusquau milieu du XIXe sicle, elle y dtermina en bonne
partie lorganisation des espaces industriels.
Une cration aussi durable fut rendue possible par une
srie dinnovations institutionnelles et juridiques dont notre
(117) Cf. par exemple A. CORTONESI, Ruralia. Economie e paesaggi del Medioevo
italiano, Rome, 1995, pp. 259-263 ou S. CAUCANAS, Moulins et irrigation en Roussillon du
IXe au XVe sicle, Paris, 1995, pp. 101-118.
746
MATHIEU ARNOUX
documentation rend compte fidlement, qui permirent la
constitution dun march minutieusement rgul de lnergie
hydraulique. Lappropriation des ressources nergtiques
par le groupe seigneurial peut tre considre comme une
dfaite pour les communauts paysannes, l o celles-ci en
taient propritaires. Il nest pas vident, vu le cot de ces
installations et les risques qui pesaient sur leur fonctionnement, que les moulins aient en tous lieux fait la fortune
de leurs dtenteurs, et bien des espoirs de promotion sociale
furent sans doute briss par une crue ou un incendie. Dans
beaucoup de rgions cependant, cette expropriation fut le
prlude une croissance proprement inoue des installations
hydrauliques, et donc une augmentation remarquable du
niveau de vie des paysans. Une telle russite ne rsulta pas
de la volont malthusienne dun groupe social de sarroger un
monopole sur les cours deaux: cest bel et bien la mise en
concurrence des installations par leurs de usagers et la
constitution dun march de leurs services qui permit la mise
en place dun cercle vertueux de loffre et de la demande. Cest
parce quils connaissaient les avantages quils pourraient en
retirer que les paysans rendirent possible par leur travail la
mise en place et le fonctionnement de ces installations.
Partout dans lEurope des Xe-XIIe sicles, les moulins furent
luvre et loutil des laboratores. Nen faisons pas a posteriori
linstrument tyrannique mais progressiste du pouvoir seigneurial quils ne furent pas alors.
Discussione sulla lezione Arnoux
GALETTI: ringraziando Mathieu Arnoux per lampia sintesi sul problema dei mulini ad acqua tra IX e XII secolo e
per lutile aggiornamento bibliografico, vorrei segnalare che
ho apprezzato particolarmente le sue osservazioni sulla funzione del mulino nella genesi dei poteri signorili. Ci ha proposto una nuova interpretazione, anche se, soprattutto, relativa alla situazione delle regioni occidentali della Francia e
dei secoli XI-XII. Quello che ci ha indicato la notevole articolazione delle forze sociali attive nello sviluppo di un
mercato della macinazione, a partire soprattutto dalla met
del secolo XI. Si tratta di una interpretazione che ha il pregio di spingere ad una rilettura delle fonti anche per il territorio italiano.
Per quel che mi dato conoscere, infatti, per ora, della
documentazione dei secoli VIII-XI relativa allItalia centrosettentrionale, la presenza di mulini segnalata su terre signorili, legata al possesso di diritti pubblicistici sulle acque,
ottenuti tramite autorizzazione regia. Gli inventari registrano in certi casi la presenza di mulini sulla pars dominica,
oltre che i redditi, generalmente in natura (moggi di grano),
che derivavano al signore dal controllo del mulino dominico, al quale i coloni del massaricio dovevano portare il proprio grano a macinare. Troviamo anche riferimenti a mulini communi su centri domocoltili, che dovevano fare riferi-
748
LA DISCUSSIONE
mento a pi propriet, in un quadro di razionale gestione
delle risorse della propriet stessa nel suo complesso. Oppure ma la casistica molto rara , per il IX secolo troviamo, ad esempio, per la Sabina mulini posseduti da piccole
comunit di allodieri, in una fase, per, precedente di poco
lo sviluppo dellinquadramento castrale. Il mulino sembra
risultare qui pienamente inserito nel quadro di una economia signorile che vede anche nello sfruttamento dei servizi
offerti dalla struttura molitoria uno dei fattori di sviluppo
di un controllo del territorio non solo in termini economici.
ARNOUX: comme le souligne Paola Galetti dans sa question,
le problme du lien entre diffusion du moulin et construction des
pouvoirs seigneuriaux est au cur de mon enqute. La comparaison quelle propose ici entre lespace plus septentrional
sur lequel je me suis arrt pour une priode plus tardive et
celui de lItalie du haut Moyen ge me parat tout fait
fconde. Il est effectivement vident, comme dans les autres
mditerranennes, que le moulin constituait un quipement
frquent des ensembles domaniaux, quelle que soit par ailleurs
sa place dans le systme social et juridique sous-jacent ces
structures. On peut donc penser que la situation mditerranenne anticipait sur ce point un processus qui sest tendu
par la suite lensemble de lEurope occidentale puis centrale.
Il me semble cependant que le rle tenu par les moulins
partir des Xe-XIe sicles dans la construction dun paysage
hydraulique, agraire et commercial nouveau dans les rgions
de Francie occidentale constitue un lment original par
rapport la situation quelle dcrit, en particulier par la
puissance des installations en question, qui explique la
ncessit de les construire loignes les unes des autres. Je ne
crois dailleurs pas quil faille attribuer cette innovation un
dynamisme spcifique des populations concernes. Il faut
faire place dans notre explication me part notable de
LA DISCUSSIONE
749
dterminisme gographique, qui interdit dans les rgions mditerranennes, soumises une trs forte discontinuit des prcipitations, des installations hydrauliques comparables aux
moulins avec biefs de lEurope du Nord-Ouest. Cest dans
dautres formes de construction du paysage, bonification des
sites marcageux ou restructuration des terroirs castraux quil
faut alors chercher les consquence dun mme dynamisme,
dont les effets sont constatables dans toute lEurope.
ARSLAN: la lezione del Collega Arnoux stata particolarmente stimolante per quanti hanno direttamente vissuto,
nel loro territorio e nella solo societ, la fase finale della
cultura del molino, che meglio definirei cultura degli impianti ad acqua. Essa da intendere quindi in unaccezione pi ampia, comprendente anche i magli, gli impianti per
la follatura, gli interventi per la manutenzione degli argini e per la regolamentazione delle acque a queste attivit
collegati, vitali in molti casi per la gestione del territorio,
delle vie dacqua, dellirrigazione. Negli anni 60, la quasi
totalit degli impianti stata prima disattivata, sulla base
di cavilli giuridici, e poi distrutta, ad opera del Genio Civile, in Italia, come conseguenza della nazionalizzazione della produzione dellenergia elettrica, per rendere obbligatorio
lallacciamento alla rete elettrica statalizzata degli impianti
prima attivi utilizzando lacqua come forza motrice. La disattivazione degli impianti, con la successiva mancata manutenzione di prese dacqua, canalizzazioni, chiuse ecc.,
spesso in stretto rapporto con i sistemi dirrigazione, ha portato oggi a forme, anche gravi, di dissesto idrogeologico. Mi
chiedo quindi: nellaltomedioevo come veniva gestito, anche
giuridicamente, questo particolare aspetto del rapporto con
il territorio, cio la captazione e la gestione dellacqua per i
mulini, la manutenzione delle strutture, il rapporto con
lirrigazione?
750
LA DISCUSSIONE
Ma la cancellazione della rete degli impianti port anche alla scomparsa in tempi molto brevi di una societ
particolare, di norma residente appartata, negli impianti
stessi, accanto ai corsi dacqua, spesso con funzioni multiple (tradizionale era il collegamento alla follatura della
canapa, affidata alle donne), senza radici reali nel territorio (erano frequenti i trasferimenti ed esistevano mulini
galleggianti fluviali), con rapporti spesso non facili con le
comunit che usufruivano del servizio.
La mia seconda domanda quindi si precisa in questi
termini: se, quando e come, questa societ con specificit
proprie si defin nellEuropa altomedievale? Quali erano i
rapporti con le comunit? Prendevano forma attriti e sospetti, come per tutti coloro che erano collocati ai margini
o esternamente al contesto territoriale (come quanti esercitavano mestieri itineranti)? Ma altri quesiti si affollano.
Se e quando si crearono i collegamenti con la diversa attivit della follatura, che richiedeva la captazione di acqua abbondante? Quali erano i rapporti che ne derivavano con la produzione, con il mercato al consumo del tessile, con il consumatore?
Vi erano poi rapporti (abbastanza rari in et moderna) tra gli impianti di molitura e i magli? I due tipi di
impianto esprimevano due gruppi umani professionalmente distinti o coincidevano? E quali erano i rapporti
con il fabbro, o il maniscalco, in et moderna invece integrati nella societ? Nellattivit di impianti con magli
quale conseguenza per i rapporti con la societ aveva la
fabbricazione di oggetti metallici per la vita quotidiana e
per lagricoltura? Lattivit si estendeva anche alla produzione di armi? Con quali limitazioni?
ARNOUX: je remercie Ermanno Arslan de ses remarques, qui
soulignent combien le problme que jai essay daborder dans
LA DISCUSSIONE
751
mon rapport est fondamentalement un problme de longue ou
de trs longue dure. Si lon veut bien considrer les moulins
non pas seulement comme des objets ou des sites mais comme
autant de points centraux dun ensemble de rgles, dusages,
de droits, essentiels la construction et au fonctionnement des
socits rurales dEurope, il devient vident que leur tude ne
peut se concentrer sur une priode rduite, sous peine de
manquer le problme fondamental du dveloppement de leur
rle, en particulier dans le secteur artisanal puis industriel.
Si lon va au-del de lusage textile des moulins, attest pour
lItalie partir du la fin du Xe sicle, il faut attendre le XIIIe
sicle pour voir utiliser la force hydraulique dans le secteur
mtallurgique, pour marteler, polir et aiguiser des armes dans
un premier temps, pour aider la rduction des minerais par la
suite. Ces innovations concernent au premier chef les districts
sidrurgiques de Lombardie (Milan, Bergame, Brescia, Lecco),
dont la prminence en matire darmement tait tablie
avant la fin du XIIIe sicle.
Vous aimerez peut-être aussi
- Annexe 2 - NORME ISO 2531 2009 FRDocument81 pagesAnnexe 2 - NORME ISO 2531 2009 FRFatre 1980Pas encore d'évaluation
- Molénat (Jean-Pierre) - L'Organisation Militaire Des AlmohadesDocument11 pagesMolénat (Jean-Pierre) - L'Organisation Militaire Des AlmohadesJean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- SONCASDocument1 pageSONCASazweegooPas encore d'évaluation
- ES15G Formation Ibm Z Os Facilities PDFDocument1 pageES15G Formation Ibm Z Os Facilities PDFCertyouFormationPas encore d'évaluation
- Daaïf (L.) - Ibn Anbal Un Faqīh (Jurisconsulte) ControverséDocument13 pagesDaaïf (L.) - Ibn Anbal Un Faqīh (Jurisconsulte) ControverséJean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Cheynet (J. C.) - Byzance Et Ses Voisins Musulmans, Xe-XIe S.Document10 pagesCheynet (J. C.) - Byzance Et Ses Voisins Musulmans, Xe-XIe S.Jean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Molénat (J.-P.), Les Francs de Tolède Aux XIIe Et XIIIe Siècle À Travers Les Documents de La Pratique (Comprendre Le XIIIe Siècle. Études Offertes À Marie-Thérèse Lorcin, Lyon, 1995, 59-72)Document11 pagesMolénat (J.-P.), Les Francs de Tolède Aux XIIe Et XIIIe Siècle À Travers Les Documents de La Pratique (Comprendre Le XIIIe Siècle. Études Offertes À Marie-Thérèse Lorcin, Lyon, 1995, 59-72)Jean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Femme Guerriéres LibreDocument9 pagesFemme Guerriéres LibreMaria Edith MarocaPas encore d'évaluation
- Quand L'imagination Envahit L'histoire, Et Que Celle-Ci Marche À ReboursDocument6 pagesQuand L'imagination Envahit L'histoire, Et Que Celle-Ci Marche À ReboursJean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Menjot (D.) - L'Historiographie Du Moyen Âge EspagnolDocument45 pagesMenjot (D.) - L'Historiographie Du Moyen Âge EspagnolJean-Pierre Molénat100% (1)
- Molénat (Jean-Pierre), Chemins Et Ponts Du Nord de La Castille Au Temps Des Rois CatholiquesDocument52 pagesMolénat (Jean-Pierre), Chemins Et Ponts Du Nord de La Castille Au Temps Des Rois CatholiquesJean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Menjot (D.) - Les Mudéjares Du Royaume de MurcieDocument15 pagesMenjot (D.) - Les Mudéjares Du Royaume de MurcieJean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Ferhat (Halima) - La Grande-Mosquée de Ceuta:SabtaDocument9 pagesFerhat (Halima) - La Grande-Mosquée de Ceuta:SabtaJean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Kleinclausz L'Empire CarolingienDocument652 pagesKleinclausz L'Empire CarolingienJean-Pierre Molénat100% (1)
- Janon (M.) - L'Aurès Au VIe S. Note Sur Le Récit de ProcopeDocument8 pagesJanon (M.) - L'Aurès Au VIe S. Note Sur Le Récit de ProcopeJean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Grundfosliterature 3828406Document132 pagesGrundfosliterature 3828406Julian GencoPas encore d'évaluation
- DTF Sud Version Mai 2022Document11 pagesDTF Sud Version Mai 2022Ali HajjPas encore d'évaluation
- QOS Formation Mettre en Oeuvre La Qos Cisco PDFDocument2 pagesQOS Formation Mettre en Oeuvre La Qos Cisco PDFCertyouFormationPas encore d'évaluation
- CoursDocument69 pagesCoursMargaux BrlPas encore d'évaluation
- EXE2.1.1施工图设计报告 -(A、B匝道)Document4 pagesEXE2.1.1施工图设计报告 -(A、B匝道)苏佳园Pas encore d'évaluation
- Gmsa2 8 10 2021Document1 pageGmsa2 8 10 2021YOUNES KABBAJPas encore d'évaluation
- Accès Et Service Universels - Guide - FRENCHDocument138 pagesAccès Et Service Universels - Guide - FRENCHAnonymous iAYcAhPas encore d'évaluation
- IceWarp - V10 - Guide Load BalancingDocument12 pagesIceWarp - V10 - Guide Load BalancinggeockPas encore d'évaluation
- PPPDocument146 pagesPPPtuo44Pas encore d'évaluation
- Preparation tp04Document12 pagesPreparation tp04Brahim ELGBPas encore d'évaluation
- Guide - Tableau Electrique Comprendre Choisir CablerDocument32 pagesGuide - Tableau Electrique Comprendre Choisir CableralflyPas encore d'évaluation
- Audiovisuel - VideoprojecteursDocument6 pagesAudiovisuel - VideoprojecteursLes ATESPas encore d'évaluation
- A1-3 2JavaAvanceDocument162 pagesA1-3 2JavaAvanceNohaila DoulfakarPas encore d'évaluation
- Refonte Complète Et Perspectives D'amélioration: Valérie Ugo Franck Geneviève Damien Luque PazDocument9 pagesRefonte Complète Et Perspectives D'amélioration: Valérie Ugo Franck Geneviève Damien Luque PazAbdellah Id BallouchPas encore d'évaluation
- Presentation Pfe Gestion Parc Informatique Et Help Desk 150615123549 Lva1 App6891Document46 pagesPresentation Pfe Gestion Parc Informatique Et Help Desk 150615123549 Lva1 App6891Goblen100% (1)
- Introduction À L'ingénierie Maritime - Chapitre 4Document35 pagesIntroduction À L'ingénierie Maritime - Chapitre 4Naifar OnsPas encore d'évaluation
- Extrait de Normes - XP A 87 - 005Document1 pageExtrait de Normes - XP A 87 - 005DEFOULOUNOUX ThierryPas encore d'évaluation
- Eurovent KlasikDocument2 pagesEurovent KlasikMaksims GrigorjevsPas encore d'évaluation
- RapportDocument93 pagesRapportFarouk BoughazalaPas encore d'évaluation
- Formation Gestion Des AvenantsDocument58 pagesFormation Gestion Des AvenantsJosephPistonePas encore d'évaluation
- Cours de Fertigation - AmellDocument25 pagesCours de Fertigation - AmellSaidAfkir100% (2)
- Test - 1 - Méta-Heuristiques Et Data Mining CorrectionDocument2 pagesTest - 1 - Méta-Heuristiques Et Data Mining CorrectionInsfp InfPas encore d'évaluation
- Install Borne VigikDocument17 pagesInstall Borne Vigikapi-326789955Pas encore d'évaluation
- B-28-1 - PE0101 - Note de Calcul Mécanique Convoyeur CVL' - MEC32801 - 00 - 20151101Document26 pagesB-28-1 - PE0101 - Note de Calcul Mécanique Convoyeur CVL' - MEC32801 - 00 - 20151101Akram FerchichiPas encore d'évaluation
- UML-Informatisation D'une MédiathèqueDocument15 pagesUML-Informatisation D'une MédiathèqueAqwzsx EdcrfvPas encore d'évaluation
- Dialogues Hiver 2009Document102 pagesDialogues Hiver 2009ibsfrPas encore d'évaluation