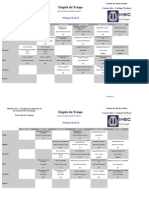Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Inha 3399 Decadence de La Theorie Des Ordres A La Fin Du Xviiiesiecle
Inha 3399 Decadence de La Theorie Des Ordres A La Fin Du Xviiiesiecle
Transféré par
Florentina MatacheTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Inha 3399 Decadence de La Theorie Des Ordres A La Fin Du Xviiiesiecle
Inha 3399 Decadence de La Theorie Des Ordres A La Fin Du Xviiiesiecle
Transféré par
Florentina MatacheDroits d'auteur :
Formats disponibles
Collections lectroniques de
l'INHA
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jean-Philippe Garric
Dcadence de la thorie des ordres
e
la fin du XVIII sicle
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Avertissement
Le contenu de ce site relve de la lgislation franaise sur la proprit intellectuelle et est la proprit exclusive de
l'diteur.
Les uvres figurant sur ce site peuvent tre consultes et reproduites sur un support papier ou numrique sous
rserve qu'elles soient strictement rserves un usage soit personnel, soit scientifique ou pdagogique excluant
toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'diteur, le nom de la revue,
l'auteur et la rfrence du document.
Toute autre reproduction est interdite sauf accord pralable de l'diteur, en dehors des cas prvus par la lgislation
en vigueur en France.
Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales dvelopp par le Clo, Centre pour l'dition
lectronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rfrence lectronique
e
Jean-Philippe Garric, Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIII sicle,inArchitecture et thorie.
Lhritage de la Renaissance (Actes de colloques) [En ligne], mis en ligne le 28 septembre 2015, consult le 02
octobre 2015. URL: http://inha.revues.org/3399
diteur : INHA
http://inha.revues.org
http://www.revues.org
Document accessible en ligne sur :
http://inha.revues.org/3399
Document gnr automatiquement le 02 octobre 2015.
Tous droits rservs
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
Jean-Philippe Garric
Dcadence de la thorie des ordres la fin
e
du XVIII sicle
1
Lan VIII de la Rpublique, larchitecte Charles Franois Viel (1745-1819), constructeur
chevronn et thoricien signataire de nombreux pamphlets1, publiait une brochure lintitul
provocateur, Dcadence de larchitecture la fin du XVIIIesicle2. Cette formule alarmiste
et percutante, comme les affectionnait lauteur, est emblmatique du combat rcurrent, qui
motive toute son uvre publie, contre la dissociation de la triade, solidit, convenance,
beaut, qui fondait la thorie de larchitecture depuis la Renaissance. Les titres des deux
livres suivants, De l'impuissance des mathmatiques pour assurer la solidit des btimens
(1805)3, puis, De la solidit des btimens, puise dans les proportions des ordres d'architecture
(1806)4, font aujourdhui figure de pure provocation, tant il est vrai que nous regardons comme
une vidence que lart de btir relve des techniques et des sciences de lingnieur et quil
repose sur une connaissance exprimentale de la rsistance des matriaux et sur des modles
mathmatiques qui permettent de calculer la capacit des structures, non sur une matrise
exemplaire du vocabulaire classique et du systme des ordres. Pour autant, lengagement
ractionnaire de celui qui fut lun des btisseurs les plus reconnus de son temps tmoigne bien
de la fin dune poque. Elle soppose linstauration dune approche autonome de la question
de la solidit, fonde sur une comptence spcifique et qui concide avec lmergence de la
figure de lingnieur contemporain.
Cet abandon de la thorie de lordonnance, qui va de pair avec ce que Georg Germann a dsign
comme la fin du Vitruvianisme5 a notamment fait lobjet dune tude de James McQuillan
publie en 1998 et intitule From Blondel to Blondel: on the Decline of the Vitruvian
Treatise6. Lauteur y pointe ce quil considre comme les raisons du dclin de la thorie
de la Renaissance centre sur le modle grco-romain: le dveloppement de larchologie
comme un champ de connaissance autonome du projet architectural, louverture de lOccident
une diversit de cultures, qui rsulte notamment de la multiplication des voyages, et, plus
globalement, la remise en cause de tous les fondements des sciences et des arts par lesprit
des Lumires, qui sexprime en particulier dans les colonnes de lEncyclopdie. De fait, le
Cours darchitecture en partie posthume de Jacques Franois Blondel, publi partir de 17717,
apparat bien comme le dernier grand livre darchitecture franais plaant au cur de son
propos la thorie des ordres et son emploi dans lordonnance des difices ou de leurs lments
les plus labors, comme les portes ou les portiques.
Collections lectroniques de l'INHA
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
Fig. 1. Jacques Franois Blondel, Cours darchitecture, 1771, t.1, pl.1
Encore faut-il noter que les positions dveloppes par cet auteur se distinguaient dj de la
tradition initie dans la seconde moiti du XVIesicle. Lillustration la plus vidente de cet cart
apparat ds la premire planche du Cours, dans laquelle les cinq ordres ne sont pas rangs du
plus petit au plus grand, suivant la croissance de leurs hauteurs, mais du plus gros au plus fin,
suivant la diminution de leurs diamtres (fig. 1).
Fig. 2. Sebastiano Serlio, Regole generali di architettura, 1537, fIIII
La figure synthtique de la croissance verticale des ordres, imagine par Vignole8 et reprise
aprs lui par la plupart des auteurs, tmoignait dune conqute de la pense systmatique,
par rapport au simple rapprochement dobjets indpendants les uns des autres, que constitue
la juxtaposition propose notamment par Serlio9 (fig. 2). Sur le plan smantique, cest le
passage du pluriel Regole employ par ce dernier, au singulier Regola du titre de
Vignole, qui trouvait l son expression graphique. Cette mise en systme illustrait aussi une
progression crescendo de la formule la plus modeste vers la plus magnifique, la grandeur
physique accompagnant la noblesse symbolique. Jacques Franois Blondel, pour justifier la
rduction des cinq formules une hauteur constante, explique que cette mthode permet de
Collections lectroniques de l'INHA
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
faire connatre plus positivement la diffrence du diamtre10, ce qui sous-entend que le
choix dun ordre plutt quun autre na pas dincidence sur la hauteur de lordonnance, mais
sur la grosseur des colonnes. Dans la planche de Blondel, la progression qui ne se fait plus
du petit vers le grand, mais plutt du fort vers le frle, relve dun pragmatisme qui attnue
la hirarchie entre les ordres et qui tend considrer les colonnes comme des objets rapports
et interchangeables.
Si lon accepte provisoirement lide quun cycle sachve, aprs 1750, caractris notamment
par un dclin de la thorie des ordres issue de la Renaissance, on doit pourtant noter que ce
mouvement ne soldait aucunement la fin des difices portiques o colonnades, qui devaient
au contraire demeurer le modle le plus utilis dans le monde pour reprsenter le pouvoir et
les institutions, jusqu la seconde guerre mondiale. Ainsi la dcadence des ordres la fin du
e
XVIII sicle, sur laquelle saccordent les historiens de la thorie de larchitecture, na-t-elle
pas du tout la mme vidence lorsque lon sintresse la production btie, surtout lorsque
celle-ci mane danciens lves de lcole des beaux-arts de Paris ou darchitectes forms dans
lune des trs nombreuses institutions denseignement dont elle fut le modle. Car, si lon peut
affirmer que les principaux thoriciens abandonnent la thorie des ordres ds les annes 1760,
pour se tourner vers dautres mthodes et vers dautres objets, celle-ci reste nanmoins la base
de lenseignement jusquau milieu du XXesicle, Paris comme Rio de Janeiro: une seconde
vie qui permettrait dcrire une histoire de la thorie des ordres aprs la thorie des ordres.
Comme on la soulign, la mort de Jacques Franois Blondel concide avec la multiplication de
cours libres darchitecture11 et de publications de second plan, qui tmoignent de son influence,
et, pour beaucoup dentre elles, dun surinvestissement dans la question des ordres, qui est
une bonne illustration de lemphase que le zle des disciples ou des suiveurs donne parfois
la leon des matres. Parmi ces fantassins de la thorie tardive des ordres figure notamment
larchitecte Charles Dupuis (1733-1792). En dpit dune relle constance tenter dacqurir
de la reconnaissance travers les versions successives de son Trait darchitecture plusieurs
fois remani, entre 1762 et 178212, le rival malheureux de lacadmicien Nicolas Marie Potain
fut, selon ses propres termes, repouss par des ennemis acharns hors de lenceinte que le
gnie du sicle a tablie pour les artistes distingus, cest--dire tenu lcart de lAcadmie.
Accessoirement ruin par son enttement thorique, Dupuis en fut rduit accepter un emploi
alimentaire de commis aux bureaux de la Loterie royale de France, Strasbourg13.
Dans ces mmes dcennies qui prcdent la Rvolution franaise, deux suiveurs de
Jacques Franois Blondel, Raymond Lucotte et Pierre Panseron (1742-1803), lun et lautre
responsables dun cours libre darchitecture, publient galement des ouvrages sans doute
acquis en premier lieu par leurs lves et dans lesquels la thorie des ordres occupe une place
centrale. Les deux publications commencrent paratre la mme anne, en 1772, deux ans
avant la mort de Blondel, qui, lanne prcdente, avait livr au public les deux premiers
tomes de son propre Cours. Le Vignole moderne de Lucotte14 et les lments darchitecture de
Panseron15 comptent chacun trois parties parues entre 1772 et 1784, pour le premier, entre 1772
et 1776, pour le second, qui comprend galement des cahiers additionnels ajouts jusquau
milieu des annes 1780. Il sagit, par consquent, de deux livres exactement contemporains
lun de lautre et dont la publication stale sur une priode de plus dune dcennie, malgr
leurs tailles relativement restreintes: le premier forme au total un petit volume in-quarto, le
second trois fins volumes in-octavo.
Collections lectroniques de l'INHA
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
Fig. 3. Jacques Raymond Lucotte, Le Vignole moderne, 1772, t.1, pl.II; Pierre Panseron,
lments darchitecture, 1772, t.1, pl.1
Lucotte et Panseron adoptent le principe de Blondel dune reprsentation des cinq ordres
rduits une mme hauteur (fig. 3). Le second, qui intitule sa planche Les cinq ordres
darchitecture pris sous une mme hauteur, dtaille trs prcisment la mthode qui permet,
suivant lordre adopt, de dduire le diamtre du ft de la hauteur donne. Cest une faon de
prendre acte du fait que les architectes taient plus souvent confronts la situation de devoir
dessiner des colonnes pour les loger dans un emplacement dtermin, plutt qu celle de
dduire du type de colonne employ la hauteur des tages dun difice. Cela signifie galement
que la colonne tait vue comme un dcor ou un accessoire rapport dans une architecture
prexistante, plutt que comme un lment vritablement structurant.
Fig. 4. Pierre Panseron, Profil corinthien [sic] pour la saillie des balcons, dans Recueil
des profils darchitecture, 1784, pl.22
Chez Panseron, mme des dtails de dcoration extrieure, qui ne font pas partie du
vocabulaire antique, sont rangs suivant des catgories correspondant aux cinq ordres, comme
les consoles supportant la saillie des balcons qui peuvent tre toscanes, doriques, ioniques,
corinthiennes ou composites (fig. 4).
Collections lectroniques de l'INHA
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
Fig. 5. Pierre Panseron, Application de lordre ionique antique un portail dglise, dans
Nouveaux lments darchitecture. Troisime partie, 1776, pl.16
Cependant, loppos de cette rduction des ordres une suite dornements interchangeables,
lauteur reprend, dans sa troisime partie, le principe qui consiste au contraire tendre le
contrle modulaire issu du systme des ordres aux proportions de toute une faade16 (fig. 5).
Appliquant ici la mthode que Vincenzo Scamozzi avait dveloppe de faon systmatique
dans lIdea universale17, il rgle larrire-plan du portique la largeur des tables saillantes, des
chambranles ou des niches en fonction du module des colonnes, non sans contredire le choix
de ce systme proportionnel par lintroduction de dimensions (sept pieds pour la largeur de la
porte) et tout en persistant prendre comme point de dpart la hauteur des ordres, quil divise
ensuite pour en dduire le module.
Fig. 6. Jacques Raymond Lucotte, Le Vignole moderne, 1781, t.3, pl.XXV
Cette mme hsitation, entre une faon de considrer les ordres plutt comme des genres plus
ou moins svres ou gracieux permettant de classer les diffrents types dornements rapports,
ou plutt comme des lments structurants propres rgler la composition dun difice ou
dune partie dun difice, est galement prsente chez Raymond Lucotte. La premire partie
Collections lectroniques de l'INHA
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
10
11
12
de sa publication se prsente en effet comme un Vignole plutt conventionnel dans sa forme
comme dans son contenu, tandis que la varit des propositions runies sur les planches de
la deuxime partie voque au contraire les feuillets des catalogues dornements tels que les
fabricants du sicle suivant allaient bientt les proposer aux architectes et dans lesquels les
concepteurs seraient conduits choisir les lments de vocabulaire quils souhaitaient mettre
en uvre (fig. 6) au lieu de les faire raliser suivant leurs propres dessins. Mme si les numros
qui figurent ici cot des objets ne sont pas encore ceux dun inventaire commercial, la
juxtaposition de ces variantes interchangeables induit par elle-mme un certain relativisme
dans le choix dun dtail ou dun autre et favorise lide dune forme dclectisme dans la
dmarche de projet.
Une production comparable celles de Panseron ou de Lucotte, par sa vocation pdagogique
et son ancrage dans des cours libres destins aux dbutants, se poursuit aprs la Rvolution,
avec notamment le Vignole de Michelinot et de Moreau le jeune (1741-1814), qui se dclarent
respectivement professeur et professeur aux coles centrales, publi par tapes entre
1800 et 180618, ou mieux encore celui dAthanase Dtournelle (1766-1807), en 180419, qui
annonce, ds la page de titre, stre mis le plus possible la porte de lIntelligence de
ceux qui commencent et des ouvriers en btiment . Aprs lavoir tudi, ajoute-t-il, on
pourra mieux concevoir les ouvrages plus importants qui traitent des nombreuses parties de
la science de larchitecture, laquelle il peut servir dintroduction. Comme les Elments
de Pierre Panseron, le Nouveau Vignole au trait tait disponible dans une version termine
au lavis. Les ombres, prcise encore lauteur, sont traces avec le plus grand soin pour
lutilit des lves.
Lune des nouveauts qui fragilisaient la thorie des ordres issue de la Renaissance dans la
deuxime moiti du XVIIIesicle tait bien sr la dcouverte du dorique grec, la fois tranger
au systme et nanmoins aurol du prestige dont bnficiait la civilisation grecque, modle
de la culture classique romaine. Ce nest pas du tout par hasard que Jacques Franois Blondel
prcise dans le commentaire de la premire planche de son Cours que la proportion de 14
modules dvolue lordre toscan lui parat constituer un seuil en de duquel on ne saurait
descendre : Effectivement au-dessous de sept diamtres, il semble quon ne puisse faire
un ordre rgulier, qui puisse entrer pour quelque chose dans lordonnance dun difice de
marque20. Ctait une faon de dire quen dpit des observations publies en 1758 par Julien
David Le Roy21, puis, partir de 1762, par Stuart et Revett22, il ny avait pas lieu de tenir
compte des dcouvertes archologiques en cours pour tendre la gamme des ordres issus de
la Renaissance.
Mais cette position ntait pas tenable. Mettre jour la rgle des ordres en llargissant
lordre de Paestum tait une faon de conforter lancien systme en ladaptant au got
du jour et lvolution de la connaissance. Ce fut lambition thorique majeure de Claude
Mathieu Delagardette. Celui-ci publia en 1786 le trait des ordres le plus populaire de la fin
du XVIIIesicle et du dbut du XIXe, puisquil devait tre rdit au moins cinq fois jusquen
1851 et traduit en espagnol23. Lauteur ne change pas le titre du livre, qui sintitule bien Trait
des cinq ordres darchitecture de Vignole, mais il ajoute dans le sous-titre Avec un dtail
dun ordre dorique de Paestum. Dans son commentaire cependant, il estime que lordre de
Paestum ne doit pas tre confondu avec dautres ordres accessoires, comme le rustique, le
persique, le cariatide, le gothique, [ou] lattique , mais quil est digne denrichir notre
architecture, poursuivant: il est remarquable par son austre simplicit, par le sublime
effet de ses profils et de ses dtails. Cest un vritable ordre dorique, dont la colonne de trs
courte proportion na point de base, et dont le chapiteau na pas dastragale saillante24.
Collections lectroniques de l'INHA
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
Fig. 7. Claude Mathieu Delagardette, Rgle des cinq ordres darchitecture, 1786, pl.30
13
Delagardette intgre pour la premire fois lordre de Paestum son trait des ordres, avant
de lavoir vu sur place, puisque, laurat du Grand Prix en 1792, ce nest que lanne suivante
quil peut se rendre au sud de Naples pour y relever les monuments grecs de la Campanie,
qui lui fourniront la matire dune monographie publie en lan VII25. Mme sil sinspire
du temple le moins archaque du site, il est nanmoins conduit prsenter un ordre dont la
colonne na pour hauteur que quatre fois son diamtre, mais surtout dont certaines spcificits
dans la mise en uvre empchent quil soit trait exactement comme les cinq autres (fig. 7).
Cest ainsi quil commence sa prsentation, en montrant la faade complte dun temple et le
plan correspondant, qui expliquent lirrgularit des entrecolonnements plus troits aux deux
extrmits. Dans la planche suivante il publie un dtail expliquant le dcalage entre le triglyphe
et laxe de la colonne langle du temple26. Lordre de Paestum ne diffre pas seulement du
dorique classique par ses proportions ou par le dtail de ses profils, il rpond surtout une
logique de mise en uvre dans laquelle la composition densemble de ldifice inflchit les
principes dassemblage des lments du vocabulaire. Cest un ordre dans lequel la colonne,
lentablement et la composition de la frise sont assujettis une logique suprieure, un ordre
qui varie suivant sa position dans ldifice et dans lequel, contrairement ce qui tait la rgle
depuis la Renaissance, on prfre terminer un angle saillant par la runion de deux triglyphes
et par une srie dadaptations, plutt que par des demi-mtopes. Comme lauteur le remarque:
il faut observer que les entrecolonnements des angles sont plus serrs que ceux du milieu,
et les quatre colonnes des angles plus grosses, -peu-prs dun quarantime. Ce nest donc
pas exactement un ordre.
Collections lectroniques de l'INHA
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
Fig. 8. Charles Normand, Nouveau parallle des ordres darchitecture, 1819, pl.n.c.
14
15
16
Aprs Delagardette, le dernier grand livre consacr aux ordres, qui ait t publi Paris par un
architecte important est d Charles Normand. Ce dernier, galement laurat du Grand prix,
avait vu sa carrire perturbe et dtourne, non seulement par limpossibilit de se rendre en
Italie en 1793, mais aussi, sans doute, par la crise de la construction monumentale qui peut
expliquer quil se soit en partie dtourn de la matrise duvre pour se spcialiser dans la
gravure (quil pratiqua abondamment, y compris au-del du domaine architectural) et dans
ldition (dont il devint un vritable professionnel). Toujours est-il que Normand, qui possdait
une culture architecturale livresque assez approfondie, choisit une rfrence prestigieuse pour
son ouvrage publi en 1819 en lintitulant: Nouveau parallle des ordres d'architecture des
grecs et des romains et des autheurs modernes27. Avant lui, cette notion de parallle avait t
employe notamment dans deux ouvrages darchitecture de premier plan, avec deux acceptions
assez diffrentes lune de lautre, le Parallle de larchitecture antique et de la moderne de
Roland Frard de Chambray28, en 1650, et le Recueil et parallle des difices en tout genre,
de Jean Nicolas Louis Durand29, en 1799. La premire planche du Nouveau parallle montre
que Charles Normand emprunte ses deux prdcesseurs (fig. 8). Frard, bien sr, puisquil
annonce vouloir, comme lui, aborder la question des ordres en tablissant un parallle entre des
exemples anciens et modernes, mais Durand aussi, en prsentant une collection de colonnes
antiques reprsentes une chelle unique, comme le sont les modles publis par le professeur
de lcole polytechnique.
Dans cette gravure intitule Parallle des ordres antiques contenus dans ce volume, sous le
rapport de leurs dimensions respectives, Normand propose une collection dobjets et non
lillustration dune rgle systmatique. Les ordres, qui jusquici avaient des proportions et
rentraient dans un systme qui les enchanait tous, ont dsormais aussi des dimensions et mme
des dimensions extrmement variables entre elles. Larchologie est passe par l, enrichissant
le registre des rfrences dune multitude dexemples plus ou moins conformes aux canons
classiques. Mais, surtout, la matire premire collecte sur le terrain est dabord prsente
suivant un ordre chronologique (de la Grce classique la Rome impriale), ce qui rpond
davantage une logique historique qu des motivations architecturales. On peut rappeler,
cet gard, que les publications contemporaines de recueils de modles ntaient pas ordonnes
en fonction des dates des difices reprsents.
La suite du volume confirme, dans une certaine mesure, ce principe de collection. On privilgie
dsormais laccumulation et la juxtaposition de diffrentes formules possibles et cet ouvrage,
qui est sans doute un recueil de modles dordres darchitecture plutt quun trait des ordres,
propose une srie abondante dexemples interchangeables. Si lon considre, par exemple,
Collections lectroniques de l'INHA
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
17
18
19
20
21
lordre ionique, ce sont dsormais neuf diffrents modles antiques (six grecs et trois romains)
qui sont proposs, avant les cinq versions modernes empruntes Palladio, Scamozzi, Vignole,
Serlio et Alberti. Nanmoins, Normand, dans son Avis prliminaire , ne prtend pas
alimenter une forme dclectisme ou de relativisme, mais plutt fournir des outils pour
dpasser la rgle de Vignole. Aujourdhui, crit-il, que nos coles ont adopt les grands
principes de lAntiquit, et quelles en analysent les beauts avec discernement, et quune
critique claire apprcie mieux les productions de lart, on reconnat linsuffisance du seul
auteur consacr par lusage, et lon sent la ncessit de recourir aux sources o il a puis, ainsi
que les architectes de ce temps qui se sont loigns tous, plus ou moins, comme lui, de leurs
modles30.
Pour comprendre le Nouveau parallle des ordres, sans doute faut-il conduire une lecture
croise des intentions revendiques par lauteur, des planches quil publie et des commentaires
qui les accompagnent. La planche de parallle, place entre le frontispice et la planche
chiffre 1, ne saccompagne daucun commentaire. Chaque planche prsente ensuite un
exemple, plus rarement deux, comme la dernire de lordre ionique qui compare Serlio et
Alberti. Si lauteur livre un commentaire, dailleurs souvent succinct, il ne construit donc
pasun parallle graphique propre faciliter la comparaison.
En revanche, quil sagisse des ordres emprunts aux principaux auteurs modernes ou des
nombreux modles antiques provenant chaque fois dun difice bien prcis, il applique un
systme identique de cotation proportionnel exprim en module. Cest ce qui distingue cette
publication destine aux architectes dun livre darchologie. Les mesures recueillies sont
transformes en un systme de composition, qui relie les diffrentes parties entre elles, mme
si aucune rgle ne vient plus dsormais crer de relations systmatiques entre les diffrents
ordres.
Parmi tous les ouvrages que lon vient dvoquer, quelques-uns connurent un succs
commercial indniable, dautres nont sans doute gure dpass le cercle direct des lves de
leurs auteurs, mais aucun ne compte parmi les ouvrages majeurs de la priode considre.
Mme si Delagardette ou Charles Normand eurent plus dcho que Lucotte ou Panseron, aucun
des quatre nest un thoricien ou un matre trs influent. Or, sil se confirme ainsi que la thorie
des ordres, qui demeure le fondement de la formation des jeunes architectes, nest plus, la
fin du XVIIIesicle et au dbut du XIXe, un enjeu propre mobiliser les principaux auteurs,
il nen reste pas moins que ces derniers ne sont pas pour autant indiffrents la question de
lornement, du dcor sculpt et du vocabulaire antique. Comme nous lavons dj montr31,
Charles Percier et Pierre Fontaine, lors de leurs sjours italiens, consacrrent aux fragments
sculpts, quil sagisse de ronde bosse, de bas-relief ou dornement darchitecture, davantage
dtudes qu la composition ou lordonnance des difices. Cette attention particulire
la sculpture, dont le moment emblmatique est le relev de la colonne Trajane par Charles
Percier, pour son envoi de Rome, correspond explicitement la conviction selon laquelle les
exemples antiques en matire de sculpture et dornement ne sauraient tre dpasss. Leur
obstination dans cette voie tait soutenue par lide quil sagissait l de la vritable cole du
got, seule faon de se hisser au diapason de la plus pure manire, celle de lAntiquit.
Pourquoi, dans ces conditions, consacrer des publications uniquement larchitecture de la
Rome moderne, celle des palais et des villas construits depuis la Renaissance, comme lont
fait Percier et Fontaine avec les deux recueils issus de leurs sjours romains: Palais, maisons
et autres difices modernes dessins Rome en 179832 et Choix des plus clbres maisons de
plaisance de Rome et de ses environs en 180933? regarder de plus prs, il apparat au contraire
quen dpit des thmes annoncs par les titres ces deux grands volumes, dont linfluence fut
majeure pour la culture architecturale contemporaine, ceux-ci accordent bien une place notoire
aux lments darchitecture antiques.
Le systme de vente et de commercialisation du premier, fond sur la ncessit de financer par
souscription une entreprise ditoriale trop coteuse pour des auteurs encore impcunieux et
qui devaient assumer eux-mmes le rle dditeurs, fut celui dune division en cahiers livrs
successivement aux souscripteurs, afin de faire rentrer largent mesure quon linvestissait.
Chacune de ces livraisons de six planches commenait par une page de titre que lannonce
Collections lectroniques de l'INHA
10
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
publicitaire prsentait comme une feuille de fragmens anciens ou modernes . Ces
frontispices, en marge du propos principal concernant les palais romains de la Renaissance
et de lge baroque, instituaient un genre, qui navait pas t invent par Percier et Fontaine,
mais qui, issu des caprices piransiens, devait, grce eux, sinstaller durablement au cur
de la tradition acadmique franaise.
Fig. 9. Charles Percier et Pierre Fontaine, Palais, maisons et autres difices modernes
dessins Rome, pl.44
22
Les compositions base de fragments antiques conues par Charles Percier utilisent peu ou
prou les mmes lments qui avaient dj servi de base aux publications des sicles prcdents.
Mais, au lieu dtre employs la cration dun systme rgulier proposant une dfinition
graphique et des principes de mise en uvre inflexibles, ils prennent dsormais place dans un
contexte subjectif, qui laisse le champ libre limagination du dessinateur et dont lvaluation
est uniquement soumise lapprciation qualifie du concepteur et de ses confrres (fig. 9).
Les frontispices la Percier sont la version free style de lart dassembler les lments de
vocabulaire antique, sans chercher reconstituer un nouvel difice conforme aux rgles des
Anciens, mais avec lesouci de sapproprier cette culture partage dans une approche crative,
qui lgitime le statut dartiste des architectes du XIXesicle.
Collections lectroniques de l'INHA
11
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
Fig. 10. Auguste Ancelet, Rome. Fragments antiques (1851) dans DEspouy, Fragments
darchitecture antiques, 1905, vol.I, pl.33
Collections lectroniques de l'INHA
12
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
Fig. 11. Louis Jean Hulot, Fragments antiques, dans LArchitecte, vol.1-1906, pl.1
23
Nous lavons soulign, la rgle des ordres ntait pas oublie. Au-del mme de sa fonction
pdagogique, au dbut de la formation des futurs architectes, elle devait largement contribuer
imposer le principe dune solution de continuit, dans la composition et dans les proportions
de lensemble du projet darchitecture, un impratif dont le Modulor de Le Corbusier34 est
une adaptation moderne. Mais, dans la seconde moiti du XVIIIe sicle, une autre faon
dassembler les fragments antiques se superpose la premire, permettant de mesurer non
plus la connaissance et la matrise des rgles, mais la capacit dimaginer des jeux de libre
association. Ds 1806, les premiers lves de Percier qui publient leur tour un recueil
ddifices modernes italiens, Auguste Grandjean de Montigny (1776-1850) et Auguste Famin
(1776-1859), reprenaient le principe des frontispices, qui simposa au cours du sicle comme
un lment de reconnaissance, une sorte de dmonstration de matrise architecturale. En
tmoigne la grande composition de Gabriel Auguste Ancelet (1829-1895), prix de Rome de
1851 (fig. 10), qui fut publie par DEspouy35 et mme, en 1906, le choix dun frontispice
la Percier, dessin par Jean Hulot (1871-1859), prix de Rome de 1901, avec lequel la Socit
des architectes diplms par le gouvernement inaugure sa nouvelle revue LArchitecte (fig.
11). Le commentaire accompagnant la planche est assez loquent: Nous ouvrons la srie de
Collections lectroniques de l'INHA
13
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
24
nos planches par la reproduction du si joli dessin de M.Hulot, pensionnaire de lAcadmie
de France Rome, o il a su runir dans un ensemble fort harmonieux divers fragments
darchitecture romaine. Le charme de la composition et de larrangement ajoute encore au
plaisir que ressentiront tous les artistes constater limpeccabilit [sic], la souplesse du dessin
et lhabilet du rendu36. Les architectes sont alors des artistes, dont le talent, qui se manifeste
dans larrangement des formes et la composition, sexprime par ledessin.
Cette position hritire de Piranse et dEtienne Louis Boulle, institutionnalise au dbut du
e
XIX sicle par des architectes artistes comme Charles Percier, ne soldait pas labandon de la
rgle des ordres mais son dpassement dans une pratique artistique. Connatre les principes de
Vignole restait la condition sine qua non pour se prtendre un architecte, savoir sen affranchir
tait devenu la gloire et la prrogative des matres.
Notes
1 propos de Charles Franois Viel et de ses publications voir Valrie NGRE, Principes de
lordonnance et de la construction des btiments (1797-1814) de Charles Franois Viel, dans Daniel
RABREAU et Dominique MASSOUNIE (d.), Claude Nicolas Ledoux et le livre darchitecture franais,
Paris, Monum/ditions du patrimoine, 2006, p.184-188.
2 Charles Franois VIEL, Dcadence de l'architecture la fin du XVIIIesicle, Paris, l'auteur/impr. de
Perroneau..., anVIII, in-4.
3 Charles Franois VIEL, De l'impuissance des mathmatiques pour assurer la solidit des btimens,
et recherches sur la construction des ponts par Charles-Franois Viel, Architecte de l'Hpital gnral,
Membre du Conseil des travaux publics du dpartement de la Seine, de la Socit libre des sciences
lettres et arts de Paris, Paris, l'auteur/impr. de Vve Tillard, 1805, in-4.
4 Charles Franois VIEL, De la Solidit des btimens, puise dans les proportions des ordres
d'architecture, et de l'impossibilit de la restauration des piliers du dme du Panthon franais, sur le
plan excut par Soufflot, architecte de ce temple. Par Charles-Franois Viel..., Paris, l'auteur/impr. de
Tilliard frres, 1806.
5 Georg GERMANN, Vitruve et le vitruvianisme, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires
romandes, 1991 (d. allemande, Darmstadt, 1987).
6 James MCQUILLAN, From Blondel to Blondel: on the Decline of the Vitruvian Treatise, dans
Vaughan HART et Richard HICKS (d.), Paper Palaces: the rise of the architectural treatise, New Haven/
Londres, Yale University Press, 1998, p.338-357.
7 Jacques Franois BLONDEL et Pierre PATTE, Cours darchitecture ou trait de la dcoration,
distribution & construction des btiments; contenant les leons donnes en 1750, & les annes suivantes,
par J.F.Blondel, architecte, dans son cole des Arts [et continu par M.Patte, Architecte de S.A.S. Mgr
le Prince Palatin, Duc rgnant de Deux-Ponts], Paris, Desaint [puis Vve Desaint], 1771-1777, 9vol.
8 VIGNOLA, Regola delli cinque ordini darchitettura, [Rome, 1563].
9 Sebastiano SERLIO, Regole generali di architetura sopra le cinque maniere de gli edifici, Venise,
Francesco Marcolini da Forli, 1537.
10 Jacques Franois BLONDEL et Pierre PATTE, Cours darchitecture,op. cit. n.7, t.I, p.216.
11 Voir Laurent PELPEL, La Formation architecturale au XVIIIesicle en France, Paris, Corda, 1980,
p.26.
12 Charles DUPUIS, Nouveau trait darchitecture,Paris, Vve Chreau,1762; Nouveau trait des cinq
ordres d'architecture tant ancien que moderne [sic], ddi llecteur de Cologne, Paris, Mondhare,
1766 ; Nouveau trait d'architecture comprenant les cinq ordres des anciens tablis dans une juste
proportion entre eux avec un sixime ordre nomm ordre franois, Paris, Lambert et Delalain, 1768
(ouvrage remis en vente sous le mme titre chez Jombert en 1773); Trait darchitecture, comprenant
les cinq ordres des anciens, tablis dans une juste proportion entre eux, Paris, lauteur, 1782.
13 Minute manuscrite dun courrier conserve au Centre canadien darchitecture de Montral: Dossier
Architecture franaise: Lettres et documents 1776-1819, CAGE PO 11694.
14 Raymond LUCOTTE, Le Vignole moderne ou Trait lmentaire d'architecture, Paris, Le Pre et
Avaulez, 1772; Le Vignole moderne ou Trait lmentaire d'architecture, IIe Partie o sont expliqus
les accessoires aux ordres de J.B. de Vignole, Paris, Campions, 1781; Le Vignole moderne ou Trait
lmentaire d'Architecture, IIIe partie, o sont expliqus les principes et la manire d'appliquer aux
difices les cinq ordres de J.B. de Vignole, Paris, Campions, 1784.
Collections lectroniques de l'INHA
14
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
15 Pierre PANSERON, lments d'architecture ddis Monsieur de Sartine. Premire [Seconde,
Troisime] partie..., Paris, l'auteur et Desnos, 1772-1773-1776, 3part. en 3vol,petit in-4o; 28p. (dont
la page de titre imprime la date de 1776), 16pl. laves et rehausses, 28pl. (Recueils des profils),
28pl. (2me et dernier cayer des profils darchitecture), [2] f. (catalogue); 22p., 14pl., [1] f. blanc, 7
cahiers de 6pl. lavs (Pendentifs, Trophes militaires, Attributs de guerre, Bas-reliefs du Louvre, Vases,
Attributs de chasse, Cartouches); 110p., 38pl., 6pl. (cahier de portes), 6pl. (cahier dglises), reli
avec les Mmoire sur lhtel Dieu, 17-[1]p., 1pl. dpl.; [2] f. (catalogue). Louvrage est paru sous la
forme de multiples parties spares vendues isolment. Aussi la composition des exemplaires varie.
16 Ibid., 3epart., pl.13.
17 Vincenzo SCAMOZZI, Idea della architettura universale di Vincenzo Scamozzi, architetto veneto.
Divisa in X libri. Parte prima [seconda], Venise, Giorgio Valentino, 1615.
18 J[ean?] MICHELINOT et Jean-Michel MOREAU, Rgle des cinq ordres d'architecture selon Jacques
Barrozzi de Vignole, dessine et grave par J.Michelinot, Paris, Jean, 1800-1806.
19 Athanase DTOURNELLE, Nouveau Vignole au trait ou lmens des ordres par Dtournelle. Ce petit
trait contenant 20 planches, grd in-4 est mis le plus possible porte de l'intelligence de ceux qui
commencent et des ouvriers en btiment, qui veulent avoir une ide exacte des ordres: aprs l'avoir
tudi on pourra mieux concevoir les ouvrages plus importants qui traitent des nombreuses parties de
la science de l'architecture, laquelle il peut servir d'Introduction, Paris, lauteur, 1804.
20 Jacques Franois BLONDEL et Pierre PATTE, Cours darchitecture,op. cit. n.7, t.I, p.217.
21 Julien David LE ROY, Les Ruines des plus beaux monuments de la Grce considres du ct de
lhistoire et du ct de larchitecture, Paris/Amsterdam, Gurin et Delatour/Nyon, 1758.
22 James STUART et Nicholas REVETT, The Antiquities of Athen; And Other Monuments of Greece: As
Measured And Delineated By, Londres, printed by John Haberkorn, 1762-1794.
23 Claude Mathieu DELAGARDETTE, Reglas de los cinco Ordenes de arquitectura de Vignola. Con un
orden dorico de Posidonia, y un appendice que contienne las lecciones elementales de las sombras en
la Arquitectura, demostradas por principios naturales. Por C.M.Delagardette, Arquitecto discipulo
de la Real Academia de Arquitectura de Paris. Dibuxado en mayor tamao, y grabado al agua fuerte
por Don Fausto Martinez de la Torre, y concluido a buril por Don Joseph Asensio, discipulos de la
Real Academia de San Fernando, Madrid, Manuel Gonzalez, 1792. Un exemplaire numris de cette
premire dition espagnole est en ligne sur le site de luniversit de Heidelberg. Un exemplaire de la
seconde dition, publie en 1843, est conserv la bibliothque nationale de Madrid: voir Florentino
ZAMORA LUCAS et Eduardo PONCE DE LEON, Bibliografia Espaola (1526-1850), Madrid, Asociacion
de libreros y amigos del libro, 1947, notice269.
24 Claude Mathieu DELAGARDETTE, Rgle des cinq ordres darchitecture de Vignole Nouvelle dition,
Paris, Jean, 1823, p.19.
25 Claude Mathieu DELAGARDETTE, Les Ruines de Paestum ou Posidonia, ancienne ville de la Grande
Grce, vingt-deux lieues de Naples, dans le golfe de Salerne, Paris, lauteur, 1799.
26 Ibid., pl.29 et 30.
27 Charles NORMAND, Nouveau parallle des ordres d'architecture des grecs et des romains et des
autheurs modernes..., Paris, lauteur de limprimerie Pillet, 1819.
28 Roland FRART DE CHAMBRAY, Parallle de l'architecture antique et de la moderne: avec un recueil
des dix principaux autheurs qui ont crit des cinq ordres ; savoir, Palladio et Scamozzi, Serlio et
Vignola, D.Barbaro et Cataneo, L.B.Alberti et Viola, Bullant et de Lorme comparez entre eux, Paris,
Edme Martin, 1650.
29 Jean Nicolas Louis DURAND, Recueil et parallle des difices en tout genre, anciens et modernes,
remarquables par leur beaut, par leur grandeur ou par leur singularit et dessins sur une mme
chelle, Paris, lauteur/Impr. de Gill fils, 1801.
30 Charles NORMAND, Nouveau parallle des ordres d'architecture,op. cit. n.27, p.[iii]-iv.
31 Voir notamment les introductions dans Charles PERCIER, Pierre-Franois-Lonard FONTAINE etJeanPhilippe GARRIC, Palais de Rome. Palais, maisons et autres difices modernes dessins Rome (rdition
de lexemplaire aquarell de la collection Jacques Doucet),Wavre, Mardaga/Institut national dhistoire
de lart, 2008; et dans Id., Villas de Rome, dans le Choix des plus clbres maisons de plaisance de
Rome et de ses environs, (rdition intgrale de ldition de 1809), Wavre, Mardaga, 2007.
32 [Charles PERCIER, Pierre FONTAINE, Claude BERNIER et Lon DUFOURNY], Palais, maisons et autres
difices modernes dessins Rome, Paris, les auteurs de limpr. Ducamps, 1798.
33 Charles PERCIER, Pierre FONTAINE [et Pierre BONNARD], Choix des plus clbres maisons de
plaisance de Rome et de ses environs, mesures et dessines, Paris, Pierre Didot lan, 1809-[1813].
34 Charles douard JEANNERET, dit LE CORBUSIER, Le Modulor, Boulogne, ditions de larchitecture
daujourdhui, 1950; Le Modulor 2, Boulogne, ditions de larchitecture daujourdhui, 1950.
Collections lectroniques de l'INHA
15
Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle
35 Auguste ANCELET, Rome. Fragments antiques , dans Hector DESPOUY (d.), Fragments
darchitecture antique [du Moyen ge et de la Renaissance] d'aprs les relevs et restaurations des
anciens pensionnaires de l'Acadmie de France Rome, vol.I, Paris, Massin, [1905], pl.33.
36 Louis Jean HULOT, Fragments antiques, Socit des architectes diplms par le gouvernement,
LArchitecte. Revue mensuelle de lart architectural, vol.I, Paris, Librairie centrale des beaux-arts, 1906,
pl.1.
Pour citer cet article
Rfrence lectronique
Jean-Philippe Garric, Dcadence de la thorie des ordres la fin du XVIIIesicle,inArchitecture et
thorie. Lhritage de la Renaissance (Actes de colloques) [En ligne], mis en ligne le 28 septembre
2015, consult le 02 octobre 2015. URL: http://inha.revues.org/3399
propos de lauteur
Jean-Philippe Garric
Historien de larchitecture, architecte de formation, ancien pensionnaire de la Villa Mdicis.
Jean-Philippe Garric est actuellement Conseiller scientifique lInstitut national dhistoire de lart
et enseignant lcole national suprieure darchitecture de Paris-Belleville. Ses travaux personnels
portent sur larchitecture franaise au dbut de la priode contemporaine, en particulier sur le livre
et la thorie de larchitecture, les architectes Charles Percier et Pierre Fontaine, lenseignement de
larchitecture et larchitecture rurale. Il a notamment publi Recueils dItalie. Les modles italiens
dans les livres darchitecture franais (Mardaga, 2002) et rcemment les actes du colloque Le livre et
larchitecte (ENSA Paris-Belleville/INHA, 2011), avec E.dOrgeix et E.Thibault.
Droits dauteur
Tous droits rservs
Collections lectroniques de l'INHA
16
Vous aimerez peut-être aussi
- ME aW5QGxDocument30 pagesME aW5QGxAlfredho Shactar0% (1)
- Les Anormaux Michel FoucaultDocument230 pagesLes Anormaux Michel FoucaultÉric Zuliani100% (7)
- Ccna 1 Chapitre 2 v5 Francais PDFDocument9 pagesCcna 1 Chapitre 2 v5 Francais PDFAnonymous TlKZ18eLq0% (1)
- TP2 TérminéDocument20 pagesTP2 TérminéKhadija DaouanePas encore d'évaluation
- Motivation 2Document5 pagesMotivation 2Joël FafaPas encore d'évaluation
- TP Échangeurs de ChaleurDocument7 pagesTP Échangeurs de Chaleurikrambella81Pas encore d'évaluation
- La Roue Du TempsDocument39 pagesLa Roue Du Tempszenmaster95000100% (1)
- Histoire de ToyotaDocument28 pagesHistoire de ToyotacherifPas encore d'évaluation
- Ecriture Feminines Algerienne de Langue Francaise 1980-1997 - Esma Lamia AZZOUZDocument420 pagesEcriture Feminines Algerienne de Langue Francaise 1980-1997 - Esma Lamia AZZOUZBaya Miloudi100% (1)
- Nos Ank II Nav Mar 1881Document152 pagesNos Ank II Nav Mar 1881Kocam GamhaPas encore d'évaluation
- 4 GéoreferencementDocument27 pages4 GéoreferencementOthman EsrPas encore d'évaluation
- BigonoffDocument202 pagesBigonoffjimbassPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument16 pagesIntroductiontakichelseaPas encore d'évaluation
- La Question de La Subjectivité P GuenanciaDocument17 pagesLa Question de La Subjectivité P Guenanciajlassi-tPas encore d'évaluation
- Mayotte Bollack Momen Mutatum (La Déviation Et Le Plaisir, Lucrèce, II, 184-293)Document52 pagesMayotte Bollack Momen Mutatum (La Déviation Et Le Plaisir, Lucrèce, II, 184-293)josé macedoPas encore d'évaluation
- ( Maths, Informatique, Jeux - Cours de Programmation Pour Débutant - (En BASIC - ) )Document8 pages( Maths, Informatique, Jeux - Cours de Programmation Pour Débutant - (En BASIC - ) )Mohammed Adile NajemPas encore d'évaluation
- Niveau1 LAGDocument4 pagesNiveau1 LAGImed LeGrandPas encore d'évaluation
- Fiche BilanDocument2 pagesFiche BilantopazePas encore d'évaluation
- Cticm Cmi 01 2018Document44 pagesCticm Cmi 01 2018Brice Patrice GollyPas encore d'évaluation
- Prise Charge Sepsis Sur PTGDocument54 pagesPrise Charge Sepsis Sur PTGFanaru PetricaPas encore d'évaluation
- Système Temps ReelDocument32 pagesSystème Temps ReelMohamed Taher JbeliPas encore d'évaluation
- 02 Cour ANARIS TMSDocument23 pages02 Cour ANARIS TMSSõlã KhedPas encore d'évaluation
- V-10ef-R1 Volume Correction Factors To 15c For EthanolDocument22 pagesV-10ef-R1 Volume Correction Factors To 15c For EthanolRene ParedesPas encore d'évaluation
- Procedure de Gestion Du Materiel ITDocument3 pagesProcedure de Gestion Du Materiel ITmermoz konanPas encore d'évaluation
- Universite M'Hamed Bougara de Boumerdes Faculté Des Science de L'ingénieurDocument8 pagesUniversite M'Hamed Bougara de Boumerdes Faculté Des Science de L'ingénieurmoussouni ayoubPas encore d'évaluation
- Théorème de La Limite CentraleDocument3 pagesThéorème de La Limite CentralemamoudoubalPas encore d'évaluation
- Fonderie Cours Trace Des Bruts Et Conception Du MouleDocument20 pagesFonderie Cours Trace Des Bruts Et Conception Du MouleEdgard Varela EspinozaPas encore d'évaluation
- Charte Graphique CouleursDocument2 pagesCharte Graphique CouleursSabri KaddourPas encore d'évaluation
- Parement de Qualite v23 0905Document40 pagesParement de Qualite v23 0905SAR57Pas encore d'évaluation
- BIBO007 Formation Business Object Designer Xi 3 PDFDocument2 pagesBIBO007 Formation Business Object Designer Xi 3 PDFCertyouFormationPas encore d'évaluation