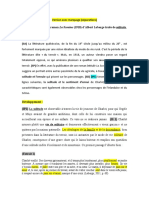Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Françoise Choay-Genealogias Del Urbanismo Europeo
Françoise Choay-Genealogias Del Urbanismo Europeo
Transféré par
Alexis GonzalezCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Françoise Choay-Genealogias Del Urbanismo Europeo
Françoise Choay-Genealogias Del Urbanismo Europeo
Transféré par
Alexis GonzalezDroits d'auteur :
Formats disponibles
Editions Esprit
[Introduction]
Source: Esprit, No. 318 (10) (Octobre 2005), pp. 53-56
Published by: Editions Esprit
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/24470111
Accessed: 06-03-2016 01:29 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Editions Esprit is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Esprit.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 128.111.121.42 on Sun, 06 Mar 2016 01:29:35 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
L'ARCHITECTURE
ET L'ESPRIT DE L'URBANISME EUROPEN
1. Autour de Franoise Choay.
Gnalogies de l'urbanisme europen
Le NOLOGISME urbanizacion, un terme qui renvoie l'ide d'une
science de l'organisation des espaces dans les villes, a t de facto
cr par Ildefonso Cerd en 18671. Si cette invention ne doit pas faire
oublier le caractre plus ancien des pratiques lies l'urbanisme,
encore faut-il en prciser la gnalogie. Alors qu'on crit des histoires
de l'urbanisme impliquant les Grecs ou les Romains, la naissance de
l'urbanisme, en tant que concept fondateur, doit tre date avec prci
sion. Selon Franoise Choay, on ne trouve avant la Renaissance
aucune socit o la production de l'espace bti relve d'une discipline
rflexive autonome2 . C'est dans le De re aedificatoria de Leon Battis
ta Alberti, en 1452, que l'art d'difier est prsent comme une
discipline , comme un savoir reposant sur des principes et des rgles
scientifiques3.
Le De re aedificatoria labore rationnellement, partir d'un petit
nombre de principes et d'axiomes, un ensemble de rgles devant per
mettre l'dification de tout projet d'espace imaginable et ralisable4.
Cette discipline rgle ne concerne pas seulement la construction de
btiments, isols ou non, mais
l'ensemble du cadre de vie des humains, depuis le paysage rural, les
routes et les ports jusqu' la ville, ses difices publics et privs, ses
places, ses jardins5.
Inventeur du mot urbanizacion, Cerd affirme, quatre sicles plus tard,
que la thorie obit des principes immuables et des rgles fixes .
1. Voir la Thorie gnrale de l'urbanisation, prsente et adapte par Antonio Lopez de
Aberasturi, Paris, Le Seuil, 1979.
2. Franoise Choay, Urbanisme , dans Franoise Choay et Pierre Merlin (sous la dir. de),
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'amnagement, Paris, PUF, 1996.
3. Leon Battista Alberti, l'Art d'difier (texte trad, du latin, prsent et annot par Pierre
Caye et Franoise Choay), Paris, Le Seuil, coll. Sources du savoir , 2004.
4. F. Choay, Urbanisme. Thories et ralisations , Encyclopaedia universalis, Paris, 2004.
5. Ibid.
ESfRIT 53 Octobre 2005
This content downloaded from 128.111.121.42 on Sun, 06 Mar 2016 01:29:35 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Autour de Franoise Choay. Gnalogies de l'urbanisme europen
S'il est gnralement considr de ce fait comme l'hritier d'Alberti,
l'homme de la Renaissance et l'inventeur de la perspective avec Brunel
leschi, trois diffrences mritent d'tre soulignes : les critres retenus,
la diffrence de contexte historique (la Renaissance et la socit indus
trielle son apoge) et les liens avec la tradition utopique.
Une premire diffrence rside dans les approches des deux auteurs.
Alors qu'Alberti envisageait l'dification en fonction de trois critres
- la ncessit (les lois de la physique applique), la commodit (le res
pect dialogique de l'exigence du client, qui fait de l'dification une
activit duelle) et le plaisir esthtique qui est la finalit suprme de
l'art d'difier -, Cerd retient seulement le terme ncessit , celui
qui renvoie directement aux lois et aux rgles, relguant ainsi l'exi
gence du client, la finalit esthtique, c'est--dire le critre de la com
modit qui invite un dialogue entre l'architecte et le destinataire de
l'espace bti.
L'urbanisme cerdien ne reconnat pas ce caractre dialogique qui intro
duit la contingence dans l'dification. Au contraire, il postule que ses
lois sont scientifiques et qu' l'instar de toutes celles des sciences de la
nature, elles sont dotes d'une valeur universelle de vrit et ne peuvent
tre mises en question6.
La deuxime diffrence rside dans le dcalage historique entre l'ur
banisme de Cerd et la rvolution industrielle. Sur ce plan, il est moins
l'hritier d'Alberti que d'Haussmann dont il admire les grands travaux,
qui ont dur de 1853 1869. Mme s'il a pris l'initiative du premier
plan tabli pour Paris, Haussmann ne considre pas la ville comme une
totalit et il ne s'inquite pas d'imaginer, ce que font les urbanistes, des
villes spcifiques. Son souci principal est de rgulariser la ville, un
verbe qu'il affectionne. Mais cette entreprise de rgularisation s'ins
crit spcifiquement dans le cadre d'une socit industrielle dont le corps
malade exige un urbanisme chirurgical. Consquence d'une volont
ancienne de penser les rgles et les principes de l'art d'difier un
ensemble, la naissance de l'urbanisme dcoule aussi de l'industrialisa
tion qui transforme la ville en un ensemble de rseaux interconnects
(voies de circulation, systme d'adduction d'eau, gouts). Si la mon
dialisation contemporaine peut donner l'impression de substituer un
monde des rseaux au monde de la ville classique, l'urbanisme hauss
mannien traduit dj ces mutations dcisives en valorisant express
ment les flux. La ville est alors perue comme un ensemble aux lois
complexes qui ne relvent plus du seul trait d'architecture.
Si Cerd fait cho la fois Alberti et Haussmann, si le caractre
scientifique de sa dmarche est patent comme son souci de ne pas
confondre trait d'urbanisme et trait d'architecture, il est aussi l'hri
6. F. Choay, Urbanisme , dans Dictionnaire de l'urbanisme et de l'amnagement, op. cit.
54
This content downloaded from 128.111.121.42 on Sun, 06 Mar 2016 01:29:35 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Autour de Franoise Choay. Gnalogies de l'urbanisme europen
tier d'une tradition utopique dont l'urbanisme progressiste du dbut du
XXe sicle est l'aboutissement. En cela rside la troisime diffrence:
l'urbanisme europen et occidental est impensable sans la matrice uto
pique qui, labore vers la Renaissance, a port sur l'art d'difier des
ensembles urbains. Le comprendre exige de mettre en rapport le Trait
d'Alberti de 1452 et Utopia, l'ouvrage de Thomas More qui date de
1516 c'est--dire de privilgier simultanment l'ide d'un bon espace,
l'espace difi selon les rgles, et celle d'un espace qui n'existe pas, l'es
pace utopique du nowhere de William Morris. Alors que l'le d'Utopie
comporte cinquante-quatre villes dans le rcit de Thomas More, et que
ces villes se ressemblent toutes, la matrice utopique se dfinit comme la
double volont d'adopter les rgles d'une discipline (Cerdd ) et de rgu
lariser un espace (Haussmann). La configuration urbaine, dcrite par
Franoise Choay dans la Rgle et le modle, renvoie d'un ct la
rgle de l'architecte et de l'autre au modle utopique. Ce double
mouvement caractrise d'emble le devenir d'un urbanisme qui, mme
s'il n'existe pas en tant que tel la Renaissance, donne lieu une
grande diversit d'applications historiques du modle initial. Le
modle utopique de l'urbanisme lui confre une capacit d'universali
sation qui ignore les spcificits culturelles, ce dont tmoignent les ra
lisations de Le Corbusier en Inde, dont l'exemple le plus connu est celui
de Chandahar dans le Pendjab7. Les deux traditions apparemment les
plus opposes de l'urbanisme, la tradition progressiste des Ciam et la
tradition culturaliste des cits-jardins d'Ebenezer Howard (qui publie
Garden-Cities of To-Morrow en 1898), relvent ainsi de ce modle
qui s'oriente dans deux directions fondamentales du temps, le pass et
le futur, pour prendre les figures de la nostalgie ou du progressisme8 .
De mme la distinction entre un urbanisme pragmatique et sans pr
tention scientifique et un urbanisme scientifique remontant aux
grands travaux d'Haussmann est seconde par rapport la dpen
dance de ces deux urbanismes envers la matrice commune qui associe
la rgle architecturale et le modle utopique. Avant que Paris se plie
aux contraintes de l'haussmannisme, Hugo rve encore la ville uto
pique, Paris comme capitale de l'Europe :
Avant d'avoir son peuple, l'Europe a sa ville. De ce peuple qui n'existe
pas encore, la capitale existe dj. Cela semble un prodige, c'est une
loi9.
Magnifique aveu de l'utopiste, crer l'espace qui rendra possible la
naissance d'un peuple qui n'existe pas encore !
7. Pour une approche mesure du parcours chaotique et contradictoire de Le Corbusier,
voir les pages que lui consacre Jean-Michel Leniaud, dans les Btisseurs d'avenir. Portraits
d'architectes. XIXe, XXe sicle (Paris, Fayard, 1998). Sur Le Corbusier, ce grand admirateur du
Parthnon athnien (ce monument qui condense la cit en lui-mme), voir p. 323-389.
8. F. Choay, Urbanisme, utopies et ralits, Paris, Le Seuil, coll. Point Essais , 1979, p. 15.
9. Victor Hugo, Paris (1867).
55
This content downloaded from 128.111.121.42 on Sun, 06 Mar 2016 01:29:35 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Autour de Franoise Choay. Gnalogies de l'urbanisme europen
Suscite par la parution rcente de la traduction de l'Art d'difier de
Leon Battista Alberti (auquel Olivier Remaud consacre un article), la
premire partie de ce dossier est un hommage l'uvre majeure de
Franoise Choay. Cotraductrice du livre d'Alberti, elle avait soulign le
rle de celui-ci et de Thomas More dans la gnalogie de l'urbanisme et
de l'architecture europens. Mais ici, grce un entretien et un texte
original sur l'utopie, d'autres figures sont voques, parmi lesquelles
Haussmann, Cerd , Giovannoni et Magnaghi, auteurs de rfrence qui
ont fait l'objet de travaux de sa part. Autant de penseurs et de praticiens
qui soulignent le caractre anthropologique de l'architecture et de l'ur
banisme.
Esprit
56
This content downloaded from 128.111.121.42 on Sun, 06 Mar 2016 01:29:35 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Vous aimerez peut-être aussi
- Modele La Scouine 1 1Document6 pagesModele La Scouine 1 1RenadexPas encore d'évaluation
- Comment Enseigner en Petite Section, Hachette, 2008Document228 pagesComment Enseigner en Petite Section, Hachette, 2008Laureen Hicquet100% (2)
- Disco Inferno Score and Parts PDFDocument27 pagesDisco Inferno Score and Parts PDFPawel JedrzejewskiPas encore d'évaluation
- 25 Colas PDFDocument1 page25 Colas PDFNizarRahhaouiPas encore d'évaluation
- Roughs D'architecture InrerieureDocument17 pagesRoughs D'architecture InrerieureSophie RoussetPas encore d'évaluation
- Atelier ChansonsDocument5 pagesAtelier Chansonsiuliaeu100% (1)
- Biblio Grit 02Document47 pagesBiblio Grit 02Mourad BelhajPas encore d'évaluation
- TP Analyse Porte PieceDocument12 pagesTP Analyse Porte PieceSeif HabbachiPas encore d'évaluation
- Copie de VENUS ANADYOMENEDocument4 pagesCopie de VENUS ANADYOMENEIvoPas encore d'évaluation
- Butor Sur PousseurDocument6 pagesButor Sur Pousseurmauricio_bonisPas encore d'évaluation
- 02 Tougourt02Document3 pages02 Tougourt02civilndPas encore d'évaluation
- Utilisation de Gimp Exercices PDFDocument18 pagesUtilisation de Gimp Exercices PDFQuentin RuidePas encore d'évaluation
- BePersonal VenetaCucine-1Document51 pagesBePersonal VenetaCucine-1Aala-addine El BaghdadiPas encore d'évaluation
- Fiche Tech Peinture Sur Ouvrage Bois UNIWOOD ACRYL OPAQUE (225) FTDocument3 pagesFiche Tech Peinture Sur Ouvrage Bois UNIWOOD ACRYL OPAQUE (225) FTFlavien Mesbah-SavelPas encore d'évaluation
- IMSLP358355-PMLP21377-Gluck Mandozzi Melodie VC KL H Moll - Violoncello PDFDocument1 pageIMSLP358355-PMLP21377-Gluck Mandozzi Melodie VC KL H Moll - Violoncello PDFSurya RPas encore d'évaluation
- L'éducation Corporelle Dans L'enseignement de La RythmiqueDocument77 pagesL'éducation Corporelle Dans L'enseignement de La RythmiqueEliton PereiraPas encore d'évaluation
- Aragon Drieu°Document15 pagesAragon Drieu°andrés moraPas encore d'évaluation
- Module de Formation Machine MPM & Indicateurs de PerformanceDocument32 pagesModule de Formation Machine MPM & Indicateurs de Performanceachref jebaliPas encore d'évaluation
- Examen A1Document5 pagesExamen A1prof.margo.rayPas encore d'évaluation
- LeCid Sequence 4eDocument14 pagesLeCid Sequence 4ePapa SarrPas encore d'évaluation
- 53 Histoires Pour EnfantDocument84 pages53 Histoires Pour Enfantdjsopem musiques & arts art-techPas encore d'évaluation
- B.P.U #Désignation Des Ouvrages U Prix Unitaires Travaux Préparatoires Et ObligatoiresDocument18 pagesB.P.U #Désignation Des Ouvrages U Prix Unitaires Travaux Préparatoires Et ObligatoiresoussamaPas encore d'évaluation
- Dossier - de - Presse - Yves - Klein - Intime 2Document35 pagesDossier - de - Presse - Yves - Klein - Intime 2Jean-Pierre MarcosPas encore d'évaluation
- UntitledDocument60 pagesUntitledmon fourretoutPas encore d'évaluation
- Consignes de Mise en PageDocument21 pagesConsignes de Mise en PagepatorrusoPas encore d'évaluation
- Le Théâtre - Vivant EssaDocument447 pagesLe Théâtre - Vivant EssaRafael PrudencioPas encore d'évaluation
- Adverb EsDocument2 pagesAdverb EsJorge Manuel Alves TeixeiraPas encore d'évaluation
- Mémoire m2 Anne-Laure MarandinDocument215 pagesMémoire m2 Anne-Laure MarandinAnnelauremarandinPas encore d'évaluation
- 3 Stylo ArtisanDocument2 pages3 Stylo ArtisanGustavo RuizPas encore d'évaluation
- A2 Décrire Un Produit Dameublement ÉtudiantDocument9 pagesA2 Décrire Un Produit Dameublement ÉtudiantElena Prado SilvaPas encore d'évaluation