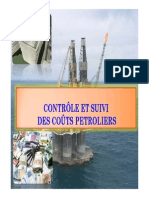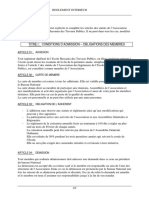Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Au Conflit de Deux Libertés - Bernard Gibaud
Transféré par
dmp77120 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
156 vues170 pagesTitre original
Au conflit de deux libertés - Bernard Gibaud
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
156 vues170 pagesAu Conflit de Deux Libertés - Bernard Gibaud
Transféré par
dmp7712Droits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 170
Bernard GmAUD
RVOLUTION ET DROIT D'ASSOCIATION
AU CONFLIT DE
,
DEUX LIBERTES
Prface de Michel VOVELLE
Paris, Mutualit Franaise 1989
~ A U T t
FRANAISE
REMERCIEMENTS
Je remercie Jean Bennet pour l'inestimable documenta-
tion, fruit de quarante annes de recherche au service de
l'histoire de la mutualit, qu'il a bien voulu me confier.
Je remercie Franois Hincker pour ses prcieuses et ami-
cales remarques sur les aspects gnraux de l'histoire de la
Rvolution franaise. .
Je remercie Chantal Castel, Antoine Capell et Michel
Dreyfus pour leur indfectible soutien.
Couverture : Gravure satirique ayant pour cible Le Chapelier. Le biribi, quivalent du
loto classique, est le jeu d'argent le plus rpandu la fin du XVIIIe sicle. Le surnom de
Chapelier-Biribi a t lanc par Marat dans l'Ami du peuple .
Lgende de la gravure : Toi qui portas les premires atteintes la franchise de la presse
et chtras impitoyablement la constitution, le signe de la rprobation est sur ton front;
partout sur ton passage on te montrera du doigt en disant : voii Chapelier, ce dput
breton, qui mit ses pieds le bonnet de la libert .
4
TABLE DES MATIRES
Prface 7
Introduction 9
Chapitre 1
Sous le rgime ancien de la coercition 13
Chapitre II
L'association en chantier 41
Chapitre III
La cassure 63
Chapitre IV
Le despotisme du contrat 79
Chapitre V
Le trou noir 99
Chapitre VI
La protection une affaire d'Etat 119
Conclusion
L'effet Le Chapelier 145
Liste des travaux cits 153
Index des noms des personnes cites 161
5
PRFACE
L 'histoire sociale de la Rvolution Franaise que certains
disent puise est encore un terrain fcond, et ce livre en
tmoigne.
Bernard Gibaud y fait rhistoire du droit d'association
sociale sous la Rvolution. On pouvait croire la question
rgle: en 1791, les fameuses lois d'Allarde et Le Chapelier
n'ont-elles pas tu ce droit pour un sicle? Mais rauteur
prouve qu'i! y a encore beaucoup chercher, trouver et
rflchir sur le pourquoi de cette idologie antiassocia-
tive qui semble si unanimement partage, et qui aura une
vie si longue que la libert d'association sera la dernire des
grandes liberts rpublicaines entrer dans le droit (1901,
vingt ans aprs la libert de la presse, les liberts commu-
nales, les lois scolaires ... ) : hantise de la reconstitution des
corps , hantise de la rupture de runit de la nation, reli-
gion du contrat, tel fut, me semble-t-il, le fonds des argu-
ments utiliss.
Mais, plus encore, il convient de s'interroger sur le
comment , entendons sur le droulement du combat
entre adversaires et partisans de l' association. Car des parti-
sans, il y en eut, chez les salaris eux-mmes. En effet, une
ralit salariale, dj relativement moderne, tait plus pr-
sente, au moins dans les grandes villes, la fin du XVIIIe
sicle, qu'on ne le pense gnralement. Comme d'autres
chercheurs, propos de l'affaire Rveillon ou des femmes
ouvrires parisiennes, Bernard Gibaud a rencontr cette ra-
lit. Il produit un impressionnant corpus de libelles
changs - et un haut niveau d'argumentation - entre
patrons et ouvriers pendant les mois qui ont prcd le vote
de la loi Le Chapelier. Les deux camps s'appuient sur la
Dclaration des Droits de rHomme dont on mesure ainsi
rimmdiate oprativit et rimmdiate ambigut. A la
lumire de cette documentation indite, il ne sera plus pos-
sible dsormais de dire, comme Louis Blanc, que, sous la
7
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Rvolution Franaise, la voix des salaris ne faisait que
profrer des sons inarticuls .
L'auteur souligne d'autre part combien il serait inexact
d'attribuer le refus de l'association de la part des rvolu-
tionnaires une insensibilit bourgeoise l'gard de la
question sociale. L'argument vaut sans doute pour certains.
Mais on ne peut souponner un Robespierre, un Marat, ou
mme ces nobles libraux philanthropes, comme Clermont-
Tonnerre qui, le 27 aot 1789, proposait dj d'ajouter un
article la Dclaration des Droits de l'Homme sur le
droit des indigents aux secours . La vritable explication
est ailleurs, elle tient ce que les rvolutionnaires, toutes
tendances confondues, attribuent la Nation, donc l'Etat,
la responsabilit de la bienfaisance. Le malheur fut que le
temps et les moyens manqurent la ralisation de ces prin-
cipes, alors que la charit ecclsiastique et les associations
fraternelles de l'Ancien Rgime disparurent. Mais le prin-
cipe resta.
A cet investissement dans le tout politique, les sala-
ris eux-mmes ne furent pas insensibles, c'est le moins
qu'on puisse dire. On peut ainsi expliquer le peu de contes-
tations que suscita la loi Le Chapelier, une fois vote.
Mme si, Bernard Gibaud le montre, il y eut sur le terrain
des compromis avec la loi, des initiatives associatives de
type mutuelliste gnralement interprofessionnelles -
tout au moins se prsentaient-elles ainsi, pour tourner une
l(Ji condamnant les coalitions professionnelles.
Mais il est bien vrai qu'il y eut ainsi dsormais une spci-
ficit franaise du traitement de la question sociale. Cette
approche eut-elle un caractre positif ou ngatif? Ce n'est
peut-tre pas l'historien d'en juger.
Que Bernard Gibaud soit remerci d'avoir ainsi labour
un chantier qui, dcidment, est loin d'tre referm.
8
Michel V ovelle,
Prsident de la Commission Nationale
de Recherche Historique
pour le Bicentenaire de la Rvolution Franaise
INTRODUCTION
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Au conflit de deux liberts, la libert d'association
contre la libert du travail, l'arbitrage de la Constituante
fait prvaloir celle qui est la plus favorable la bour-
geoisie
Michel VOVELLE
(La chute de la Monarchie, 1787- 1792, p. 174)
La Rvolution franaise entretient des relations ambigus
avec le phnomne associatif. Les droits de l'homme et du
citoyen proclams en 1789, ont rapidement trouv les condi-
tions de leur exercice dans le cadre de clubs et de sections
populaires. Cette sociabilit indite a ouvert, temporaire-
ment, la cour des grands aux gens du peuple. Dans le
mme temps, la thologie individualiste des nouvelles lites
condamne sans appel le principe de l'association solidaire
entre gens de mtiers. Le schma alternatif d'une Rvolu-
tion libratrice pour les droits politiques et d'une Rvolu-
tion carcan pour les droits sociaux founirait- il la cl ?
La taille de l'vnement interdit de le rduire un choix
sommaire. Les hommes de la Rvolution ouvrent les nou-
veaux espaces politiques et sociaux, davantage par des che-
mins de traverse que par les voies royales. La gestation
tourmente de la nouvelle socit brouille le regard que por-
tent, deux sicles de distance, les acteurs de la vie associa-
tive sur l'uvre rvolutionnaire. La loi Le Chapelier est-
elle l'arbre qui cache la fort ou son symbole?
10
INTRODUCTION
L'influence exerce par le cours de la Rvolution sur le
destin de la mutualit et sur l'architecture du mouvement
social franais n'est gure contestable. Reste le plus diffi-
cile : dterminer la nature et le degr de cet ascendant, sans
jamais perdre de vue que le patrimoine de solidarit accu-
mul sous l'Ancien Rgime demeure vivace au cur des
mutations. Nous avons jug utile de parcourir, en guise de
prologue, les principales tapes de la prhistoire associative
et mutualiste.
La gense de la loi Le Chapelier, fil conducteur de notre
enqute, nous a conduit rejouer la dramatique du
printemps 1791, au cours de laquelle le sort de la libert
d'association est scell. Aveuglement de classe, triomphe de
l'individualisme libral, obsession du maintien de l'ordre,
les explications sont connues. Elles laissent subsister des
zones d'ombre sur le malentendu qui a spar compagnons,
matres et dputs de la Constituante. Aussi, avons-nous
tent d'tendre la recherche des facteurs explicatifs aux rf-
rences culturelles du temps.
Le rcit d'un interdit, lourd de consquence, ne referme
pas le dossier. Les ambitions sociales de la Rvolution,
l'closion de la prvoyance, la mtamorphose de la mde-
cine, produisent des effets de longue dure dans le champ
de l'association et de la solidarit. Ils ont leur place en con-
trepoint de notre chronique.
S'il a pu exister du fait de 1789 et surtout de 1793 une
exception franaise pour penser et pratiquer le plura-
lisme, la lgislation anti-associative en constitue l'expression
la plus tenace. Par cette restitution nous souhaitons rendre
plus claire, plus sereine la vision d'une page de l'histoire
rvolutionnaire, sujette aux a priori.
11
Chapitre 1
SOUS LE RGIME ANCIEN
DE LA COERCITION
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
L'entraide mutuelle est prsente ds l'aube de la civilisa-
tion. La technique spontane des origines s'est peu modifie
au cours des sicles. Il s'agit, toujours, pour les membres
d'une communaut de verser une part convenue de leurs
ressources dans le but d'aider, sous des formes galement
convenues, ceux des membres qui viendraient en avoir
besoin.
Si la mthode est demeure immuable, les motivations et
les objectifs ont vari selon l'identit des utilisateurs et les
circonstances de l'utilisation.
Un dtour par l'amont s'impose pour comprendre les
dcisions de la Rvolution concernant les associations de
solidarit. Tocqueville parat trop unilatral quand il dit des
Franais, qu'aprs avoir dtruit l'Ancien rgime, sans le
vouloir, ils s'taient servis de ses dbris pour construire
l'difice de la socit nouvelle (1). L'observation ne
manque pas de pertinence s'agissant des socits d'entraide.
Le survol de cet immense continent, n'est gure propice
l'ouverture des nombreux chantiers qui y demeurent inex-
ploits. Aussi nous sommes-nous borns reprer dans les
expriences du pass les rfrences qui ont pu nourrir cons-
ciemment ou inconsciemment les dcisions prises par les
hommes de la Rvolution. Nous aurons recours pour tenter
de dgager ces lignes de force aux travaux faisant autorit
sur le pass associatif. Seront particulirement mis contri-
bution, ceux de Maurice Agulhon, Jean Bennet, Emile Cor-
naert, Bronislav Geremek, William H. Sewell.
UNE FILIATION LOINTAINE
L'utilisation de techniques d'entraide caractre mutua-
liste est contemporaine des grandes socits de l'Antiquit.
La trace la plus ancienne de pratiques solidaires selon
L'encyclopdia universalis est celle des tailleurs de
pierre de la Basse-Egypte. Ils avaient constitu vers 1400
avant Jsus-Christ un fonds de secours en prvision des
accidents.
14
SOUS LE RGIME ANCIEN
Sur de telles distances, la reconstitution des faits mlent
invitablement histoire et mythologie. Jean Bennet (2) nous
a appris que les fameux Khasidens , ouvriers construc-
teurs du Temple de Salomon (1000 av. J.-C.), honors par
plusieurs gnrations de mutualistes comme leurs premiers
anctres, n'avaient probablement jamais exist que dans
l'imagination du dput ouvrier maon, Martin Nadaud. La
prsence de lgende n'est jamais fortuite. Si l'on pense,
avec Roland Barthe, que le mythe n'est ni un mensonge,
ni un aveu, c'est une rflexion; on peut penser sans
grand risque que la tradition d'entraide mutuelle est plu-
sieurs fois millnaire.
Elle jouit en tout cas d'une grande faveur dans les
socits grco-romaines. La description qu'en fait Tho-
phraste frappe par sa modernit : Il existait chez les ath-
niens et les autres tats de la Grce des associations ayant
bourse commune que leurs membres alimentaient par le
paiement d'une cotisation mensuelle. Le produit de ces coti-
sations tait destin donner des secours ceux qui avaient
t atteints par une adversit quelconque (3).
La motivation principale qui prside alors la constitu-
tion des groupements caractre mutualiste est moins la
protection de la vie que la prparation d'une bonne
mort . Ainsi les collges funraires romains assurent
comme l'indique leur nom une spulture pour leur membre.
Frle lot de fraternit dans un monde impitoyable pour les
faibles, les collges d'esclaves rpondent cette qute de
dignit. C'est afin d'viter de pourrir dans la fosse com-
mune qu'i/s se groupent et s'imposent une cotisation se
donnant la tranqui/lit d'esprit ncessaire, en sachant que
toutes les crmonies leur sont assures (4).
L'activit des associations d'entraide constitue d'emble
un enjeu social et politique. Rglements draconiens et inter-
dits sont prononcs par Jules Csar, Nron, Trajan (5). Sous
Auguste (25 av. J. C.) l'association non autorise est mme
assimile un dlit criminel. Quiconque tablit un collge
illicite est passible des mmes peines que ceux qui attaquent
main arme les lieux publics et les temples (6).
15
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
De l'Antiquit la fin de l'ancien rgime, l'histoire des
groupements d'entraide est en fait l'histoire d'une intermi-
nable coercition. Inoffensifs organismes de dfense crs,
presque toujours par les faibles, contre les alas de la
nature, ils peuvent devenir trs vite de redoutables instru-
ments, servant catalyser la force du nombre contre la
richesse et l'autorit.
Cette fonction instinctive de rsistance explique la
dfiance persistante qu'inspirent les associations de solida-
rit. Aprs l'avnement du christianisme la volont des pou-
voirs successifs de contrler ou d'interdire ces groupements
ne connat aucun flchissement.
LA RVOLUTION CULTURELLE CHRTIENNE
Ds ses origines, le christianisme enrichit la pratique du
mutualisme. Le message chrtien non seulement consacre et
divinise le travail mpris par les lites romaines, mais il
exalte l'galit et l'amour du semblable. Retenant la
forme des associations funraires, le christianisme les adap-
tera peu peu l'volution des murs, dans sa pntration
en terre paenne, et s'efforcera d'tendre l'esprit de pr-
voyance non seulement en vue des crmonies s'attachant
au dcs, mais galement en y introduisant la pratique de la
charit tous les moments de la vie (7) nous dit Jean
Bennet.
Aprs le IVe sicle et l'accession aux responsabilits poli-
tiques, l'Eglise tempre le caractre social des premires
communauts chrtiennes. Son intervention revt, ds lors,
les contradictions classiques d'une puissance spirituelle et
temporelle. Elle ne renonce pas, cependant, son interven-
tion en faveur des humbles.
A l'aube du moyen-ge, le patrimoine soli dari ste est pro-
fondment renouvel par l'apport chrtien. Le secours aux
pauvres est officialis par un capitulaire de 818 ordonnant
qu'un quart des dmes faites la paroisse lui soit consacr.
16
SOUS LE RGIME ANCIEN
La majeure partie des associations d'entraide, qui naissent
la fin du premier millnaire et au dbut du second sont
d'origine chrtienne. Les socits d'inspiration paenne
adoptent la conception chrtienne largie de la solidarit.
L'entraide ne vise plus essentiellement la prparation la
mort, mais la sauvegarde de la vie. L'effort solidaire est
dirig prioritairement vers les plus vulnrables. La sacralisa-
tion du travail, celui qui ne travaille pas ne doit pas
manger , dit St Paul, favorise la mise en place de rseaux
de solidarit dans les communauts de mtiers.
Les groupements vocation solidaire qui rassemblent
matres et ouvriers, ensemble ou sparment, se prsentent
selon les poques ou les pays sous des formes et des appella-
tions extrmement varies. On les nomme selon les circons-
tances: fraternits, charits, confrries, frairies, amitis,
hanses, ghildes, alliances, collges, etc. Les corps ou com-
munauts d'art et de mtier, les jurandes, appartiennent
galement bien que de faon spcifique, ces rseaux de
solidarit professionnelle.
L'usage du mot corporation pour dsigner l'organisation
conomique et juridique des mtiers, institu sous l'Ancien
rgime est, pour partie, anachronique. Selon Emile Cor-
naert (8), le terme emprunt aux britanniques n'est apparu
en France que dans la dernire partie du XVIIIe. Il ne sera
d'ailleurs pas employ dans les textes des lois Turgot et
d'Allarde supprimant les corps de mtiers. Nous conserve-
rons, cependant, le terme d'origine anglaise, pour la com-
modit de l'expos.
LES CORPORATIONS
L'articulation chronologique et fonctionnelle entre cor-
poration et confrrie, n'a pas encore livr tous ses mystres.
n n'est pas possible, aussi bien pour le moyen-ge que
pour les sicles suivants, de dcider par une rgle gnrale si
la forme religieuse des corporations a prcd leur forme
17
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
laque ou inversement mais presque toujours, l'une et
l'autre se sont associes trs tt quand elles n'taient pas
confondues l'origine (9).
Il reste qu'au fil du temps, une dissociation dans les fonc-
tions s'est produite. La corporation exprime les stratgies
conomiques et socio-politiques des communauts de
mtiers; la confrrie s'efforce de prendre en charge les
besoins individuels manant indissociablement de l'me et
du corps. Le caractre d'entraide mutualiste de la confrrie
a de puissants motifs pour s'affirmer, car la logique d'en-
treprise tend spontanment considrer les membres
improductifs (malades, infirmes ou uss) comme un han-
dicap pour la communaut. L'individu compte peu dans cet
univers rude et cloisonn.
Le grand dpart des corporations correspond la priode
qui s'ouvre vers l'an mil, la fin des invasions, dites bar-
bares . Une phase de stabilit favorable au commerce et
l'artisanat s'amorce. Les activits productives, qui s'taient
replies dans les domaines et les monastres, font retour
vers les villes.
L'organisation corporative s'impose au dtriment des pri-
vilges nobiliaires et cclsiastiques. Non seulement les cor-
porations et les confrries insufflent un rel dynamisme co-
nomique, mais elles contribuent galement former un
nouvel espace de libert appel un grand avenir : les fran-
chises communales. Dsintrt ou incapacit, les autorits
se contentent jusqu'au XVe sicle de surveiller distance et
d'homologuer, sauf cas d'exception, les dcisions prises par
les communauts. Mais au fur et mesure que s'affermit
l'Etat monarchique, l'intervention royale dans les mtiers se
fait plus pressante.
Louis XI, le premier, rige en communaut jure un
mtier libre (10). Ds cette poque les corporations devien-
nent, selon le mot de Cornaert, la chose du roi (11), au
point que ses chefs sont considrs comme des fonction-
naires tenus un devoir de loyaut politique envers l'auto-
rit. Colbert achve le processus d'intgration. A Paris le
nombre de corporations passe de 60 129 la fin du XVIIe.
18
SOUS LE RGIME ANCIEN
Les seigneurs hauts justiciers perdent le droit de rglementer
les mtiers installs dans leurs fiefs. Pour le pouvoir
monarchique, la corporation est d'abord un instrument de
prlvement fiscal (12). Le poids de cet assujettissement
tend, par voie de consquence, reposer sur les compa-
gnons. La seule issue pour rsister la pression rside dans
la force du nombre rassembl.
L'organisation corporative ne mconnait pas, initiale-
ment, les besoins sociaux. Les livres des mtiers , rdig
en 1268 par Etienne Boileau, prvt des marchands
indique : Le corps de mtier est une institution sociale ;
en consquence, rapprentissage ne doit pas tre seulement
lucratif pour le matre ; le valet ou le compagnon doit tre
trait selon les usages et de faon domestique (13).
Le souci d'assurer la subsistance de la main d' uvre
ouvrire existe, mais il s'inscrit dans des rapports de domes-
ticit. Le mot valet utilis pour dsigner le compagnon jus-
qu'aux XIVe et XVe sicles exprime cette position de dpen-
dance (14). Les relations de domesticit ne sont pas sens
unique. Elles procurent un toit au salari et le protgent
contre le flau du chmage.
Avec le gte, il bnficie galement du couvert. Paul
Chauvet rapporte les plaintes savoureuses des matres
imprimeurs parisiens contre leurs compagnons, qu'ils accu-
sent d'tre incroyablement exigeants en matire de
nourriture et de boissons. Le pain est toujours trop
noir , le vin trop vert , et les viandes jamais assez
bonnes (15). Ce qui n'empche nullement les compagnons
imprimeurs de rejeter la proposition des matres d'changer
cet avantage en nature contre une modeste augmentation de
la rtribution. Ils savent dj que les prix des denres grim-
pent gnralement plus vite que les salaires.
A la veille de la Rvolution le caractre domestique qui
s'attache au statut salarial sera loin d'avoir disparu des
mentalits. Ds les origines de l'organisation corporative les
compagnons ont pourtant tent de desserrer les carcans de
l'autorit par le moyen de l'association. A la diffrence des
corporations, qui bnficient d'une lgalit pleine et entire,
19
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
les confrries de mtiers sont prives de tout caractre licite,
hormis quelques brves priodes de tolrance.
LES CONFRRIES
On ne compte pas les dcisions de conciles et les dits de
souverains, qui ont condamn, dissout, saisi les biens des
ghildes et des confrries, qu'elles soient caractre profes-
sionnel ou strictement religieux, comme les confrries de
pnitents. Deux interdits sont particulirement exem-
plaires :
- Le concile d'Avignon proclame le 18 juin 1326, ...
En vertu de rautorit du prsent concile, nous prononons
la nullit, la dissolution et la rupture de tous les rassemble-
ments, alliances, socits, conjurations dites fraternits et
confrries fondes par les clercs ou les lacs ... (16).
- Franois 1
er
, le 25 aot 1539, pose l'un des plus
solides maillons de cette longue chane de coercition, par
l'ordonnance de Villers-Cotterts. Clbre pour la cration
de l'tat civil et l'obligation faite d'utiliser le franais dans
les actes officiels et de justice, l'ordonnance de Villers-Cot-
terts tablit durablement les bases juridiques de la rpres-
sion anti-associative. Dfendons tous les compagnons
de tous mtiers ... de ne faire aucun monopole et n'avoir ou
prendre aucune intelligence les uns et les autres du fait de
leur mtier, sous peine de confiscation de corps et de
biens.
La confrrie est particulirement suspecte car extrieure
au champ de l'autorit religieuse, monarchique et souvent
patronale. Association pieuse dirige par des lacs, elle
chappe en fait bien 'souvent aux pouvoirs civils et religieux.
La religion donne la forme, l'encadrement, plus que le
fonds et la substance , observe Maurice Agulhon (17).
La suspicion est systmatique ds qu'il est question
d'association. Au dbut du XVIIe sicle, un lieutenant du
roi prononce une rquisition contre un certain prtre,
20
SOUS LE RGIME ANCIEN
nomm Vincent, lequel sans communiquer aux officiers
royaux avait assembl et reu trois cents femmes ou environ
dans une confrrie laquelle il donne le nom de charit .
Ce dangereux suspect, Saint Vincent de Paul, devait aprs
cette admonestation rdiger le rglement de la confrrie en
ces termes : les dames auront pour maxime de ne pas
traiter dans leurs assembles des affaires particulires, ni
gnrales, notamment celles de rEtat (18).
Les activits d'entraide des confrries revtent des aspects
trs varis. Les cotisations prleves sous forme de qute
hebdomadaire ont pour objectif essentiel de prserver les
confrres et leur famille de la misre qu'occasionne invita-
blement la maladie et l'accident. Elles participent galement
aux funrailles, particulirement pour les plus dmunis.
Elles tiennent dans les hpitaux et les hospices des lits la
disposition des malades de la communaut, quand elles ne
grent pas elles-mmes leurs propres uvres sociales,
comme chez les orfvres parisiens. Certaines confrries,
pourvues de trsorerie relativement confortable, vont
jusqu' prter de l'argent pour faire face aux sinistres
causs par l'incendie ou l'inondation ou pour lancer une
entreprise familiale.
Au fil du temps une certaine baisse de ferveur reli-
gieuse, une certaine lacisation de l' ambiance politique, font
que vers la fin du XVIIIe sicle, l'aspect corporatif est plus
apparent dans -les textes que raspect mystique (19). Le
climat de tension qui s'instaure entre matres et ouvriers
participe la monte des proccupations profanes dans les
confrries de mtiers. Toute rvolution sociale dans
l'industrie franaise du xve au XVIe sicles avait abouti
expulser les ouvriers du gouvernement de la communaut,
devenue la chose des matres (20). Cette scission donne
naissance des formes autonomes d'organisation chez les
compagnons.
21
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
LE COMPAGNONNAGE
Les clivages qui gagnent les mtiers n'ont que partielle-
ment leur source dans les antagonismes internes. Ils rsul-
tent aussi des contraintes du cadre fodal. La pression fis-
cale monarchique sans cesse plus pesante, la transformation
lente mais continue du mode productif alimentent ces ten-
sions. Les matres renforcent le caractre rpressif des rgle-
ments en vigueur avec l'appui des autorits, notamment par
l'instauration d'un systme d'amendes, destin interdire le
travail libre de l'ouvrier. Aucun compagnon ne peut
quitter son matre sans un long pravis que ron essaye
d'allonger encore au XVIIIe sicle ... La pratique des
avances sur salaires rend le compagnon encore plus dpen-
dant (21).
La pomme de discorde la plus vive entre matres et com-
pagnons concerne l'accs la matrise. La ralisation du
chef d'uvre a perdu sa fonction initiale d'preuve pro-
batoire. La matrise tant convoite n'est plus accessible
qu'aux membres de la famille du matre. Aprs qu'un dit
ait limit trente-six les matres imprimeurs Paris en
1686, les compagnons protestent treize ans plus tard, car
pendant cette priode vingt-quatre fils de matres ont t
reus la matrise contre un seul compagnon (22).
Trs tt le conflit fait partie du paysage social. Une
ordonnance royale de 1330, fltrit en termes vifs ces
alliances ayant pour but d'obtenir des salaires levs (23).
La coercition ne parvient pas empcher les compagnons,
notamment dans les principaux mtiers: l'habillement,
l'alimentation et le btiment, de s'orienter vers cette
forme d'auto-dfense organise qui ne vise pas seulement
les employeurs, mais s'efforce de remdier la mauvaise
fortune, la misre, au chmage (24). Le compagnonnage
est n.
Le passage de la confrrie, rassemblant les ouvriers d'un
mme mtier au regroupement compagnonnique vocation
litiste demeure, aujourd'hui encore, largement inexpliqu.
La volont d'effacer toute filiation avec les formes associa-
22
SOUS LE RGIME ANCIEN
tives prexistantes apparat clairement dans le comporte-
ment des compagnons des diverses obdiences. D'o
l'importance du mythe d'une ascendance lie la construc-
tion du temple de Salomon ou aux btisseurs des cath-
drales du XIIIe sicle. Le plus ancien texte relatant les
thmes et les pratiques spcifiques du compagnonnage date,
semble-t-il, de la fin du XVe ou du dbut du XVIe (25).
A partir du XVIIe sicle dans les mtiers requrant une
qualification professionnelle leve, les compagnons s'assu-
rent, malgr les interdits et les sanctions, une certaine
matrise du march du travail. Au sicle suivant ils " con-
trlaient " plus de 30 % de la main d'uvre dans les trente
plus importants mtiers dont ils assuraient la prennit de la
qualit professionnelle (26).
Le mode d'action est moins la grve que la mise en
interdit de la boutique ou de l'choppe; dans le cas de con-
flits plus importants, on a recours la damnation de la
ville ; celle-ci voit alors disparatre la majeure partie des
ouvriers des mtiers. Cette forme de lutte extrme, relative-
ment exceptionnelle, est favorise par le caractre itinrant
de l'activit professionnelle du compagnon. Le Tour de
France ncessaire pour la transmission des connaissances
techniques, reprsente un cadre privilgi pour raliser
l'intgration sociale et culturelle des apprentis dans la
contre-socit compagnonnique.
Quelle que soit l'obdience, Devoir ou Gavot ,
l'association de compagnons constitue presque toujours,
aux yeux des autorits, une menace pour l'ordre public. En
1730 le Marquis de Castries, gouverneur royal de la ville de
Montpellier disqualifie l'action des compagnons menuisiers
et charpentiers de sa ville par un terme promu certain
avenir : ... par un abus punissable, ils ont entrepris de
faire un syndicat entre eux... de sorte que les voil les uns
syndiqus contre les autres ... (27).
L'entraide sans faille pour tous les membres du groupe
s'arrte strictement, aux limites de l'association compa-
gnonnique. Prfiguration des formes organises en milieu
professionnel, le compagnonnage est-il le dtachement pr-
23
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
curseur d'un monde ouvrier en gestation ? Emile Cornaert
ne le croit pas. Les compagnons spars de la masse par
rinitiation, formant un monde part... se considraient
comme une lite suprieure la foule. Ils n'exprimrent
jamais, sans doute n'prouvrent-ils jamais un sentiment de
classe au sens o nous rentendons aujourd'hui (28).
La solidarit plurifonctionnelle du compagnonnage, de
mme que l'activit de certaines confrries de mtiers en
faveur de l'entraide et de l'action collective, appartiennent
la tradition historique du mutualisme. Le rle actif et spec-
taculaire de ces groupements dans la dynamique des opposi-
tions sociales, ne doit pas faire cran aux autres sources de
la tradition solidaire.
Les socits qui se consacrent, pour des raisons diverses,
la seule organisation des secours contre les alas de la vie
constituent en raison de leur nombre et du patrimoine
d'expriences, la parent la plus proche des futures socits
de secours mutuels du XIXe sicle. Elles prsentent dj
nombre des traits de la mutualit moderne.
LES PIONNIERS DU MUTUALISME
L'essor des techniques d'entraide mutuelle est favoris
par le mouvement qui, depuis la Renaissance, porte l'huma-
nit vers les lumires . Un nouvel idal prend forme
dans lequel la destine humaine dpend moins de Dieu et
davantage de l'homme. L'ide-force exprime par Diderot:
L 'homme est le terme unique d'o il faut partir et auquel
il faut tout ramener , constitue le dnominateur commun
des profondes mutations en cours. Les besoins de l'individu
le plus dmuni ne sont pas seulement d'ordre physiologique.
L'homme du peuple se nourrit aussi de dignit.
A la faveur de cette lacisation la charit connat un dis-
crdit croissant. La vitalit dont fait preuve la solidarit de
type mutualiste contribue l'usure du modle caritatif.
L'entraide organise, phnomne minoritaire dans une
France massivement rurale, est prsente au cur des villes
24
SOUS LE RGIME ANCIEN
dans de nombreux mtiers. On recense au XVIIIe sicle un
nombre significatif d'associations solidaires qui procurent
leurs membres, matres et ouvriers, ensemble ou spar-
ment, des prestations caractre mutualiste.
Telle l'action des orfvres parisiens. Cette profession
assure, non seulement la couverture financire des cons-
quences de la maladie, mais elle cre dj les organismes,
qui prfigurent les uvres sociales du XXe sicle. Ayant
son propre H hpital ", sa chapelle, sa caisse de secours
exceptionnels (les aumnes) et de pensions, percevant tri-
mestriellement des cotisations de ses membres, recevant des
H subventions " (confiscations son profit, paves, etc .. . ),
plaant ses capitaux pour en distribuer les revenus aux
H pauvres et veuves ", tous les caractres d'une socit
mutualiste sont encore runis ici (29).
Chez les ouvriers imprimeurs, pionniers de la solidarit
professionnelle selon Paul Chauvet, l'organisation de
l'entraide ne passe pas par le fonctionnement d'une socit
de secours. Le matre imprimeur Momoro crit: Dans
rAncien rgime, on faisait la qute pour un compagnon
malade dans toutes les imprimeries ; cette qute se faisait
par deux ouvriers de l'imprimerie o travaillait le malade, et
ils devaient tenir un registre sign des protes de tout ce
qu'ils recevaient dans chaque inlprimerie. La Chambre Syn-
dicale donnait cette permission de qute, laquelle tait
signe des adjoints... (30).
Il arrive cependant que se constituent clandestinement des
assembles de charit entre ouvriers d'une mme impri-
merie, runissant trente quarante compagnons, dans le
but de compenser les pertes de salaires en cas de maladie.
Ces groupements sont considrs comme ... des cabales;
malgr cela il y en a plusieurs qui subsistent depuis long-
temps et qui ont actuellement des fonds assez hon-
ntes (31).
Les typographes strasbourgeois fondent en 1783 leur
caisse maladie-dcs, probablement l'une des premires,
sinon la premire mutuelle interprofessionnelle d'impri-
meurs. Cette socit est dfinie comme un lieu de refuge
25
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
pour tous ceux de nos confrres qui gmissent sous le poids
d'une maladie ou que l'ge a rendu caduques (32). Aprs
avoir soulign que les fonds de la caisse proviennent de
leurs maigres pargnes, ils s'adressent avec courtoisie
leurs trs honors Matres pour les inviter faire preuve
d'esprit philanthropique. Le principe de la participation
patronale la cotisation mutualiste est lanc.
La fondation en 1780 de la Bourse des malades et
infirmes de Saint-Laurent , qui prendra le nom au dbut
du XIXe sicle de socit de secours mutuels Panotech-
nique (interprofessionnelle), symbolise parfaitement le
mouvement de lacisation observe par Maurice Agulhon
dans les formes de sociabilit voue l'entraide la fin
de l'Ancien rgime. Cette mutuelle toujours en activit,
est ne classiquement de l'initiative d'une confrrie, la
Confrrie de la nativit de la Sainte-Vierge cre en
1720.
Si les statuts de la Bourse comportent une rfrence for-
melle la confession catholique, les premiers mots du rgle-
ment sont consacrs au caractre profane de ses buts :
Nous tous, intresss la dite socit tablie pour nous
soulager mutuellement dans nos maladies et infirmits, nous
engageons remplir le contenu de nos rglements ci- dessus
depuis le commencement jusqu' la fin ... (33).
Tout l'esprit et bien souvent la lettre de la mutualit du
XXe sicle sont prsents dans les statuts de la Bourse de St-
Laurent. L'institution d'une pension de retraite reprsente
une anticipation remarquable. Le contrle collectif et part
consquent dmocratique de la socit fait l'objet d'une
attention particulire. L'ouverture de la bote en cuivre, qui
contient les fonds de la Bourse, ncessite l'usage de sept cl&
diffrentes dtenues par sept socitaires, eux-mmes renou-
vels chaque anne au cours de l'Assemble gnrale.
Le principe mutualiste gagne le soutien de l'lite
claire des philanthropes, au milieu du XVIIIe sicle.
Piarron de Chamousset matre de la Cour des comptes
donne un certain retentissement la notion de mutualit en
proposant dans ses Vues d'un citoyen, en 1757 un
26
SOUS LE RGIME ANCIEN
plan d'une maison d'association, dans laquelle, au moyen
d'une somme trs modique, chaque associ s'assurera dans
l'tat de maladie toutes sortes de secours qu'on peut
dsirer (34).
Pour Piarron de Chamousset, adepte des lumires les
sciences de l'homme et de la nature permettent de saisir les
lois de l'univers. L'une de ces lois, le calcul des probabilits
permet de fixer des cotisations variables selon l'ge des
associs et le niveau dsir de protection contre la maladie.
Il est le premier montrer que la prvoyance vocation
solidaire doit ncessairement reposer sur des bases scientifi-
ques, en dpit du caractre rudimentaire des formules
mathmatiques proposes .
Ses projets mutualistes n'ayant eu aucune suite, il change
son fusil d'paule et place ses espoirs, en 1770, dans la for-
mation d'organismes d'assurance qui assureront en
maladie des secours les plus abondants et les plus efficaces
tous ceux qui, en sant, paieront une trs petite somme par
an ou mme par mois . Piarron de Chamousset s'tonne
que l'on ait pas song tendre le systme des assurances
la sant, dans la mesure o : Plus les compagnies guri-
ront de malades, plus elles les guriront vite et plus elles
auront d'associs sur lesquelles elles gagneront (35). La
prvoyance but lucratif fait une entre remarque dans le
dernier tiers du XVIIIe sicle.
LA PERCE DE LA PRVOYANCE
Selon Camille Bloch (36), la notion de prvoyance,
importe de Hollande, l'un des pays pionniers en matire
d'assurance, apparat en France aux environs de 1764.
L'influence anglaise n'est pas moins importante. La pre-
mire vritable assurance-vie, l'Equitable voit le jour
Londres en 1762 (37) et servira longtemps de modle pour la
formation des institutions de ce type. Mais si la combi-
naison rationnelle de l'utilisation des capitaux consacrs la
27
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
dure de la vie humaine et du calcul des probabilits sduit
les milieux financiers dans la deuxime moiti du XVIIIe
sicle, des obstacles srieux en retardent la mise en uvre.
C'est d'abord la vague des tontines, du nom du banquier
italien Tonti, proche de Mazarin, qui dferle sur la France
partir de la fin du XVIIe. La tontine relve davantage de la
loterie que de l'assurance, c'est mme l'antithse la plus
absolue de l'assurance en cas de dcs (38).
Le discrdit caus par les tontines n'est pas le seul obs-
tacle, ni le plus grave. L'assurance est surtout l'objet
d'interdit au nom des principes sacrs de la morale. Selon
l'un des minents juristes de l'Ancien rgime, l'assurance-
vie n'a pas lieu d'tre, puisque: la vie d'un homme libre
n'tait susceptible d'aucune estimation . Ce qui ne
l'empche pas de prciser que: ces raisons n'ont point
d'application aux esclaves; les ngres tant des choses qui
font dans le commerce, et qui sont susceptibles d'estima-
tion (39).
Il faut attendre les toutes dernires annes de la monar-
chie pour qu'a.pparaisse la premire compagnie d'assurance-
vie. Evoquer la personnalit des promoteurs de la Compa-
gnie royale d'assurance-vie, autorise le 3 novembre 1787,
revient lever le rideau du dernier acte du rgime mo-
narchique, puisqu'ils se nomment: Clavire, Brissot et
Mirabeau (40).
Condorcet reproche aux institutions d'assurance de
n'tre utile qu'aux personnes aises (41). Brillant math-
maticien, l'un des tous premiers de son poque, il entrevoit
la possibilit de mettre le calcul des probabilits au service
des classes dshrites sous forme de caisses d'accumu-
lation. Ces caisses au moyen desquelles de petites par-
gnes puissent assurer les secours l'infirmit, la vieil-
lesse (42).
Camille Bloch donne divers exemples des progrs faits
dans les dernires annes de l'ancien rgime par les ides de
prvoyance sociale et de mutualit , parmi lesquels ce
projet d'une caisse d'assurance en faveur du peuple
contre les atteintes de la misre et de la vieillesse , pr-
28
SOUS LE RGIME ANCIEN
sente l'Assemble provinciale d'Orlans dans les derniers
mois de 1787.
L'ide que le secours aux indigents doit dsormais tre
envisag sous l'angle du droit, notion radicalement nou-
velle, est porte par le courant philanthropique en pleine
ascension dans la dernire moiti du XVIIIe sicle. Le prin-
cipe que la pauvret engage la responsabilit de la socit
est dfendu par Montesquieu et Rousseau, ainsi que par des
hommes d'Etat comme Turgot et Necker. La philanthropie
dont le but est de venir en aide aux hommes en gnral,
plutt qu' un homme en particulier, se distingue de la cha-
rit. Il est lgitime de considrer que la philanthropie
incarne, non seulement un mouvement de scularisation,
mais galement de socialisation de la pauvret (43).
Le duc de Larochefoucauld-Liancourt, Grand du
royaume, est l'une des principales figures emblmatiques de
ce mouvement. En 1780, il fonde dans son domaine la pre-
mire cole d'arts et mtiers en faveur des enfants de mili-
taires pauvres, sur le modle anglais. Il participe galement
la naissance de la Socit philanthropique de Paris, qui
influera de faon dcisive au XIXe sicle, sur le dveloppe-
ment de la mutualit.
Louis XVI confie Larochefoucauld-Liancourt, ainsi
qu'au savant astronome Bailly et au chirurgien Tenon une
enqute sur l'Htel-Dieu et les hpitaux de Paris. Le rap-
port publi en dcembre 1786 dresse un terrible acte d'accu-
sation sur la ralit hospitalire du temps. L'hpital, qui
assure thoriquement une double fonction d'assistance et de
soins, provoque dans les milieux populaires une aversion et
une frayeur incommensurables. Les lits des hpitaux gn-
raux (la moiti du total des lits) ne sont utiliss que pour un
tiers par des malades, les deux tiers restant tant occups
par des incurables, des insenss et certains prisonniers (44).
Les Htels-Dieu, prsums entirement consacrs aux
soins, n'ont gure meilleure rputation. Les trois commis-
saires s'exclament : ... Comment dormir dans ces lits
deux que ron surcharge de quatre et six malades. Que
penser d'un hpital o les malheureux ainsi entasss dans
29
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
un mme lit ne peuvent obtenir le sommeil dsirable, que
lorsqu'ils se concertent pour que les uns se lvent et veillent
une partie de la nuit, tandis que les autres dorment (45).
Certes, Louis XVI, depuis sa visite en 1781 l'Htel-Dieu,
a ordonn par dcret (46), que les lits soient occups par une
seule personne. Les trois reprsentants de l'Acadmie des
sciences ne l'ont pas oubli, puisqu'ils se permettent
d'observer le parti est pris cet gard ... mais nous savons
aussi que tout ce qui est dcid n'a pas toujours son excu-
tion.
L'conomiste Dupont de Nemours, autre personnalit
marquante du courant philanthropique, publie en 1786 ses
ides sur les moyens d'viter les affres de l'hpital (47),
notamment l'Htel-Dieu de Paris, qu'il nomme le Temple
de la mort . Sa proposition d'administrer, sur le modle
anglais, les soins domicile parce qu'ils sont plus respec-
tueux de la dignit du malade et moins coteux, sera reprise
dans son intgralit par la Constituante.
Les vues de Dupont de Nemours, nourries de rfrences
philanthropiques et physiocratiques, sont reprsentatives
des novations et des ambiguts qui caractrisent les
conceptions dominantes en matire de soins et de protection
la veille de la Rvolution. La position des hommes des
lumires sur les corporations ne souffre, en revanche,
d'aucune quivoque. Le systme plusieurs fois centenaire
vit ses derniers instants.
LA CHUTE DES CORPS
L'esprit de corps dont la socit fodale a pu tirer initia-
lement une force de dveloppement, prcipite le dclin de la
monarchie absolue. Le raffinement juridique des statuts ne
vise qu' prserver les positions acquises, au prix d'un mal-
thusianisme professionnel meurtrier pour l'conomie. Les
hommes des lumires condamnent sans appel les corpo-
rations. L'Encyclopdie crit : ... ces communauts ont
des lois particulires, qui sont presque toutes opposes au
30
SOUS LE RGIME ANCIEN
bien gnral et aux vues du lgislateur. La premire et la
plus dangereuse est celle qui oppose des barrires l'indus-
trie, en multipliant les frais et les formalits des rcep-
tions ... L'abus n'est pas qu'il y ait des communauts, puis-
qu'il faut une police; mais qu'elles soient indiffrentes sur
le progrs des Arts mmes dont elles s'occupent; que
l'intrt particulier y absorbe l'intrt public, c'est un
inconvnient trs honteux pour elles (48).
Le dsaveu du systme corporatiste est-il l'uvre exclu-
sive des gens de lettres et des philosophes? William H.
Sewell en est convaincu : L'opposition aux corporations
de mtier ne venait pas du monde des arts et du commerce
mais d'un secteur de la socit trs diffrent - l'lite admi-
nistrative et littraire constitue par les philosophes et leurs
disciples - et ce pour des raisons qui tenaient davantage
la logique de la pense des Lumires qu'aux problmes
internes des corporations (49).
Les donnes conomiques participent la condamnation
du modle corporatif. L'opposition des corps l'innovation
industrielle provoque d'innombrables affrontements juridi-
ques au cours du sicle. ... La corporation lainire de
Lille entre en conflit avec les manufacturiers de Roubaix et
de Tourcoing qui veulent lancer de nouvelles fabrications et
russit les faire condamner en 1732, en 1755 et en
1757 (50).
Nombre d'entrepreneurs s'installent en milieu rural pour
bnficier de la proximit des sources de matires premires
et d'nergie, mais aussi pour chapper aux juridictions dra-
coniennes des corporations. L'industrie du tissage devient
une activit essentiellement rurale au cours des XVIIe et
XVIIIe sicles. Cette rigidit est tellement accentue que
la cour est oblige d'accueillir au sein de ses palais les arti-
sans au talent reconnu qu'elle veut protger (51). Dans
Paris les lieux ouverts au travail libre n'ont cess de
s'tendre, de's galeries du Louvre au faubourg St Antoine,
en passant par l'enclos du Temple.
Le systme des corporations en cloisonant la socit
l'excs, la sclrose. Chacun des mille petits groupes dont
31
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
la socit franaise se composait ne songeait qu' lui-
mme; c'tait, si je puis m'exprimer ainsi, une sorte d'indi-
vidualisme collectif qui prparait les mes au vritable indi-
vidualisme que nous connaissons (52).
Les hommes d'Etat les plus lucides, gnralement acquis
aux lumires , tentent d'imposer la rforme des corps de
mtiers, Turgot le plus brillant des rformateurs, porte le
fer sur l'institution corporatiste en fvrier 1776: Etei-
gnons et supprimons tous les corps et communauts de mar-
chands et artisans, ainsi que les matrises et les jurandes.
Abrogeons tous les privilges, statuts et rglements donns
aux dits corps et communauts. Il avait sous-estim la
raction en chane qu'une telle dcision devait provoquer
dans une socit dont les ordres constituaient la substance
organique.
Le 12 mars 1776 le Parlement refuse d'enregistrer l'dit.
Le 12 mai le roi congdie Turgot. Ds aot 1776, son suc-
cesseur, Necker, rtablit les corporations. Les confrries
demeurent bel et bien interdites. Turgot partage les prven-
tions l'gard des confrries de mtier. Celles-ci, dit-il :
... resserrant encore les liens qu'unissaient entre elles les
personnes d'une mme profession, leur donnrent des occa-
sions plus frquentes de s'assembler et de s'occuper, dans
ces assembles, de l'intrt commun des membres de la
socit particulire, qu'elles poursuivent avec une activit
continue, aux prjudices des intrts de la socit gn-
rale (53).
L'amalgame, qui conduit bannir dans des termes quasi
identiques les associations volontaires des fins d'entraide
et les structures juridico-administratives professionnelles
devenues archaques, fait l'unanimit parmi les esprits du
temps. Nous aurons nous interroger sur les causes de cette
confusion lorsqu'elle prendra force de loi, l'explication par
la filiation rousseauiste n'puisant pas le sujet. Pour
l'heure, le systme corporatif bnficie, la faveur de la
rdaction des cahiers de dolances d'une rmission trom-
peuse.
32
SOUS LE RGIME ANCIEN
LA DISPERSION OUVRIRE
La participation des gens de mtiers au plus vaste dbat
national jamais organis jusqu'alors pour un peuple semble
avoir t modeste. Pourtant l'invitation du roi lui faire
connatre les souhaits et les dolances de nos peuples ,
les concernait au plus haut chef. Les donnes dmographi-
ques ne jouent pas en faveur du salariat dans la France du
XVIIIe sicle finissant. Le monde urbain ne reprsente que
15 % de la population totale. Reste Paris, avec sa concen-
tration de plus de cinq cent mille mes (524 186 habitants
recenss l'occasion des Etats gnraux), dont la moiti est
de composition ouvrire, en comptant les familles'.
Les ouvriers parisiens sont dissmins. ... Le nombre
moyen de travailleurs par patron s'tablit pour l'ensemble
de Paris 16,6 ... (54). L'effectif de l'entreprise de papiers
peints Reveillon fait figure avec ses 350 salaris d'unit
gante. Le terme ouvrier peut dsigner simultanment,
cette poque, le matre et le salari. Pour l'Encyclopdie,
ouvrier se dit en gnral de tout artisan qui travaille
quelque mtier que ce soit . Le monde de l'atelier est une
ralit composite dans laquelle les lignes de clivage se super-
posent.
Le schma idal recherch par les autorits monarchi-
ques, que le Lieutenant gnral de police de Paris Lenoir
dfinit comme une chane domestique subordonnant ma-
tres aux jurs, compagnons aux matres, apprentis aux com-
pagnons. .. (55), se heurte de vives rsistances dans la vie
quotidienne des mtiers. Il n'en reste pas moins une rf-
rence pour les ouvriers qui s'identifient davantage leur
mtier qu' leur classe. En province, notamment Gre-
noble et surtout Lyon l'industrie textile fournit le cadre
d'un nouveau systme productif. La Grande Fabrique
rompt le tte--tte matre-ouvrier avec l'entre en scne du
marchand-fabricant. Un nouveau type de confrontation
s'amorce.
Les conditions culturelles et sociales de l'affirmation
d'une personnalit autonome du monde salarial n'existent
33
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
pas. La quasi absence des gens de mtiers au droulement
des Etats gnraux lie la slection naturelle d'ordre
culturel, est aggrave par les dispositions lectorales censi-
taires. Le rgime parisien s'avre plus slectif qu'en pro-
vince. La population salariale, largement prdominante, ne
compte aucun reprsentant dans la liste des 407 lecteurs
chargs de dsigner les 20 dputs de la capitale. On en
dnombre trois parmi les 998 lecteurs du Tiers'-Etat de
Provence.
LE QUART-MONDE DU SILENCE
Quelques cahiers dits du Quatrime Ordre mergent
des milliers de documents publis dans la phase prpara-
toire des Etats gnraux. Ces publications sont gnrale-
ment rdiges par des personnes appartenant aux catgories
aises. C'est le cas de l'ouvrage prsent par l'abb Favre
pour le compte du duc d'Orlans dans lequel on se pro-
pose le moyen d'assurer le soulagement et le bonheur du
pauvre peuple par le rtablissement d'un des plus anciens
droits de la couronne sur les biens du clerg (56).
Les rdacteurs de suppliques sont souvent des philan-
thropes. Dans ses Cahiers des pauvres journaliers, des
infirmes, des indigents , Dufourny de Villiers, ingnieur en
chef de la ville de Paris, demande pourquoi cette classe
immense ... est-elle rejete du sein de la Nation ? . Lam-
bert, inspecteur des apprentis de l'Hpital de la Piti, tente
vainement, dans son district lectoral parisien, de soumettre
un cahier des pauvres et constate avec amertume : La
nation s'assemble pour rgler les impts et leur rpartition.
Les puissants et les riches paraissent seuls intresss ces
discussions qui cependant dcident invitablement du sort
des faibles et des pauvres (57).
La ptition adresse le 3 mai 1789 Bailly, secrtaire de
l'assemble du Tiers-Etat par cent cinquante mille ouvriers
et artisans de Paris plaide dans le mme sens. Observant
que parmi les quatre cents grands lecteurs de la capitale, il
34
SOUS LE RGIME ANCIEN
ne se trouve que quatre ou cinq personnes susceptibles de
connatre leur sort et de s'y intresser. Les signataires expri-
ment leur dception : A u moment o la Patrie ouvre son
sein ses enfants, pourquoi faut-il que cent cinquante mille
individus utiles leurs concitoyens soient repousss de leurs
bras ? Pourquoi nous oublier, nous pauvres artisans, sans
lesquels nos frres prouveraient les besoins que nos corps
infatigables satisfont ou prviennent chaque jour? Ne
sommes-nous pas des hommes, des Franais, des
citoyens ! (58).
Ce texte qui soutient la cause du monde ouvrier est visi-
blement crit par des matres et des entrepreneurs. La bour-
geoisie industrieuse, forte de sa position de tutrice d'un
proltariat mineur , selon l'expression de Jaurs (59), utilise
la souffrance ouvrire pour dnoncer l'hgmonie des
hommes de loi et des hommes de lettres dans les instances
lues. Les auteurs de cette ptition ouvrire montrent le
bout de l'oreille, lorsqu'ils demandent que soient lus ...
des ngociants, des manufacturiers intelligents, mme des
artisans honntes (sic) ; il en est parmi nous (60). La pti-
tion, souvent voque comme un tmoignage exemplaire de
la prise de parole ouvrire, ne propose aucune candidature
de salari.
Cependant la dmarche exprime l'inquitude des milieux
populaires devant l'ventualit d'tre laisss au bord du
chemin. On peut galement voir l'expression de l'incertitude
du milieu salarial dans le fait que les travailleurs se sont
joints aux matres, dans certaines professions, pour
demander le maintien du systme corporatif vcu comme un
espace protg en dpit des contraintes qu'il gnre.
La demande de la suppression des corps et des commu-
nauts de mtiers n'est formule que par 41 cahiers sur le
total de 943 manant des corporations (61). La socit
d'ordre est moribonde, mais elle inspire ce combat en
dfense que l' on appelle la raction aristocratique, comme
on le retrouve dans les dolances des artisans de mtiers
corpors (62).
Si les jours du systme archaque des corporations sem-
35
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
blent compts, les interdits prononcs contre la libert
d'association appartiennent l'immuable en cette fin
d'Ancien rgime. Les Parlements rappellent obstinment, le
caractre illicite des groupements de travailleurs quelle
qu'en soit la nature.
L'arrt du Parlement de Paris du 7 septembre 1778, aprs
avoir fait dfense particulirement aux ouvriers de
constituer des associations compagnonniques, tente d'ins-
taurer un vritable cordon sanitaire autour de ceux-ci, en
menaant les cabaretiers, les marchands de vin, les auber-
gistes, les limonadiers, les traiteurs, les tenanciers de bil-
lards etc., dans le cas o ils accueilleraient ces assembles
ou ne les dnonceraient pas ... d'tre rputs fauteurs et
complices desdites assembles illicites... (63).
En 1783 la demande des matres, un arrt est publi
contre les compagnons ferrailleurs, cloutiers et pingliers
pour obvier (rsister) aux cabales que les compagnons
font pour quitter en mme temps les boutiques et les ate-
liers (64). Un autre arrt du 23 fvrier 1786 fait dfense
aux garons marchaux ferrants de crer une socit sous
peine d'tre poursuivis extraordinairement (65).
Le rejet des associations ne souffre aucune exception.
Tmoin cette raction de la chambre de commerce de
Guyenne, qui repousse la demande des arrimeurs de Bor-
deaux et des Chartrons (faubourgs de Bordeaux) de former
deux communauts d'assistance, car H ils n'ont pas besoin
pour faire du bien leurs veuves et leurs membres affligs
par les maladies et la vieillesse d'tre en communaut, puis-
qu'il est satisfaisant de soulager son prochain sans con-
trainte " (66).
S'il est vrai qu' la veille de 1789, ... la voix des salaris
ne faisait que profrer des sons inarticuls, selon la for-
mule saisissante de Louis Blanc (67), il arrive cependant que
la parole ouvrire se fasse explicite pour rclamer le droit
d'association. Les compagnons chapeliers de Marseille
demandent dans le cahier de dolance de leur snchausse
le rtablissement de leur socit d'entraide finance par
une lgre imposition volontaire sur chacun de nous et
36
SOUS LE RGIME ANCIEN
qui fut dtruit sous de faux rapports . Ils ajoutent, non
sans habilet, nous supplions que cette uvre soit rtablie
dans toute son intgrit comme cooprant la prosprit de
la fabrication nationale (68).
Il n'existe pas encore proprement parler de question
ouvrire . La notion, cependant, de classe dangereuse
qui prosprera au XIXe sicle, apparat en filigrane dans le
mouvement de la socit franaise la veille de la Rvolu-
tion. Quand Restif de la Bretonne crit: Depuis quelques
temps, les ouvriers de la capitale sont devenus intraitables,
parce qu'ils ont lu dans nos livres une vrit trop forte pour
eux, que l'ouvrier est un homme prcieux (69), il exprime
une dfiance dont les racines ne sont pas la veille d'tre
radiques.
37
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
NOTES
(1) Tocqueville. - L'Ancien Rgime et la Rvolution, 1967, p. 43.
(2) La Mutualit franaise des origines la Rvolution de 1789, 1981,
p.19.
(3) Ibidem, p. 21.
(4) Ibidem, p. 31.
(5) Emile Laurent. - Le pauprisme et les associations de prvoyance,
1865, p. 116.
(6) Jean Bennet. - La Mutualit franaise, op. cit., p. 35.
(7) Ibidem, p. 56.
(8) Les corporations en France avant 1789, 1968, p. 23, le sens revtu
par ce mot en Grande-Bretagne sera, toutefois, sensiblement diff-
rent car dans ce pays la corporation servira de vecteur au dveloppe-
ment du grand capitalisme britannique.
(9) Ibidem, p. 223.
(10) Henri Hausser. - Ouvriers du temps pass, 1889, p. 2.
(11) Les corporations en France, op. cit., p. 96.
(12) Jean-Charles Asselain. - Histoire conomique de la France, t. 1,
1984, p. 75.
(13) Maurice Bouvier-Ajam. - Histoire du travail en France des ori-
gines la Rvolution, 1957, p. 267.
(14) Bronislav Geremek. - Les salaris dans rartisanat parisien aux
XIII-xve sicles, 1982, p. 36.
(15) Les ouvriers du livre en France, des origines la Rvolution de
1789, 1959, p. 53.
(16) Jean-Pierre Duroy. - Le compagnonnage initiateur de rconomie
sociale, Thse de doctorat de rUniversit du Maine, 1982, p. 67.
(17) Pnitents et Francs-maons de rancienne Provence, 1984, p. 67.
(18) Paul Nourrisson. - Histoire de la libert d'association depuis
1789, 1920, p. 54.
(19) Maurice Agulhon. - Pnitents et Francs-maons, op. cit., p. 72.
(20) Henri Hausser. - Les dbuts du capitalisme, 1927, p. 179.
(21) Maurice Garden. - Lyon et les lyonnais au XVIIIe sicle, 1975,
p.330.
(22) Paul Chauvet. - Les ouvriers du livre en France, op. cit., p. 298.
38
SOUS LE RGIME ANCIEN
(23) Bronislav Geremek. - Les salaris dans rartisanat parisien, op.
cit., p. 109.
(24) Ibidem, p. 116.
(25) Paul Labal. - Notes sur les compagnons migrateurs et les socits
de compagnons Dijon la fin du XVe sicle et au dbut du XVIe
sicle, annale de Bourgogne, 1950, pp. 189/191.
(26) Jean-Pierre Duroy. - Le Compagnonnage, op. cit., p. 56.
(27) Ibidem, p. 282.
(28) Emile Cornaert. - Les corporations en France, op. cit., p. 233.
(29) Jean Bennet. - La Mutualit franaise, op. cit., p. 587.
(30) Paul Chauvet. - Les ouvriers du livre en France, op. cit., p. 445.
(31) Anecdotes typographiques par Nicolas Contat, dit Lebrun, 1980,
p.79.
(32) Eugne Ruhfel. - Notice du 150
e
anniversaire de la socit typo-
graphique de Strasbourg de 1783 1933.
(33) Registre de la Panotechnique. - Union des mutuelles cogres,
Paris.
(34) Cit par Jean Bennet. - Piarron de Chamousset, philanthrope et
mutualiste, 1964, p. 4.
(35) Piarron de Chamousset. - uvres compltes, 1787, p. 96.
(36) Camille Bloch. - L'assistance et rEtat en France la veille de la
Rvolution, 1908, p. 155.
(37) Victor Senes. - Les origines des compagnies d'assurance, 1900,
p.42.
(38) Georges Hamon. - Histoire gnrale de rassurance en France et
rtranger, 1895-1896, p. 503.
(39) Robert Joseph Pothier. - Traits des contrats alatoires, 1777,
pp. 27-28.
(40) Jean Bouchary. - Les compagniers financires Paris la fin du
XVIIIe sicle, 1942, t. 3, p. 23.
(41) Cit par Camille Bloch. - L'assistance et rEtat, op. cit., p. 375.
(42) Ibidem.
(43) Franois Ewald. - L'Etat-Providence, 1986, p. 74.
(44) Catherine Duprat. - L 'hpital et la crise hospitalire. - In:
L'tat de la France pendant la Rvolution sous la direction de
Michel Vovelle, 1986, p. 58.
(45) Rapport des commissaires chargs par l'Acadmie d'examiner un
projet d'un nouvel Htel-Dieu, Bibliothque Nationale, R.35570.
39
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
(46) Isambert. - Recueil des lois anciennes, n 1408, lettres patentes
concernant l'Htel-Dieu de Paris.
(47) Ides sur la nature, la forme et l'tendue des secours donner aux
pauvres malades dans une grande ville, 1786, p. 18.
(48) Encyclopdie, t. 3 (premire dition 1751-1780), p. 724.
(49) William H. Sewell. - Gens de mtiers et rvolutions, 1983, p. 97.
(50) Jean-Charles Asselain. - Histoire conomique de la France, op.
cit., p. 77.
(51) Jean-Nol Chopart. - Le fil du rouge du corporatisme, 1987,
p.50.
(52) Tocqueville. - L'Ancien rgime et la Rvolution, 1967, p. 176.
(53) Jean Bennet. - La Mutualit franaise, op. cit., p. 710.
(54) Albert Soboul. - Les sans culottes, 1968, p. 43.
(55) Arlette Farge. - La vie fragile, 1986, p. 125.
(56) L'abb Favre de plusieurs acadmies. - La cause des journaliers,
ouvriers et artisans prsente aux tats gnraux par S.A.S. Mgr le
duc d'Orlans, B.N. Lb39.7879.
(57) Chassin. - Les lections et les cahiers de Paris, 1888/1889, t. 2,
p.582.
(58) Ibidem, p. 592.
(59) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, 1969,
t. 1, p. 212.
(60) Chassin. - Les lections et les cahiers de Paris, op. cit., p 593.
(61) Albert Soboul. - L'histoire de la Rvolution franaise, 1962, t. 1,
p. 143.
(62) Michel Vovelle. - La chute de la monarchie, 1972, p. 33.
(63) Isambert. - Recueil des anciennes lois franaises, t. 22, p. 412.
(64) Grace M. Jaff. - Le mouvement ouvrier Paris pendant la Rvo-
lution franaise, 1924, p. 38.
(65) Ibidem.
(66) Henri See. - Histoire conomique de la France, 1939, t. 1, p. 392.
(67) Louis Blanc. - Histoire de la Rvolution franaise, 1898, t. 1,
p.508.
(68) Joseph Fournier. - Cahiers de dolances de la snchausse de
Marseille, 1908, p. 66 et sqq.
(69) Franois Bluche. - Au temps de Louis XVI, 1980, p. 278.
40
Chapitre II
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
La Rvolution vue d'en bas , selon la formule de
Georges Rud (1), demeure malgr ses angles morts un poste
d'observation irremplaable. L'examen des conduites
sociales au sein des mtiers apparat d'autant plus nces-
saire, qu'elles s'expriment dans un cadre surdtermin par
le politique.
L'insubordination ouvrire ne cesse de grandir Paris.
On ne compte pas moins de 170 conflits d'ateliers dans la
deuxime moiti du XVIIIe sicle (2) ; ces conflits opposant
parfois les compagnons entre eux. La frquence des
confrontations, parfois violentes, contredit l'image idyllique
de communauts artisanales tenant lieu de familles largies
sous l'Ancien rgime. L'crivain Louis Sbastien Mercier,
partisan des rformes, est inquiet: De nos jours, le petit
peuple est sorti de la subordination, un point que je puis
prdire qu'avant peu on verra les plus mauvais effets de cet
oubli de toute discipline (3).
L'exprience des compagnons en matire de coalition a
fait des progrs sensibles la veille des chances rvolu-
tionnaires. Telle la grve dclenche en 1776, par les
compagnons relieurs de Paris, pour ramener la journe de
travail de seize quatorze heures : ... l'existence d'un
comit de grve analogue ce qui existe de nos jours en
pareille circonstance ... (4), ne fait aucun doute. Ces prati-
ques ne concernent qu'une fraction minoritaire des gens de
mtiers.
Le libraire Sbastien Hardy (5), note dans son journal la
monte de conflits importants, parfois victorieux, chez les
travailleurs du btiment, les menuisiers, les marchaux-fer-
rants, les serruriers, les boulangers, les maons et les chape-
liers.
Ces mouvements joueront un rle limit dans le dclen-
chement du processus rvolutionnaire. La revendication pro-
prement salariale est largement occulte par le prix du pain,
par sa raret ou son abondance: l'meute des subsistances
plutt que la grve demeurait la forme typique et tradition-
nelle de la revendication populaire (6). Les vnements
sanglants du Faul?ourg St-Antoine en fournit l'illustration.
42
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
L'AFFAIRE RVEILLON
L'meute des 27 et 28 avril 1789, dont la cible est le
citoyen Rveillon, propritaire d'une manufacture de
papiers peints, constitue la seule insurrection compose
exclusivement de salaris pendant la Rvolution (7). Albert
Soboul la lumire de cet pisode considre que le salari
de la manufacture est capable de montrer ... l'occasion
un comportement plus indpendant, qui n'est pas sans
annoncer celui du proltaire de la grande entreprise contem-
poraine (8).
Rveillon avait affront, onze ans auparavant, une grve
des ouvriers de la fabrique de papiers qu'il venait d'acqurir
Courtalin. Le conflit avait provoqu un arrt du Conseil
d'Etat interdisant nouveau, toute association parmi les
salaris des papeteries royales (9).
Rappelons brivement les faits de cette nigme trs obs-
cure et passablement indchiffrable (10). Rveillon parti-
cipe activement la prparation des Etats-Gnraux. Son
nom figure sur une liste des amis du peuple diffuse aux
lecteurs parisiens. Il se trouve en bonne compagnie puisque
ses colistiers se nomment: Condorcet, Siys, Brissot, Cla-
vire, etc. Le prospectus lectoral vante curieusement ses
mrites en le dclarant: mule par sa gnrosit, son
caractre patriotique et industrieux des manufacturiers
anglais .
Selon toute vraisemblance au cours de l'Assemble du
. district de Sainte-Marguerite, Rveillon a tenu le discours
dflationniste ordinaire des entrepreneurs plus soucieux de
faire baisser le prix du pain que d'augmenter les salaires. Il
semble galement que l'industriel l'instar des autres nota-
bles s'abstint de se mler la masse des participants.
Cette sorte de distinction qui n'tait ni prmdite, ni
l'effet d'aucune prtention, humilia le reste de l'Assemble
et la fit murmurer (11).
A-t-il dit, qu'un ouvrier pouvait parfaitement vivre avec
15 sous par jour? Aucun document ne l'atteste. Jaurs sug-
gre que ce reprsentant type du Tiers-Etat bourgeois n'a
43
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
fait que reprendre la proposition des industriels, prconi-
sant l'abaissement du prix du bl un niveau permettant
l'ouvrier de vivre avec 15 sous par jour (12). Diffuser de tels
propos qualifis d'inconsidrs par le lieutenant gnral
de police, quivalait lancer une torche dans la poudrire
du faubourg St-Antoine. Le nombre des victimes n'a jamais
pu tre vritablement tabli. Il aurait t de plusieurs cen-
taines. L'hypothse d'une manipulation n'est pas exclue, en
raison de l'inertie flagrante des forces de l'ordre le 27 avril
et du rle occulte attribu au Duc d'Orlans dans le drou-
lement des vnements.
Rveillon a toujours ni farouchement les paroles qu'on
lui a prtes, notamment dans un plaidoyer crit peu aprs
au fond d'une retraite clandestine, la Bastille, o il a t mis
l'abri de la colre populaire du 1
er
au 28 mai 1789.
L'entrepreneur possde l'poque la rputation d'un
patron philanthrope. La moyenne des salaires dans son
entreprise se situe entre 25 et 30 sous, les ouvriers les plus
qualifis pouvant atteindre les 50 sous. Or les salaires inf-
rieurs 20 sous, ne sont pas rares mme Paris.
Le fabricant, pionnier de la mutualit patronale, a cr
une caisse de secours qui sera officiellement reconnue le
17 novembre 1789. Par la suite elle prendra le nom de son
successeur : la Socit de secours mutuels des ouvriers en
papiers peints de l'entreprise Jacquemart . On porte gale-
ment son crdit l'indemnit de 15 sous par jour verse
ses ouvriers, que la carence de combustible avait privs
d'ouvrage pendant le terrible hiver 88/89.
Rveillon n'est probablement pas un homme barbare
qui valuait au prix le plus vil les sueurs des malheu-
reux (13), comme il le dit lui-mme, mais sa richesse, va-
lue cinquante mille livres, constitue en ces temps de
disette un vritable dfi. L'explication de l'meute par
l'hostilit de classe est, cependant, incomplte.
En instituant une zone de travail libre dans son entre-
prise, le fabricant heurte le conservatisme corporatif. On
met rarement en vidence le fait rapport par Chassin, selon
lequel parmi les individus qui furent poursuivis et con-
44
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
damns pour les meutes des 27 et 28 avril, il y eut un grand
nombre d'ouvriers attachs aux corporations qui consid-
raient la nouvelle industrie du papier peint comme une vio-
lation de leurs antiques privilges (14).
Pour dterminer si l'on se trouve en prsence d'un vne-
ment prcurseur de la lutte des classes des temps modernes,
il convient de considrer l'attitude des ouvriers de la
fabrique. Or : Chose frappante, aucun des trois cent cin-
quante employs de Rveillon ne fut parmi les meutiers
tus, blesss ou arrts. R n'est jamais question non plus,
dans les rapports, de tentatives qui auraient t faites le 28
avril en vue de rallier ces employs l'meute. R est donc
draisonnable de vouloir faire de l'affaire Rveillon une
grve ou une simple manifestation dirige contre un patron
impopulaire. R s'agit bien plus d'une protestation violente,
inconsciente en partie sans doute, contre la pnurie et le
prix lev du pain (15).
A travers l'affaire Rveillon la rue a fait la preuve de sa
puissance. Dsormais le mouvement populaire des villes et
des campagnes influe directement sur le rythme des trans-
formations de la socit franaise. L'tude mene par Rud
sur les vainqueurs de la Bastille ne laisse aucun doute
sur leur identit sociale. La destruction du symbole du des-
potisme monarchique est l' uvre quasi exclusive des gens de
mtiers, artisans et salaris. On ne relve pas dans la liste
des combattants les rentiers et les capitalistes pour lesquels
en partie la Rvolution tait faite (16), ironise Jaurs.
L'incendie rvolutionnaire, au propre et au figur, a
gagn l'ensemble du territoire national dans la seconde
quinzaine de juillet. Les privilgis n'ont d'autre issue pour
tenter de circonscrire le sinistre que de jeter nombre de leurs
privilges dans le brasier. Le jeune pouvoir constituant tra-
vaille fivreusement pendant le mois d'aot 1789, l'labo-
ration des droits nouveaux seuls susceptibles d'apaiser la
soif populaire de libert et d'galit. L'association de soli-
darit ouvrire entre dans une priode riche de promesse,
que ses acteurs vont vivre avec confiance et exaltation pen-
dant prs de deux annes.
45
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
LES DROITS OMIS
Pour parvenir reprendre en main une situation proche
du chaos, il importe sans doute que l'opration soit bien
mene, et comme le dit un dput, cela ne va pas sans
quelque "magie ", cela s'appelle la nuit du 4 aot (17).
Les dcisions mmorables d'aot reprsentent autre chose
qu'un brillant exercice de prestidigitation. Elles consacrent
simultanment l'acte de dcs de l'Ancien rgime (18) et
la proclamation de droits nouveaux et universels pour
l'homme. Peu de messages ont tenu une place aussi impor-
tante dans le destin de l'humanit. Sa prodigieuse porte
historique ne peut masquer les bornes dans lesquelles ses
auteurs ont souhait l'inscrire.
Les corporations, supprimes le 5 aot au matin, sont
rtablies le Il aot, quand paraissent les dcrets d'applica-
tion. La formulation adopte sur proposition de l'avocat
Charles-Antoine Chasset, dput du Beaujolais, supprimant
les privilges des provinces, des villes, des corps et des
communauts (19) n'a pas t retenue. Le lobby corporatif
qui s'tait mobilis lors de la rdaction des cahiers de
dolances vient de marquer son dernier point. Le Chapelier
au sortir de la nuit historique qu'il a prside, dclare une
dlgation des Six-Corps: ... L'Assemble nationale
s'occupera des moyens qui peuvent dbarrasser le com-
merce des entraves qui le gnent (20).
La proclamation de la libert et de l'galit des droits ne
s'oppose nullement dans l'esprit des constituants la pr-
minence du droit de proprit. Ils pensent avec Jean-Jac-
ques Rousseau que le droit de proprit est le droit le plus
sacr de tous les droits des citoyens et plus important cer-
tains gards que la libert mme ... (21). Reste qu'tablir
une hirarchie des droits, conduit en luder certains.
La dclaration des droits de l'homme et du citoyen
adopte le 26 aot 1789 comporte deux omissions impor-
tantes: le droit d'association et le droit au secours.
L'absence du principe d'assistance trouve son explication en
partie dans le climat de prcipitation des travaux. Le silence
46
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
de la dclaration sur la libert d'association est dlibr.
L'ide que la dispense de secours en faveur des plus
dmunis doit tre considre comme un droit a fait une
perce remarquable en cette fin du XVIIIe sicle. Le prin-
cipe d'assistance publique est prsent dans nombre de pro-
jets qui ont contribu l'laboration du texte final. Des tra-
vaux rcents ont permis de rpertorier une cinquantaine de
contributions prparatoires. Le nombre rel est probable-
ment plus lev, si l'on se fonde sur le tmoignage de
l'ambassadeur des Etats-Unis, Jefferson, qui crit en fvrier
1789: tout le monde ici rdige des dclarations des
droits (22).
Ption, alors compagnon de Robespierre et futur maire
de Paris propose : Tout citoyen doit trouver une existence
assure, soit dans ses revenus de ses proprits, soit dans
son travail et son industrie ; et si des infirmits ou des mal-
heurs le rduisent la misre, la socit doit pourvoir sa
subsistance (23).
Siys, au znith de son influence sur la Constituante
estime que tout citoyen qui est dans rimpuissance de
pourvoir ses besoins, a droit au secours de ses conci-
toyens (24). Dans une seconde version, l'abb rduit la
porte du droit reconnu en l'assortissant de considrations
moralisatrices: il n'entrera jamais dans l'intention des
contribuables de se priver, quelque fois mme, d'une partie
de leur ncessaire, pour fournir au luxe d'un pensionnaire
de rEtat (25).
Le ngociant versaillais de Boislandry, dput du Tiers,
crit: Tout citoyen qui est dans l'impuissance de pour-
voir ses besoins, a droit aux secours publics (26). De son
ct, le comte de Sinety dput marseillais de la noblesse,
estime que pour se prserver des dangers de l'ingalit les
hommes ... se doivent tous des secours mutuels d'huma-
nit et de fraternit, qui corrigent cette ingalit (27).
Pour le comte de Custine : Tout citoyen qui est dans
l'impuissance de pourvoir ses besoins, a droit aux secours
publics (28). En marge du dbat parlementaire, Marat
crit: ... la socit doit ceux de ses membres qui n'ont
47
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
aucune proprit, et dont le travail suffit peine leurs
besoins, une subsistance assure, de quoi se soigner dans
leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi lever leurs
enfants .
Il estime que la socit ne peut raliser une vritable ga- 1
lit, puisque celle-ci n'existe pas dans la nature, et que ...
si elle doit ses secours tout homme qui respecte rordre
tabli, et qui cherche se rendre utile; elle n'en doit aucun
au fainant qui refuse de travailler (29).
Il a manqu peu de chose pour que ces diverses proposi-
tions en faveur des secours publics soient inscrites dans la
dclaration des droits. Le 27 aot 1789, le prsident de
l'Assemble, le comte de Clermont-Tonnerre, propose de
complter le texte adopt la veille. Il soumet aux dputs
l'article suivant: Tous les membres de la socit, s'ils
sont indigents ou infirmes, ont droit aux secours gratuits de
leurs concitoyens (30). L'urgence des dcisions politiques,
au premier rang le dlicat problme du droit de veto royal,
conduit l'Assemble ajourner la discussion.
L'absence de la libert d'association dans la dclaration
ne doit rien la prcipitation des dlibrations. Elle signifie
d'abord un rejet de principe: dans le rgime aristocratique
que l'on vient d'abattre, s'associer revenait instaurer un
corps, donc des privilges. L'article 3 de la dclaration est
particulirement transparent : Le principe de toute sou-
verainet rside essentiellement dans la nation. Nul corps,
nul individu ne peut exercer d'autorit qui n'en mane
expressment . L'omission n'exprime pas seulement une
ngation du pass, elle traduit une vision d'avenir dont on
retrouve l'cho dans les projets en comptition.
Pison du Galland, avocat, dput du Dauphin, met en
garde contre le principe de l'association de rsistance, car
dit-il: il est absurde de supposer que des tres intelligents
s'associent pour ravantage des uns au dsavantage des
autres (31). De Boislandry veut bien admettre, il est le
seul, que tous les citoyens ont le droit de s'assembler de
manire paisible ... condition qu'on abolisse tous les pri-
vilges prjudiciables rintrt gnral de la socit. Les
48
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
jurandes et les matrises sont des privilges exclusifs, et doi-
vent tre abolis (32).
Pour Siys le choix est clair : le citoyen doit avoir la
libert de dvelopper des activits commerciales et indus-
trielles, en gros et en dtails , comme bon lui semble.
Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle asso-
ciation n' a le droit de le gner, plus forte raison de
rem pcher. La loi seule peut marquer les bornes qu'il faut
donner cette libert comme tout autre (33). La libert
d'entreprendre possde une prminence absolue sur la
libert d'association ds qu'elles se croisent. Le postulat est
pos, reste le mettre en uvre.
LE DRANGEMENT DES MATRES
La proclamation des droits de l'homme et la condamna-
tion de facto des corporations soulvent l'enthousiasme des
salaris. Persuads d'agir en pleine conformit avec l'esprit
de la Rvolution, ils s'emparent des nouveaux droits pour
revendiquer, s'associer et mme s'tablir. Depuis le
drangement des matres , que reprsente la nuit du
4 aot, selon un membre des corporations (34), les manifes-
tations se succdent Paris contre la raret du travail et la
chert du pain.
Sbastien Hardy en tient le relev scrupuleux (35). Le
14 aot 1789, les garons boulangers mcontents de n'avoir
pas d'ouvrage, dfilent rue St-Jacques; le 18, plusieurs mil-
liers de garons tailleurs se plaignent de ne toucher que
trente sous par jour au lieu des quarante qu'ils rclament;
le mme jour les garons perruquiers s'lvent contre la taxe
excessive prleve par le bureau de placement dans la com-
munaut. Ils demandent que le surplus soit utilis pour
acqurir des lits l'Htel-Dieu.
Le 29 aot, Hardy relate la tenue d'une runion aux
Champs Elyses, qui disait-on aurait regroup quarante
mille domestiques pour rclamer la qualit de citoyen. Quel-
ques jours plus tard les ouvriers cordonniers, au nombre de
49
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
six cents, forment un comit charg de veiller au fonction-
nement de leur association et de recueillir une cotisation
pour venir en aide aux compagnons sans emploi (36).
Bien que ces rassemblements n'aient pas caus de vio-
lence, les autorits parisiennes s'inquitent. Ils publient plu-
sieurs arrts les 7, 15, 18 et 21 aot, dans lesquels on
dfend tout particulier, de quelque qualit et condition
que ce soit, toute corporation, de s'attrouper sous aucun
prtexte; dclare ceux qui s'y prteraient ou exciteraient
lesdits attroupements, sditieux et perturbateurs de l'ordre
public (37).
La manifestation revendicative n'est pas la seule voie
qu'utilise le peuple des mtiers pour explorer les nouveaux
espaces de libert. Mettant profit la dislocation progres-
sive du cadre corporatif, nombre de compagnons et
d'ouvriers ralisent le vieux rve de s'tablir. La chose est
d'autant plus aise que les formalits sont inexistantes dans
cette priode de transition.
Le phnomne touche diversement les professions. Des
imprimeurs sont sduits par ces possibilits nouvelles,
malgr l'importance de la mise de fonds initiale ncessaire.
A l'occasion d'une fte clbre en l'honneur de leur col-
lgue Benjamin Franklin, le 1 0 aot 1790, par La
socit des ouvriers imprimeurs de Paris , l'un d'entre eux
affirme: Nous sommes redevenus, d'aprs la dclaration
des droits, propritaires de notre industrie ; la libert de la
presse nous assure la facilit de former des tablissements,
et d'amliorer notre sort proportion de notre intelligence
et de nos talents (38).
Les matres perruquiers de Paris trouvent cette concur-
rence funeste. En dcembre 1790, ils rdigent une ptition
dnonant le fait que les 400 boutiques ouvertes par leurs
anciens employs provoquent, en raison du dtournement
de clientle, la ruine des 972 charges existantes. Sans
compter ajoutent-ils, les 2000 ouvriers qui travailleraient en
chambre (39).
L'tal de boucher devient l'objet de comptition et de
chicanes. Les garons bouchers obtiennent gain de cause
50
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
contre les matres. Un dcret des 15-28 mars 1790 range au
nombre des droits fodaux supprims sans indemnit les
droits d'tal et d'talage . Les matres cherchent rsister.
Le 23 janvier 1791, Pzenas, ils dnoncent la fausse ide
que l'Assemble nationale avait aboli les matrises (40). A
St-Quentin, des poursuites sont intentes contre les particu-
liers prtendant exercer des professions sujettes aux
jurandes et aux matrises (41).
La recomposition du cadre corporatif par la libralisation
de l'activit professionnelle bouleverse les rapports sala-
riaux traditionnels. Le salaire fix, auparavant, par les
rgles communautaires des mtiers jurs, devient une affaire
prive entre le patron et l'ouvrier. La loi de l'offre et de la
demande sur le march du travail embryonnaire cons-
titue la rfrence dans les rapports employeurs-salaris.
L'individualisation des relations salariales se heurte aux tra-
ditions communautaires, surtout dans les mtiers qualifis.
L'TAT DE GRCE
1790 est-elle une anne heureuse ? Elle n'a que les
apparences du rpit (42) estime Michel Vovelle. L'observa-
tion vaut pour le monde des mtiers, la rserve prs que
les tensions sociales et le processus rvolutionnaire ne sont
pas ncessairement synchrones.
En se regroupant, les ouvriers savent qu'ils s'exposent
la redoutable accusation de reconstituer les corporations. Ils
s'en dfendent avec nergie, affirmant tre les derniers
souhaiter le retour d'un systme, dont ils taient les vic-
times. Discrets sur leurs intentions revendicatives, les sala-
ris justifient principalement l'existence des associations par
leurs objectifs d'entraide.
La socit cre en juin 1790, sous le nom de Corps
typographique constitue l'exemple le plus remarquable de
ces tentatives d'associations ouvrires. La brochure
conserve au British Museum de Londres, intitule le
51
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Rglement gnral pour le corps typographique ne
donne aucune information sur les conditions de cette nais-
sance.
Une lettre du maire de Paris, date du 9 mai 1790 (43),
approuvant le projet d'une runion entre les reprsentants
de la chambre syndicale patronale et une dlgation
ouvrire, indique que le processus d'organisation est dj
entam. Le contexte de l'activit professionnelle est favo-
rable aux compagnons. La libert de communication
reconnue par la dclaration des droits, a entran un
accroissement considrable de l'dition. Du 14 juillet 1789
au 1 0 aot 1792, on passe de soixante priodiques plus de
cinq cents.
Les ouvriers imprimeurs proclament dans l'expos des
motifs de leur rglemedt une adhsion enthousiaste la
Rvolution. Ils n'imaginent pas un instant que la naissance
de leur groupement puisse contrarier le mouvement qui a
mis fin au despotisme et aux privilges. ... Aujourd'hui
vos droits ne sont plus douteux, rien ne peut empcher vos
actes de bienfaisance et votre association (44).
La socit vous procurera des secours dans vos infir-
mits et dans votre vieillesse et dtruira cette dmarche
humiliante laquelle tant de vos frres ont t autrefois
exposs pour se procurer quelques soulagements dans leurs
maux (45). La qute tolre par les matres en faveur de
confrres ncessiteux, leur apparat avec le recul comme un
acte de mendicit. On aurait tort de ne voir dans la mise en
valeur de la motivation mutualiste que l'expression d'une
tactique. L'organisation solidaire de la protection est pour
ces salaris un impratif vital.
Le souci d'une bonne gestion de la bourse commune et
celui d'une dmocratie relle sont particulirement marqus
dans l'nonc des statuts. Le chapitre intitul De la police
dans les imprimeries bauche une structure mi- chemin
entre la commISSIon paritaire et les prudhommes.
L'article 5, interdit aux ouvriers de faire grve sans y avoir
t autoriss par l'Assemble. L'instance de rgulation
fonctionnera effectivement pendant quelques mois. Paul
52
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
Chauvet (46) relate un diffrend professionnel trait par
cette mthode contractuelle, qui concerne Prud'homme,
l'diteur-imprimeur du journal Les Rvolutions de
Paris . L'assemble a l'lgance de donner gain de cause
au publiciste.
Pendant six mois, de novembre 1790 mai 1791, le corps
typographique disposera d'un priodique, le Club philan-
thropique et typographique , dit par Vital Roux,
membre de la profession. La typographie parisienne a-t- elle
fait cole? Rien ne permet de confirmer l'optimisme de
Roux crivant que les grandes villes du royaume ont vu
clore depuis rheureuse rvolution, des socits ou des
clubs typographiques (47).
La vitalit du phnomne associatif s'exprime galement
dans d'autres mtiers. Les compagnons serruriers ont form
une socit qui se runit les dimanches soir, tant pour
s'instruire des dcrets de rAssemble nationale que pour
procurer des secours ceux d'entre eux qui se trouveraient
malades ou sans occupations (48). La demande d'affilia-
tion faite par les serruriers auprs de la section de la Biblio-
thque et la rponse des dirigeants sectionnaires, confirment
l'ambigut des relations entre les socits ouvrires et l'lite
militante rvolutionnaire. La dmarche accueillie avec une
certaine chaleur, est finalement rejete vu que les assem-
bles de pareilles socits sont illgales (49).
L'enqute mene par l'Office du Travail en 1899, publie
sous le titre des Associations professionnelles
ouvrires (50), fournit quelques indications sommaires, sur
l'closion de socits d'entraide dans la premire phase de
la Rvolution. Les orfvres fondent leur socit le
1 er janvier 1791. Elle deviendra sous la Restauration une
socit de secours mutuels interprofessionnelle. Les tan-
neurs et corroyeurs de Paris forment le 6 fvrier 1791, la
socit d'entraide Saint-Simon du nom du saint patron
de la profession. Aprs 1789, les chapeliers-fouleurs lyon-
nais n'avaient cess d'tre organiss .
Au Havre, en juillet 1790, les garons cordonniers
dposent un projet de socit de secours en cas de maladie
53
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
et de chmage, le projet est approuv par le conseil muni-
cipal. Les cotisations de deux sols par semaine serviront
aider les malades et leurs familles, secourir les adhrents
sans ouvrage, aider l'ouvrier cordonnier qui arrivera dans
la ville pour chercher du travail ... (51). Le prlvement des
cotisations veille des mfiances. Neuf ouvriers- rpeurs de
tabac demandent la municipalit qu'on leur reconnaissent
le droit de ne pas participer la caisse de maladie institue
dans leur profession ou tout le moins d'avoir un droit
de regard sur le mode de gestion de ces fonds (52).
L' Union fraternelle des ouvriers en l'art de la charpente
de Paris , rsurgence de la tradition compagnonnique, a
obtenu depuis le dbut de l'anne 1791, le droit de se runir
chaque semaine dans une salle de l'Archevch. Les char-
pentiers prsentent leur association comme une institution
philanthropique.
La socit des charpentiers participe au bouillonnement
rvolutionnaire. Elle se runit dans la mme salle que le
Club des Cordeliers et adhre au comit central form par
le Club en mai 1791 (53). Les Cordeliers, o s'illustrent
Marat, Danton et Camille Desmoulins semblent avoir t
l'origine une socit fraternelle d'assistance sociale et de
protection mutuelle (54).
L'euphorie consensuelle de l'anne 1790 culmine lors de la
fte de la Fdration. Les travailleurs de tous les mtiers
consacrent de longues heures la prparation des festivits
aux cts de leurs employeurs. Il n'est point de corpora-
tion qui ne veuille contribuer lever rautel de la patrie ...
Les ouvriers du pont Louis XVI y viennent avec leurs instru-
ments, leurs tombereaux, leurs brouettes, aprs avoir fini la
journe. Les bouchers avaient sur leur flamme un large cou-
teau et on lisait dessous: H tremblez aristocrates, voici les
garons bouchers ". Les imprimeurs avaient crit sur leur
drapeau: H imprimerie, premier flambeau de libert " (55).
La libert d'association semble assure par la loi du
21 aot 1790 : Les citoyens ont le droit de s'assembler
paisiblement et de former entre eux des socits libres, la
charge d'observer les lois qui rgissent tous les
54
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
citoyens ... (56). La mepnse est patente. Les droits
reconnus concernent le domaine politique. Les matres et les
autorits ne vont pas tarder fournir la bonne grille de lec-
ture.
DISCORDANCES
L'anne 1790 se termine par la promulgation de la consti-
tution civile du clerg. Le cours paisible de la Rvolu-
tion n'a que six mois vivre. C'est pourtant dans cette
priode que va se jouer le sort de la libert d'association.
L'esprit de conciliation dont font preuve les ouvriers du
livre ne dsarme pas l'hostilit des matres imprimeurs pari-
siens. Regroups dans une Assemble encyclopdique ,
ils adressent le 7 janvier 1791 la Commune de Paris une
ptition dnonant la socit forme par les compagnons.
Le Corps typographique est prsent comme une organisa-
tion fixant arbitrairement les tarifs des salaires et utilisant la
violence pour les imposer. Aucun fait prcis n'est apport
l'appui des accusations.
Selon le groupement patronal, l'association ouvrire
reprsente ... sans doute le plus ingnieux imaginer par
les ennemis de la patrie pour dtruire la libert de la presse
et par consquent la libert individuelle de tous les citoyens
de ce vaste empire . Les matres font confiance aux diles
parisiens pour imaginer les moyens de dissoudre une
socit aussi monstrueuse (57).
Les entrepreneurs mettent profit le mcontentement
provoqu par les rivalits compagnonniques. Ils font
dposer le 5 mai 1791 auprs de l'Assemble nationale, une
ptition intitule Adresse de la grande majorit des
ouvriers des manufactures, compagnons des arts et mtiers,
pour la suppression des Compagnons du devoir (58).
Dmarche que Dupont de Nemours transmet au Comit de
Constitution.
D'autre part les matres entendent empcher leurs
employs d'ouvrir librement des choppes et des boutiques.
55
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Au dbut de l'anne 1791, ils assigrent de plaintes les
municipalits et s'adressrent mme l'Assemble natio-
nale (59). Sur ce point la rponse de la Constituante va
cruellement dcevoir leur attente.
LA LIBERT D'ENTREPRENDRE
La loi que l'Assemble nationale vote sur la proposition
du dput d' Allarde rpond une double exigence : trouver
des recettes fiscales en instituant la patente, rformer la
lgislation industrielle et commerciale en supprimant dfini-
tivement le systme des corporations. D'Allarde, ancien
page de la Dauphine et officier de cavalerie, est devenu l'un
des meilleurs spcialistes des questions financires de la
Constituante.
Sa loi abroge au dtour d'un dbat fiscal, un ensemble de
rgles plusieurs fois centenaires. A compte du 1
er
avril
prochain, il sera libre toute person,ne de faire tel ngoce,
ou d'exercer telle profession, art ou mtier qu'elle trouve-
rait bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant
d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-
aprs dtermins, et de se conformer aux rglements de
police qui sont ou pourront tre faits (60):
La nouvelle lgislation consacre l'un des grands principes
de la Rvolution: l'me du commerce est l'industrie,
l'me de l'industrie est la libert (61). Le texte adopt,
concrtise les dcisions de la nuit du 4 aot. L'article 4 de
la loi s 'y rfre explicitement : Les particuliers reus dans
les matrises et jurandes, depuis le 4 aot 1789, seront rem-
bourss de la totalit des sommes verses au Trsor
public (62). La loi ne semble pas avoir provoqu un mou-
vement de protestations. Les ouvriers et les patrons crurent
trouver leur intrt dans l'abolition des corporations, note
Jacques Godechot (63).
Quelques plaintes ont t mises. Leur nombre pourrait
s'avrer plus lev dans l'hypothse d'un dpouillement sys-
tmatique. Citon.s l'adresse des clercs des corps et commu-
56
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
nauts d'arts et mtiers de la ville de Paris: Pendant
qu'une foule de citoyens poussent des cris d'allgresse sur
ce nouveau bienfait de l'Assemble nationale, il existe une
classe d'hommes utiles, que cette opration menace du plus
grand malheur ... Que deviendront soixante citoyens, la plu-
part pres de familles, qui, livrs tout entiers, depuis la jeu-
nesse, l'exercice d'une pareille occupation, ont perdu
toutes les relations qui auraient pu venir leurs
secours ? (64).
Le 3 mai 1791, les artisans de Clermont-Ferrand interro-
gent: Souffrirez-vous que le droit d'une concurrence illi-
mite puisse donner au premier venu les moyens d'acca-
parer toutes les pratiques d'un artiste qui ne devait souvent
sa rputation qu' vingt ans de travail et qui peut-tre n'a
pour soutenir sa famille que cette seule ressource... )} (65).
La loi d' Allarde cause les premiers dommages que vont
subir les caisses de solidarit. L'article 6 fait obligation de
verser les fonds de secours professionnels la Caisse de
l'extraordinaire, cre pour recevoir les produits provenant
surtout de la vente des biens nationaux (66).
Une seule voix, celle de Marat, s'lve des rangs rvolu-
tionnaires contre ce dcret insens . Il crit dans l'Ami
du peuple du 16 mars 1791 : A u lieu de tout boule-
verser, comme l'a fait l'ignare comit de constitution, il
aurait d consulter des hommes instruits sur les choses qui
ne sont pas sa porte; pour s'attacher uniquement cor-
riger les abus .
Ce point de vue est l'objet d'interprtations divergentes.
Faut-il penser, avec Bouvier-Ajam, que Marat perut claire-
ment le danger social (67) de la loi, ou estimer avec
Jaurs, que le directeur de l'Ami du peuple commit en
cette occasion un des contresens les plus dcids (68) ?
Pour Marat la possibilit d'exercer librement le mtier de
son choix, sans tre contraint de faire la preuve de sa capa-
cit, conduit une ruine rapide de l'conomie et de l'Etat.
Lorsque chaque ouvrier peut travailler pour son compte,
il cesse de vouloir travailler pour le compte d'autres ; ds
lors plus d'ateliers, plus de manufactures, plus de com-
57
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
merces . Pire, la libert dveloppe l'appt du gain facile et
la rgression du savoir-faire professionnel. Je ne serai pas
tonn que dans vingt ans on ne trouvera pas un seul
ouvrier Paris qui ne st faire un chapeau ou une paire de
souliers . Jaurs s'exclame: Quel trange amalgame
d'ides et o la tendance ractionnaire domine (69).
La loi d' Allarde ne dit mot sur le sort des socits
ouvrires. Silence, qui s'explique, en partie, par le souci de
ne pas provoquer le mcontentement des salaris sans une
situation conomique relativement prospre. Les consti-
tuants estiment, tort, qu'en l'absence de fondements juri-
diques lgaux les associations de mtiers ne peuvent que
s'effacer.
58
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
NOTES
(1) Georges Rud. - La foule dans la Rvolution franaise, 1982,
p. 18.
(2) Arlette Farge. - La vie fragile, op. cit., p. 133.
(3) Louis Sbastien Mercier. - Le tableau de Paris, dit. 1979, p. 318.
(4) Paul Chauvet. - Les ouvriers du livre, op. cit., p. 353.
(5) Sbastien Hardy. - Mes loisirs ou journal d'vnements tels qu'i!s
me parviennent ma connaissance, t. 4, p. 315.
(6) Georges Rud. - La foule dans la Rvolution franaise, op. cit.,
p.35.
(7) Ibidem, p. 55.
(8) Albert Soboul. - Les sans culottes, op. cit., p. 56.
(9) Chassin. - Les lections et les cahiers de Paris, t. 3, op. cit., p. 55.
(10) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, t. 1,
op. cit., p. 189.
(11) Chassin. - Les lections et les cahiers de Paris, op. cit., p. 54.
(12) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., p. 189.
(13) Expos justificatif pour le sieur Rveillon entrepreneur de la manu-
facture royale de papiers peints, B.N., Lb 39.1618. Indemnis par-
tiellement par Necker, Rveillon remet en marche sa manufacture
en 1790 dsormais consacre la fabrication des assignats. Tou-
jours sous le choc de l'meute d'avril 1789, il migre en Angleterre
o il meurt en 1794.
(14) Chassin. - Les lections et les cahiers de Paris, t. 3, op. cit., p. 55.
(15) Georges Rud. - La foule dans la Rvolution franaise, op. cit.,
p.59.
(16) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., p. 378.
(17) Michel Vovelle. - La chute de la monarchie, op. cit., p. 132.
(18) Georges Lefebvre. - La Rvolution franaise, 1968, p. 149.
(19) Isabelle Bourdin. - Les socits populaires Paris pendant la
Rvolution, 1937, p. 109.
(20) Edmond Sorreau. - La loi Le Chapelier, Annales historiques de la
Rvolution franaise, janvier/fvrier 1931, p. 292.
(21) Jacques Attali. - ln : Au propre et au figur, une histoire de la
proprit, 1988,p. 299.
59
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
(22) Yvon Bizardel. - Les Amricains Paris pendant la Rvolution,
1972.
(23) Antoine de Baecque, Wolgang Schmalle, Michel Vovelle. - L'an 1
des droits de rhomme, 1988, p. 275.
(24) Christine Faur. - La dclaration des droits de rhomme de 1789,
1988, p. 106.
(25) Ibidem, p. 224.
(26) Antoine de Baecque. - L'an 1 des droits de rhomme, op. cit.,
p.285.
(27) Ibidem, p. 224.
(28) Ibidem, p. 278.
(29) Christine Faur. - La dclaration des droits, op. cit., pp. 277 et
278.
(30) Antoine de Baecque. - L'an 1 des droits de rhomme, op. cit.,
p.195.
(31) Ibidem, p. 230.
(32) Ibidem, p. 286.
(33) Christine Faur. - La dclaration des droits, op. cit., p. 104.
(34) J .-M.-J. Biaugeaud. - La libert du travail ouvrier sous rAssem-
ble constituante, 1939, p. 40.
(35) Sbastien Hardy. - Mes loisirs au journal, op. cit., t. 8, pp. 434-
455.
(36) Sigismond Lacroix. - Actes de la commune de Paris, 2
e
srie, op.
cit., t. 1, p. 416.
(37) Ibidem, p. 298.
(38) A.N. DI IV ISO.
(39) Marcel Reinhard. - La Rvolution 1789-1799, 1971, p. 216.
(40) J .-M.-J. Biaugeaud. - La Libert du travail ouvrier, op. cit.,
p.41.
(41) Ibidem.
(42) Michel Vovelle. - La chute de la monarchie, 1972, p. 139.
(43) Paul Chauvet. - Les ouvriers du livre en France de 1789 la cons-
titution de la Fdration du livre, 1956, p. 7.
(44) British Museum, F.R. 8,68.
(45) Ibidem.
(46) Paul Chauvet. - Les ouvriers du livre, op. cit., p. 23.
(47) Ibidem, p. 21.
60
L'ASSOCIATION EN CHANTIER
(48) 1. Bourdin. - Les socits populaires Paris, op. cit., p. 120.
(49) Ibidem.
(50) Les associations professionnelles ouvrires, Ministre du commerce
et de l'industrie, des postes et tlgraphes, 1899.
(51) Jean Nol Chopart. - Lefil rouge du corporatisme, op. cit., p. 67.
(52) Ibidem, p. 69.
(53) Georges Rud. - La foule dans la Rvolution franaise, op. cit.,
p.l05.
(54) Dictionnaire historique et biographique de la Rvolution franaise
et de l'Empire, 1789-1815. Sous la direction du Dr Robinet, 1975.
(55) Confdration nationale ou rcit circonstanci de tout ce qui s'est
pass Paris le 14 juillet 1790 la Fdration. B.N. Lb. 39.3768.
(56) Jacques Godechot. - Les institutions de la France sous la Rvolu-
tion et rEmpire, 1969, p. 214.
(57) Sigismond Lacroix. - Actes de la commune de Paris, 2
e
srie, op.
cit., t. 2, p. 58.
(58) E. Levasseur. - Histoire des classes ouvrires de rindustrie en
France de 1789 1870, 1903-1904, t. 1, p. 51.
(59) 1. Bourdin. - Les socits populaires Paris, op. cit., p. 110.
(60) Archives parlementaires, t. XXIII, p. 626.
(61) Ibidem, p. 200.
(62) Ibidem, p. 626.
(63) Jacques Godechot. - Les institutions de la France sous la Rvolu-
tion et rEmpire, op. cit., p. 214.
(64) AN. AD/XI/65.
(65) Ibidem.
(66) Florent Du Cellier. - Les classes ouvrires en France depuis 1789,
1859, p. 16.
(67) Maurice Bouvier Ajam. - Histoire du travail en France des ori-
gines la Rvolution, 1957, p. 703.
(68) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, t. 1,
op. cit., p. 874.
(69) Ibidem.
61
Chapitre III
LA CASSURE
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
La loi d'Allarde met un point final au mode fodal
d'organisation des mtiers. Les rapports soigneusement
codifis depuis des sicles entre matres et compagnons
deviennent caduques. Dsormais, le salaire ne sera plus
fix en vertu d'une tradition corporative. Le salaire sera
librement dbattu entre le patron et ses employs (1). Un
principe nouveau est pos, les conditions de sa mise en
uvre restent inventer. .
Les ouvriers n'ont pas attendu que leur travail soit offi-
ciellement assujetti la loi de l'offre et de la demande, pour
dcouvrir les vertus de l'action collective. La nouvelle
donne les incite renforcer l'organisation de leurs mouve-
ments. L'historienne Grace M. Jaff a montr que la
demande de main d'uvre tait considrable (2) au prin-
temps 1791. Le duc de la Rochefoucauld-Liancourt recon-
nat le 16 juin le caractre favorable de la conjoncture pour
les salaris: l'espce de coalition mme de plusieurs
ouvriers qui s'entendent pour demander un grand hausse-
ment dans leurs salaires, semble prouver seule qu'il y a
moins d'ouvriers que de moyens de travail (3).
Des diffrences d'attitude sont perceptibles parmi les
entrepreneurs et la nouvelle classe dirigeante sur la conduite
tenir l'gard des associations ouvrires. Paradoxale-
ment, l'influence des ides d'Adam Smith sur une fraction
de cette lite ne peut qu'alimenter les hsitations. Le fonda-
teur de la thorie du capitalisme libral est lu et comment
dans les milieux cultivs.
En 1790, l'occasion de la sortie de la deuxime traduc-
tion franaise de La Richesse , Condorcet en publie un
rsum chaleureux et didactique dans sa Bibliothque de
l'homme public . Siys, puise de nombreuses rfrences
dans la pense de l'conomiste cossais (4).
Adam Smith n'prouve aucune sympathie pour les asso-
ciations ouvrires : Les gens de mtiers se rassemblent
rarement, mme pour se divertir et prendre de la dissipa-
tion, sans que la conversation aboutisse une conspiration
contre l'ordre public ou quelque invention pour renchrir
leur travail. Mais il ajoute: il est impossible d'emp-
64
LA CASSURE
cher ces assembles par aucune loi qui soit excutable et qui
soit compatible avec la libert et la justice (5). Quelle que
soit l'influence d'Adam Smith sur les conceptions des Cons-
tituants, un certain flottement est perceptible sur le trac
des frontires du terrain associatif. Les autorits souhaitent
convaincre les ouvriers de renoncer leurs rassemblements
pour s'pargner les dsagrments d'une politique rpressive.
Avant d'aborder les tensions sociales du printemps de
1791, il convient de distinguer les oppositions existantes
dans les communauts de mtiers, des grandes pousses
populaires lies la faim, jouant un rle direct dans le pro-
cessus rvolutionnaire. Le prix du pain rglait la tempra-
ture de Paris avec la prcision d'un thermomtre (6).
L'associationnisme ouvrier ne possde qu'une influence
marginale sur le cours des vnements. Il fournit, en
revanche, de prcieuses indications sur l'tat d'esprit de la
main d'uvre salarie urbaine et pose l'une des grandes
problmatiques que devra affronter la socit franaise au
sicle suivant.
LA MODRATION DE BAILLY
Le conflit qui se noue partir d'avril 1791 entre les
ouvriers et les matres charpentiers, occupe une place
majeure dans le cours dsormais inexorable des vnements.
C'est moins son rle dclencheur qui importe, que l'pret,
la densit et l'intelligence de l'argumentation change. Les
ouvriers charpentiers, forts de la bonne marche des affaires
et de l'attitude conciliante du maire de Paris proposent aux
matres le 14 avril de tenir une runion de concertation pour
faire des rglements fixes relativement aux journes et aux
salaires des ouvriers (7). Les employeurs refusent de s'asso-
cier une telle procdure qu'ils qualifient d'illgale .
Aprs avoir attendu inutilement pendant quatre
jours , les compagnons dcident de fonder leur Union
fraternelle et de rdiger un rglement compos de huit
articles, aux nombres desquels figurent un seuil minimum
65
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
de 50 sols par journe et la mise en place d'un vritable
bureau de placement. Ils rfutent l'accusation de coalition,
en affirmant que leurs propositions correspondent des
conventions de gr gr, et soulignent le caractre
philanthropique de leur groupement. Dsireux de parvenir
un rglement ngoci, les ouvriers demandent au Maire de
Paris de se rendre mdiateur dans cette affaire .
La circonspection de Bailly reflte une indcision gn-
rale, mais tient aussi son caractre. Personnalit scienti-
fique et littraire respecte de l'Ancien rgime, il prside les
travaux de la Constituante en juin 1789 et concourt rendre
la Rvolution irrversible, le 20 juin l'occasion du serment
du Jeu de Paume. Sa rplique au marquis de Dreux-Brz le
23, qui lui demandait de faire vacuer la salle des Etats
gnraux, moins connue que celle de Mirabeau, mrite la
postrit: je crois que la Nation assemble ne peut rece-
voir d'ordre .
Adepte des valeurs philanthropiques, il a men en 1787,
aux cts du chirurgien Jacques Tenon et du duc de Laro-
chefoucauld-Liancourt, une enqute particulirement di-
fiante sur la terrible situation des hpitaux parisiens. Si les
initiateurs de la ptition des cent cinquante mille
ouvriers la dposent dans ses mains, la veille de l'ouver-
ture des Etats-gnraux, c'est disent-ils parce qu'il a su
retracer d'une manire si touchante les maux qui assigent
l'humanit dans l'asile des douleurs (8).
Bailly s'efforcera en permanence d'orienter la Consti-
tuante vers la prise en charge de la pauvret. Il persuade
l'Assemble nationale, au terme d'une vibrante plaidoirie
prononce le 20 janvier 1790 au nom de la misre pari-
sienne (9), d'instituer le fameux Comit de mendicit.
Le maire de Paris partage l'idologie contractuelle domi-
nante, mais le cheminement d'un savant et d'un humaniste
ne prdispose pas la matrise des conflits sociaux. Les
entrepreneurs et certains de ses collgues lui reprochent son
manque de fermet. C'est lui pourtant qui le 26 avril 1791
lance la premire sommation officielle aux travailleurs pari-
siens.
66
LA CASSURE
Le texte du maire de Paris, intitul Avis aux
ouvriers (10), s'adresse aux deux parties. L'admonestation
reste parternelle et rend hommage la classe estimable et
laborieuse des ouvriers, qui ... a toujours donn des
preuves les moins quivoques de son attachement la Cons-
titution ... . La loi ne doit pas, comme par le pass, pro-
fiter seulement aux riches. La libert nouvelle offre
chaque ouvrier la possibilit d'obtenir un salaire correspon-
dant ses talents. Mais il ne peut le stipuler que pour lui
individuellement; il ne peut l'exiger que lorsqu'il a t con-
venu de gr gr. S'il en tait autrement, il n'y aurait plus
de justice, ni par consquent, de vraie libert .
L'galit des droits ne saurait tre assimile celle des
facults et des talents. Les autorits municipales reprochent
aux ouvriers de proposer des prix uniformes pour les
salaires. Peu importe, que ces derniers affirment demander
un salaire minimum et non uniforme, ce qui domine c'est
l'impression que les charpentiers ont port atteinte l'une
des ides phares de la Rvolution: le primat du mrite indi-
viduel sur celui li la naissance.
L'autre volet de la mise en garde est plus politique. Les
ouvriers ressucitent par leurs coalitions les privilges corpo-
ratifs, qui ont pour effet de mettre la socit entire la
discrtion d'un petit nombre d'individus . Le corps muni-
cipal souhaite que les ouvriers gars renouent avec leur
patriotisme, sinon il sera contraint d' employer contre eux
les moyens qui lui ont t donns pour assurer rordre
public et maintenir rexcution des lois .
Quatre jours plus tard, les matres adressent une ptition
la municipalit l'informant que les ouvriers n'ont pas
modifi leur attitude. Les revendications ouvrires sont ill-
gales et ruineuses. Une augmentation subite d'un tiers sur
le prix de la main d'uvre de la charpente est donc impos-
sible (11). Les consquences des grves sont dramatiques
au point disent-ils qu' il en rsulte les plus grands prju-
dices pour les propritaires par le dfaut de solidit des bti-
ments. Certes, les ouvriers ne doivent pas tre des
esclaves, mais il leur faut admettre les nouvelles rgles:
67
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
plus de coalitions, plus de prix banal : et la concurrence
fixera naturellement les intrts mutuels .
Les ouvriers charpentiers justifient dans une nouvelle
ptition prsente la Municipalit le 5 mai, la mise sur
pied de leur organisation par le besoin de se soulager
mutuellement dans leur infirmit et leur vieillesse (12). Ils
rcusent toutes les accusations de violence et ritrent leur
demande d'une mdiation municipale. Les diles parisiens
apprcient d'autant moins la tnacit des charpentiers, que
d'autres catgories de travailleurs commencent suivre leur
exemple. A peine, Bailly a-t-il exhort la dputation des
ouvriers charpentiers retourner leurs travaux , ce
5 mai 1791, qu'une dlgation d'ouvriers attachs la cons-
truction du pont Louis XVI (pont de la Concorde) se
disant dputs de la part des 500 hommes composant rate-
lier, ont t introduits (13).
La municipalit, toutefois, montre peu d'empressement
pour appliquer les dcisions du Directoire lui enjoignant
de fermer tous les lieux vacants dans lesdites maisons ci-
devant cclsiastiques... (14). Les entrepreneurs qui ont la
conviction d'tre en symbiose avec le nouveau rgime, ne
dissimulent pas leur mcontentement l'gard des ater-
moiements de Bailly.
L'INCOMMUNICABLE QUESTION OUVRIRE
Comment les milieux rvolutionnaires les plus avancs,
notamment ceux qui ont vocation de commenter l'actualit,
peroivent-ils cette combativit ouvrire? Prudhomme,
consacre dans Les Rvolutions de Paris , class par J ac-
ques Godechot comme journal d'extrme gauche, un long
article sur le sujet (15). Le pamphltaire ne trouve pas la
revendication de cinquante sous excessive. La demande,
d'une mdiation municipale, en revanche, est une erreur
de droit qu'i1 est essentiel de relever... Entre celui qui tra-
vaille et celui qui fait travailler, il est tyrannique et absurde
qu'un tiers puisse contre le gr des contractants donner sa
volont par convention .
68
LA CASSURE
Il examine ensuite la dnonciation des matres portant sur
le caractre illgal de l'association ouvrire. Il ne rejette pas
formellement la justification d'entraide mutuelle donne
par les ouvriers charpentiers leur Union fraternelle .
Pourtant : ce motif est louable sans doute, et les dangers
auxquels, ils sont chaque jour exposs dans leur tat pour-
raient lgitimer cette association, si quelque chose pouvait
rendre lgitime ce qui est contraire rordre public. Mais
nous devons le dire avec vrit: une assemble o ne peu-
vent tre admis que les hommes qui exercent la mme pro-
fession, blesse le nouvel ordre des choses; elle porte
ombrage la libert ; en isolant les citoyens ; elle les rend
trangers la patrie, en leur apprenant s'occuper d'eux-
mmes; elle leur fait oublier la chose commune; en un mot
elle tend perptrer cet gosme, ces esprits de
dont on a voulu anantir jusqu'au nom .
C'est moins le patron qui s'exprime chez Prudhomme que
l'adepte de l'idologie librale des lumires . Il conseille
aux matres : de se dfaire promptement des vieilles habi-
tudes qu'ils ont contractes sous r ancien rgime r ombre
de leurs privilges. Reste, que malgr sa sympathie pour
les travailleurs, Prudhomme leur dnie catgoriquement le
droit de s'assembler par mtiers.
L'opinion sur le sujet de Franois Robert, rdacteur du
Mercure national et tranger est encore plus intres-
sante. Cet avocat des Ardennes, rvolutionnaire de la pre-
mire heure, s'installe Paris, aprs avoir t le comman-
dant gnral de la garde nationale de Givet (16). Il est l'un
des premiers s'exprimer en faveur de l'ide rpublicaine.
Sa brochure publie en dcembre 1790, le Rpublicanisme
adapt la France fait scandale dans une priode o la
formule d'Aulard : plus on est rvolutionnaire en 1789,
plus on est monarchiste (17) n'a rien perdu de sa perti-
nence. Aprs la fuite du roi, il sera le rdacteur de la pti-
tion exigeant sa dchance et la proclamation de la Rpu-
blique (18). La fusillade qui ponctuera la manifestation orga-
nise au Champ de Mars le 17 juillet, pour soutenir ce texte,
prcipitera la scission entre modrs et rvolutionnaires.
69
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Franois Robert est en ce printemps 1791, secrtaire du
comit central form par le Club des Cordeliers et les
socits fraternelles. Prcision capitale fournie par Rud :
Les dmocrates rvolutionnaires prodigurent secours et
encouragements aux compagnons charpentiers. Non seule-
ment les charpentiers se runissaient dans la mme salle que
le Club des Cordeliers, mais l'Union fraternelle des ouvriers
en r art de la charpente se trouvait galement affilie au
comit central form par le Club en mai 1791 (19).
Le journaliste du Mercure a des vises sur le monde
du travail. Selon Albert Mathiez, le comit central de
Robert ne se proposait rien moins que de grouper et de
coordonner, de diriger aussi le mouvement ouvrier (20).
Franois Robert s'exprime sur le diffrend opposant matres
et ouvriers charpentiers dans le numro du Il mai 1791 du
Mercure . Aprs avoir rsum la mise en garde de Bailly,
il avoue son embarras : ... que faire, que conclure dans
cette circonstance. Rien, sinon que de toutes parts, il y a des
torts .
Le journaliste fait preuve sur la libert d'association
d'une indniable ouverture d'esprit. Il admet que: ... les
ouvriers ont le droit de s'assembler, qu'i!s peuvent dlibrer
sur leurs intrts, qu'ils peuvent mme s'engager ne pas
travailler pour tels prix ; mais il ajoute il est galement
vrai qu'i!s ne peuvent ni forcer les entrepreneurs leur
accorder ce mme prix, ni dfendre leurs camarades de
travailler pour un prix moindre .
Tout en reconnaissant l'opposition d'intrt entre les
deux parties, il est franchement hostile la proposition des
ouvriers visant introduire un tiers dans ce tte tte. ...
Cette dmarche est fausse et injuste; ils reconnaissent, ils
attribuent la Municipalit un droit qu'elle n'a pas et bles-
sent videmment les droits des entrepreneurs ... .
Pour le secrtaire du comit central, la seule mthode
capable de rsoudre le problme est: La concurrence,
voil le seul taux du commerce, la seule rgle invariable
tous contrats d'change: un ouvrier donne son travail pour
de l'argent, il est libre de ne pas le donner qu' condition;
70
LA CASSURE
comme l'homme argent est le matre de ne donner son
argent que sous condition . Peu importe ensuite qu'il pro-
nonce des paroles svres l'gard des patrons et fasse l'loge
de la conduite patriotique des ouvriers, l'essentiel est dit.
S'en remettre aux seuls mcanismes du march pour
assurer la rgulation de rapports sociaux divergents, peut
difficilement avec le recul, s'interprter comme un soutien
la cause populaire. Pourtant, l'incomprhension de Robert
et de ses amis l'gard du caractre spcifique des aspira-
tions ouvrires, n'est pas toujours perue par les historiens,
quelle que soit d'ailleurs leur sensibilit.
Albert Mathiez voit dans l'article du Mercure une
protestation contre la dfense faite aux charpentiers de se
coaliser et souligne combien il faut apprcier toute
rimportance de ces paroles, alors trs nouvelles sous une
plume bourgeoise (21). Curieusement, le primat de la
logique marchande ne retient pas son attention. Sur un
autre versant, Pierre Gaxotte (22) prsente les socits
ouvrires comme de simples courroies de transmission des
Cordeliers. C'taient eux qui partir de mai 1791, avaient
organis les grandes grves de charpentiers, de typographes,
de chapeliers et de marchaux-ferrants ... .
Les rapports entre le mouvement revendicatif du prin-
temps 1791 et l'lite rvolutionnaire semblent achopper sur
une vidente incomprhension entre ces deux univers cultu-
rels. De ce point de vue, la rectification publie par le
journal de la Commune du 6 mai 1791, n'est pas qu'anec-
dotique. La dlibration du 4 mai de la section du Temple
prsente initialement comme favorable la ptition des
ouvriers charpentiers, concerne en fait celle des patrons
charpentiers. Sigismond Lacroix ajoute: nous ne
connaissons d'ailleurs sur la question aucune autre manifes-
tation de section et de comit de section (23).
FIN DE PARTIE
Alors que l'on ne se bouscule gure du ct des dmo-
crates rvolutionnaires pour prendre la dfense des ouvriers,
71
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
les matres harclent la municipalit pour obtenir la dissolu-
tion de 1' Union fraternelle. L'extension des conflits
d'autres professions provoque l'irritation des usagers ,
surtout quand ils sont royalistes et que cela permet de
dnoncer bon compte le nouveau cours. La Feuille du
jour du 10 juin 1791 signale trois ou quatre quartiers de
Paris agits par des rassemblements d'ouvriers mcontents
et dplore la coalition des garons cordonniers : de faon
que depuis trois jours, on ne peut tre ni ferr, ni chauss.
Tout ce dsordre tient la nullit des ressorts administratifs
qui n'ont ni force, ni jeu .
Bailly finit par cder aux pressions redoubles. Il ferme,
le Il mai, la salle de l'Archevch, ainsi d'ailleurs que celle
du couvent de l'Observance o se runissaient les Corde-
liers. Un point capital convient d'tre soulign, dans une
priode o la rue s'embrase facilement, les ouvriers sem-
blent n'avoir utilis d'autres moyens que la parole. La cor-
respondance abondante change entre Bailly, Lafayette et
de Gouvion major gnral de la garde nationale de Paris,
confirme l'absence d'incidents.
Bailly, le 26 avril, demande Gouvion de surveiller les
ateliers pour empcher les grvistes d'entraner ceux qui tra-
vaillent. Le major gnral rpond dans la journe, qu'il
prend toute disposition pour surveiller l'assemble de
l'Archevch. Il ajoute, ce qui en dit long sur le calme des
ateliers : J'ai l'honneur d'observer monsieur le maire
que si l'on recommande l'ordre une surveillance particu-
lire sur les ateliers des matres charpentiers, elle se rduira
rien parce que beaucoup de commandants de bataillon
ignorent absolument dans quelle partie de l'arrondissement
de leurs bataillons les ateliers sont situs (24).
Si les compagnons font preuve de sang-froid, ils ne
renoncent pas leurs revendications. L'Archevch leur
tant interdit, ils se rassemblent ailleurs. La municipalit
mesurant son impuissance faire cesser cette action
nomme, le 20 mai, trois commissaires pour se concerter
avec le Directoire du dpartement. Le dnouement est
proche, mais l'affrontement demeure circonscrit au
72
LA CASSURE
domaine des ides. Nombre d'arguments changs par les
ouvriers et les matres charpentiers dans leurs dernires pti-
tions tmoignent, deux sicles de distance, d'une ton-
nante modernit.
Les matres charpentiers dans un prcis adress
l'Assemble Nationale, le 22 mai 1791 refont l'historique du
conflit dans lequel les ouvriers runis en corporation ... se
sont rigs et constitus en assemble dlibrante (25). Les
employeurs rappellent les dangers irrparables d'assem-
bles corporatives d'ouvriers, qui tendraient augmenter
les salaires et qui en forceraient l'augmentation par la dser-
tion des travaux: exemple qui pourrait se propager dans
toutes les manufactures de l'empire et porter le coup le plus
fatal au commerce; en effet, les fabrications franaises ne
pourraient plus soutenir la concurrence avec celles de
l'tranger . Les entrepreneurs attendent de la sagesse de
l'Assemble Nationale qu'elle rendra un dcret l'effet
d'empcher la formation de toute espce de corporation
nuisible au progrs du commerce et de sa libert .
Les ouvriers ripostent les 26 mai et 2 juin par deux longs
prcis adresss la Constituante. Ils s'attachent rfuter
point par point les allgations des matres. Non seulement,
ils s'insurgent contre l'accusation qui les prsente comme de
dangereux perturbateurs, mais ils retournent le compli-
ment: Au surplus, si nous voulions dnoncer comme les
ci-devant matres, nous dirions qu'ils s'assemblent journel-
lement, qu'ils se coalisent et qu'ils s'entendent ensemble
pour ne donner aux ouvriers que le moins qu'ils pourront,
de sorte qu'un ouvrier, en se prsentant chez un entrepre-
neur, est oblig d'accepter le prix qu'il lui offre, puisqu'il
est certain de ne pas avoir davantage chez un autre. Ils le
nieront sans doute. Mais les preuves existent ... Or, dans ce
cas-l, les ouvriers ne peuvent faire aucune rclamation
pour faire valoir leur droit (26).
Les employeurs jouissent de la libert de se concerter. Les
salaris en sont privs. Or, l'Assemble Nationale, en
dtruisant tous les privilges et les matrises et en dclarant
les Droits de l 'homme, a certainement prvu que cette
73
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
dclaration servirait quelque chose la classe la plus indi-
gente, qui a t si longtemps le jouet du despotisme des
entrepreneurs .
Le 2 juin les ouvriers en l'art de la charpente ritrent
leur hostilit la corporation, qui faisait notre mal-
heur (27). Ils utilisent pour prciser la fonction de bienfai-
sance de l'Union fraternelle un terme destin faire
carrire: l'homme honnte cherche adoucir le sort de
ses semblables ; eh bien ! telles sont nos intentions, et ce ne
sont pas les leurs; car ils s'opposent autant qu'ils peuvent
l'tablissement que nous faisons. Nous formons une caisse
de secours mutuels pour les malades et les infirmes si fr-
quents dans notre tat .
L'expression caisse de secours mutuels semble appa-
ratre ici pour la premire fois. A dfaut d'en reconnatre
l'existence le contexte rvolutionnaire aura permis de forger
le mot. In fine, les 120 ouvriers charpentiers signataires for-
mulent leur totale confiance dans les dcisions de l'Assem-
ble nationale.
Dans les premiers jours de juin une autre profession entre
en scne, celle des marchaux-ferrants. Les termes du dbat
entre matres et ouvriers sont identiques ceux des charpen-
tiers. Ils dessinnent un type de confrontation sociale, qui
n'est pas encore venu maturit. L'heure n'est pas la
recherche d'un hypothtique consensus. Les patrons mar-
chaux s'adressent le 7 juin l'Assemble nationale pour
rclamer l'excution de vos dcrets et demander tre
soustraits l'espce de tyrannie que leurs ouvriers exercent
aussi contre eux (28).
Les entrepreneurs brossent un tableau dramatique de la
situation parisienne: C'est la coalition gnrale de 80 000
ouvriers de la capitale; c'est la runion d'une masse
immense d 'hommes qui croient devoir tre diviss d'intrts
et de principes avec le reste de leurs concitoyens; les serru-
riers, les cordonniers, les menuisiers commencent dj
suivre les traces des charpentiers et des marchaux, les
autres n'attendent que la russite des premiers pour suivre
les mmes errements .
74
LA CASSURE
L'historienne Grace M. Jaff dans le cadre de l'tude sys-
tmatique qu'elle a consacr cette priode ne trouve pas
de trace de violence et encore moins de prparation
l'meute de la part des ouvriers charpentiers et marchaux.
Elle est galement formelle sur la suppose coalition gn-
raie : ... on ne trouve aucune mention d'une association
gnrale des ouvriers nulle part ailleurs (29), que dans la
ptition des matres marchaux.
Reste la lettre publie dans L'Ami du Peuple, le
12 juin, au nom des 340 ouvriers charpentiers du chantier
de l'glise Ste-Genevive, qui dnonce nommment une
dizaine d'entrepreneurs. Jean Jaurs souligne le ton agressif
de la lettre (30), mais ne formule aucune remarque sur son
authenticit. Grace M. J aff ne cache pas son scepticisme.
Ce texte tranche avec les prises de positions antrieures.
Nous pensons que la lettre que l'on a suppose l'expres-
sion de la violence ouvrire n'est qu'une diatribe passionne
de la plume du fougueux journaliste, de Marat lui-
mme (31), estime l'historienne.
Provocation journalistique ou non, cette lettre est le seul
excs sur lequel le Comit de Constitution peut s'appuyer
pour instruire charge contre les salaris. Le souci exprim
en permanence par les compagnons de trouver un com-
promis acceptable pour les deux parties, s'est heurt une
brutale fin de non-recevoir. L'onde de choc provoque par
la cassure amorce sa longue trajectoire.
75
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
NOTES
(1) Noyelles. - Cours d'conomie politique, 1936/1937, p. 84.
(2) Le mouvement ouvrier Paris pendant la Rvolution franaise, op.
cit., p. 101.
(3) Sigismond Lacroix. - Les actes de la commune, op. cit., t. 5,
p.233.
(4) Gilbert Faccarello. - L'conomie politique.- In: rEtat de la
France pendant la Rvolution, 1988, p. 425.
(5) La richesse des nations, 1800, t. 1, pp. 124-125.
(6) Eric J. Hobsbawn. - L're des rvolutions, 1988, p. 88.
(7) Sigismond Lacroix. - Les actes de la commune, op. cit., 21 mai
1791, p. 350.
(8) Chassin. - Les lections et les cahiers de Paris, op. cit., t. 2, p. 592.
(9) Ferdinand Dreyfus. - Larochefoucauld-Liancourt un philanthrope
d'autrefois, 1903, p. 147.
(10) B.N. Fol. PIano. Lb40.1.
(11) Sigismond Lacroix. - Les actes de la commune, op. cit., 30 avril
1791, p. 92.
(12) Ibidem, op. cit., 5 mai 1791, p. 144.
(13) Ibidem, p. 136.
(14) Ibidem, t. 4, p. 83.
(15) Les Rvolutions de Paris , n 96 du 7 au 14 mai 1791, B.N.
8 Lc2.171.
(16) Isabelle Bourdin. - Les socits populaires Paris, op. cit.,
p. 163.
(17) Cit par Ferdinand Dreyfus. - Larochefoucauld-Liancourt, op.
cit., p. 90.
(18) Albert Mathiez. - Le club des Cordeliers pendant la crise de
Varennes et le massacre du Champ de mars, 1910, p. 44.
(19) La foule dans la Rvolution franaise, o p ~ cit., pp. 104-105.
(20) Le club des Cordeliers, op. cit., p. 31.
(21) Ibidem.
(22) La Rvolution franaise, 1988, p .. 170.
(23) Sigismond Lacroix. - Les actes de la Commune, op. cit., 6 mai
1791, p. 152.
(24) B.N. Fonds franais, 11697.
76
LA CASSURE
(25) Prcis prsent rAssemble nationale par les entrepreneurs de
charpente de la ville de Paris, 22 mai 1791, Bibliothque Nationale
4
e
FM. 35345.
(26) Rfutations des ouvriers en rart de la charpente la rponse des
entrepreneurs, A.N.AD/XI/65.
(27) Ibidem.
(28) Sigismond Lacroix. - Les actes de la commune, op. cit., 4 juin
1791, p. 485.
(29) Le mouvement ouvrier Paris, op. cit., pp. 154-155.
(30) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., t. 1, p. 912.
(31) Le mouvement ouvrier Paris, op. cit., p. 165.
77
CHAPITRE IV
LE DESPOTISME DU CONTRAT
79
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Dans la deuxime quinzaine de mai 1791, le corps muni-
cipal avait nomm trois commissaires pour se concerter avec
le Directoire du dpartement. Cet organisme dirig par le
. procureur gnral syndic, de Pastoret, avait cart tout
esprit de conciliation. Ironie de l'histoire, le chevalier de
Pastoret issu de la noblesse de robe, sera au dbut du XIxe
sicle l'un des principaux animateurs de la Socit philan-
tropique, dont on connat le rle essentiel dans l'essor des
socits de secours mutuels.
Au terme de la confrence entre la municipalit et le
dpartement, il est dcid de s'adresser au Comit de
Constitution pour lui exposer les faits et prendre son avis
sur les principes qui doivent diriger la conduite de l'admi-
nistration (1). La dmarche des autorits locales intervient
dans un climat de crispation scuritaire. Les graves inci-
dents survenus le 28 fvrier 1791 : meute au faubourg
St- Antoine, destruction par la foule du parapet du donjon
de Vincennes, rassemblement de 400 aristocrates arms de
poignards, ont provoqu une profonde inquitude.
Concidence troublante, le mme jour Le Chapelier avait
prsent devant la Constituante un rapport sur le respect
d la loi . Il avait fait adopt, malgr une vive opposi-
tion, de Ption et de Robespierre, le principe selon lequel
aucune section ne participe la souverainet ; celle-ci
ne devant s'exercer que dans l'assemble nationale. Par-
tout ailleurs il n'y a pas que des sujets qui doivent mettre
leur vu et obir avait-il conclu (2).
Le 26 avril, Bailly pour la ville et Larochefoucauld-Lian-
court pour le dpartement signent une adresse demandant
l'Assemble nationale l'laboration d'un nouveau code
pnal pour assurer le maintien de l'ordre. L'Assemble
acquiesce et adopte le 10 mai 1791 une loi limitant le droit
de ptitions et d'affiches. Le climat politique ne joue pas en
faveur des ouvriers parisiens.
80
LE DESPOTISME
UN CONSTITUANT MODLE
L'image d'un personnage historique varie en fonction de
l'poque et du lieu d'o on l'observe. Le Chapelier, moins
que tout autre, n'chappe cette constatation banale. La loi
anti-associative du 14 juin 1791 qui assure aujourd'hui sa
notorit est ignore par les biographes du XIXe (3). Louis
Blanc, Adolphe Thiers, Michelet, Taine, l'exception de
Roux et Buchez, ne prtent le moindre intrt une loi que
rien ne semble distinguer de la couleur du temps.
Le Chapelier Isaac-Ren-Guy nat Rennes en 1754. Fils
d'un avocat, btonnier de l'ordre, il devient trs jeune un
matre du barreau. En 1788, fort des titres de noblesse
obtenus par son pre, il fait campagne pour que les anoblis
de frache date puissent tre dsigns comme reprsentants
de la noblesse. L'chec de cette dmarche a probablement
nourri de solides prventions anti-aristocratiques. Il mani-
feste lors des affrontements de janvier 1789 contre la
noblesse du Parlement de Rennes, la tte du Tiers-Etat,
un courage et une dtermination remarqus.
Son action faillit tourner court, le Tiers-Etat de Bretagne
l'ayant cart en raison de son statut d'anobli. Le 13 avril,
la dcision est rapporte et Le Chapelier est nomm repr-
sentant du Tiers. Dput de Rennes aux Etats Gnraux,
il arriva Versailles avec une rputation d'audace et d'habi-
let, et il ft presque aussitt un des orateurs dont les
paroles rpondirent le mieux aux sentiments de la moyenne
des constituants (4).
Le Chapelier s'impose d'emble comme l'un des cham-
pions de la bourgeoisie rvolutionnaire. Il dnonce le 1 er
juillet 1789, en des termes encore peu usits la responsabi-
lit de la cour et du roi dans la crise: C'est, dit-il, cette
espce de violation, cette usurpation de l'autorit excutive
sur l'autorit lgislative (5). Il fonde la Socit des amis
de la Constitution , plus communment appele le Club
breton , qui devient le Club des Jacobins .
Prsident plusieurs reprises de l'Assemble nationale, il
dirige la s ~ n c e historique de la nuit du 4 aot 1789. Sa
81
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
prsidence ft remarquable, en ce qu'i! saisit l'occasion de
s'arroger le premier la prminence sur le roi (6). Ses dons
d'improvisation et son talent oratoire sont reconnus. Le
comte de Montlosier, l'un de ses adversaires, affirme : ...
Il n' a cd en talent qui que ce soit, pas mme Mira-
. beau (7).
Ses capacits intellectuelles et morales sont plus diverse-
ment apprcies. Pour Bouvier-Ajam, c'tait surtout un
arriviste d'intelligence mdiocre (8) ; Camille Desmoulins
le qualifie d' ergoteur misrable (9); en revanche,
Aulard le considre comme run des lgistes de rAssem-
ble, un des rdacteurs de la Constitution, un des rappor-
teurs les plus couts (10).
Son uvre parlementaire est impressionnante. On y
relve plus de trois cents interventions sur les sujets les plus
varis, parmi lesquelles: la nationalisation des biens du
clerg en novembre 1789, la nomination des juges par le
peuple, le 5 mai 1790, l'abolition des titres de noblesse, le
9 juin 1790, l'adoption du drapeau tricolore, le 21 octobre
1790 et la loi du 29 juillet 1791, garantissant aux crivains la
proprit de leurs uvres, la plus sacre, la plus lgitime,
la plus inattaquable et... la plus personnelle des pro-
prits , proclame-t-il.
Jusqu' la fuite du roi, Le Chapelier mne un combat
vigoureux contre les privilges de l'Ancien rgime. Une
anecdote rapporte par Aulard montre l'hostilit des aristo-
crates son gard. Aprs qu'il ait dnonc l'Assemble, le
Parlement de Rennes comme le symbole de ce que les
abus ont de plus odieux, r aristocratie de plus absurde, la
fodalit de plus barbare... les royalistes devaient se venger
de faon la plus odieuse. Ils allrent en nombre attaquer Le
Chapelier dans un caf et le jetrent par la fentre (11).
Il rompt avec les Jacobins aprs Varennes et se joint
comme la plupart des constitutionnels aux lments
modrs du Club des Feuillants , pour tenter d'enrayer
la radicalisation provoque par la fuite du roi. Son dernier
acte lgislatif sera de prsenter, le 29 septembre 1791, la
veille de la clture de la Constituante, un projet de loi qui
82
LE DESPOTISME
interdit aux clubs, associations et socits d'avoir sous
aucune forme une existence politique. Il est temps, mar-
tle Le Chapelier, d'arrter le processus rvolutionnaire.
Lorsque la Rvolution est termine, lorsque la Constitu-
tion est fixe ... alors il faut que tout rentre dans l'ordre le
plus parfait (12). La cohrence de sa conception du rgime
reprsentatif se retrouve entirement dans ce dernier rap-
port.
Le Chapelier passe en Angleterre la fin de l'anne 1791.
Il revient Paris pour empcher la rnise sous squestre de
ses biens. Accus de conspiration, notamment au profit de
l'Angleterre, il est excut le 30 avril 1794 en compagnie de
Malesherbes et du comte de Chateaubriand, convaincus
d'tre auteurs ou complices des complots qui ont exist
depuis 89 contre la libert, la sret et la souverainet du
peuple... (13).
LA LOI TERRIBLE (14)
Jaurs souligne, par ce qualificatif, les dommages dura-
bles causs au monde du travail. Il suggre que la loi du
14 juin 1791 consacre aux associations ne pouvait avoir,
dans l'esprit de ses auteurs, la brutalit que prs d'un
sicle d'histoire ouvrire devait lui donner. Aussi doit-on
faire l'effort de lire, sans l'abstraire de son cadre histo-
rique, le rapport liminaire cette loi prsente par Le Cha-
pelier. Ce qui n'implique aucune adhsion la thse de la
Loi de circonstance , pro ne nagure par Germain
Martin et Henri Se.
Les aspects conjoncturels pour secondaires qu'ils soient
ne sont pas ngliger. La thse d'un vaste complot contre
l'ordre public tient une large place dans la premire partie
de l'expos des motifs. Citant une correspondance adresse
par la municipalit d'Orlans, Le Chapelier y voit une
entreprise de dsordre et de violence mene l'chelle natio-
nale.
L'affaire d'Orlans est dmesurment grossie. L'incident,
83
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
qui date de cinq semaines, a t matris sans peine. Une
brochure, rdige par un observateur proche des autorits,
le dit clairement. Les ouvriers d'Orlans informs que leurs
compagnons parisiens avaient obtenu certaines augmenta-
tions de salaires, s'taient rassembls devant l'Htel de ville
pour demander qu'on doubla la paye ... la municipalit
tint bon, se refusa tout et en imposa cette horde furieuse
par l'arrestation des trois plus mutins (15). Le chroniqueur
conclut ... une proclamation acheva de mettre le calme .
La peur des coalitions ouvrires au sein de la Constituante
n'est probablement pas feinte, mais les faits invoqus pour
la justifier sont minces, sinon inexistants.
Les motivations idologiques sont plus srieuses. Le Cha-
pelier mne son rquisitoire contre les associations ouvrires
sur trois plans. Le premier assimile les groupements profes-
sionnels la reconstitution des corporations. Or, il n'y a
plus de corporation dans l'Etat; il n'y a plus que l'intrt
de chaque individu et l'intrt gnral. Il n'est permis per-
sonne d'inspirer aux citoyens un intrt intermdiaire, de les
sparer de la chose publique par esprit de corpora-
tions (16).
Le second, plus original, qualifie de motifs spcieux
la notion d'entraide mise en avant par les ouvriers pour jus-
tifier leurs associations. L'avocat rennais voque le tradi-
tionnel soupon du double jeu. Il argue que l'organisation
des secours relve dsormais de la Nation. La municipalit
est vivement blame d'avoir autoris les rassemblements
d'ouvriers sous le prtexte d'assistance aux malades et aux
infirmes.
Le troisime argument, plus puissant, probablement celui
qui rassemble les constituants, traite du mode de rgulation
des rapports sociaux. Les coalitions ont le tort d'engendrer
l'augmentation du prix de la journe de travail, alors qu'il
faut s'en tenir au principe que c'est aux conventions
libres, d'individu individu, fixer la journe pour chaque
ouvrier .
Tout en rappelant la rgle d'or qui doit prsider au fonc-
tionnement d'une conomie librale idale, le rapporteur
84
LE DESPOTISME
exprime le vu que le salaire ouvrier soit plus consid-
rable qu'il rest prsent afin que celui qui le reoit soit
hors de cette dpendance absolue que produit la privation
des besoins de premire ncessit, et qui est presque celle de
l'esclavage . Les murmures (17), que provoque le rap-
porteur donnent la mesure du conservatisme social au sein
de l'Assemble.
Ce frmissement dsaprobateur confre rtrospective-
ment Le Chapelier un brevet de progressisme aux yeux de
certains observateurs. Ernest Lavisse, crit: ainsi mme
dans une assemble bourgeoise, bien peu favorable aux
droits ouvriers, une voix autorise reconnaissait que tout
travailleur a droit la suffisante vie et que la libert civile et
politique ne peut s'accommoder de resclavage cono-
mique (18).
En conclusion, le rapport souligne que la loi est qui-
table, puisqu'elle vise prvenir les coalitions pouvant se
former de part et d'autre. La proclamation d'une stricte
neutralit entre les deux parties ne sera pas mme observe
formellement, puisque Le Chapelier acceptera un amende-
ment excluant les Chambres de commerce du champ
d'application de la loi. ... Vous imaginez bien qu'aucun
de nous n'entend empcher les commerants de causer
ensemble de leurs affaires admet-il. '
De fait, l'article 2, qui a fait la rputation de la loi, n'a
jamais vritablement concern que les seuls salaris.
Article 2 : Les citoyens d'un mme tat ou profession, les
entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers
d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront
ensemble se nommer ni prsident, ni secrtaire, ni syndic,
tenir des registres, prendre des arrts ou dlibrations,
former des rglements sur leurs prtendus intrts com-
muns .
Les termes du choix arrt sont limpides : au conflit de
deux liberts, la libert d'association contre la libert du tra-
vail, l'arbitrage de la Constituante fait prvaloir celle qui est
la plus favorable la bourgeoisie (19).
85
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
L'MERGENCE DE L' TAT PROVIDENCE
L'invocation de l'assistance publique pour mieux
contester la lgitimit des caisses de secours est spcieuse.
Les secours tatiques n'ont pas encore dpass le stade des
intentions. Malgr cela les justifications de Le Chapelier ne
peuvent tre considres comme un alibi. Le rapporteur du
Comit de constitution se rfre directement aux projets du
Comit de mendicit form par la Constituante au dbut de
1790. Ce Comit nous apparat comme la rsultante du
mouvement philanthropique prrvolutionnaire et comme le
point de dpart de l'uvre de la Rvolution en matire de
bienfaisance , dit Camille Bloch (20).
La personnalit de son prsident, le duc de Larochefou-
cauld-Liancourt, symbolise parfaitement cette transition
entre les deux poques. Dput de l'Oise la Constituante,
il accomplit son uvre principale en matire d'assistance,
en prsentant les sept premiers rapports du Comit de men-
dicit de juin 1790 janvier 1791. Les ides et les plans
adopts par le Comit et approuvs par l'Assemble, mar-
quent une tape essentielle dans l 'histoire de la protection
sociale franaise. Larochefoucauld-Liancourt est l'un de ces
hommes dont les ides ont franchi leur poque... (21).
Le premier rapport dclare solennellement ce grand
principe longtemps mconnu dans les institutions sociales:
la misre des peuples est un tort des gouvernements ...
Aucun Etat n'a considr les pauvres dans la Constitu-
tion... On a toujours pens faire la charit aux pauvres et
jamais faire valoir les droits de l'homme pauvre sur la
socit et ceux de la socit sur lui (22).
Le principe de l'galit des droits adopt par la nouvelle
socit doit s'appliquer aux secours en cas de malheurs et de
besoins. L'article 1 er du projet de dcret inscrit dans le troi-
sime rapport lu par Liancourt le 3 septembre 1790, prfi-
gure les grandes dcisions rvolutionnaires en matire
d'assistance: L'Assemble nationale dclare qu'elle met
au rang des devoirs les plus sacrs de la Nation l'assistance
aux pauvres dans tous les ges et toutes les circonstances de
86
LE DESPOTISME
la vie et qu'il y sera pourvu, ainsi qu'aux dpenses pour
l'extinction de la mendicit sur les revenus publics, dans
l'tendue qui sera juge ncessaire (23).
Considrable sur le plan conceptuel, l'uvre de la Consti-
tuante est sensiblement plus modeste sur les ralisations.
Elle inscrit dans la Constitution de 1791, au titre des garan-
ties fondamentales, la disposition suivante: Il sera cr et
organis un tablissement gnral de secours publics, pour
lever les enfants abandonns, soulager les pauvres infirmes
et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas
pu s'en procurer .
En dpit d'hsitations perceptibles et surtout de la bri-
vet de son mandat, la Constituante a accumul de remar-
quables matriaux pour les assembles suivantes. En
revanche, les salaris se voient privs des moyens de protec-
tion dont ils s'taient dots, en change de principes gn-
reux mais abstraits. Dans l'esprit des constituants, le devoir
d'assistance de la Nation concerne les indigents, catgorie
laquelle les gens "de mtiers n'ont pas le sentiment d'appar-
tenir.
La socit fraternelle est leur bouclier contre les affres de
la grande indigence, particulirement de l'hpital, qui
demeure, d'aprs Larochefoucauld-Liancourt le haut lieu
de la douleur. La mise l'index des socits d'entraide
mutuelle, ne peut qu'accrotre l'inscurit quotidienne des
gens de mtiers. La discrtion des dmocrates rvolution-
naires sur les propositions de Le Chapelier, n'en parat que
plus surprenante.
LE SILENCE DE LA GAUCHE
Seul, Gaultier-Biauzat, met de timides rserves sur le
rapport du Comit de Constitution. Le dput de Clermont-
Ferrand, est un modr qui s'tait oppos le 3 aot 1789
la dclaration des droits. Bien que partageant sur le fond la
volont d'en finir avec l'esprit de corporation, il demande le
renvoi du projet la sance du lendemain pour donner
87
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
l'Assemble le temps de la rflexion, car dit-il, je dsire-
rais qu'on ne portt pas atteinte la libert qu'on a de
s'assembler quelquefois (24). Le Chapelier n'a gure de
difficult faire repousser l'ajournement en invoquant la
fermentation Paris et en province.
Il est probable que Robespierre n'a vu l qu'une pr-
caution justifie, l'gard des particularismes corporatifs
susceptibles de nuire l'unit nationale ... estime l'un de
ses biographes (25). Cette explication, la plus couramment
avance en raison de l'troite filiation de pense entre Rous-
seau et Robespierre, ne dissipe pas entirement le mystre.
Le dput d'Arras avait livr les 9 et 10 mai un vigoureux
combat contre le projet de limitation du droit de ptition et
d'affiche, galement prsent par Le Chapelier.
Dans ce rapport, la rfrence aux corporations, tait
omniprsente. Robespierre ne s'tait pas laiss intimider par
cet argument d'autorit. Il avait pris, malgr les quolibets,
la dfense des droits spcifiques des pauvres : Eh ! Mes-
sieurs, le droit de ptition ne devrait-il pas tre assur d'une
manire plus particulire aux citoyens non actifs ? Plus un
homme est faible et malheureux, plus il a de besoins, plus
les prires lui sont ncessaires . L'affrontement entre
Robespierre et Le Chapelier avait revtu une telle vigueur,
que le prsident de sance rappela ce dernier l'ordre.
Le mutisme qu'observe le dirigeant jacobin le 14 juin,
reflte, selon Jean Jaurs, un manque de clairvoyance dans
l'ordre conomique. Le dput d'Arras n'a pas pressenti les
oppositions sociales qui surgiraient la faveur de l'essor de
l'industrie. Sans doute la prdominance encore marque
de la petite industrie lui cachait le problme (26). Deux
jours aprs la loi Le Chapelier, Robespierre demeure une
nouvelle fois silencieux, lors de la suppression des ateliers
parisiens de charit, qui prive de toutes ressources vingt
mille ouvriers.
La presse rvolutionnaire n'est pas plus prolixe. Camille
Desmoulins ne dit mot dans les Rvolutions de France et
du Brabant ; Prudhomme se contente de publier le texte
de loi sans commentaire. La presse monarchiste exprime
88
LE DESPOTISME
son approbation; c'est le cas du Le Babillard , du
16 juin: Plusieurs ouvriers se plaignent du dcret qui
rend aux matres la libert de rcompenser les talents et
ractivit; cette loi contrarie les fainants et les ignares qui
foraient les entrepreneurs les payer comme bons
ouvriers .
Le 17 juin, l'Ami du roi estime que ... resprit de
licence et d'insubordination est rpandu dans le peuple ... Si
M. Chapelier veut contenir le peuple dans le devoir, emp-
cher les attroupements, les associations sditieuses, qu'i!
commence donc par tablir une force publique. Mais le
ct gauche ... s'est mis lui-mme dans la dpendance du
peuple . Nul doute pour le journaliste monarchiste: les
ouvriers continueront de s' assembler sans craindre les
amendes, les excommunications, les dgradations civi-
ques .
Marat est une nouvelle fois le seul protester contre la
loi Le Chapelier. Comme pour la loi d'Allarde, Jaurs a
beau jeu d'observer qu'il n'a visiblement pas saisi la
porte de la future loi (27). Le directeur de l'Ami du
peuple ne voit dans les restrictions touchant le droit
d'association au sein des mtiers, qu'un simple complment
politique des limitations apportes au droit de ptition. Ce
n'est d'ailleurs que de faon subsidiaire, qu'il aborde la loi
Le Chapelier dans un article (28) essentiellement consacr
aux mesures destines empcher les citoyens de
s'occuper en commun de la chose publique .
En considrant l'interdiction faite aux travailleurs de
s'assembler, comme l' uvre de dputs presque tous
prostitus la Cour , Marat commet un contresens. La
Constituante consacre le principe de la libre concurrence et
le pouvoir des entrepreneurs. Il parat vraisemblable dans
cette perspective que la loi Le Chapelier ait t conue par
ses promoteurs, du moins en partie, comme un acte de
dfense rvolutionnaire: . . . les dputs patriotes crai-
gnaient que les associations ouvrires, les compagnonnages
ne devinssent des centres de propagande contre-rvolution-
naire (29). Le souvenir de la disgrce de Turgot provoque
89
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
par la cour, sous les applaudissements du peuple, est encore
dans de nombreuses mmoires. Cette explication n'puise
pas le sujet. Elle a le mrite de souligner la complexit des
mobiles des constituants dans cette affaire.
UN INDIVIDUALISME TATIQUE
L'exceptionnelle longvit de la lgislation contre les
associations ouvrires, sa stricte application au plus fort de
la terreur, montrent que la loi rpond aux exigences du
temps, parmi lesquelles le droit de proprit occupe la place
majeure. L o je ne vois point le respect des proprits,
je ne reconnais plus rordre social (30). La proccupation
de classe qui pointe ici chez Barre fournit- elle, pour
autant l'explication ?
Les rfrences idologiques des constituants sont ce
point diverses, que Jaurs emploie une expression hybride
pour cerner la personnalit de Le Chapelier. Celui-ci est :
... si je puis dire un individualiste tatiste (31). Le para-
doxe de la formule n'est qu'apparent, si l'on veut bien con-
sidrer que l'action des constituants se situe au point de
confluence de Rousseau, de Smith et des physiocrates.
La thorie rousseauiste de la ncessaire fusion de la
volont individuelle dans la volont gnrale, a procur au
combat des rvolutionnaires contre la socit d'ordres,
l'une de ses plus puissantes motivations. La proposition de
Rousseau de procder ... r alination totale de chaque
associ avec tous ses droits toute communaut (32), est
cependant conteste par Voltaire : tout cela est faux, je ne
me donne point mes concitoyens sans rserve .
Le Chapelier n'en a cure, puisqu'il cite littralement le
Contrat social , pour condamner l'esprit de corporation.
Quand il affirme: Il n) a plus de corporation dans
rEtat; il n'y a plus que rintrt particulier de chaque indi-
vidu et rintrt gnral. Il n'est permis personne d'ins-
pirer aux citoyens un intrt intermdiaire, de les sparer de
la chose publique, n'est-il pas l'cho presque parfait de
90
LE DESPOTISME
Rousseau : ... Il importe donc pour avoir bien l'nonc
de la volont gnrale qu'il n'y ait pas de socit partielle
dans l'Etat et chaque citoyen n'opine que d'aprs lui (33).
L'immensit de la tche et son caractre indit, obligent
les constituants rechercher des outils conceptuels les plus
divers et parfois opposs: il n'y a rien de si exactement
contraire au mode de travail dcrit par Smith que celui qui
est dcrit et clbr par Rousseau (34). Depuis Quesnay,
l'cole physiocrate sous l'impulsion notamment de Turgot
et de Dupont de Nemours, avait prpar les esprits la
libert complte du travail et aux ncessits d'une concur-
rence sans frein. La pr,minence octroye l'agriculture,
source principale de richesse leurs yeux, a jet le discrdit
sur cette doctrine. La pense qui guide, dans la priode
rvolutionnaire, les forces nouvelles de l'industrialisme et
du commerce, semble tre davantage celle d'Adam Smith.
Nous avons vu la haute estime que lui portaient Siys et
Condorcet. Il apparat que l'audience de l'conomiste cos-
sais dpasse les cercles rudits. Ainsi le corps de l' orf-
vrerie, dans une ptition adresse l'Assemble nationale le
22 septembre 1790 en faveur d'une concurrence illimite,
cite le fait qu' Londres, dit M. Smith, c'est dans les fau-
bourgs affranchis des privilges des corporations qu'on
trouve les meilleurs ouvriers (35).
Le fonctionnement de la socit-march repose sur
l'change continu entre des besoins et des intrts stricte-
m ~ n t individuels. Le travail ne saurait chapper cette rgle
et son prix doit faire l'objet, comme n'importe quelle mar-
chandise d'un contrat conclu de gr gr. Comment parler
d'galit des droits, si la libert individuelle s'exerce sans
prendre en compte le rapport des forces sociales en pr-
sense? La lucidit de Turgot aurait pu aider les consti-
tuants trouver une rponse quitable. Il crit dans
Rflexions sur la formation et la distribution des
richesses : Le simple ouvrier, qui n'a que ses bras et son
industrie, n'a rien qu'autant qu'il parvient vendre
d'autres sa peine. Il la vend plus ou moins cher; mais ce
prix plus ou moins haut, ne dpend pas de lui seul; il
91
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
rsulte de l'accord qu'il fait avec celui qui paye son travail.
Celui-ci le paye le moins cher qu'il peut; comme il a le
choix entre un grand nombre d'ouvriers, il prfre celui qui
travaille au meilleur march. Les ouvriers sont donc obligs
de baisser leur prix l'envi les uns les autres. En tout genre
de travail, il doit arriver et il arrive que le salaire de
l'ouvrier se borne ce qui lui est ncessaire pour lui pro-
curer sa subsistance (36).
Confier l'Etat la charge des secours et s'en remettre
exclusivement l'individualisation des relations sociales,
reprsente une contradiction srieuse. Les contemporains ne
retiennent que la complmentarit des deux principes. La
socit industrielle et son cortge de douleurs ouvrires sont
encore en devenir. Les gens de mtiers demeurent trs large-
ment perus, en cette fin de XVIIIe, comme une catgorie
relevant de la domesticit ; assimilation qui a contribu
masquer les consquences alinantes de la loi Le Chapelier.
LA CONDITION SERVILE
La distinction tablie ds le dbut de la Rvolution, pri-
vant les citoyens passifs du droit de vote pour dfaut de
revenus, prsente les caractristiques d'une mesure de
classe. Ces dispositions censitaires peuvent aussi s'expliquer
par des motivations plus honorables. Seule la possession
d'un bien, ft-il modeste, garantit l'indpendance et le
civisme des citoyens: Les pauvres, dans l'tat d'igno-
rance et d'inorganisation o ils se trouvent, pouvaient ais-
ment devenir une clientle lectorale (37).
L'limination des domestiques du corps lectoral est
dcide sans soulever d'opposition. Le 9 juin 1791, la Cons-
tituante dcrte l'inligibilit de tout homme aux gages et
aux ordres habituels d'un autre . La formule peut prter
confusion dans une poque o le statut social des salaris
conserve une connotation domestique. Ainsi, le dcret du
19 juillet 1791, portant sur l'organisation de la police muni-
cipale et correctionnelle, dont l'un des articles stipule qu'en
92
LE DESPOTISME
cas de coups et de blessures la peine sera plus forte, si les
violences ont t commises ( ... ) par des apprentis, compa-
gnons et domestiques l'gard de leurs matres (38).
L'amalgame entre le salariat et la domesticit est explicite.
La vulnrabilit sociale et conomique des ouvriers face
aux entreprises de sduction des aristocrates est redoute
par tous les rvolutionnaires ... Marat dnonce dans l'Ami
du peuple du 7 avril 1791, une nouvelle tentative de
faire gorger les amis de la libert par la main mme des
pauvres qu'ils nourrissent . Il ajoute que les ministres aris-
tocrates et leurs agents ont attir dans la capitale une foule
d'indigents: ... une multitude de gardes du corps n'avait
pas rougi de se mettre la tte des ateliers et des bandes
d'ouvriers en qualit de piqueurs ... .
Les dmocrates rvolutionnaires, confirme Aulard,
redoutaient que les ouvriers, particulirement ceux des
banlieues, ne tombent sous l'influence des doctrines contre-
rvolutionnaires. Il cite l'appui de cette observation le fait
relat par La Bouche de Fer , du 1 er avril 1791 : Je
crois devoir vous dnoncer une chose de la plus haute
importance: j'ai vu hier, en me promenant hors de Paris,
des ouvriers aux travaux publics qui lisaient l'Ami du
Roi ; je me suis approch d'eux et j'ai entendu qu'ils
l'approuvaient (39).
La crainte de voir s'oprer la jonction entre les monar-
chistes et les ouvriers, en dpit de leur engagement majori-
taire dans le camp de la Rvolution n'est pas dnue de fon-
dement. L'adresse (40) prsente au roi par plus de trois
cents ouvriers de Paris, dont prs des trois-quarts origi-
naires du faubourg St-Antoine, vers la fin de l'anne 1791,
ne peut qu'alimenter cette mfiance.
Le texte porte des critiques svres contre le nouveau
rgime. La plume a pu tre tenue par un reprsentant de
l'aristocratie, mais les noms, accompagns du lieu de rsi-
dence, sont bien ceux d'ouvriers reprsentatifs des diff-
rents arts et mtiers de la capitale. Nous souffrons,
disent-ils, depuis longtemps sans murmurer, tous le flaux
qu'entranent aprs eux les grands changements: notre
93
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
patience a gal nos esprances, parce qu'on nous parlait de
bonheur, de libert, d'galit ... mais que cette illusion a peu
dur .
Aprs la dception vient la charge, dont on imagine la
source d'inspiration: Qu'ont fait les reprsentants du
peuple pour sa flicit ? Quels sont ceux dont le sort est
amlior? La libert, rgalit sont des chimres qui ont
rompu tous les liens de la socit, confondu tous les pou-
voirs, dtruit rordre, sem la division et produit tous les
maux dont nous, nos femmes et nos enfants sommes les
premires victimes .
Il est difficile d'apprcier le degr de reprsentativit d'un
tel document. L'adresse du 29 octobre 1790 des ouvriers de
plusieurs ateliers de Paris aux sections de la capitale (41),
dnonant les aristocrates qui voudraient semer le trouble et
la division semble y faire cho : ces desseins sont crimi-
nels sans doute, mais aussi les ouvriers qui se dclarent leurs
complices, en servant leurs projets sditieux .
Les indications d'ordre politique confortent les rfrences
culturelles, auxquelles adhrent spontanment les acteurs de
la Rvolution. Saint-Just crit, sans dtours: Un mtier
s'accorde mal avec le vritable citoyen: la main d'un
homme n'est faite que pour la terre ou pour les armes (42).
Soboul rapporte le mot de la fille du menuisier Duplay,
hte de Robespierre, femme du conventionnel Lebas:
suivant laquelle son pre soucieux de dignit bourgeoise,
n'et jamais admis sa iable run de ses serviteurs, c'est
dire de ses ouvriers (43).
Camus, futur initiateur des Archives nationales, l'un
des plus fermes caractres de rAssemble , selon Michelet,
recommande que le rapport de M. Le Chapelier soit
imprim en mme temps que les articles parce que je le crois
trs propre clairer les ouvriers sur leurs devoirs (44). Le
dput de Paris s'tait signal le 4 aot 1789, par la proposi-
tion d'adjoindre une dclaration des devoirs celle des
droits. Dans le cas prsent, seuls les devoirs sont voqus,
comme s'il s'adressait des gens de maison.
Le Chapelier veille, il est vrai, au respect formel du prin-
94
LE DESPOTISME
cipe d'galit entre salaris et employeurs en substituant le
terme d'entrepreneur celui de matres dont l'usage
demeure le plus courant. L'assimilation du monde ouvrier
la domesticit, conserve un bel avenir. Dans une lettre du
22 dcembre 1792, le ministre de l'Intrieur demande ses
services de prendre en considration le fait que les ouvriers
marchaux de la Saline de Dieuze se plaignent que leurs
gages sont trop modiques (45). Au dbut du XIXe sicle, le
Code civil napolonien emploiera indiffremment pour les
ouvriers le terme de gage ou de salaire.
Le continent ouvrier demeure encore trs largement
immerg. La distance, voire la condescendance observes
par les dmocrates rvolutionnaires, procde davantage de
la mconnaissance de sa fonction relle que du mpris. Le
dclenchement de la deuxime Rvolution (46), six jours
aprs le vote de la loi Le Chapelier, l'occasion de la fuite
Varennes, concentre pour longtemps l'attention sur des
enjeux qui transcendent les oppositions sociales. Le temps
de l'affirmation du rle messianique du monde ouvrier n'est
pas encore venu.
La dissuasion lgislative pointe contre l'association a
pour consquence immdiate de fragiliser la condition
ouvrire. Les socits d'entraide entrent dans un tunnel.
95
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
NOTES
(1) Sigismond Lacroix. - Les actes de la commune, op. cit., t. 4,
p .348.
(2) Archives parlementaires, Mavidal et Laurent, t. 23, 28 fvrier 1791,
p.563.
(3) Notamment : Nouvelle biographie gnrale depuis les temps les plus
reculs jusqu' 1850-60, Firmin-Didot Frres; Biographie univer-
selle ancienne et moderne, Michaud 1844, Dictionnaire de la Rvo-
lution franaise, E. Boursin, Album du centenaire de la Rvolution
franaise.
(4) Franois-Alphonse Aulard. - L 'loquence parlementaire pendant la
Rvolution franaise, 1882, p. 391.
(5) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., t. 1, p. 401.
(6) Franois-Alphonse Aulard. - L'loquence parlementaire, op. cit.,
p.392.
(7) Ibidem.
(8) Histoire du travail, op. cit., p. 705.
(9) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., p. 906.
(10) Franois-Alphonse Aulard. - L'loquence parlementaire, op. cit.,
p.390.
(11) Ibidem, p. 394.
(12) Archives parlementaires, le 29 septembre 1791, p. 617.
(13) Le Moniteur Universel, 30 avril 1794.
(14) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., p. 903.
(15) Grands dtails sur la grande meute excite Orlans par les
ouvriers, 5 mai 1791, B.N. Lb39. 4910.
(16) Archives parlementaires, 14 juin 1791, p. 210.
(17) Ibidem.
(18) Histoire de la France contemporaine, 1920, t. 1, p. 292.
(19) Michelle Vovelle. - La chute de la monarchie, op. cit., p. 174.
(20) L'assistance et fEtat en France la veille de la Rvolution, op.
cit.,p. 423.
(21) Maxime Leroy. - Histoire des ides sociales en, France, 1950,
p.319.
96
LE DESPOTISME
(22) Premier rapport du Comit de mendicit, Le Comit de mendicit
de la Constituante, 1790-1791, publis et annots par Camille
Bloch et Alexandre Tuetey, p. 328.
(23) 3
e
rapport du Comit de mendicit, Ibidem, p. 380.
(24) Les archives parlementaires, le 14 juin 1791, p. 211.
(25) Henri Guillemin. - Robespierre, 1987, p. 58.
(26) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., p. 911.
(27) Ibidem.
(28) L'Ami du peuple , n 498, 18 juin 1791.
(29) Jacques Godechot. - Les institutions de la France sous la Rvolu-
tion, op. cit., p. 217.
(30) Georges Rud. - La foule dans la Rvolution franaise, op. cit.,
p. 139.
(31) Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op. cit., p. 907.
(32) Du contrat social, livre premier, chapitre 6, 1988.
(33) Ibidem, livre deuxime, chapitre 3.
(34) Bertrand de Jouvenel. - Essai sur la politique de Rousseau. - In :
Du contrat social, op. cit., p. 437.
(35) A.N. AD/XI/65.
(36) Cit par Bouvier-Ajam. - Histoire du travail en France depuis la
Rvolution, 1969, p. 24.
(37) Michel Winock. - Chronique de 1789, tanne sans pareille, Le
Monde, 26/08/1988.
(38) J.-B. Duvergier. - Collection complte des lois, t. 3, p. 138.
(39) Franois Alphonse Aulard. - Histoire publique de la Rvolution
franaise (1789-1804), 1901, p. 100.
(40) Adresse des ouvriers de la ville de Paris prsente au roi, B.N.
Lb39.11162.
(41) Adresse des ouvriers de plusieurs ateliers de Paris aux sections de la
capitale, B.N. Lb39.9490.
(42) Cit par Bouvier-Ajam. - Histoire du travail en France, op. cit.,
p.30.
(43) Les sans-culottes, op. cit., p. 47.
(44) Archives parlementaires, 14 juin 1791, p. 212.
(45) A.N. F/12/1560.
(46) Michel Vovelle. - La chute de la monarchie, op. cit., p. 239.
97
Chapitre V
LE TROU NOIR
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Les historiens unanimes observent la foudroyante effica-
cit de la loi du 14 juin 1791 et l'absence totale d'opposi-
tion. Le constat peu discutable, prsente un inconvnient :
il rsulte avant tout de notre ignorance. Nous savons peu de
chose sur les attitudes rellement adoptes par les destina-
taires de la loi. Bien que le manque de traces matrielles tra-
duise une chute brutale de l'activit associative, il est peu
satisfaisant de l'tablir par dfaut.
Le voile pos sur l'association ouvrire, au dbut de l't
1791, peut-il tre lev? Le simple bon sens nous autorise
penser que la rsurgence multiforme de l'association
ouvrire, l'ore du XIXe sicle, ne peut s'expliquer sans le
maintien de l'esprit associatif au sein des communauts de
travail. Reste dterminer son ampleur. Ce qui n'est pas le
plus ais.
La toute puissance de la loi a d'autant mieux opr,
qu'elle manait d'un pouvoir auquel les salaris vouaient
une grande confiance. Les charpentiers n'crivaient-ils pas
dans leur dernire lettre du 2 juin : nous attendons des
lois la douce satisfaction d'tre reconnus pour amis de la
vrit, et persuads de leur protection, nous veillerons avec
toute l'exactitude que demande la sagesse de leur ordon-
nance ne nous garer jamais du sentier de la vertu ... .
Le compte-rendu de la sance du 1
er
juillet 1791 du Con-
seil municipal mentionne un procs-verbal dress par le
commissaire de police de la section de Fontaine-de-Grenelle
des ouvriers charpentiers assembls en contravention la
loi. L'enqute ordonne dbouche le 19 septembre sur
l'ajournement du dossier. Sigismond Lacroix conclut: on
ne voit pas que l'affaire des charpentiers ait t mise plus
tard l'ordre du jour (1). La brve page de l'association
ciel ouvert est tourne.
LE PAV DE L'OURS
Pour tre certain de prvenir les coalitions, le lgislateur a
entrepris de refouler toute forme de rassemblement chez les
100
LE TROU NOIR
gens de mtier. Il est frappant de constater la permanence et
la cohrence de cette dmarche toutes les tapes de la
Rvolution. Sans perdre de temps, la Constituante introduit
dans le dcret du 19 juillet 1791, relatif l'organisation
d'une police municipale et correctionnelle, un article stipu-
lant que : les peines portes dans la loi sur les associations
et attroupements des ouvriers et gens du mme tat seront
prononces par le tribunal de police correctionnelle . Son
adoption au cours de la sance du Il juillet ne provoque
aucune objection gauche , selon le compte-rendu du
Moniteur }) (2).
L'assemble fascine par le libralisme intgral, au point
de supprimer les chambres de commerce aprs les avoir
maintenues dans la loi Le Chapelier, est loin de respecter
l'galit de traitement entre les patrons et les ouvriers. Le
dcret du 26 juillet 1791 prvoit en cas de rupture inopine
du contrat de travail, une diffrence de traitement juri-
dique. Les sanctions visant les matres sont ... des dom-
mages-intrts alors que l'ouvrier doit payer une
amende (3).
Certains secteurs d'activit jugs stratgiques, comme la
fabrication du papier monnaie, font l'objet d'une dlibra-
tion spciale. La tradition d'insubordination des papetiers
est particulirement vise. Le dput Leclerc se plaint dans
un rapport, le 26 juillet, qu' actuellement, des ouvriers
prtendent sortir leur premire rquisition et menacent de
faire coalition pour sortir tous ensemble, ce qui exposerait
les manufactures de papier du royaume une suspension
force qui pourrait s'tendre jusqu' la manufacture des
assignats . Il fait adopter, pour ces salaris, des disposi-
tions reprenant le rglement draconien institu sous
l'Ancien rgime en 1739 (4).
La loi du 20 juillet 1791 tend la loi Le Chapelier aux
moissonneurs et aux domestiques . La premire vague de
mesures destines complter le texte du 14 juin 1791, vise
la dimension revendicative des rassemblements de salaris.
La fonction mutualiste des socits d'entraide est atteinte
par la loi du 18 aot 1792, supprimant les confrries. Cette
101
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
mesure lgislative, vote pendant la chute de la monarchie,
constitue l'un des multiples pisodes du conflit religieux.
L'interdiction n'pargne pas les associations laques de cha-
rit.
La lgislation rvolutionnaire contre les associations
signifie-t-elle un retour la case dpart ? On peut le penser,
dans la mesure o les contrevenants sont passibles de
police. Les similitudes ne peuvent masquer les diffrences.
Si minimes soient-elles, elles ouvrent des brches dans le
systme coercitif hrit de l'Ancien rgime.
A l'encontre de la lgislation monarchique qui punissait
les individus pour simple fait d'association, la loi de juin
1791 les sanctionne pour passer des conventions tendant
refuser de concert ou n'accorder qu' un prix dtermin
le secours de leur industrie ou de leurs travaux... . L' asso-
ciation sans la coalition n'est pas autorise, mais elle n'est
pas expressment interdite. Les termes utiliss par Le Cha-
pelier sont ambigs : Les citoyens de mme tat ou pro-
fession, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne
pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer
etc. .
La cl de l'quivoque, si l'on carte l'inadvertance, serait
inattendue; Emile Cornaert suggre Cette autorisation
tacite de se runir tait-elle destine fournir une chappa-
toire aux membres des compagnonnages? Une tradition
orale assure, chez les compagnons, que Le Chapelier, initi
l'un de leurs rites, aurait voulu leur permettre de main-
tenir leurs groupements (5). L 'hypothse selon laquelle
l'avocat d'obdience franc-maonne aurait marqu une affi-
nit idologique, est galement avance.
La prohibition n'est pas totale. Les citoyens appartenant
des professions diffrentes ont le droit de s'assembler et
de former des socits, la condition de respecter les lois en
vigueur. La loi de police du 19 juillet 1791 recommande :
Ceux qui voudront former des socits ou des clubs
seront tenus, peine de 200 livres d'amende, de faire pra-
lablement, au greffe de la municipalit, la dclaration des
lieux et des jours de leur runion ... . On est encore loin
102
LE TROU NOIR
d'une vritable libert d'association, mais ce n'est dj plus
l'interdit associatif sans faille de l'Ancien rgime.
SOUS LE MANTEAU
Les animateurs d'unions fraternelles n'ont pas le loisir
d'tablir un bilan juridique nuanc. Cette pe de Damocls
ne leur laisse d'autre issue que de surmonter leur amertume
et de chercher des solutions de repli pour maintenir un
minimum de liens associatifs. L'entraide mutuelle offre le
cadre de ce redploiement, non seulement pour des raisons
tactiques, mais pour rpondre des besoins pressants de
protection.
A peine Le Chapelier a-t-il affirm, le 14 juin 1791, que
les secours incombent l'Etat, les ateliers de charit sont
supprims le 16. L'Etat-Providence ne peut faire une
plus fcheuse eritre en scne. L'avocat rennais reconnat
lui-mme, dans les derniers jours de l'Assemble Consti-
tuante, que les actes n'ont aucunement suivis les intentions.
Il met le souhait que la prochaine assemble puisse ...
jeter un premier regard... sur cet acte de justice et de bien-
faisance (6).
Larochefoucauld-Liancourt va plus loin dans l'auto-cri-
tique. S'il flicite les lus de la Nation d'avoir proclam
les droits sacrs et imprescriptibles du malheur , il ne
leur dissimule pas la situation relle. L'tat actuel des
secours ... se borne aux hpitaux dans les villes et quelques
distributions fondes de pain et de bouillie. L'administra-
tion d'un grand nombre d'hpitaux est nulle . Il ajoute
une information, de nature temprer les poursuites contre
les socits d'assistance : Cet tat excite des rclamations
de toutes parts (7).
Bien que l'ouvrage en matire de secours abonde, le dve-
loppement des organisations de solidarit parat ingal,
selon les milieux professionnels. Artisans de la premire
heure, les charpentiers se sont fondus dans l'anonymat. Les
ouvriers imprimeurs, en revanche, nous ont laiss, fonction
103
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
oblige, quelques crits sur leur adaptation au nouveau
cours. Curieusement ce tmoignage exceptionnel, sur un
comportement de conduites ouvrires que l'on peut consi-
drer comme exemplaire aprs juin 1791, a chapp
l'attention des chercheurs depuis un demi- sicle (8).
Les textes rapports par Isabelle Bourdin expriment
simultanment la volont de maintenir une organisation et
le souci de n'offrir aucune prise aux poursuites. Le nom du
Corps typographique disparat des textes publis par les
imprimeurs. Douze commissaires, dont la plupart taient
des dirigeants de l'association dissoute, sont dsigns pour
procder aux transformations et dmarches ncessites par
la nouvelle lgislation.
Ils interprtent la fameuse phrase de l'article 2: ...
lorsqu'ils se trouveront ensemble ... comme une recon-
naissance tacite du droit de runion. Pour conforter cette
lecture optimiste, ils invoquent l'article 5 de la dclaration
des droits de l'homme : La loi n'a le droit de dfendre
que les actions nuisibles la socit. Tout ce qui n'est pas
dfendu par la loi ne peut tre empch et nul ne peut tre
contraint faire ce qu'elle n'ordonne pas .
Les compagnons soulignent avec insistance que le champ
d'activit de la nouvelle organisation collective est limite
l'entraide mutuelle contre la maladie, la vieillesse et l'infir-
mit. La Socit patriotique des Amis de l'Humanit ,
qui assumera un rle exemplaire au dbut du XI Xe sicle,
est ne. Concession majeure, les imprimeurs admettent les
ouvriers de tous mtiers pour chapper au soupon de cor-
poratisme. Concession matrise, car la prdominance pro-
fessionnelle semble avoir t soigneusement prserve jus-
qu'au tournant du sicle.
La mise en discussion de tout sujet relatif quelque art
ou mtier que ce soit est expressment dfendue. Les ru-
nions hebdomadaires deviennent mensuelles et se tiennent le
premier dimanche de chaque mois. La trace de la socit se
perd la veille de l'Assemble gnrale consacre l'adop-
tion du projet de rglement. On la retrouve en 1801, dans
un rapport de la Socit philanthropique de Paris.
104
LE TROU NOIR
De son ct, la Caisse de maladie et de dcs des typo-
graphes de Strasbourg , cre en 1783, traverse sans
encombres cette priode (9). Seuls, le manque de fiabilit
des assignats et l'introduction du calendrier rpublicain sont
mentionns dans le livre de caisse. La socit strasbour-
geoise n'avait jamais poursuivi d'autre dessein que celui de
l'assistance.
Tout autre est l'tat d'esprit des ouvriers chapeliers, selon
l'enqute mene par l'Office du travail en 1899 : Parmi
les socits de secours mutuels professionnels qui remplis-
sent le rle de caisse de rsistance, ou plutt qui annexrent
leurs oprations de mutualit une caisse spciale de rsis-
tance fonctionnant plus ou moins secrtement, il faut citer
en premire ligne celles des chapeliers (10). Les fouleurs
lyonnais, au nombre de 1500 en 1789 qui composaient
seuls le compagnonnage des chapeliers, n ' avaient cess
d'tre organiss et donnrent bientt des preuves de leur
cohsion (11).
L'tude de l'Office du travail rapporte le cas de deux
socits mutuelles nes sous la Rvolution : la Socit des
orfvres (12) et la Socit St-Simon des tanneurs-
corroyeurs (13). On ne dispose malheureusement d'aucune
prcision sur leur fonctionnement pendant cette priode.
Les registres de la Socit philanthropique de Paris signa-
lent la naissance le 23 septembre 1794 de la Socit de pr-
voyance de Chaillot , compose de salaris de divers
mtiers: blanchisseurs, brasseurs, serruriers, fondeurs et
surtout ouvriers de la pompe feu des Etablissements des
frres Prier, installs sur la colline de Chaillot.
La prudence commande aux associations de mtier de se
fondre dans l'interprofessionnalit ; les caisses de secours
ou charit constitues dans le sillage de confrries doivent
imprativement abandonner, depuis aot 1792, toute rf-
rence religieuse. La confrrie de Sainte-Anne, l'origine de
la plus ancienne mutuelle existante aujourd'hui, cre dans
le cadre d'une confrrie religieuse de compagnons menui-
siers du faubourg du Temple en 1694, renonce en septembre
1692 toute filiation clricale. Sous le nom de Socit fra-
105
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
ternelle Sainte-Anne , elle poursuit sans encombre son
activit d'entraide. La cotisation de 5 sols ouvre le droit
un secours de 60 sols par semaine; les vieillards et les
infirmes bnficiant de conditions d'hospitalisation particu-
lires Bictre (14).
La Bourse des malades et des infirmes de St-Laurent ,
institue en 1780 procde une adaptation du mme ordre.
Elle prend le nom de Socit des amis de l'galit au
cours d'une Assemble gnrale extraordinaire le 7 octobre
1792 aprs la loi supprimant les confrries. Nous dcla-
rons que nous ne pouvons, ni ne devons laisser subsister
plus longtemps la confrrie de la nativit de la Sainte- Vierge
en Notre-Dame-de-Bonne Dlivrance, qu'elle est sup-
prime (15).
Le produit de la vente des biens de la confrrie dissoute
est vers la caisse de la Bourse. La mention la manire
accoutume inscrite rituellement sur le livre des registres,
en marge du compte-rendu de l'Assemble gnrale
annuelle, dit assez bien le parcours sans histoire de la
socit jusqu' la fin de la Rvolution.
LES VARIATIONS DE LA LOI
L'interprtation bienveillante de la loi n'est pas toujours
la rgle, mme quand l'organisation n'est le sige d'aucune
vellit revendicative, telle l'Association de charit de
Rouen fonde en 1772 (16). Les courriers changs entre la
commune et le district de la cit normande font apparatre
clairement l'embarras des autorits et leur conformisme
juridique, face la procdure de dissolution engage le
15 mai 1793 par le procureur de la commune.
Les adhrents avaient affirm dans une ptition quelques
semaines auparavant que leur association ne ft jamais ni
congrgation, ni confrrie, mais une socit de charit .
L'argument n'avait pas laiss insensible les officiers munici-
paux rouennais, puisqu'ils estimrent devoir plaider la cause
de cette socit auprs du District. Les administrateurs du
106
LE TROU NOIR
Conseil gnral du district voulurent bien admettre les
vues sages de cette association et que la loi du 18 aot
1792 ne lui tait pas applicable. La logique bureaucratique
finit par l'emporter, car: ... ce serait donner une latitude
l'interprtation de loi, qu'elle ne semble pas pr-
senter ... .
Ce qui n'empche pas les mmes autorits normandes de
tolrer le fonctionnement de la socit des Brouettiers
bremens et portefaix du grands corps du Havre, dont les
statuts sont adopts le 28 avril 1794, en vue d'assurer les
fonctions traditionnelles d'entraide (17). Mais, comme le
remarque Jean Nol Chopart il semble pourtant que
l'objet principal de ces socits soit plutt la mise en place
d'une auto-rgulation pratique et lgale du march du tra-
vail ... dans l'organisation de la manutention des marchan-
dises dans la zone portuaire. Les contraintes techniques
du march imposent dans certaines professions des excep-
tions la rgle librale de la concurrence.
La loi, en revanche, a t strictement applique dans
l'ancienne Provence. Maurice Agulhon souligne les larges
dchirures causes au tissu associatif de cette rgion:
vitalit probable, donc, de certaines confrries de mtiers,
qui n'ont d leur disparition qu' la loi (ou aux lois) rvolu-
tionnaires (18).
Le carcan anti-associatif fait parti des bagages de l'arme
rpublicaine. Aprs la conqute de l't 1794, la loi Le
Chapelier, promulgue en Belgique le 6 novembre avait pro-
voqu la liquidation des corporations et sans doute des
compagnonnages (19). Face la tendance spontane des
ouvriers gantois reconstituer des mutualits de
secours, on retrouve la traditionnelle dfiance des auto-
rits et des milieux patronaux.
Le maire de Gand reprend un argument de Le Chapelier
pour interdire une association d'ouvriers fileurs, constitue
selon leur patron sous le prtexte de former une bourse de
secours. L'arrt municipal dcrte toute runion ouvrire
sans objet : considrant que les hospices de cette ville sont
assez considrables, bien organiss et pourvus pour conti-
107
AU CONFLIT DE.DEUX LIBERTS
nuer admettre les ouvriers fileurs malades (20). La
Commune-Providence , en quelque sorte.
Les interdictions dveloppent le sens de l'esquive. On est
encore loin de connatre, aujourd'hui, les innombrables
ruses et parades inventes pour vider les lois de leur subs-
tance coercitive. L'exemple, cit par Emile Laurent, de la
ville de Bordeaux, montre qu'il convient de parler d'immer-
sion provisoire, plutt que de naufrage. Nombre de confr-
ries de mtiers, parmi la centaine dment rpertories dans
les archives municipales en 1791, referont surface dans leurs
nouveaux habits de socit de secours mutuels ds le dbut
du sicle. Cependant, nous ne disposons pas d'indications
permettant d'tablir comment la chane dut tre renoue
plus facilement qu'ailleurs (21).
Les stratagmes visant neutraliser les rglements n'ont
pas manqu, comme le montrent divers tmoignages,
notamment celui de la confrrie des bouchers de Limoges,
que Le Play aimait nommer la perle du Moyen
ge (22). Pour faire obstacle la dissolution de leur con-
frrie, les bouchers de Limoges, dcident d'organiser une
souscription parmi les confrres afin d'acheter la chapelle
St-Aurlien, centre et cur de la confrrie , mise en
vente comme bien national. Cette tche redoutable est con-
fie deux d'entre eux, les sieurs Cibot et Malivaud, qui se
chargent de l'achat en leur nom propre. La chapelle rede-
vient officiellement la proprit de la corporation des bou-
chers sous la Restauration.
Autre parcours associatif tonnant, celui de La Tri-
nit de Gaillac (Tarn). Les membres de cet tablissement
de charit form en 1781 s'efforcent ds 1790 de mettre
leurs statuts l'heure nouvelle. Les termes de confrries et
de confrres sont remplacs par ceux d'associations et de
rcipiendaires ou admis. La socit poursuit son activit
sans encombre. En aot 1792, victime de la lenteur des
moyens d'information le 16 aot, la socit populaire
affirmait encore son attachement au H malheureux roi " et
n'approuvait que le 25 la journe parisienne du 10 (23).
Cette conversion rpublicaine tardive ne porte nullement
108
LE TROU NOIR
ombrage la socit, qui fonctionne normalement pendant
prs de trois annes. Le comit rvolutionnaire du district
feint, la suite d'une dnonciation, de dcouvrir son exis-
tence dans un courrier adress le 23 fvrier 1795, la muni-
cipalit de Gaillac. La dmarche est de pure forme, certains
signataires du comit tant des membres actifs de la Tri-
nit . Rien n'interdit d'imaginer que ce double jeu ait t
pratiqu plus souvent qu'on ne le croit.
L'IRRDUCTIBILIT OUVRIRE
Si, on ne trouve pas trace d'objections populaires contre
la loi du 14 juin 1791, les conflits du travail n'ont pas dis-
paru du paysage social. La persistance d'une autonomie
ouvrire, aussi limite soit-elle, mrite l'attention sachant
les liens entretenus par l'action collective et l'organisation
de la prvoyance.
Le mouvement lanc par les ouvriers assurant le flottage
du bois vers Paris sur la Cure et l'Yonne en mars 1792, pro-
voque un tel retentissement qu'il suscite un dbat devant
l'Assemble lgislative (24). La premire phase de ce conflit
a clat en avril 1791. Les autorits de la Nivre se sont,
alors, adresses au maire de Paris pour qu'il tablisse un
tarif sage et bien conu pour faire cesser le dbat entre les
ouvriers et le marchand flotteur (25). Une anne plus tard
le conflit n'a pas t rsolu et a pris de l'ampleur. Signe des
temps, souligne Jaurs, la coalition ouvrire, isole au sein
de la masse paysanne, est crase par les vignerons pauvres
forms en garde nationale.
En mai 1792, les compagnons menuisiers du Devoir de
Marseille se mettent en grve pour obtenir une augmenta-
tion de salaire. Le Conseil municipal prend l'affaire au
srieux et lui consacre plusieurs dlibrations. Ces indi-
vidus, mconnaissant les lois rgnratrices qui ont sup-
prim toute espce de corporations en France sont
menacs de huit jours de prison et de poursuites comme
perturbateurs du repos public. Le Conseil municipal
109
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
estime : que le vritable Devoir de tous les citoyens fran-
ais ne consiste pas se livrer des crmonies ridicules et
superstitieuses, mais se conformer la volont gnrale et
courber la tte sous le joug des lois (26).
Le dveloppement des fabrications de guerre la fin
de 1793 et au dbut de 1794, favorise une relative concen-
tration de la main d'uvre ouvrire. Le 12 dcembre 1793
le Comit de Salut Public adopte, sous l'impulsion de
Robespierre, un arrt svre contre la grve des ouvriers
de l'atelier d'armes des Capucins dans lequel on rappelle
que les coalitions et les rassemblements d'ouvriers sont
interdits. On les prsentait comme des "agents de
l'tranger " (27).
Les ouvriers papetiers fidles leur tradition frondeuse,
dclenchent dans cette mme priode un mouvement reven-
dicatif dans les quatre manufactures qui fabriquent le
papier-assignat. Le rapport prsent la Convention
dnonce vivement la survivance de ce vestige du despo-
tisme que constitue l'organisation ouvrire. La Conven-
tion dcrte en consquence : Art. 1 eT. - Les entrepre-
neurs et ouvriers des manufactures de papiers tablies dans
toute la Rpublique sont mis en rquisition pour l'exercice
de leur profession et pour le service desdites manufac-
tures ... Art. 5. - Les coalitions entre ouvriers des diff-
rentes manufactures, par crits ou par missaires, pour pro-
voquer la cessation du travail, seront regards comme des
atteintes la tranquillit qui doit rgner dans les ate-
Iiers. .. (28).
La contestation ouvrire n'est pas absente des imprime-
ries. Elle s'exprime selon des modalits plus matrises,
comme le veut la tradition de cette corporation. Se rcla-
mant des principes de base de la Rpublique, la libert et
l'galit, les imprimeurs rclament en fvrier 1794 pour
chacun un salaire qui soit : dans la juste proportion des
besoins qu'il prouve et du renchrissement progressif des
denres de premire ncessit... (29). Ils obtiennent, fait
remarquable, une allocation de 5 livres par jour de maladie
pour les citoyens maris et de 3 livres pour les clibataires.
110
LE TROU NOIR
Le principe d'une pension est mme prvu en cas d'infir-
mit ou de vieillesse (30).
Des relations contractuelles de cette nature sont excep-
tionnelles. D'autant qu'avec le Directoire la dfiance natu-
relle des autorits l'gard des milieux populaires a ten-
dance se renforcer. L'administration centrale du dparte-
ment de la Haute-Sane dissout le 7 fvrier 1796 la corpora-
tion de porte-faix des communes de Gray et d'Arc, au nom
de cette base fondamentale de la Constitution franaise
qu'est la loi du 14 juin 1791. Cette corporation n'est, selon
les autorits dpartementales qu'un attroupement conti-
nuel d'autant plus alarmant et redoutable, qu'il est compos
d'hommes robustes et grossiers, toujours disposs la rsis-
tance ... (31).
Le 16 novembre 1796, le Ministre de l'intrieur attire
l'attention des administrateurs de la Seine et Oise sur une
plainte dpose par un entrepreneur charg de l'exploitation
de coupes de bois, propos de l'avidit des ouvriers (32)
qui ont abandonn les ateliers parce qu'ils estiment leurs
salaires insuffisants. Un rapport de police portant sur un
conflit du mme ordre survenu dans des ateliers proches du
Luxembourg, relativise l'influence de ces actions: En
gnral ces mouvements ne prsentent rien d'inquitant .
Inoffensifs ou pas, ces mouvements collectifs sont abso-
lument prohibs. Le 6 mai 1797, un commissaire du Direc-
toire du dpartement de l'Hrault, informe les autorits du
fait que des ouvriers cordonniers de la ville de Montpellier
se sont rassembls dans le cadre de socits compagnonni-
ques pour exiger l'augmentation du prix de leur salaire. Il
conclut qu' il importe de faire rprimer cette entreprise
d'ouvriers cordonniers et de dissoudre ces assembles
d'individus qui cherchent rorganiser les dites associa-
tions (33).
Dernier aperu sur la cohrence du comportement de
l'autorit publique en matire de relations sociales, la lettre
du Ministre de la marine adresse au Ministre de l'intrieur,
pour lui seul , propos d'une ptition prsente par les
ouvriers du port de Toulon. La dmarche des ouvriers tou-
111
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
lonnais est considre comme aussi dangereuse que cou-
pable pour la raison qu'elle viole la Constitution, et
qu'elle est prsente en nom collectif . Le Ministre exige
de svres sanctions contre les fonctionnaires d'autorit,
qui ont fait preuve de complaisances l'gard de la pti-
tion (34).
LE PATRIOTISME EN TTE
Les proccupations d'assistance n'apparaissent gure
dans le cours de ces conflits, hormis chez les imprimeurs.
Selon les recherches menes par Jean Bennet, 17 socits
d'entraide mutuelle Paris et une cinquantaine sur le plan
national poursuivirent leur mission jusqu'au tournant du
sicle. Soulignons une ide sur laquelle nous reviendrons :
la brche ouverte par la lgislation anti -associative entre les
activits de rsistance et celles de secours a commenc
faire son uvre au sein des associations professionnelles.
La marginalisation de la demande sociale est renforce
par les tensions et les prils de l'poque. L'heure n'est pas
la dfense des intrts particuliers mais celle de la
communaut nationale. Trs tt, le don patriotique devient
le diapason de la nouvelle solidarit. Ds dcembre 1789, les
mntriers de Paris offrent l'Assemble nationale leur
chapelle St-Julien avec toutes ses valeurs (35). Le 20 juillet
1790 la confrrie des compagnons paveurs en l'glise de la
Madeleine dans la Cit, fait don l'Assemble de l'argen-
terie d'glise lui appartenant (36).
Le 2 novembre 1790, les marchandes de morue de la con-
frrie St-Louis portent auprs de Bailly les avoirs de leur
socit se montant 3 000 livres (37). Les Dames de la Halle
remettent, en aot 1791, l'Assemble nationale leurs
fonds disponibles, ainsi que les ornements et l'argenterie de
leur confrrie, connue sous le nom de Notre-Dame-des-
Anges (38) . Sbastien Mercier, relate (39) l'offrande faite
l'Assemble nationale en 1792 par la socit d'artisans cor-
donniers de la rue de la Grande Truanderie, du montant de
112
LE TROU NOIR
leur bourse commune l'Assemble nationale. En change
du fruit de leurs cotisations, qu'ils avaient continu de per-
cevoir, ils rclament une pension pour les vieillards et les
infirmes .
Les circonstances tonnantes au cours desquelles, en
1794, la Socit philanthropique de Paris se sacrifie sur
l'autel de la patrie confirment la force d'entranement de
l'enthousiasme patriotique, feint ou sincre. Cre par des
personnages influents de la cour et des membres minents
de la franc-maonnerie, cette forme de sociabilit des
classe suprieures (40), la socit a travers sans anicroche
une priode dlicate pour ce type d'institution (41). La prsi-
dence assure avant 1789 par le duc de Charost, pair de
France, est confie sous la Convention un obscur citoyen,
nomm Hurel.
La Socit philanthropique jouit d'une grande estime
auprs des autorits rvolutionnaires. Celles-ci apprcient
une forme d'assistance qui conforte la priorit fondamen-
tale donne aux soins domicile. Le Moniteur du
8 juillet 1790 explicite les motifs de la convergence, sous le
titre, Rflexion sur la ncessit de donner des secours aux
pauvres malades domicilis chez eux : La Socit phi-
lanthropique de Paris a soutenu 484 vieillards avec 45 000
livres pendant un an en les secourant chez eux; elle et
employ cent mille livres, qu'elle n'en et pas fait plus dans
ces maisons de charit. C'est qu'elle n'a ni loyer, ni rpara-
tions de maison payer, ni directeur, ni entrepreneur, ni
fournisseur enrichir .
Ce comportement apprci des autorits permet la
Socit d'obtenir pendant l'anne 1793 vingt cinq mille
livres sur les fonds de secours. Une nouvelle demande au
printemps de 1794 provoque un dbat insolite la Conven-
tion, le 17 juin sous la prsidence de Robespierre, en plein
cur de ce que les historiens appellent la Grande Ter-
reur .
Le rapporteur Roger-Ducos invoque le rle exclusif, qui
revient la Nation en matire d'assistance, pour justifier la
rponse ngative du Comit. Il prcise : Je n'entends faire
113
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
aucun reproche la socit philanthropique de Paris ... si
vous accordez quelques fonds la socit de Paris, toutes
les autres qui sont rpandues sur la surface de la Rpu-
blique et dont vous ne connaissez ni l'esprit ni l'usage
qu'elles font de leurs caisses, auront droit d'en exiger (42).
La socit approuve avec joie un refus qui provoque
pourtant sa dissolution. Elle fait don dans une lettre-testa-
ment, le 6 octobre 1794, de ses derniers fonds la Conven-
tion, car dit-elle : vous avez organis en grand la bienfai-
sance publique, et la socit philanthropique, venant rendre
dans votre sein un dernier soupir, vous remercie d'avoir
dcrt la fois qu'il n'y aurait plus dans la Rpublique, ni
pauvres ni esclaves (43).
Ce texte rdig par une socit fonde et contrle par
l'aristocratie tonne, d'autant plus que l'exercice de la
terreur a chang de main depuis la chute de Robespierre.
Les termes employs pour fltrir l'Ancien rgime sont par-
ticulirement vifs: sous le despotisme, l'extrme luxe
existait ct de l'extrme misre et des secours insuffi-
sants et humiliants ... . On conoit que la Socit philan-
thropique, toujours active sous la conduite de grandes
familles , ait prfr oublier ce moment d'garement dans
le recueil historique publi en 1980 l'occasion de son
bicentenaire.
La fragile autonomie des associations ouvrires, des
annes 1790 et 1791, n'a pas rsist l'acclration du pro-
cessus rvolutionnaire et aux exigences de la dfense natio-
nale. Le passage de l'association professionnelle l'activit
des sections et clubs s'effectue d'autant plus aisment que la
tradition de la sociabilit (44) lie aux mtiers, fournit
souvent, le cadre propice la naissance des institutions
reprsentatives de la Rvolution.
Comme l'a montr Albert Soboul, l'investissement dans
le tout politique ne va pas sans dommages pour les aspi-
rations des ouvriers, tant il est vrai qu' on ne peut identi-
fier sans-culottes et salaris (45). Les compagnons et les
journaliers entendent marquer leur singularit. Les ouvriers
travaillant sur le chantier de l'glise Ste-Genevive se sont
114
LE TROU NOIR
forms en club et se runissent en dehors et aprs l' assem-
ble de la section (46).
Les socits populaires, les sections ou les clubs peuvent-
ils tre considrs comme un substitut associatif authen-
tique ? Maurice Agulhon ne semble pas le penser : ... la
premire explosion associative a trs vite disparu, et en deux
temps. D'abord la radicalisation de la Rvolution de 1792
au IX Thermidor, a fait disparatre la partie du secteur
associatif qui lui tait devenue dfavorable. Quant aux
clubs affilis aux jacobins et favorables la rpublique con-
ventionnelle, ils ont continu prolifrer mais en devenant
rapidement des organes officieux du gouvernement rvolu-
tionnaire, et aprs le IX Thermidor, les clubs jacobins ont
t leur tour suspects et traqus. De telle sorte que dans la
Rpublique de l'an III, la libert d'association, et l'on
pourrait presque dire sans doute la ralit mme de la vie
associative, ont atteint vritablement un degr zro (47).
L'apparente facilit avec laquelle s'est impose l'interdic-
tion faite aux travailleurs de s'associer librement dans leurs
mtiers rvle que l'entit sociale et culturelle du monde
ouvrier n'est pas encore constitue. La taille et la perma-
nence des bouleversements ne peuvent que relativiser les
amertumes et les dceptions. A l'poque de la Terreur les
ouvriers s'intressent davantage la politique (48). Le
cours des choses leur apparat, tout compte fait, plus favo-
rable que dommageable.
C'est l'opinion que les ouvriers de plusieurs ateliers de
Paris communiquent le 20 mars 1794 la Convention natio-
nale. Ils stigmatisent tous ceux qui ... s'efforcent, mais en
vain d'armer le pauvre contre le riche, d'arracher l'ouvrier
de ses ateliers pour le faire servir d'instrument leurs inten-
tions coupables . Ils dclarent accepter comme suffisant
leurs besoins la portion de pain que la loi nous accorde ;
trop heureux d'tre dbarrasss de cette affreuse tyrannie
qui seule a caus les maux que nous prouvons (49).
Propos, il est vrai de circonstance; nous sommes la veille
du procs des enrags .
Ils refltent, nanmoins, l'adhsion populaire au cours
115
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
nouveau. L'lan patriotique chez les imprimeurs, est tel que
les autorits sont conduites prendre des dcrets astrei-
gnant ces ouvriers qualifis demeurer dans les imprime-
ries (50). La conviction d'avoir des droits fraichement acquis
dfendre, notamment en matire d'assistance et de pr-
voyance, l'emporte, semble-t-il, sur le dpit et les frustra-
tions chez les gens de mtiers.
116
LE TROU NOIR
NOTES
(1) Les actes de la commune, op. cit., t. 5, p. et t. 6, p. 362.
(2) Archives parlementaires, t. 28, p. 127.
(3) J.-M.-J. Biaugeaud. - La libert du travail ouvrier, op. cit., p. 60.
(4) Germain Martin. - Les associations ouvrires au XVIIIe sicle, op.
cit., p. 60.
(5) Les corporations en France, op. cit., p. 176.
(6) Archives parlementaires, 26 septembre 1791, t. 31, p. 340.
(7) Camille Bloch et Alexandre Tuetey. - Le comit de mendicit, op.
cit., pp. 177-178.
(8) Des extraits de ce document sont publis dans le livre d'Isabelle
Bourdin. - Les socits populaires Paris pendant la Rvolution,
op. cit., pp. 129-130. Nos tentatives pour consulter aux Archives
nationales cette pice unique la cte indique, par Isabelle
Bourdin, sont demeures vaines.
(9) Eugne Rufbel. - Notice du 150 e anniversaire, op. cit., p. 32.
(10) Les Associations professionnelles ouvrires, enqute publie par
l'Office du travail du ministre du Commerce, de l'Industrie, des
Postes et Tlgraphes, 1989, t. 2, p. 473.
(11) Ibidem, p. 537.
(12) Ibidem, t. 3, p. 73.
(13) Ibidem, t. 2, p. 184.
(14) Romain Lavielle. - Histoire de la mutualit, 1964, p. 29.
(15) Livre des registres de la Bourse St-Laurent, conserv par l'Union
des mutuelles cogres.
(16) Archives dpartementales de la Seine-Maritime, L. 1350, document
que nous devons l'aimable collaboration de Yannick Marec.
(17) Jean-Nol Chopart. - Le fil rouge du corporatisme, op. cit.,
p.85.
(18) Pnitents et Franc-Maons de rancienne Provence, op. cit.,
p.260.
(19) Jean Dhont. - Notes sur les ouvriers industriels gantois rpoque
franaise. - ln : La Revue du Nord, 1954, vol. 36, p. 320.
(20) Ibidem, p. 321.
(21) Emile Laurent. - Le pauprisme et les associations de prvoyance,
op. cit., p. 272.
(22) Marquis de Moussac. - Une corporation d'autrefois, 1982, p. 10.
117
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
(23) Ch. Portal. - Une socit de secours mutuels sous la Rvolution,
La Trinit de Gaillac , 1907, p. 11.
(24) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution, op. cit., t. 2,
pp. 419-423.
(25) A.N. F/12/1560.
(26) Les associations professionnelles ouvrires, op. cit., t. 4, pp. 171-
172.
(27) Daniel Gurin. - La lutte de classes sous la 1 re Rpublique, 1946,
t. 2, p. 157.
(28) Ibidem, p. 158.
(29) Paul Chauvet. - Les ouvriers du livre en France, op. cit., p. 36.
(30) Ibidem, p. 38.
(31) A.N. F/12/1560.
(32) Ibidem.
(33) Ibidem.
(34) Ididem.
(35) A.N. C.33 n 225.
(36) A.N. C.128 n 345.
(37) A.N. C.75 n 745.
(38) A.N. C.76 n 715.
(39) Le nouveau Paris, t. 3, pp. 160-161.
(40) Maurice Agulhon. - Pnitents et Francs-Maons, op. cit., p. 163.
(41) Bernard Gibaud. - La socit philanthropique de Paris ou les
paradoxes du patronage aristocratique. - In : La Revue de l'co-
nomie sociale, n 13, janvier 1988, p. 177-183.
(42) Archives parlementaires, 29 prairial an II, p. 693.
(43) Ferdinand Dreyfus. - L'assistance sous la Lgislative et la Con-
vention, 1791-1795, 1905, p. 53.
(44) Maurice Agulhon. - Pnitents et Francs-Maons, op. cit., p. 262.
(45) Les Sans Culottes, op. cit., p. 239.
(46) Cit par Georges Rud. - La foule dans la Rvolution franaise,
op. cit., p. 211.
(47) Maurice Agulhon. - L 'histoire sociale et les associations. - In : La
Revue de l'conomie sociale, n 14, avril 1988, p. 38.
(48) Henri Se. - Histoire conomique de la France, t. 2, op. cit.,
p.62.
(49) A.N. AD/XIV/6.
(50) Paul Chauvet. - Les ouvriers du livre en France, op. cit., p. 45.
118
Chapitre VI
LA PROTECTION,
UNE AFFAIRE D'TAT
119
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
L'assistance constitue l'un des terrains de prdilection de
la mise en uvre du nouveau type de relations, qui s'tablit
en 1789 entre l'individu et la socit. Le droit l'assistance,
institu corollairement celui du travail, comme une
crance sur la collectivit, rompt radicalement avec les doc-
trines caritatives de l'Ancien rgime.
Le crdit acquis par l'uvre assistancielle de la Rvolu-
tion tient galement au fait qu'elle transcende les affronte-
ments qui la jalonnent. On peut distinguer dans l'labora-
tion des droits sociaux, un dpart laborieux et une
apoge rayonnante; mais la cohrence de l'ensemble
demeure le trait essentiel. Le brouillon (1) est rdig ds
l'ouverture de la Constituante.
Dans le sillage de la proclamation du droit l'assistance,
la protection sanitaire et sociale connat des dveloppements
conceptuels importants. Le renouvellement complet des
sciences mdicales et des conditions d'exercice de la mde-
cine, la naissance des techniques de prvoyance individuelle
et collective, autant de facteurs qui ne manqueront pas
d'influer en profondeur sur l'organisation de la solidarit.
Face une uvre aussi dense et aussi contraste, notre vo-
cation n'a d'autre ambition que d'tablir quelques points de
repre.
LE CREUSET CONSTITUANT
Jacques Godechot (2) constate: ... bien que la rupture
avec l'Ancien rgime soit moins profonde qu'on ne l'a cru,
il n'est gure d'institution de la France contemporaine qui
n'ait son origine dans les dcrets de l'Assemble consti-
tuante. L'observation vaut pour les conceptions et les
dcisions adoptes en matire de secours. Rarement des
hommes se sont fixs un but aussi lev : la Rvolution
tend rien moins qu' la suppression de la pauvret et au
remplacement de toute charit prive par un ambitieux sys-
tme d'assistance publique (3).
La Constituante avait-elle d'autre choix, si l'on considre
120
LA PROTECTION
l'tat dliquescent dans lequel se trouvent en 1789 les insti-
tutions clricales d'assistance? L'ide d'accrotre sensible-
ment l'intervention assistancielle de l'Etat est dj plus ou
moins l' uvre depuis Louis XV. La peur des pauvres
n'est plus sa seule justification. D'autres motivations lgiti-
ment plus noblement l'engagement social de la puissance
publique.
Le mouvement des ides philanthropiques joue un rle
crucial dans l'mergence de ces nouvelles attitudes politi-
ques. De leur ct, les physiocrates considrent le droit au
secours en faveur des pauvres comme une volution favo-
rable au dveloppement de l'conomie. Dj Montesquieu
avait soulign dans la premire moiti du XVIIIe, le lien
indissociable entre pauvret et activit productive. Le phy-
siocrate Baudeau crit, de son ct, en 1765: Notre
axiome fondamental est que les vrais pauvres ont _un droit
rel d'exiger leur vrai ncessaire (4). L'utopie du Tout
Etat ne manquera pas de s'opposer l'utopie majeure du
temps, qui prconise la diffusion de la proprit, comme
remde fondamental la pauvret.
Le Comit de mendicit, install en janvier 1790, accom-
plit au cours des soixante-dix runions tenues pendant ses
dix-huit mois d'activit, sous la direction de Larochefou-
cauld-Liancourt, un travail remarquable sur le plan concep-
tuel. Le rayonnement des analyses et des propositions for-
mules par le Comit imprgnera non seulement toutes les
tapes de la Rvolution, mais portera bien au del.
Deux lignes de force sont dgages: secours en travaux
pour les pauvres valides et pensions domicile pour les non
valides. En prsentant son plan de travail, le 30 avril 1790,
Larochefoucauld-Liancourt pose la pierre angulaire de
l' uvre rvolutionnaire : Tout homme a droit sa subsis-
tance, cette vrit fondamentale de toute socit et qui
rclame imprieusement une place dans la dclaration des
droits de rhomme ... (5). La lacisation des biens hospita-
liers, la mise en commun des fonds disponibles pour leur
redistribution aux hpitaux et la dispense de secours
domicile en proportion de la population indigente des
121
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
dpartements, constituent les principaux moyens dfinis, au
service de cette politique.
Brillante sur le plan conceptuel, l'action de la Consti-
tuante pche par dfaut de concrtisation. Elle doit parer
la grave crise financire qui frappe les tablissements de
bienfaisance la suite de la nationalisation des biens
d'glise. Selon Camille Bloch malgr les obstacles que la
lgislation opposa au fonctionnement des tablissements
charitables, particulirement des hpitaux, rassistance ne
cessa pas d'y tre distribue aux pauvres malades ou
infirmes (6).
LA PAUSE LGISLATIVE
La Constituante passe le relais l'Assemble nationale
lgislative le 30 septembre 1791 sans avoir pu amorcer la
construction de l'difice assistanciel. On se rappelera que
c'est le mme Le Chapelier qui en juin 1791, dclarait cadu-
ques les socits de secours en raison des nouvelles respon-
sabilits de la Nation ; le 26 septembre il regrette au nom de
l'Assemble de n' avoir pas eu le temps de seconder les
vues sages et bienfaisantes envers une portion de citoyens si
digne d'une attention particulire ... (7).
Ce dcalage provoque des mouvements d'impatience. Le
chirurgien Jacques Tenon lu la Lgislative constate :
Voil bientt deux annes que cette Rvolution est faite,
que le rgne de la loi est rtabli et ron ne s'est pas encore
occup assez srieusement du vritable soulagement de la
classe des citoyens indigents. C'est cependant cette classe
nombreuse qui a le plus fait pour la Rvolution (8).
La Lgislative, confirme et parfois enrichit le patrimoine
doctrinal lgu par la Constituante, mais elle ne franchira
pas davantage le stade des intentions. La nouvelle Assem-
ble rejette la connotation rpressive contenue dans le terme
de mendicit, en lui substituant celui de Comit des secours
publics. Garran de Coulon justifie cette modification par la
volont de sparer ce qui est relatif aux prisons et maisons
122
LA PROTECTION
d'arrt, afin de ne pas avilir d'une certaine manire les der-
nires classes du peuple, en confiant galement le soin des
infortuns et des criminels aux mmes personnes (9).
Le Comit de secours publics, prsid par Jacques
Tenon, accomplit en moins d'une anne un travail lgislatif
considrable. Cinquante-six dcrets en faveur des plus
dmunis sont vots par l'Assemble nationale. Parmi les
dcisions arrtes, l'assistance aux parents des dfenseurs de
la patrie occupe dj une place importante. Les vues
d'ensemble du Comit sur l'organisation gnrale des
secours publics et sur la destruction de la mendicit sont
prsentes le 13 juin 1792 par le dput de l 'Yonne, Ber-
nard.
En vertu du contrat naturel qui lie chaque membre de la
socit l'Etat, Bernard proclame ... Cet axiome qui
manque la dclaration des Droits de l'Homme, cet axiome
digne d'tre plac en tte du Code de l'humanit que vous
allez dcrter: tout homme a droit sa subsistance par le
travail, s'il est valide, par des secours gratuits s'il est hors
d'tat de travailler (10).
Jean Jaurs n'est gure enchant par la forme contrac-
tuelle donne au droit, mais il insiste sur la porte consid-
rable de cette ... grande nouveaut humaine d'avoir pro-
clam le droit de tout homme l'existence, la subsis-
tance (11). Le droit l'existence est entendu ici, selon
Albert Soboul, dans le sens troit de droit la subsistance,
qu'il revtait l'poque (12). La cration d'un service
d'assistance publique est devenue urgente depuis la vente
des biens dtenus par les tablissements hospitaliers. Les
autorits rvolutionnaires ont la sagesse de maintenir dans
les hpitaux le personnel religieux, malgr la suppression
des congrgations.
Aprs le manifeste de Brunswick et le franchissement des
frontires, une nouvelle dynamique sociale s'impose pour
galvaniser le peuple dans ses profondeurs. La politique
rvolutionnaire de protection sociale est l'une des princi-
paux ressorts de la leve en masse .
123
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
L'APOGE CONVENTIONNELLE
Selon Camille Bloch ... la priode culminante de rhis-
toire de rassistance pendant la Rvolution ... celle o les
conceptions proprement rvolutionnaires se transforment
en lois (13) correspond pour l'essentiel la dure de la
Convention. Il retranche de cette priode les six premiers
mois marqus par l'influence des Girondins.
Pour Jean Jaurs la phase initiale de la Convention giron-
dine participe pleinement aux grandes dcisions de la
lgislature. La chute politique de la Gironde ne marque
pas l'avnement d'un nouveau systme d'ides. On peut
dire qu'avant le 31 mai la thorie politique et sociale de la
Convention tait fixe dans ses grandes lignes (14).
Pour parer au plus press la Convention accorde des
secours aux parents et aux enfants des volontaires, par le
dcret du 26 novembre 1792. Cette disposition sera tendue
ultrieurement aux familles des militaires de toutes armes.
Les revendications en matire d'assistance ne se bornent pas
aux besoins de la Nation combattante.
Un vritable constat de carence est fait par les milieux
populaires. L'adresse que les 48 commissaires des sections
de Paris communiquent au dbut de l'anne 1793, la Con-
vention nationale sur la situation des pauvres est particuli-
rement difiante : Citoyens comme nous, ces infortuns
seraient-ils donc les seuls pour lesquels notre heureuse rvo-
lution ne serait qu'un superbe songe?}). Ils rappellent
qu'un dcret du 20 mars 1791 avait autoris la municipalit
prendre des dispositions concrtes pour distribuer des
secours. Or, prs de deux annes se sont coules depuis
ce dcret et le plan qui l'exigeait imprieusement est encore
dans les abmes de l'avenir (15).
La Convention s'efforce de rpondre partiellement cette
attente par la loi du 19 mars 1793, en dterminant les moyens
financiers accords chaque dpartement pour assurer la
dispense des secours publics. Mais la grande affaire pour le
lgislateur demeure, en l'an 1 de la Rpublique, la rdaction
de la nouvelle dclaration des droits de l'homme.
124
LA PROTECTION
Le projet de Constitution prsent le 15 fvrier 1793,
avec le soutien de la majorit des girondins, d'o le nom de
Girondine, est principalement l'uvre de Condorcet.
Nomm rapporteur du comit de constitution l'automne
prcdent, il s'est beaucoup investi dans la rdaction de ce
texte. En matire d'assistance, le pas dcisif est franchi: le
droit aux secours fait son entre dans les droits de l'homme.
Les moyens propres en assurer la ralisation demeurent
incertains: c'est la loi d'en dterminer rtendue et
rapplication (16).
Les graves vnements lis aux oprations militaires et
la trahison de Dumouriez, provoquent l'ajournement des
dbats sur la constitution en avril 1793. Dans le projet de
dclaration des droits qu'il prsente la socit des jaco-
bins le 21 avril, Robespierre exprime des positions proches
de celles de Condorcet, l'exception d'une dfinition
volontariste de la proprit: ... le droit qu' a chaque
citoyen de jouir et de disposer de la portion de bien qui lui
est garantie par la loi (17).
La version dfinitive de la dclaration des droits de
l'homme et du citoyen, du 24 juin 1793, constitue, mal-
gr l'limination politique des girondins, un compromis
entre les conceptions de Condorcet et de Robespierre.
... La fameuse formule du dput d'Arras sur " la por-
tion de biens garantie par la loi " ne reparat point: et
la Dclaration des Droits du 24 juin reproduit sur la
proprit la tranquillisante formule de la Dclaration
girondine (18).
Pour la premire fois dans l'histoire de l'humanit,
l'assistance publique acquiert force de loi. Les principes de
l'article 21 entament une carrire de longue dure : Les
secours publics sont une dette sacre. La socit doit la sub-
sistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du
travail, soit en assurant les moyens d'exister ceux qui sont
hors d'tat de travailler . La lgislation sociale adopte par
l'Assemble nationale est accueillie avec une vive satisfac-
tion par les milieux populaires. De nombreuses sections
parisiennes adressent leurs flicitations la Convention,
125
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
mais rendues prudentes par l'exprience, la pressrent de
" consommer son ouvrage " .
Les tmoignages rapports par Albert Soboul montrent
avec loquence l'obstination et la prcision des revendica-
tions exprimes par les sans-culottes dans ce domaine. Les
sections des Quinze- Vingts, de Popincourt et de Montreuil,
celles o les indigents taient les plus nombreux, dclarent
le 4 juillet 1793 qu'il est temps que le pauvre qui a jusqu'ici
soutenu seul la Rvolution, "commence en cueillir les
fruits " ; elles rclament "l'tablissement depuis si long-
temps dsir d'ateliers o l'homme laborieux trouvera tou-
jours en tout temps et en tout lieu, les travaux dont il
manque; d'hospices o le vieillard, le malade et l'infirme
reoivent avec fraternit les secours que leur doit l'huma-
nit (19).
La demande populaire de mesures concrtes est partielle-
ment entendue. Des dcisions sont prises: l'assistance aux
filles-mres et aux enfants trouvs, avec la loi du 28 juin
1793, avec celle du 22 floral an II (11 mai 1794) la forma-
tion d'un grand livre de la bienfaisance nationale principale-
ment pour les populations rurales, la nationalisation dfini-
tive des hpitaux par le dcret du 23 messidor an II
(11 juillet 1794), avec la loi du 24 vendmiaire an II
(15 octobre 1794), l'extinction de la mendicit, par le dcret
du 21 pluviose an II (9 fvrier 1794) : versement de secours
et d'allocations aux parents ncessiteux des dfenseurs de la
patrie.
Seul ce dernier dcret ft pleinement appliqu. Ici on
touchait de trop prs au systme politique dont dpendait le
sort de la Rvolution pour qu'on pt se permettre de trans-
gresser les lois, qu'on venait peine de voter (20). Jacques
Godechot souligne que le Grand livre de la bienfaisance
nationale, tout imparfait et insuffisant qu'il ft n'en
constituait pas moins un progrs norme .
Le rapport Barre du 22 floral an II, offre d'intres-
santes prcisions sur la rflexion sociale des conventionnels.
La priorit est accorde aux populations rurales dont le tra-
vail est considr comme le plus utile et le plus prouvant.
126
LA PROTECTION
... La prfrence pour les cultivateurs, les bergers et les
artisans des campagnes est trop juste, trop urgente, pour
tre conteste . Cette hirarchisation de la souffrance, con-
firme la mconnaissance que les lites rvolutionnaires
prouvent l'gard de ce que Michelet appellera Les ser-
vitudes de rhomme d'industrie (21).
Le rapport est une tonnante combinaison de mesures
positives et de considrations utopiques cheveles. Chaque
indigent malade inscrit sur le Grand livre peut esprer
toucher 10 sous par jour de maladie, plus 6 sous par enfant
de moins de dix ans. En partant de la proposition (sous
estime) d'un indigent sur vingt Franais, il value cin-
quante et un mille le nombre des citoyens concerns par le
revenu minimum; soit une dpense importante pour
l'poque de sept millions et demi de livres. Mais, Barre fait
observer: Qu'est cette dpense pour un bienfait national,
quand la Rpublique dpense 400 millions par mois pour le
flau de la guerre ? .
La prminence absolue accorde aux soins domicile,
fait surgir des mirages: Plus d'aumnes, plus d'hpi-
taux ! Tel est le but vers lequel la Convention doit marcher
sans cesse; car ces deux mots doivent tre effacs du voca-
bulaire rpublicain. L'institution de la premire fte
nationale par dcret du 18 floral pour honorer le mal-
heur , n'est pas moins dconcertante, mme si nous savons
aujourd'hui que toutes les socits humaines organisent,
d'une faon ou d'une autre la rception du malheur, son
interprtation, la gestion de ses crises (22).
LE REFLUX THERMIDORIEN
Le changement intervenu le 1 0 thermidor avec la chute de
Robespierre amorce une dcrue continue des conceptions
rvolutionnaires en matire d'assistance, sans jamais cepen-
dant signifier un retour la case de dpart. L'intervention
de Merlin de Douai le 23 germinal an III (12 avril 1795) sur
les principes essentiels de l'ordre social et de la Rpu-
127
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
blique (23) est caractristique du nouveau cap. Les secours
de la Rpublique ... ne peuvent tre accords qu'aux vrais
indigents, laborieux, temprants, conomes et probes ...
Ceux qui favoriseront la paresse ou le dsordre en faisant
donner des secours aux hommes sans vrai besoin ou sans
murs ... seront rputs dilapideurs des fonds publics et res-
ponsables de leur fausse application .
Merlin de Douai ne manque pas de rappeler que la loi Le
Chapelier conserve sa validit: Toutes les corporations
ou coalitions et mme toutes dlibrations non express-
ment autorises par la loi entre citoyens de mme tat ou
professions sont prohibes, comme contraires aux principes
de la libert .
L'orientation qui s'impose ds lors consiste renvoyer
l'assistance vers les municipalits ou la bienfaisance prive.
Le dput de la Somme, Delecloy, prononce le 4 octobre
1795 dans un Rapport sur l'organisation gnrale des
secours publics , l'oraison funbre de la politique d'assis-
tance de la Convention. Qu'est-il arriv de ce chaos
d'ides? Une srie effrayante de dpenses illimites, des
lois striles et impossibles excuter... Posons donc comme
principe que le gouvernement ne peut pas seul se charger de
l'entretien du pauvre; mais en le mettant sous la sauve-
garde de la commisration gnrale et de la tutelle des gens
aiss, il doit donner l'exemple d'une bienfaisance limite
comme ses moyens (24).
Le principe d'assistance obligatoire fonde sur la solida-
rit nationale, proclam pendant la phase la plus avance de
la Rvolution, devra attendre plus d'un sicle pour sortir de
son hibernation. Ferdinand Dreyfus, tout en faisant la part
des dommages causs par le volontarisme rvolutionnaire,
notamment sur le plan hospitalier, n'en conclut pas moins:
Ces rserves faites, il faut reconnatre ce qu'il y a de gn-
reux dans la conception rvolutionnaire dgage des excs
qui l'ensanglantrent (25).
128
LA PROTECTION
L'ART SOCIAL
Le concept d'Etat-assistance, inscrit dans les tables de la
loi au plus fort de la vague rvolutionnaire, gnralise les
pratiques sculaires de solidarit. Les techniques d'entraide
d'origine mutualiste soulvent un intrt d'autant plus vif
vers la fin du XVIIIe sicle, que la science mathmatique
connat des dveloppements prometteurs sur le plan du
calcul des probabilits.
L'influence de Condorcet, de Laplace et de leurs coll-
gues, ne s'exerce pas seulement sur la lgislation rvolution-
naire. Ils posent avec leurs travaux les bases scientifiques de
l'essor ultrieur de la solidarit mutualiste. La prvoyance
est perue comme un instrument de socialisation pour la
satisfaction des besoins sociaux et comme un substitut indi-
viduel aux formules tatiques.
La socit de 1789 , qui se cre aprs le transfert de
l'Assemble de Paris pendant les journes d'octobre, sous
l'impulsion de La Fayette, Sieys, Larochefoucauld-Lian-
court, Dupont de Nemours et Condorcet, se donne pour
objectif d'laborer un nouvel art social et d'utiliser ses
principes pour la future Constitution. Le prospectus rdig
par Condorcet dans le Journal de la socit de 1789
dfinit la mthode : runir tant de matriaux pars et
inconsistants, rechercher dans les sciences conomiques
leurs rapports mutuels, et surtout la liaison commune
qu'elles peuvent avoir avec la science gnrale de la civilisa-
tion, tel est robjectif de l'art social ~ 2 6 ) .
L'application du calcul des probabilits la dure de la
vie humaine, apparat, dans les dernires annes de l'Ancien
rgime un instrument porteur de la rforme social. Con-
dorcet, dernier grand reprsentant des encyclopdistes et de
leur tradition de lutte contre l'arbitraire judiciaire, publie en
1785 L'essai sur l'application de l'analyse la probabilit
des dcisions rendues la pluralit des voix .
Les progrs raliss dans l'utilisation directe des math-
matiques des fins de prvoyance ont une origine pre-
mire vue inattendue. Ils rsultent en partie des travaux sta-
129
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
tistiques de grands commis de l'Etat monarchique. Cette
filiation n'est qu' moiti surprenante, si l'on considre que
la crise financire permanente sous l'Ancien rgime avait
contraint les gouvernements successifs recourir systmati-
quement aux loteries et aux emprunts, assortis de rentes via-
gres, pour remplir les coffres de l'Etat.
Une meilleure connnaissance du calcul des probabilits
s'imposait, pour ne pas gonfler dmesurment la dette.
Les difficults scientifiques nes de ces expdients mirent
les mathmaticiens en face de problmes importants pour le
dveloppement du calcul des probabilits, au moment mme
o leur rsolution mathmatique apportait la preuve mani-
feste que la science tait en mesure de ramener les contin-
gences humaines des lois constantes (27).
Deux hommes ont jou un rle direct dans cette mise au
point. Duvillard de Durand, attach au bureau statistique
du ministre de l'Intrieur, publie en 1786 un ouvrage, inti-
tul : Recherches sur les rentes, les emprunts et les rem-
boursements. Condorcet ratifie chaleureusement ce tra-
vail, au nom de l'Acadmie des sciences. A la veille de la
Rvolution, Duvillard devient le premier actuaire franais
au service de la Compagnie Royale d'assurance sur la vie.
Sa Table de mortalit restera oprationnelle pendant
tout le XIxe sicle.
Andr Jean de Larocque, avocat et valet de chambre de
la Reine, selon Jean Bouchary (28), propose en 1785 L'ta-
blissement d'une caisse gnrale des pargnes du
peuple (29). S'il dclare s'inspiI:er de l'exprience britan-
nique de l'assurance, de Larocque estime que cette tech-
nique doit d'abord servir protger les hommes contre les
affres de la grande pauvret. La misre est le terme des
travaux du peuple quand nul moyen d'acqurir n'est en pro-
portion avec la modicit de ses salaires . Un projet inspir
par cette initiative est soumis l'Assemble provinciale
d'Orlans, en 1787 par Lavoisier, sous le nom de caisse
d'assurance en faveur du peuple contre les atteintes de la
misre et de la vieillesse .
Les avances de la mathmatique sociale n'encouragent
130
LA PROTECTION
pas uniquement des vocations philanthropiques, elles susci-
tent des apptits financiers, qui placent les savants consults
en position dlicate. Ainsi, ... Laplace et Condorcet se
retrouvrent au beau milieu de cette cure et, ce qui est
symptomatique, ils ne purent s'empcher de prendre posi-
tion sur les questions politiques de fond qui taient en
jeu (30).
Condorcet qui a trs tt privilgi les finalits humani-
taires, trouvera avec la Rvolution le cadre propice pour
l'utilisation du nouveau savoir. Sa proposition d'tablir des
caisses de secours et d'accumulation soulve l'enthou-
siasme de Jean Jaurs, qui salue les vues vastes et fermes
du grand Condorcet (31). Dans Esquisse d'un tableau
historique des progrs de l'esprit humain , rdig dans les
conditions dramatiques de la clandestinit, aprs la chute
des girondins en juin 1793, Condorcet dveloppe avec
audace les perspectives d'une mutualit ... tendue tous
les individus et tous les risques (32).
Condorcet pressent que les applications du calcul des pro-
babilits ouvrent des voies indites pour la connaissance des
aspects les plus divers du droulement de la vie humaine. Il
nous livre une bauche remarquable de la notion encore
inconnue de morbidit. Combien les recherches sur la
dure de vie des hommes, sur rinfluence qu'exerce sur cette
dure la diffrence des sexes, des tempratures, du climat,
des professions, des gots, des habitudes de vie; sur la
mortalit qui rsulte des diverses maladies, sur les change-
ments que la population prouve, sur l'tendue des diverses
causes qui produisent ces changements, sur la manire dont
elle est distribue dans chaque pays suivant les ges, les
sexes, les occupations; combien toutes ces recherches ne
peuvent-elles pas tre utiles la connaissance physique de
rhomme, la mdecine, rconomie publique. Combien
rconomie publique n'a-t-elle pas fait usage de ces mmes
calculs pour les tablissements de rentes viagres, des ton-
tines, des caisses d'accumulation et de secours, des cham-
bres d'assurance de toute espce (33).
Dans une priode o s'affirme la prminence de l'Etat,
131
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Condorcet ouvre une perspective originale en proposant de
conjuguer l'effort d'assistance de la puissance publique et
celui des socits de secours d'origine prive. A la condition
que ces dernires ne soient pas rserves aux privilgis et
qu'elles assimilent les rudiments de la science actuarielle.
Nous ferons voir que ces tablissements qui peuvent tre
forms au nom de la puissance sociale et devenir un de ses
grands bienfaits, peuvent tre aussi le rsultat d'associations
particulires, qui se formeront sans aucun danger, lorsque
les principes d'aprs lesquels ces tablissements doivent
s'organiser seront devenus plus populaires et que les erreurs
qui ont dtruit un grand nombre de ces associations cesse-
ront d'tre craindre pour elles (34).
La cration d'organismes d'entraide mutuelle de statut
priv avait t prsente quelques mois plus tt par le Dr
Marsillac. S'inscrivant dans la politique anti-hospitalire
officielle, il propose que les hpitaux soient : ... rem-
placs par des socits civiques, qui assureront aux artisans
dans le cadre de maladies ou d'afflictions humaines tous les
secours... (35). Les institutions prconises par Marsillac
sont conues sur le modle des socits civiques connues
en Ecosse, en Angleterre, sous le nom de socits frater-
nelles, d'Union, de Concorde, etc. qu'il a tudi au cours
de plusieurs sjours dans les les britanniques.
On ne connat gure l'cho vritable rencontr par cette
initiative, mais outre la confirmation de l'attraction exerce
par les friendly societies , elle mrite notre attention car
son rglement constitue en fait, de vritables statuts-types
de socit mutualiste, les premiers trs vraisemblablement
qui aient t publis (36).
Marsillac, soucieux de prserver les futures socits de
secours de l'aventure financire, souhaite qu'elles s'inspi-
rent des progrs de la science actuarielle, sans remettre en
cause leur finalit philanthropique. Tel n'est pas le but des
divers promoteurs de caisses d'pargne, tontines ou compa-
gnies d'assurance, qui flerissent sous la Constituante et la
Lgislative.
132
LA PROTECTION
DANS LE FRUIT DE LA PRVOYANCE, LE VER
DE L'AGIOTAGE
La morale de la prvoyance en France s'est construite
comme une morale de bourgeois et de paysans aiss, en
opposition la providence de la religion catholique (37).
Lorsque le cur de Gap tonne contre la prvoyance en 1773,
il vise moins l'pargne populaire, que celles des bourgeois
fortuns. C'est donc votre argent qui vous rassure contre
tous les accidents qui peuvent vous arriver? C'est donc lui,
qui est votre Dieu ? (38). La Rvolution de 1789 bouscule
les dogmes de l'ancienne morale dans le domaine de la pr-
voyance.
L'idologie de l'pargne s'impose d'autant plus aisment,
du moins dans la phase initiale de la Rvolution, que la pr-
voyance est gnralement prsente comme l'assurance-vie
du pauvre. C'est ce que propose Larochefoucauld-Lian-
court dans son quatrime rapport du Comit de mendicit
en regrettant que les nouvelles techniques de calcul soient
surtout utiles aux actionnaires des tablissements d'assu-
rances et leurs clientles privilgies.
Dans ce contexte, les oprations financires menes sous
le couvert des divers projets de caisses d'pargne, de secours
et de prvoyance, qui prosprent en 1790, se prsentent tout
naturellement au nom de l'intrt gnral et de l'assistance
aux pauvres. Le cas le plus connu, celui de la Caisse
Lafarge, devient rapidement un objet de controverses parmi
les Constituants.
Aprs plusieurs tentatives infructueuses, faites avant la
Rvolution, Joachim Lafarge, ancien ngociant, soumet
la fin de 1790 diffrentes autorits rvolutionnaires un
projet de bienfaisance intitul Tontine viagre et d'amor-
tissement . L'accueil de la Section du Thtre Franais et
du Club des Jacobins est trs favorable. La commune de
Paris, puis le Comit des finances de l'Assemble nationale
portent un regard bienveillant sur le projet, nanmoins
soumis l'avis de l'Acadmie des sciences.
Favorable au principe, l'autorit scientifique n'approuve
133
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
pas les modalits proposes. Le rapport, qui porte les signa-
tures de La Place et de Condorcet, considre le plan du
sieur Lafarge comme dsavantageux aux actionnaires
d'un ge avanc et renfermant une partie des inconvnients
attachs aux loteries... (39). Condorcet, dans la lettre
accompagnant les conclusions transmises aux parlemen-
taires, justifie le jugement ngatif de l'Acadmie par le
souci de prserver le principe de prvoyance contre des
projets mal combins qui discrditeraient les bons projets
qu'on voudrait y substituer ... (40).
Lors du dbat ouvert l'Assemble nationale le
27 fvrier 1791, Mirabeau salue dans la prvoyance la
seconde providence du genre humain . La seule rserve
que lui inspire le projet Lafarge, c'est le nom de tontine. Il
propose de lui donner l'appellation plus sduisante de
Caisse d'Epargne et de bienfaisance; ce titre aurait mieux
fait connatre au pauvre ses besoins et au riche ses
devoirs ... (41). Dans le but d'engager l'Assemble en
faveur de cet tablissement, Mirabeau propose le prlve-
ment de cinq jours du traitement de chaque dput, pour
constituer des actions destines aux familles deshrites.
Robespierre dnonce l'appt de Mirabeau et le prin-
cipe mme de l'entreprise: Il semble que l'on ait choisi le
projet le moins conforme la morale, celui d'une loterie,
pour vous la prsenter sous des formes sduisantes (42).
Buzot, proche du dput d'Arras, obtient le rejet du projet
Lafarge, en arguant que L'Assemble ne devait pas avoir
l'air de cautionner une compagnie de finances (43).
L'chec ne dcourage pas Lafarge. Il russit, en diffusant
largement l'opinion de Mirabeau, runir un nombre
important de souscripteurs. La critique des avantages illu-
soires de la Caisse Lafarge, n'empchera nullement ses
dirigeants de raliser de copieux profits (44). A peine,
peut-on noter, sous le Directoire, la mise en garde de
Laussat, dput des Basses-Pyrnnes au Conseil des
Anciens : Je vois simplement en elle une compagnie qui a
spcul sur les effets publics (45).
Il . faudra attendre 1809, pour que l'administration de la
134
LA PROTECTION
caisse soit retire des mains de ses fondateurs. Le rapport
des commissaires chargs de l'enqute est accablant: Les
malversations des directeurs de la Caisse d'pargne dite
Lafarge sont enfin connues. Depuis quinze annes ils
exploitent comme leur proprit unique une entreprise en
apparence d'utilit publique, devenue profitable eux
seuls (46).
Sur les vingt-trois caisses et tontines cres pendant la
Rvolution, il ne restera en activit sous l'Empire, que la
Caisse Lafarge et la tontine du Pacte social, toutes deux
dans le mme tat de dlabrement. Jean Bouchary observe
que ces tablissements, dont le but social tait de faire con-
tribuer le riche au bonheur du pauvre, avaient dbouch sur
un rsultat inverse : la mortalit des gens aiss, des ren-
tiers tant infrieure celle des artisans et des ouvriers,
d'ailleurs plus nombreux (47).
L'ASSURANCE-VIE MORT-NE
L'assurance est la fille du capital (48). Instrument de
protection et de valorisation de la proprit mobilire,
l'assurance se trouve l'troit dans le cadre de la proprit
foncire fodale : ... le seul domaine qui permettait, aux
origines, de s'vader de la rigide armature fodale tait la
mer (49). L'assurance maritime apparat logiquement
comme la premire tape de l'aventure assurantielle. La
morale religieuse constitue, ds le dpart, un obstacle de
taille pour cette activit qui a la particularit de produire de
l'argent partir de l'argent. Encore ne s'agit-il, l'origine,
que de garantir des biens matriels.
L'opposition l'assurance sur la vie humaine sera plus
opinitre encore, tout particulirement dans les pays de tra-
dition catholique. L'ordonnance de Colbert de 1681 interdi-
sant l'assurance sur la vie pour la raison qu' on ne saurait
attribuer un prix la vie humaine , est encore en vigueur
un sicle plus tard. Il faut attendre la dernire anne de
l'Ancien rgime pour que soit autorise, nous l'avons vu, la
135
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
cration de la Compagnie royale d'assurance sur la vie ,
sous la houlette de Mirabeau, de Brissot et surtout de Cl a-
vire.
Le prospectus de prsentation, rdig en 1788 par Etienne
Clavire, brillant aventurier de la finance d'origine gene-
voise, suscite encore l'admiration un sicle et demi plus tard
chez les spcialistes (50) pour le talent de vulgarisateur dont
il sut faire preuve. Clavire, expuls de Genve vers l'Angle-
terre pour des raisons politiques, eut la chance de recevoir
l'enseignement du Docteur Price, fondateur de l'Equi-
table , premire compagnie d'assurance-vie de l'histoire.
Au cours de ce sjour britannique, Clavire dcouvre que
l'assurance est un merveilleux moyen de concilier les int-
rts du capitalisme et ceux de la classe laborieuse . Il dve-
loppe la future thmatique rvolutionnaire sur l'pargne
populaire. L'assurance-vie ne s'adresse pas aux seuls indi-
vidus aiss: c'est non seulement pour venir au secours
d'une sollicitude aussi louable que des calculateurs ing-
nieux et prvoyants ont cr diverses sortes d'assurance sur
la vie; ils ont eu un but plus respectable encore, celui de
favoriser la classe pauvre et laborieuse; la plus importante
de la socit ... L'ouvrier pauvre se persuade qu'il est impos-
sible de faire fructifier solidement de petites pargnes. Ce
prjug lui te l'esprit de prvoyance (51).
L'accs des milieux d'affaires au pouvoir, en 1789, ouvre
thoriquement des perspectives prometteuses pour les acti-
vits d'assurance. Il y a loin de la coupe aux lvres, puis-
qu'au bout de quatre annes de Rvolution l'assurance est
mise hors la loi. Clavire, administrateur-grant de la
Royale , parvient pendant les trois premires annes
assurer un dveloppement honorable de la compagnie. Les
facteurs politiques jouent un rle certain dans l'effacement
des institutions d'assurance, au nombre desquels il faut
noter la personnalit de Clavire, devenu le 10 avril 1792,
ministre des Contributions dans le ministre girondin.
L'assurance-vie a galement souffert de son assimilation
aux loteries. ... l'abtardissement de l'assurance en pari
retarda trs fortement le dveloppement rationnel de l' assu-
136
LA PROTECTION
rance srieuse ... (52). Clavire dans un mmoire rdig en
fvrier 1793, dans le cadre de ses responsabilits minist-
rielles contribue la confusion des genres : Vous con-
naissez, citoyens, la passion du pauvre pour les loteries.
Tchons, efforons-nous de tourner son avantage ce pen-
chant qui lui fait chercher son bien-tre dans ces inven-
tions ... Dans les loteries l'entrepreneur s'enrichit des mises
du pauvre; ici, c'est le pauvre qui profite des avantages
d'une entreprise soutenue par le trsor national (53).
Au lendemain de la chute de la monarchie, les institutions
financires deviennent suspectes. Le Journal de Paris
publie le 20 octobre 1792, un communiqu de la Compagnie
d'assurance-vie annonant la suspension de ses activits.
Aprs la dfaite des Girondins et l'arrestation de Clavire le
2 juin 1793, l'interdiction des diverses activits financires,
notamment celles des compagnies d'assurance, ne tarde pas.
Elle est proclame par la Convention dans la sance du
24 aot 1793, prside par Robespierre. La raison invoque
est essentiellement politique. En effet, il existe en ce
moment un combat mort entre tous les marchands
d'argent et l'affermissement de la Rpublique. Il faut donc
tuer toutes ces associations destructives du crdit public, si
nous voulons tablir le rgne de la libert , dit Cambon, au
nom du comit des finances (54).
Le rejet de l'assurance ne dcoule pas seulement du
combat rpublicain contre l'agiotage contre-rvolution-
naire, il rpond des motivations thiques. Les assu-
rances substituent le service du calcul au service de l'huma-
nit et font disparatre de la socit la sensibilit gnrale
qui en est une des bases (55), rapporte P.-J. Richard. Bien
que l'argument ne figure pas dans les dbats de la Conven-
tion, il parat plausible. Les racines de cette dfiance morale
sont profondes. L'assurance sur la vie devra attendre
l'anne 1819 pour retrouver droit de cit en France, creu-
sant ainsi un srieux retard technique et financier sur le
redoutable concurrent britannique.
137
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
NAISSANCE DE LA MDECINE MODERNE
L'Etat rvolutionnaire dtruit de fond en comble
l'ancien rgime mdical (56). Dans ce domaine comme
dans bien d'autres, la besogne avait t prpare par l'Etat
monarchique, infiltr par l'esprit rformateur des
lumires. Le caractre collectif de l'pidmie, risque
majeur du temps, interdit de s'en remettre l'individua-
lisme mdical. L'Etat a la responsabilit de mobiliser toutes
les ressources de la science pour combattre ce risque. Ce
que fait Turgot, en crant la Socit royale de mdecine,
dans le but de coordonner la lutte contre les pidmies. Le
mouvement lanc, la Socit royale passe vite des flaux
exceptionnels aux malheurs du quotidien, ceux vcus par les
pauvres quand ils sont malades.
L'un des membres les plus minents de la Socit royale
de mdecine, le chirurgien Jacques Tenon, rdige, avec le
concours de Bailly et de Larochefoucauld-Liancourt, en
novembre 1786, le clbre et terrible rapport sur l'Htel-
Dieu et les hpitaux de Paris. Tenon crie son indignation
devant: le spectacle rvoltant qu'offrent aux yeux des
citoyens les malades couchs depuis deux jusqu' huit dans
un lit (57).
Quelques mois plus tard, le 24 mai 1787, Jacques Tenon
s'embarque pour l'Angleterre sur l'ordre de Louis XVI,
pour tudier l'organisation hospitalire de ce pays. II
revint d'Angleterre profondment impressionn par cette
ide que la responsabilit morale du pauvre et du malade,
tout comme le fardeau financier, appartient la commu-
naut et la Nation ... (58). L'volution de Tenon reflte
l'aspiration rformatrice du corps mdical qui trouve avec
1789 les conditions de son panouissement.
Les principes de la politique hospitalire dfinie par la
Constituante, donnent le cap pour toute la priode rvolu-
tionnaire. Trois objectifs principaux sont proposs:
Dcharger l'hpital de sa population d'assists en instau-
rant des secours domicile, assurer une meilleure rparti-
tion des revenus hospitaliers entre les rgions, amliorer
138
LA PROTECTION
l'hygine et les soins des tablissements destins aux
malades (59). La prescription du lit individuel ou la sup-
pression par Pinel des chanes pour les dments attestent
que le volontarisme rvolutionnaire n'interdit pas de
prendre des mesures concrtes.
Paradoxalement, l'hpital se modernise dans une priode
o l'on programme sa disparition. Au total, la mutation
opre dans le mode de financement des institutions hospi-
talires s'avrera, contre toute attente, profitable. A
l'issue d'une crise srieuse mais transitoire, cette transfor-
mation du financement des hpitaux (moins de loyers et fer-
mages, davantage de rentes, recettes variables et crdits
d'octroi) leur est, terme bnfique. Ds l'an XII, les
recettes des hpitaux et hospices parisiens sont suprieures
celles de 1789 (60).
Ce sont les dcisions touchant le plus directement la
rnovation des pratiques et des connaissances mdicales,
qui connatront la postrit la plus sre. Trois universits
de mdecine, Paris, Montpellier et Strasbourg, sont cres
par loi du 14 frimaire an III (4 dcembre 1794). Elles se
substituent la multiplicit des coles existant sous l'Ancien
rgime dont l'archasme le disputait au laxisme, puisque
quelques unes dlivraient des diplmes sans faire subir
d'examens aux candidats (61). L'enseignement mdical est
doublement rnov par l'instauration de liens entre la mde-
cine et la chirurgie et par l'essor des activits cliniques, qui
permet la liaison de la thorie et de la pratique.
Soyons clair, dit Jacques Lonard : la clinique ne date
pas de 1795 et l'anatomie pathologique non plus ... Ce qui
est nouveau, c'est la destruction des institutions d'enseigne-
ment o proraient la routine et le byzantinisme (62). Les
noms des acteurs de cette transformation rvolutionnaire au
plein sens du terme, sont prestigieux, comme le sont ceux de
leurs disciples directs. Les citer, revient dresser l'inven-
taire du patrimoine hospitalier contemporain: Tenon,
Bichat, Cabanis, Foucroy, Corvisart, Baudelocque, Pinel,
HaIl, Chaptal, Berthollet, Broussais, Bretonneau,
Lannec, Rcamier, Dupuytren, Velpeau, etc.
139
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Les matres mots lgus par les lumires : science et
galit, assurent, au-del des improvisations hasardeuses, la
cohrence de cette gigantesque mutation. A une poque o
les charlatans sont le plus grand nombre, l'galit dans
l'accs aux soins exige la multiplication des mdecins et leur
installation la campagne. Lorsqu'on demande Jacques
Tenon les raisons qui l'on conduit, lui chirurgien, se
proccuper de l'organisation des soins, il rpond: qu'il
avait pens aux paysans de Massy, o il avait une maison;
qu'on est citoyen avant d'tre gurisseur (63).
La foi dans la science est l'autre grande force propulsive.
Le lien entre science et Nation est si fort pendant la Rvolu-
tion que jamais tant de savants n'approchrent du pou-
voir central , selon l'observation du philosophe Michel
Serres (64). Cette connivence, rarissime dans l'histoire, entre
savoir et pouvoir, particulirement dveloppe dans le
domaine sanitaire, assurera pendant un demi sicle la pr-
minence de l'cole franaise de mdecine dans le monde (65).
Le bilan de l'action de la Rvolution franaise dans le
domaine de la protection sociale et sanitaire prsente, sur le
plan compar des intentions et des actes, un dficit indiscu-
table. Mais, la porte de l'vnement interdit de l'enfermer
dans une balance comptable, ft-ce celle du bilan globale-
ment positif .
Alan Forrest, au terme d'un examen sans complaisance,
conclut son livre La rvolution et les pauvres par les
mots du bon sens : La Rvolution -essaie, au moyen de
mesures parfois draconiennes d'imposer une structure lgi-
slative moderne, et souvent complique, une socit o
l'ignorance est largement rpandue et le sentiment nationale
encore en gestation. C'est un objectif inaccessible. En
vrit, il est surprenant qu'une uvre aussi importante ait
pu tre accomplie dans des conditions aussi difficiles (66).
Comment le peuple des villes et des campagnes, destina-
taire proclam de l'uvre rvolutionnaire, n'aurait-il pas
peru, malgr les preuves dramatiques, lui aussi son
importance?
140
LA PROTECTION
NOTES
(1) Antoine de Baecque. - L'an 1 des droits de rhomme, op. cit.,
p.317.
(2) Jacques Godechot. - La Rvolution franaise, 1787-1799, 1988,
p.95.
(3) Alan Forrest. - La Rvolution franaise et les pauvres, op. cit.,
p. 15.
(4) Ides d'un citoyen sur les droits et les devoirs des vrais pauvres,
1765, t. 1, p. 169.
(5) Camille Bloch et Alexandre Tuetey. - Le Comit de mendicit et la
Constituante, op. cit., p. 310.
(6) Camille Bloch. - L 'assistance publique-Instruction, recueil de textes
et notes (de 1789 l'an VIII), 1909. - In : Bulletin d'Histoire de la
Scurit Sociale, n 16, p. 21.
(7) Archives parlementaires, t. 31, p. 340.
(8) Jacques Tenon. - Rflexions en faveur de pauvres citoyens
malades, 1791, B.N. RP.I0475.
(9) Cit par Ferdinand Dreyfus. - L'assistance sous la Lgislative et la
Convention, op. cit., p. 10.
(10) Moniteur, t. 12, p. 655.
(11) Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op. cit., t. 2, p. 481.
(12) Ibidem.
(13) Bulletin d'histoire de la Scurit sociale, n 16, p. 21.
(14) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., t. 6, p. 11.
(15) Adresse la Convention nationale par les commissaires runis des
48 sections de Paris, B.N. Lb41. 2857.
(16) uvres, XII, p. 316.
(17) B.N. 8 Lb41. 751.
(18) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rpublique franaise, op.
cit., t. 6, p. 162.
(19) Les sans-culottes, op. cit., p. 90.
(20) Jacques Godechot. - Les institutions de la France, op. cit., p. 443.
(21) Jules Michelet. - In : Le Peuple, 1974, pp. 92-93.
(22) Alain Cottereau. - Table ronde Prvenir, 16 et 17 dcembre 1988,
paratre courant 1989.
141
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
(23) Discours et projets de dclaration des principes essentiels de rordre
social et de la Rpublique par Philippe-Antoine dit Merlin de
Douai, B.N. C38.1340.
(24) - Rapport sur rorganisation des secours publics, sance
du 12 Vendmiaire an IV, pp. 2-4, B.N. Le 38. 1709.
(25) L'assistance sous la Lgislative et la Convention, op. cit., p. 171.
(26) Keith Baker. - Condorcet, 1988, p. 357.
(27) Ibidem, p. 366.
(28) Jean Bouchary. - Les compagnies financires Paris, 1940, t. 1,
p.14.
(29) L'tablissement d'une caisse gnrale des pargnes du peuple, B.N.
R.40798.
(30) Keith Baker. - Condorcet, op. cit., p. 368.
(31) Jean Jaurs. - Histoire socialiste de la Rvolution franaise, op.
cit., t. 2, p. 482.
(32) Ibidem, t. 6, p. 474.
(33) Condorcet. - Esquisse d'un tableau historique des progrs de
resprit humain, pp. 42-43, B.N. R.32169.
(34) Ibidem, p. 70.
(35) Dr Marsillac. - Hpitaux remplacs par des socits civiques et par
des maisons d'industrie, 1792, B.N. RP.6472.
(36) Jean Bennet. - Dj des statuts types mutualistes en 1792, 1961,
p.5.
(37) Alain Cottereau. - Prvoyance des uns, imprvoyance des autres.
In : La Revue Prvenir, n 9, mai 1984, p. 59.
(38) Bernard Groethuysen. - Origines de resprit bourgeois en France,
1977, p. 226.
(39) Jean Bouchary. - Les compagnies financires de Paris la fin du
XVIIIe sicle, op. cit., p. 17.
(40) Ibidem.
(41) Ibidem, p. 19.
(42) Ibidem, p. 20.
(43) Ibidem, p. 21.
(44) Ibidem, p. 24.
(45) A.N. AD/XIV /6.
(46) Ibidem.
(47) Les compagnies financires Paris, op. cit., p. 102.
(48) Franois Ewald. - L'Etat-Providence, 1986, p. 182.
142
LA PROTECTION
(49) J. Halprin. - Les assurances en Suisse et dans le monde, 1945,
p.22.
(50) P .-J. Richard. - Histoire des institutions d'assurance en France,
1956, p. 20. Selon une publication rcente le vritable auteur de ce
texte serait en ralit Duvillard de Durand (voir Guy THUILLIER,
In : Bulletin d'Histoire de la Scurit Sociale, n 18, p. 32).
(51) A.N. AD/XIV/S.
(52) J. Halprin. - Les assurances en Suisse et dans le monde, op. cit.,
p.65.
(53) A.N. AD/XIV /6.
(54) Moniteur universel, 25 aot 1973.
(55) Histoire des institutions d'assurance en France, op. cit., p. 37.
(56) Jacques Lonard. - La mdecine entre les pouvoirs et les savoirs,
1981, p. 12.
(57) Jacques Tenon. - Rflexions en faveur des pauvres citoyens
malades, op. cit., p. 12.
(58) Louis S. Greenbaun. - La tourne des hpitaux anglais par J.
Tenon en 1787. - In : Revue d'histoire des sciences, 1971, t. 24,
pp. 317-350.
(59) Catherine Duprat. - L 'hpital et la crise hospitalire. - In : l'tat
de la France sous la Rvolution, op. cit., p. 58.
(60) Ibidem, p. 59.
(61) Henry Ingrand. - Le comit de salubrit de l'Assemble nationale
Constituante, (1790-1791). Thse de doctorat en mdecine, B.N.
Tb. Paris-l0762.
(62) Jacques Lonard. - La mdecine entre les pouvoirs et les savoirs,
op. cit., p. 23.
(63) B.N. Nouvelles acquisitions franaises - 11358 Fol. 32.
(64) Cit par Rgis Debray. - Que vive la Rpublique, 1989, p. 128.
(65) Catherine Duprat. - L 'hpital et la crise hospitalire, op. cit.,
p.60.
(66) op. cit., p. 233.
143
Conclusion
L'EFFET LE CHAPELIER
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
Au terme de cette rapide exploration du paysage social
dessin par la Rvolution franaise, le moment est venu de
risquer quelques hypothses concernant la porte de
l' uvre rvolutionnaire sur le cours de la mutualit et celui
des associations de solidarit formes dans les commu-
nauts de travail.
L'entreprise est aventureuse, l'interprtation historique
n'ayant jamais t un long fleuve tranquille. Raison de plus,
pour nous garder des cueils les plus apparents. Le dvelop-
pement contemporain de la mutualit et du mouvement
social ne saurait tre considr comme le pur produit d'un
dterminisme initi par la Rvolution franaise. L'entraide
mutuelle appartient la longue dure. Elle jette un pont
entre l'ancien et le nouveau rgime. Sa prennit illustre
l'observation chre l'historiographie anglo- saxonne, selon
laquelle des continuits nombreuses traversent l'poque
rvolutionnaire.
A peine a-t-on mis l'accent sur la permanence de l'action
mutualiste, qu'il convient de souligner avec force
l'empreinte laisse par la Rvolution sur la forme des
socits vocation solidaire. Autre pige, celui qui conduit
crditer la lgislation rvolutionnaire de motivations for-
ges dans la phase ultrieure de l'industrialisation. Les dci-
sions touchant le droit d'association relvent indissociable-
ment de considrations sociales et culturelles.
L'effet Le Chapelier, figure emblmatique de l'influence
rvolutionnaire, s'exerce sur deux plans: le rejet de l'asso-
ciation professionnelle et la promotion du principe d'assis-
tance dans le cadre de la solidarit nationale. L'interdit
associatif vise la coalition ouvrire. Les activits d'entraide
mutuelle n'ont pas vritablement souffert de la rpression.
Faut-il estimer, pour autant, que la mutualit a t prise
en tenaille dans une contradiction qui ne la concernait pas ?
L'assertion nglige les liens historiques tisss entre les acti-
vits de rsistance et de secours. Ds lors que la libert du
commerce apparat irrmdiablement oppose la libert
d'association professionnelle, toute forme de groupement
interne aux mtiers ne pouvait que devenir suspecte.
146
CONCLUSION
L'association est davantage refoule pour des raisons cul-
turelles et idologiques que par gosme de classe. La libert
proclame est, avant tout, celle du travail et de l'entreprise ;
l'galit signifie l'abolition des privilges aristocratiques,
parmi lesquels les corporations figurent en bonne place.
L'assimilation des socits fraternelles aux privilges corpo-
ratifs de l'Ancien rgime constitue prcisment le cur du
malentendu.
Finalement, l'hostilit commune des rvolutionnaires
l'encontre des associations de salaris trouve sa justification
dans l'ide abstraite de l'intrt gnral qui mobilise les
esprits clairs de la fin du XVIIIe sicle. L'expression des
intrts particuliers, selon le principe rousseauiste, constitue
une menace pour la socit toute entire.
La prennit de cette utopie dangereuse a eu pour cons-
quence, outre le veto au droit d'association, de faire obs-
tacle une conception de l'intrt gnral fonde sur un
compromis pass entre les intrts particuliers, dans un
cadre conflictuel reconnu.
Les dommages causs par la prohibition du principe asso-
ciatif ne soulvent gure de doute; l'influence de la poli-
tique rvolutionnaire d'assistance sur les associations
d'entraide parat moins tablie. A l'instant mme o elle
refoule les socits fraternelles, la Rvolution lve la fra-
ternit, cette autre faon de dire la solidarit, au rang de
devoir sacr de la Nation (1).
Paradoxalement le premier homme d'Etat qui invoque le
principe de l'assistance publique dans un texte de loi, n'est
autre que Le Chapelier. Anticipation qui lui vaudra des
reproches posthumes de la part d'Emile Ollivier pour avoir
formul la conception de l'Etat-Providence (2). Dans le sil-
lage du principe des secours publics conus comme un
droit, les sciences mdicales et les techniques de prvoyance
accomplissent des progrs considrables. Leur rsurgence
un sicle plus tard favorise l'organisation publique et prive
de la protection sociale sur des bases solidaires.
L'exprience rvolutionnaire fait prendre conscience aux
humbles que la misre et l'injustice n'appartiennent pas,
147
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
fatalement, l'aventure humaine. La dynamique libre par
1789 . fait reculer le fatalisme et la rsignation. La devise
mutuelliste des doreurs sur mtaux, repousss de partout,
ils se soutiennent eux-mmes (3), apparat significative-
ment au lendemain de la Rvolution.
La socit vocation librale de la premire moiti du
XIXe sicle ne peut ignorer les antagonismes qu'elle
engendre. L'industrialisation et l'urbanisation naissantes
rvlent les limites du dogme de l'individu isol. Les auto-
rits successives appliquent la loi du 14 juin 1791 avec un
pragmatisme modul. Le barrage oppos l'association
ouvrire s'accompagne d'un filtrage subtil. La pratique
d'assistance est tolre, sans que jamais se relche la vigi-
lance l'gard des ... effets pervers qu'elle pourrait
induire (4).
L'effet Le Chapelier, qui agit alternativement comme un
frein et un moteur sur l'organisation de l'entraide, favorise
la diversification des socits de secours. La sparation des
fonctions de rsistance et de prvoyance, est amorce ds la
Constituante. Les adhrents des mutuelles grenobloises,
notamment la mutuelle des gantiers cre en 1803, adoptent
des statuts par lesquels ils se disent fidles observateurs de
la loi du 14 juin 1791 (5). Nombre de socits profession-
nelles rcusent toute allgeance et sont condamnes un
fonctionnement semi -clandestin.
Les mutuelles du XIXe sicle, qu'elles soient respec-
tueuses de l'ordre social ou pr-syndicales, intgrent dans
leur gestion de l'entraide, les acquis de la solidarit largie
et rationnelle transmis par la Rvolution. La pression anti-
associative provoque, dans la dernire partie du sicle, le
divorce dfinitif des formes de solidarits mutualistes et
syndicales. Ce rendez-vous manqu de la mutuellit et du
fait syndical a pes lourd dans rhistoire du syndicalisme
franais , estime Pierre Rosanvallon (6).
On a coutume de souligner la prcocit des liberts
sociales tablies en Grande-Bretagne, dans le cadre de la
rvolution industrielle. Les mutuelles (Friendly societies)
sont lgalises en 1793 et les associations syndicales en 1824.
148
CONCLUSION
La Rvolution franaise, plus politique, invente les concepts
dmocratiques de l'poque moderne. Le suffrage universel
instaur en France par la Rvolution de 1848, ne verra le
jour en Angleterre qu'en janvier 1918. L'hgmonie du
politique propulse par 1789 constitue, avec l'interdit asso-
ciatif, l'autre puissant motif de fragmentation du mouve-
ment social franais et de diffrenciation de ses fonctions.
L'entre en Rpublique dans les annes 1880 autorise,
enfin, l'abrogation de la loi Le Chapelier. C'est chose faite
en 1884, pour les syndicats ... ns rpublicains (7), en
1898 pour la mutualit aprs quatorze annes de noviciat
rpublicain, en 1901 pour l'association en gnral. La
Charte mutualiste, dit son pre spirituel Hippolyte Maze
constitue: le 89 de la mutualit qui s'est accompli (8).
Un sicle aura donc t ncessaire pour que les contradic-
tions, loges entre la libert d'association et la libert
d'entreprise, soient gres dans un cadre lgal.
La Mutualit franaise devient l'instrument des ambitions
sociales des autorits rpublicaines. Sa rencontre avec la
rpublique n'est pas fortuite. Depuis un sicle libert, ga-
lit, fraternit, exprimait une contradiction plus qu'une
association (9). L'institution de solidarit possde les
atouts pour rconcilier les termes du tryptique rvolution-
naire.
La pratique de l'entraide mutuelle met en jeu une double
souverainet, l'individu et la socit, l'une et l'autre
inalinables selon le mot de Proudhon. A l'aube du XXe
sicle, le mouvement mutualiste s'impose comme l'un des
lieux privilgis pour raliser la synthse des logiques invidi-
viduelles et collectives mises jour par la Rvolution.
L'arbitrage dfavorable rendu la libert d'association
par la Constituante a contraint les salaris diffrencier
l'organisation de l'auto-dfense quotidienne par le syndicat,
de l'organisation de l'entraide par la mutuelle. Il se pourrait
que les barrires dresses contre l'association aient repr-
sent une chance pour la mutualit.
La loi Le Chapelier, en rendant inluctable le processus
d'automatisation des principales fonctions du mouvement
149
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
social, n'a-t-elle pas cr les conditions de leur panouisse-
ment respectif? La position de la Mutualit franaise,
devenue le premier mouvement social dans notre pays et la
seule institution de solidarit indpendante de cette enver-
gure en Europe, autorise une rponse positive.
Tel n'tait probablement pas le but poursuivi le 14 juin
1791, mais comme le dit Henri Hatzfeld: Aucun acteur
de rhistoire ne dtient la connaissance de tous les fils de la
toile qu'il tisse (10).
150
CONCLUSION
NOTES
(1) Voir le livre de Marcel David. - La fraternit et la Rvolution
franaise, 1987.
(2) Emile Ollivier. - Le Moniteur, 15 mai 1864, p. 688.
(3) Les Associations Professionnelles Ouvrires, op. cit., t. 1, p. 196.
(4) Franois Ewald. - L'Etat-Providence, op. cit., p. 73.
(5) Archives Nationales, AD/XIV /12.
(6) Pierre Rosanvallon. - La question syndicale, 1988, p. 83.
(7) Madeleine Rebrioux. - Premires lectures du Congrs de 1883. -
In : Prvenir, n 9, p. 85.
(8) Compte rendu du 1 er Congrs national des socits de secours
mutuels, p. 227.
(9) Eric J. Hobsbawm. - L're des rvolutions, op. cit., p. 307.
(10) Henri Hatzfeld. - Du pauprisme la scurit sociale, op. cit.,
p.327.
151
LISTE DES TRAVAUX CITS
classs par ordre alphabtique
AGULHON (Maurice). - Pnitents et Francs-maons de
rancienne Provence. - Paris: Fayard, 1984. - 454 p.
AGULHON (Maurice). - L 'histoire sociale et les asso-
ciations. - In : La Revue de l'conomie sociale, n 14, avril
1988, pp. 35-44.
ASSELAIN (Jean-Charles). - Histoire conomique de la
France. - Paris: Editions du Seuil, 1984. - t. 1, 221 p. -
t. 2, 209 p.
ATTALI (Jacques). - Au propre et au figur, une his-
toire de la proprit. - Paris: Fayard, 1988. - 553 p.
AULARD (Franois-Alphonse). - L'loquence parle-
mentaire pendant la Rvolution franaise. - Paris:
Hachette, 1882. -
AULARD (Franois-Alphonse). - Histoire politique de
la Rvolution franaise (1789-1804). - Paris: A. Colin,
1905. - 805 p.
BAECQUE (Antoine de), SCHMALLE (Wolfgang),
VOVELLE (Michel). - L'an 1 des droits de rhomme. -
Paris: Presses du C.N.R.S., 1988. - 359 p.
BAKER (Keith). - Condorcet. - Paris : Hermann- Edi-
teurs des sciences et des arts, 1988. - 623 p.
BENNET (Jean). - La Mutualit franaise des origines
la Rvolution de 1789. - Paris: C.LE.M., 1981. - 916 p.
BENNET (Jean). - Dj des statuts-types mutualistes en
1792. - Etampes: S.R.LP., 1961. - 12 p.
BENNET (Jean). - Piarron de Chamousset, philan-
thrope et mutualiste. - Etampes: S.R.LP., 1964. - 20 p.
BIAUGEAUD (J.-M.-J.). - La libert du travail sous
l'Assemble constituante. - Paris: P.U.F., 1939. - 124 p.
BIZARDEL (Yvon). - Les Amricains Paris pendant
la Rvolution. - Paris: Calmann-Lvy, 1972. - 293 p.
153
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
BLANC Louis). - Histoire de la Rvolution franaise. -
Paris: Langlois et Lec1ercq, 1847-1862. - 12 vol.
BLUCHE (Franois). - Au temps de Louis XVI. -
Paris: Hachette, 1980. - 396 p.
BLOCH (Camille) et TUETEY (Alexandre). - Le comit
de mendicit et la Constituante. - Paris : Imprimerie natio-
nale, 1911. - 847 p.
BLOCH (Camille). - L'assistance et l'Etat en France la
veille de la Rvolution. - Paris: A. Picard et Fils, 1908. -
504 p.
BLOCH (Camille). - L'assistance publique-Instruction,
recueil de textes et notes (de 1789 l'an VIII) - In : Bulletin
d'histoire de la Scurit sociale, n 16, septembre 1987,
p. 11-32.
BOUCHARY (Jean). - Les compagnies financires
Paris la fin du XVIIIe sicle. - Paris: M. Rivire, 1940-
1942. - 3 vol.
BUCHEZ (P .-J.) et ROUX (P .-C.). - Histoire parlemen-
taire de la Rvolution franaise. - Paris: Paulin, 1834-1838.
- 40 vol.
BOURDIN (Isabelle). - Les socits populaires Paris
pendant la Rvolution. - Paris : Librairie du recueil Sirey,
1937. - 455 p.
BOUVIER-AJAM (Maurice). - Histoire du travail en
France des origines la Rvolution. - Paris: L.G.D.J.,
1957. - 774 p.
BOUVIER-AJAM (Maurice). - Histoire du travail en
France depuis la Rvolution. - Paris: L.G.D.J., 1969. -
604 p.
CELLIER (Florent du). - Les classes ouvrires en France
depuis 1789. - Paris: Imprimerie de Dubuisson, 1857. -
96 p.
CHAMOUSSET (Piarron de). - uvres compltes. -
Paris : de Senne, 1787. - 2 vol.
CHASSIN (Charles-Louis). - Les lections et les cahiers
de Paris en 1789. - Paris: Jouast et Signaux - Charles
Noblet-Maison Quantin, 1888/1889. - 4 vol.
154
LISTE DES TRAVAUX
CHAUVET (Paul). - Les ouvriers du livre en France,
des origines la Rvolution de 1789. - Paris : P. U .F., 1959.
- 542 p.
CHAUVET (Paul). - Les ouvriers du livre en France, de
1789 la constitution de la Fdration du livre. - Paris :
Librairie Marcel Rivire et Cie, 1964. - 717 p.
CH OP ART (Jean-Nol). - Le fil du rouge du corpora-
tisme. - Rouen: L.E.R.S., 1987. - 123 p.
COMIT D'HISTOIRE DE LA SCURIT SOCIALE.
- La Scurit sociale - Son histoire travers les textes. -
Paris: Association pour l'tude de la Scurit sociale. -
t. 1 : 1780-1870, 1988. - 718 p.
CONDORCET (Jean Caritat de). - Esquisse d'un
tableau historique des progrs de l'esprit humain. - Paris:
Dubuisson, 1864. - 2 vol.
CONTAT (Nicolas dit Lebrun). - Anecdotes typographi-
ques. - Oxford bibliographical society publication, 1980. -
163 p.
CORNAERT (Emile). - Les corporations en France
avant 1789. - Paris: Les Editions ouvrires, 1968. - 316 p.
COTTEREAU (Alain). - Prvoyance des uns, impr-
voyance des autres. - In : Prvenir n 9, mai 1984, pp. 57-
68.
DAVID (Marcel). - La fraternit et la Rvolution fran-
aise. - Paris: Aubier, 1987. - 350 p.
DEBRAY (Rgis). - Que vive la Rpublique. - Paris:
Editions Odile Jacob; 1989. - 218 p.
DHNONT (Jean). - Notes sur les ouvriers industriels
gantois l'poque franaise. - In: La Revue du Nord,
1954, volume 36.
DREYFUS (Ferdinand). - Larochefoucauld-Liancourt,
un philanthrope d'autrefois. - Paris: Plon-Nourrit et Cie,
1903. - 547 p.
DREYFUS (Ferdinand). - L'assistance sous la lgislative
et la Convention, 1791-1795. - Paris: G. Bellais, 1905. -
180 p.
155
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
DUPRAT (Catherine). - L 'hpital et la crise hospita-
lire. - In : L'Etat de la France pendant la Rvolution (sous
la direction de Michel Vovelle). - Paris: Editions La Dcou-
verte, 1988, pp. 58-60.
DUROY (Jean-Pierre). - Le compagnonnage initiateur
de l'conomie - Le Mans: thse de doctorat de
l'Universit du Maine, 1982. - 483 p.
DUVERGIER (J.-B.). - Collection complte des lois de
1788 1830. - 1824, Paris : A. Guyot et Scribe, 1834. - 30
vol.
DUVILLARD DE DURAND. - Recherches sur les
rentes, les emprunts et les remboursements. - Bibliothque
Nationale R.7348, 1787.
ENCYCLOPDIE ou dictionnaire raisonn des sciences
des arts et des mtiers. - Stuttgart-Bad Canstatt, premire
dition 1751-1780, 1966. - 17 vol.
EWALD (Franois). - L'Etat-Providence. Paris :
Grasset, 1986. - 606 p.
FACCARELLO (Gilbert). - L'conomie politique. - In :
L'Etat de la France pendant la Rvolution. - Paris: Edi-
tions La Dcouverte, 1988, pp. 423-427.
FARGE (Arlette). - La vie fragile. - Paris : Hachette,
1986. - 354 p.
FAURE (Christine). - Les dclarations des droits de
rhomme de 1789. - Paris: Payot, 1988. - 387 p.
FORREST (Alan). - La Rvolution franaise et les pau-
vres. - Paris: Librairie Acadmique Perrin, 1986. - 283 p.
GARDEN (Maurice). - Lyon et les lyonnais au XVIIIe
sicle. - Paris: Flammarion, 1975. - 374 p.
GAXOTTE (Pierre). - La Rvolution franaise. - Paris,
1988.
GEREMEK (Bronislav). - Les salaris dans rartisanat
parisien aux XIII-xve sicles. - Paris: Ecole des hautes
tudes en sciences sociales, 1982. - 147 p.
GIBAUD (Bernard). - La socit philanthropique de
Paris ou les paradoxes du patronage aristocratique. - In :
156
LISTE DES TRAVAUX
La Revue de l'conomie sociale, n 13, janvier 1988,
pp. 177-183.
GODECHOT (Jacques). - Les institutions de la France
sous la Rvolution et l'Empire. - Paris: P.U.F. : 1968. -
791 p.
GODECHOT (Jacques). - La Rvolution franaise,
1787-1799. - Paris: Perrin, 1988. - 392 p.
GREEN BA UN (Louis). - La tourne des hpitaux
anglais par Jacques Tenon en 1787. - In : La Revue d'his-
toire des sciences, t. 24, 1971, pp. 317-350.
GROETHUYSEN (Bernard). - Origines de l'esprit bour-
geois. - Paris: Gallimard, 1977. - 300 p.
GURIN (Daniel). - La lutte des classes sous la 1 re
Rpublique. - Paris : Gallimard, 1946. - 2 vol.
GUILLEMIN (Henri). - Robespierre. - Paris : Editions
du Seuil, 1987. - 421 p.
HALPERIN (J.). - Les assurances en Suisse et dans le
monde. - Neuchtel: Editions de la Baconnire, 1945. -
276 p.
HAMON (Georges). - Histoire gnrale de l'assurance
en France et l'tranger. - Paris: Bureau du journal
L'assurance moderne , 1895-1896. - 768 p.
HARDY (Sbastien). - Mes loisirs ou journal d'vne-
ments tels qu'ils me parviennent ma connaissance. - Paris,
1764-1789. - B.N., Fonds Franais n 6680-6687.
HATZFELD (Henri). - Du pauprisme la Scurit
sociale. - Paris: Librairie Armand Colin, 1971. - 344 p.
HATZFELD (Henri). - Note sur la mutualit au XIxe
sicle. - In : Prvenir, n 9, mai 1984, pp. 17-23.
HAUSSER (Henri). - Ouvriers du temps pass (xve-
XVIe sicles). - Paris: 1899.
HOBSBA WM (Eric). - L're des rvolutions. - Paris:
Editions Complexe, 1988. - 416 p.
INGRAND (Henry). - Le Comit de salubrit de
l'Assemble nationale constituante (1790-1791). - Thse de
doctorat en mdecine. - B.N. Th. Paris-l0762.
157
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
ISAMBERT (F .-A.). - Recueil gnral des anciennes lois
franaises depuis l'an 420 jusqu' la Rvolution de 1789. -
Paris : 1822-1833. - 29 vol.
JAFFE (Grace M.). - Le mouvement ouvrier Paris
pendant la Rvolution franaise. - Paris : Librairie Flix
Alcan, 1924. - 215 p.
JAURS (Jean). - Histoire socialiste de la Rvolution
franaise. - Paris: Editions sociales, 1969. - 6 vol.
LABAL (PauI). - Notes sur les compagnons migrateurs
et les socits de compagnons Dijon la fin du xve sicle
et au dbut du XVIe sicle. - In : Annales de Bourgogne 22,
1950, pp. 189-191.
LACROIX (Sigismond). - Actes de la commune de Paris
pendant la Rvolution. - Paris : L. Cerf-Charles Noblet-
Maison Quantin, 1900-1914, 15 vol., notamment les t. 3, 4
et 5 de la 2
e
srie.
LAROCQUE (Andr-Jean de). - Etablissement d'une
caisse gnrale des pargnes du peuple. - Bruxelles, 1786. -
119 p.
LAURENT (Emile). - Le pauprisme et les associations
de prvoyance. - Paris: Librairie de Guillaumin et Cie,
1865. - 447 p.
LA VIELLE (Romain). - Histoire de la mutualit. -
Paris: Hachette, 1964. - 254 p.
LA VISSE (Ernest). - Histoire de la France contempo-
raine. - Paris: Par P. Sagnac, 1920. - t. 1.
LEFEBVRE (Georges). - La Rvolution franaise. -
Paris: P.U.F., 1968. - 699 p.
LEONARD (Jacques). - La mdecine entre les pouvoirs
et les savoirs. - Paris: Aubier, 1981. - 384 p.
LEROY (Maxime). - Histoire des ides sociales en
France. - Paris: Gallimard, 1950. - 551 p.
LEV ASSEUR (Emile). - Histoire des classes ouvrires de
l'industrie en France de 1789 1870. - Paris: A. Rousseau,
1903-1904, 2 vol.
MARSILLAC (Dr). - Hpitaux remplacs par des
socits civiques et par des maisons d'industrie. - Paris:
Imprimerie de la loterie nationale, 1792. - B.N. RP 6472.
158
LISTE DES TRAVAUX
MARTIN (Germain). - Les associations ouvrires du
XVIIIe sicle, 1700-1792. - Paris: A. Rousseau, 1900. -
277 p.
MARTIN (J .-B.). - La fin des mauvais pauvres. -
Seyssel: Collection milieux Champ Vallon, 1983. - 197 p.
MATHIEZ (Albert). - Le club des Cordeliers pendant la
crise de Varennes et le massacre du Champ de Mars. -
Paris: H. Champion, 1910. - 392 p.
MAYEN (Claude). - Les socits de secours mutuels. -
Paris: A. Rousseau, 1901. - 539 p.
MICHELET (Jules). - Le peuple. - Paris : Hachette et
Paulin, 1846. - 375 p.
MICHELET (Jules). - Rvolution franaise. - Paris:
Calmann-Lvy, 1898-1900. - 10 vol.
MERCIER (Louis Sbastien). - Le tableau de Paris. -
Paris: Franois Maspro, 1979. - 356 p.
MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE,
DES POSTES ET DES TLGRAPHES. - Les associa-
tions professionnelles ouvrires. - Paris : Imprimerie natio-
nale, 1899, t. 1 909 p., t. 2 895 p., t. 3 679 p., t. 4 821 p.
MOUSSAC (Marquis de). - Une corporation d'autre-
fois. - Paris: Lamulle et Poisson, 1892. - 117 p.
NOURRISSON (Paul). - Histoire de la libert d'associa-
tion depuis 1789. - Paris, 1920.
POTHIER (Robert Joseph). - Traits des contrats ala-
toires. - Paris: Debure l'an, 1767. - 358 p.
PORTAL (Charles). - Une socit de secours mutuels
sous la Rvolution : la Trinit de Gaillac (Tarn). - Albi :
Imprimerie Nouguis, 1907. - 15 p.
REBRIOUX (Madeleine). - Premires lectures du con-
grs de 1883. - In : Prvenir, nO 9, mai 1984, pp. 75- 85.
REIN HARD (Marcel). - Nouvelle histoire de Paris-La
Rvolution 1789-1799. - Paris: Hachette, 1971. - 457 p.
RICHARD (P.-J.). - Histoire des institutions d'assu-
rance en France. - Paris: Editions de l'Argus, 1956. -
333 p.
159
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
ROSANV ALLON (Pierre). - La question syndicale. -
Paris: Calmann-Lvy, 1988. - 268 p.
ROUSSEAU (Jean-Jacques). - Du contrat social. -
Paris: Pluriel, 1988. - 445 p.
RUBFEL (Eugne). - Notice du 150
e
anniversaire de la
socit typographique de Strasbourg de 1793 1933. - Stras-
bourg: Imprimerie strasbourgeoise-bilingue, 1933. - 196 p.
RUD (Georges). - La foule dans la Rvolution fran-
aise. - Paris: Franois Maspro, 1982. - 285 p.
SE (Benri). - Histoire conomique de la France. -
Paris : A. Colin, 1939. - 2 vol.
SENES (Victor). - Les origines des compagnies d'assu-
rance. - Paris: L. Dulac, 1900. - 376 p.
SEWELL (William B.). - Gens de mtiers et rvolu-
tions). - Paris : Aubier, 1983. - 423 p.
SOBOUL (Albert). - Les sans culotte - Paris : Editions du
Seuil, 1968. - 136 P.
SOBOUL (Albert). - L 'histoire de la Rvolution fran-
aise. - Paris: Editions Sociales, 1982. - 609 p.
SORREAU (Edmond). - La loi Le Chapelier. - In:
Annales historiques de la Rvolution franaise, janvier /f-
vrier 1931.
TAINE (B.). - Les origines de la France contemporaine-
La Rvolution. - Paris, 1876. - 3 vol.
TENON (Jacques). - Rflexions en faveur de pauvres
citoyens malades. - Paris: Imprimerie de Dsaine, 1791. -
23 p.
TENON (Jacques). - Mmoires sur les hpitaux de
Paris. - Royez, 1788. - 472 p.
TOCQUEVILLE. - L'Ancien rgime et la Rvolution. -
Paris: Gallimard, 1967. - 378 p.
VOVELLE (Michel). - La chute de la monarchie 1787-
1792. - Paris: Editions du Seuil, 1972. - 282 p.
WINOCK (Michel). - L'anne sans pareille. - Paris: O.
Orban, 1988. - 300 p.
160
INDEX DES PERSONNES CITES
AGULHON Maurice. . . . . . . . . . . . .. p. 14, 20, 25, 107, 115
ALLARDE Pierre-Gilbert, Leroi, baron d'
p. 17,56,57,58,64
AUGUSTE (l'empereur) ......................... p.15
AU LARD Franois-Alphonse .............. p. 69, 82, 93
BAILLY Jean-Sylvain
p. 29, 34, 65, 66, 68, 70, 72, 80, 112, 138
BARRE de VIEUZAC Bertrand ............. p. 90, 127
BARTHE Roland ............................... p.15
BAUDEAU Abb Nicolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 121
BAUDELOCQUE Jean-Louis ................... p. 139
BENNET Jean ........................... p. 14,15,16
BERNARD Pierre ............................. p. 123
BERTHOLLET Claude-Louis ................... p. 139
BICHAT Marie Franois Xavier .................. p.139
BLANC Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 36, 81
BLOCH Camille ................. p. 27, 28, 86, 122, 124
BOILEAU Etienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 19
BO ISLANDRY Franois-Louis Legrand de . . . . .. p. 47, 48
BOUCHARY Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 130, 135
BOURDIN Isabelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 104
BOUVIER-AJAMMaurice .................... p. 57, 82
BRETONNEAU Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 139
BRISSOT Jacques Pierre. .. . . . . . . . . . . . . . .. p. 28, 43, 136
BROUSSAIS Franois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 139
BUCHEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 81
BUZOT ...................................... p. 134
CABANIS Pierre Jean Georges .................. p. 139
CAMBON Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 137
CAMUS Armand-Gaston ........................ p. 94
CASTRIES marquis de .......................... p.23
CESAR Jules ................................... p.15
CHAPTALJeanAntoine ....................... p.139
CHAROST Armand-Joseph de Bthune, duc de .... p.113
CHASSET Charles-Antoine . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 46
161
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
CHASSIN Ch.-L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p.44
CHATEAUBRIAND comte de .................... p.83
CHAUVET PauL ......................... p. 19,25,53
CHOPART Jean-Nol .......................... p.l07
CLAVIRE Etienne .................. p. 28,43, 136,137
CLERMONT -TONNERRE Stanislas-Marie,
comte de ..................................... p.48
COLBERT Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. p. 18, 135
CONDORCET Jean Antoine Nicolas de Caritat,
marquis de ..... p. 28, 43, 64, 91, 125, 129, 130, 131, 134
CORNAERT Emile ................ p. 14, 17, 18,24, 102
CORVISART Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 139
CUSTINE Adam-Philippe, comte de . . . . . . . . . . . . . .. p. 47
DANTON Georges Jacques ....................... p.54
DELECLOY Jean-Baptiste ...................... p.128
DESMOULINS Camille ................... p. 54, 82, 88
DIDEROT Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 24
DUFOURNY DE VILLIERS M. .................. p. 34
DUMOURIEZ Charles Franois du Prier, dit. . . . .. p. 125
DUPLA y Maurice .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 94
DUPONT de NEMOURS Pierre-Samuel . p. 30, 55, 91, 129
DUPUYTREN Guillaume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 139
DUVILLARD de DURAND Emmanuel Etienne. . .. p. 130
DREUX-BRZ Henri Evrard, marquis de. . . . . . . .. p. 66
DREYFUS Ferdinand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 128
FAVRE(l'abb) ................................ p.34
FORREST Alan ............................... p. 140
FOUCROY Antoine-Franois de ................. p. 139
FRANOIS 1
er
. p.20
FRANKLIN Benjamin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 50
GARRAN de COULON Jean Philippe ............ p. 122
BIAUZAT Jean Etienne Gaultier de . . . . . . . . . . . . . . .. p. 87
GAXOTTE Pierre ............................... p.71
GEREMEK Bronislav ............................ p. 14
GODECHOT Jacques. . . . . . . . . . . . . . .. p. 56, 68, 120, 126
GOUVION Jean-Baptiste ........................ p. 72
HALL Jean-Nol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 139
HARDY Sbastien ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 42, 49
162
INDEX
HATZFELD Henri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 150
JAFF Grce Mo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 64, 75
JAURS Jean 00 p. 43, 45, 57, 75, 88, 89, 109, 123, 124, 131
JEFFERSON Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p.47
LACROIX Sigismond 000000000000000000000000 po71, 100
LAENNEC Ren Th. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 139
LAFARGE Joachim 000 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po 133, 134
LAFAYETTE Marie Joseph marquis de 00000000 p. 72, 129
LAMBERT Jean-Franois 000000000000000000000000 p.34
LAPLACE Pierre Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 129, 130, 134
LAROCHEFOUCAULD Franois-Alexandre,
duc de Liancourt
p. 29, 64, 66, 80, 86, 87, 103, 121, 129, 133, 138
LAROCQUE Andr Jean de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po 130
LAURENT Emile 000000000000000000000000000000 p.108
LAUSSAT Pierre Clment de . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po 134
LAVISSE Ernest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 85
LAVOISIER Antoine-Laurent de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 130
LEBAS 0000000000000000000000000000000000000000 p.94
LE CHAPELIER Isaac-Ren-Guy p. 46, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 87, 88, 89, 90, 100, 101, 102, 103, 122, 146, 147, 148
LECLERC Jean-Baptiste 000000000000000000.00000 p.l0l
LEFEBVRE Georges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 59
LENOIR (Lt gnral de police) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 33
LEONARD Jacques 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 139
LE PLAY Frdric 00000000000000000000000000000 p.l08
LOUIS XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 18
LOUIS XV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 121
LOUIS XVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 30
MALESHERBES Guillaume
Chrtien de Lamoignon de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po 83
MARAT Jean-Paulo 0 000000000000 po 47, 54, 57, 75, 89, 93
MARSILLAC J. (Dr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000000000000000 p.132
MARTIN Germain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p. 83
MATHIEZ Albert. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000 p. 70, 71
MAZARIN Jules 00000000000000000000000000000000 p.28
MAZE Hippolyte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po 149
MERCIER Louis-Sbastien 0000000000000000000 p. 42, 112
163
AU CONFLIT DE DEUX LIBERTS
MERLIN Philippe Antoine dit Merlin de Douai 0 po 127, 128
MICHELET Jules 00000000000000000000000 po 81,94, 127
MIRABEAU Honor-Gabriel Riquetti,
comte de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. po 28, 66, 82, 134, 136
MOMORO Antoine Franois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po 25
MONTESQUIEU Charles de Secondat,
baron de la Brde . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po 29, 121
MONTLOSIER Franois Dominique de Reynaud,
comte de 00.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000.00.00000 po 82
NADAUD Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po 15
NECKER Jacques 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. po 29, 32
NERON 00 000000.0.000.000 000000 po15
OLLIVIER Emile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. po 147
ORLEANS Louis Philippe, duc d' 0 0 0 0 0 po 34, 44
P ASTORET Claude Emmanuel Joseph Pierre de 0 0 0 O. po 80
PETION de VILLENEUVE Jrome ........... 0 p. 47, 80
PIARRON DE CHAMOUSSET Claude Humbert 0 p. 26, 27
PINEL Philippe ................................ p.139
PISON du GALLAND Alexis-Francis. . . . . . . . . . . . .. p.48
PRICE Richard ........................ 0 p. 136
PROUDHON Pierre-Joseph ..................... p. 149
PRUDHOMME Louis Marie ..... . . . . . . . . .. p. 68, 69, 88
QUESNAY.o .... o ............ 0 0 p.91
RECAMIER Joseph-Claude-Anthelme ............ p. 139
RESTIF de la BRETONNE Nicolas Anne
Edme Rtif dit ....... 0 0 p. 37
RVEILLON Jean-Baptiste ............. p. 33, 43, 44, 45
ROBERT Franois ................. 0 0 p. 69, 70, 71
ROBESPIERRE Maximilien Marie Isidore de
p. 47, 80, 88, 110, 113, 125, 127, 134, 137
ROGER-DUCOS Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 113
ROSANVALLON Pierre 0 0 p. 148
ROUSSEAU Jean-Jacques. . . . . . . . . .. p. 29, 46, 88, 90, 91
ROUX Vital. ................................ p. 53, 81
RUD Georges ................ 0 0 p. 42, 45, 70
SAINT-JUST Louis ................. 0' p.94
SAINT-PAUL ................ o ................. p.17
SAINT VINCENT de PAUL .. 0 p. 21
164
INDEX
SE Henri ..................................... p. 83
SERRES Michel ............................... p. 140
SEWELL William H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 14, 30
SIEYES Emmanuel-Joseph ...... p. 43, 47, 49, 64, 91,129
SINETY Andr-Louis, marquis de ................. p.47
SMITHAdam ......................... p.64,65,90,91
SOBOUL Albert ................ p. 42, 94, 114, 123, 126
TAINE Hippolyte ............................... p.81
TENON Jacques ............ p. 29, 66, 123, 138, 139, 140
THEOPHRASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 15
THIERS Antoine ............................... p. 81
TOCQUEVILLE Alexis de ....................... p. 14
TONTI Lorenzo ................................ p.28
TRAJAN Marcus Ulpius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 15
TURGOT Anne Robert Jacques .. p. 17,29,32,89,91,138
VELPEAU Alfred .............................. p.139
VOL TAIRE Franois Marie Arouet dit. . . . . . . . . . . .. p. 90
VOVELLE Michel .............................. p.51
165
Dans la mme collection
- La Mutualit, une histoire maintenant accessible,
par Michel Dreyfus.
- La Mutualit en Lorraine,
par Franoise Birck et Michel Dreyfus.
Ralisation CIEM - 40.43.30.10
dition - FNMF - 255, rue de Vaugirard 75719 Paris Cedex 15
Imprim en France
Dpt lgal : Juin 1989
ISBN: 2-906376-05-1
Vous aimerez peut-être aussi
- Femme Et Le Sacrifice, La - Anne DufourmantelleDocument302 pagesFemme Et Le Sacrifice, La - Anne Dufourmantelledmp7712100% (3)
- Attirer Les Oiseaux Au Mangeoires - Jean Paquin PDFDocument248 pagesAttirer Les Oiseaux Au Mangeoires - Jean Paquin PDFdmp7712Pas encore d'évaluation
- Audier, Serge - Le Socialisme LibéralDocument128 pagesAudier, Serge - Le Socialisme LibéralOlivier DevoetPas encore d'évaluation
- DR - Antidemarrage Citroen Et RenaultDocument6 pagesDR - Antidemarrage Citroen Et Renaultaymendab100% (1)
- Daudet Léon - Deux Idoles SanguinairesDocument107 pagesDaudet Léon - Deux Idoles SanguinairesNunussePas encore d'évaluation
- Symbol Is Me de La ClocheDocument460 pagesSymbol Is Me de La ClocheNeggystylePas encore d'évaluation
- Famines Et Émeutes À Rome Des Origines de La République À La Mort de Néron PDFDocument136 pagesFamines Et Émeutes À Rome Des Origines de La République À La Mort de Néron PDFdmp7712Pas encore d'évaluation
- Dénonciation Et Délation en Milieu Organisationnel - Techniques de Management Ou Perversion de La PDFDocument110 pagesDénonciation Et Délation en Milieu Organisationnel - Techniques de Management Ou Perversion de La PDFdmp7712Pas encore d'évaluation
- Audit Comptable, Audit InformatiqueDocument300 pagesAudit Comptable, Audit InformatiqueKamèl Key Kams'sPas encore d'évaluation
- Introduction À La Notion D'ordiDocument2 pagesIntroduction À La Notion D'ordikabi6713Pas encore d'évaluation
- LINFO1101Document10 pagesLINFO1101itsamePas encore d'évaluation
- Les Abaques Multiplaz 3500Document5 pagesLes Abaques Multiplaz 3500Nacer MezghichePas encore d'évaluation
- A ImprimerDocument14 pagesA ImprimerhsnghhPas encore d'évaluation
- Dossier Synthese HCRDocument26 pagesDossier Synthese HCRGil GuardiaPas encore d'évaluation
- Amazon FRDocument1 pageAmazon FRangelisharma455Pas encore d'évaluation
- Examen Final Seer Gecsi 09 Juin 2020 v2Document3 pagesExamen Final Seer Gecsi 09 Juin 2020 v2Youness BoufsadPas encore d'évaluation
- Ex06 - Etage D'adaptationDocument6 pagesEx06 - Etage D'adaptationAissa KalachePas encore d'évaluation
- Classif CoursDocument86 pagesClassif Courskistidi33Pas encore d'évaluation
- LM ArmDocument27 pagesLM ArmMis DoSomePas encore d'évaluation
- BNT Is Normal 2021Document25 pagesBNT Is Normal 2021YS ConsultingPas encore d'évaluation
- LE CIRCUIT IMPRIME .-ConvertiDocument3 pagesLE CIRCUIT IMPRIME .-Convertiسعيد تامرPas encore d'évaluation
- Stratégies GroupesDocument36 pagesStratégies GroupesstrideworldPas encore d'évaluation
- Controle Et Suivi Des Couts PtroliersDocument34 pagesControle Et Suivi Des Couts PtroliersMick Toty100% (7)
- Teufel ShopDocument1 pageTeufel ShopCaractère ExclusivePas encore d'évaluation
- Reglement Interieur AiehtpDocument5 pagesReglement Interieur AiehtpTaha BenPas encore d'évaluation
- Pfe Gouvernance Financière Des VillesDocument118 pagesPfe Gouvernance Financière Des VillesOumaima ElPas encore d'évaluation
- TD Estimation 2022 2023Document2 pagesTD Estimation 2022 2023Mariam GueyePas encore d'évaluation
- Application Mobile Netbeans PDFDocument18 pagesApplication Mobile Netbeans PDFABDELKADER GUENAIZIPas encore d'évaluation
- PPA Solutions DownloadDocument16 pagesPPA Solutions DownloadSam BroisePas encore d'évaluation
- Courroies Dentées ATN 1207Document8 pagesCourroies Dentées ATN 1207Claudine Elisseev100% (2)
- Planification D'urgenceDocument20 pagesPlanification D'urgenceABADI NAHIDPas encore d'évaluation
- Inf1600 Devoir 01Document3 pagesInf1600 Devoir 01Ahmed GafsiPas encore d'évaluation
- Descriprion Procédé de PlâtreDocument3 pagesDescriprion Procédé de PlâtreErick basiluaPas encore d'évaluation
- Accessibilite Physique Animee - CanDocument7 pagesAccessibilite Physique Animee - CanZbedi ChaimaPas encore d'évaluation
- 796Document8 pages796Simo SimoPas encore d'évaluation
- Boulonnerie Visserie CoursDocument10 pagesBoulonnerie Visserie CoursRizouga AbdallahPas encore d'évaluation
- Msyn PDFDocument34 pagesMsyn PDFbensumbbPas encore d'évaluation
- VERDITDocument27 pagesVERDITAya SePas encore d'évaluation