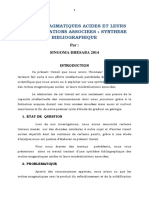Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Imbert - Anclaje Residential PDF
Imbert - Anclaje Residential PDF
Transféré par
VladoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Imbert - Anclaje Residential PDF
Imbert - Anclaje Residential PDF
Transféré par
VladoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cet article est disponible en ligne ladresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=ESP&ID_NUMPUBLIE=ESP_119&ID_ARTICLE=ESP_119_0159
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes :
une approche comparative
par Christophe IMBERT
| rs | Espaces et socits
2004/4 - 119
ISSN 0014-0481 | ISBN 2-7492-0324-4 | pages 159 176
Pour citer cet article :
Imbert C., Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes : une approche comparative,
Espaces et socits 2004/4, 119, p. 159-176.
Distribution lectronique Cairn pour rs.
rs. Tous droits rservs pour tous pays.
La reproduction ou reprsentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorise que dans les limites des
conditions gnrales d'utilisation du site ou, le cas chant, des conditions gnrales de la licence souscrite par votre
tablissement. Toute autre reproduction ou reprsentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manire
que ce soit, est interdite sauf accord pralable et crit de l'diteur, en dehors des cas prvus par la lgislation en vigueur
en France. Il est prcis que son stockage dans une base de donnes est galement interdit.
Les villes nouvelles franciliennes ont t conues pour contrer un proces-
sus dtalement urbain de la rgion parisienne. Il sagissait de crer des
centres urbains nouveaux (Estbe et al., 2002). Mais que peut-on faire contre
un mouvement spontan et gnralis lensemble des mtropoles industria-
lises sinon laccompagner pour en limiter ses effets les plus pervers ? cette
tche sest jointe une autre, non moins ardue, qui consistait garantir aux
futurs habitants des conditions attractives de logement, de desserte vers le
centre de lagglomration et daccs des quipements de toutes sortes (sco-
laires, culturels, commerciaux et de loisirs de plein air). Car en grands
commis de ltat gaulliste, Paul Delouvrier et ses collaborateurs ne voulaient
pas seulement urbaniser la pri-urbanisation. Ils avaient galement pour
souci le bien-tre collectif dans la coexistence harmonieuse de toutes les
couches sociales, tirant les leons dun premier sicle durbanisation anar-
chique de la banlieue parisienne, dont les deux figures extrmes sont la
bicoque et le grand ensemble (Fourcaut, 2000).
Ancrage et proximits familiales
dans les villes nouvelles
franciliennes :
une approche comparative
Christophe Imbert
Christophe Imbert, INED/UMR 8504 Gographie-cits, doctorant Universit Paris I.
christophe.imbert@ined.fr
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 159
Aujourdhui, la russite de lopration en ces domaines primordiaux est
suspendue ladquation de ces espaces urbains au qualificatif de bassin de
vie , que la DATAR
1
dfinit comme un territoire structur par des quipe-
ments et des services, supports des activits quotidiennes. Dans le cas des
villes nouvelles, on se propose dtendre la temporalit de la notion celle
des trajectoires rsidentielles. Ces espaces urbains, conus avec un parc de
logements mixte, ont en effet pu accueillir des personnes ayant effectu en
leur sein plusieurs tapes rsidentielles. Aussi, si les villes nouvelles sont le
cur de bassins de vie, elles ne le sont pas seulement en tant que ples dem-
plois, mais aussi en tant que bassins de vie au sein desquels les parcours rsi-
dentiels prennent place. Ce second aspect, au cur de notre questionnement,
est apprhend partir du concept dancrage.
Lancrage, que Jean Remy (1996) dfinit comme lattachement un lieu
[] le point de rfrence partir duquel des explorations ultrieures se font ,
peut se dcliner sous plusieurs modalits et plusieurs chelles sociales, spa-
tiales et temporelles. La monographie de quartier permet dapprofondir la
question de lattachement collectif un lieu dans ses dimensions les plus sym-
boliques, et, bien souvent, de dcrire jusque dans ses plus fins dtails les l-
ments qui font quau quotidien, les personnes sancrent dans un
environnement (Authier, 2001 ; Benot-Guilbot, 1986). lautre extrmit du
spectre, les enqutes biographiques qui ont pour principe de recueillir les
vnements en tout domaine ponctuant la vie dindividus prsentent lavan-
tage de mieux saisir la relation micro-macro qui caractrise linsertion des per-
sonnes dans une mtropole, pour peu que soient identifis de manire prcise
les processus en cours dans la mtropole tudie
2
. Notre objectif ici est de
rechercher, dans les parcours individuels, des rponses une question qui
simpose au sujet des villes nouvelles : forment-elles des bassins de vie ?
Le traitement dune telle question sappuie sur une dmarche compara-
tive qui aborde lancrage rsidentiel des personnes sous trois aspects :
les circonstances de larrive en ville nouvelle. Sagissant dune telle offre
de logements, lhypothse dune installation dans une ville nouvelle loc-
casion dune accession la proprit se pose. Cependant, les villes nouvelles
se distinguent-elles au sein de la grande couronne qui, dans son ensemble,
constitue un eldorado de laccession la proprit (Berger et al., 2000) ?
Dautres vnements, professionnels ou matrimoniaux, lis la biographie
des individus, ont-ils accompagn de manire spcifique une tape rsiden-
tielle en ville nouvelle ?
lexistence de formes particulires dancrage rsidentiel dans les villes nou-
velles. Lobjectif est dvaluer la capacit des villes nouvelles fixer des
Espaces et socits 119
160
1. Dlgation lamnagement du territoire et laction rgionale.
2. Les travaux de F. Dureau et V. Dupont (1994), qui ont travaill respectivement sur Quito et
Jetpur, fournissent une bonne illustration de la porte heuristique de ce type dtudes.
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 160
populations en mettant au jour, autour des villes nouvelles, lexistence de
bassins de vie enveloppant les trajectoires rsidentielles ;
le critre relatif aux proximits familiales dans un contexte urbain est selon
nous essentiel. Depuis les travaux de Willmott et Young (1962), lexistence
ainsi que le rle (accs au march du logement et au march de lemploi, ser-
vices mutuellement rendus, et plus gnralement, convivialit et dpendance
affective) de ces liens familiaux de proximit nont jamais t dmentis
(Ortalda, 2001), en dpit de lmergence de la thmatique des liens faibles
3
.
Ces proximits familiales revtent de plus un intrt spcifique dans le cas des
villes nouvelles franciliennes. Dune part, les premiers habitants des villes
nouvelles ont t souvent dcrits sous la figure du pionnier (Smadja, 1989),
donc de personnes qui investissent un lieu aprs en avoir quitt un autre. Pour
autant, retrouve-t-on plus frquemment parmi les rsidants des villes nou-
velles, des personnes dont la famille dorigine (parents et beaux-parents, fra-
trie) rside une plus grande distance ? Dautre part, ne peut-on pas voir dans
ladquation entre offre demploi (informatique, industrie de pointe) et offre
de formation, et dans linflexion rcente dans la construction de logements
(habitat collectif de moindre surface) des lments fixateurs pour les enfants
des habitants des villes nouvelles aprs leur dcohabitation ?
Le traitement de ces questions repose sur lanalyse des donnes de len-
qute Biographies et entourage , ralise lINED en 2000-2001 par
E. Lelivre, C. Bonvalet et G. Vivier
4
(encart 1 et carte 1).
LES VILLES NOUVELLES : QUELLES PLACES DANS LES PARCOURS
RSIDENTIELS ?
La grande majorit des habitants de la rgion de Paris dsirerait une
maison individuelle avec jardin, mais, si possible, prs du cur de la ville. Ce
si possible nest pas possible, et le choix en ces termes sera toujours rserv
un nombre infime de gens riches [] La cration des villes nouvelles doit
redonner un sens possible, celui-l au choix : les centres assez denses doi-
vent tre habits pour lessentiel en appartements et les quartiers composs
de maisons individuelles pourront sordonner autour dun centre qui ne sera
pas trop loin (SDAURP, 1965, p. 83).
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes
161
3. On souligne bon droit limportance de nos liens faibles en ces domaines (Granovetter,
1973). Nanmoins, ceux-ci sappuient bien souvent sur des relations amicales ou familiales.
4. Cette enqute a reu le soutien financier de la CNAF (Caisse nationale dallocations fami-
liales), de la CNAV (Caisse nationale dassurance vieillesse), de la DPM (Direction de la popula-
tion et des migrations), de la DREES (Direction de la recherche, des tudes, de lvaluation et
des statistiques), de la DREIF (Direction rgionale de lquipement dle-de-France), de lIAURIF
(Institut damnagement et durbanisme de la rgion le-de-France), de lODEP Mairie de Paris
(Observatoire du dveloppement conomique parisien), de la RATP (Rgie autonome des trans-
ports parisiens) et du ministre de la Recherche, Action concerte incitative Ville.
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 161
Espaces et socits 119
162
BIOGRAPHIES ET ENTOURAGE
Lenqute Biographies et entourage a pour objectif de retracer les trajectoires rsiden-
tielles, familiales et professionnelles de 2 830 Franciliens des gnrations 1930-1950. Sont rele-
vs et dats au sein dun questionnaire semi-directif les vnements survenus au cours de la vie
dune personne : changements de rsidence, de profession, et vnements familiaux et matrimo-
niaux. Cette enqute biographique, outre le fait quelle permet de mettre en relation larrive de
plusieurs vnements (un changement de rsidence avec un changement de profession, par
exemple), a pour caractristique de rinsrer les biographies individuelles dans lvolution dun
entourage familial (volution de la corsidence au cours du temps, identification des figures fami-
liales ayant jou un rle important et localisation des personnes de lentourage). Biographies et
entourage prsente de surcrot un intrt spcifique pour lhistoire des villes nouvelles franci-
liennes car elle concerne les gnrations cibles du projet, ges de 20 40 ans en 1970.
CONSTITUTION DE LCHANTILLON DES COMMUNES
Dun point de vue mthodologique, il sagit de spcifier lancrage dans les villes nouvelles
au regard dautres espaces pri-urbains. La situation des villes nouvelles est compare celle des
communes de leur voisinage, dune part, et celles des communes du reste de la grande cou-
ronne, dautre part. Au sein de cette dernire catgorie, ne seront conserves que les communes
situes une distance comparable de celle qui spare Paris des villes nouvelles, au moment de
traiter les proximits familiales. La slection des communes a d rpondre la contrainte de
lchantillonnage des communes de lenqute. Les effectifs des enquts rsidant dans chaque
zone au moment de lenqute sont indiqus entre parenthses.
Communes en ville nouvelle (335)
Cergy-Pontoise (84) vry-Ville-Nouvelle (60)Marne-la-Valle (130) Saint-Quentin/Yvelines (31)
Cergy Courcouronnes Bussy-St-Georges lancourt
Jouy-le-Moutier vry Champs-sur-Marne Guyancourt
Pontoise Gouvernes Snart (30)
St-Ouen-lAumne Lagny-sur-Marne Combs-la-Ville
Vaural Noisiel Savigny-le-Temple
St-Thibault-des-Vignes
Torcy
Communes du voisinage des villes nouvelles (431)
Cergy-Pontoise (100) vry-Ville-Nouvelle Marne-la-Valle (124) Saint-Quentin/
et Snart (99) Yvelines (108)
Auvers-sur-Oise Grigny Chelles Gif-sur-Yvette
Chars Melun Couilly-Pont-aux-Dames Maurepas
Maurecourt Mennecy Nanteuil-les-Meaux Versailles
Mriel Montereau-sur-le-Jard Neuilly-Plaisance
Mry-sur-Oise Montgeron Neuilly-sur-Marne
Meulan Ste Genevive des Bois La-Queue-en-Brie
Santeuil Savigny-sur-Orge Villenoy
Vaux-sur-Seine Villecresnes
Communes du reste de la grande couronne (516)
Toutes les autres communes de lenqute situes au sein des dpartements priphriques de lIle-
de-France ont t prises en compte. Ces communes sont gnralement situes dans les franges de
lagglomration plus de 40 km du centre de la capitale. Lors du calcul des distances aux per-
sonnes de lentourage, ne seront intgres que les communes situes une distance de Paris com-
parable celle qui spare les villes nouvelles de la capitale (20 40 km). On procde ainsi de
sorte quun dplacement de 5 km entre la rsidence de lenqute et celle dun membre de sa
famille ait la mme signification du point de vue des densits urbaines traverser. Seront alors
conserves dans lchantillon : Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Bassot, Roissy-en-France, Le
Thillay, Tremblay-en-France au nord (73) ; Orgeval, Le Pecq, Poissy louest (91) ; Breuillet,
Bruyres-le-Chtel, gly, Saint-Chron, au sud (62).
Encart 1 Lenqute Biographies et entourage
et lchantillon de lanalyse comparative
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 162
Ce court passage du Schma directeur ne laisse pas de doute sur les
intentions qui ont prsid la construction des villes nouvelles : rendre pos-
sibles les aspirations contradictoires dune majorit de Franciliens en crant
de lhabitat proche de centres eux-mmes crs de toutes pices.
Linstallation dans une ville nouvelle a donc pu signifier pour beaucoup une
tape essentielle dans lamlioration des conditions de logement. Dans quelle
mesure, cela a-t-il t le cas ? Les villes nouvelles se distinguent-elles alors
du reste de la grande couronne ?
La mobilit vers les villes nouvelles sest faite prfrentiellement aprs
lge de 30 ans, contrairement aux autres parties de la rgion. Seulement le
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes
163
Enqute Biographies et entourage , INED, 2000-2001
Carte 1 Les communes enqutes de la grande couronne
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 163
quart des tapes rsidentielles effectues dans une ville nouvelle a dbut
avant cet ge. Que ce soit dans le centre de lagglomration (Paris et petite
couronne), ou dans les communes voisines des villes nouvelles, ou dans le
reste de la grande couronne, plus de la moiti des tapes rsidentielles effec-
tues par les personnes de ces gnrations lont t alors quelles taient de
jeunes adultes (de 18 30 ans).
Dans ce qui suit, les tapes qui prennent place avant lge de 30 ans ne
sont pas prises en compte, ce qui vite de fait dintgrer celles dbutant avant
la mise en uvre des villes nouvelles.
Accder la proprit sans pour autant avoir un jardin cultiver
Source : enqute Biographies et entourage , INED, 2000-2001.
Tableau 1 Caractrisation des tapes rsidentielles effectues
dans la grande couronne selon leur localisation,
lge de leur commencement
et les caractristiques des logements (frquences en %)
Espaces et socits 119
164
Localisation de ltape rsidentielle
volution du villes nouvelles voisinage des villes nouvelles reste de la grande couronne
statut
doccupation/
tape prcdente
30-39 40-49 50 ans 30-39 40-49 50 ans 30-39 40-49 50 ans
ans ans et plus ans ans et plus ans ans et plus
locat.-locat. 32 32 51 41 32 25 42 37 35
propri.-locat. 6 9 9 7 6 10 8 10 8
locat.-propri. 46 40 19 35 38 27 34 33 34
propri.-propri. 16 19 21 17 24 37 16 20 23
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
volution villes nouvelles voisinage des villes nouvelles reste de la grande couronne
du type de
logement/
tape prcdente
30-39 40-49 50 ans 30-39 40-49 50 ans 30-39 40-49 50 ans
ans ans et plus ans ans et plus ans ans et plus
coll.-coll. 41 40 56 39 30 32 43 33 32
indiv.-coll. 8 11 16 11 12 21 11 12 10
coll.-indiv. 39 30 12 37 39 22 30 29 29
indiv.-indiv. 12 20 16 13 19 25 16 26 29
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 164
Selon lge, les tapes effectues en ville nouvelle prennent des formes
diffrentes. Avant 40 ans, 46 % des tapes rsidentielles se caractrisent par
le passage du statut de locataire celui de propritaire, quand cette propor-
tion ne dpasse pas les 35 % dans les communes voisines des villes nouvelles
ou dans celles plus loignes de la grande couronne (Tableau 1). Les enqu-
ts, entre 30 et 40 ans, sont arrivs en nombre dans les villes nouvelles, sou-
vent pour accder la proprit, dans une moindre mesure, pour accder
lhabitat individuel. Dans le reste de la grande couronne, le phnomne a t
plus limit tmoignant dune phase moins avance de la pri-urbanisation,
notamment dans les franges de lagglomration et laccession la proprit,
plus systmatiquement synonyme dacquisition dun pavillon.
Les tapes en accession la proprit sont proportionnellement moins
nombreuses en ville nouvelle entre 40 et 49 ans, quon les compare aux
tapes effectues entre 30 et 39 ans ou bien celles ayant dbut dans une
autre partie de la grande couronne entre 40 et 49 ans. Par ailleurs, cette dcen-
nie se caractrise partout dans la grande couronne par une augmentation des
tapes effectues en proprit par des personnes prcdemment propritaires.
On est plus souvent propritaire 40 ans qu 30 ans. Il convient galement
de souligner la baisse importante, dans le voisinage des villes nouvelles
comme dans le reste de la grande couronne, des tapes rsidentielles en
appartement, alors quune stabilisation est releve en ville nouvelle.
Ce phnomne prend une ampleur bien plus marque pour les tapes com-
mences aprs 50 ans : 72 % des tapes rsidentielles effectues en ville nou-
velle se sont faites dans de lhabitat collectif, contre respectivement 53 % et
42 % dans le voisinage des villes nouvelles et le reste de la grande couronne.
Cette inflexion, qui distingue les villes nouvelles, met en vidence ce quon
pourrait qualifier deffet de centralit : la prsence de centres lotis en apparte-
ments, dont la construction a t plus longue et plus rcente que celle des quar-
tiers pavillonnaires. Les quinquagnaires que ces centres ont hbergs
appartiennent souvent aux classes populaires, employs et ouvriers. Ces habi-
tants sont majoritairement issus des villes nouvelles ou de leur grande couronne
environnante, et sont frquemment logs dans le parc social ; une tendance bien
plus marque vry ou Cergy que dans les autres villes nouvelles, soit parce
que les compositions socioprofessionnelles diffrent (Saint-Quentin et Marne-
la-Valle), soit parce que le parc de logements est principalement pavillonnaire
(Snart). En outre, ces rsultats relvent de processus locaux (constructions
rcentes donnant la priorit lhabitat collectif dans les villes nouvelles) et
rgionaux (poursuite de la pri-urbanisation vers la priphrie de la rgion,
dautant plus le fait douvriers et demploys que lon sloigne de Paris
5
).
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes
165
5. Les ouvriers et employs accdent peu souvent aux pavillons en villes nouvelles aprs
50 ans, au contraire de ceux qui se dirigent vers la grande couronne plus loigne (prs du tiers
contre le dixime en villes nouvelles).
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 165
En somme, les villes nouvelles cultivent, au regard des tapes rsiden-
tielles explores, la double caractristique durbanit de la petite couronne et
de pri-urbanit de la grande couronne, conformment ce qui tait annonc
dans le projet. En revanche, un autre trait distinctif de la centralit
6
urbaine
ntait pas inscrit sur le papier.
La centralit des villes nouvelles
comme recours aprs une sparation conjugale
Bien des auteurs ont soulign limpact quont eu les transformations
rcentes intervenues dans les structures familiales sur la demande de loge-
ments (Bonvalet, 1989 ; Festy, 1990). Parce quil tait difficilement prvi-
sible et parce que la famille nuclaire tait et le reste dans une certaine
mesure au cur des conceptions des politiques de tous horizons, les pro-
moteurs des villes nouvelles nont pas anticip le mouvement. Cependant,
ldification des centres des villes nouvelles (notamment vry et Cergy)
a eu pour consquence de proposer, dans le parc locatif social, des logements
de grande taille particulirement adapts aux personnes peu mobiles et dis-
posant de faibles revenus, linstar de beaucoup de femmes avec enfants
venant de se sparer.
Les gnrations tudies sont partie prenante, et mme pionnires, de ces
transformations familiales, et par consquent il est intressant de vrifier si
les Franciliennes sortant dune sparation ont eu recours aux villes nouvelles
pour se loger. Si cela se confirme, la localisation de ltape prcdente per-
mettra alors de mieux caractriser le rle des villes nouvelles en termes de
bassin de vie.
Les donnes permettent didentifier aisment ce phnomne : pour les
femmes, plus du sixime des emmnagements ayant eu lieu dans une ville
nouvelle entre 40 et 49 ans est conscutif une sparation, accompagne ou
non dun divorce. Cette proportion, leve en soi, est dautant plus remar-
quable quelle est deux fois plus importante en ville nouvelle que dans les
autres parties de la grande couronne
7
. Le rapport est le mme pour les tapes
commences entre 30 et 39 ans, mais les sparations conjugales surviennent
alors moins frquemment.
Les villes nouvelles ont principalement accueilli des femmes divorces
provenant de lensemble de la grande couronne ; des villes nouvelles elles-
mmes tout dabord : lorsquune sparation intervient au moment o le
Espaces et socits 119
166
6. Lanalyse du gographe se porte sur la rpartition des logements et les effets de centralit
quelle induit, quand celle de lconomiste part de loffre de logements.
7. Les villes nouvelles ont accueilli 11 % du total des tapes rsidentielles fminines qui ont
dbut entre 40 et 59 ans dans lensemble de lle-de-France (en incluant donc Paris et la petite
couronne) et, parmi celles-ci, 19,2 % de celles qui succdent une sparation.
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 166
couple rside dans une ville nouvelle, lex-conjointe reste dans cette ville
nouvelle sept fois sur dix. Lorsque ce nest pas le cas, elle se dirige vers Paris,
de prfrence au reste de lagglomration. En revanche, les femmes se spa-
rant alors quelles rsident dans la grande couronne (villes nouvelles exclues)
se dirigent plus souvent vers une ville nouvelle quen direction de la capitale
ou bien de sa petite couronne. Dans le voisinage des villes nouvelles, les
femmes ont eu plus souvent recours aux villes nouvelles pour se loger la
suite dune sparation, quaux tissus denses de la petite couronne ou aux
vieux centres de la grande couronne (Melun, Corbeil-Essonnes, Versailles,
Argenteuil, Meaux). De mme, lorsque les couples se sont dsunis alors
quils rsidaient dans le reste de la grande couronne, les femmes ont plus sou-
vent rejoint les communes des villes nouvelles que celles de leur voisinage,
pourtant plus proches.
Cela illustre encore cette centralit secondaire qui caractrise les
villes nouvelles franciliennes. En effet, les situations des femmes en cours de
sparation qui vont rsider dans une ville nouvelle sont trs comparables :
celles-ci ont la garde de leurs enfants, travaillent non loin de leur nouvelle
rsidence qui est, de rares exceptions, un appartement en location. Les
villes nouvelles, en remplissant cette fonction de centralit de recours, ont
donc accompagn les volutions sociodmographiques dont la plus impor-
tante quaient connue ces dernires dcennies : la monte des divorces. Il
convient de le souligner car il sagit :
du seul vnement biographique accompagnant une mobilit rsidentielle
pour lequel les villes nouvelles se distinguent du reste de la grande couronne
francilienne (les autres vnements familiaux : mise en couple, naissance
dune enfant, dcs familial ou bien changement demploi, nont, ni plus ni
moins frquemment quailleurs dans la grande couronne, prcd une tape
rsidentielle dans une ville nouvelle
8
) ;
dun phnomne qui nest mis en vidence que pour les femmes, les
hommes ne se dirigeant pas, aprs un divorce, plus frquemment vers une
ville nouvelle que vers une autre commune de la grande couronne.
POUVOIR DE RTENTION ET POUVOIR DE POLARISATION
Aprs avoir restitu de manire factuelle les principales significations
dune tape rsidentielle en ville nouvelle, la rflexion va se porter sur lan-
crage des personnes travers ltude des trajectoires.
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes
167
8. Martine Berger (1992), en montrant un allongement important des navettes domicile-travail,
insiste bien sur ce point : le logement, notamment pour laccession la proprit ou lhabi-
tat pavillonnaire, influence bien plus les choix rsidentiels des Franciliens que les motifs pro-
fessionnels.
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 167
Larrive massive de population en direction des villes nouvelles sest
faite en peu de temps en comparaison de lensemble de la grande couronne,
dont le peuplement a t globalement plus progressif. Seulement le quart des
enquts rsidant dans une ville nouvelle au moment de lenqute y rsidait
lge de 30 ans. cet ge, plus de 4 rsidents sur 10 dune commune du
voisinage des villes nouvelles habitaient dj dans ce voisinage. Cette pro-
portion slve 55 % pour les personnes domicilies dans le reste de la
grande couronne. La diffrence est moindre 45 ans o 80 % de ceux qui
rsident dans les villes nouvelles y sont alors prsents. Cest peine 5 % de
moins que pour les autres catgories de localisation de la grande couronne.
Outre un effet dge quil faut considrer
9
, ces chiffres montrent que 55 %
des enquts de ces gnrations qui vivent dans une ville nouvelle y sont arri-
vs entre 30 et 45 ans. Aussi, comme il vient dtre signal, si les enquts
venant vivre dans les villes nouvelles ne sy sont pas rendus plus souvent
quailleurs immdiatement la suite dun vnement familial (naissance,
etc.) ils lont fait, dans une grande majorit, un moment o leur famille tait
constitue (couples avec des enfants ou familles monoparentales), mais ga-
lement un moment o se produit gnralement laccs la proprit. Ce
rsultat illustre donc limportance de loffre de logements et dquipements
dans le choix de rsider dans une ville nouvelle. Lautre vidence qui se
trouve ici confirme est celle dun peuplement relativement rapide des villes
nouvelles, qui en fait un espace pionnier signalons titre dillustration que
plus de la moiti de la croissance dmographique de lle-de-France entre les
recensements de 1975 et 1999 a t absorbe par les villes nouvelles.
Cest l une caractristique propre aux villes nouvelles ( cette chelle,
et pour lle-de-France tout au moins) que davoir accueilli une population
homogne du point de vue dmographique. Elles lont accueillie de surcrot
des priodes de la vie o il sagissait de sinstaller
10
en accdant la pro-
prit aprs la naissance des premiers enfants ou de se r-installer aprs
une sparation conjugale. Ces circonstances participent-elles faire des villes
nouvelles des lieux dancrage ?
La rponse cette question ne peut reposer sur la seule analyse des
dures de prsence des personnes dans les villes nouvelles. Cet indice pr-
sente le biais de ne pas tenir compte de la jeunesse du bti dans celles-ci. On
se contentera de noter que les habitants de ces gnrations ont en moyenne
une prsence moins ancienne dans leur dpartement et leur commune de rsi-
Espaces et socits 119
168
9. Les enquts des villes nouvelles tant en moyenne plus jeunes que ceux des autres parties
de la grande couronne, ils ont donc plus de chances de demeurer au moment de lenqute l o
ils rsidaient lorsquils avaient 45 ans.
10. P. Meyfroidt (2002) parle dinstallation comme cadre de la recherche sur les consquences
pour un individu dune mobilit rsidentielle. Lauteur place en tte des processus constitutifs
de linstallation la constitution dun rseau de sociabilit et porte une attention particulire aux
trajectoires individuelles ainsi quaux proximits familiales.
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 168
dence que les autres habitants de la grande couronne. Est-ce dire quils sont
moins ancrs que ne le sont les autres rsidants de la grande couronne ? Tenir
compte de lanciennet de limplantation dans un lieu comme facteur dan-
crage na de sens que si celle-ci est contextualise. Cette remarque est dau-
tant plus valable pour les villes nouvelles. En effet, rsider depuis 25 ans dans
une ville nouvelle na pas la mme signification que rsider depuis la mme
priode Fontainebleau, Meaux ou Versailles, sans voquer les franges
rurales de la rgion. Dans un cas, on peut se considrer comme un ancien, un
pionnier, alors que dans lautre, il a fallu sintgrer une population locale
porteuse de la mmoire dun territoire et avec qui, surtout, on peut entrer en
conflit ou bien rechercher le voisinage. Lhypothse soutenue ici est que les
personnes qui sont passes dans les villes nouvelles ont pu dautant mieux sy
ancrer quelles nont pas eu faire face une population locale, ce qui a pu
faciliter lappropriation de leur environnement. Cela tant, lancrage ne peut
sinterprter en termes uniquement cologiques , on doit galement faire
entrer dans lanalyse des lments plus matrialistes , car on ne choisit pas
toujours lenvironnement dans lequel on vit. Et vu sous cet angle, lancrage
des personnes a pu tre favoris dans les villes nouvelles par les conditions
de logement et les amnits que celles-ci offrent leur population.
Ds lors, comment mettre en vidence, dun point de vue factuel, des
formes dancrage ? Cela peut tre fait dune manire simple en apprciant le
turn-over existant dans chaque espace. Le calcul de la proportion de per-
sonnes qui, rsidant dans les villes nouvelles lge de 30 ans, y rsident
encore au moment de lenqute, permet destimer le pouvoir de rtention des
villes nouvelles. De mme, en recherchant o se sont diriges les personnes
qui ont quitt les villes nouvelles, il est possible de tester lventualit de la
constitution de bassins de vie autour de ces mmes villes.
Le tableau 2 est ces gards trs instructif : 76 % des personnes qui rsi-
daient 30 ans en ville nouvelle y rsident encore au moment de lenqute.
Cest bien plus que pour le voisinage des villes nouvelles ou le reste de la
grande couronne. Une diffrence qui persiste, mais sattnue 45 ans. Ainsi,
pour les gnrations concernes demeurant encore en le-de-France en 2000-
2001, une tape rsidentielle en ville nouvelle a souvent signifi une instal-
lation durable. Cest moins le cas dans les autres parties de la grande
couronne, dont une part importante de la population a soit t peu mobile
durant toute sa vie et tait pour ainsi dire installe depuis la naissance ,
soit a effectu dans ces lieux une tape rsidentielle qui ne devait pas durer.
Ce pouvoir de rtention des villes nouvelles est significatif en ce quil
sexerce sur toutes les formes de trajectoires rsidentielles. Ceux qui sont
rests depuis lge de 30 ans dans le parc locatif lont fait en demeurant dans
les villes nouvelles alors quailleurs dans la grande couronne, ils ont plus sou-
vent rejoint le centre de lagglomration. Par ailleurs, plus de 85 % des per-
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes
169
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 169
sonnes qui taient propritaires (accdants compris) en ville nouvelle
30 ans le sont rests en ville nouvelle. Dans le reste de la grande couronne,
cette proportion natteint que 70 %. Parmi ces propritaires prcoces demeu-
rs en ville nouvelle, on trouve une majorit de cadres maison qui le sont
devenus gnralement en fin de carrire. Il apparat ainsi que les villes nou-
velles ont un plus grand pouvoir de rtention que les autres parties de la
grande couronne sur les cadres de ces gnrations. Lincapacit, sans cesse
dplore, des villes nouvelles attirer des cadres doit donc tre plus patente
pour les plus jeunes et pour ceux qui disposent dun plus grand capital cultu-
rel. Mais ce pouvoir de rtention ici soulign, accompagn de mobilit rsi-
dentielle interne aux villes nouvelles peut avoir des effets pervers et tre le
signe dune polarisation sociale en cours. Il nest pas question ici den faire
la description, il sagit plutt de rendre compte du pouvoir de polarisation des
villes nouvelles sur les trajectoires rsidentielles.
Ce processus de polarisation dpasse les limites des villes nouvelles
elles-mmes pour dborder vers leur voisinage Dans un premier temps on
Espaces et socits 119
170
rsidence au moment de lenqute
Paris petite villes voisinage reste de total
couronne nouvelles des villes la grande
nouvelles couronne
rsidence Paris 59 21 7 6 7 100
30 ans petite couronne 7 67 7 10 9 100
villes nouvelles 4 4 76 11 5 100
voisinage des villes nouvelles 4 9 15 61 11 100
reste de la grande couronne 4 8 8 13 67 100
autres rgions mtropolitaines 23 26 16 15 20 100
hors France mtropolitaine 26 34 13 11 16 100
rsidence Paris 90 5 1 1 2 100
45 ans petite couronne 2 93 2 2 2 100
villes nouvelles 0 1 95 4 1 100
voisinage des villes nouvelles 2 2 5 89 2 100
reste de la grande couronne 2 3 2 3 90 100
autres rgions mtropolitaines 30 32 9 10 19 100
hors France mtropolitaine 41 29 2 14 14 100
Source : enqute Biographies et entourage , INED, 2000-2001.
Tableau 2 Caractrisation des trajectoires rsidentielles
(rpartition en % de la localisation rsidentielle des enquts
au moment de lenqute en fonction des localisations 30 et 45 ans)
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 170
peut mettre en vidence une polarisation des villes nouvelles sur les trajec-
toires rsidentielles effectues au sein des communes de leur voisinage. Entre
30 ans et lge au moment de lenqute, 39 % des enquts qui ont quitt le
voisinage des villes nouvelles ont rejoint ces dernires. Cette proportion aug-
mente si lon prend pour ge initial 45 ans (43 %). Fouchier et Mirande
(1999) ont dj relev, chez les personnes venant occuper des logements
neufs en ville nouvelle, cette inflexion dans les provenances : de plus en plus,
les villes nouvelles recrutent leurs habitants dans leurs alentours. Une ten-
dance inverse est note du voisinage des villes nouvelles vers le reste de la
grande couronne. Les personnes passes par une commune voisine des villes
nouvelles se sont, au fil de lge, donc au fil du temps, de plus en plus diri-
ges vers les villes nouvelles, de prfrence au reste de la grande couronne.
Rciproquement, les rares Franciliens de ces gnrations qui ont quitt
les villes nouvelles aprs y avoir rsid lge de 30 ans, lont fait en direc-
tion des communes de leur voisinage. Ils lont fait bien plus fortement encore
aprs 45 ans 71 % des personnes rsidant 45 ans en ville nouvelle et qui
ny rsident plus, vivent, au moment de lenqute, dans leur voisinage. La
notion de bassin de vie au sens de bassin de trajectoire rsidentielle, de
bassin dancrage savre donc tre un qualificatif pertinent pour les villes
nouvelles.
Le tableau est cependant nuancer, tant la situation peut diffrer dune
ville nouvelle lautre
11
. Snart, o le peuplement a t plus tardif et plus
massivement port vers la proprit, les personnes sont gnralement restes
dans la ville nouvelle aprs y tre frquemment parvenues par la valle de la
Seine les tapes rsidentielles depuis Paris ou le Val-de-Marne vers Brunoy,
Montgeron ou Vigneux-sur-Seine sont typiques du peuplement de Snart.
Marne-la-Valle, les sorties ont t galement peu nombreuses. Plus
quailleurs, elles sont conscutives une sparation conjugale qui a pu entra-
ner le retour vers Paris. Nombreux sont aussi les cas de trajectoires rsiden-
tielles qui demeurent dans le parc social de la banlieue est, et qui ont pour
tape une commune de Marne-la-Valle. vry et Cergy, les personnes
issues dautres rgions mtropolitaines sont plus nombreuses, et se sont gn-
ralement tablies dans la ville nouvelle. De ces villes-prfectures, cependant,
les sorties ont t plus frquentes. Ces dparts se sont ports vers la basse
valle de lOise (dAuvers-sur-Oise Persan) ou vers Chars, pour Cergy, ou
en direction des communes limitrophes (Corbeil-Essonnes, Mennecy), pour
la ville nouvelle dvry. Elles concernent principalement danciens locataires
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes
171
11. On sera prudent sur la porte donner aux descriptions qui suivent. Dune part, lchan-
tillon nest pas reprsentatif de la population de chacune des villes nouvelles. Les enquts de
Saint-Quentin-en-Yvelines sont particulirement sous-reprsents (carte 1). Dautre part,
toutes les communes du voisinage des villes nouvelles ne sont pas reprsentes dans le corpus
de lenqute.
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 171
rsidant en immeuble de centre-ville, qui loffre de logements individuels
devenant moins intressante en ville nouvelle, ou ne correspondant pas au
standing recherch ont accd la proprit dans sa priphrie. Notons que
les lieux de travail de ces personnes sont indistinctement localiss proxi-
mit de leur rsidence ou dans le centre de la mtropole. Cest Saint-
Quentin que les dparts ont t les plus nombreux en proportion relative.
Mais cest dans cette ville nouvelle quils ont eu le plus frquemment pour
destination des communes limitrophes, Versailles et Maurepas, en premier
lieu. Pour la plupart, ces personnes travaillaient Saint-Quentin au moment
o elles y rsidaient, et ont continu de le faire aprs leur dpart de la ville
nouvelle.
Chaque ville nouvelle a donc des formes dancrage typiques et un bassin
de vie plus ou moins tendu, avec sa propre capacit de rtention. Retenons
que les habitants de lensemble des villes nouvelles franciliennes de ces
gnrations semblent, plus que dans les vieux centres ou le bti rcent de la
grande couronne, stre ancrs dans leur environnement. Mais sy trouvent-
ils isols ?
LANCRAGE PAR LES PROXIMITS FAMILIALES
La proximit de la famille est certes dun grand recours, que ce soit en
priode de difficults personnelles ou dans les changes les plus banals de la
vie quotidienne. Mais elle peut aussi correspondre une situation hrite,
un effet dinertie rsultant dune mobilit limite (voire dlimite) des
membres dune famille tout au long de leur existence. Il ne sagit donc pas de
donner une signification trop largie ces proximits. Prises isolment, elles
renseignent plus sur les caractristiques dun lieu (un quartier, une ville) que
sur un type de fonctionnement familial. Dans tous les cas, elles tmoignent
de lancrage dune personne dans son environnement. Si la proximit phy-
sique saccompagne dune proximit relationnelle, on peut parler de famille
entourage locale (Bonvalet, 2003). Si la relation nest plus entretenue, on
peut alors supposer que la personne dispose de relations non familiales hri-
tes de lenfance qui lattachent son environnement. A contrario, ne pas
avoir son rseau familial circonscrit un territoire donn nimplique pas
ncessairement une absence dancrage (Tarrius, 2000).
Les proximits familiales ne sont donc quune dimension de lancrage.
Mais une dimension qui entre de manire dcisive dans la comprhension du
vieillissement des villes. Dans un premier temps, il sagira de vrifier que les
villes nouvelles ont accueilli des personnes qui se sont loignes de leur
famille dorigine. Dans cette ventualit, cest la mmoire actuelle des villes
nouvelles qui est en jeu : seraient-elles des espaces qui ne sont le support
Espaces et socits 119
172
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 172
daucune histoire familiale ? Ltude de la relation parents-enfants fournira
un complment de rponse prcieux.
En moyenne, les enquts connaissent prs de 3 non-corsidents de leur
entourage qui rsident en le-de-France, cette moyenne cachant de grandes
disparits selon les origines (Lelivre et Imbert, 2002). Lentourage francilien
prsente une composition gnrationnelle homogne au sein des trois chan-
tillons de la grande couronne : 17-18 % dascendants (parents et parents des
conjoints) ; 38-39 % de collatraux (fratrie) ; 44-45 % de descendants
(enfants des enquts et de leurs conjoints). Sa rpartition gographique est
galement homogne dun chantillon lautre.
En revanche, des diffrences apparaissent ds que composition et rpar-
tition spatiale de lentourage sont mises en relation. Les personnes de len-
tourage qui rsident moins de 5 km de la rsidence des enquts ne sont pas
les mmes dun chantillon lautre. Dans deux tiers des cas, il sagit de des-
cendants lorsque lenqut rside en ville nouvelle, alors que ceux-ci ne
reprsentent que la moiti des personnes les plus proches dans le voisinage
des villes nouvelles ou dans les communes situes entre les villes nouvelles.
A contrario, quand lenqut rside en ville nouvelle, les personnes loi-
gnes sont plus frquemment des ascendants ou des collatraux que des
descendants.
Si les parents et les beaux-parents franciliens sont plus loigns, on ne
relve pas pour autant une tyrannie de la distance engendre par cet loigne-
ment relatif. Les enquts des villes nouvelles ont certes moins de contacts
quotidiens avec leurs ascendants, mais ceux-ci sont compenss par des
contacts hebdomadaires plus importants.
En outre, on pourrait supposer que la plus grande proximit des enfants
provient du fait quils sont plus jeunes quailleurs, les enquts ltant eux-
mmes. Une analyse de la variance montre que, pour les enquts des villes
nouvelles, la rpartition gographique des enfants adultes ne dpend pas de
lge de ces derniers. Autre lment significatif : alors que pour les enquts
des villes nouvelles la distance aux enfants est indpendante du statut social
de ces derniers, ce nest pas le cas pour les enquts des autres parties de la
grande couronne. Leurs enfants, lorsque ceux-ci sont cadres suprieurs, ont
investi plus souvent Paris ou un autre secteur de lagglomration (et moins le
voisinage de leurs parents) que ne lont fait les enfants dun autre statut
social. Il est tentant dinterprter la relative rtention par les villes nouvelles
de ses descendants cadres par une plus grande adquation entre loffre com-
bine de formation et demploi, et ce statut. Ne disposant pas du lieu de tra-
vail des enfants des enquts, cette assertion restera au stade de lhypothse.
Les villes nouvelles ont ainsi produit des types dancrage tout fait sp-
cifiques. Leur peuplement massif et la centralit de leurs quipements engen-
drent chez les gnrations tudies des ancrages en devenir, en construction
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes
173
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 173
autour de bassins de vie dont les proprits ont t prsentes pour chacune
des villes nouvelles. Dans le reste de la grande couronne, se rencontrent des
types dancrage plus composites : une population peu mobile ctoie des tra-
jectoires pri-urbaines.
ANCRAGE ET VILLES NOUVELLES : UNE ESQUISSE AFFINER
Le processus dancrage des individus dans des espaces de peuplement
rcent comme les villes nouvelles na t qubauch ici. Les pistes sont
dbroussailles, et il va sagir dans une prochaine tape de les clairer. Il
convient tout dabord de mieux comprendre les trajectoires rsidentielles des
Franciliens, en offrant une plus grande lisibilit aux vnements biogra-
phiques qui servent de contexte ces mobilits. Les tapes rsidentielles
effectues dans les villes nouvelles font souvent sens, cest ce sens dont il
faut restituer la richesse. Cela permettra une comprhension plus grande
encore des proximits familiales. La conduite dentretiens et lanalyse statis-
tique des biographies apporteront un clairage ce questionnement.
Lenjeu est de taille, du point de vue de la thmatique de lurbain. Au
regard des bassins de vie qui semblent se constituer autour des villes nou-
velles franciliennes, au regard de lvitement du cur de lagglomration
parisienne par les enfants de parents des gnrations 1930-1950 qui ont
grandi dans la grande couronne, et plus particulirement dans les villes nou-
velles, la question du dcrochage de ces espaces se pose. Lle-de-France
connat-elle un nouveau morcellement en secteurs fonctionnels qui pourrait
se drouler lchelle de la rgion ? Va-t-on voir Paris et sa proche banlieue
se dtacher de la grande banlieue elle-mme dlimite en quartiers sui-
vant des axes radiaux ? Le processus ne serait pas nouveau mais il pourrait
se cristalliser. La centralit des villes nouvelles, dont on a pu valuer limpact
sur les trajectoires individuelles et les proximits familiales, pourrait en tre
partie prenante en sinterposant entre la grande couronne et le cur de lag-
glomration. Peut-on y voir le signe de lavnement dune centralit duale
qui ferait de Paris le sige exclusif de nouveaux cosmopolitismes
(Tarrius, 1992), et de la grande couronne, des lieux dancrage qui suffisent
aux besoins de ses habitants
12
? Vieille thmatique qui se dploie une nou-
velle chelle et qui saccommode mal de prophties. Ltude du vieillisse-
ment des espaces pri-urbains laune de lancrage de leurs habitants nen
devient que plus ncessaire et pourra senrichir dune interaction entre mono-
graphies de quartiers et enqutes plus large chelle.
Espaces et socits 119
174
12. Les rsultats prsents abondent dans le sens du constat tabli par les spcialistes de la
question (revue Esprit, 1999 ; Remy, 1992).
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 174
RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AUTHIER, J.-Y. (sous la dir. de) 2001. Du Domicile la Ville. Vivre en quartier ancien,
Paris, Economica, coll. Villes .
BENOT-GUILBOT, O. 1986. Quartiers-dortoirs ou quartiers-villages ? , dans
Collectif, Lesprit des lieux. Localits et changement social en France, Paris,
ditions du CNRS.
BERGER, M. 1992. Mobilit rsidentielle et navettes domicile-travail en le-de-
France , Espace populations socits, n 2.
BERGER, M. et al. 2000. Les mnages contre les amnageurs ? Migrations rsiden-
tielles et navettes domicile-travail des pri-urbains en le-de-France , dans
J. DArmagnac, C. Blayo et A. Parant, Dmographie et amnagement du terri-
toire, actes du X
e
Colloque national de dmographie, 1996, Bordeaux, Paris,
CUPED, IDUP, Centre Pierre Mends-France.
BONVALET, C. 1989. volution des structures familiales et consquences sur lha-
bitat en France , dans M. Haumont et M. Segaud, Familles modes de vie et
habitat, Paris, LHarmattan, coll. Habitat et Socits .
BONVALET, C. 2003. La famille entourage locale , Population, n 1.
DUREAU, F. ; DUPONT, V. 1994. Rle des mobilits circulaires dans les dynamiques
urbaines. Illustrations partir de lquateur et de lInde , Revue Tiers Monde,
n 140.
ESPRIT, n 258. 1999, Quand la ville se dfait.
ESTBE, P. ; BEHAR, D. ; GONNARD, S. 2002. Les villes nouvelles en le-de-France ou
les fortunes dun malentendu, rapport pour le programme valuation et histoire
des villes nouvelles, Paris, ACADIE cooprative conseil.
FOURCAUT, A. 2000. La banlieue en morceaux, Grne (France), Craphys.
FESTY, P. 1990. Mobilit rsidentielle des femmes spares : une tape dans le cycle
familial , dans C. Bonvalet et A.-M. Fribourg (sous la dir. de), Stratgies rsi-
dentielles, Paris, INED, Plan Construction et Architecture, MELTM, coll. Congrs
et colloques .
FOUCHIER, V. ; MIRANDE, B. 1999. Les logements neufs et leur population dans les
cinq villes nouvelles dle-de-France (1990-1997), Paris, ministre de lquipe-
ment, des Transports et du Logement (METL).
GRANOVETTER, M. 1973. The Strength of Weak Ties , American Journal of
Sociology, vol. 78, n 6.
LELIVRE, E. ; IMBERT, C. 2002. Lentourage des Franciliens de 50 70 ans stend
au-del des limites de la rgion , dans INSEE, Atlas des Franciliens : ge et
modes de vie, Paris, IAURIF, INSEE, tome 3.
MEYFROIDT, P. 2002. La notion dinstallation dans la sociologie urbaine de langue
franaise : mergence dun concept, Recherches sociologiques, n 3.
ORTALDA, L. 2001. Le systme dentraide au sein de la parent : entre logiques
sociales et pratiques familiales, Thse de sociologie et dmographie, Nanterre,
Universit Paris X.
PREMIER MINISTRE, DLGATION GNRALE AU DISTRICT DE LA RGION DE PARIS (1965),
Schma directeur damnagement et durbanisme de la rgion parisienne
(SDAURP), Paris, District de la rgion de Paris.
Ancrage et proximits familiales dans les villes nouvelles franciliennes
175
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 175
REMY, J. 1992. La ville : vers une nouvelle dfinition, Paris, LHarmattan, coll.
Villes et entreprises .
REMY, J. 1996. Mobilits et ancrages : vers une autre dfinition de la ville , dans
M. Hirschhorn et J.-M. Berthelot, Mobilits et ancrages. Vers un nouveau mode
de spatialisation ?, Paris, Montral, LHarmattan, coll. Villes et entreprises .
SMADJA, G. 1989. Linnovation sociale, dans J.-E. Roullier (sous la dir. de), Villes
nouvelles en France, Paris, conomica.
TARRIUS, A. 1992. Les fourmis dEurope : migrants riches, migrants pauvres et nou-
velles villes internationales, Paris, LHarmattan, coll. Logiques sociales .
TARRIUS, A. 2000. Les nouveaux cosmopolitismes. Mobilits, identits, territoires,
Paris, ditions de lAube.
WILLMOTT, P. ; YOUNG, M. 1962. Family and Kinship in East London, Middlesex,
Pelican Books.
Espaces et socits 119
176
Espaces et socits 119 1/03/05 11:56 Page 176
Vous aimerez peut-être aussi
- DDS2 SERIE3 2016-Solutionex2-Ex3Document4 pagesDDS2 SERIE3 2016-Solutionex2-Ex3dzfansPas encore d'évaluation
- Repenser Le Centre-Ville de RimouskiDocument69 pagesRepenser Le Centre-Ville de RimouskiRadio-CanadaPas encore d'évaluation
- Le BouturageDocument2 pagesLe Bouturageelga74Pas encore d'évaluation
- GP RE 2013 - WebDocument150 pagesGP RE 2013 - WebGisele GalafacciPas encore d'évaluation
- INTRODUCTIONDocument7 pagesINTRODUCTIONchoaibPas encore d'évaluation
- Travail Christian OriginalDocument55 pagesTravail Christian OriginalTanguy DoumbiaPas encore d'évaluation
- Salma Chalouati's ResumeDocument1 pageSalma Chalouati's ResumeHbib LommaPas encore d'évaluation
- Tyron - Ovni Et Extraterrestres Par Yves NaudDocument25 pagesTyron - Ovni Et Extraterrestres Par Yves NaudTyron CorrePas encore d'évaluation
- TP SimondonDocument15 pagesTP SimondonLoïc-Epicurea de La MettriePas encore d'évaluation
- Mémoire Sur Les Centralités UrbainesDocument37 pagesMémoire Sur Les Centralités Urbainesmalogohier312585% (13)
- L’essentiel du code international de nomenclature botaniqueDocument168 pagesL’essentiel du code international de nomenclature botaniquejuliengagne18Pas encore d'évaluation
- La ViandeDocument26 pagesLa Viandeyoucef100% (2)
- Document EftDocument211 pagesDocument Efteuqehtb100% (1)
- Mes Vacances Au PortugalDocument3 pagesMes Vacances Au Portugalmirela cocoPas encore d'évaluation
- Saidisara 161119222204 PDFDocument30 pagesSaidisara 161119222204 PDFRafik Dra100% (1)
- S1 TD2 Protides PDFDocument8 pagesS1 TD2 Protides PDFmartinmune67% (3)
- Le Monde-1 PDFDocument388 pagesLe Monde-1 PDFcristor2010100% (2)
- Utilisation D ArcmapDocument546 pagesUtilisation D ArcmapPavel Morati100% (3)
- Développement des algorithmes pour l’automatisation de la classification des données utilisant les réseaux de neurones probabilistes (PNN). Application à l’analyse, la catégorisation et la cartographie des images de télédétection. Thèse de Iounousse JawadDocument120 pagesDéveloppement des algorithmes pour l’automatisation de la classification des données utilisant les réseaux de neurones probabilistes (PNN). Application à l’analyse, la catégorisation et la cartographie des images de télédétection. Thèse de Iounousse JawadAhmed Iounousse100% (1)
- Physiologie de L'oignonDocument22 pagesPhysiologie de L'oignonAmos NIYOGUSERUKAPas encore d'évaluation
- Fractionne French T-Rex38Document6 pagesFractionne French T-Rex38FranckPailhasPas encore d'évaluation
- AstrologieDocument104 pagesAstrologienicolasPas encore d'évaluation
- Doc1rrrDocument24 pagesDoc1rrrAbdelali SolPas encore d'évaluation
- Topo 1Document37 pagesTopo 1idomPas encore d'évaluation
- L'Utilisation de La Métaphore Dans Le Processus de Conception ArchitecturaleDocument34 pagesL'Utilisation de La Métaphore Dans Le Processus de Conception ArchitecturaleSamira Alliche50% (2)
- La Prospection GéophysiqueDocument87 pagesLa Prospection GéophysiqueRahma MejriPas encore d'évaluation
- COURS DE GEOL STRUCT Prof PMNDocument60 pagesCOURS DE GEOL STRUCT Prof PMNjahyokotaPas encore d'évaluation
- Syllabus SNV Zoologie TAIBI FaizaDocument3 pagesSyllabus SNV Zoologie TAIBI FaizaSou FiPas encore d'évaluation
- Classification Des Sols GTRDocument12 pagesClassification Des Sols GTRH!Ch@m75% (4)
- Bro BINEUSES 90400 FR 2013Document16 pagesBro BINEUSES 90400 FR 2013couscousriderPas encore d'évaluation