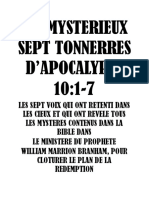Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lucien Gassino - Utopie
Lucien Gassino - Utopie
Transféré par
Maria RitaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lucien Gassino - Utopie
Lucien Gassino - Utopie
Transféré par
Maria RitaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fiction, parodie et utopie:
les Histoires vraies de Lucien
Isabelle Gassino
Universit de Rouen-ERIAC (Frana)
Resumo
Les Histoires vraies de Lucien ont inspir de nombreux rcits de voyages
imaginaires ; elles sont considres comme lune des sources possibles de lUtopie de
More. On sattachera prciser la nature des Histoires vraies, le statut quy revt la
fiction, ainsi que la manire dont Lucien organise son rcit. En quoi le fait quil sagisse
dun rcit de voyage influe-t-il sur ce texte-ci et sur ceux qui sen inspirent ?
Dautre part, les Histoires vraies sont aussi le lieu o les mythes grecs (re)prennent
vie et o les rves de toute une civilisation trouvent une forme dexpression. En ce sens,
elles sont ce que nous appellerons une utopie littraire, mme si Lucien ne donne pas
son texte une valeur de modle pour en faire une utopie au sens platonicien et morien.
Palavras-chave
Lucien de Samosate, Histoires vraies, utopie, fiction, voyage.
Isabelle Gassino, docente da Universidade de Rouen, agrge de letras clssicas, doutora em
estudos gregos e licenciada em grego moderno. Dedica-se a pesquisar o autor Luciano de Samsata
e, particularmente, as relaes que este srio de cultura grega mantm com o mundo romano.
Interessa-se tambm pelas originalssimas Narrativas verdadeiras. Publicou vrios artigos, entre
eles: "Les Histoires vraies de Lucien: de la parodie au manifeste", "Par-del toutes les frontires: le
pseudos dans les Histoires vraies de Lucien", ou ainda "Lucien entre grec et latin: les ambiguts
d'un choix culturel et esthtique".
Isabelle Gassino
D
Voir Robinson, 1979, p. 130.
On sait que More prisait
particulirement la mthode
de Lucien dont il a traduit
en latin quelques opuscules
parce que, conformment
aux recommandations
dHorace, elle joint lutile
lagrable (voir lettre-prface
aux traductions de Lucien
adresse Th. Ruthall). Par
ailleurs, la critique morienne
estime que les deux textes de
Lucien les plus susceptibles
davoir influenc More
sont les Histoires vraies et
lIcaromnippe. Sur la question
des sources ou des influences
lucianesques sur More, voir
Thompson, 1974, en particulier
p. XLIX-L e Surtz, 1965, p.
CLXI-CLXII.
Voir Sargent, 2005.
4
Voir Quarta, 2005.
Voir E. Surtz, 1965, p. CLXICLXII.
5
Cest ce que fait par exemple
P. Grimal en incluant ce texte
dans les Romans grecs et latins.
6
Voir Bompaire, 1958, p. 660 ;
Canfora, 1986, p. 203 ; Grimal,
1958, p. XXIV.
7
Voir Fredericks, 1976.
Nous prenons ici le terme
"intellectuel" au sens large
dune personne occupe une
activit qui nest pas manuelle,
en dehors de toute notion
dengagement public ou
politique.
9
44
s le XVIe sicle, le nom de Lucien est troitement associ au
motif littraire du voyage imaginaire, notamment par le biais de
lUtopie de Thomas More; mieux encore, au XVIIe sicle, cette
thmatique nest jamais mentionne sans rfrence lauteur des Histoires
vraies. Si les Histoires vraies de Lucien sont, de lavis des spcialistes, lune
des sources dont More a pu sinspirer, il semble pourtant quil y a loin
entre le voyage imaginaire aimablement fantaisiste dont elles sont le rcit et
lutopie morienne. En effet, mme si la dfinition de lutopie pose problme,
on peut la caractriser a minima comme la description dune socit idale,
le plus souvent faite dans le cadre dune rflexion politique; mme si une
telle dmarche peut laisser place un aspect humoristique, il est indniable
quelle comporte galement un aspect didactique qui semble, de prime
abord, tranger Lucien. Dautre part, More sinspire galement de Platon,
tout autant pour la forme de discours quil cre que pour le nom quil lui
donne puisque, comme on le sait, il est linventeur du nom "utopia"4: dans
la Rpublique (592b), il est bien prcis que ltat qui est dcrit nexiste nulle
part (oudamou) mais quil y en a dans le ciel un modle (paradeigma) que lon
peut contempler (horan) et sur lequel rgler sa conduite.
More na-t-il donc rien emprunt dautre Lucien, comme cela a
pu tre suggr, que quelques traits ponctuels, et un changement de dcor?5
En dautres termes, le voyage ne sert-il rien dautre qu apporter une
touche dexotisme avant la lettre ? Pour rpondre cette question, il est
ncessaire de prciser ce que sont les Histoires vraies. dfaut de rsoudre
la question mille fois souleve, et jamais totalement rsolue, de savoir de
quel(s) genre(s) littraire(s) elles relvent, nous souhaiterions faire le point
sur la nature de cet objet littraire quelles constituent et circonscrire en
quoi elles pourraient, ou non, recler les prmices dune utopie au sens
morien du terme.
I. Le projet de Lucien
Il existe au moins un point commun entre la littrature utopique
et les Histoires vraies: cest la difficult quil y a dfinir le genre auquel
elles appartiennent lune et lautre. En effet, que lon caractrise le texte de
Lucien comme un roman6, comme une parodie7 ou encore comme un rcit
de science-fiction8, la dfinition est incomplte et manque, de notre point
de vue, ce qui fait loriginalit de louvrage. Pour sortir de cette impasse,
examinons ce que lauteur lui-mme nous dit du texte quil introduit.
Lucien commence par dfinir le but quil assigne son ouvrage. Les
Histoires vraies souvrent en effet par une comparaison entre les athltes
et les intellectuels9 fatigus par des lectures srieuses (I 1): les uns comme
les autres doivent prendre du repos afin de se remettre ensuite avec plus
dardeur leurs activits respectives. Les Histoires vraies se prsentent donc
comme un ouvrage de loisir, destin offrir un peu de dtente et semblant
exclure, demble, toute forme de rflexion srieuse. Nanmoins, il nest
pas indiffrent quil soit destin un public de lettrs et que, de ce fait,
il propose, dit Lucien, "un sujet de rflexion qui ne soit pas tranger aux
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
Fiction, parodie et utopie: les Histoires vraies de Lucien
Muses10" (therian ouk amouson), comme si cette "rcration" pouvait tre le
point de dpart dun travail ultrieur: Lucien dit dailleurs que cette dtente,
pour les gens de lettres comme pour les athltes, est souvent considre
comme "la part la plus importante de leur entranement".
Quels moyens lauteur se donne-t-il pour parvenir ce but ? Lucien
cherche se dmarquer des innombrables crivains qui ont, avant lui, livr
des rcits incroyables tout en les donnant pour vridiques, chose bien sr
moralement rprhensible, car elle revient tromper le lecteur en mentant
deux fois: en racontant des faits qui nont jamais exist et en affirmant que ces
faits ont rellement eu lieu. La figure emblmatique dun tel comportement
est dailleurs non un auteur, mais un narrateur secondaire: Ulysse, qualifi
de "matre s-bouffonnerie" (didaskalosbmolochias), qui a racont des
histoires dormir debout aux Phaciens, "qui ny connaissaient rien" (iditas
anthrpous I 3). Deux autres noms de "menteurs" sont galement cits:
Ctsias de Cnide, auteur dun ouvrage sur lInde, et Iamboulos, auteur dun
rcit de voyage sur une le imaginaire considr comme une utopie avant la
lettre11. Il est intressant de noter que Lucien ne critique pas directement
les mensonges de Iamboulos, mais note que "si le caractre mensonger du
rcit quil a forg tait connu de tous, le sujet ne manquait pas de charme"
(ouk aterp tn hupothsin). Cest dans cette voie que Lucien va lui aussi
sengager.
En effet, dune manire paradoxale et dlibrment provocante,
Lucien se dmarque non pas en promettant de dire la vrit, mais, au
contraire, en proclamant son intention de faire comme les auteurs quil
vient de mentionner, "pour ne pas tre le seul ne pas avoir sa part de
libert daffabuler (muthologein)" (I 4). Cependant, il y mettra, dit-il, plus
dhonntet que les autres, puisquil dit dentre de jeu quil va mentir
et renonce ainsi tromper son lecteur sur ses intentions, ponctuant sa
dclaration dune formule aux accents la fois socratiques et parodiques:
"Je dirai la vrit en tout cas sur un point, un seul: cest quand je dis que je
mens" (I 4).
Le texte est donc plac sous le signe dun pseudos qui ne cherche pas
tromper, mais uniquement distraire le lecteur, ce qui suffit le distinguer
de limmense majorit des textes de fiction antiques12. Le pseudos tel que
Lucien le dfinit pour lui-mme doit donc tre entendu, ici, non comme un
mensonge, mais comme une fiction, et mme une fiction autoproclame et
revendique13.
Lucien annonce galement (I 2) que son texte sera une collection
dallusions des auteurs antrieurs, car "chaque pisode comporte une
allusion qui ne manque pas dhumour certains anciens potes, historiens et
philosophes" que Lucien se dispense de nommer, sous prtexte quils seront
identifis coup sr. En dautres termes, Lucien confirme son intention de
destiner son texte des lecteurs cultivs, en mettant en place, demble, un
jeu littraire rserv aux happy few, et met en avant la tonalit minemment
comique et plaisante de son ouvrage.
Sauf indication contraire,
les traductions des textes de
Lucien donnes ici nous sont
propres.
10
Ce texte de Iamboulos est
rapport par Diodore de Sicile,
dans un passage (II 55-60)
traduit en franais dans le
volume intitul Naissance des
dieux et des hommes (Michel
Casevitz ed., 1991). Pour le
texte grec correspondant, on
pourra consulter ldition (avec
traduction en anglais) de C.
H. Oldfather, Loeb Classical
Library, Londres, Heinemann,
1953 (rimpression), tome 2.
11
Sur la fiction dans
lAntiquit, voir Brando, 2005
et 2001, en particulier p. 48.
12
Sur le statut du pseudos dans
les Histoires vraies, voir Briand,
2005; Gassino (a).
13
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
45
Isabelle Gassino
II. Lexcution de ce projet
1. Une utopie littraire
14
Voir Espelosn, 2010.
En I 7, les voyageurs
dbarquent sur une le o
une inscription commmore
le passage dHracls et de
Dionysos.
15
Comme les Femmes-Vignes
rencontres dans lle de
Dionysos et Hracls (I 8).
16
46
Rduite sa plus simple expression, la caractrisation des Histoires
vraies pourrait tre la suivante: le rcit dun voyage imaginaire. LUtopie de
More reprend ce schma en se prsentant comme le rcit du sjour fait
par le narrateur chez les Utopiens. Le voyage constitue-t-il un artifice de
prsentation commun aux deux textes, ou bien le voyage en tant que tel
apporte-t-il une dimension supplmentaire ? En quoi le fait quil sagisse
dun rcit de voyage influe-t-il sur lorganisation du texte ?
Le narrateur des Histoires vraies donne comme seuls motifs du
voyage quil a entrepris "la curiosit" (ts dianoias periergia), "la soif de
nouveaut" (pragmatn kainn epithumia), ainsi que le dsir de savoir ce quil
y avait de lautre ct de lOcan et qui y habitait (I 5). Ainsi commence
un voyage qui est sans but et sans fin, puisque le rcit sinterrompt sur la
promesse dune suite qui na jamais exist. Chose paradoxale pour ce type
de rcit, les dplacements dans lespace nintressent manifestement pas
Lucien14: mme lorsquil est entran travers les airs jusque sur la Lune,
lui, son bateau et ses compagnons, aucun dtail nest donn. La narration se
concentre sur ce que vivent les personnages dans les diffrents lieux visits.
Toutefois, loin de sattacher dcrire en profondeur les murs et coutumes
dun seul peuple, la narration retrace une succession de sjours faits dans les
lieux les plus inattendus et qui se succdent dans un ordre apparemment
alatoire: la Lune, les entrailles dune baleine, lIle des Bienheureux et lIle
des Songes. Aucun de ces lieux nest situ prcisment, ce qui est normal
puisque le narrateur et ses compagnons souhaitaient partir la dcouverte
dun monde inconnu, et que, pour ce faire, ils ont choisi de franchir les
colonnes dHracls, cest--dire le dtroit de Gibraltar, donc de saventurer
hors du monde familier aux Grecs quest la Mditerrane entreprise dans
laquelle seuls quelques navigateurs se risquaient. En outre, ils sont pris, ds
le dbut de leur priple, dans une tempte qui dure soixante-dix-neuf jours,
ce qui entrane la perte de tout repre gographique prcis.
Malgr cette plonge dans linconnu, il est frappant de voir combien
les personnages retrouvent le connu au sein mme de linconnu. Non
seulement linconnu est le plus souvent ramen du connu par le procd
de lanalogie, comme nous le verrons, mais il est de rgle que, au cur des
lieux les plus trangers, les voyageurs retrouvent des personnages clbres,
ou la trace de ceux-ci15, ou bien encore des cratures, humaines ou non, qui
parlent leur langue16 et/ou partagent les mmes murs queux. Ainsi, la
Lune a pour roi Endymion, la baleine est habite par un vieillard chypriote
et son fils qui parlent, bien videmment, un grec impeccable. LIle des
Bienheureux, quant elle, est peuple de figures clbres tant de lhistoire
et de la philosophie que de la mythologie, hros grecs et Barbares fameux,
parmi lesquels se trouvent Socrate, Homre, Hlne, Ulysse, Cyrus lAncien
et Cyrus le Jeune, ou encore Diogne. Quant aux songes qui habitent lle
du mme nom, ils sont encore plus intimement connus du narrateur et de
ses compagnons, puisquils en ont vu certains jadis, pendant leur sommeil
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
Fiction, parodie et utopie: les Histoires vraies de Lucien
("Nous en reconnmes mme certains, pour les avoir vus chez nous
autrefois" II 34).
Ce que Lucien se plat particulirement faire, cest jouer au
mythographe, soit quil corrige les mythes, soit quil leur invente une suite.
Il met en avant son passage dans un lieu prcis pour soctroyer une autorit
en la matire, suivant en ceci la dmarche des ethnographes qui, en disant
"Jai vu", signifient "je sais"17. Ainsi, on ne savait rien du sort d'Endymion
une fois celui-ci endormi d'un sommeil ternel: on le voit (I 11) devenu roi
des Lunaires chez qui il a t transport ce qui parat finalement logique,
puisque la Lune tait amoureuse de lui. On constate aussi qu'Ulysse, une
fois revenu dans sa patrie, regrette la vie qu'il menait auprs de Calypso
et projette de retourner auprs d'elle (II 35). On assiste un nouvel
enlvement d'Hlne (II 25-27), perptr par Cyniras avec lassentiment
de celle-ci et qui connat une issue diffrente de celui de Pris, puisque les
deux amants sont vite ramens, tout honteux ("Hlne pleurait et, dans sa
honte, se couvrait le visage" I 26) et sont chtis (Cyniras est tortur dans
l'Ile des Impies, II 32). Certes, Lucien ne se prive pas de faire paratre les
personnages les plus prestigieux sous un jour peu flatteur: l'pisode du nouvel
enlvement d'Hlne insiste sur l'infidlit de celle-ci, et la lettre d'Ulysse
Calypso montre le hros de l'Odysse mconnaissable, s'ennuyant auprs
de Pnlope et aspirant limmortalit et la vie facile que la nymphe lui
proposait. Mais la dmarche de Lucien, ici comme dans dautres uvres,
procde moins dune volont de critiquer avec svrit que de proposer
son lecteur une variation amusante sur des thmes connus. Cest surtout
une manire de redonner vie des personnages imaginaires, au sein du
cercle choisi runissant Lucien et ses lecteurs. En plus dune occasion, des
lieux invents par la littrature prennent consistance, linstar de la cit de
Coucouville-les-Nues, imagine par Aristophane dans Les Oiseaux et vue
de loin par le narrateur alors quil redescendait de la Lune (I 29); celui-ci
en conclut: "Et moi, je me souvins du pote Aristophane, homme sage et
disant la vrit, dont les crits taient mis en doute sans raison."
Le paysage dans lequel Lucien se promne est ainsi constitu des
histoires crites avant lui, et c'est travers une foule de rcits imaginaires,
d'auteurs clbres et de personnages de lgende qu'il volue. Les Histoires
vraies voient se raliser, selon la trs jolie formule de Jacques Bompaire,
un "rve de bibliothcaire, la faon des chartistes d'Anatole France, qui
voient, entre les pages de leurs in-folio, se lever de gracieuses silhouettes de
lgende, puis gambader, puis entrer dans leur vie18." Le monde des Histoires
vraies est un monde pour intellectuels apprciateurs de rfrences littraires
et culturelles; cest la raison pour laquelle on pourrait peut-tre parler,
leur propos, d "utopie littraire", dans la mesure o elles runissent en un
lieu qui na, nulle part, aucune existence concrte (un texte) une foule de
personnages et de lieux littraires et mythologiques.
Nous avons dit que Lucien ramne souvent linconnu au connu;
cest que, en effet, les Histoires vraies sont galement une parodie de rcits
ethnographiques la manire dHrodote notamment, comme cela a pu
tre montr19. Cest dire quelles offrent avant tout des descriptions de
17
Sur la parodie de la littrature
ethnographique par Lucien,
voir Sad, 1994.
18
Voir Bompaire, 1958, p. 672.
19
Voir Sad, 1994.
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
47
Isabelle Gassino
Raifort selon la traduction
donne par J. Bompaire (1998,
2009).
20
Cest galement un procd
que lon retrouve par exemple
chez Hrodote, qui prsente
lgypte comme un envers de
la Grce (II 35-36).
21
Voir Photius, Bibliothque
48b.
22
Voir Photius Bibliothque
49b.
23
Voir Diodore de Sicile,
Bibliothque historique II 56.
24
25
Voir Sad, 1994.
Sur les tymologies de
Lucien ainsi que sur la
concrtisation des mtaphores
luvre dans les Histoires
vraies, voir Gassino, 2010.
26
48
lieux et de peuples trangers, entre lesquels la slection se fait selon le
critre de ltranget et non en fonction dun idal, puisque la littrature
ethnographique dcrit des ralits kaina kai paradoxa, "tranges et inoues"
(I 22). Il sagit de concilier descriptions de murs et de peuples inconnus et
comprhension de ceux-ci par le lecteur. Dans cette perspective, lanalogie
joue un rle important, car ce procd permet de rendre compte des
particularismes tout en rduisant la distance entre ce qui est connu des
lecteurs et lobjet dcrire. Ainsi, explique Lucien, sur la Lune (I 23-24),
on mange en sasseyant autour du feu comme on le ferait autour dune table
(hsper peri trapezan); les Lunaires ont au-dessus du postrieur une sorte
de chou ou de raifort20 qui leur pousse et qui est comme une queue (hsper
oura). Ils tirent des oignons une huile qui sent bon comme du parfum
(hsper muron).
Le monde que Lucien prsente est un monde lenvers21, o ce
sont les mles qui assurent la reproduction et o mme la chronologie, en
certaines circonstances, fonctionne rebours, puisque les enfants naissent
morts avant dtre amens la vie en tant exposs lair ambiant (I 22).
Les diffrents aspects des murs des Lunaires sur lesquels le
narrateur met laccent sont ceux qui sont galement privilgis par les
ethnographes. On retrouve notamment chez Ctsias de Cnide (mentionn
en I 3) un dveloppement spcifique relatif la digestion et aux excrments22.
Les particularits physiques et physiologiques sont galement trs prsentes
aussi bien chez Ctsias23 que chez Iamboulos24.
Lucien garde nanmoins une distance avec cette littrature, en la
parodiant: on a pu montrer par exemple que ses protestations de bonne foi et
autres assurances frquentes chez un Hrodote davoir personnellement
vu ce quil dcrit servent en ralit introduire les plus gros mensonges25.
De nombreux faits dcrits reposent en ralit sur un jeu de mots ou sur une
attitude faussement scientifique: ainsi, dit-il, les chauves sont apprcis sur
la Lune, et les chevelus sur les comtes: la constatation repose sur un jeu
de mots entre les deux sens de komts, la fois "chevelu" quand le mot est
adjectif et "comte" quand le terme est substantiv. De mme, Lucien prtend
par exemple expliquer ltymologie du terme gastroknmia (littralement
le ventre de la jambe , terme qui dsigne le mollet) par le fait que les
enfants sont ports non dans le ventre, mais dans le mollet, ce qui est une
explication la fois totalement fantaisiste (elle supposerait au moins que des
Grecs aient eu connaissance des phnomnes existant dans la Lune, pour
que leur langue en rende compte !) et se donnant une apparence srieuse26.
Lucien sinscrit ainsi dans la tradition du rcit de voyage ethnographique,
cest--dire du voyage comme source de connaissance, tout en dnonant,
sur le mode comique, la vanit toujours possible de ce savoir.
2. Variations sur le thme de lge dor
Ainsi se traduit lintention initiale de Lucien de donner repos et
distraction son lecteur: mme si son propos sinspire de sources multiples,
cest bien limagination et la verve lucianesques qui sont ici aux commandes.
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
Fiction, parodie et utopie: les Histoires vraies de Lucien
Pour autant, ce qui est racont ici nest pas le pur produit de la fantaisie la
plus dbride: non seulement une analyse de la structure des Histoires vraies
rvlerait un plan densemble bien rel27, mais en outre, derrire chaque
dtail, on retrouve les rves, les obsessions et les manires de penser des
Grecs, comme on peut sen rendre compte en lisant lintgralit du passage
relatif aux deux modes de reproduction existant chez les Lunaires (I 22):
Ils pratiquent le mariage entre mles et mme, ils ne connaissent absolument
pas le nom "femme". Donc, jusqu lge de vingt-cinq ans, chacun est
pouse, et ensuite, est poux; ils portent les enfants non dans le ventre,
mais dans le mollet, ventre de la jambe; une fois lembryon conu, la jambe
grossit; quelque temps aprs, ils pratiquent une incision et font sortir des
ftus morts; ils les exposent au vent, bouche ouverte, et leur donnent la vie.
mon avis, cest de l que vient, chez les Grecs, le nom de "mollet-ventre de
la jambe", parce que, chez les Lunaires, cest lui qui porte les enfants, au lieu
du ventre. Mais je vais raconter quelque chose de plus fort que cela. Il y a
chez eux une race dhommes, que lon appelle les Arborignes, et qui nat de
la manire suivante. On coupe le testicule droit dun homme et on le plante
en terre; il en pousse un arbre trs haut, fait de chair, pareil un phallus,
avec des branches et des feuilles; ses fruits sont des glands de cinquante
centimtres de long. Quand ils sont mrs, on les rcolte et on les casse pour
en faire sortir les hommes (traduction Bompaire, 2009, modifie).
Ces deux modes de gestation font cho une double tradition
mythologique: dune part, toute la tradition misogyne (la femme est
un mal ncessaire) dont lune des plus anciennes expressions est le mythe
de Pandore et qui a des chos dans toute la littrature grecque28; dautre
part, aux diffrents mythes dautochtonie existant dans des cits telles
quAthnes ou Thbes, selon lesquels les hommes sont littralement ns de
la terre sur laquelle ils habitent. Les murs des Lunaires sont comme une
fantasmagorie grecque, la ralisation dun rve vieux comme lhumanit:
celui d'un monde qui pourrait vivre sans femmes.
Dans le systme de reproduction par andrognse, on retrouve aussi
un cho du mythe de la naissance de Dionysos, qui a termin sa gestation
dans la cuisse de son pre Zeus, cette diffrence prs que, chez les Lunaires,
cest dans le mollet, et non dans la cuisse, que lenfant est port. Il serait
exagr de dire que les Lunaires sont comparables des dieux; ce qui est
certain, cest quils sont diffrents des simples mortels. Contrairement aux
textes ethnographiques qui dcrivent des hommes ayant simplement des
habitudes de vie diffrentes de celles que connaissent le narrateur et les
lecteurs auxquels il sadresse, les Lunaires sont dune nature diffrente des
hommes, nature marque par une certaine forme dimmatrialit. En effet,
ils consomment une nourriture et une boisson dpourvues de consistance:
ils mangent la fume que dgagent les grenouilles quils font griller, de
sorte que leurs repas consistent humer cette fume ("Ils hument la fume
qui monte et sen rgalent" I 23) comme les dieux le font avec le fumet
des victimes sacrifies. Quant leur boisson, elle consiste en un peu dair
exprim dans une coupe (I 23). Comme cette nourriture ne produit pas de
rsidu, le systme digestif est inutile, comme on le constate au paragraphe
27 Voir Gassino (b).
Voir, pour ne citer que ce
seul exemple, le discours de
Pausanias dans le Banquet de
Platon (180d sq).
28
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
49
Isabelle Gassino
En outre, dans la Bible, le
lait et le miel sont synonymes
dabondance et de bonheur,
puisque le pays o ils abondent
est la Terre promise (voir
notamment Exode 3,8; 13,5;
Lvitique 20,24; nombreuses
rfrences dans le Pentateuque).
Lucien sen est peut-tre
souvenu ici, comme il a pu
sinspirer du livre de Jonas pour
le sjour dans la baleine que
font ses propres personnages.
29
50
24: leur ventre nabrite aucun intestin et leur sert de fourre-tout. Tout aussi
superflu serait un orifice destin lvacuation des produits de la digestion:
par consquent, celui-ci nexiste pas (I 23).
Parvenus en fin de vie, ces tres ne connaissent pas, proprement
parler, la mort, mais ils se bornent disparatre sans laisser de trace:
"Lorsquun homme a atteint un ge avanc, il ne meurt pas, mais il se
dissout, tel une fume, et se transforme en air" (I 23).
Labsence de consistance physique a pour corollaire la transparence,
labsence de couleur: apparemment, le comble de llgance consiste tre
vtu de verre, puisque les riches en portent, tandis que les pauvres sont vtus
de cuivre (I 25); les vignes qui sont cultives chez eux produisent non du
vin, mais de leau.
Sur le plan de la physiologie, les Lunaires scrtent, malgr tout,
certaines substances: de leur nez coule du miel (I 24), et leur sueur est du
lait. Or, ces substances ne sont pas rpugnantes et /ou inutiles comme celles
que scrtent les corps humains; non seulement elles sont comestibles, mais
elles constituent mme une nourriture divine, puisque, comme on le sait,
Zeus a t nourri de miel et du lait de la chvre Amalthe29. Le mlange
de ce lait et dune goutte de miel produit un fromage dont on ne sait
dailleurs ce quils font, puisque le fromage ne fait pas partie de leur rgime
alimentaire. Au-dessus de leur postrieur pousse une sorte de lgume
(chou ou raifort) qui leur donne un aspect ridicule, mais ce nest pas le
plus important. En effet, ces tres semblent avoir des besoins tonnamment
limits dans le temps: les Arborignes (ceux des Lunaires qui, littralement,
sont ns des arbres) ont un sexe postiche, et tous les Lunaires ont des yeux
galement amovibles, comme si la copulation et la vue taient pour eux des
activits intermittentes rpondant des besoins ponctuels.
Ces cratures lunaires semblent raliser le rve bien humain dun
monde dans lequel les tres vivants ne seraient plus soumis aux besoins
fondamentaux que sont la nourriture et tout ce quelle implique: ils ignorent
le souci de se procurer manger et boire, car les grenouilles dont ils se
nourrissent volent dans les airs, en grande quantit; leur boisson, faite dair
comprim, est galement disposition; on ne se donne aucun mal pour faire
du vin, qui nexiste pas, puisque les vignes produisent de leau; le fromage est
produit presque spontanment, comme nous venons de le voir. La digestion
et les dsagrments quelle peut gnrer sont absents eux aussi. La mort
elle-mme nest en rien effrayante, tant une simple disparition, un passage
instantan de ltre au non-tre. Enfin, tous les soucis lis au mariage sont
eux aussi vacus: on est tour tour pouse et poux, les femmes nexistent
absolument pas, et les Lunaires nont pas besoin delles pour la procration.
Mme la copulation apparat comme une ralit marginale, comme le
montre le fait que certains dentre eux ont des organes amovibles.
En rsum, les Lunaires apparaissent comme des tres qui sont michemin entre la simple humanit et la divinit, ce qui ntonne gure dans
la mesure o la Lune est perue, au moins par Lucien, comme un astre qui
est mi-chemin entre le sjour des hommes et le sjour des dieux. On en
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
Fiction, parodie et utopie: les Histoires vraies de Lucien
voudra pour preuve le fait que, dans lIcaromnippe 11, lorsque le philosophe
Mnippe dcide de monter chez les dieux pour se plaindre des agissements
des philosophes, il fait tape, prcisment, sur la Lune.
Les Bienheureux occupent eux aussi une sphre intermdiaire entre
le commun des hommes et les dieux, comme le montre la description
qui est faite de lle quils habitent (II 11-16). Outre tous les aspects trs
attendus, presque convenus, quelle prsente (les fleurs abondent, les
fruits poussent seuls et donnent plusieurs rcoltes par an, les habitants
vivent dans labondance et le plaisir permanents), on trouve galement
un passage plus original peut-tre, qui dcrit les habitants comme tant
totalement immatriels, encore plus que ne le sont les Lunaires, car ils
nont pas de corps. Comme dans le cas des Lunaires, cette immatrialit
nest pas la simple consquence de larbitraire de la fantaisie lucianesque:
cette caractristique est prise dans une chane causale dont elle ne peut
tre dissocie30. Limmatrialit relative des corps des Lunaires (notamment
le fait quils se changent en air la fin de leur vie) tait finalement la
consquence de celle de leur nourriture. Les choses sont diffrentes chez les
Bienheureux: ils consomment du vin et une nourriture solide (I 14), mais
on ne peut imaginer des Bienheureux soumis au temps et au vieillissement;
tre "impalpables" (anapheis II 12) est pour eux une manire de ne pas
donner prise aux ravages du temps (il est bien prcis que chacun demeure
ternellement lge quil avait en arrivant). Ne pas avoir de corps est, en
somme, le corollaire de lachronie qui rgne dans lIle des Bienheureux.
Cela peut galement tre compris comme la consquence du fait que leur
pays est baign dans une lumire tamise permanente31, qui rduit les corps
des formes ayant malgr tout une consistance, un peu comme lIle des
Songes est difficile distinguer32 en raison de la nature mme des cratures
quelle abrite.
Le monde des Bienheureux a donc les caractristiques dun ge dor:
lharmonie est omniprsente, les personnes ne vieillissent pas, tout ce dont
le besoin se fait sentir est gnreusement prodigu par la nature, sans que
lhomme ait consentir le moindre effort pour le produire ou lobtenir.
Lucien fait ici cho la description de la race dor que lon trouve chez
Hsiode33, tout en la parodiant par le biais de lamplification, omniprsente
dans les Histoires vraies. Nous sommes ici dautant plus videmment dans le
monde du mythe que, comme nous lavons vu, tous les habitants de cette le
sont des personnages connus de la mythologie ou de lhistoire.
En revanche, le seul personnage mythologique prsent dans lpisode
sur la Lune est Endymion; Lucien greffe sa propre description sur un mythe
connu (lamour de la Lune pour Endymion) quil traduit ici par le fait que le
jeune homme est devenu le roi de la Lune. Cependant, les autres habitants
dcrits par Lucien ne sont des personnages ni mythologiques ni historiques
ni jouissant dune quelconque notorit; du reste, ils ne sont dsigns que
par des termes gnriques et ne sont nullement individualiss. Ce qui
caractrise leurs particularits, cest, en premier lieu, quelles sont tranges,
ce qui justifie la tenue dun discours ethnographique ce moment-l. Les
Sur le type de cohrence que
Lucien met en place dans les
Histoires vraies, voir Gassino,
2010.
30
II 12 : Il ny a chez eux ni
de nuit, ni de plein jour ; cest
comme la lueur qui prcde
laurore, avant le lever du soleil
: cest cette sorte de lumire qui
baigne leur terre.
31
II 32 : Peu aprs apparut,
proximit, lle des Songes,
quon voyait et distinguait mal
; elle-mme se comportait un
peu comme les songes, car
elle sloignait quand nous
approchions, elle nous esquivait
et reculait.
32
Voir Les Travaux et les Jours,
108-126.
33
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
51
Isabelle Gassino
Lunaires suscitent indubitablement la curiosit, et mme si la vie quils
mnent ne peut tre assimile un ge dor, il nen est pourtant pas moins
vrai quon y trouve les lments dun mode de vie idalis, dans lesquels on
peut voir les prmices dune utopie.
En effet, cet espace o les besoins sont naturellement peu nombreux
est peut-tre la matrialisation dun rve de puissance (les Lunaires,
comme les dieux, auraient moins de besoins que les humains parce quils
sont plus puissants queux), mais peut-tre aussi la ralisation dun idal
philosophique. En effet, plusieurs reprises, dans dautres opuscules34,
Lucien dnonce les excs des riches, qui se gorgent de choses inutiles et
vivent dans un luxe tapageur dont le seul but est de les faire remarquer et
de susciter lenvie chez les plus pauvres queux. Peut-tre y a-t-il, dans cette
socit lunaire, quelque chose qui les rapproche des dieux, mais aussi de la
socit que Lucien, idalement, appellerait de ses vux; une socit do,
certes, les pauvres ne sont pas absents, comme nous lavons vu (I 25), mais
o les occasions de faire talage de ses richesses sont rduites du simple
fait que les besoins vitaux le sont. Nanmoins, on ne trouve pas dexpos
suivi qui manifesterait clairement les prfrences de lauteur; tout au plus
des descriptions pittoresques de nature distraire le lecteur et susciter
ventuellement un dbut de rflexion de sa part.
III. Lhritage de Lucien: le voyage imaginaire comme art du dtour
Labsence dun contenu didactique directement perceptible ne
signifie pas quil ny ait rien retenir du texte; noublions pas que Lucien le
destine un public de lettrs, capable de saisir ce qui nest que sous-jacent.
Sur ce point, More fait cho Lucien lorsquil dit:
Vous parlez des hommes imbus de principes contraires aux vtres; quel
cas feront-ils de vos paroles si vous leur jetez brusquement la tte la
contradiction et le dmenti? Suivez la route oblique, elle vous conduira plus
srement au but. Sachez dire la vrit avec adresse et propos (More, 1976,
p. 105).
Voir notamment les Ftes
de Cronos et le Nigrinos (en
particulier 13 et 21-23).
34
Voir Cyrano de Bergerac,
1970, p. 58.
35
52
Ces termes rsument bien ce que les voyages imaginaires modernes
dans leur ensemble ont retenu de Lucien: la manire la plus efficace de dire le
vrai nest pas la plus directe mais passe par un dtour, au sens propre comme
au sens figur, par un sjour en terre trangre. Lapproche dune ide neuve,
par dfinition trangre aux catgories familires, se fait de manire plus
efficiente dans un cadre galement neuf et, proprement parler, tranger. Il
est trs significatif, cet gard, que le motif du monde lenvers soit prsent
dans de nombreux textes: ainsi, le monde de la Lune de Lucien est repris par
Cyrano de Bergerac dans son Voyage dans la Lune, o les habitants ont des
corps impalpables35 (comme les Lunaires de Lucien se dissolvent aprs leur
mort, cf. I, 23) et se nourrissent eux aussi de fume. La Lune apparat aussi
chez Swift, lorsque les Lilliputiens mettent en doute le fait que le narrateur
puisse venir d'un point de la terre peupl d'hommes de sa taille: "[Nos
philosophes] croiraient plutt que vous tes tomb de la Lune ou de quelque
toile (1991, p. 69)." La Lune constitue donc par excellence un monde la
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
Fiction, parodie et utopie: les Histoires vraies de Lucien
fois tranger (le narrateur est source d'un tonnement sans bornes de la part
des Lilliputiens, cause de sa taille dmesure), et familier (le narrateur
n'est pas d'une nature foncirement diffrente de celle de ses htes; il n'y a
pas de diffrence physiologique fondamentale entre eux, contrairement ce
qui se passe entre les Lunaires et les voyageurs des Histoires vraies). Chez
Cyrano galement, il y a cette ambigut: la Lune est l'envers de la terre,
avec ce que cela comporte d' la fois trange et familier: "Je crois () que la
Lune est un monde comme celui-ci, qui le ntre sert de Lune" dclare le
narrateur au tout dbut de son rcit (1970, p. 31).
Cette rencontre de ltranget initie une mise en scne de la
relativit des points de vue. Si les Histoires vraies sont remplies dtres et de
phnomnes extra-ordinaires, il arrive que le narrateur et ses compagnons
suscitent eux aussi ltonnement36: les voyageurs rencontrent des hommesnavires qui eux-mmes "regardaient, tout tonns, la forme de notre bateau
et nous examinaient sous toutes les coutures" (II 45). Ce thme est repris et
dvelopp chez Cyrano, o l'on voit le narrateur en butte aux prjugs que
les habitants de la Lune nourrissent son gard (les hommes marchant
quatre pattes tant rputs suprieurs ceux qui se tiennent debout, il est
pris pour un animal et mis en cage37). Cette mme notion de relativit des
points de vue est reprise chez Swift en de nombreuses occasions; c'est mme
l'un des fondements du texte, puisque dans les deux premiers voyages, le fait
majeur est la taille des habitants de Lilliput tout d'abord, de Brobdingnag
ensuite.
Dans l'Utopie, enfin, on peut observer de nombreux traits incongrus
dans les murs des habitants, qui prennent le contre-pied des ides reues
l'poque de Thomas More; on peut citer ce propos les positions affiches
sur la religion (p. 146 sqq.), sur la mort (p. 161) ou encore sur le mariage
(p. 162 sqq.). Comme chez Swift, le dcalage entre la vision habituelle des
choses et celle qu'en ont les Utopiens est traite sur le mode comique: on
voit en effet les habitants de l'le commenter la trop grande finesse des
chanes d'or que portent ceux qu'ils prennent pour des esclaves que l'on
aurait ainsi entravs (p. 142 sqq.).
Les textes de More, Swift et Cyrano sont, littralement, des
"paraboles", cest--dire des manires dtournes de dire quelque chose
qui n'a rien de futile. Le motif du voyage imaginaire fait surgir un monde
autre, qui jette sur le ntre un regard aussi surpris que peut l'tre le ntre
sur lui: l'important rside dans le changement de point de vue qui est ainsi
introduit, qui ouvre la voie une volution des esprits et un renouveau de
la vision du monde. Le voyage est donc la dcouverte de nouveaux horizons,
non seulement gographiques, mais aussi intellectuels; il est tout fait
remarquable, cet gard, de constater que les hros de Swift et de More
voyagent en emportant avec eux leurs livres favoris: Raphal Hythloday38
fait don de la bibliothque qu'il transportait avec lui aux Utopiens, et Lucien
figure en bonne place (en seconde position derrire Plutarque) parmi leurs
auteurs prfrs. Le voyage nest pas un simple ornement, il nest pas la
ncessaire touche dexotisme destine faire passer la potion amre de la
leon de politique illustre; il nest pas un banal artifice de prsentation,
36
Voir Sad, 1994.
Voir Cyrano, op. cit., p.
65-66.
37
38
Voir lUtopie, 1976, p. 158.
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
53
Isabelle Gassino
mais le dtour ncessaire, la trajectoire parabolique qui mnera lesprit
humain, plus srement que ne le ferait la route droite, dcouvrir le vrai;
car ce processus implique de se dfaire de ses habitudes, de se dcentrer,
dobserver lautre pour mieux se percevoir soi-mme et son semblable.
Conclusion: les Histoires vraies et lUtopie
Lauvergnat-Gagnire p.
58-86.
39
40
Cf. The Yale edition of
complete works of St Thomas
More, vol. 3, premire partie, p.
xliii de l'introduction de Craig
Thompson.
Voir la lettre-prface aux
traductions de Lucien adresse
Th. Ruthall, in Thompson,
1974.
41
54
Les Histoires vraies sont donc, par certains aspects, la concrtisation
dun idal littraire et culturel, mais aussi la ralisation de quelques-uns des
plus vieux rves de lhumanit. On a vu, dune part, que Lucien considrait
le sujet quil traitait comme "non indigne des Muses" (I 2) et que, sil visait
fournir une dtente aux gens de lettres, la dtente mme ntait pas
considrer comme un moment sans importance. Mais peut-on dire pour
autant que Lucien avait lambition de faire de cette bauche dutopie un
modle, comme lest la rpublique labore par Platon (paradeigma)? Y a-til la moindre vise didactique dans son propos?
Le propos de Lucien est avant tout parodique et comique; il fait rire
mais ne propose pas de modle proprement parler; sil rve parfois ce
que pourrait tre une humanit dlivre des contraintes qui psent sur elle
notamment de celles qui concernent la gnration et la nourriture il
ne se fait jamais le chantre dune forme dorganisation sociale permettant
laffranchissement de ces contraintes. Il se borne distiller quelques ides
qui, sait-on jamais, pourront fconder les ttes bien faites auxquelles le texte
est destin.
Mais, comme on le sait, il y a parfois loin du projet dun auteur sa
rception. Le XVIe sicle en particulier a apprci Lucien pour son humour
et sa verve, mais aussi pour les prceptes moraux que ses textes pouvaient
facilement venir illustrer39 chose qui, autant quon puisse linfrer de ses
crits, lui tait parfaitement trangre; ainsi, sa manire de tourner les dieux
en ridicule permettait denseigner la mythologie aux enfants sans prsenter
la religion grecque sous un jour trop favorable dont le dogme chrtien aurait
pu ptir.
More, de son ct, juge que le principal mrite de l'uvre de Lucien
rside dans l'effet proprement salutaire que peut produire la lecture de ses
textes40; le plaisir de la lecture n'a pas de valeur particulire s'il est purement
gratuit, mais il doit enseigner quelque prcepte moral pour tre valide. Il
est clair en effet que Lucien n'exclut pas qu'un texte de fiction puisse avoir
un intrt autre que la simple distraction: son jugement sur Iamboulos,
dont les mensonges vidents "ne manquent pas de charme" vaut aussi bien
pour les Histoires vraies. Que le texte nait aucune apparence didactique
nempche pas quil puisse tre galement destin nourrir une rflexion
srieuse, sur lorganisation de la socit par exemple. Cest mme tout fait
caractristique des textes de Lucien que de rvler une grande complexit
sous les dehors dune aimable dsinvolture. Comme le dit Thomas More,
"uoluptatem cum utilitate coniunxerit41", "il a joint le plaisir lutilit". Cette
formule, il convient, de notre point de vue, de la garder toujours prsente
lesprit quand on lit Lucien: car, sil est toujours plaisant, il est galement
toujours prendre au srieux.
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
Fiction, parodie et utopie: les Histoires vraies de Lucien
Bibliographie
N.B.: Il nexiste pas de traduction franaise rcente de lensemble des textes
de Lucien. Pour le texte grec et la traduction des Histoires vraies, on pourra
utiliser ldition de J. Bompaire et A.-M. Ozanam mentionne ci-dessous,
ou celle de J. Bompaire parue dans la Collection des Universits de France
(Lucien, uvres t. 2, Paris, 1998). Concernant les autres opuscules auxquels
nous avons fait rfrence, le Nigrinos figure dans le tome 1 de la mme
collection (Paris, 1993), et lIcaromnippe dans le tome 3 (Paris, 2003); pour
les Ftes de Cronos, on se reportera la traduction dE. Chambry (Lucien de
Samosate, uvres compltes, Paris, Garnier, 1933) et au texte grec tabli par
M. McLeod, dans la collection Oxford Classical Texts.
BOMPAIRE, J. Lucien crivain, imitation et cration. Paris: Belles Lettres,
1958.
BOMPAIRE, J. (ed.). Lucien, uvres, tome 2. Paris: Belles Lettres, CUF,
1998.
BOMPAIRE, Bompaire, J. et OZANAM, A.-M. (ed.). Lucien, Voyages
extraordinaires. Paris: Belles Lettres, 2009.
BRANDO, Jacyntho Lins. A potica do hipocentauro. Literatura, sociedade
e discurso ficcional em Luciano de Samsata. Belo Horizonte: UFMG,
2001.
BRANDO, Jacyntho Lins. Antiga Musa. Arqueologia da fico. Belo
Horizonte: UFMG, 2005.
BRIAND, M. "Lucien et Homre dans les Histoires vraies: pratique et
thorie de la fiction au temps de la Seconde Sophistique". In: Lalies, 25,
2005, p. 127-140.
CANFORA, L. Histoire de la littrature grecque lpoque hellnistique.
Trad. par Marilne Raiola et Luigi-Alberto Sanchi. Paris-Arles:
Desjonqures-Harmonia mundi, 2004.
CASEVITZ, Michel (ed.). Naissance des dieux et des hommes. Paris: Belles
Lettres, 1991.
BERGERAC, Cyrano de. Voyage dans la Lune (l'Autre Monde ou les Etats et
Empires de la Lune). Paris: Garnier-Flammarion, 1970.
ESPELOSN, J. Gmez. "Luciano y el viaje: una estratega discursiva".
In: Lucian of Samosata, Greek writer and Roman citizen (F. Mestre et P.
Gmez ed.). Barcelone: Universitat de Barcelona, 2010, p. 169-182.
FREDERICKS, S. "Lucians True History as SF". In: Science Fiction Studies,
3.1, 1976, p. 49-60.
FUSILLO, M. "Le miroir de la Lune". In: Potique, 73, 1988, p. 109-135.
GASSINO, I. "Par-del toutes les frontires: le pseudos dans les Histoires
vraies de Lucien. In: Lucian of Samosata, Greek writer and Roman citizen
(F. Mestre et P. Gmez ed.), Barcelone: Universitat de Barcelona, 2010,
p. 87-98.
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
55
Isabelle Gassino
GASSINO, I. "Les Histoires vraies de Lucien: de la parodie au manifeste",
paratre dans le volume Prsence du roman grec et latin, collection
Caesarodunum (Centre de recherches Andr Piganiol-Centre de
recherches sur les civilisations de lAntiquit de lUniversit de
Clermont-Ferrand). (a)
GASSINO, I. "Les principes de la narration dans les Histoires vraies", article
paratre dans le Bulletin de lassociation Guillaume Bud. (b)
GRIMAL, P. Romans grecs et latins. Paris: Gallimard, 1958.
LAUVERGNAT-GAGNIRE, Ch. Lucien et le lucianisme en France au
XVI sicle. Genve: Droz, 1988.
MORE, Thomas. L'Utopie. Traduction Victor Stouvenel, revue et corrige
par Marcelle Bottigeli-Tisserand. Paris: Editions Sociales, 1976.
QUARTA, C., "Lutopia come progetto e processo storico: dallet antica
allalto Medioevo". In: Morus Utopia e Renascimento, 2, 2005, p. 185207.
ROBINSON, Christopher. Lucian and his influence in Europe. London:
Duckworth, 1979.
RIBEIRO, A. C. R. "O andrgino, o hermafrodita, o canibal e o selvagem:
habitantes de terras utpicas". In: Morus Utopia e Renascimento, 3,
2006, p. 266-275.
SAD, S. "Lucien ethnographe". In: Lucien de Samosate (A. Billault ed.).
Lyon, Paris: Universit Jean Moulin/de Boccard, 1994, p. 149-170.
SURTZ, E. et HEXTER, J. H. (ed.). The complete works of St Thomas More,
vol. IV. New Heaven & Londres: Yale University Press, 1965.
SWIFT, Jonathan. Voyages de Gulliver. Traduit et annot par J. Pons. Paris:
Gallimard, 1991.
THOMPSON, C. R. (ed.). The complete works of St Thomas More, vol. III,
1. New Heaven & Londres: Yale University Press, 1974.
SARGENT, L. T. "What is utopia?". In: Morus Utopia e Renascimento, 2,
2005, p. 153-160.
56
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
Fiction, parodie et utopie: les Histoires vraies de Lucien
Fiction, parody and utopia:
the True Stories by Lucien
Isabelle Gassino
Abstract
Lucien's True Stories inspired many imaginary travelers' tales and are
considered as a possible source of More's Utopia. We aim to analyze the nature
of the True Stories, the status of fiction, and how Lucien organizes his narrative.
How does the fact that they are traveler's tales influence the text and those who are
inspired by it? On the other hand, the True Stories are also a place where the Greek
myths come (back) to life and where the dreams of an entire civilization find a form
of expression. In this sense, they are what we call a literary utopia, even though
Lucien doesn't value his text as a model and thus doesn't make it a utopia in the
Platonic and Morian sense.
Key-words
Lucien of Samosate, True Stories , utopia fiction, travel.
MORUS - Utopia e Renascimento, n. 7, 2010
57
Vous aimerez peut-être aussi
- Livre Recettes Textures Modifiees - Robot CoupeDocument52 pagesLivre Recettes Textures Modifiees - Robot CoupeTeddy30Pas encore d'évaluation
- Thanatologie QCM MEDECINEDocument22 pagesThanatologie QCM MEDECINEKader KaderPas encore d'évaluation
- Temps D'usinageDocument4 pagesTemps D'usinageIadh Triaa88% (8)
- Feuille Dépouillement Chrono+catalogue de Temps LinderDocument9 pagesFeuille Dépouillement Chrono+catalogue de Temps LinderAbou YossriPas encore d'évaluation
- Pessah 2013: Liste Des Médicaments, Produits de Beauté Et Enfants AutorisésDocument16 pagesPessah 2013: Liste Des Médicaments, Produits de Beauté Et Enfants AutorisésJudaismePas encore d'évaluation
- Menu - Carte Boissons - Mars 2023Document6 pagesMenu - Carte Boissons - Mars 2023karam_g_eliePas encore d'évaluation
- LES SOL COMPRESSIBLE Kawtar El GuessabiDocument14 pagesLES SOL COMPRESSIBLE Kawtar El Guessabikaoutarelguessabi7Pas encore d'évaluation
- Manuel CompletDocument8 pagesManuel CompletMater Admirabilis100% (1)
- Le Contrat de Transport MaritimeDocument9 pagesLe Contrat de Transport Maritimejihane amraniPas encore d'évaluation
- Sdmo J30uDocument1 pageSdmo J30uEdward EncarnacionPas encore d'évaluation
- Sefi FluidesDocument39 pagesSefi FluidesNicolas AguilarPas encore d'évaluation
- Chapitre VII Viande-Production Et TransformationDocument18 pagesChapitre VII Viande-Production Et TransformationGedion DouaPas encore d'évaluation
- Rapport Stage - CosumarDocument37 pagesRapport Stage - CosumarEssoulahi EssoulahiPas encore d'évaluation
- 3.XIX V.Hugo NDdeParisDocument28 pages3.XIX V.Hugo NDdeParisMoni SfarleaPas encore d'évaluation
- Pharmacologie OrthopedieDocument26 pagesPharmacologie OrthopedieAlphaPas encore d'évaluation
- Économie Monétaire s3 ''Document87 pagesÉconomie Monétaire s3 ''Ziko Ezza100% (1)
- projetTP2012-Commande Ascenseur PDFDocument29 pagesprojetTP2012-Commande Ascenseur PDFNadhir Brahem100% (3)
- Yo YoDocument3 pagesYo YoNadhmi AchouriPas encore d'évaluation
- Sémiologie Du Syndrome de SevrageDocument5 pagesSémiologie Du Syndrome de SevrageNarimeneKahloulaPas encore d'évaluation
- Beton Arme Cours Complet Chap08 PDFDocument48 pagesBeton Arme Cours Complet Chap08 PDFTOVIHO SessinouPas encore d'évaluation
- Togo BAC Maths C E 2019 PDFDocument3 pagesTogo BAC Maths C E 2019 PDFNAOUNOU75% (4)
- Le Reassureur Africain: Publication de La Societe Africaine de ReassuranceDocument52 pagesLe Reassureur Africain: Publication de La Societe Africaine de Reassuranceoualè yao justin yaoPas encore d'évaluation
- Essai Mars 2023Document16 pagesEssai Mars 2023groupescolaireibnataimran100% (1)
- Formes IndeterminéesDocument2 pagesFormes IndeterminéesGDel kati baPas encore d'évaluation
- Les Mysterieux Sept Tonnerres Dapocalypse 10 2017 PDFDocument40 pagesLes Mysterieux Sept Tonnerres Dapocalypse 10 2017 PDFYannick MBARGAPas encore d'évaluation
- L'Histoire de L'algérie Racontée À (... ) Drohojowska Antoinette-Joséphine-Françoise-Anne Bpt6k57886436Document392 pagesL'Histoire de L'algérie Racontée À (... ) Drohojowska Antoinette-Joséphine-Françoise-Anne Bpt6k57886436Jemel BoumazaPas encore d'évaluation
- These PDFDocument150 pagesThese PDFkmeriemPas encore d'évaluation
- Naturopathie Module 14Document18 pagesNaturopathie Module 14crom 74 HSPas encore d'évaluation
- EPREUVE DE Circuit Analogique&Numer - Séq4-2012Document5 pagesEPREUVE DE Circuit Analogique&Numer - Séq4-2012ensetasse100% (1)
- Techniques Du Corps MaussDocument8 pagesTechniques Du Corps MaussTaniaPas encore d'évaluation