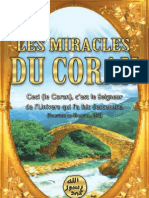Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
24beland PDF
24beland PDF
Transféré par
amine1331Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
24beland PDF
24beland PDF
Transféré par
amine1331Droits d'auteur :
Formats disponibles
« Tout n’est pas possible » : herméneutique et perspectivisme
par Martine Béland
Un lecteur pourrait s’étonner de la quasi-absence de Nietzsche dans L’universalité de
l’herméneutique, le maître ouvrage de Jean Grondin, qui retrace la théorie de l’interprétation
et la question de la conscience historique depuis le romantisme allemand. Ce lecteur sera plus
encore frappé par quatre mots du deuxième paragraphe, « Nietzsche, le premier
panherméneute ». Ces mots font différentes choses. De prime abord, ils qualifient Nietzsche.
Or, vu la thèse avancée par Grondin sur l’universalité de l’herméneutique, le titre de «
premier panherméneute » devrait être significatif. Ces mots, pourtant, éclipsent Nietzsche :
dans cette histoire de l’herméneutique, qui se propose de préparer une conception
herméneutique de la philosophie, Nietzsche est décidément absent.
Ce constat soulève des questions. Une première concerne la substance de l’affirmation : que
signifie cette qualification de « panherméneute » ? Une seconde, plus importante, interroge sa
présence : comment est-il possible que Nietzsche puisse apparaître dans un tel ouvrage, pour
tout aussi rapidement en disparaître ? Ces deux questions sont évidemment liées : si Nietzsche
est le « premier panherméneute », pourquoi n’occupe-t-il pas un chapitre dans l’histoire (ou
même la préhistoire) de l’herméneutique ?
Nietzsche, « panherméneute »
Des rares passages où Jean Grondin évoque Nietzsche, il ressort clairement qu’il ne le
rattache pas à l’herméneutique méthodologique – à savoir celle qui, avec Schleiermacher,
veillait à définir les règles de l’art de l’interprétation. Bien que Nietzsche ait précisé des règles
de lecture et qu’il ait travaillé à une méthodologie philologique (dans ses cours de rhétorique
ancienne, par exemple), son œuvre publiée ne présente pas de traité proposant une
méthodologie interprétative au sens classique. C’est pourquoi Grondin évoque plutôt
Nietzsche dans le cadre d’une discussion sur l’herméneutique philosophique – à savoir la
réflexion fondamentale sur le phénomène de l’interprétation en fonction de notre historicité et
finitude.
Le nom de Nietzsche revient trois fois dans L’universalité de l’herméneutique. Il s’agit de
courtes mentions où le « perspectivisme généralisé » est identifié à l’un des deux extrêmes de
la théorie de l’interprétation. Rappelons qu’en voyant dans l’historicité « un ressort positif de
l’expérience du vrai », l’herméneutique philosophique, suivant Jean Grondin, occupe « une
position intermédiaire » entre le positivisme et la déconstruction derridienne. Le positivisme
postule la possibilité d’un accès pur au sens transmis par le texte (c’est-à-dire l’accès pur à
une « vérité définitive », entreprise qui demande une méthode), tandis que la déconstruction
cherche à « maintenir l’universalité du perspectivisme que Nietzsche a imprégné à la
conscience philosophique ». Ce « déconstructivisme » débouche sur « une destruction du
concept de vérité » et ainsi, sur le « relativisme nihiliste » dont Grondin souhaite montrer
qu’on ne peut l’associer à l’herméneutique sous peine de malentendu : « Taxer de relativisme
la compréhension à chaque fois “autre”, parce qu’enracinée en des individus différents, c’est
en rester à une perspective purement externe. » Externe, ici, signifie externe au texte : il
s’agirait d’une perspective purement subjective, celle de l’interprète lui-même – plutôt que de
la perspective interne, celle de l’auteur, qui est condition de possibilité de l’objectivité. En
bref, en entraînant la déconstruction de l’idée même de vérité, le perspectivisme généralisé
entraînerait le relativisme et empêcherait du coup la possibilité même de l’atteinte du sens.
L’objet qu’est le texte ne pourrait alors plus offrir de « “résistance” aux interprétations qu’on
pourrait vouloir en donner ».
Vous aimerez peut-être aussi
- Géometrie SacréeDocument49 pagesGéometrie SacréeElie Désiré100% (1)
- Clubs FRANCEDocument33 pagesClubs FRANCEtomato1983100% (4)
- Les Miracles Du CoranDocument123 pagesLes Miracles Du CoranAmine BejaouiPas encore d'évaluation
- Prat Georges - L'Architecture InvisibleDocument161 pagesPrat Georges - L'Architecture InvisibleMercedes Catherine100% (1)
- Cours de MecaniqueDocument104 pagesCours de Mecaniquedoctor_atefPas encore d'évaluation
- Lapensee Hermeneutique - 1Document14 pagesLapensee Hermeneutique - 1amine1331Pas encore d'évaluation
- Du Symbole Selon René GuénonDocument22 pagesDu Symbole Selon René GuénonBelhamissi100% (4)
- Dossier Pédagogique "Astralala"Document53 pagesDossier Pédagogique "Astralala"Cap sciencesPas encore d'évaluation
- Le Paradigme de L Interpretation Chez Schleiermacher Et DiltheyDocument43 pagesLe Paradigme de L Interpretation Chez Schleiermacher Et Diltheyamine1331Pas encore d'évaluation
- Bernard Marillier Le SvastikaDocument98 pagesBernard Marillier Le SvastikaVettonika Sil67% (3)
- ExtraitDocument20 pagesExtraitamine1331Pas encore d'évaluation
- Annales de Phénoménologie #20 2021Document388 pagesAnnales de Phénoménologie #20 2021Alavi AurélienPas encore d'évaluation
- Tetractys Et MedietesDocument60 pagesTetractys Et MedietesGuillaume DenomPas encore d'évaluation
- (Occultisme - Alchimie) Berthelot - Origine de L'Alchimie Et Des Sciences MystiquesDocument7 pages(Occultisme - Alchimie) Berthelot - Origine de L'Alchimie Et Des Sciences MystiquesLokiNegrakerPas encore d'évaluation
- Sommaire RsDocument17 pagesSommaire RsAnouhianouhi AnouhiPas encore d'évaluation
- Jean Greiche HermeneitiqueDocument25 pagesJean Greiche Hermeneitiqueamine1331Pas encore d'évaluation
- Augustin Et L Ethique de L InterpretationDocument15 pagesAugustin Et L Ethique de L Interpretationamine1331Pas encore d'évaluation
- LE SOLEIL NATUREL - Jacob LorberDocument269 pagesLE SOLEIL NATUREL - Jacob LorberBORIS63% (8)
- Arrété N 704 CotutelleDocument8 pagesArrété N 704 Cotutelleamine1331Pas encore d'évaluation
- Anthropologie Sante Au QCDocument41 pagesAnthropologie Sante Au QCamine1331Pas encore d'évaluation
- Anthropologie Sante Au QCDocument41 pagesAnthropologie Sante Au QCamine1331Pas encore d'évaluation
- Heritage HermeneutiqueDocument3 pagesHeritage Hermeneutiqueamine1331Pas encore d'évaluation
- Berner Christian ArtDocument3 pagesBerner Christian Artamine1331Pas encore d'évaluation
- Levenement Et Le Monde PDFDocument1 pageLevenement Et Le Monde PDFamine1331Pas encore d'évaluation
- Colloque de Philosophie: Le Sens de L'activité Philosophique en QuestionDocument4 pagesColloque de Philosophie: Le Sens de L'activité Philosophique en Questionamine1331Pas encore d'évaluation
- Statique DynamiqueDocument8 pagesStatique DynamiqueabdennourPas encore d'évaluation
- Modele Projet Memoire Et FormulaireDocument7 pagesModele Projet Memoire Et FormulairemarcoPas encore d'évaluation
- Introduction A La Geom at I QueDocument61 pagesIntroduction A La Geom at I QueSamuel kayomboPas encore d'évaluation
- ILEPHYSIQUE Phys 2 Controle4Document2 pagesILEPHYSIQUE Phys 2 Controle4Moussa BanaPas encore d'évaluation
- Manual Reloj Cat YO 149Multi-ISA-9238-7Document16 pagesManual Reloj Cat YO 149Multi-ISA-9238-7ajrangelnPas encore d'évaluation
- 5.1.5 (Act) Le Syst SolaireDocument1 page5.1.5 (Act) Le Syst Solairefkcxt78m9xPas encore d'évaluation
- 1am FraDocument2 pages1am FrarozitaPas encore d'évaluation
- Le Délire HumainDocument50 pagesLe Délire HumainThom_latulipe100% (2)
- EX StatiqueDocument41 pagesEX StatiqueSiraj ChahbounPas encore d'évaluation
- Tube Sur Une Nappe Que L'on TireDocument2 pagesTube Sur Une Nappe Que L'on TireIngenieur EnsaPas encore d'évaluation
- Siberia ScoreDocument3 pagesSiberia ScoreJuan Ignacio Di PasqualePas encore d'évaluation
- Porro La Causalité Et Son Histoire. Une Bibliographie 2002Document30 pagesPorro La Causalité Et Son Histoire. Une Bibliographie 2002Federico OrsiniPas encore d'évaluation
- Le Tao Te King de Lao TseuDocument77 pagesLe Tao Te King de Lao TseuMackenjPas encore d'évaluation
- Rome Et La Science Moderne - L'héliocentrisme À Rome, À La Fin Du Xviie Siècle - Une Affaire D'étrangers - Publications de L'école Française de RomeDocument19 pagesRome Et La Science Moderne - L'héliocentrisme À Rome, À La Fin Du Xviie Siècle - Une Affaire D'étrangers - Publications de L'école Française de RomeGilbert KirouacPas encore d'évaluation