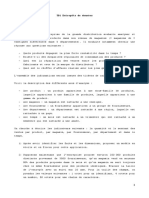Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
L'analyse Préliminaire D'un Projet PDF
L'analyse Préliminaire D'un Projet PDF
Transféré par
Wenceslas ArsèneTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
L'analyse Préliminaire D'un Projet PDF
L'analyse Préliminaire D'un Projet PDF
Transféré par
Wenceslas ArsèneDroits d'auteur :
Formats disponibles
Show
Accueil > Travail de l'ingénieur > Gestion de projet > L‘identification d’un projet > L’analyse préliminaire d’un projet
Publié en mai 2011
L’analyse préliminaire d’un projet
Bien qu’il ne participe pas nécessairement à l’identification d’un projet, lors de la prise en charge, l’ingénieur devrait analyser les divers aspects dont il aura la responsabilité, afin de clarifier les
objectifs du client ainsi que ceux de son entreprise, et s’assurer de sa compréhension des enjeux. En, effet, ces derniers peuvent être négligés dans la fébrilité des activités de démarrage du projet et
les obligations professionnelles quotidiennes. Cette analyse peut être mentale ou écrite, mais dans tous les cas, l’ingénieur devrait s’y astreindre avec rigueur. Elle portera sur l’environnement du
projet, les parties prenantes, les risques et la préfaisabilité. L’utilisation de l’outil appelé cadre logique aidera l’ingénieur à mieux effectuer et synthétiser son analyse avant la mise en forme au moyen
du Mémoire d’identification de projet (MIP).
L’analyse de l'environnement
Tout projet se déroule dans un environnement qui peut être complexe et varier d’un projet à un autre. Par exemple, un projet exécuté dans un milieu syndiqué ne sera pas géré de la même façon
qu’un projet issu d’un cadre de travail non syndiqué. Avant de commencer le projet, le gestionnaire analysera de manière exhaustive son environnement et celui du projet, afin d’en comprendre les
enjeux et les contraintes potentielles.
Dans son édition 2004 du PMBOK®, le Project Management Institute (PMI) énumère trois types d’environnement :
l’environnement culturel et social;
l’environnement international et politique;
l’environnement physique.
Bien que ces trois catégories englobent la majorité des environnements d’un projet, il est de la responsabilité de l’ingénieur gestionnaire de bien définir ceux de son projet.
O’Shaughnessy (1992), pour sa part, définit l’environnement interne et externe du projet. L’environnement interne fait référence aux diverses variables de l’organisation d’où est issu le projet, alors que
l’environnement externe touche aux variables qui sont indépendantes de la volonté de l’entreprise et qui peuvent influencer la bonne marche du projet. Le tableau 1 résume la pensée de cet auteur.
Tableau 1 : Les principales composantes de chaque environnement selon O’Shaughnessy (1992)
Figure 11 : Un exemple de document type pour une analyse de l’environnement d’un projet10
Tableau 2 : Un exemple d’analyse de l’environnement d’un projet de déplacement d’une entreprise11
L’analyse des partie prenantes
Le gestionnaire de projet doit aussi s’assurer de bien connaître toutes les parties prenantes du projet. Une partie prenante est ainsi définie par le PMI (2004) : « les personnes et les organisations
activement impliquées dans le projet. Elles peuvent aussi influencer les objectifs et les résultats du projet. L’équipe de management de projet doit identifier ces parties prenantes, déterminer leurs
exigences et leurs attentes et, dans la mesure du possible, gérer leur influence par rapport aux exigences de façon à assurer le succès du projet. » D’autres méthodes peuvent être utilisées, comme
celle proposée par ProjectWare (figure 12) ou encore pour un projet de déplacement d’une entreprise (tableau 3).
Figure 12 : Un exemple d’analyse des parties prenantes par ProjectWare
Tableau 3 : Un exemple (partiel) d’analyse des parties prenantes pour un projet de déplacement d’une entreprise
La gestion du risque
Durant la phase d’identification, l’analyse du risque demeure au stade préliminaire. Le gestionnaire de projet effectuera une analyse des risques plus approfondie lors de la planification détaillée du
projet. Cependant, il doit cerner dès le départ les principaux risques du projet, et ce, de façon aussi rigoureuse que durant la phase de définition, même s’il ne possède pas toute l’information
nécessaire pour une analyse plus poussée. Il est clair qu’elle sera bonifiée au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles ou découvertes. Le cadre logique apporte un premier
éclairage sur les risques en repérant les conditions critiques du projet. Cependant, pour la planification détaillée, cette première analyse devient rapidement dépassée.
Le PMI définit le risque comme étant « un événement ou situation dont la concrétisation, incertaine, aurait une incidence positive ou négative sur les objectifs du projet ». Le PMBOK® établit des
catégories de risques et une structure de découpage des risques, selon leurs origines : techniques, externes, organisationnels, environnementaux ou de gestion du projet. La figure 1312 illustre un
exemple de structure de découpage des risques extrait du PMBOK®.
Figure 13 : Un exemple de structure de découpage des risques
Toujours selon le PMBOK®, on distingue l’analyse quantitative de l’analyse qualitative du risque. La première analyse évalue la gravité du risque et la probabilité de modification inhérente au projet.
Dans la seconde, le gestionnaire veille à la mise en place de mesures de probabilité du risque et de son effet sur le projet. Selon le domaine d’application, il existe un grand nombre d’outils portant sur
la reconnaissance des dangers et des risques associés à un procédé ou à une installation. Lors de l’analyse plus approfondie, l’ingénieur utilisera des méthodes informatiques plus élaborées, comme
les analyses de scénarios, de sensibilités, de simulation Monte Carlo, ainsi que des logiciels, comme Crystal Ball d’Oracle et @Risk de Palisade. L’ingénieur pourra s’approprier le tableau 4, qui porte
sur l’analyse préliminaire du risque en milieu pharmaceutique, et le modifier selon les besoins et l’environnement du projet dont il est responsable.
Tableau 4 : Un exemple d’analyse préliminaire du risque en milieu pharmaceutique
Figure 14 : La définition d’échelles d’impact pour quatre objectifs du projet
Source : PMI, Corpus des connaissances en management de projet, 3e édition (2004) p. 245
La réponse aux risques13
La mise en œuvre de stratégies de réponse est le processus qui consiste à élaborer des solutions et à déterminer des actions visant à susciter les occasions de réduire les menaces qui modifieraient
les objectifs du projet. Elle nécessite l’identification des parties ou des individus auxquels sera confiée la responsabilité de chacune des stratégies de réponse approuvées. Ce processus permet de
s’assurer que les risques repérés seront gérés de façon appropriée. L’efficacité de la planification des stratégies de réponse aura une influence directe sur l’augmentation ou la baisse du niveau global
de risques du projet.
Plusieurs stratégies de réponse sont envisageables. Pour chaque risque, le choix doit porter sur la plus efficace selon le contexte, les circonstances, la ou les culture(s) en place (ex. d’entreprise,
professionnelles, locales) ou tout autre aspect pouvant influer sur le projet et les décisions à prendre. L’ingénieur retiendra essentiellement les quatre stratégies de réponse aux risques suivantes : le
rejet ou l’évitement, le transfert, l’atténuation ou la réduction, et l’acceptation.
Le rejet d’un risque consiste à modifier le plan de projet afin d’éliminer le risque ou la circonstance, ou encore de préserver l’atteinte des objectifs du projet de ses conséquences. Le fait d’opter
pour un type de langage plutôt qu’un autre (ex. C++) pour le développement d’un logiciel, parce que les membres de l’équipe connaissent ce langage, est une stratégie de rejet type.
Le transfert des risques vise à transférer à une tierce partie les conséquences d’un risque et la responsabilité de la stratégie de réponse correspondante. Transférer le risque à une tierce
partie n’élimine pas le risque. Une assurance automobile est l’exemple type de transfert de risque.
La réduction d’un risque a pour objet d’atténuer la probabilité ou les conséquences d’une menace jusqu’à un seuil acceptable. Prendre à temps des mesures visant à réduire la probabilité de
la concrétisation d’un risque ou de son effet sur le projet est plus efficace que d’essayer d’en réparer les conséquences une fois le risque concrétisé. Les coûts de la réduction doivent être
proportionnels à la probabilité du risque et de ses conséquences. Les cautionnements de soumission sont des exemples de réduction de risque.
L’acceptation d’un risque indique que l’équipe de projet a décidé de ne pas modifier le plan de projet pour affronter le risque, ou qu’elle n’est pas en mesure de trouver d’autres stratégies de
réduction convenables. L’acceptation active peut inclure l’élaboration d’un plan de remplacement à mettre en œuvre au cas où un risque devenait réalité.
L’analyse de préfaisabilité
Les études de préfaisabilité et de faisabilité portent essentiellement sur les mêmes variables ou composantes du projet, mais à des niveaux d’analyse qui diffèrent en matière de profondeur ou de
détails, et de l’effort, en heures et en coût financier. L’étude de préfaisabilité consiste à énoncer un ensemble de questions clés, dont les réponses permettront de porter un premier jugement sur le
projet. Cependant, selon O’Shaughnessy (1992, p. 64), il faut rappeler que ce type d’étude a pour principaux objectifs d’analyser de façon non détaillée la faisabilité du projet sous divers angles
(marché, technique, financier, etc.), de cerner les aspects du projet nécessitant une étude approfondie, de déterminer si on doit poursuivre le projet avec ou sans étude de faisabilité, de réviser le
projet s’il y a lieu, ou de décider de l’abandonner à ce stade. Il est clair cependant que l’ingénieur ne sera pas appelé à exécuter certaines analyses qui n’entrent pas dans son champ de compétence.
En sa qualité de professionnel, l’ingénieur doit être ouvert à un questionnement afin de mieux comprendre les raisons qui ont conduit à la réalisation du projet. Ce questionnement ne peut qu’être
avantageux et sain pour le succès du projet, ne serait-ce que pour mieux définir les besoins du client.
Préfaisabilité de marché ou des services
Le produit ou le service déterminé est-il le bon produit, répond-il aux besoins et aux exigences du client?
Le produit ou le service est-il clairement défini, et le client approuve-t-il sa définition?
Dans un environnement de production donné, le marché peut-il absorber une quantité raisonnable de ce genre de produit ou service pour le promoteur?
À quel prix peut-on espérer vendre le produit ou le service, et quelle sera l’évolution du marché?
Est-ce que tous les participants ont la même compréhension du projet?
Préfaisabilité technique
Le projet fait-il appel à une technologie connue et maîtrisée ou faut-il d’abord maîtriser la technologie proposée?
Le projet est-il techniquement réalisable?
Les ressources techniques nécessaires pour l’exécution du projet sont-elles disponibles?
Le personnel est-il convenablement formé pour la technologie proposée?
Le calendrier d’exécution est-il réaliste et les ressources humaines sont-elles disponibles durant les périodes de réalisation du projet?
Quelles sont les conséquences du projet sur le fonctionnement actuel de l’entreprise?
Préfaisabilité économique et financière
Les estimations préliminaires du projet sont-elles réalistes?
Les revenus projetés sont-ils réalistes comparativement à ce qui a été réalisé dans le passé?
Quels sont les flux monétaires préliminaires du projet?
Une analyse financière préliminaire a-t-elle été réalisée?
Divers scénarios financiers ont-ils été élaborés?
Comment le projet sera-t-il financé?
Quelles sont les perspectives de rentabilité du projet, à court, moyen et long termes?
Préfaisabilité sociopolitique
L’entreprise dispose-t-elle des ressources humaines nécessaires à l’exécution du projet?
Quelles sont les possibilités de recrutement dans les domaines visés en cas de manque de ressources, à court, moyen et long termes?
Préfaisabilité institutionnelle et légale
Quels sont les règlements, les lois et les us et coutumes (éthique, culture professionnelle et d’association) qui régissent la réalisation du projet?
Préfaisabilité organisationnelle
L’entreprise dispose-t-elle de l’organisation appropriée pour la réalisation du projet?
Selon le financement prévu, sera-t-il nécessaire d’approcher des partenaires?
Comment un partenariat serait-il perçu par les dirigeants de l’entreprise?
Préfaisabilité environnementale
Le projet a-t-il un impact social?
Quel sera l’effet sur l’organisation?
Existe-t-il des normes environnementales et sociales pouvant empêcher ou menacer les objectifs du projet?
Si le projet se réalise sur un site autre que celui où œuvre l’entreprise, existe-t-il des contraintes environnementales ou sociales qui peuvent nuire au projet?
Le cadre logique
La méthode du cadre logique est un outil qui permet de synthétiser les données connues d’un projet. Il existe plusieurs modèles, dont celui élaboré par l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) (voir La méthode du cadre logique de l’ACDI). Le tableau 5 propose une explication de la matrice du cadre logique. Nous reconnaissons que cette méthode peut comporter
certaines faiblesses, mais elle demeure un point de départ et une excellente réflexion sur les grands enjeux du projet.
Tableau 5 : Les détails de la matrice du cadre logique
Vous aimerez peut-être aussi
- TDR - SMQ ISO 9001 IPT 1601 PDFDocument12 pagesTDR - SMQ ISO 9001 IPT 1601 PDFRim OUACHANIPas encore d'évaluation
- Old Age Support Ratio 812011041P1G018Document40 pagesOld Age Support Ratio 812011041P1G018doudyscribdPas encore d'évaluation
- Correction Exercice 3Document2 pagesCorrection Exercice 3Khalid Ediani100% (1)
- Mensuel Reussir Mars 2020Document52 pagesMensuel Reussir Mars 2020CheikhPas encore d'évaluation
- Ode CguDocument9 pagesOde CguKrabePas encore d'évaluation
- Commissariat Aux ComptesDocument28 pagesCommissariat Aux ComptesSnoussi OussamaPas encore d'évaluation
- Placement NCT 21 AssuranceDocument7 pagesPlacement NCT 21 AssuranceZied BouraouiPas encore d'évaluation
- PMToR (Full) OD511 (FR) v1.4Document6 pagesPMToR (Full) OD511 (FR) v1.4cedricgauryPas encore d'évaluation
- Oh 05 Bis Dalot 1x200x150 Seguela ToubaDocument8 pagesOh 05 Bis Dalot 1x200x150 Seguela ToubaChristian Dorian BouaPas encore d'évaluation
- Le Transport Des ObligationsDocument4 pagesLe Transport Des ObligationsOth ManPas encore d'évaluation
- La Criminologie CritiqueDocument13 pagesLa Criminologie Critiquesouhaila elfaizPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Coutumier g2Document14 pagesCours de Droit Coutumier g2f9gvrzs6f9Pas encore d'évaluation
- Cah Charge Tabac FRDocument3 pagesCah Charge Tabac FRRed cubePas encore d'évaluation
- Methodologie Du Droit UCAO 2Document19 pagesMethodologie Du Droit UCAO 2Emmanuel coffee 7Pas encore d'évaluation
- Principles and Guidelines FrenchDocument24 pagesPrinciples and Guidelines FrenchKANGAPas encore d'évaluation
- Resumé CB PPDocument98 pagesResumé CB PPAbdessamad El JeraouiPas encore d'évaluation
- Charte de Vie de ClasseDocument1 pageCharte de Vie de ClasseSanae CharhouriPas encore d'évaluation
- TD1 EntrepôtsDocument4 pagesTD1 EntrepôtsMoussango Edimo GeorgesPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture - La Ferme Des AnimauxDocument5 pagesFiche de Lecture - La Ferme Des AnimauxrosePas encore d'évaluation
- L1S1 - Histoire Economique Et Sociale de L Europe - TD 2Document15 pagesL1S1 - Histoire Economique Et Sociale de L Europe - TD 2SeidaíPas encore d'évaluation
- OptimisationDocument83 pagesOptimisationEconomiste ComptaPas encore d'évaluation
- El Sexto (Arguedas, José Maria)Document196 pagesEl Sexto (Arguedas, José Maria)ADRIANA NICHOLE CHUQUIRIMA JUAREZPas encore d'évaluation
- Palmier ProfilDocument2 pagesPalmier ProfilMohamed GoumanehPas encore d'évaluation
- Contexte Historique Exemples M. Ndour 2023Document4 pagesContexte Historique Exemples M. Ndour 2023bineta01ndiayePas encore d'évaluation
- Politique Étrangère de La France Depuis 1945 - WikipédiaDocument161 pagesPolitique Étrangère de La France Depuis 1945 - WikipédiaPierre PelloquetPas encore d'évaluation
- Formulaire Demande NIF Personnes Morales Type A FinalDocument3 pagesFormulaire Demande NIF Personnes Morales Type A FinalandyPas encore d'évaluation
- 7-2-Avaries Maritimes Communes ParticulièresDocument9 pages7-2-Avaries Maritimes Communes Particulièrestoavina andriaPas encore d'évaluation
- BO 7192 FRDocument40 pagesBO 7192 FRHamza LoukaimPas encore d'évaluation
- Hypothèque Ou CautionDocument2 pagesHypothèque Ou CautionHajar KhalbiPas encore d'évaluation
- Districts de Côte D'ivoire - WikipédiaDocument4 pagesDistricts de Côte D'ivoire - WikipédiaHady SANOGOPas encore d'évaluation