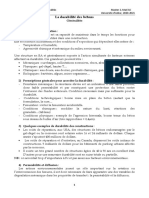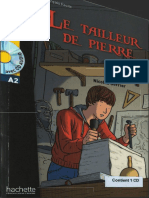Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Paul Ricœur
Paul Ricœur
Transféré par
Franklin SosaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Paul Ricœur
Paul Ricœur
Transféré par
Franklin SosaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Franklin Sosa Théologie Fondamentale Semestre d’automne 2021
— Proséminaire —
INTRODUCTION
La démythologisation est une forme d'exégèse qui décrit les phénomènes miraculeux des textes
sacrés (ex: la bible) comme relevant de la mythologie et cherche à les distinguer de la réalité
factuelle et historique. Cette méthode ne veut pas abolir les éléments surnaturels, comme dans une
position athée, mais les interpréter. Ils répondent en effet à un dessein légitime qui est celui de
témoigner du divin, mais reste une approche maladroite, qui en fausse la portée. Ce type
d'herméneutique s'applique en particulier au Nouveau Testament. Il est illustré notamment par le
théologien et philosophe Rudolf Bultmann (1884-1976).
CORPUS
Ricœur propose qu’il ne faut pas abandonner ce méthode mais il faut savoir comment le mépriser
pour ne pas se faire avoir. Pour pouvoir bien le maitriser, Ricœur classe les différents nivaux de la
démythologisation chez Bultmann en trois. En premier niveau (celle-ci étant la forme la plus
évidente) c’est l’homme lui même qui démythologise. Si on limiterait la démythologisation à ceci,
on ne ferait qu’une interprétation moderne, confondre les choses d’une mentalité ancienne et le
pervertir avec le sens moderne. Ricœur donne une seconde dimension qu’il définit de la manière
suivante: « l’interprétation de la vie se correspondent, la tâche de l’herméneutique est d’amplifier la
compréhension du texte du coté de la doctrine, de la pratique, de la méditation des mystères car
l’Écriture constitue un trésor inépuisable qui donne à penser sur toutes choses, qui recèle une
interprétation totale du monde ». Et enfin le troisième niveau c’est le kérygme lui même. C’est le
noyau de la prédication originaire qui non seulement exige, mais initie et met en mouvement le
procès de démythologisation. En effet saint Paul dit dans que le monde sera sauvé par la µωρία ὁ
κήρυγµα.
CONCLUSION
Cette disponibilité de la foi, Ricœur cherche à la retrouver sur le plan d’une réflexion qui tienne
entièrement compte du rapport paradoxal que le croyant d’aujourd’hui peut entretenir avec la source
de sa croyance. « Pour comprendre le texte, il faut se laisser guider par ce que le texte m’annonce,
mais ce que le texte m’annonce n’est donné nulle part ailleurs que dans le texte; c’est pourquoi il
faut comprendre le texte pour croire ».
Vous aimerez peut-être aussi
- La Très Sainte TrinosophieDocument178 pagesLa Très Sainte TrinosophieAntoine DUPEUXPas encore d'évaluation
- La Villa D'en Face TEXTE INTEGRALDocument8 pagesLa Villa D'en Face TEXTE INTEGRALITPas encore d'évaluation
- Durabilité GénéralitésDocument2 pagesDurabilité GénéralitésMohamed AminePas encore d'évaluation
- Notions D HydrauliqueDocument13 pagesNotions D HydrauliqueMajide MajdPas encore d'évaluation
- RobotDocument2 pagesRobotkopnangPas encore d'évaluation
- La Collaboration de Joe Hisaishi Et de Hayao Miyazaki Dans La Musique Des Films Du Studio GhibliDocument11 pagesLa Collaboration de Joe Hisaishi Et de Hayao Miyazaki Dans La Musique Des Films Du Studio GhibliShiny CheungPas encore d'évaluation
- IpppDocument73 pagesIpppعثمان البريشي100% (1)
- Règle Des 3P - Cas Génériques: Pilote Passage ProximitéDocument1 pageRègle Des 3P - Cas Génériques: Pilote Passage ProximitéhajarbelmPas encore d'évaluation
- TD MX Solaire Serie N°4 Enoncé+SolutionDocument3 pagesTD MX Solaire Serie N°4 Enoncé+SolutionJalal TiYalPas encore d'évaluation
- 583 Hugo HernaniDocument4 pages583 Hugo HernanidhorovskyPas encore d'évaluation
- Manuel Houry-Cinquieme PDFDocument1 041 pagesManuel Houry-Cinquieme PDFimranflePas encore d'évaluation
- Torseur Et Déformation en RDMDocument1 pageTorseur Et Déformation en RDMIzzedine AdjibadéPas encore d'évaluation
- Etablissement Du Tableau Des Flux de TresorerieDocument18 pagesEtablissement Du Tableau Des Flux de TresorerieGamarosse PIERRE100% (1)
- NAO 2020 Dans L'assuranceDocument3 pagesNAO 2020 Dans L'assuranceArgus de l'AssurancePas encore d'évaluation
- Electrolux Four Multifonction Pyrolyse Eec2400box 7332543320981Document28 pagesElectrolux Four Multifonction Pyrolyse Eec2400box 7332543320981tiPas encore d'évaluation
- Nicolas Gerrier - Le Tailleur de Pierre A2Document24 pagesNicolas Gerrier - Le Tailleur de Pierre A2STANISLAV0% (1)
- Umgo Carnet TolerancesDocument54 pagesUmgo Carnet TolerancesAdrohPas encore d'évaluation
- Développement D'un Banc de Validation Des Performances de Différentes Commandes Pour Moteur Asynchrone Via Carte Dspace 1104Document84 pagesDéveloppement D'un Banc de Validation Des Performances de Différentes Commandes Pour Moteur Asynchrone Via Carte Dspace 1104MechernenePas encore d'évaluation
- Ex 5B - Problème Sur La Trigonométrie - CORRIGEDocument8 pagesEx 5B - Problème Sur La Trigonométrie - CORRIGEjulienpinto634Pas encore d'évaluation
- PhilsophieDocument8 pagesPhilsophierafamuller21Pas encore d'évaluation
- Traduction de Noms Des Plantes Aromatiques Du MarocDocument2 pagesTraduction de Noms Des Plantes Aromatiques Du MarocAhmed SeddikiPas encore d'évaluation
- Diviseur de Tension - WikipédiaDocument4 pagesDiviseur de Tension - WikipédiaDaniel tounou100% (1)
- TP03 Et TP04 DosageDocument4 pagesTP03 Et TP04 DosageHawa COULIBALYPas encore d'évaluation
- Les Cultures Sur Buttes PDFDocument8 pagesLes Cultures Sur Buttes PDFerick kitungwa100% (1)
- Comunica RiDocument4 pagesComunica RiIoan PascaPas encore d'évaluation
- 12-98-Générateur HF (2ème Partie)Document7 pages12-98-Générateur HF (2ème Partie)Wed WedPas encore d'évaluation
- PRO11 Traitement Eaux ChaudieresDocument1 pagePRO11 Traitement Eaux ChaudieresEkouna-Kanga JustePas encore d'évaluation
- BH Doc 1268408Document61 pagesBH Doc 1268408Sylvio GraydenPas encore d'évaluation
- Coefficients de Fourier ComplexesDocument3 pagesCoefficients de Fourier ComplexesKamal DehbiPas encore d'évaluation
- CP SGMB T3 19Document2 pagesCP SGMB T3 19Imane BouzidPas encore d'évaluation