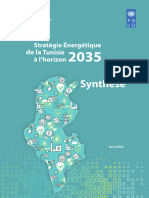Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Apprareilsecuritaireetchangementderegime KBT
Apprareilsecuritaireetchangementderegime KBT
Transféré par
Luz LuzTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Apprareilsecuritaireetchangementderegime KBT
Apprareilsecuritaireetchangementderegime KBT
Transféré par
Luz LuzDroits d'auteur :
Formats disponibles
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/332782081
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire et changement de régime
Article · August 2018
CITATIONS READS
0 537
1 author:
Khansa ben tarjem
University of Lausanne
2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS
SEE PROFILE
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Construction des services de sécurité dans la Tunisie post-coloniale View project
All content following this page was uploaded by Khansa ben tarjem on 01 May 2019.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
12
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire
et changement de régime
Khansa Ben Tarjem
Éclairer le présent sécuritaire par l’héritage répressif
Le 22 janvier 2011, des policiers manifestent, devant le siège du minis-
tère de l’Intérieur, avenue Bourguiba, dans le centre-ville de Tunis,
réclamant la création d’un syndicat et demandant pardon pour avoir été
l’instrument de la répression. Sur les pancartes, on pouvait lire des slogans
tels que « Plus de tyrannie, plus de peur, la police avec le peuple1 ». Pourtant,
sept ans après la fuite de Ben Ali, l’édifice sombre qui abritait différents
services du ministère de l’Intérieur avec ses geôles où des opposants au
régime subissaient des sévices n’a pas changé, les agents en fonction sont
toujours les mêmes, mais le régime politique et l’institution sécuritaire
sont en plein bouleversement. Comment comprendre les transforma-
tions qui affectent le ministère de l’Intérieur ?
Dès l’indépendance, l’appareil sécuritaire (police, Garde nationale,
services de renseignement) acquiert une place centrale dans l’édification
d’un pouvoir politique autoritaire, dont il est devenu le « pivot2 ». Pro-
tégé par un contexte de censure et par un usage démesuré de la notion
de secret3, il se dérobait à l’analyse tout en étant omniprésent. Très peu
1. Observation sur le terrain et archives photos 22 janvier 2011.
2. CAMAU M., GEISSER V., Le syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bour-
guiba à Ben Ali, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.
3. À partir du coup d’État du 7 novembre 1987, et en l’absence d’un système
clair de classification, même les textes légaux qui régissaient l’organisation au sein
229
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 229 06/08/2018 14:47:00
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Tunisie
d’informations étaient disponibles sur ses effectifs ou son fonctionne-
ment. Toutefois, depuis la fuite de Ben Ali, si les archives restent relati-
vement difficiles d’accès, les anciens ministres de l’Intérieur, directeurs de
la Sûreté nationale, cadres ou simples agents du ministère de l’Intérieur
acceptent plus volontiers de témoigner et permettent ainsi de questionner
l’institution sécuritaire. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a rompu
avec la tradition des décrets secrets pour la nomination de ses direc-
teurs établie sous Ben Ali. Désormais, les effectifs des forces de sécurité
intérieure sont publiés dans la loi de finances4 et il existe même un site
internet de « données ouvertes », où l’on peut trouver des statistiques sur
les activités des différentes directions du ministère. Le moment révolu-
tionnaire de 2011 offre ainsi de nouvelles opportunités de recherche per-
mettant d’ouvrir cette boîte noire.
Curieusement, les sept premières années suivant la chute de Ben Ali
nous mettent face à un paradoxe : comment expliquer que l’appareil sécu-
ritaire tunisien, réputé pour sa toute-puissance, se soit révélé inefficace
pour assurer sa mission première : la sécurité de la population. Tout en
continuant à faire un usage disproportionné de la force contre les mouve-
ments sociaux5, il s’est avéré défaillant pour contenir la montée de la vio-
lence salafiste6 et faire face à l’instabilité de la frontière tuniso-libyenne.
Qu’est-ce qui explique qu’une institution réputée « efficace7 » sous un
régime autoritaire, ne le soit plus dans un contexte de libéralisation poli-
tique ? Tout d’abord, la barrière de la peur est tombée. Quant à l’usage
du ministère de l’Intérieur sont tenus secrets, alors que ce n’était pas le cas sous
Bourguiba.
4. Le budget de 2013 publié par le ministère des Finances indique pour la pre-
mière fois les effectifs des forces de sécurité intérieure (FSI) pour l’année 2012. Les
forces de sécurité intérieure sont évaluées à 72 684 agents.
5. Après la dispersion violente des sit-in à la Kasbah 1, 2 et 3 (entre janvier et
juillet 2011), plusieurs manifestations ont été réprimées, que ce soit à Tunis (notam-
ment la manifestation demandant la démission du gouvernement de Beji Caïd
Essebsi, le 6 mai 2011, la marche de l’UGTT le 25 février 2012, la manifestation
du 9 avril 2012, etc.), ou encore en région (à Sidi Bouzid en juillet 2012, à Siliana
novembre 2012, etc.).
6. Ces violences se sont soldées par des assassinats politiques de deux figures de
la gauche radicale en 2013, trois attentats en 2015 au musée du Bardo, à Tunis et à
Sousse, une attaque armée contre la ville frontalière de Ben Guerdane (mars 2016)
et plusieurs affrontements entre les forces de sécurité (armée, police et Garde natio-
nale) et groupes salafistes armés faisant plus de 180 morts dans les rangs des forces de
l’ordre.
7. La réputation des renseignements tunisiens était surtout liée à l’efficacité de
« la police politique ».
230
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 230 06/08/2018 14:47:00
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire et changement de régime
systématique de la violence, il n’est plus admis. Ensuite, la surveillance
généralisée appuyée par les cellules de base du RCD8, les relais dans l’ad-
ministration et le large réseau d’informateurs ont cessé de fonctionner. À
partir de là, nous formulons l’hypothèse que l’affaiblissement de l’appareil
sécuritaire après 2011 est dû en partie à la perte de ses outils d’action
traditionnels et de la force que lui conférait la confusion entre le parti et
l’État. D’où l’intérêt de se demander dans quelles circonstances l’appareil
de sécurité s’est constitué en institution partisane.
Selon notre hypothèse, la première phase de transfert des services de
sécurité des autorités coloniales aux élites nationalistes, à la suite de la
signature des accords d’autonomie interne en 1955, constitue une pierre
angulaire dans le devenir de cette institution. Les premières décisions
prises pour faire face au conflit à l’intérieur du mouvement national ont
généré une dépendance au sentier. Ce moment fondateur marque le
début d’un processus d’assujettissement de l’appareil sécuritaire aux inté-
rêts du régime en place ; un processus qui se renforce progressivement
sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali temps jusqu’à ce qu’il soit
rompu par le moment révolutionnaire de 2011 et l’effondrement du
RCD.
Pour étayer cette hypothèse, nous nous pencherons sur les enjeux du
transfert des pouvoirs de police dans la négociation des accords d’auto-
nomie interne entre les autorités coloniales et les nationalistes d’un côté
et à l’intérieur du mouvement national de l’autre. Ensuite, nous montre-
rons comment le transfert limité des services de sécurité au gouvernement
tunisien à la veille de l’Indépendance l’a placé en situation de dépendance
vis-à-vis de la France. Enfin, nous allons explorer comment la dynamique
de compétition entre les deux factions du mouvement national s’est tra-
duite par une confusion progressive entre les intérêts du parti au pouvoir
et de l’institution sécuritaire.
8. Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) fondé en 1988 est
le parti hégémonique sous le régime de Zine el Abidine Ben Ali. Il est l’héritier du
Parti socialiste destourien, l’ancien Néo-Destour.
231
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 231 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Tunisie
« Tunisifier » la matraque :
un enjeu au cœur de l’autonomie interne
Le maintien de l’ordre dans les négociations
de l’autonomie interne
Un an avant l’indépendance totale, la question des pouvoirs de police
sera au cœur des négociations de l’autonomie interne, et en constituera
la principale pierre d’achoppement. Dans le contexte du protectorat,
l’État colonisé est déchu de sa souveraineté et l’État colonisateur reven-
dique l’exercice du monopole de la violence, qui n’est pas légitime aux
yeux de ceux qu’il colonise, mais légalisée par des traités signés sous la
contrainte. Le monopole de l’exercice de cette violence sera d’ailleurs au
cœur des négociations d’autonomie interne qui démarrent à Tunis le
4 septembre 1954. Celles-ci sont dès le départ subordonnées à l’arrêt de
la lutte armée et à la reddition des « fellagas9 », les combattants tunisiens
retranchés dans les montagnes. Depuis le 18 janvier 1952, le parti natio-
naliste tunisien, le Néo-Destour, les syndicats nationaux, les scouts et
les fellagas sont les acteurs de cette lutte armée. En plus de concurrencer
l’ambition de la puissance colonisatrice à exercer le monopole de la vio-
lence sur le territoire tunisien, ils remettent en cause ses intérêts écono-
miques et politiques et ceux de ses alliés locaux10. En effet, ils multiplient
autant les attaques contre les forces armées françaises, que les assassinats
et les attentats ciblés contre des colons et des Tunisiens proches des auto-
rités coloniales. Ils visent aussi les infrastructures économiques françaises
par des actions de sabotage. Le mouvement national tunisien était donc
clairement considéré comme une menace à l’ordre public à réprimer
sévèrement. Interdiction du congrès du Néo-Destour le 18 janvier 1952,
arrestations massives de leaders et militants nationalistes, suspension de
journaux, répression sanglante des manifestations, internement dans des
camps, torture, condamnation à mort, etc. En 1954, en contrepartie de
9. Le terme fellaga signifiant « bandits de grand chemin » était au départ un
terme péjoratif utilisé par les autorités françaises pour désigner les combattants tuni-
siens et algériens. Par la suite, il a perdu progressivement sa connotation négative.
10. Rien que pendant les premiers mois du déclenchement de la lutte armée,
entre le 14 janvier et le 15 mars 1952, le groupe de recherche de l’Institut supé-
rieur de l’histoire du mouvement national (devenu l’Institut supérieur d’histoire de
la Tunisie contemporaine) a recensé 39 opérations d’incendie et de sabotage des ins-
tallations économiques, 151 opérations de sabotage des lignes téléphoniques et 58
opérations de sabotage des lignes ferroviaires et de ponts.
232
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 232 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire et changement de régime
l’arrêt de la résistance armée, le gouvernement français propose d’accorder
quelques concessions aux Tunisiens. L’autonomie interne limitée devait
permettre aux nationaux tunisiens de gérer les affaires internes du pays,
tout en laissant à l’autorité coloniale le contrôle sur les affaires de sécurité
et de diplomatie tunisiennes. Pour la France, l’enjeu est de contenir la
propagation de la résistance armée dans les trois pays du Maghreb, en
particulier dans ce qui était considéré alors comme un département fran-
çais : l’Algérie.
Depuis sa prison, Habib Bourguiba, président du Néo-Destour, se
saisit de l’occasion et s’engage à ce que les combattants tunisiens déposent
les armes. Il demande en contrepartie que la police revienne aux Tuni-
siens de crainte qu’elle ne se retourne à nouveau contre un « mouvement
national » désarmé. Dans un entretien accordé au Monde, le 23 novembre
1954, il explique sa position :
« Les Tunisiens demandent fermement le rattachement de la police
au gouvernement tunisien. Il leur serait impossible d’assurer l’ordre et la
sécurité publics s’ils n’ont pas entre les mains l’instrument de cet ordre et
de cette sécurité. Ce transfert de services est d’ailleurs indispensable pour
le règlement pacifique du problème des fellagas (…). Mais je demande à
prendre la responsabilité de la police. Je ne veux pas être le jouet d’une
provocation, d’un assassinat ou d’un pillage sur commande. Je connais
trop les services que peuvent rendre au colonialisme répressif un contrô-
leur civil ou un directeur de la sécurité ou un commissaire malveillant à
notre égard. »
Les leaders du Néo-Destour entretenant des liens étroits avec la résis-
tance armée ont dû fermement manœuvrer, en décembre 1954, pour
obtenir une reddition de la majorité des fellagas. Seuls quelques irréden-
tistes tels que Tahar Lassoued refusent de quitter le maquis et rejoignent
la lutte armée algérienne. Malgré cela, les négociations traînent et butent
essentiellement sur les questions relatives à la police, à la justice, mais
aussi à la durée et l’issue de l’indépendance interne. Pour le Néo-Destour,
ces négociations ne sont qu’une étape vers l’indépendance totale. Pour
les Français l’union entre les deux pays doit être « indissoluble, structu-
relle et définitive », dixit Pierre Mendès-France à l’Assemblée nationale, le
4 février 1955.
Installé à Genève, le secrétaire général du Néo-Destour Salah Ben
Youssef reçoit régulièrement des visites et des informations de la délé-
gation tunisienne sur les avancées des négociations. Il défend une ligne
233
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 233 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Tunisie
intransigeante, soutenue par Mongi Slim, chef de la délégation tunisienne
et futur ministre de l’Intérieur. Deux visions se dessinent : celle de Bour-
guiba adepte de la « politique de libération par étapes ». Depuis sa prison,
son plafond des revendications est relativement bas. De l’autre côté, Ben
Youssef, exilé, a une fenêtre sur les récentes victoires de peuples colonisés en
Asie. Il compte sur leur soutien ainsi que sur celui de l’Égypte nassérienne
et défend l’idée d’une lutte armée commune des Tunisiens avec les Algé-
riens et les Marocains. Il se montre donc plus intransigeant sur les questions
relevant des attributs régaliens de l’État et fustige à plusieurs reprises le blo-
cage des négociations où « la France voudrait prendre à sa charge exclusive les
questions concernant la sécurité et la justice11 ». Il demande « le transfert immé-
diat et sans condition (…) de toutes les responsabilités inhérentes au maintien
de l’ordre, auquel ne devra participer aucune autorité française militaire ou
civile12 ». Ce sont précisément ses positions tranchées et, surtout, son soutien
affiché à une jonction des luttes au Maghreb qui font perdre à Ben Youssef
sa qualité d’interlocuteur auprès des Français au profit de Bourguiba.
La concomitance des préparatifs de la conférence de Bandoeng – du 18
au 24 avril 1955 – et les pressions appuyées de Ben Youssef contribuèrent
à accélérer les négociations pour l’autonomie interne. Un accord est fina-
lisé le 21 avril puis signé le 3 juin. Son adoption va déclencher un conflit
sanglant divisant le mouvement nationaliste tunisien.
L’ordre et la discorde
La question du maintien de l’ordre a été au cœur des rivalités qui domi-
nèrent le mouvement de libération. Les accords d’autonomie interne ne
prévoient qu’un transfert progressif et limité des pouvoirs de police aux
Tunisiens. L’article 10 du protocole d’accord sur l’autonomie interne, les
protocoles additionnels 2 et 4 ainsi que les annexes fixent les modalités
d’une cogestion des services de sécurité entre les gouvernements tunisien
et français. Le calendrier relatif au transfert des services de sécurité est
supposé s’étaler sur plusieurs années. Un délai de deux ans est fixé pour
que le maintien de l’ordre soit affecté au gouvernement tunisien, excep-
tion faite de Bizerte, Ferryville et des frontières avec l’Algérie et la Libye
qui demeurent sous contrôle français, sans limites de temps. Dès l’entrée
en vigueur des accords, le directeur de la Sûreté, de nationalité française,
doit transmettre au chef du gouvernement tunisien les rapports élaborés
11. Le Monde, 21 décembre 1954.
12. Le Monde, 4 janvier 1955.
234
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 234 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire et changement de régime
par les renseignements généraux. Au niveau de la gendarmerie, seuls cinq
postes sont immédiatement transférés aux autorités tunisiennes. Toute-
fois, les annexes de l’accord fixent un délai de dix ans pour que les postes
sensibles reviennent à des Tunisiens. Le directeur de la Sûreté, les res-
ponsables des différents services de transmission, de sécurité publique,
d’anthropométrie et des prisons doivent être français, de même pour le
Commissaire central de la ville de Tunis et les chefs de district des villes
de Tunis, Bizerte, le Kef, Sousse, Sfax et Gafsa.
Ce volet sécuritaire est au centre des critiques formulées par le secré-
taire général du Néo-Destour contre l’accord d’autonomie interne.
Dans un communiqué remis à la presse le 25 avril 1955 depuis Ban-
doeng, Salah Ben Youssef affirme que « tout protocole qui ne prévoirait
pas le transfert immédiat au gouvernement tunisien de la responsabilité du
maintien de l’ordre sur tout le territoire de la Tunisie, y compris toute la
région de Bizerte et tous les territoires du Sud jusqu’à la frontière libyenne »,
sera rejeté13. De retour à Tunis, le 13 septembre 1955, Ben Youssef est
intraitable. Toutes les tentatives de conciliation entre lui et Bourguiba
échouent. Le conflit se transforme progressivement en guerre fratricide
qui se déploie au-delà du parti pour traverser des franges plus larges de la
société tunisienne. Un discours particulièrement virulent à la mosquée de
la Zitouna, le 7 octobre 1955, vaut à Salah Ben Youssef d’être exclu du
parti néo-destourien le 13 octobre. Une décision qu’il ne reconnaît pas,
continuant de se prévaloir du Secrétariat général. Sa campagne se poursuit
contre les accords et il réussit à s’attirer un nombre croissant de partisans
à travers tout le pays, dont la puissante fédération destourienne de Tunis.
Le contexte régional semble favorable en raison du soutien de l’Égypte et,
surtout, avec la déclaration de La Celle-Saint-Cloud (6 novembre 1955)
qui ouvre les négociations pour l’indépendance du Maroc. Les autorités
françaises soutiennent Bourguiba, sans intervenir directement dans les
premiers mois du conflit. Le soutien du syndicat ouvrier, l’UGTT fait
clairement pencher la balance vers Bourguiba et lui permet de reprendre
en main l’appareil du parti lors du Congrès de Sfax, le 15 novembre
1955. À partir de ce moment, les heurts sporadiques se transforment
en troubles sanglants avant d’évoluer en lutte armée. En octobre 2016,
l’Instance Vérité Dignité chargée de la justice transitionnelle – couvrant la
période 1955-201314 – a estimé à presque deux mille (1927 exactement)
13. Le Monde, 26 avril 1955.
14. L’instance est créée par la loi organique 35/2013 portant organisation de la
justice transitionnelle.
235
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 235 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Tunisie
le nombre des victimes du conflit entre yousséfistes et bourguibistes, un
chiffre qui traduit le déferlement de la violence, sans clarifier toutefois le
rôle des différents protagonistes ni leurs relations avec le ministère de l’In-
térieur. Pour cela, il faut évaluer les stratégies d’action et les moyens dont
disposent les acteurs.
Peut-on être souverain sans en avoir les moyens ?
Au lendemain de l’autonomie interne, une partie des effectifs de la
police est transmise aux autorités tunisiennes. Cette autonomie demeure
cependant relative, car le transfert est minime : les nouvelles autorités
tunisiennes n’ont pas les moyens d’exercer pleinement leur pouvoir sur le
plan interne sans l’appui des autorités françaises.
Le ministère tunisien de l’Intérieur est créé le 6 octobre 1955. Mongi
Slim, directeur du Néo-Destour, est chargé de sa mise en place dans les
limites fixées par l’accord d’autonomie interne. En l’espace de quelques
mois, il passe du statut de prisonnier politique dans les geôles coloniales,
à celui de ministre à la tête de l’institution sécuritaire. Ce parcours ful-
gurant fait écho au lendemain de la fuite de Ben Ali en 2011, quand
les opposants politiques emprisonnés ou exilés se retrouvent à la tête de
ministères régaliens, dont celui de l’Intérieur. Que ce soit durant le pro-
cessus de l’indépendance, ou le processus de la révolution, ces change-
ments de régime se traduisent par une attention particulière aux relais du
pouvoir à un niveau national (directions générales de certains services),
régional (gouverneurs : wali) et local (délégués : omda). Dans les deux cas,
s’assurer les allégeances au nouveau pouvoir en place est considéré comme
plus prioritaire que les grandes réformes institutionnelles et la rupture
avec le régime précédent.
Au moment de l’autonomie interne, il existe 36 caïdats (circonscrip-
tions administratives), chacun administré par un caïd, agent de l’admi-
nistration traditionnelle du pouvoir beylical, étroitement contrôlé par le
contrôleur civil français. Cette administration comportait aussi des kha-
lifas, suppléants du caïd et des kahias (cadres intermédiaires entre le caïd
et le khalifat). Ces administrateurs régionaux sont généralement recrutés
parmi les notables loyaux aux autorités du protectorat. Avec l’organisation
provisoire des pouvoirs publics (décret beylical 21 septembre 1955), ils
représentent désormais le gouvernement tunisien dans leur localité, y dis-
posent des pouvoirs de police sous la direction du ministre de l’Intérieur
236
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 236 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire et changement de régime
tunisien. Les prérogatives du tout puissant contrôleur civil sur cette admi-
nistration lui sont transférées (décret beylical du 6 octobre 1955). Un
directeur destourien, Ismail Zouiten, est nommé à la tête de l’adminis-
tration régionale. Le nouveau ministre n’a pourtant pas les mains libres.
Tout changement dans le corps caïdal doit recevoir l’assentiment du Bey
qui doit y apposer son sceau.
Avec l’autonomie interne, l’enjeu est double pour le ministre de l’In-
térieur : il s’agit tout d’abord d’écarter les agents proches des Français,
et aussi de s’assurer la loyauté de l’administration caïdale aux décisions
du bureau politique du parti. C’est ce que confirme le secrétaire général
de la fédération de Gabès, qui affirme avoir fait le tour des caïdats dans
tout le pays, à la demande de Mongi Slim, pour évaluer des caïds15 sur la
base de deux critères : la nature de leur collaboration avec les Français et
leur positionnement par rapport à Salah Ben Youssef. Le 10 novembre
1955, une dizaine de kahias et de caïds sont démis de leurs fonctions,
quelques jours avant le Congrès du parti à Sfax. À cette occasion, le kahia
et maire adjoint de Sfax, Sadok Ammar, est limogé, laissant la main libre
aux destouriens du bureau politique (pro-Bourguiba) pour contrôler la
sécurité du Congrès. Depuis, aucun mouvement caïdal n’est publié dans
le Journal officiel, et ce jusqu’au 13 janvier 1956, soit une semaine après
la convocation d’une assemblée nationale constituante. Dans un premier
temps, le Bey, soutien de Ben Youssef, refuse d’entériner ce mouvement
de grande ampleur16. Le souverain, sous pression, n’accepte d’apposer
son sceau que sur une version légèrement modifiée où 13 fonctionnaires
régionaux ne sont pas révoqués, mais placés provisoirement en disponibi-
lité17.
Mais quels sont les effectifs sous contrôle tunisien et à disposition du
ministère de l’Intérieur ? C’est dans la distribution des fonctionnaires
dans les années 1955-1956 que l’on peut trouver des informations à ce
sujet. Au 15 décembre 1955, le ministère comprend les troupes auxi-
liaires dans les territoires du Sud tunisien recrutées parmi la population
locale et formées par 515 agents du Makhzen du sud18 et 314 agents des
troupes du Makhzen mobile (troupes de réserve) et aussi 539 de spahis de
l’Oujak (cavalerie beylicale). Si l’on ajoute les fonctionnaires des adminis-
trations régionales et des villes, le ministère de l’Intérieur tunisien compte
15. Entretien, Tunis, mars 2017.
16. Le Monde, 7 janvier 1956.
17. Le Monde, 10 janvier 1956, décret beylical.
18. Troupes recrutées dans les tribus du Sud tunisien.
237
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 237 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Tunisie
un effectif global atteignant 1886 agents. Le haut-commissaire français
Roger Seydoux, « l’intermédiaire des rapports du Gouvernement français et
des autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays »
(accords 3 juin 1955), garde le contrôle sur une grande partie des forces
de police et de la gendarmerie.
En l’absence d’un appareil sécuritaire fort à disposition du bureau poli-
tique destourien, quels moyens a-t-il utilisés pour réprimer l’opposition
yousséfiste ?
Que faut-il pour réprimer une opposition ?
Contesté, le bureau politique du Néo-Destour a fait appel non seu-
lement aux moyens que lui fournissaient les services du ministère de
l’Intérieur à sa disposition, mais aussi aux ressources du parti et à une
alliance de circonstance avec les autorités françaises. Cette dynamique
s’est traduite par une confusion progressive entre les intérêts du parti au
pouvoir et l’institution sécuritaire. Trois phases peuvent être dégagées :
la première commence avec l’exclusion de Ben Youssef du Néo-Destour
le 13 octobre 1955, la deuxième fait suite au congrès de Sfax, la troisième
après la fuite de Ben Salah.
Dès le début de la première phase, les yousséfistes et leur leader pro-
voquent les réactions hostiles des soutiens du bureau politique. Le
28 octobre à Kairouan, la voiture de Ben Youssef est attaquée et ses vitres
sont brisées. D’autres incidents sont signalés lors de sa tournée à Béja et
Mjez al Bab le 2 novembre. Six personnes sont blessées et le discours de
Ben Youssef prévu à Jendouba est annulé. Les militants fidèles au secré-
taire général du parti réagissent deux jours plus tard et attaquent le mee-
ting d’un membre du bureau politique faisant plus d’une dizaine de
blessés. La spirale de la violence est enclenchée.
Dans une situation de forte polarisation, Mongi Slim se refuse à pro-
clamer haut et fort sa position dans le conflit. Il est même suspecté par
les partisans de Bourguiba de manquer de fermeté vis-à-vis des youssé-
fistes19. Le ministre est alors soumis à des pressions contradictoires. Sa
position attentiste était-elle mue par sa volonté, en tant que directeur du
Néo-Destour, d’éviter à travers sa position au sein du ministère de l’Inté-
rieur l’implosion du parti ? Il est difficile de répondre à ces questions, sans
19. DOUGUI N., Mongi Slim : L’homme des missions difficiles 1908-1969, Tunis,
Institut supérieur d’histoire de la Tunisie contemporaine, 2017, p. 91-92.
238
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 238 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire et changement de régime
archives. On sait cependant qu’au Congrès de Sfax, Mongi Slim laisse
la direction du parti à un autre tunisois, Taïeb Mehiri, qui prendra la
tête du ministère de l’Intérieur après l’Indépendance. D’ailleurs, tous les
ministres de l’Intérieur qui vont suivre font partie du bureau politique
du Néo-Destour. Dans les premiers mois du conflit, le ministère de l’In-
térieur laisse libre cours aux activités de Salah Ben Youssef et de ses par-
tisans, pas encore considérés comme une menace à l’ordre public. Ses
meetings et réunions publiques sont autorisés, sans que le ministère se
tienne à une position de stricte neutralité. L’administration caïdale est en
effet mise à contribution contre Salah Ben Youssef. La presse ne manque
pas de révéler cet usage de l’appareil de l’État contre le secrétaire général
et ses fidèles. Lors d’une conférence de presse organisée le 5 novembre
195520, celui-ci accuse le ministre de l’Intérieur de ne pas lui avoir assuré
une protection face aux attaques dont il a été victime, et surtout d’avoir
ordonné à deux reprises à ses adjoints, les caïds et les kahias, de désarmer
leurs agents, laissant le champ libre aux milices du bureau politique.
La tenue du Congrès de Sfax marque le début d’une deuxième phase
où l’institution sécuritaire s’implique de plus en plus dans le conflit.
« La chasse à l’opposition » à laquelle appelle le quotidien bourguibiste
al-‘Amal21 est lancée. Rixes violentes, menaces de mort, attaques contre
les locaux des journaux, assassinats, la situation s’embrase à travers le pays.
Seuls les crimes commis par les yousséfistes sont suivis d’arrestations selon
les sources actuellement traitées. Ce qui veut dire que seule la violence
des bourguibistes est considérée comme légitime. Les fidèles du secréta-
riat général sont clairement désignés comme une menace à l’ordre public.
En outre, l’administration caïdale est employée pour faire pression sur les
appuis yousséfistes. Dans le Sahel, le caïd de Monastir est accusé par Ben
Youssef, le 25 novembre, d’avoir mis des spahis à disposition d’une com-
mission envoyée par le bureau politique pour contraindre des syndicats
d’agriculteurs à faire scission de l’Union générale des agriculteurs tuni-
siens (UGAT), un syndicat connu pour son soutien au secrétariat général.
L’action sécuritaire est soutenue par la mise en place d’un arsenal juri-
dique qui donne des outils légaux à la répression. Le 8 décembre 1955,
deux décrets beylicaux sont publiés. Le premier encadre de manière très
stricte les manifestations et le port d’armes. Le deuxième réprime « les
20. DHIFALLAH M., Salah Ben Youssef : discours et documents divers (en arabe),
Tunis, Institut supérieur d’histoire de la Tunisie contemporaine, 2015, p. 209
et 223.
21. Al-Amal, 22 novembre 1955.
239
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 239 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Tunisie
délits et les infractions politiques ». Ce dernier décret punit sévèrement
les complots contre la sûreté de l’État. La répression légale continue et
le 18 décembre 1955, la demande d’autorisation de Salah Ben Youssef
pour organiser un meeting est refusée, tout comme celle pour organiser
un congrès du « Secrétariat général ». Les journaux yousséfistes sont sus-
pendus et leurs partisans font face à la répression policière. Les recettes
utilisées par les autorités coloniales contre le mouvement nationaliste sont
remises au goût du jour par une partie de ces mêmes nationalistes.
Habib Bourguiba et Salah Ben Youssef sont dans une logique d’éra-
dication. Le 2 décembre, Bourguiba échappe à une tentative d’assassinat
à Korba (ville littorale du nord-est). Une tentative réitérée un mois plus
tard à Redeyef. Roger Seydoux, haut-commissaire français, craint aussi
une liquidation physique de Ben Youssef et son exploitation « aussi bien
au Proche-Orient qu’en Afrique du Nord ». Il ordonne aux services de
police de renforcer sa protection physique22.
Le 16 décembre, une opération de la police aboutit à la perquisition
d’armes et d’explosifs et à une quarantaine d’arrestations de yousséfistes.
selon les notes de la direction des services de sécurité, les interrogatoires
révèlent que le groupe se préparait pour des actions violentes et certains
d’entre eux avaient reçu des consignes de Salah Ben Youssef pour se tenir
prêts à la révolte et à la lutte armée si l’action politique se révélait infruc-
tueuse. De surcroît, à partir du mois de novembre, les renseignements fran-
çais signalent le trafic d’armes et la formation de nouvelles bandes armées
yousséfistes, notamment sous l’impulsion de Tahar Lassoued. L’Égypte
nassérienne fournit les armes aux opposants de l’autonomie interne.
Craignant la résurgence de la lutte armée en Tunisie et d’une jonction
avec celle qui se déploie en Algérie, les autorités françaises sortent de leur
neutralité affichée au début du conflit et en deviennent des acteurs clés.
Le calendrier d’application des accords d’autonomie interne en matière
de maintien de l’ordre est accéléré au profit du gouvernement tunisien.
Le Bey, puis deux émissaires de Ben Youssef s’en plaignent au haut-
commissaire lors d’une rencontre le 28 décembre 1955. En effet, même
si, au départ, les yousséfistes contestent la lenteur du transfert des services
de sécurité, ils sont bien conscients que c’est contre eux qu’ils vont être
utilisés. Les tentatives de rapprochement entre Ben Youssef et les auto-
rités françaises demeurent sans succès.
22. Fonds Alain Savary, SV14 Dr 3 sdr b, Annexe n° 1, Lettre de M. Roger Sey-
doux… à M. Massigli, Secrétariat général du ministère des Affaires étrangères, datée
du 11 décembre 1955 (02 pages dactylographiées).
240
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 240 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire et changement de régime
Sur la frontière, les notes de la direction des services de sécurité
indiquent que des fellagas algériens se sont attaqués à des militants du
Néo-Destour en menaçant « les habitants de les exécuter s’ils n’adhèrent pas
au “Secrétariat général”23 ». Pour Roger Seydoux, il faut agir : « Nous ne
pouvons pas être plus bourguibistes que Bourguiba (…) nous pouvons être
amenés, s’il est trop inactif, à intervenir de nous-mêmes pour assurer la sécu-
rité, si les agissements de Salah Ben Youssef risquaient de faire réapparaître le
terrorisme ou la rébellion armée dans le bled24 . » Il préconise de procéder à
l’arrestation de Salah Ben Youssef et de le traduire devant une cour spé-
ciale pour complot contre la sûreté de l’État. Mais s’agissant d’une affaire
de police intérieure, il ne peut qu’exécuter les décisions du gouverne-
ment tunisien. L’arrestation est prévue pour le 28 janvier. De leur côté,
le bureau politique de Néo-Destour et surtout le ministre de l’Intérieur
Mongi Slim tergiversent et choisissent de faciliter la fuite du secrétaire
général en Libye dans la nuit25.
Le lendemain du départ de Ben Youssef, une nouvelle étape s’annonce
avec une recrudescence de la répression. Son domicile est perquisitionné,
des armes sont saisies. Le ministère de l’Intérieur lance une vague d’ar-
restations contre ses partisans et suspend leurs journaux. Une Cour cri-
minelle spéciale est instituée le 28 janvier avec pour objectif de juger les
crimes de « nature à troubler l’ordre public », ainsi que « les attentats
contre la sûreté intérieure de l’État ». Elle va juger les militants youssé-
fistes.
La violence ressurgit et prend une nouvelle ampleur. En février 1956,
Tahar Lassoued, opposant aux accords d’autonomie interne, annonce
la création d’une armée de libération tunisienne. Son objectif est non
seulement l’indépendance totale, mais aussi le soutien aux Algériens. La
lutte armée est officiellement déclarée contre le gouvernement tunisien
et les autorités françaises. Un nouveau fellagisme est né, mais les anciens
fellagas se divisent. Ironie de l’histoire, une frange des nationalistes tuni-
siens s’allie à l’armée française pour réprimer ces nouveaux fellagas dans
les rangs desquels ils combattaient quelques mois auparavant26. En effet,
23. Ibidem.
24. SHAT, carton 2H133, compte-rendu des contacts de Roger Seydoux.
25. CHAIBI L., Le mouvement national et la question ouvrière syndicaliste : ensemble
pour arracher l’Indépendance, t. II (en arabe), Tunis, Centre de publication universi-
taire, 2016, p. 410-425.
26. OUALDI M., L’orage des indépendances : Salah Ben Youssef et les youssé-
fistes, en Tunisie en 1955-1956., Mémoire d’histoire, Paris I (non publié), 1998,
p. 102-103.
241
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 241 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Tunisie
d’anciens fellagas, tels que Hassan Ayadi, Lazhar Chraïti, Mahjoub Ben
Ali et Sassi Lassoued s’alignent sur les positions du bureau politique et
contribuent activement à la chasse de leurs anciens frères d’armes en
bénéficiant de la couverture du ministère de l’Intérieur. Ils participent
aux activités des milices destouriennes ou « comités de vigilance » qui
sévissent. Ils créent des centres de détention et d’interrogation clan-
destins, tels que Sabbat Edhlam à Tunis, où kidnapping et torture sont
pratiqués contre les yousséfistes. Ces groupes sont même légalisés par
décret le 31 mars avant d’être dissous par arrêté du Premier ministre le
6 juillet 1956. Le fellaga Hassan Ayadi a écrit dans ses mémoires qu’il
n’a fermé Sabbat Edhlam qu’après « tunisification » de la Sûreté géné-
rale. Il affirme avoir « remis tout ce qu’il y avait à la direction de la sûreté
nationale27 ».
1956-2011 : Les traces d’une violence fondatrice
Pour le bureau politique du Néo-Destour, détenir les rênes d’un appa-
reil sécuritaire aux moyens limités, au lendemain de l’autonomie interne,
n’était pas suffisant. Pour y remédier, deux choix ont été opérés. Le pre-
mier est d’utiliser les ressources du parti pour renforcer la capacité de
répression des institutions étatiques (appareil sécuritaire, administration
régionale), posant ainsi les bases d’une confusion entre le parti et l’État.
Le deuxième est de faire appel au soutien de la puissance colonisatrice
en prenant le risque de renforcer sa dépendance vis-à-vis d’elle28, et de
faire face à des accusations de compromission. Seulement, si le camp
bourguibiste instrumentalise le conflit yousséfiste pour faire pression
sur la France et obtenir l’Indépendance, signée le 20 mars 1956, il s’en
démarquera par la suite en assurant un soutien actif aux combattants
algériens. De leur côté, les yousséfistes ont également recours aux res-
sources humaines et organisationnelles de leurs partisans pour constituer
des milices et reprendre la lutte armée. Ils font par ailleurs appel au sou-
tien de la puissance régionale égyptienne pour s’armer. Mais, ils n’ont
pas accès aux ressources étatiques du ministère de l’Intérieur et, surtout,
27. DHIFALLAH M., « Mémoires de cheikh Hassan Ayadi », Revue d’Histoire
maghrébine, n° 126, février 2007, p. 155.
28. Après la signature des accords d’indépendance, la France demande à ses
alliés de ne pas vendre des armes à la Tunisie indépendante et conditionne son aide
économique et sécuritaire par l’arrêt de tout soutien aux combattants algériens.
242
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 242 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Ouvrir la boîte noire : appareil sécuritaire et changement de régime
leur positionnement politique leur a aliéné toute possibilité de négocier
l’Indépendance avec la France.
Dans la lutte interne au parti nationaliste, les services de sécurité
étaient à la fois un enjeu et un acteur. Le camp sorti vainqueur a pris
aussi bien le contrôle du parti que de l’appareil sécuritaire. Avec la chute
du RCD en 2011, on assiste à une renégociation entre le politique et
l’appareil sécuritaire. Celui-ci ne peut plus se soustraire au débat public.
L’usage disproportionné de la violence contre des mouvements sociaux
ou des opposants notoires a désormais un coût politique29. Il s’est donc
relativement réduit au fil du temps30. Toutefois, les violences policières et
la torture persistent, mais ciblent les groupes ou les individus qui ne dis-
posent pas d’un réseau politique ou familial ou de relais médiatiques puis-
sants. Ces abus sont renforcés par le fait que l’arsenal juridique hérité des
régimes précédents, qui les légalise, n’a pas encore été amendé en confor-
mité avec la nouvelle constitution de 2014.
Par ailleurs, avec la reconfiguration du champ politique, de nouveaux
acteurs ont émergé. L’appareil sécuritaire est devenu un terrain de com-
pétition pour les différents partis politiques en présence qui essaient d’en
prendre le contrôle sans forcément chercher à en modifier les règles de
fonctionnement31. Face aux tentatives d’ingérence politique, le mot
d’ordre de « police républicaine » a été affirmé par des syndicats de police,
créés après le 14 janvier 2011. Le principe de sûreté nationale « républi-
caine » et « neutre » a d’ailleurs été constitutionnalisé dans la Constitu-
tion de 201432. Pourtant, la revendication de neutralité politique pour
les syndicats de police s’est souvent muée en recherche d’autonomie et
en répulsion par rapport à tout contrôle politique, même parlementaire.
Le contexte de la lutte anti-terroriste aidant, ils ont formé des groupes de
pression qui interviennent pour protéger les intérêts de leurs adhérents ou
forcer le vote de projets de lois renforçant leur pouvoir et les soustrayant
29. À titre d’exemple, la répression par l’usage de la chevrotine contre les mani-
festations hostiles au gouvernement à Siliana, qui, fin novembre 2012, s’est soldée de
plus de 250 blessés, a sensiblement écorné l’image de la Troïka et a valu au ministère
de l’Intérieur l’ouverture d’une enquête judiciaire.
30. Observations de l’auteure mouvement social à Kasserine, Kairouan, régions
périphériques de Tunis, janvier 2016.
31. INTERNATIONAL CRISIS GROUP, « Réforme et stratégie sécuritaire en Tunisie »,
n° 161, 2015, p. 12-15.
32. Art. 19 : « La sûreté nationale est républicaine ; ses forces sont chargées de main-
tenir la sécurité et l’ordre public, de protéger les individus, les institutions et les biens, et
d’exécuter la loi dans le respect des libertés et de la neutralité totale. »
243
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd 243 06/08/2018 14:47:01
Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018 © CNRS Editions 2018
Tunisie
à toute redevabilité33. En face, des organisations de défense des droits de
l’homme ou des mouvements de jeunes (ex : le mouvement « Hasebhom »
[Demandez-leur des comptes]) se mobilisent pour dénoncer les abus poli-
ciers et faire campagne contre ces mêmes projets de loi. L’équilibre entre
toutes ces forces demeure pour l’instant précaire.
Dès lors, si la signature des accords d’autonomie interne a constitué
un moment fondateur avec un effet structurant à long terme sur le fonc-
tionnement de l’appareil sécuritaire, peut-on en dire de même pour le
moment révolutionnaire de 2011 ?
33. À la suite du décès du commandant Riadh Barrouta, victime avec un collègue
d’une attaque au couteau le 1er novembre 2017 devant le parlement, certains syndi-
cats des forces de sécurité ont menacé de ne plus assurer la sécurité des parlementaires
s’ils ne votaient pas un projet de loi sur la « répression des attaques contre les forces
armées ». Celui-ci réduit fortement la liberté de presse et d’expression et établit une
quasi-impunité des forces armées sur le plan pénal.
TUNISIE_DEMOCRATISAT_CS6_pc_ok.indd
View publication stats 244 06/08/2018 14:47:01
Vous aimerez peut-être aussi
- Charte D'investissementDocument5 pagesCharte D'investissementmkjihanePas encore d'évaluation
- Bouse de TunisDocument30 pagesBouse de TunisOuerghi KarimPas encore d'évaluation
- Résumé Exécutif Analyse SectorielleDocument8 pagesRésumé Exécutif Analyse Sectorielledrissiwala3Pas encore d'évaluation
- Grêle & Culture Arboricole en TunisieDocument402 pagesGrêle & Culture Arboricole en TunisieMontassar BouslamaPas encore d'évaluation
- Les Littératures Francophones Du MaghrebDocument5 pagesLes Littératures Francophones Du MaghrebLou VidelPas encore d'évaluation
- 701Document23 pages701dknewsPas encore d'évaluation
- Fusions AcquisitionsDocument13 pagesFusions AcquisitionsAmal HammamiPas encore d'évaluation
- Rappoert PR AmelDocument10 pagesRappoert PR AmelRayées ZtPas encore d'évaluation
- Imen Tunisien Hexa 3DDocument13 pagesImen Tunisien Hexa 3DsheymaPas encore d'évaluation
- Rapport Solarbuid TunisieDocument25 pagesRapport Solarbuid TunisieAyoub EnergiePas encore d'évaluation
- Festival Founoun Des Poésies MarocainesDocument37 pagesFestival Founoun Des Poésies MarocainesNaima NimaPas encore d'évaluation
- Synthèse - Stratégie - Tunisie 2035Document22 pagesSynthèse - Stratégie - Tunisie 2035meryemjaziri9Pas encore d'évaluation
- Exportateurs FRDocument5 pagesExportateurs FRzouhaierPas encore d'évaluation
- Les Cimentries en Tunisie (Mlawah Med Ali)Document15 pagesLes Cimentries en Tunisie (Mlawah Med Ali)SINGOPas encore d'évaluation
- Liste Des Études de l'ANPE PDFDocument7 pagesListe Des Études de l'ANPE PDFAmine KacemPas encore d'évaluation
- Safran Book Pfe 2021Document45 pagesSafran Book Pfe 2021oussema jendoubiPas encore d'évaluation
- 142journal Annonces2022Document13 pages142journal Annonces2022Mohamed SaidaniPas encore d'évaluation
- MemoireDocument11 pagesMemoireMay Ssa Ben Saleh100% (1)
- Naaman Guessous, S. (2015) - Les Sociologues Et La Sociologie Au MarocDocument468 pagesNaaman Guessous, S. (2015) - Les Sociologues Et La Sociologie Au MarocchitourakhouloudPas encore d'évaluation
- Creer Une Entreprise en Tunisie EtapesDocument4 pagesCreer Une Entreprise en Tunisie Etapesabdelli onsPas encore d'évaluation
- GIPP Rapport FINAL de La Phase 2 (1) - 0Document115 pagesGIPP Rapport FINAL de La Phase 2 (1) - 0Askri SamirPas encore d'évaluation
- LibertéDocument20 pagesLibertéIlyes Time To SayPas encore d'évaluation
- Prix Sadok Besrour2020Document1 pagePrix Sadok Besrour2020Mohamed Yassine LahianiPas encore d'évaluation
- Dossier Sposoring TKWC2Document10 pagesDossier Sposoring TKWC2Safouen GasmiPas encore d'évaluation
- 666 Em30052012Document20 pages666 Em30052012elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- CV Canadien-Noura-1Document2 pagesCV Canadien-Noura-1HakimBenSaâdPas encore d'évaluation
- Tribus Maisons États Monde ArabeDocument9 pagesTribus Maisons États Monde ArabeJamaa OuarezzamenPas encore d'évaluation
- 3774 11063 1 PBDocument21 pages3774 11063 1 PBKhaoula Hanchi ChaabanePas encore d'évaluation
- Le Tourisme Culturel Durable Une Opportunité de Mise en Valeur Du Patrimoine Algérien (Le Cas de La Ville Historique de Tlemcen)Document9 pagesLe Tourisme Culturel Durable Une Opportunité de Mise en Valeur Du Patrimoine Algérien (Le Cas de La Ville Historique de Tlemcen)sam mirouPas encore d'évaluation
- Journal Le Soir Dalgerie Du 22-01-2019Document20 pagesJournal Le Soir Dalgerie Du 22-01-2019StukinePas encore d'évaluation