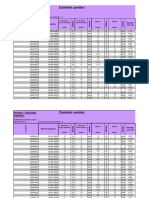Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
TEXTE PRINCIPAL Lévi-Strauss - 1952 - Extrait Race Et Histoire
TEXTE PRINCIPAL Lévi-Strauss - 1952 - Extrait Race Et Histoire
Transféré par
Theo Brunello0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues10 pagesTitre original
TEXTE PRINCIPAL Lévi-Strauss_1952_Extrait Race et histoire
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues10 pagesTEXTE PRINCIPAL Lévi-Strauss - 1952 - Extrait Race Et Histoire
TEXTE PRINCIPAL Lévi-Strauss - 1952 - Extrait Race Et Histoire
Transféré par
Theo BrunelloDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
RACE ET CULTURE
Parler de contribution des races humaines & la
civilisation mondiale pourrait avoir de quoi sur-
prendre, dars une collection de brochures destinées
A luter conte le préjugé racist. Il serait vain avoir
consacré tart de talent et tant d'efforts & montrer
que rien, dans Tétat actuel de la science, ne permet
affirmer Ja supériorité ou Tinfériorté intelletuelle
d'une race par rapport & une autre, si c’était seu-
lement pour restituer subrepticement sa consistance
la notion de race, en paraissant démontrer que les
‘grands groupes ethniques qui composent Vhumanité
‘ont apporté, en fant que tls, des contributions spéci-
‘iques au paitimoine commun,
‘Mais rien n'est plus éloigné de notre dessein qu'une
telle entreprise qui aboutirait seulement & formuler
la doctrine raciste & Yenvers. Quand on cherche &
caractériser les races biologiques par des propriétés
peychologiqees particuliéres, on s'écarte autant de la
vérité scientfique en les défnissant de fagon postive
que négative, Il ne faut pas oublier que Gobineau,
10 RACE ET BISTOIRE
dont Vhistoie a fait le pire des théoriss racistes, ne
concevait pourtant pas I « inégalité des races humai-
nes > de manitre quantitative, mais qualitative :
pour lui, let grandes races primitives qui formaient
Vhumanité ses débuts — blanche, jaune, noire
— n'étaient pas tellement inégales en valeur absolve
‘que diverses dans leurs aptitudes particulites. La
tare de la dégénérescence sattachait pour Iui au
phénoméne du métissage plutét qu’a la position de
chaque race dane une échelle de valeurs commune
A toutes ; elle était done destnge a frapper lhuma-
nité tout entiére, condamnée, sans distinction de
race, a un métissage de plus en plus poussé. Mais le
péché originel de l'anthropologie consiste dans la
confusion entre Ia notion purement biologique de
race (A suppoter, dailleurs, que, méme sur ce terrain
limité, cette notion puisse prétendre a Yobjectivité
ce que Ia génétique moderne coateste) et les produc
tions sociologiques et psychologiques des cultures
‘numaines. 11 a sulfi a Gobineau de Pavoir commis
pour se trouver enfermé dans le cercle infernal qui
‘conduit d'une erreur intellectuele n'excluant pas Ja
bonne foi a la Iégitimation involontare de toutes les
tentatives de discrimination et exploitation.
‘Aussi, quand nous parlons, en cette étude, de
contribution des races humaines & Ja civilisation, ne
voulons-nous pas dire que les apports culturels de
Asie ou de l'Europe, de PAfrique ou de Amérique
tirent une quelconque originalité du fait que ces
continents sont, en gros, peuplés par des habitants de
RACE BT CULTURE u
souches raciales diférentes, Si cette originalité existe
— et Ia chose n'est pas douteuse — elle tient 2 des
ciconstances géographiques, historiques et sociolo-
iques, non 2 des aptitudes distinctesliges & la consti=
tution anatomique ou physiologique des noirs, des
jaunes 04 des blancs. Mais il nous est apparu que,
dans la mesure méme od cette série de brochures
sestefforeée de faire droit & ce point de vue négatif,
elle risquat, en méme temps, de reléguer au second
plan un aspect également trés important de Ia vie de
Phumanité: & savoir que celle-ci ne se développe
pas sous le régime d'une uniforme monotonie, mais
A travers dos modes extraordinairement diversi
de sociétés et de civilisations ; cette diversité intel-
Jeetuelle, etthétique, sociologique, n'est unie par
aucune rela‘on de cause a effet & celle qui existe,
sur le plan biologique, entre certains aspects obser-
vables des zroupements humains: elle lui est seu
Jement paralldle sur un autze terrain, Mais, en méme
temps, elle ven distingue par deux caractéres impor-
tants, D'abord elle se situe dans un autre ordre de
grandeur. I1y a beaucoup plus de cultures humaines
que de races humaines, puisque les unes se comptent
Par muuers et les autres par unités: deux cultures
Glaborées par des hommes appartenant A la méme
race peuvent diférer autant, ou davantage, que deux
cultures relevant de groupes racialement éloignés.
En second lieu, a Vinverse de Ja diversté entre les
races, qui présente pour principal intérét celui de
Jeur origine historique et de leur distribution dans
2 RACE ET HISTOIRE
TTespace, Ia diversté entre lez cultures pote de nom
bbreux problémes, car on peut se demander si elle
constitue pour Vhumanité un avantage ov un incon-
venient, question ensemble qui se subdivse, bien
‘entendu, en beaucoup autres.
Enfia’ et surtout on doit se demander en quoi
consiste cette diversité, au risque de voir les pré
jugés racstes, A peine déracinés de leur base biolo-
‘ique, se reformer sur un nouveau terrain, Car il
serait vain davoir obtenw de Vhomme de la rue qu'il
renonce A attribuer une signification intellectuele ou
‘morale au fait d'avoir Ia pew noire ou blanche,
Je cheveu lisse ou crépu, pour rester silencieux
devant une autre question & laquelle Texpérience
prowve quill se raccroche immédiatement : sil
existe pas ‘aptitudes racisles innées, comment
‘expliquer que la civilisation développée par "homme
blanc ait fait les immenses progrés que l'on sait,
tandis que celles des peuples ¢e couleur sont restées
en arrtre, les unes & mi-chemin, les autres frappées
un retard qui se chiffre par miles ou dizaines de
millers d'années? On ne szurait done prétendre
avoir résolu par la négative le probléme de Tinéga-
Tité des races humaines, si Yon ne se penche pas
aussi sur celui de Tinégalité — ou de Ia diversité —
des cultures humaines qui, en fait sinon en droit,
Jui est, dans Fesprit public, étoitement Lie
2
DIVERSITE DES CULTURES
Pour comprendre comment, et dans quelle mesure,
Jes cultures humaines different entre elles si ces
dliflérences Sannulent ou se contredisent, ou si elles
‘concourent i former un ensemble harmonieux, il faut
abord essayer den dresser Vinventaire. Mais Cest
‘ci que les dfficultés commencent, car nous devons
nous rendre compte que les cultures humaines ne
diférent pas entre elles de la méme fagon, ni sur le
‘méme plan, Nous sommes abord en présence de
sociétés juntaposées dans Tespace, les unes proches,
Jes autres lointaines, mais, 8 tout prendre, contempo-
raines. Ensvite nous devons compter avec des for-
mes de la vie sociale qui se sont succédé dans le
temps et que nous sommes empéchés de connaltre
par expétience directe, Tout homme peut se trans
former en ethnographe et aller partager sur place
Yreristence c'une societé qui Tinéresse ; par contre,
sméme s'il devient historien ou archéologue, il n'en-
trera jamais directement en contact avec une civilisa-
tion disparu:, mais seulement a travers les documents
4 RACE ET HISTOIRE
Zerite om Tes monuments figueés que cette société —
‘ou d'autres — auront lissés & son sujet. Enfn, i ne
faut pas oublier que les sociéés contemporaines
restées ignorantes de T'éeriture, comme celles que
nous appelons « sauvages > ou « primitives >, furent,
celles aussi, préctdées par d'autres formes, dont 1s
connaissance est pratiquement impossible, fit-ce de
smanigre indirecte ; un inventaire consciencieux se
doit de leur réserver des cases blanches sans doute
‘en nombre infiniment plus éevé que celui des cases
fo nous nous sentons capables dinscrire quelque
chose. Une premiére constatation simpose: la diver-
Sité des cultures humaines est, en fait dans le pré=
sent, en fat et aussi en droit dans le passé, beaucoup
plus grande et plus riche que tout ce que nous som-
mes destings & en connaitre jamais.
Mais, méme pénéirés d'un sentiment d'humilité
et convaincus de cette imitation, nous rencontrons
autres problémes. Que faut-l entendre par cultu-
res différentes? Certaines semblent etre, mais si
celles émergent d'un trone commun elles ne diffrent
pas au méme titre que deux sociétés qui aucun
moment de leur développement n'ont entretenu de
rapports. Amst Fancien empir> des Incas du Perou
‘et exlui du Dahomey en Afrique different entre eux
de fagon plus absolve que, cisons, l'Angleterre et
les Biats-Unis d'anjourd’hui, bien que ces deux socié-
‘és doivent anseh re traitées comme des socités
distinctes, Inversement, des socités entrées rEcem-
‘meat en contact ts intime purassent offir Vimage
DIVERSITE DES CULTURES 15
de 1a méme civilisation alors qu’elles y ont accédé
par des chemins différents, que Ton n'a pas le droit
de négliger. Il y a simultanément & Teeuvre, dans les
sociétés humaines, des forces travaillant dans des.
directions opposées: Jes unes tendant au mainticn
et méme & Taccentuation des partcularismes ; tes
autres agissent dans le sens de la convergence et de
Vaffinté, Liétude du langage offre des exemples
frappants de tels phénoménes: ainsi, en méme temps
‘que des langues de méme origine ont tendance a se
diférenciet es unes par rapport aux autres (els: Je
russe, le fraagais et l'anglais), des langues d'origines
variges, mais parlées dans des terrtoires contigus,
développent des caractéres communs : par exemple,
le russe stst, 2 certains égards, diflérencié d'autres
langues slaves pour se rapprocher, au moins par
certains traits phonétiques, des langues finno-ovgrien-
nes et turgues parlées dans son voisinage géogra-
phique immédiat.
Quand o2 étudie de tele fits — ot autres
domaines de Ja civilisation, comme les institutions
sociales, I'ar la teligion, en fourmiraient aisément de
semblables — on en vient & se demander si les soci
‘és humaine: ne se definissent pas, en égard & leurs
relations matuelles, par ua certain optimum de
diversité audeta duquel eles ne sauraient aller, mais
fen dessous duguel elles ne peuvent, non plus, des
scendre sans danger. Cet optimum varierait en fonc-
tion du nombre des socités, de leur importance
‘numérique, de leur éloignement géographique et des
16 BACE ET HISTOIRE
moyens de communication (mstériels ot iatellectuels)
dont elles disposent. En efle, le probléme de la
diversité ne se pose pas seulement 2 propos des
cultures envisagées dans leurs rapports réciprogques ;
il existe aussi au sein de chaque société, dans tous
les groupes qui la constituent : castes, classes, milieux
professionnels ou confessionnels, ete, développent
certaines différences auxquelles chacun eux attache
‘une extréme importance. On peut se demander si
ceite diversification interne ne tend pas saccrate
Forsque la société devient, sous d'autres rapports,
plus volumineuse et plus homogene ; tl fut, peut-
‘tre, le cas de Inde ancienne, avec son systéme de
castes #épanouissant & la suite de Vétablissement de
Phégémonie aryenne.
‘On voit donc que la notion de ta diversité des
cultures humaines ne doit pis etre congue dune
imanigre statique. Cette diversté n'est pas celle d'un
‘éhantilonnage inerte ou d'un catalogue desséché.
Sans doute les hommes ont élaboré des cultures
différentes en raison de Iéloignement géographique,
des proprictés particuiéres du milieu et de Yigno-
ance oi ils étaient da reste de Yhumanité ; mais
cela ne serait rigoureusemen: vrai que si chaque
culture ou chaque société état lige et sétait déve~
loppée dans V'isolement de toutes los autres. Or cela
est jamais le cas, sauf peut-tre dans des exemples
exceptionnels comme celui doe Tasmaniens (et Th
‘encore, pour une période limitée). Les sociétes
‘bumaines ne sont jamais seules ; quand elles sem-
DIVERSITE DES CULTURES a
bent te plus séparées, cest encore sous forme de
groupes ou de paquets. Ans, il n'est pas exagéré
de supposer que les cultures nord-américaines et sud~
américaines ont été coupées de presque tout contact
avec le reste du monde pendant une pétiode dont Ia
durée se sive entre dix mille et vingt-cing mille
années. Mais ce gros fragment 'humanité détachée
consistait ev une multitude de sociétés, grandes et
Petites, qui avaient entre elles des contacts fort
Greoits. Et A eOtE des diérences dues & I'solement,
ily a celles, tout aussi importantes, dues a la
roximité: désir de s'opposer, de se_distinguer,
tre soi, Beaucoup de coutumes sont nées, non de
quelque nécessité interne ou accident favorable, mais
4e Ia seule volonté de ne pas demeurer en reste par
rapport 3 ur groupe voisin qui soumettait & un usage
précis un domaine oi 'on n'avait pas songé soi-méme
A Gdicter dos s@ples. Par conséquent, Ja diversité
des cultures humaines ne doit pas nous inviter & une
‘observation morcelante ou morcelée, Elle est moins
fonction de (isolement des groupes que des relations
ui les uniseeat.
3
L'ETHNOCENTRISME
Et pourtant, il semble que Ia diversité des cultu-
es soit rarement apparue aux hommes pour ce
auielle est: un phénoméne nature, résltant des rap-
ports directs ou indirects entre le sociéts 5 ils y ont
plutot vu une sorte de monstruosté ou de scandale ;
dans ces maiires, le progrés de Ia connaissance 2°
pas tellement consisté & dissiper cette illusion au
profit d'une vue plus exacte qu’d l'accepter ou &
trouver Je moyen de sy résigner
Lattitude In plus ancienne, et qui repose sans
doute sur des fondements psychologiques solides
puisqu'elle tend & réapparattre chez chacun de nous
quand nous sommes placés dans une situation inat-
fendue, consiste & répudier purement et simplement
les formes caltureles : morales, religeuses, sociales
festhétiques, qui sont les plus éloignées ‘de celles
auxquelles nous nous identifions, « Habitudes de
cmmvages », ecela n'est pas de chez nous », ¢ on
‘ne devrait pas permettre csla s, ete, autant de
réactions grossitres qui traduisent ce méme frisson,
20 RACE ET wuSTOIRE
cette méme répulsion, en présence ce manidres de
vivre, de croire ou de penser qui nous sont étran~
g2tes. Ainsi TAntiquité confondaitelle tout ce qui
ne partiipait pas de la culture grecque (puis gréco-
romaine) sous le méme nom de barbate; la civilisa-
tion occidentale a ensuite utlisé Je terme de sau-
vage dans le méme sens. Or dertiere ces épithétes
se dissimule un méme jugemeat : il est probable que
Je mot barbare se référe ymologiquement & la
confusion et & Vinarticuation da chant des oiseaux,
opposéss & la valeur signiiane du langage humain ;
cet sauvage, qui veut dire ede la forét », évoque
aussi un genre de vie animale, par opposition a la
culture humaine. Dans les deax cas, on refuse d'ad-
mettre le fait méme de la diversité culturelle;
fon préfere rejeter hors de Ja culture, dans la nature,
tout ce qui ne se conforme pas & la norme sous
Iaquelle on vit
Ce point de vue naif, mais profondément ancré
chez la plupart des hommes, n'a pas besoin d'tre
discuté puisque cette brochurs en constitue prévisé-
‘ment la réfutation, 11 suffira de remarquer fei qu'il
recdle un paradoxe assez sigificatif. Cette attitude
de pensée, au nom de laquele on rejette les « sau-
‘vages » (ou tous ceux quion choisit de considérer
‘comme tels) hors de Vhumanité, est justement Iati-
tude la plus marquante et Ia plus distinctive de ces
sauvages mémes. On eit, ea effet, que Ta notion
Thumanité, englobant, sans distinction de race ou
‘de civilisation, toutes les formes de Tespce humaine,
LIETHNOCENTRISME a
est d’appariion fort tardive et d'expansion limitée.
LA méme od elle semble avoir atteint son plus haut
développement, il n'est aullement certain — This-
toire révente le prouve — quelle soit établie & Pabsi
des. équivpques ou des ségressions. Mais, pour de
vastes tractions de Tespice humaine ot pendant des
dizaines de nillenaires, cette notion parait étre iota-
Jement abserte, L'humanité ceste aux frontitres de
a tribu, du groupe linguistique, parfois méme du
village ; 3 te! point qu'un grand nombre de popula-
tions dites primitives se désignent d'un nom qui
sigifie les « hommes > (ou parfois — dirons-nous
avec plus de discrétion — les « bons >, les « excel-
ents», Tes ou une « apparition >. Ainsi se réalisent de
ceurieuses situations ob deux interlocuteurs se don-
‘nent cruellement la réplique. Dans les Grandes
‘Antes, quelques années aprés la découverte de
Amérique, pendant que les Espagnols eavoyaient
des commissions d'enguéte pour rechercher si les
indigenes possédaient ou non une me, ces derniers
Kempleyaient A immerger des blancs prisonniers
afin de vérfie par une surveillance prolongée si leur
cadavre éait, ov non, sujet la putréfaction,
2 RACE ET HISTOIRE
Cette anecdote A Ia foie baroque et tengique
illustre bien le paradoxe du relativisme culturel (que
nous retrouverons ailleurs sous d'autres. formes) :
est dans la mesure méme od on prétend établi
‘une discrimination entre les caltures et Jes coutumes
{que Ton sidentife Je plus complétement avec celles
4quion estaye de nier. En refusant lhumanité a ceux
ui apparaisent comme les plus « sauvages > ot
‘cbarbares » de ses représentants on ne fait que leur
fempruuter une de louis attitudes typiques. Le bar-
bare, cst d’abord homme qui eroit a la barbaric.
Sans doute les grands systimes philosophiques et
religieux de Vhumanité — qu’ sagisse du boud-
diame, dx christionisme ou de I'elam, dos doctrines
stoieienne, Kantienne ou martiste — se sontils
cconstamment levés contre cette aberration. Mais
la simple proclamation de Tégalité naturelle entre
tous les hommes et de la fraternité qui doit les unit,
sans distinction de races ou de cultures, a quelque
chose de décevant pour Fesprit, parce qu'elle néglige
tune diversité de fait, qui simpose a Yobservation et
dont il ne sufft pas de dire quelle naffecte pas le
ond au probleme pour que Tou sult duéorlquesnent
ct pratiquement autorisé a faire comme si elle n'exis-
tait pas. Ainsi le préambule & la seconde déclaration
de Unesco sur le probléme des races remarque
jinliciensement que ee qui eenvaine homme de la
rue que les races existent, c'est I'e évidence immé
iate de ses sens quand il apergoit ensemble un
VETHNOCENTRISME 2
Africain, un Européen, un Asiatique et un Indien
Les grandes déclarations des droits de Thomme
ont, elles ausi, cette force et cette fablesse d'énon-
cer un idéal trop souvent oublicux du fait que
homme ne réalise pas sa natute dans une humanité
abstrate, mais dans des cultures traditionnelles oi
Jes changements les plus révolutionnaires Isissent
subsister des pans enters et s'expliquent eux-mémes
ex foaction June situation strictement définie dans
le temps et dans espace. Pris entre la double tenta-
tion de concamner des expériences qui le heurtent
aflectivement, et de ier des différences quil ne
comprend pas intellectuellement, homme moderne
ses livré 8 cent spéculations philosophiques et socio-
logiques pour établir de vains compromis entre ces
poles contradictoires, et rendre compte de la diver-
sité des cultures tout en cherchant & supprimer ce
quelle conserve pour lui de scandaleux et de-cho-
quant.
Mais, si dilérentes et parfois si bizartes qu'elles
pulssent étre, toutes ccs spéculations se raménent en
fait & une seule recette, que le terme de faux évolue
tionnisme est sans doute le mieux apte 3 caractériser.
En quoi cotsiste-lle? Trts exactement, il sagit
une tentative pour supprimer la diversité des cultur
tes tout en feignant de la reconnatre pleinement.
Cas, si Yon trite les differents états oli se trouvent
les sociétés tumaines, tant aucennes que lointaines,
comme des stades ou des é1apes d'un développement
Pry RACE BT HISTOIRE
unique qui, partant da méme point, doit les fa
converger ‘ers Je méme but, on voit bien que la
diversté nest plus qu’apperecte. Lihumanité devient
tune et ideatique & elle-méme ; seulement, cctte unité
et cette identité ne peuvent s réaliser que progres-
sement et la varieté ~des cultures lustre es
moments d'un processus qui dissimule une réalité
plus profonde ou en retarde Ia manifestation
Cette défnition peut paritre sommaire quand
fon a présent a esprit Jes immenses conquétes du
ddarwinisme. Mais celu-ci nlest pas en cause, car
Yévolutionnisme biologique et le pseudo-évolution-
nisme que nous avons ici en vue sont deux doctrines
rts différentes, La premitre est née comme une vaste
Dypomese de travail, fondée sur des observations
Ja part lassée & Vinterprétation est fort petite. Ainsi,
les différents types constiuant a _généalogie du
cheval peuvent étre rangés dans une série évolutive
pour deux raisons : la premire est quill faut un
cheval pour engendrer un cheval; la seconde, que
des couches de terrain superposées, donc historique-
ment de plus en plus anciennes, conticnnent des
squelettes qui varient de fagon graduelle depuis 1a
forme la plus resene Jusqu’ la plus archaigue. 1
devient ainsi hautement probable que Hipparion soit
Vancétre réel de Equus cabalus. Le méme raisoane~
‘ment s'applique sans doute 2 Tespece humaine et 2
se8 races. Mais quand on passe des faits biologiques
aux faits de culture, Jes choses se compliquent singu-
ligrement. On peut recueilir dans le sol des objets
LeTHNOCENTRISME 25
matéricls, ct constater que, selon la profondeur des
couches géologiques, Ia forme ou la technique de
fabrication dun certain type objet varie progres-
sivement. Et pourtant une hache ne donne pas phy-
siquement miissance & une hacke, a la fagon d'un
‘animal. Dire, dans ce dernier cas, qu'une hache a
Gvolué a partir d'une autre constitue donc une for-
mule métaphorique et approximative, dépourvue de
Ja rigueur scientifique qui sattache a Texpression
similaise appliquée aux phénoménes biologiques. Ce
qui est vrai objets matérels dont la présence physi-
que est attesiée dans Ie sol, pour des époques déter-
‘minables, Pest plus encore pour les institutions, les
croyances, les gots, dont le passé nous est générale-
‘ment inconnu. La notion d'évolution biologique
correspond i une hypothése dotée dun des plus
hhauts coefficients de probabilié qui puissent se ren-
contret dans le domaine des sciences naturelles;
tandis que la notion «’évolution sociale ou eulturelle
s'epporte, tout au plus, qu'un procédé séduisant,
‘mais dangereusement commode, de présentation dos
fits.
Diailleus, cette diférence, trop souvent négligée,
‘entre Je vrai et le faux évolutionnisme s'explique
par leurs dates d'appartion respectives, Sans doute,
Vévolutionnisme sociclogique devait recevoir une
spulsion vigoureuse de la patt de 'évolutionnisme
biologique + mais il Iui est antérieur dans les fats
‘Sans remonter jusqu’aux conceptions antiques, repri=
ses par Pascal, assimilant Vhumanité a un étre
26 RACE BT HISTOIRE
vivant qui pase pat les stades successifs de Menfance,
de Vadolescence et de Ja maturité, cst au xvi
sitele qu'on voit fleuris les schémas fondamentaux
‘qui seront, par Ia suite, Vobjet de tant de manipula
tions : les « sprales » de Vico, ses « trois ages »
‘annongant les «trois états » de Comte, 'e escaler >
de Condorcet, Les deux fordateurs de Pévolution-
nisme social, Spencer et Tylor, aborent et publient
leur doctrine avant Lorigin: des espéces ou sans
avwir lu cet ouvrage, Antéreur & F'évolutionnisme
biologique, théorie scientiique, 'évolutionnisme
social nest, trop souvent, que le maquillage fausse-
tment scientifique d'un vieux probléme philosophique
dont il n'est nullement certain que observation et
TTinduction puissent un jour fournir Ia clef
4
CULTURES ARCHAIQUES
ET CULTURES PRIMITIVES
Nous avons suggéré que chaque société peut, de
son propre point de vue, répartr es culties en trois
‘catégories celles qui sont ses contemporaines, mais
se trouvent sites en un autre lieu du globe ; celles
‘qui se sont manifestées approximativement dans le
méme espace, mais Yont précédée dans le temps ;
celle, enfin, qui ont existé la fois dans un temps
antéricur au sien et dans un espace différent de
‘celui ob elle se place.
‘On a vu que ces tris groupes sont ts inégale-
‘ment connaissables. Dans le cas du dernier, et quand
il s'act de exltures sans éeritute, sans architecture et
technique: rudimentaires (comme c'est le cas
ppour la moiié de la terre habitée et pour 90 & 99 %,
selon les régions, du laps de temps écoulé depuis te
début de Ia civilisation), on peut dire que nous ne
pouvons rier en savoir et que tout co qu'on essaie
de se présenter 3 leur suet se réduit & des hypothéses
gratuites.
Vous aimerez peut-être aussi
- HA2R505T-CC - Cultures Matérielles Antiques Et MédiévalesDocument2 pagesHA2R505T-CC - Cultures Matérielles Antiques Et MédiévalesTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- Archéologie Grecque - S2Document4 pagesArchéologie Grecque - S2Theo BrunelloPas encore d'évaluation
- Ethnologue-Video HTMLDocument1 pageEthnologue-Video HTMLTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- Habitat Médiéval. S-1Document3 pagesHabitat Médiéval. S-1Theo BrunelloPas encore d'évaluation
- HA2R504T-CC - de Néandertal À Sapiens. L'âge de Bronze en FranceDocument3 pagesHA2R504T-CC - de Néandertal À Sapiens. L'âge de Bronze en FranceTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- UntitledDocument8 pagesUntitledTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- Ae00201t CC Brunello Theo Univ Tlse2 21810227Document3 pagesAe00201t CC Brunello Theo Univ Tlse2 21810227Theo BrunelloPas encore d'évaluation
- Ha00201t Brunello Theo 21810227 TD09Document5 pagesHa00201t Brunello Theo 21810227 TD09Theo BrunelloPas encore d'évaluation
- UntitledDocument2 pagesUntitledTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- Ueha00102t Brunello Theo 21810227 TD01Document5 pagesUeha00102t Brunello Theo 21810227 TD01Theo BrunelloPas encore d'évaluation
- Sujet D'Examen: Vous Traiterez Chacun Des Deux Sujets Suivants, À Déposer en Deux Fichiers SéparésDocument2 pagesSujet D'Examen: Vous Traiterez Chacun Des Deux Sujets Suivants, À Déposer en Deux Fichiers SéparésTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- Paul. La Technique Baroque Du Clair-Obscur Utilisée Pour Ce Tableau Permet de Rendre PerceptibleDocument3 pagesPaul. La Technique Baroque Du Clair-Obscur Utilisée Pour Ce Tableau Permet de Rendre PerceptibleTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- Ueha00101t Brunello Theo ValdeyronDocument3 pagesUeha00101t Brunello Theo ValdeyronTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- Brunello Theo HA2R305TDocument1 pageBrunello Theo HA2R305TTheo BrunelloPas encore d'évaluation
- Plantes Vikings 1Document3 pagesPlantes Vikings 1Theo BrunelloPas encore d'évaluation
- Ae00404t Brunello Theo 21810227Document4 pagesAe00404t Brunello Theo 21810227Theo BrunelloPas encore d'évaluation