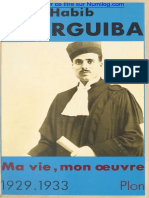Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Affects Et SC Pol SCPO - MUXEL - 2014 - 01 - 0061
Affects Et SC Pol SCPO - MUXEL - 2014 - 01 - 0061
Transféré par
Hichem AbdouTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Affects Et SC Pol SCPO - MUXEL - 2014 - 01 - 0061
Affects Et SC Pol SCPO - MUXEL - 2014 - 01 - 0061
Transféré par
Hichem AbdouDroits d'auteur :
Formats disponibles
3.
LES AFFECTS EN POLITIQUE
Ce qu'en dit la science politique
Pascal Perrineau
in Anne Muxel, La vie privée des convictions
Presses de Sciences Po | « Académique »
2014 | pages 61 à 74
ISBN 9782724614657
Article disponible en ligne à l'adresse :
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/la-vie-privee-des-convictions---page-61.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.
© Presses de Sciences Po. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Chapitre 3 / LES AFFECTS EN POLITIQUE
CE QU’EN DIT LA SCIENCE POLITIQUE
Pascal Perrineau
L
a politique ne peut se réduire, en dépit des rêves positivistes de
nombre de sociologues du xixe siècle, à la gestion rationnelle de
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
la vie commune. La politique, que ce soit dans l’espace privé ou
l’espace public, est le théâtre des passions et des affects. Amours et
haines, espoirs et déceptions, identifications et rejets, introjections et
projections, sont à l’œuvre et traversent la vie politique, les institu-
tions, les attitudes et les comportements politiques. D’ailleurs, gouver-
nants et médias jouent avec ce système d’affects, avec ces passions,
et tentent de susciter des émotions favorables à leur cause. Du côté
des gouvernés, ce sont des « citoyens sentimentaux » qui, à travers
des filtres émotionnels, saisissent les informations et élaborent leurs
choix et orientations politiques 1. En dépit de ce très riche tissu d’af-
fects, la science politique s’est longtemps montrée, particulièrement
en France, très réticente à intégrer dans ses analyses ce registre des
émotions et des affects.
Les réticences de la science politique
à prendre en compte la dimension
psycho-affective du politique
La science politique s’est construite en France à partir d’héritages
positivistes – le droit, la sociologie durkheimienne, la géographie,
etc. – qui l’ont conduite à privilégier des objets déjà construits, aisé-
ment identifiables et mesurables. Dans ce paysage scientifique dominé
par la rassurante collecte des « faits » et par le primat épistémologique
selon lequel seul « le social peut expliquer le social », il n’y avait que
1. George E. Marcus, Le Citoyen sentimental : émotions et politique en
démocratie, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
9782724614657.indb 61 18/12/13 13:26
62
La vie privée des convictions
peu de place pour les processus émotionnels. Gabriel Tarde ou encore
Gustave Le Bon, qui s’intéressaient à la dimension psychologique des
phénomènes politiques et sociaux, ont été marginalisés et leur statut
scientifique contesté 2.
Le rationalisme est un autre héritage déterminant. Notre culture
intellectuelle a mis la raison au cœur de notre dispositif intellectuel et
moral, et ce processus de rationalisation, engagé dès la Renaissance,
a fortement touché nos représentations du champ politique. Cette
trace est particulièrement sensible dans la définition républicaine
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
du citoyen « maître de ses passions ». Celle-ci s’appuie sur la pri-
mauté de la raison individuelle et de l’autonomie morale du citoyen
et rejette tous les éléments singuliers de son histoire, de ses origines,
de sa naissance, de sa famille, ou encore de sa culture, dans l’enfer
de l’irrationnel et de l’affect. Seule la raison, à en croire cet héritage,
peut fonder la dignité et la valeur de la personne et du citoyen 3. Une
raison à laquelle on va rendre un véritable culte dans ces fêtes de la
Raison et de l’Être suprême dont Mona Ozouf a si bien rendu compte4.
Dans le moment révolutionnaire de 1789 et des années qui suivent,
le culte de la Raison, lié à la déchristianisation, est considéré comme
le vecteur de la fin des superstitions et de l’irrationnel. Lors de son
discours sur l’instruction publique du 5 novembre 1793 devant la
Convention, Marie-Joseph Chénier précise qu’il s’agit de fonder « sur
les débris des superstitions détrônées la seule religion universelle […]
qui fait des citoyens et non des sujets […], qui n’a ni sectes ni mystères,
dont le seul dogme est l’Égalité, dont les lois sont les oracles, dont les
magistrats sont les pontifes […] 5 ».
2. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris, PUF, 2003 [1re éd. 1895] ;
Gabriel Tarde, Les Lois de l’imitation : étude sociologique, Paris, Slatkine,
1979 [1re éd. 1890], et L’Opinion et la Foule, Paris, PUF, 1989 [1re éd. 1901].
3. Dans l’ouvrage qu’il consacre à l’analyse des manuels de morale et d’ins-
truction civique des deux écoles laïque et catholique, Yves Déloye distingue
une définition républicaine du citoyen appuyée sur la primauté de la raison
individuelle dans la première et une conception davantage organique et
affective dans la seconde (École et citoyenneté. L’individualisme républicain
de Jules Ferry à Vichy : controverses, Paris, Presses de Sciences Po, 1994).
4. Mona Ozouf, La Fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976.
5. Marie-Joseph Chénier, Œuvres, t. 5, Paris, Guillaume, 1826, p. 130.
9782724614657.indb 62 18/12/13 13:26
63
Les affects en politique
Un siècle plus tard, dans ce grand moment républicain qu’est, à la fin
du xixe siècle, l’affaire Dreyfus, s’opposent « deux France » désireuses
d’imposer, l’une et l’autre au nom de la « raison » ou de la « tradition »,
leur propre conception de l’identité nationale. La première défend un
modèle de la nation à la française, modèle universaliste imaginé par
les hommes de 1789 et prolongé plus tard sous la IIIe République. Une
nation constituée de citoyens égaux (rejetant les différences de classe,
de religion et de culture) qui sont avant tout des « êtres de raison ».
Gabriel Compayré, dans ses Éléments d’instruction morale et civique,
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
développe cette approche d’une raison qui seule peut protéger des
dogmes, des passions et des survivances du passé : « L’homme est
raisonnable et libre. L’animal ne l’est pas. La raison, c’est la faculté de
juger, entre plusieurs actions possibles, celle qu’il convient de faire […].
La raison réfléchit, délibère, juge ; la liberté se décide et agit. La liberté
de l’homme n’est pas illimitée : il y a bien des choses, soit dans notre
âme, soit dans notre corps, sur lesquelles nous ne pouvons rien 6. » La
seconde, celle qui réfère à la tradition, s’attache à la nation revendiquée
par les mouvements nationalistes et pensée selon un modèle identitaire
fondé sur l’appartenance ethnique. Ainsi, la nation se retrouve-t-elle
expurgée de ses éléments étrangers. C’est cette conception organique
que porte, par exemple, Maurice Barrès dans son discours « La Terre
et les Morts », prononcé en 1889, où l’individu ne trouve place dans
la nation qu’au travers de « l’acceptation d’un déterminisme », celui
d’une collectivité nationale considérée comme un véritable organisme
vivant avec ses exigences et sa force sentimentale : « On ne fait pas
l’union sur des idées, tant qu’elles demeurent des raisonnements ; il
faut qu’elles soient doublées de leur force sentimentale. À la racine de
tout, il y a un état de sensibilité. »
À une France universaliste et rationaliste s’oppose donc une France
nationaliste, plongée dans l’affect, « une France de chair et d’os » pour
reprendre la terminologie de Maurice Barrès qui, dans Le Roman de
l’énergie nationale 7, refusait que son intelligence ne se dégrade « en
laissant s’atrophier en [lui] les qualités délicates de la vie affective ».
6. Gabriel Compayré, Éléments d’instruction morale et civique, Paris,
Delaplane, 1883, cité par Yves Déloye, École et citoyenneté, op. cit., p. 46.
7. T. 3 : Leurs figures, Paris, Juven, 1902.
9782724614657.indb 63 18/12/13 13:26
64
La vie privée des convictions
Face à cette conception affective et romantique, une conception morale
de la politique, dont nous sommes encore aujourd’hui largement les
héritiers, conduit à une méfiance généralisée des passions, des affects
et des sentiments, qui sont jugés perturbateurs et même contraires à
notre idéal démocratique et républicain.
Comme toute discipline jeune à la recherche de son identité intellec-
tuelle et institutionnelle, la science politique a voulu tenir à distance
d’autres savoirs qui se sont, eux, beaucoup intéressés aux relations
entre émotions et politique, notamment ces deux savoirs essentiels
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
que sont la théorie politique et la psychanalyse. De la Renaissance aux
Lumières, la question des passions et des affects a été traitée comme
l’objet par excellence de la théorie politique. On s’éloigne alors d’une
perspective où les passions et les affects étaient avant tout pensés
sous l’angle du péché. En effet, la philosophie augustinienne – et son
triptyque de convoitises pécheresses : le désir de chair, le désir de
richesse et le désir de pouvoir, la libido dominandi – a été longtemps
dominante. Saint Augustin identifiait le mal moral à la passion qui
n’est qu’un mouvement irrationnel de l’âme que l’homme partage avec
les bêtes8. La théorie politique, à partir de la Renaissance, s’efforce de
penser la question des passions sous l’angle de la « nature humaine ».
La difficulté politique se pose en ces termes : comment contrôler,
contenir ou canaliser les passions lorsqu’elles sont celles du Prince ou
du Peuple et lorsqu’elles risquent de faire naître l’arbitraire ou la vio-
lence ? Du xv e au xviiie siècle, tous les penseurs politiques (Machiavel,
Spinoza, Hobbes, Smith, etc.) vont s’ingénier à proposer des stratégies
de gouvernement des passions ou de recyclage des affects derrière la
notion d’« intérêts ».
Pour comprendre la dynamique temporelle de ce processus, Albert
Hirschman9 va mettre au jour un processus d’inversion normative qui
a accompagné la naissance du capitalisme et vu les affects dominants
du Moyen Âge être subvertis. Au Moyen Âge, les valeurs nobiliaires
dominantes sont l’honneur, la recherche de la gloire et l’amour de soi.
Ces affects dominants définissent un idéal chevaleresque d’aristocrates
qu’ont su illustrer des littérateurs comme Pierre Corneille et la figure
8. Saint Augustin, Traité du libre arbitre, livre 1, 395.
9. Albert O. Hirschman, Les Passions et les Intérêts, Paris, PUF, 1980.
9782724614657.indb 64 18/12/13 13:26
65
Les affects en politique
du Cid. À cette époque, l’appât du gain est au contraire perçu comme
un sentiment médiocre caractéristique de la bourgeoisie et du vulgaire.
Quelques siècles plus tard, ce sont d’autres valeurs qui s’imposent.
La cupidité et l’appât du gain sont devenus autant de capacités de capi-
talisation personnelle, fondatrices d’un nouvel ordre social. Albert
Hirschman interroge : « Comment se fait-il qu’on en soit venu à consi-
dérer comme honorables des activités lucratives telles que le commerce
et la banque ? » Pour répondre, Hirschman revient à la période de la
Renaissance. Il constate à cette époque que le vieil affect de la quête
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
d’honneur suscite de plus en plus des conduites irrationnelles comme
celle que prête, au début du xvii e siècle, Miguel de Cervantès à « l’in-
génieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche ». Les cours d’Europe
regorgent alors de notables qui agissent avec, comme visée principale,
la satisfaction de leur propre grandeur, cédant pour cela aux passions
les plus irréfléchies.
Convaincus que cet abandon aux passions ne peut servir ni les princes
ni les sujets, plusieurs philosophes entreprennent de déconstruire l’idéal
du héros pour entamer une réflexion nouvelle qui vise à comprendre
« les hommes tels qu’ils sont », dit Spinoza : « Les philosophes conçoivent
les affects qui se livrent bataille en nous comme des vices dans lesquels
les hommes tombent par leur faute ; c’est pourquoi ils ont accoutumé
de les tourner en dérision, de les déplorer, de les réprimander ou, quand
ils veulent paraître plus vertueux, de les détester. Ils croient ainsi agir
divinement et s’élever au faîte de la sagesse, prodiguant toutes sortes
de louanges à une nature humaine qui n’existe nulle part, et flétris-
sant par leurs discours celle qui existe réellement. Ils conçoivent les
hommes, en effet, non tels qu’ils sont, mais tels qu’eux-mêmes vou-
draient qu’ils fussent : de là cette conséquence que la plupart, au lieu
d’une Éthique, ont écrit une Satire, et n’ont jamais eu, en Politique,
de vues qui puissent être mises en pratique, la Politique, telle qu’ils la
conçoivent, devant être tenue pour une Chimère […] 10. »
10. Baruch Spinoza, Traité politique (1677), chap. 1, § 1-2, trad. fr. Charles
Appuhn (légèrement modifiée), dans Œuvres, t. 4, Paris, Garnier-Flammarion,
1966, p. 11-12.
9782724614657.indb 65 18/12/13 13:26
66
La vie privée des convictions
De Machiavel à Hobbes 11, une analyse similaire rassemble sur le
constat suivant : à « l’état de nature », l’homme est dangereux, c’est
un « loup pour l’homme » car prisonnier de ses passions. La nature
humaine étant ainsi posée, comment la contrôler ? Comment mettre en
place une police efficace des passions ? Chaque théoricien apportera sa
pierre : l’État répressif pour Hobbes ou, pour Vico 12 ou Mandeville 13,
la volonté de transformer les passions individuelles en intérêt public,
les vices privés pouvant contribuer à façonner le bien public. De toutes
ces entreprises théoriques, peu à peu va se dégager une idée neuve et
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
forte : le meilleur remède à la puissance des passions est à chercher
dans les passions elles-mêmes.
Les passions ne sont plus considérées comme un tout homogène, il
y a des passions négatives et des passions positives. Il faut canaliser
les premières par l’usage des secondes. C’est le principe de la « passion
compensatrice » mis en avant par nombre de philosophes du xviie siècle
(Bacon, Spinoza, Hume, etc.). Les passions individuelles et les intérêts
particuliers peuvent se neutraliser au profit d’un bien commun har-
monieux. Naît l’idée que l’appât du gain peut être un frein à l’amour-
propre et à la recherche de la gloire. Cette inversion de l’ordre normatif
se produit à l’aide d’une mutation terminologique : la « passion du
gain » devient simple « intérêt ».
Les penseurs vont alors s’évertuer à démontrer les vertus sociales
d’un monde où priment les intérêts particuliers. Il y aurait une vraie
vertu pacificatrice des activités lucratives, de ce que Montesquieu
appelle « l’esprit de commerce »14 : « Le commerce guérit des préjugés
destructeurs ; et c’est presque une règle générale, que partout où il y
a des mœurs douces, il y a du commerce ; et que partout où il y a du
commerce, il y a des mœurs douces. »
11. Nicolas Machiavel, Le Prince, Paris, Ivrea, 2001 [1re éd. 1532] ; Thomas
Hobbes, Léviathan, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2001 [1re éd. 1651].
12. Gianbattista Vico, La Science nouvelle, Paris, Gallimard, 1993
[1re éd. 1725].
13. Bernard Mandeville, La Fable des abeilles, Paris, Institut Coppet, 2011
[1re éd. 1714].
14. Dans De l’esprit des lois publié pour la première fois à Genève en 1748,
Montesquieu écrit : « L’effet naturel du commerce est de porter à la paix ».
9782724614657.indb 66 18/12/13 13:26
67
Les affects en politique
Ainsi, comme on peut le constater, la théorie politique a été prolixe
sur le rôle des affects, leurs mutations et recompositions, leur carac-
tère organisateur des systèmes sociaux et politiques. Mais nombre
de courants très sociologistes de la science politique rejettent cette
réflexion dans l’enfer de la pensée normative, a- ou anti-scientifique.
Alors, que dire de leur réticence vis-à-vis de la psychanalyse ! En
soulignant le rôle des affects et des mécanismes de l’inconscient dans
le psychisme individuel, la psychanalyse invite la science du politique
à jeter un autre regard sur les mécanismes réels qui sont en œuvre
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
dans les institutions et les relations de pouvoir.
Quels sont les rôles d’affects comme le sentiment de convoitise, de
frustration ou d’estime de soi dans l’action publique des hommes poli-
tiques et dans les orientations politiques des citoyens ? Quelles rela-
tions complexes lient une foule à son chef politique dans des situations
totalitaires ? Quel exutoire trouvent les pulsions fondamentales (de vie
et de mort) sur la scène politique ? Quelle place accorder au sentiment
d’honneur et au ressentiment dans les processus révolutionnaires ?
Se poser toutes ces questions, c’est admettre le principe d’un intérêt
à regarder autrement les phénomènes politiques qu’au travers des
seules lunettes sociologiques. Le concept d’inconscient permet alors
de penser l’impossible maîtrise de l’homme sur lui-même et de mettre
au jour les limites – et non pas l’inanité – des explications des com-
portements humains à partir de variables qui situent l’homme dans
un système de positions démographiques, sociales, culturelles et poli-
tiques. Vis-à-vis de cette matrice de positions objectives se trouve
une matrice décisive de positions subjectives, enracinées dans les
formations de l’inconscient, formations (rêve, lapsus, symptômes, etc.)
qui traduisent l’existence dans un autre lieu que la conscience, d’un
texte qui se manifeste, au prix de déformations et de déplacements,
de métaphores et de métonymies, dans la conscience. L’interprétation
psychanalytique permet alors, à partir de ce contenu manifeste, de
déchiffrer un contenu latent. Il n’y a que peu d’analyses de ce type
sur l’objet politique. Cependant, Sigmund Freud lorsqu’il écrit, à l’été
1929, Malaise dans la culture 15 nous montre comment, au cœur de la
15. Sigmund Freud, Malaise dans la culture, Paris, PUF, 2004 [1re éd. 1929].
9782724614657.indb 67 18/12/13 13:26
68
La vie privée des convictions
vieille culture européenne, la pulsion de mort peut offrir un espace au
retour d’idéologies politiques mortifères. Le père de la psychanalyse
constate, dans sa réflexion désenchantée, une certaine naïveté portée
par les progrès de la culture et de la raison : « l’homme n’est pas un
être doux, en besoin d’amour, qui serait tout au plus en mesure de se
défendre quand il est attaqué, mais […], au contraire, il compte aussi
à juste titre parmi ses aptitudes pulsionnelles une très forte part de
penchant à l’agression. […] Homo homini lupus. Qui donc, d’après toutes
les expériences de la vie et de l’histoire, a le courage de contester
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
cette maxime ? » Wilhelm Reich cherche, à la même époque, à percer
les mystères de la propagande nazie à partir de la « psychologie des
profondeurs »16. Harold Dwight Lasswell, dans une optique beaucoup
plus behavioriste, présente à la même époque une analyse très forte
des mécanismes de manipulation psychologique qui sont à l’œuvre
dans la propagande nazie 17. Dans les années d’après-guerre, Theodor
Adorno, dans The Authoritarian Personnality 18, montre comment
les comportements fascistes et antidémocratiques s’enracinent dans
des traits de personnalité. Cette tradition de l’étude des structures
de la personnalité comme soubassements des choix et orientations
politiques sera poursuivie particulièrement aux États-Unis 19. En
France, l’approche psychologique notamment inspirée par les grilles
d’interprétation de la psychanalyse a été très développée par Philippe
Braud qui, du comportement électoral des citoyens aux ressorts de
l’adhésion aux régimes démocratiques, est parti à la recherche des
bases psycho-émotionnelles du politique20. Mais, au-delà de ce travail
16. Wilhelm Reich, La Psychologie de masse du fascisme, Paris, Petite
bibliothèque Payot, 1977 [1re éd. 1933].
17. Harold D. Lasswell, Psychopathology and Politics, Chicago (Ill.),
University of Chicago Press, 1986 [1re éd. 1930].
18. Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswick, Daniel J. Levinson et
R. Nevitt Sanford, Études sur la personnalité autoritaire, trad. fr. Hélène
Frappat, Paris, Allia, 2007 [1re éd. 1950].
19. Fred Greenstein, Personality and Politics. Problems of Evidence:
Inference and Conceptualization, Chicago (Ill.), Markham, 1969 ; William
P. Kreml, The Anti-Authoritarian Personality, Oxford, Pergamon Press,
1977 ; Patrick Sniderman, Personnality and Democratic Politics, Berkeley
(Calif.), University of California Press, 1975.
20. Philippe Braud, Le Comportement électoral en France, Paris, PUF, 1973,
Le Suffrage universel contre la démocratie, Paris, PUF, 1980, Le Jardin des
délices démocratiques, Paris, Presses de Sciences Po, 1991, et Petit traité
9782724614657.indb 68 18/12/13 13:26
69
Les affects en politique
solitaire, relativement rares sont les auteurs français qui ont exploré
ce substrat émotionnel à partir d’une entrée philosophique 21 ou de
la grille analytique 22.
À toutes ces préventions de la science politique contre l’interpré-
tation des phénomènes politiques au travers des systèmes d’affects, il
faut peut-être encore ajouter deux mouvements de la pensée qui ont
conduit à minimiser et à contester le rôle des émotions en politique.
D’un côté, les usages qui ont été faits par les totalitarismes des émo-
tions en matière politique ont entaché d’une aura négative les analyses
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
des sociologues qui avaient pris au sérieux l’impact des émotions dans
les phénomènes politiques collectifs. Les analyses des comportements
pathologiques de la foule agissant d’un seul bloc et de façon déraison-
nable23 ont pu contribuer à discréditer l’usage de la catégorie des émo-
tions dans la science politique. Or, en France, la sociologie dominante
durkheimienne s’est construite largement contre la psychologie sociale
du type de celle de Gabriel Tarde qui insistait sur les explications des
comportements en termes de contagion mimétique ou d’imitation.
D’un autre côté, les émotions et les passions ont été largement exclues
du champ de l’analyse parce que les intérêts et le calcul utilitaire ont
semblé être les plus pertinents pour comprendre les comportements.
À cet égard, la fin du xviiie siècle où s’impose en économie politique le
paradigme de l’intérêt est tout à fait décisive24. Les approches en termes
de « choix rationnel », aujourd’hui dominantes, reposent entièrement
sur le postulat selon lequel les émotions peuvent être négligées au
bénéfice de calculs fondés sur la maximisation de son intérêt personnel.
des émotions, sentiments et passions politiques, Paris, Armand Colin, 2007.
21. Pierre Ansart, La Gestion des passions politiques, Lausanne, L’Âge
d’homme, 1983.
22. Eugène Enriquez, De la horde à l’État : essai de psychanalyse du lien
social, Paris, Gallimard, 1983, et Clinique du pouvoir : les figures du maître,
Toulouse, Érès, 2012 ; Raphaël Draï, La Politique de l’inconscient, Paris,
Payot, 1978 ; Pierre Legendre, Jouir du pouvoir : traité de la bureaucratie
patriote, Paris, Minuit, 1976, et L’Amour du censeur : essai sur l’ordre
dogmatique, Paris, Seuil, 2005 ; Michel Schneider, Big Mother : psycho-
pathologie de la France politique, Paris, Odile Jacob, 2002.
23. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, op. cit. ; Gabriel Tarde, Les
Lois de l’imitation, op. cit., et L’Opinion et la foule, op. cit. ; Vilfredo Pareto,
Traité de sociologie générale, Lausanne, Payot, 1917.
24. Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations, Paris, Gallimard, 1976 [1re éd. 1776].
9782724614657.indb 69 18/12/13 13:26
70
La vie privée des convictions
De quelques regards de la science politique
sur le rôle des affects en matière politique
Dans un bilan publié dans Traité de science politique 25, Madeleine
Grawitz constatait la grande faiblesse de ce qu’elle appelait la psy-
chologie politique – particulièrement en France – et distinguait trois
niveaux dans les études essentiellement anglo-saxonnes réalisées sur
le sujet : l’analyse du poids des affects sur les comportements poli-
tiques des individus ; l’analyse des affects sur le leadership politique
(qui fait de la politique, pourquoi et comment ?) ; l’analyse du poids
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
des affects dans les groupes. Si l’on retient la manière dont la poli-
tique s’immisce dans la sphère affective et intime des individus, seule
la première dimension nous intéresse. Comment les comportements
politiques et les comportements affectifs et intimes des individus se
tissent ou interférent entre eux ?
Sur ce registre, Madeleine Grawitz distingue trois ensembles de
recherches et d’approches. Tout d’abord, les approches qui partent à la
recherche des sources biologiques et éthologiques de quelques affects
fondamentaux chez l’homme. D’importants travaux ont été menés dans
ce domaine qui a été et reste l’objet de fortes polémiques initiées, dès
les années 1970, contre la sociobiologie. On peut penser aux travaux
d’Hans Jürgen Eysenck qui insistent sur l’homme comme animal bio-
social 26, à ceux de Konrad Lorenz sur l’agressivité qui généralisent
la théorie anthropologique du « bouc émissaire » 27, ou encore aux
recherches d’Albert Somit qui montrent la difficile émergence de la
forme démocratique dans un contexte où les primates sociaux que nous
sommes seraient génétiquement prédisposés aux structures sociales
et politiques autoritaires 28.
25. Madeleine Grawitz et Jean Leca (dir.), Traité de science politique, t. 3 :
L’action politique, Paris, PUF, 1985.
26. Hans Jürgen Eysenck, The Psychology of Politics, Londres, Routledge
& K. Paul, 1954.
27. Konrad Lorenz, L’Agression : une histoire naturelle du mal, Paris,
Flammarion, 1969.
28. Albert Somit, Biology and Political Behavior: the Cutting Edge, Bingley,
Emerald, 2011.
9782724614657.indb 70 18/12/13 13:26
71
Les affects en politique
Ces travaux insistent beaucoup sur une dimension instinctuelle des
grands affects à l’œuvre dans le champ politique : défense du territoire,
capacité de violence et d’agressivité, volonté de domination ou de sou-
mission, etc. Par exemple, dans un chapitre d’ouvrage publié en 197629,
David Schwartz défend l’idée selon laquelle la moindre participation
politique des femmes s’enracinerait dans les différences hormonales
existant entre hommes et femmes qui entraînent d’inégales prédispo-
sitions à l’agressivité. Dans cette optique, les tropismes politiques des
individus sont inscrits dans un registre instinctuel qui est activé ou
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
non selon les circonstances. La scène intime comme la scène publique
n’est qu’un lieu d’expression de ces registres fondamentaux inscrits
dans une « nature humaine ». Le privé et le public ne sont que des
« circonstances particulières » qui permettent ou non à ces registres
instinctuels de s’exprimer.
Madeleine Grawitz distingue ensuite les approches qui explorent
les sources contextuelles des affects. Le behaviorisme, par exemple,
analyse les comportements comme autant de réponses à des stimuli
venant du contexte ou de l’environnement de l’individu. Dans cette
perspective, on ne s’intéresse plus seulement aux facteurs endogènes
(instinctuels) des affects et des comportements. Ceux-ci sont considé-
rés comme le fruit d’apprentissages qui se construisent en réaction à
des incitations venues de l’extérieur de l’individu. L’analyse d’André
Siegfried relative au vote du granit et du calcaire dans la France de
l’ouest sous la IIIe République s’inscrit dans cette veine. C’est un envi-
ronnement physique qui va mettre en scène un registre d’affects et
de comportements : « Il faut insister sur cette armature géologique
et notamment sur la limite essentielle entre la Plaine et le Bocage,
parce que tout le reste en dépend. […] La Plaine est acquise à l’œuvre
de la révolution, soit sous la forme républicaine, soit sous la forme du
bonapartisme démocratique ; mais le Bocage demeure obstinément
fidèle aux champions de l’Ancien Régime 30. » L’armature géologique
a mis en place une certaine occupation de l’espace (habitat dispersé,
29. Albert Somit (dir.), Biology and Politics: Recent Explorations, Paris,
Mouton, 1976.
30. André Siegfried, Tableau politique de la France de l’ouest sous la
IIIe République, Paris, Armand Colin, 1980 [1re éd. 1913].
9782724614657.indb 71 18/12/13 13:26
72
La vie privée des convictions
habitat concentré) qui elle-même a engendré des rapports socio-éco-
nomiques particuliers (grande propriété, petite propriété), porteurs de
systèmes de valeurs et d’orientations politiques spécifiques (soumis-
sion à la hiérarchie, démocratie égalitaire). Affects et choix politiques
sont ainsi l’expression de contextes spatiaux et sociaux particuliers.
Pour ce qui nous intéresse, dans cette optique, l’intimité peut être
perçue comme un environnement spécifique imposant des contraintes
propres (et différentes de l’espace public) sur les affects et les com-
portements politiques.
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
Enfin, Madeleine Grawitz considère les approches qui partent à la
recherche des sources psychiques des affects et des comportements
politiques (analyse des personnalités). Ici, l’individu n’est pas un être
rationnel et son comportement dépend en partie de forces psychiques
qu’il ne maîtrise pas. La plupart de ces approches débouchent sur une
analyse en termes de personnalité comme ensemble de traits psy-
chiques définissant une véritable structure de production d’attitudes,
de comportements, d’affects et d’opinions dans les domaines person-
nel, social et politique 31.
À partir des cadres fixés par ces auteurs, de nombreuses recherches
vont développer la mise au jour de personnalités étudiées du point de
vue descriptif et analytique : la personnalité est alors un ensemble de
croyances, de jugements, d’opinions et d’attitudes (aspect cognitif et
affectif) qui se traduit en actions et en comportements (aspect conatif).
L’approche la plus marquante et la plus prestigieuse dans ce
domaine est bien sûr l’œuvre de Theodor Adorno et ses collabora-
teurs Else Frenkel-Brunswick, Daniel Levinson et Nevitt Sanford : The
Authoritarian Personnality 32. L’hypothèse de base de cette recherche
engagée dans l’immédiat après-seconde guerre mondiale est la sui-
vante : « Les convictions politiques, économiques et sociales d’un
individu constituent souvent un schéma large et cohérent. Elles sont
31. Kurt Lewin, Psychologie dynamique : les relations humaines, Paris,
PUF, 1959 ; Gordon Willard Allport, Personality: A Psychological
Interpretation, New York (N. Y.), H. Holt & Company, 1939 ; Carl Ransom
Rogers, Le Développement de la personne, Paris, Dunod, 1966 ; Abraham
Harold Maslow, Motivation and Personality, New York (N. Y.), Harper &
Row, 1970.
32. Trad. fr. Études sur la personnalité autoritaire, op. cit.
9782724614657.indb 72 18/12/13 13:26
73
Les affects en politique
liées entre elles par une mentalité ou un esprit et ce schéma est
l’expression de tendances profondes de sa personnalité ». Ainsi, au
départ, chaque individu est défini par un syndrome, un ensemble
de traits psychiques et culturels qu’il possède et qui vont définir ses
orientations et ses attitudes.
Les auteurs étudient plusieurs traits de personnalités et plusieurs
systèmes d’attitudes : l’antisémitisme, l’ethnocentrisme et le conser-
vatisme, mesurés entre autres par des échelles d’attitudes. À partir
des corrélations entre ces différents traits, ils définissent une échelle
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
de prédisposition au fascisme (échelle F). Toutes ces corrélations font
apparaître un syndrome clair : celui d’une personnalité autoritaire,
potentiellement fasciste, prête à participer à des mouvements anti
démocratiques et sensible à la propagande antisémite. Ce syndrome,
cette personnalité a plusieurs composantes psychiques fortes et lourdes :
des réactions moralisantes très conventionnelles, une tendance à la
soumission, une certaine agressivité, une nette désapprobation vis-à-
vis d'une vie sentimentale trop libre, l’utilisation de jugements stéréo-
typés, le recours à des superstitions comme moyen de fuir ses propres
responsabilités, une éducation sévère, etc. C’est à partir de cette matrice
organisée autour d’affects forts et fondamentaux que sont produits les
jugements et les comportements politiques.
Plus tard, ces analyses seront élargies aux personnalités autoritaires
de gauche et plusieurs recherches montreront que l’esprit fermé n’est
pas le seul apanage de la droite fasciste ou du fanatisme religieux 33.
Un courant de sociologues de l’action collective, dans la perspective
ouverte par Jeff Goodwin, James Jasper et Francesca Polletta 34, a
pris en compte la dimension émotionnelle des mouvements sociaux
et travaillé sur les « dispositifs de sensibilisation » déployés dans les
mobilisations sociales 35.
33. Cf. Hans Jürgen Eysenck, The Psychology of Politics, op. cit. ; Milton
Rokeach, The Open and Closed Mind: Investigations in the Nature of Belief
Systems and Personnality Systems, New York (N. Y.), Basic Books, 1960.
34. Jeff Goodwin, James M. Jasper et Francesca Polletta (eds), Passionate
Politics: Emotions and Social Movements, Chicago (Ill.), University of
Chicago Press, 2001.
35. Christophe Traïni (dir.), Émotions… Mobilisation !, Paris, Presses de
Sciences Po, 2009.
9782724614657.indb 73 18/12/13 13:26
74
La vie privée des convictions
Il faut enfin ajouter à toutes ces approches un courant qui se déve-
loppe aux États-Unis dans la perspective théorique de l’intelligence
affective 36. Il s’agit de dépasser l’opposition classique du rationnel et
de l’irrationnel dans la mesure où le citoyen qui est à la recherche
de bénéfices tente de minimiser des coûts qui sont à la fois d’ordre
rationnel et émotionnel. Dans son texte sur le « citoyen sentimental »,
George Marcus, fort des acquis des neurosciences, écrit : « Je soutiens
la thèse radicale selon laquelle les gens peuvent être rationnels pré-
cisément parce qu’ils sont sujets aux émotions : ce sont ces dernières
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
© Presses de Sciences Po | Téléchargé le 20/05/2021 sur www.cairn.info via Université Paris 8 (IP: 193.54.174.3)
qui permettent la rationalité. Ou encore nos facultés émotionnelles
(emotional faculties) sont davantage en harmonie avec notre capacité
à être rationnels. La raison n’est pas une faculté autonome de l’esprit,
indépendante des émotions 37. »
Qu’il soit pensé en rupture avec la rationalité ou étroitement arti-
culé à elle, le système d’affects doit donc être considéré comme une
véritable « infrastructure » des choix et des tropismes politiques. Dans
cette perspective, l’affectivité profonde de chaque individu produit
en quelque sorte son système d’orientations politiques, indépendam-
ment, dans une large mesure, des conditions sociales, économiques
et culturelles. Cette politique « affective » trouve-t-elle des conditions
d’expression différentes selon qu’elle s’exprime sur la scène publique
ou sur la scène privée ? Le soubassement affectif est-il prépondérant,
ou bien les scènes d’expression des choix politiques jouent-elles un rôle
décisif ? La scène privée ne conduit-elle pas à des dissimulations, des
recompositions, des compromis plus importants que la scène publique
où c’est l’abstraction du citoyen qui s’exprime dans la seule unidimen-
sionnalité de la politique, un citoyen non encombré de la multitude de
rôles caractéristique de la scène privée (par exemple, pour un homme :
le fils de…, le mari de…, le père de…, le frère de…, l’ami de…, etc.) ?
Une multidimensionnalité de la scène privée où l’unidimensionnalité
apparente du choix politique de la scène publique doit difficilement
trouver son ou ses chemin(s) d’expression.
36. George E. Marcus, W. Russell Neuman et Michael MacKuen, Affective
Intelligence and Political Judgment, Chicago (Ill.), University of Chicago
Press, 2000.
37. Idem.
9782724614657.indb 74 18/12/13 13:26
Vous aimerez peut-être aussi
- Persée: Waterbury John, Le Commandeur Des Croyants. La Monarchie Marocaine Et Son ÉliteDocument9 pagesPersée: Waterbury John, Le Commandeur Des Croyants. La Monarchie Marocaine Et Son ÉliteHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Postcolonialisme Français-Article-CiteDocument16 pagesPostcolonialisme Français-Article-CiteHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Machr1 001 0053Document9 pagesMachr1 001 0053Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Politis 1750-6-9-Maher-HaninDocument4 pagesPolitis 1750-6-9-Maher-HaninHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Violence Et Politique en IslamDocument16 pagesViolence Et Politique en IslamHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Machr1 021 0031Document17 pagesMachr1 021 0031Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Machr1 001 0009Document3 pagesMachr1 001 0009Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Machr1 001 0023Document12 pagesMachr1 001 0023Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Charisme Émotion-PakistanDocument21 pagesCharisme Émotion-PakistanHichem AbdouPas encore d'évaluation
- 107 Mascolo 14 15Document3 pages107 Mascolo 14 15Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Certeau HistoirDocument24 pagesCerteau HistoirHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Populisme Et Nationalisme G HermetDocument14 pagesPopulisme Et Nationalisme G HermetHichem AbdouPas encore d'évaluation
- L Orientalisme Mort Ou Vif Une HistoireDocument13 pagesL Orientalisme Mort Ou Vif Une HistoireHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Dialogues Sur Le Cinema Jean Luc GodardDocument101 pagesDialogues Sur Le Cinema Jean Luc GodardHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Sociologie Des Élites Délinquantes. de La Criminalité en Col Blanc À La Corruption Politique2Document325 pagesSociologie Des Élites Délinquantes. de La Criminalité en Col Blanc À La Corruption Politique2Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Bernard LepetitDocument7 pagesBernard LepetitHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Y A T Il Eu Une Révolution Conservatrice Sous LaDocument20 pagesY A T Il Eu Une Révolution Conservatrice Sous LaHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Crise de Succession TunisieDocument19 pagesCrise de Succession TunisieHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Anna 641 0171Document37 pagesAnna 641 0171Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Discours Du Palmarium-MACHR1 - 055 - 0011Document5 pagesDiscours Du Palmarium-MACHR1 - 055 - 0011Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Balibar VACA 051 0004Document10 pagesBalibar VACA 051 0004Hichem AbdouPas encore d'évaluation
- Constitutionalisme Et Participation Poli Au MaghrebDocument47 pagesConstitutionalisme Et Participation Poli Au MaghrebHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Racismes de France - Cairn - InfoDocument14 pagesRacismes de France - Cairn - InfoHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Journals 11059 9 1 Article-P223-PreviewDocument2 pagesJournals 11059 9 1 Article-P223-PreviewHichem AbdouPas encore d'évaluation
- La Résilience de L'islamisme-SeniguerDocument8 pagesLa Résilience de L'islamisme-SeniguerHichem AbdouPas encore d'évaluation
- B Ma Vie Mon Oeuvre ExtraitDocument44 pagesB Ma Vie Mon Oeuvre ExtraitHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Addi - L - Enjeux-Anthropologie Du MaghrebDocument8 pagesAddi - L - Enjeux-Anthropologie Du MaghrebHichem AbdouPas encore d'évaluation