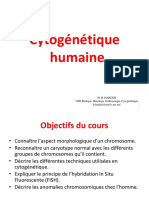Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Embryologie (By Aya - ZRH)
Embryologie (By Aya - ZRH)
Transféré par
Mohamed ECHAMAI0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
36 vues38 pagesTitre original
Embryologie (by Aya.zrh) (1)
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
36 vues38 pagesEmbryologie (By Aya - ZRH)
Embryologie (By Aya - ZRH)
Transféré par
Mohamed ECHAMAIDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 38
GAMETOGENESE
'¥ Le développement commence avec la fécondation
'¥ Les gamates proviennent des gonocytes ou cellules germinales, qui apparaissent dans la paroi de
Fallantoide a la 4éme semaine du développement. De la, les cellules germinales migrent vers les
ébauches des gonades et elles y parviennent a Ia fin de la Seme semaine.
'¥ Enyue de la fécondation, elles subissent un certain nombre de transformations, constituant la
gamétogenése : une division méiotique et une cytodifférenciation,
1- OVOGENESE
Avant la naissance
les cellules germinales se différencient en
‘ovogonies au niveau de la gonade.
Apres des divisions, un certain nombre d’ovogonies
se différencient a leur tour en ovocytes 1 qui
commencent leur premiere division méiotique
immédiatement aprés leur formation.
‘Au 7éme mois, tous les ovocytes 1 ont commencé
leur premiere division méiotique et Ie plupart
d'entre eux sont entourés d’une couronne de
cellules folliculaires aplaties, L’ensemble constitue
le follicule primordial
lls demeurent au stade diploténe.
Ale naissance, leur nombre varie de 700 000 8 2
millions
A partir de la puberté
¥ Chaque cycle ovarien, un certain nombre de
follicules primordiaux commencent leur
maturation, mais habituellement, un seul parvient
pleine maturité, les autres dégénérent et
deviennent atrésiques, ainsi le stocke diminue avec
age = ménopause
¥ Au cours de cette maturation, un ovocyte de
premier ordre donne naissance 8 un ovocyte de
deuxitme ordre +un globule polaire.
Le partage du cytoplasme entre les 2 cells issues de
la division de ovocyte ne se fait pas de fagon
équitable. C’est le futur gaméte qui contient la
grande partie.
¥ Lestade ultime de l'ovogendse ne se fait qu’a la
fécondation.
¥ La 2eme division de le méiose ne se déroule
qu’aprés la fusion du noyau spermatozoide et le
noyau de Fovocyte 2. Cette division n'est pas
équitable.
¥ Laseconde division méiotique ne se termine que si
Vovule est fécondé ; sinon l'ovocyte dégénére, 24
heures environ aprés ovulation
Les phases de Tovopentee
aa pewoaaete
a
GeeLOS rage ame
“xe: 40 [pamjow [wee
Xo 0s Oo
EOL C) —
coigele ed
namin | om | crt
Emoryon assance | Apar-de a pubené
SPERMATOGENESE
¥ Ala puberté et ne se termine qu’avec le décés de 'homme.
¥ Le gonocyte male se différenci en spermatogonie qui donnent naissance au
spermatocyte 1 qui, aprés 2 di
ions méiotiques, va produire 4 spermatides
La spermiogenése
'¥ Les spermatides subissent par la suite une série de modifications pour donner des
spermatozoides :
= formation de I'acrosome qui s’étend sur la moitié de la surface du noyau et qui contient
des enzymes aidant a la pénétration ovulaire au cours de la fécondation
= condensation du noyau ;
+ Apartir du centriole ily a formation du flagelle quivva former le collet, la piece
intermédiaire et la queue (Les mitochondries du cytoplasme de la spermatide vont se
concentrer & la base du flagelle,qui servira 8 fournir ’énergle nécessaire pour le
mouvement du spermatozoides)
- _ perte de la plus grande partie du cytoplasme
'¥ Le temps nécessaire a la transformation des spermatogonies en spermatozoides est de 64 jours.
[La spermiogendse] N
Anomalies de la gamétogenése
¥ follicule contenant 2/3 ovocytes 1
¥ Ovocyte 1 bi/tri nucléé (dégénere)
\¥ Spermatozoides anormales (constituants dédoublée = spz
-azoospermie : absence de production de spz
-oligospermie : <20 millions de spz/ml de sperme
-asthenospermie : anomalie de mobilité (touchant + 50% des spz)
-tetratospermie : perturbations de la morphologie (touchant + 70% des spz)
-necrospermie : production d'un taux élevés de spz mortes (>25%)
Anomalies chromosomiques
'¥ numériques ou de structures : congénitales et avortements
'¥ 50% des grossesses se termine par un avortement, 59% sont du 3 une anomalie
chromosomique
v Turner - triploidie - trisomie 18 et 16
PREMIERE SEM.
|E DU DEVELOPPEMENT
limplantation de I’eeuf,
[L-FECONDATION
¥ S'effectue dans l'ampoule de la trompe de Fallope, partie élargie de la trompe, 12 24 heures
aprés ovulation.
'¥ Lors de la ponte, I'ovocyte est au stade de deuxitme division méiotique. Il est entouré de sa
membrane pellucide et de quelques cellules de la granulosa : la corona radiata. Il est aspiré par
les franges tubaires et pénétre dans la trompe.
'¥ Pour devenir apte & la fécondation, le spermatozoide doit subir :
= une capacitation : la téte du spermatozoide est débarrassée de son revétement de
slycoprotéines.
~ une réaction acrosomique : les substances nécessaires au franchissement des barriéres
ovulaires sont libérées
'¥ Aucours de la fécondation, le spermatozoide doit traverser la corona radiata, la membrane
pellucide et la membrane plasmique de l'ovocyte.
'¥ Des que le spermatozoide a pénétré dans lovocyte 2, ce dernier termine sa deuxiéme division
méiotique et donne un ovule et 2 globules polaires avec formation du pronucléus femelle
'¥ Lamembrane pellucide devient imperméable 8 d'autres spermatozoides ; la téte du
spermatozoide se sépare de la queue, augmente de volume et forme le pronucléus male,
'¥ Les deux pronucléus répliquent leur ADN puis les chromosomes paternels et maternels
s‘entremélent, se clivent longitudinalement et subissent une division mitotique aboutissant au
stade deux blastomeres.
Les principales conséquences de la
fécondation :
¥ larestauration du nombre diploide de
chromosomes, ainsi le zygote comporte
tune nouvelle combinaison chromosomique
différente de chacun de ses parents ;
¥ la détermination du sexe du nouvel
individu : un spermatozoide X produira un
embryon de sexe féminin (XX) ; un
spermatozoide ¥ produira un embryon de
sexe masculin (XY). Ainsi, le sexe de
eyes
Fetur
Vembryon est déterminé aumoment dela [1 Maturation folliculaire 2 Ponte ovulaire
fécondation ; [3 Fécondation
¥ amorce de la segmentation.
IL- SEGMENTATION DE L’OEUF FECONDE
¥ L'ceuf (zygote) humain, pauvre en substances de réserves ou vitellus se divise en deux
cellules filles ou blastoméres 30 heures environ aprés ovulation (stade 2).
¥ Une deuxiéme division donnant le stade 4 intervient entre la 40éme et la 50éme heure.
¥ Une troisi¢me division donnant le stade 8 intervient au bout de la 60&me heure environ.
¥ Une quatriéme division donnant le stade 16 blastomeres plus ou moins identiques
intervient entre le 3@me et le 4@me jour environ. Ce stade porte le nom de MORULA.
NB : Pendant toute cette phase, I'ceuf garde la méme taille prouvée par la persistance de la zone
pellucide. Les cellules issues de ces différentes divisions sont de plus en plus petites. Tout se passe
sans augmentation du volume cytoplasmique total, d'oit le terme de segmentation.
¥ Lazone pellucide empéche Vceuf d'adhérer aux tissus maternels et permet a lceuf de garder sa
cohésion au début de la segmentation.
¥ Les substances contenues dans les sécrétions tubaires et utérines peuvent traverser la zone
pellucide et pénétrer dans lceut.
¥ Le déplacement du zygote vers 'utérus se fait grace aux cils de la paroi de la trompe de Fallope
¥ Jusqu'aux stades 16 & 32, les blastomeres s‘aplatissent, augmentent leur surface de contact avec
les cellules voisines, réduisent la taille de l'espace intercellulaire. Ce phénomene est appelé
compaction et la morula appelée morula compactée.
¥ Ce phénoméne se caractérise par
- _ apparition de systémes jonctionnels (jonctions de cohésion et de communication)
= une polarisation des blastomeres
* blastomeres externe ou "polaires" donneront le trophoblaste a l'origine du
placenta
* Les blastomeres internes ou “apolaires” donneront I'embryon et des annexes
embryonnaires.
~ apparition des microvillosités au péle apical des cellules externes
IL- FORMATION DU BLASTOCYSTE
'¥ Une cinquiéme division se produit entre le 4éme et le S&me jour donnant 32 blastomeres.
¥ Apartir de ce stade, la synthase protéique s'accompagne d'un accroissement du volume
cytoplasmique par pénétration d’un liquide venant des cavités utérines dans la morula. Ce
liquide sépare les cellules pour former une cavité : le blastocéle
¥- Llafflux de liquide est un phénoméne actif expliqué par 'activité d'une enzyme (ATPase)
permettant le fonctionnement des pompes 8 sodium potassium localisées au niveau
membranaire du trophoblaste
¥ Cette activité enzymatique est responsable d'un mouvement
ions NA+ vers le blastocéle, qui
entraine par action osmotique un flux liquidien. La morula se transforme alors en blastocyste.
'¥ Blastocyte = petite sphére creuse avec une paroi /trophoblaste et un groupe excentré de cellules:
la masse cellulaire interne
Mw pettuciae
ZYGOTE gis,
seme
ine SS
BLASTOCYSTE
"éclosion" de l'ceuf qui se produit vers la fin du Séme
jour sera réalisée grace 8 deux phénoménes:
- une activité enzymatique protéasique du trophoblaste
- _ledilatation du blastocéle qui distend le trophoblaste.
Le blastocyste encore libre dans la cavité utérine va se fixer 3 I'épithélium utérin par son pole
embryonnaire 8 partir du 6&mejour
La disparition de cette zone pellucide et "|
Les cellules trophoblastiques du péle embryonnaire proliférent et donnent une masse syncytiale,
début de la formation du syncytiotrophoblaste. Leur digitations pénétrent dans I'épithélium
utérin marquant le début de implantation. (Iyser les capillaires sanguins)
Ala fin de la premiére semaine, la masse cellulaire interne isole 8 son péle inférieur une assise
de cellules cubiques appelée hypoblaste, le reste de la masse cellulaire interne se réarrangera en
une couche de cellules prismatiques formant |'Epiblaste qui sera & l'origine de la totalité de
embryon.
panel brn ‘sma te
@ ectnop of ate
es sepeed S08 Je
ih ca
cave
9 sarertaten
Troptobase
(gouge ceiare
ghee)
5 jours 6 jours
IV- MIGRATION TUBAIRE ET DEBUT DE L'IMPLANTATION
'¥ Pendant quill se segmente, I'ceuf parcourt la trompe, cette migration tubaire est favorisée par:
- les battements ciliaires de I'épithélium tubaire
- les contractions péristaltiques de la musculeuse tubaire
'¥ Uoeuf s'implante normalement a la partie haute de la face postérieure de l'utérus. Ce début de
implantation survient le 2leme jour du cycle menstruel.
'¥ Implantation en dehors du sige est ectopique
'¥ Lorganisme maternel qui se prépare a recevoir 'ceuf est caractérisé par:
- une muqueuse utérine épaisse et trés vascularisée et sécrétant une grande quantité de
slycogene et de mucus;
= des taux d'cestrogéne et de progestérone produits par le corps jaune non différents de
ceux observés au cours du eycle normal;
- absence de signes tant cliniques que biologiques permettant de faire le diagnostic de
grossesse.
Oa
Follicle
de De Graal —Myométie
\
Permatre
7 . Endométre
1ére semaine
‘Ovocyte «2 Fécondation _—3 Stades des 2 pronuclei
4 fuseau de la 1ére mitose 5 Stade 2 blastomeres
6-7Morula 8 Blastocyste libre 9 Blastocyste fixe
‘A-MORT DE L'GEUF FECONDE B- ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES Elimination des blastocytes
Oifestine alan moins 50% le; Ces aberrations sont 8 'origine de
maladies chromosomiques par
Implantation ectopique
nombre d'ceufs fécondés quine
s‘implantent pas, soit du fait de leur
caractére défectueux en particulier
modification du nombre des
chromosomes (trisomie, monosomie,
sur le plan génétique, soit du fait d'un
défaut de maturation de
Vendométre.
mosaiques), ou modifications de
structure (délétion, translocation.
E EMBRYONNAIRE “DIDERMI
développement)
A=NIDATION
¥ Apres disparition de la membrane pellucide en
fin de premiére semaine, I'ceuf adhére &
Vendometre (68me jour). Le trophoblaste du
péle embryonnaire s'accole a 'épithélium
utérin. Les cellules trophoblastiques
proliférent au niveau de la zone d'adhésion,
pour donner naissance & un syncytium, le
syneytiotrophoblaste. Le reste du
trophoblaste, toujours constitué par des
cellules bien individualisées, devient anemia
: Blastocyste de 7 jours et demi
cytotrophoblaste qui sépare la masse cellulaire
interne du syncytiotrophoblaste (ST) = tissu trés actif quia la propriété de lyser
l'endométre grace 4 des enzymes protéolytiques, il
pénétre dans 'endometre entrainant avec lui
l'ensemble de |'ceuf.
¥ Crest ainsi qu’aux 9 éme-10 éme jours, tout I'ceuf a
pénétré dans |'endométre. La bréche utérine liée
la pénétration est obturée par un caillot de fibrine.
¥ Différenciation du trophoblaste en deux couches
s'étendra a toute la circonférence de l'ceuf
¥ Appararition ds le Séme jour, des vacuoles dans le
ST, vacuoles qui grossissent et confluent pour
former des lacunes qui deviennent plus Blastocyste de
nombreuses, s'agrandissent et finissent par
confluer formant un véritable réseau lacunaire
syneytiotrophoblastique.
v_ Le ST érode les capillaires endométriaux vers le 10¢me-
112me jour, permettant au sang maternel d'envahir les
lacunes d'abord au péle embryonnaire.
Clest le début de la circulation utéro-lacun
vy Apartir du 13émejour |'épithélium utérin est *
reconstitué. (|i peut se produire une petite hémorragie &
cette période au niveau du site d'implantation, en raison de
l'augmentation du débit sanguin dans les espaces lacunaires
du péle anti-embryonnaire)
omit
B- FORMATION DU DISQUE EMBRYONNAIRE
¥ Initialement les cellules de I'Epiblaste sont accolées 8 la couche cellulaire
trophoblastique périphérique. Vers le 8éme jour, un clivage entre Epiblaste et
trophoblaste se crée. Il se forme ainsi une cavité dite cavité amniotique dont le plancher
est formé par l'Epiblaste et le toit, de cellules dont l'origine fait l'objet de controverses.
¥ Les cellules constitutives du toit portent le nom d'amnioblastes.
¥ Vers les 8 éme-9 &me jours une premiére prolifération de cellules hypoblastiques donne
naissance a des éléments cellulaires aplatis situés a la face interne du cytotrophoblaste.
Cette couche cellulaire constitue ja membrane de Heuser.
¥ Une cavité limitée par I'hypoblaste et la membrane de Heuser porte le nom de
lécithocéle primaire ou Vésicule Vitelline primaire.
¥ Des cellules mésenchymateuses apparaissent entre la membrane de Heuser et le
cytotrophoblaste formant un Mésoblaste extra-embryonnaire qui commence a devenir
bien visible aux 9¢me et lO&me jour.
¥ Ce mésoblaste qui continue & proliférer se creuse de cavités (12¢me jour) qui finiront par
confluer pour donner une cavité unique ou cavité ccelomique extraembryonnaire.
¥ L'hypoblaste prolifére une seconde fois et finit par limiter une cavité appelée Lécithacéle
secondaire ou Vésicule Vitelline secondaire.
¥ Lamembrane de Heuser pincée par cette prolifération de I'hypoblaste constitue la paroi
d'une cavité résiduelle ou kyste exoccelomique.
¥_Enraison de la formation du coelome extra embryonnaire, le mésoblaste extra
‘embryonnaire se condense:
- ala face interne du cytotrophoblaste,
- ala face externe de la cavité amniotique constituant la somatopleure extra
embryonnaire,
- ala face externe de la Vésicule Vitelline secondaire constituant la
splanchnopleure extra embryonnaire.
~ entre le cytotrophoblaste et la cavité amniotique constituant le pédicule
embryonnaire.
La deuxiéme semaine est marquée par le chiffre 2 : le trophoblaste se différencie en deux
couches, cytotrophoblaste et syncytiotrophoblaste, le mésoblaste extra-embryonnaire se
clive en deux couches, somatopleure et splanchnopleure et il s'est formé deux cavités
cavité amniotique et Iécithocodle
‘Annexe toutes les parties de I'ceuf situées en dehors de I'embryon, cest-a-dire :
Trophoblaste
Cavité amniotique
~ Vésicule Vitelline secondaire
~ Mésenchyme extra embryonnaire
~ le coelome externe
¥ Les sécrétions hypophysaires de FSH et Modifications de l'organisme maternel
LH sont identiques a celles observées ees —
au cours d'un cycle normal clest-a-dire | & cavtare mar
en l'absence de fécondation. g
¥ Cycle normal : cestrogene et :
progestérone diminue 8
¥ Grossesse : cestrogene et ke
progestérone augmentent sous oa
Vinfluence de gonadotrophines
chorioniques sécrétées par le 5
syncytiotrophoblaste. 4
¥ Le corps jaune périodique se 6
transforme en un corps jaune
gravidique qui sécréte de plus en plus d'cestrogéne et de progestérone assurant
Vintégrité de 'endométre, évitant la menstruation et permettant une nidation
¥ Oestrogénes et progestérone provoque un cedéme du chorion, propice & I'implantation
nidation, une sécrétion glandulaire et parallélement une modification des cellules du
stroma (cellules déciduales) alors que la spiralisation des vaisseaux s'accentue.
¥ La nidation de I'ceuf dans I'endometre entraine une réaction des cellules du stroma
endométrial appelée réaction déciduale. Les cellules conjonctives deviennent
volumineuses se chargent en glycogéne et en lipides (cellules déciduales). Cette réaction
qui débute & proximité de la zone d'implantation va s'étendre en une semaine & toute la
muqueuse utéri "caduques"
- la caduque utéroplacentaire ou basilaire entre I'ceuf et la paroi utérine,
- la caduque ovulaire ou réfiéchie entre 'ceuf et la cavité utérine,
- la caduque pariétale ou caduque vraie pour le reste de I'endométre.
U1L- ANOMALIES DELA NIDATION
A-NIDATIONS ECTOPIQUES
Les sites anormaux d'implantations peuvent se faire
= dans la partie basse de lutérus aboutissant a un
placenta praevia (1/200) a l'origine de graves
hémorragies en fin de grossesse.
~ _endehors de l'utérus (grossesses extra-utérines),
environ 1/200. I s'agit le plus souvent d'une
grossesse tubaire (95% de cas environ),
exceptionnellement, d'une grossesse ovarienne
ou d'une grossesse abdominale.
B- DEFAUX D'IMPLANTATION
~ muqueuse utérine mal préparée (raisons
hormonales ou infectieuses)
= méthodes contragestives empéchant
implantation :
* cestrogenes 8 forte dose (pilule du
lendemain)
‘© dispositif intra-utérin (DIU ou stérilet)
E EMBRYONNAIRE TRIDERMI
développement)
Qu se déroule la gastrulation, processus au cours duquel se mettent en place les trois
feuillets de I'embryon tridermique : ectoblaste, mésoblaste et entoblaste.
L- MODIFICATIONS DE FORME
¥ Au 14éme jour, le disque embryonnaire apparait . .
circulaire et plat.
¥ Au 15éme jour, il apparait sur la ligne médiane de la face
dorsale du disque embryonnaire une bande sombre a =)
appelée ligne primitive et terminée cranialement par un — ~
renflement: le noeud de HENSEN.
¥ Au 17-188me jour, le disque embryonnaire quis'accroit
surtout dans la région céphalique devient piriforme. Une Dique embryonnaie début dela semine
gouttiére se forme dans la ligne primitive et se poursuit
dans une dépression du nceud de Hensen.
Secondairement il apparait en avant du nceud de
HENSEN, une autre ligne sombre visible par
transparence qui chemine sous 'Epiblaste, le
prolongement céphalique de la ligne p
¥ Au 198me jour, |a ligne primitive diminue de taille par
rapport a celle de I'embryon. Elle finira par dégénérer
et disparaitre. Le prolongement céphalique au
contraire s'allonge en direction céphalique. Ces
phénoménes correspondent a la formation d'un
‘embryon tridermique
Je.
Embryon au 16-17éme jour
Face dorsale - caviteé amniotique ouverte
1L- MODIFICATIONS DE STRUCTURE
Etudiées a partir de coupes transversales et longitudinales / sagittales médianes a différents instants
de la 3éme semaine.
'¥ Das le I62me jour, Le premier feuillet qui se met en place lors de la gastrulation est I'entoblaste
‘ou endoderme
= Les cellules entoblastiques prennent naissance dans I épiblaste au niveau du noeud de
Hensen, migrent et s'insinuent entre les cellules de I'hypoblaste qu'elles refoulent
latéralement.
'¥ De maniére simultanée par rapport a l'entoblaste (mais sur une plus longue période de temps)
d'autres cellules épiblastiques issues de la ligne primitive pénétrent également en profondeur en
cheminant entre le feuillet superficiel et le feuillet profond.
Cette migration, qui s‘effectue latéralement, cranialement et caudalement pour atteindre les
bords du disque embryonnaire, correspond 3 la mise en place du mésoderme ou mésoblaste
‘embryonnaire qui finit par rejoindre le mésoblaste extra embryonnaire.
'¥ D'autres cellules migrent a partir du noeud de Hensen vers la région craniale et constituent un
cordon médian, le prolongement céphalique ou prolongement chordal qui s'étend jusqu’a la,
membrane pharyngienne.
'¥ Enfin le feuillet superficiel devient I'Ectoblaste ou Ectoderme et le disque embryonnaire se
trouve des lors constitué de trois feuillets.
Mesogerme Endogerme
Mesoblaste, Entobiaste
Endoderme
DISQUE EMBRYONNAIRE:
DISQUE EMBRYONNAIRE a
"1s" Jour (coupe transversale) 16°jour coupe transversale
1“
'¥ Enavant du noeud de Hensen, le prolongement céphalique de la ligne primitive ou prolongement
chordal ou processus chordal initialement plein se creuse d'une lumiére et devient le canal
chordal.
ll apparait pendant la formation du canal chordal un petit diverticule en forme de doigt qui est
issu de la paroi caudale de la vésicule vitelline et appelée lAllantoide. C'est un petit organe
vestigial chez tembryon humain
'¥ Le plancher du canal chordal fusionne avec I'entoblaste. La dégénérescence des régions
fusionnées crée l'apparition d'orifices mettant le canal chordal et la ca
communication avec le lécithoctle. Les différents =
orifices confluent et le plancher du canal chordal finit Lsetnocite seconaare — |
par disparaitre "
Le reste du prolongement chordal constitue la plaque
chordale. Qui forme une gouttiére qui s'invagine de
plus en plus et dont les deux bords finissent par se
rejoindre s'isolant ainsi de l'entoblaste ou endoderme
pour former la chorde dorsale, premiére formation
squelettique de 'embryon.
'¥ Lentoblaste ou endoderme reconstitue une couche
continue ventralement par rapport & la chorde. Enfin,
le canal qui reliait la cavité amniotique a la vésicule canal chordal Noe de Henson
Vitelline ou Canal neurentérique disparait.
‘cranial ‘Caudal
1- Les remaniements de la 38me semaine
conférent a 'embryon sa symétrie bilatérale.
2- Au cours de la 38me semaine, le mésoblaste
‘ou mésoderme embryonnaire s'interpose entre
ectoblaste et entoblaste sauf:
~ au niveau de la membrane pharyngienne en
avant;
~ auniveau de la membrane cloacale en
mL,
arridre.
3- Entre la membrane pharyngienne et 'extrémité antérieure de la chorde se situe la plaque
préchordale, territoire mésoblastique qui aurait un réle d'induction sur l'ectoblaste sus-jacent dans
la morphogenése de I'extrémité antérieure du tube nerveux.
4- La 3eme semaine est caractérisée par le premier signe objectif de grossesse : I'aménorrhée
accompagnée de facon inconstante par d'autres signes cliniques: nausées, vomissements,
gonflement des seins.
5 - Des reliquats de la ligne primitive peuvent persister dans la région sacro coccygienne et donner
naissance a des tumeurs, les tératomes sacro coceygiens. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs du
nouveau-né, Leur fréquence est de 1 cas sur 37000 naissances.
DELA 3e ALA EMAINE (1;
Chacun des trois feuillets va donner naissance & un certain nombre de tissus et d’organes. A la fin de
la période embryonnaire, les principaux appareils sont mis en place. Suite 8 cette organogenése, la
forme de Fembryon se modifie considérablement et les principales formes extérieures du corps sont
reconnaissables a la fin du 2@me mois.
L_ DERIVES DE L'ECTOBLASTE
v Au début de la 3@me semaine, |'ectoblaste constitue un disque épithélial plat, un peu plus large
dans la région craniale que dans la région caudale.
'v apparition du mésoblaste axial induit un épaississement de l’ectoblaste sus-jacent qui forme la
plaque neurale. Les cellules de la plaque neurale vont constituer le neuroectoblaste et leur
ial de la neurulation.
induction représente le processus i
Lectoblaste situé en avant de la ligne primitive subit des
modifications concomitantes de la gastrulation. Elles ne sont
pas codées par ce tissu mais sont induites. On parle ‘induction
neurale.
+ Une premiére induction prend naissance a partir des
structures mésoblastiques axiales (plaque pré-chordale et
chorde dorsale) et agit sur 'ectoblaste sus-jacent. I s‘agit
d'une induction dite verticale.
- Une deuxiéme induction serait une onde moléculaire
propagée le long de l'ectoblaste lui-méme a partir du nceud
de Hensen. Cette induction est qualifiée de planaire.
B= MORPHOLOGIE EXTERNE
2-Neuralisation par défaut (théorie moderne)
Cette théorie permet d'expliquer certains résultats
observés chez les amphibiens, d'autoneuralisation,
C'est 8 dire lobtention de neurones in vitro sans
induction,
On a montré qu'une molécule, la BMP4 (Bone
Morphogenetic Protein) est capable d'induire la
formation d'épiderme & partir de la région apicale de
la Blastula d'Amphibiens. C’est une molécule dite
épidermisante qui est sécrétée dans le milieu extra-
cellulaire et agit sur un récepteur membranaire. Si par
mutation on rend le récepteur de BMP4 non
fonctionnel, on empéche l'action de BMP4 et on
empéche la formation d'épiderme.
'¥ Llembryon est abservé par sa face dorsale aprés avoir découpé l'amnios et retiré le toit de la
cavité amniotique
'¥ Au 198me-208me jour, la plaque neurale est surtout bien développée au niveau de I'extrémité
céphalique et s'étend en arridre jusqu'au noeud de Hensen:
'¥ _Enfin de 3¢me semaine commence & se former une gouttiére neurale, pari
wagination de la
plaque neurale dont les bords tendent a se rapprocher dans la région moyenne, alors quills se
soulévent dans la région céphalique. Ces bords prennent un énorme développement et forment
les plaques neurales cérébrales.
'¥ Petites surélévations de l'ectoblaste qui correspondent en profondeur & la mise en place des
premiéres paires de somites (3 paires environ).
'¥ Vers le 228me jour, les bords de la gouttiére neurale fusionnent sur la ligne médiane dans la
portion moyenne de 'embryon pour former le tube neural encore largement ouvert dans la
cavité amniotique vers les régions craniale et caudale.
¥ Enarriére, la quasi disparition de la ligne primitive et en avant I'apparition en position ventrale,
d'un renflement correspondant la mise en place de 'ébauche cardiaque.
'¥ Le nombre de somites @ augmenté (environ 7 paires).
'¥ Au 23éme jour, le tube neural est fermé sur toute sa longueur sauf encore aux extrémités, ce
sont les neuropores antérieur et postérieur qui se fermeront vers la fin de la 4#me semaine.
Parallelement le nombre de somites augmente (14 paires environ).
'¥ L’ébauche cardiaque devient de plus en plus proéminente ventralement.
stade p Fy rey Un épaississement ectoblastique de la région médio-dorsale de
embryon, plus large au niveau de lextrémité céphalique que de
neurale l'extrémité caudale, Cette transformation de l'ectoblaste est
induite parla chorde dorsale sousjacente ainsi que par la plaque
ade go =] GSI) invagination de la plaque neurale et soulévement des bords
latéraux de la plaque neurale.
Soudure des bords de la gouttiére. Le tube neural ainsi formé
sisole de I'Ectoblaste superficiel.
Nouropore antevour
Bord satant de a
gourtare nestle
cording
|
; =
2jours 23 jours
Vue dorsale d’embryons humains
Embryons humains de 19 et 20 jours, face dorsale
¥ Les 3 stades coexistent sur un méme embryon au méme moment mais a des endroits différents,
La formation du tube neural qui débute dans la région moyenne de I'embryon se poursuivra de
part et d'autre vers les deux extrémités. Cette région moyenne, bien que située & égale distance
de lextrémité céphalique et de l'extrémit
'¥ Ce tube neural ainsi formé sera & l'origine de l'encéphale et de la moelle c'est-8-dire du systéme
caudale représente la future région cervicale.
nerveux central.
D_- FORMATION DES CRETES NEURALES
'¥ Les crétes neurales apparaissent alors que les bords de la gouttiére neurale se rapprochent.
'¥ Aumoment de la fermeture du tube neural, se constitue transitoirement entre le tube neural et
Vectoblaste superficiel une bande cellulaire unique et médiane qui se divisera par clivage
longitudinal pour donner deux crétes neurales paraliéles au tube neural
'¥ Ces crétes se fragmenteront pour donner les ébauches ganglionnaires.
'¥ Cette fragmentation se produit aussi lors de la formation des somites qui seront étudiés
ultérieurement et s‘inscrit dans le cadre plus général d'une métamérisation caractérisée par la
répétition étagée suivant 'axe céphalocaudal d'un méme motif structural auquel prennent part
des ébauches d'origines différentes
'¥ Auniveau de I'extrémité céphalique il n'y a pas de disposition segmentaire proprement dite mais
fragmentation en 3 massifs ganglionnaires qui formeront les ganglions craniens.
'¥ ces crétes neurales donneront naissance:
= aux ganglions rachidiens sensitifs dont les neurones produiront les fibres de la
sensibilité générale;
= aux ganglions du systéme nerveux végétatifs;
+ aux cellules de Schwann;
= aux cellules médullo-surrénaliennes;
- aux cellules pigmentaires de la peau;
- aux cellules parafolliculaires sécrétrices de calcitonine;
= ade l'ectomésenchyme au niveau céphalique.
E- FORMATION DES VESICULES CEREBRALES
'¥ Lextrémité craniale du tube neural, présente 3 dilatations ou
vésicules cérébrales primitives:
- Le prosencéphale ou cerveau antérieur
- Le mésencéphale ou cerveau moyen
+ Le thombencéphale ou cerveau postérieur.
'¥ Parallélement a la formation des vésicules cérébrales, le tube
neural s'infléchit ventralement
¥ Ala fin de la 4¢me-Seme semaine, prosencéphale et
rhombencéphale se subdivisent & leur tour, de sorte que \
encéphale comporte 5 vésicules qui sont d'avant en arriére
4eme semaine
+ letélencéphale et le diencéphale (dérivés du prosencéphale) ;
= lemésencéphale;
- _ lemétencéphale et le myélencéphale (dérivés du rhombocéphale).
¥ Ala Geme semaine, l'inflexion ventrale et le développement des vésicules cérébrales font
apparaitre 3 courbures:
= une courbure cervicale & la jonction dela
moelle et du cerveau postérieur;
- une courbure céphalique sur le cerveau moyen;
+ une courbure pontique entre les 2 courbures
principales 8 concavité dorsale.
¥ ces 5 vésicules contribueront 8 former
= _ télencéphale : les hémisphéres cérébraux avec les,
2 ventricules latéraux
~ diencéphale : la rétine, I'hypothalamus, le 38me
ventricule, la post hypophyse ou neuro hypophyse
= mésencéphale : les pédoncules cérébraux et les
tubercules quadrijumeaux
- métencéphale : le cervelet et la protubérance
annulaire
- _ myéleneéphale : le bulbe rachidien en continuité avec la moelle
(Ce développement des vésicules cérébrales joue un réle important dans les phénomanes qui
conduisent 8 la délimitation de l'embryon dans sa partie antérieure.)
Début du développement de l'encéphale
Prosenctonaie forme Cortex
Dienctphateyesnue Thalamus,
wee rétine
eek — eli me
montencepate
treet si
24eme jour
Uectoblaste donne naissance :
~ au systéme nerveux central ;
- au systéme nerveux périphérique ;
~ a 'épithélium sensoriel des organes des sens ;
- al'épiderme et ses annexes (poils, ongles, glandes cutanées) ;
~ ala glande mammaire ;
- al'hypophyse ;
~ al'émail des dents.
IL- DERIVES DU MESOBLASTE
'¥ Pendant la formation du tube neural, le mésoblaste situé de chaque coté s'épaissit pour former
des colonnes longitudinales de mésoblaste para-axial
'¥ Plus latéralement le mésoblaste moins épais,
constitue la lame latérale au sein de laquelle
apparaitront de petites cavités qui finiront par
confluer, clivant ainsi cette lame latérale en deux
couches :
DEVELOPPEMENT DU MESOBLASTE
Goustire naurate
= l'une en continuité avec le mésoblaste extra-
embryonnaire tapissant la cavité am
somatopleure;
= autre en continuité avec le mésoblaste extra-
embryonnaire tapissant la vésicule vitelline, la
splanchnopleure.
'¥ Ces deux couches limitent une nouvelle cavité, le
ccelome interne.
¥ Ace stade, le mésoblaste de la lame latérale est 21€me jour
séparé du mésoblaste para-axial par un massif continu de mésoblaste, appelé mésoblaste
intermédiaire ou lame intermédiaire.
ue, la
A= MESOBLASTE PARA-AXIAL
'¥ Au début de la 4&me semaine, le mésoblaste para-axial
se segmente en massifs appelés somites disposés par
paires avec une petite cavité centrale transitoire: le
myocéle.
= Le mésoblaste intermédiaire s'isole des somites.
- La premiére paire de somites apparait dans la
région cervicale de 'embryon vers le 208me jour du
développement. I n'y a pas de segmentation du
mésoblaste dans la partie toute antérieure de la
région céphalique. 23eme jour
- La segmentation du mésoblaste para-axial se
poursuit vers la région caudale & raison de 3 paires de somites par jour, jusqu’a la fin de la
Same semaine.
= Oncompte a cette date 42 8 44 paires de somites:
+ Aoccipitaux
© 8cervicaux
© 12 thoraciques
© Slombaires
© Ssacrés
+ 8810coccygiens.
'¥ La premiére paire de somites occipitaux et les 5 87
derniéres paires de somites coccygiens disparaissent.
Les autres forment le squelette axial.
'¥ lest habituel au cours de cette période du développement d'exprimer |'age de l'embryon en
nombre de somites.
Evolution des somites
* Région médio-ventrale ou sclérotome.
'¥ Les cellules de cette région du somite perdent leur aspect pith:
autres et prennent un aspect étoilé avec des prolongements.
ide, s‘solent les unes des
‘Une matrice extracellulaire "gélatineuse" apparait entre elles. I se constitue un conjonctif
‘embryonnaire ou mésenchyme. Ces cellules envahiront les espaces libres de I'embryon et
pourront se différencier en fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes, cellules sanguines,
3s lisses..
cellules endothéliales, cellules muscul
'¥ Les cellules du sclérotome migrent en direction de la ligne médiane et viennent entourer la
chorde puis le tube nerveux, pour constituer les premiéres ébauches des vertébres et des
disques intervertébraux.
'¥ Ceci stobserve sur des coupes transversales partielles d'un embryon en fin de Jer mois et fin de
same semaine
Migration des
cellules des sclérotomes
Fin du 1st mois Sams semaine
'¥ Sur une coupe frontale, les sclérotomes apparaissent comme des condensations de cellules
mésenchymateuses le long de la chorde avec une densité cellulaire beaucoup plus importante du
été caudal que céphalique.
'¥ Lapartie caudale de chaque sclérotome fusionne avec la partie céphalique du sclérotome sous-
jacent pour donner naissance au corps vertébral et au disque intervertébral. Chaque vertébre se
développe a partir de deux sclérotomes adjacents et devient une structure intersegmentaire.
¥ La chorde régresse entigrement dans la région des corps vertébraux, persiste dans la région des,
disques intervertébraux, en donnant le nucleus pulposus qui sera plus tard entouré par des fibres
de lanneau fibreux.
'¥ Dorsalement le mésenchyme qui recouvre le tube neural forme I'arc vertébral. Des expériences
de transplantation ont permis de montrer que les cellules des sclérotomes se différencient pour
donner naissance:
~ soit au corps vertébral, en réponse & des substances produites par la chorde
- soit & are vertébral en réponse & des substances venant du tube neural.
'¥ La formation du tube neural conditionne la formation de la vertebre et notamment de I'arc
postérieur de la vertabre.
'¥ Llabsence de fermeture du tube neural par exemple entraine une anomalie appelée Spina bifida,
cette anomalie souvent localisée dans la région lombaire et sacrée s'accompagne notamment
d'une symptomatologie motrice (paralysie) qui touche les régions situées au niveau et au
dessous de la lésion.
Tube neural
\ mt Spat
ecctome Myoteme
i Chore
Recombinaison des sclérotomes Contribution de la chorde et du slérotome
Pour former les vertebres au developement du disque intrvértebral
* Région dorso-latérale ou dermomyotome.
¥ Laparttie profonde voit ses cellules se transformer en myoblastes pour former des ébauches
musculaires squelettiques. Cette portion de somite porte le nom de myotome
¥ Lapartie superficelle se détache du myotome, prend l'aspect du mésenchyme et se glisse sous
1 Ectoblaste pour donner le tissu cellulaire sous- cutané et le derme, doi! le nom de dermatome.
B= MESOBLASTE INTERMEDIAIRE
'¥ Unit temporairement le mésoblaste para-axial et la lame latérale, se différencie en ébauches
urogénitales
'¥ Dans ia région cervicale et thoracique supérieure, ils forment des amas
cellulaires segmentés métamérisés, les futures néphrotomes,
'¥ Dans les régions plus caudales, ils forment une masse non
métamérisée, le cordon néphrogéne.
'¥ Formation plus tard des unités sécrétoires du systéme urinaire et les
gonades.
Les anomalies de développement rénal
'¥ UAgénésie rénale: absence de développement rénal
= _ Inuutero, diminution du volume amniotique (oligo-amnios) ->
Hypoplasie pulmonaire
= _ Incompatible avec la vie post-natale si bilatérale,
'¥ Rein en fer & cheval: 0,2 % des naissances.
'¥ Ectopie rénale: Descente excessive des reins: Rare.
(C= MESOBLASTE DE LA LAME LATERALE
¥ Lalame latérale se clive en deux couches
- _ Pariétale : La somatopleure forme avec I'ectoblaste les parois latérale et ventrale de
Vembryon.
~ _ Viscérale : La splanchnopleure forme avec l'entoblaste la paroi du tube digestif. Leur
surface forme une fine membrane, membrane mésothéliale ou séreuse, qui tapissera les
cavités péritonéale, pleurale, et péricardique.
¥ is vont respectivement tapisser la paroi du coelome intraembryonnaire et entourer les organes.
D= SANG ET VAISSEAUX
'¥ Au début de la troisiéme semaine, les cellules mésoblastiques situées dans la paroi de la vésicule
Vitelline (splanchnopleure) vont se différencier en cellules sanguines et vaisseaux sanguins
'¥ Ces cellules que l'on appelle les angioblastes, se disposent en amas et en cordons isolés, les amas
cellulaires angioformateurs ou jlots de WollfPander
¥ Les cellules situées au centre donnent naissance aux cellules sanguines primitives et celles en
Périphérie forment des cellules endothéliales aplaties limitant les jlots sanguiformateurs.
'¥ Ces ilots se rapprochent rapidement les uns des autres par bourgeonnement des cellules
endothéliales et, aprés fusion, donnent naissance & de petits vaisseaux sanguins.
'¥ Les cellules sanguines embryonnaires primitives vont disparaitre. Elles sont remplacées par des
cellules sanguines foetales qui peuvent provenir de la vésicule vitelline ou du mésentare dorsal
Ces cellules colonisent le foie, principal organe hématopoiétique chez le foetus
¥ Parla suite, les cellules hématopoiétiques hépatiques migreront vers la moelle osseuse, autre
organe hématopoiétique chez adulte.
'¥ Pendant ce temps, cellules sanguines et capillaires se développent également dans le mésoblaste
extra-embryonnaire des villosités placentaires et de la vésicule vitelline.
'¥ Par bourgeonnement continu, les vaisseaux extra-embryonnaires vont entrer en connexion avec
les vaisseaux intra embryonnaires, faisant ainsi communiquer la circulation embryonnaire avec la
circulation placentaire
'¥ Le sang et les vaisseaux intra embryonnaires, y compris le tube cardiaque se mettent en place
selon un processus exactement superposable & se qui se passe pour les vaisseaux extra-
embryonnaires
Les dérivés du mésoblaste sont :
~ les tissus de soutien : conjonctif, cartilage, os
- les muscles striés et lisses ;
= les cellules sanguines et lymphatiques, les parois
du coeur et des vaisseaux sanguins et
= a Taber
lymphatiques ; au Ae
~ les reins, les gonades et leurs canaux excréteurs | oo sans eny
= laglande corticosurrénale ; Enicbiaste.
- larate. *-
oe ves Sarain amet
“yin to de ; Shoe = =
\ - Ebauches vasculaires extra-embryonnaires
R@aee "==
Formation du sang et des
vvalsseux sanguins
IL- DERIVES DE L’ENTOBLASTE
'¥ La formation du tube digestif, qui est le principal organe dérivé de I'entoblaste est due aux
inflexions céphalocaudale (ou longitudinale) et latérale (ou transversale} du disque
embryonnaire.
'¥ Vinflexion céphalocaudale est déterminée par la rapide croissance en longueur du systéme
nerveux central; inflexion latérale est due principalement & la croissance rapide des somites. De
sorte que la formation du tube digestif & partir de la vésicule vitelline est un phénomene passif
qui consiste, sous I'influence de ces inflexions, en I'incorporation d'une partie de la vésicule
Vitelline dans la cavité du corps de embryon. Une autre conséquence de cette plicature de
Fembryon est existence d’une large communication entre I'embryon et la vésicule ombilical
cette communication va progressivement rétrécir pour devenir l’étroit canal vtellin.
A-DERIVES DE L'INTESTIN PRIMITIF.
'¥ ensemble de l'appareil digestif et de 'appareil bronchopulmonaire provient de I'intestin primitif
dlorigine entoblastique.
'¥ Cet intestin primitif s'est lui-méme formé & partir du lécithocéle Il au cours de la délimitation de
Nembryon.
'¥ Ilva de soi que lentoblaste sera & lorigine de I'épithélium de revétement et de I'épithélium
glandulaire des voies aéro-digestives et que le mésenchyme qui entoure cet entoblaste formera
les autres constituants (conjonctif, tuniques musculaires).
¥ _Ondistingue 3 parties au niveau de I'intestin primitif:
esate L'intestin moyen Prac eat e
'¥ céphalique / pharyngiena | ¥ en communication avec la ¥ ATorigine du reste du tube
Vori vésicule vitelline & origin digestif
Y dufond dela cavité buccale | ¥ deT'intestin gréle (jéjunumet ¥" le 1/3 distal du célon
et du pharynx; iléon); transverse;
Y del'cesophage, 'estomac, le | ~ du caecum et de I'appendice; ¥ le cdlon descenda
duodénum, le foie et le ¥ ducélon ascendant; ¥ le sigmoide;
paneréas; Y des 2/3 du célon transverse. Y lerectum et la partie
Y enfin, de l'appareil supérieure du canal anal;
respiratoire. ¥_lavessie.
1 APPAREIL RESPIRATOIRE
'¥ Origine entoblastique et mésoblastique.
Y _ Entoblastique pour ce qui concerne I'épithélium penetererery
trachéobronchique, l’épithélium alvéolaire et les glandes annexes;
Mésoblastique pour toutes les formations conjonctives, e
cartilagineuses, musculaires et vasculaires.
'¥ Le début du développement est marqué par une évagination
longitudinale & la face ventrale de I'intestin céphalique, le diverticule
respiratoire ayant d'abord la forme d'une gouttiere ouverte qui
progressivement s'isolera du tube digestif par pincement latéral.
8 la fin du ter mois, I'ébauche broncho-pulmonaire s'isole de ome
oesophage.
4° semaine
'¥ Cette ébauche ne restera soudée & lintestin céphalique qu'au
niveau de I orfice laryngé.
¥ Ense séparant de I'intestin céphalique, I'ébauche respiratoire qui
sfaccroit en direction caudale se divise en 2 bourgeons, les
bourgeons bronchiques.
Y Le bourgeon bronchique droit ou bronche souche droite,
donnera naissance a 3 bronches secondaires ou bronches
lobaires droites. 8eme semaine
¥ Le bourgeon bronchique gauche ou bronche souche gauche donnera naissance a 2
bronches secondaires ou bronches lobaires gauches.
¥ Cest la préfiguration de la structure lobaire des poumons défiitifs.
¥ Ilest évident qu'ensuite, chaque bronche lobaire subira jusqu’a la fin du 68me mois, des
di otomiques pour finalement donner des bronches de
17éme ordre.
¥ La forme définitive de l'arbre bronchique ne sera atteinte qu'au
cours de la période post-natale au cours de laquelle ce méme
arbre bronchique subira encore 6 divisions.
¥ Le mésenchyme se condensera autour de ces bourgeons et rent
formera le squelette cartilagineux des voies aériennes et les parois |
musculaires.
¥ Laparoi d’échanges se formera a partir des extrémités des
bourgeons bronchiques oil 'épithélium deviendra pavimenteux
(épithélium alvéolaire) en contact intime avec les ca
sanguins. Les cellules pavimenteuses circonscrivent les sacs
alvéolaires ou alvéoles primitifs. Au cours des 2 derniers mois de la vie prénatale, ainsi
que des premiéres années de la vie extra-utérine, le nombre des alvéoles augmente, les
cellules épithéliales alvéolaires s'amincissent si bien que les capillaires font protrusion
dans les sacs alvéolaires.
ions
S* semaine
¥ Au 7éme mois, [a structure pulmonaire est telle, qu'elle autorise la survie du prématuré,
sil'accouchement était précipité. En effet, dés la fin du 62me mois, d'autres cellules
alvéolaires apparaissent sécrétant une substance, le surfactant, de nature
phospholipidique et lipoprotéique. Ce surfactant forme un mince revétement sur les
parois des alvéoles qui réduit la tension superficielle du liquide alvéolaire
Copitaires
ae ince ép:rettum lamin nce sna amo
—
Eronchioies
Endoxnetum
a eke
rd pone... (tee
pine
2- APPAREIL DIGESTIF
'¥ On distingue 3 parties: - intestin antérieur.
intestin moyen - intestin postérieur
a—Intestin antérieur
ees cd
Lorsque I'embryon atteint environ 4 semaines, le diverticule Lestomac apparait 3 la 4e semaine du
respiratoire apparait sur la paroi ventrale de Vintestin antérieur.Le | développement, sous 'aspect d’une dilatation
diverticule se sépare progressivement de la partie ventrale de fusiforme.
Vintestin antérieur par une cloison, le septum oesophagotrachéal. (i!
arrive que cette séparation ne se fasse pas comme il se doit; On parle
d'atrésie cesophagienne, une partie de l'cesophage dégénere)
Les tuniques musculaires et conjonctives sont formées par le
mésenchyme environnant.
+ foie et pancréas
¥ Présente un allongement qui est 2 ——— ° .
a c
Vorigine d'une anse intestinale ventrale A
en forme de V qui s'avance dans le rok acess
cordon ombilical et qui est vascularisée
par 'artare mésentérique supérieure.
*hemie" ‘Atrésie de Foesophee avec
¥ Cette "hernie" représente la migration ‘Atrtle oo
normale de Intestin en raison du fracheates A) 90% 8). 2%
: e Ee Deters,
manque de place dans 'abdomen.
'¥ Cette anse intestinale a 2 branches: une
branche,craniale/proximale -une branche caudale/ distale.
'¥ Paralldlement & cet allongement, 'anse inte:
inverse des aiguilles d'une montre, qui améne la branche caudale au-dessus de la branche
craniale.
sale subit une rotation de 270° dans le sens
¥ Labranche craniale va continuer a s'allonger et former I'intestin gréle qui décrit de
nombreuses sinuosités,
Y Labranche caudale s'allonge également mais demeure rectiligne, augmente de calibre et
donne le c6lon.
'¥ Laréintégration dans 'abdomen de lintestin moyen s'effectuera vers la fin du 3¢me mois. La
région du caecum sera la derniére 8 effectuer sa réintégration.
'¥ D’abord localisé dans le quadrant supérieur droit, le caecum va descendre dans la fosse iliaque
droite, ainsi se forme le célon ascendant et 'angle hépatique. Au cours de ce processus,
lextrémité distale du caecum forme un diverticule, ébauche de l'appendice.
'¥ Cetintestin moyen a done mis en place:
Y Vintestin gréle
le caecum et 'appendice
Le colon ascendant
Les 2/3 proximaux du colon transverse
S46
\f
1
Anomalie
¥ Lahernie ombilicale correspond & I'engagement
al,
n du futur intestin gréle ne peut a
de lintestin moyen vers le cordon ombi
puisque l'expan:
letoe garent vores
as étre contenue dans la cavité péritonéale. C'est
une hernie normale, temporaire et physiologique, puisqu'il va réintégrer la cavité abdominale
plus tard, sauf dans quelques cas pathologiques de malformation; on parle d'omphalocéle
lorsque les organes restent dans une poche, entourés d'amnios, ou de gastroschisis ou
laparoschisis lorsque la cavité péritonéale est insuffisante pour contenir les intestins, ceux-ci
sortent alors de la cavité abdominale par une fente.
'¥ Diverticule de Meckel apparait sur iléon et qui est lié & 'ombilic parle ligament vitellin. II se
peut qu'on ait un cyste vitellin au lieu d'un diverticule, mais le cas le plus grave reste celui de la
fistule vitelline ou le canal vitellin ne se ferme pas. Le contenu de lintestin gréle sort par le
nombril
c-Lintestin postérieur
'¥ Indépendamment du fait que I'intestin peut donner naissance:
Yau 1/3 distal du colon transverse
au célon descendant ”
au sigmoide
au rectum, g |
KAA
la partie supérieure du canal anal, la:
partie la plus caudale de cet intestin i (
postérieur ou cloaque va subir un “ \
cloisonnement. QE =
'¥ Cecloisonnement s'effectue en raison de
la progression en direction caudale d'une cloison appelée septum urorectal ou éperon périnéal
prenant naissance dans I'angle formé par|'allantoide et intestin postérieur.
'¥ Cette cloison va diviser le cloaque en 2 parties, une partie antérieure, le sinus urogénital et une
partie postérieure le rectum.
'¥ Vers la fin de la 68me sem, le septum urorectal a fusionné avec la membrane cloacale, la divisant
en une membrane anale qui disparaitra en fin de 7éme semaine et une membrane urogénitale.
'¥ Enfin la zone de fusion du septum urorectal avec la membrane cloacale devient le corps périnéal
ou périnée primitif.
Anomalie : Au cours de ce processus, il se peut que les ganglions nerveux pariétaux de la paroi
du tube digestif sont absents, donc les couches musculaires ne se contractent pas, notamment au
niveau d'une partie du colon, Cette partie regoit de plus en plus de matiére fécale et
s‘hypertrophie. Il s‘agit de la maladie de Hirschsprung ou mégacolon.
Ala fin de la 88me semaine, I'embryon baigne dans le placenta et ne mesure que 3 cm, mais tous
les organes ont été mis en place. Durant la phase suivante, on assiste & une maturation de ces
organes.
Ventoblaste est 8 Vorigine =
'¥ de 'épithélium de revétement des appareils respiratoire et digestif ; d'une partie de la vessie et
de Iurétre ; la caisse du tympan et de la trompe d’Eustache
'¥ du parenchyme de la thyroide, des parathyroides, du foie et du pancréas ;
'¥ du stroma réticulaire de ramygdale et du thymus ;
MOIS A LA NAISSANCE foetal ni
¥ Caractérisée par la maturation des tissus et des organes et par une croissance rapide du corps.
'¥ Peu de malformations sont induites au cours de cette période bien qu'il puisse encore se
produire des déformations ou autres perturbations du développement . Mais c'est la période ott
les techniques 4'investigations prénatales permettent la détection de malformations
congénitales.
'¥ La longueur du foetus est habituellement exprimée en longueur « vertex-coccyx » (foetus en
fiexion) ou en longueur « vertex-plante des pieds» ou « vertex-talon » (foetus en extension). En
fonction de ces longueurs, !’Age du foetus exprimé en semaines ou en mois lunaires est donné
parle tableau ci-aprés.
Age Longueur Poids (g)
En semaines | En mois vertex-coccyx
(cm)
0-12 3 5-8 10-45
13-16 4 9-14 60-200
17-20 5 15-19 250-450
21-24 6 20-23 500-820
25-28 7 24-27 900-1300
29-32 8 28-30 1400-2100
33-36 9 31-34 2200-2900
3740 10 35-36 3000-3400
¥ Lacroissance en longueur est particuliérement rapide au cours des 3e, 4e et Se mois de la
grossesse tandis que l'accroissement en poids intervient surtout au cours des 2 demniers mois.
'¥ Onestime généralement la durée de Ia grossesse 3 280 jours ou 40 semaines aprés le début des
dernidres régles, ou plus exactement 266 jours ou 38 semaines aprés la fécondation.
EVOLUTION MOIS PAR MOIS
'¥ Vundes caractéres les plus frappants de cette période feetale est le ralentissement relatif de la
croissance de la téte par rapport au reste du corps
Y Début du 3éme mois: environ la moitié de la longueur vertex-talon
Y Début du 4éme mois: environ le tiers de Ia longueur vertex- talon.
¥_Naissance: environ le quart de la longueur vertex-talon
ee ee en a ort Came sy
Gnd mois
la face prend.un aspect |-lefcetus augmente | - le foetus a un + lagraisse sous- = Cest le crane qui
plus humain : rapidement de aspect ridé en raison | cutangesemeten _| posséde la plus grande
les yeux, longueuret,alafinde |delapauvretéen | place ce qui donneau | circonférence de toutes
primitivement orientés | la premiere moitié de la | tissu conjonctif; | corps des contours _| les parties du corps.
latéralement, viennent | vie intra-utérine, la -silanaissance se | bien arrondis ; = la naissance le poids
se placer sure versant | longueur vertex-caccyx | produit 6 mois ou | - verslafin dela vie | du foetus est de 3000-
antérieurde la face; | etd’environ 15cm,se | dansla premiére _| intra-utérine a peau | 3400, la longueur
les oreilles se quireprésente peu | moitié du7emois, | est recouverte d’une | vertex-talon est
rapprochent deleur | prés la moitié de celle a | enfant ade substance blanchatre, | d’environ 50 cm ;- les
situation définitive, & a | la naissance grandes difficultés | le vernix caseosa. organes génitaux
face latérale de la téte; survivre. externes sont
~les membres
acquiérent une
longueur
proportionnelle & la
longueur du corps, mais | - le foetus est recouvert
les membres inférieurs
restent un peu plus
courts et moins
développés que les
membres supérieurs
- Cest aussi ala 12e
semaine que le
développement des
‘organes génitaux
externes est tel qu’il
permet le diagnostic du | particulier au cours des
sexe par 'échographie.
Te poids du foetus
augmente peu : la fin
du Se mois, iln’atteint
différenciés, etles
testicules sont en place
dans le scrotum.
as 500 g
d'un fin duvet le lanugo
+ au cours du Se mois,
les mouvements du
foetus sont nettement
percus par la mare.
Pendant la 2e moitié de
la vie intra-utérine, le
poids du foetus
augmente
considérablement, en
deux derniers mois et
demi ; pendant cette
période, il gagne 50%
de son poids total a
terme (environ 3 200g).
IL MALFORMATIONS CONGENITALES
'¥ Les malformations ou anomalies congénitales se définissent comme des troubles structuraux,
comportementaux, fonctionnels et métaboliques, présents a la naissance. La tératologie est la
science qui étudie les causes de ces anomalies.
'¥ Les anomalies de structure majeures reconnues a la naissance affectent 2 8 3 % des enfants nés
vivants. II faut y ajouter 2 8 3 % d’anomalies moins évidentes diagnostiquées dans les 5
premiéres années de la vie. Au total, la fréquence des grandes malformations est de 4a 6% ;
Elles sont au premier rang (21 %) des causes de mortalité infantile.
'¥ Lacause des malformations est inconnue dans 40 8 60 % des cas:
v
v
v
v
Dans 40 & 60% des cas ont une cause inconnue.
Dans 15 % des cas environ, elles résultent de facteurs génétiques comme les anomalies
chromosomiques et les mutations génétiques.
Dans 10 % des cas, il s‘agit de facteurs environnementaux.
Dans 20 a 25 % des cas intervient une combinaison de ces 2 facteurs.
'¥ On distingue diverses catégories de malformations
v
les malformations par agénésie des ébauches : elles entrainent une absence compléte
ou partielle de I’ébauche. La plupart de ces malformations se constituent entre la 3e et la
8e semaine du développement ; les malformations congénitales liées & la destruction ou
a l'altération de ’ébauche constituée
les déformations lites & des facteurs mécaniques, comme les piedsbots dus 8 une
malposition intra-utérine ;
les syndromes malformatifs, qui sont des associations fréquemment rencontrées de
malform:
Agents tératogénes
Les agents tératogenes sont des facteurs qui provoquent I'apparition de malformations congénitales.
Bien str, cela dépend de la dose et de la durée d'exposition de la femme enceinte, ainsi que du stade
de la grossesse (la période embryonnaire est le stade le plus vulnérable).
NB : La sensibilité aux agents tératogenes dépend aussi du type d'organe. Le systéme nerveux est &
risque durant toute la durée de la grossesse, par exemple.
[AGENTS TERATOGENES
.
FECTIEUX
Rubéole : infection bénigne, saut si elle survient chez la femme enceinte, oil les dégats sont
catastrophiques sur le foetus. Risque de malformations oculaires et cardiaques, surdité.
Cytomégalovirus : microcéphalie, cécité, arriération mentale.
Toxoplasmose : Causée par un parasite qui cause, elle se traduit par une calcification cérébrale,
une hydrocéphalie, une microphtalmie,
Syphilis : Causée par une bactérie et sexuellement transmissible, elle se traduit par une
arriération mentale, une surdité.
AGENTS TERATOGENES CHIMIQUES
.
.
’
¥
Thalidomide : phocomélie, amélie, malformation cardiaque.
Streptomycine : surdité
Sulfamid
Tétracycline : anomalie osseuse et dentaire.
rictére nucléaire.
Les 3 demiers sont des antibiotiques prescrits en cas d'infection, d'acné,
AGENTS TERATOGENES PHYSIQUES
.
.
.
Rayons X : microcéphalie, spina bifida, division palatine, phocomélie.
Hyperthermie : anencéphalie, spina bifida
Les Rl et les métaux lourds.
IIL - DIAGNOSTIC PRENATAL
.
.
Il existe plusieurs moyens d’investigation pour le dépistage in utero des troubles de la croissance
et du développement. La combinaison de ces techniques permet de détecter les malformations,
les anomalies chromosomiques et surtout de surveiller la croissance du foetus.
Les techniques a’investigation au cours de la période prénatale sont
YWéchographie : Elle se base sur l'utilisation des ultrasons, on peut donc faire autant
d'échographie qu'on veut sans aucun risque, mais on les limite 1 échographie par
trimestre si tout se passe bien.
DN foetal circulant : II suffit de prélevé du sang des veines périphériques pour pourvoir
suivre le déroulement de la grossesse, puisqu'on a pu y détecter de I'ADN foetal. Celui-ci est
amplifié pour étre étudié en vue de détecter une quelconque anomalie d'origine génétique.
Y Vamniocentése: consiste en un prélévement de liquide amniotique. Elle ne peut étre
pratiquée qu’a partir de la 14e semaine, la quantité de liquide amniotique étant insuffisante,
Ilya tout de méme risque d'avortement ou d'infection. Le risque est d’autant plus
important pour la femme enceinte si elle est dgée, puisqu'elle ne parvient plus faire de
fausses-couches, d'avortements spontanés.
Y la biopsie des villosités choriales. Ces villosités sont le sige de nombreuses divisions
cellulaires permettant un examen direct des anomalies chromosomiques et biochimiques.
Cette technique a avantage d’étre possible a un stade précoce de la grossesse (10-11
semaines).
Y cordocentase : |! s'agit d'une ponction du cordon ombilical. Elle ne peut se faire qu'a partie
de la 188me semaine, oi le veine ombilical est assez grosse pour supporter une ponction.
Cependant, le risque est d’autant plus grand en ce qui concerne cette technique (2.8 5%). On
peut faire n/importe quelle analyse & partir de cette technique (caryotype, incopatibilité des
Broupes sanguins, anémie hémolytique...)
'¥ Ces 2 derniéres méthodes sont réservées aux grossesses risque :
Y ge maternel supérieur 8 35 ans
Y _antécédents familiaux danomalies de fermeture de la gouttiére neurale
Y anomalies chromosomiques dans la fratrie (syndrome de Down)
Y anomalies chromosomiques chez I'un des parents
Les risques propres & ces méthodes sont légers : 0.5 % d'avortements pour I'amniocentése, 1%
pour la biopsie des villosités choriales.
PLACENTA ET MEMBRANES FCETALES
'¥ Annexes embryonnaires : cavité amniotique, vésicule vitelline 1, ccelome externe, le diverticule
allantoidien
Le placenta est I'annexe la plus importante.
lest constitué de deux éléments
<<
Y une portion feetale, dérivée du chorion villeux ;
une portion maternelle dérivée de la caduque basilaire.
'¥ Les principales fonctions du placenta sont :
¥ les échanges gazeux;
les échanges nutritifs et électrolytiques ;
la transmission des anticorps maternels, conférant au foetus une immunité passive ;
la sécrétion d’hormones ; (HCG)
le réle de barriére a 'encontre de certains produits toxiques.
KKK
1- FORMATION DU PLACENTA HUMAIN.
A- STRUCTURE DE LA PAROLUTERINE
'¥ Normalement, la muqueuse utérine ou endomatre, desquame 8 la fin du cycle ovarien, c'est-a
dire a la fin de la phase folliculo-lutéinique faisant apparaitre les régles, phénomene lié &
Vinvolution du corpsjaune.
'¥ Silya fécondation, le corps jaune persiste et 'endometre au lieu d'involuer, présente toute une
série de modifications. Cet endomatre prend le nom de caduque utérine.
'¥ On distingue un revétement épithélial comportant des glandes dilatées en profondeur, plissées,
tres sécrétantes (glycogéne). Cette partie profonde glandulaire et trés vascularisée & aspect
vacuolaire prend le nom de caduque spongieuse. La partie superficielle présente au contraire un
tissu constitué par de nombreuses cellules conjonctives modifiées, volumineuses, polyédriques
‘ou globuleuses a cytoplasme riche en glycogene, en enclaves lipidiques et protidiques. Ce sont
les cellules déciduales.
'¥ Cette portion de I'endométre représente la couche compacte ou déciduale. De nombreuses
cellules déciduales libérent leurs composés au cours de la nidation, composés qui seront utilises
pour la nutrition de 'embryon.
B- PREMIERS STADES DE DEVELOPPEMENT.
'¥ Au Géme jour du développement, I'euf s'applique contre la muqueuse utérine et commence &
se fixer. Le trophoblaste prolifére, forme des végétations qui perforent I'épithélium superficiel.
Ces végétations s'insinuent dans le chorion, détruisent les glandes, les cellules déciduales et les
vaisseaux
¥ Au cours de la 28me semaine, l'ensemble de 'ceuf est situé 8
Vintérieur de la muqueuse ou caduque. Cet ceuf fera de plus en plus,
saillie dans la cavité utérine. il restera toujours situé 3 'intérieur de
la caduque qui présente plusieurs parties:
Y la caduque utéro placentaire située entre l'ceuf et le
myometre ;
ot ters: pena
Y la caduque pariétale ou vraie: partie de l'endomeétre située en dehors de la zone de
nidation;
¥ lacaduque ovulaire ou réfléchie, partie de muqueuse qui recouvre I'ceuf le séparant de
la lumiére utérine.
'v En fin de 2éme semaine alors que I'embryon est encore au stade “didermique”, apparaissent
suecessivement les annexes embryonnaires:
¥ le lécithocéle et son diverticule I'allantoide tapissés EUF: fin 2°sem
d'entoblast.
Y lacavité amniotique limitée par l'amnios;
¥ le coelome extra-embryonnaire délimité par le \
mésoblaste pariétal, la splanchnopleure et la amet
somatopleure extra-embryonnaire; -
¥ le pédicule embryonnaire, pont mésoblastique
unissant I'embryon & la coque périphérique de l'ceuf :
le chorion;
¥ le chorion formé par I'accolement du mésoblaste
pariétal au trophoblaste, Iui-méme composé de
cytotrophoblaste et de syncytiotrophoblaste
Das la fin de la 2¢me semaine apparait un début d'un soulévement, d'une prolifération du
cytotrophoblaste. On parle de villosité trophoblastique, puis choriale lorsque le mésoblaste extra-
‘embryonnaire devient aussi concerné par ces soulévements. Début de la formation du placenta
C- EVOLUTION DES VILLOSITES TROPHOBLASTIQUES
1- Vers le 108me jour, le chorion se trouve constitué par une couche périphérique, le
syncytiotrophoblaste perforé de lacunes, doublé par le cytotrophoblaste lui-méme cerné parle
mésoblaste pariétal. La muqueuse au contact du syncytiotrophoblaste est caractérisée par le
présence de grosses cellules déciduales (voir nidation),
2- Vers le 12me jour, le syncytiotrophoblaste érode les
capillaires de l'endométre, le sang maternel pénétre dans
les lacunes du syncytiotrophoblaste. Des cordons
cytotrophoblastiques poussent dans les travées du
syncytio-trophoblaste constituant les villosités primaires.
En coupe transversale, Le cytotrophoblaste constituant
axe de la villosité est formé de cellules de LANGHANS.
3- Vers le début de la 38me semaine (1Séme jour environ),
un axe mésenchymateux venant du mésoblaste pariétal
s'enfonce dans l'axe cytotrophoblastique des villosités
formant les villosités secondaires.
aon vopnblesiqe prima 113208)
En coupe transversale, a villosité secondaire montre UN€——yenpnnane ~
lame périphérique syncytiotrophoblastique plus mince aveC sy.
des microvillosités constituant une bordure en brosse. LS nse ssjjo
noyaux ne sont plus répartis uniformément. Leur a
regroupement fait apparaitre des plages nucléées et des plages protoplasmiques. Quant au
cytotrophoblaste, il est constitué par une seule couche de cellules de LANGHANS. L'axe de la villosité
est occupé par du mésenchyme ou tissu conjonctif embryonnaire.
4- Vers le milieu de la 3eme semaine (18¢me/19éme jour). Les jlots sanguins se différencient dans
axe mésenchymateux des villosités qui prennent alors le
nom de villosités tertiaires.
En coupe transversale, on retrouve le syncytiotrophoblaste
qui par endroits prolifére et donne des plasmodes pouvant
se détacher. Le cytotrophoblaste devient discontinu. L'axe
conjonctif vascularisé comporte des cellules de HOFBAUER
riches en enclaves lipidiques. Parallélement, les lacunes du
syncytiotrophoblaste confluent en une cavité unique: la
chambre intervilleuse.
5- Dela fin de la 38me semaine au début du 3eme mois, certaines poussées cytotrophoblastiques
perforent le syncytiotrophoblaste. Les cellules de LANGHANS proliférent en tapissant la caduque
‘maternelle édifiant ainsi progressivement, une coque cytotrophoblastique continue sur laquelle
viennent se fixer des villosités.
¥ Ondistingue alors:
Y les vllosités libres dont 'extrémité distale flotte librement dans la chambre intervilleuse ;
¥ lesvvllosités crampons, les plus nombreuses, attachées & la coque cytotrophoblastique.
¥ Lesang de|'embryon quicircule dans les vaisseaux des villosités est séparé du sang maternel
contenu dans la chambre intervilleuse par:
¥ endothelium des capillaires embryonnaires
¥ lemésenchyme
Y le cytotrophoblaste
¥ le syncytiotrophoblaste.
¥ Les artares utéroplacentaires et les sinus veineux maternels qui s'ouvrent dans le chambre
intervilleuse permettent un flux sanguin continu dans lequel baignent les villosités.
'¥ On peut dire que le placenta est dés lors constitué et sa structure variera peu.
6- Si au cours des premiéres semaines du développement (fin du premier mois) toute la surface de
Mceuf est recouverte de villosités, seules les villosités situées dans la région du ple embryonnaire
continuent & se développer, donnant naissance au chorion villeux. Au péle antiembryonnaire, les
villosités dégénérent, si bien qu’au 3me mois, cette partie du chorion est dépourvue de villosités :
est le chorion lisse.
Llceuf volumineux entraine une réduction de la cavité utérine et vers la fin du 38me mois, la caduque
réfléchie va fusionner avec la caduque pariétale. Le développement de la cavité amniotique entraine
une quasidisparition du caelome extra-embryonnaire.
Lensemble composé de I'amnios, mésoblaste, chorion lisse et des caduques pariétale et réfiéchie,
forme les membranes foetales.
7 - Enfin 'évolution entre le 2éme et le 4#me mois est marquée
par la disparition progressive des cellules cytotrophoblastiques
quelle que soit leur localisation.
La coque cytotrophoblastique dégénére, il ne subsiste aprés le
4ame mois, que des éléments vestigiaux mélés au
syncytiotrophoblaste et aux cellules déciduales.
Al'union des éléments c'origine foetale et des cellules
déciduales se constitue une couche de substance fibrinoide : la mena ange tte
couche de Nitabuch qui formera a terme, en raison de la —
disparition quasi-compléte des éléments trophoblastiques, la Villosité trophoblastique 4éme mois
parol basale de la chambre intervilleuse
(On trouve également de la substance fibrinoide sous le syncytium des villosités et dans les septa
intercotylédonaires. II s'agit de masses homogenes, acidophiles.
En conclusion: le placenta humain est un organe hémochorial, c'est-adire que le sang maternel
est directement en contact avec le chorion au niveau de la chambre intervilleuse.
Crest un organe attaché a la paroi utérine par sa face maternelle ou plaque basale, zone
d'accrochage des villosités crampons. Sa face foetale, ou plaque choriale, base de départ des
villosités, donne insertion au cordon auquel est appendu le foetus,
A-STRUCTURE DU PLACENTA A TERME,
1-Aspect macroscopique,
'¥ Enfin de grossesse, le placenta se présente comme un organe discoide de S00 3 600 grammes
mesurant 20 cm de diamétre environ et 2.cm d'épaisseur.
¥ Il comporte deux faces:
Y Laface tournée vers le foetus, lisse, revétue par le feuillet amniotique et qui présente en
son centre I'insertion du cordon ombilical Sxtepeueccnte nse,
-Les vaisseaux ombilicaux forment un vaste coasts
réseau visible par transparence; save es,
Y La face tournée vers utérus, ou face en
maternelle, qui apparait subdivisée pardes caus = iit
sillons plus ou moins profonds enterritoires. as
cotylédonaires. ape tie
2 Aspect microscopique cue \
'¥ Sur une coupe longitudinale du placenta.
¥ Le placenta se trouve attaché a la parol utérine par
sa face maternelle ou plaque basale, zone d'accrochage des villosités crampons sur la caduque.
La plaque basale est formée de syncytiotrophoblaste, de cytotrophoblaste et des couches
compacte et spongieuse de I'endometre.
Sa face foetale ou plaque choriale qui donne insertion au cordon
représente la base de départ des villosités. Elle comprend
I'épithélium amniotique, du mésenchyme avec les vaisseaux
sanguins ombilicaux, du cyto et du syncytiotrophoblaste.
En périphérie, le placenta se poursuit par les membranes c'est &
dire ensemble composé par 'amnios, le mésoblaste, le chorion
lisse, les caduques pariétale et réfléchie.
Iya 25 a 30 troncs villositaires qui partent de la plaque choriale.
Chaque tronc villositaire primaire se divise en branches de lime -
lll&me ordre & l'origine d'une multitude de villosités libres et
soudées. Le tronc villositaire et ses ramifications forment une
Unité: le eotylédon,
Entre les cotylédons, la muqueuse maternelle envoie
des expansions, les cloisons intercotylédonaires qui ent
natteignent jamais la plaque choriale ; ly adonc 15 & —_cowrecempace
30 cotylédons bien individualisés communiquant ‘Spite
largement entre eux.
Le sang foetal arrive par les deux artéres ombilicales
enroulées en spirale autour de la veine ombilicale (100
ml par minute et par kilogramme environ). Ces
vaisseaux sont emballés dans un tissu conjonctf léche,
La GELEE de WHARTON, avec des vestiges des canaux Placenta au déme mois:
faonion “organisation générale (1)
Le cordon ombilical mesure 2 cm de diametre environ et 50 8 60 cm de longueur,
Les deux circulations ombilicale et maternelle sont indépendantes
l'une de l'autre comme le montre une coupe de villosités & terme.
Cette villosité est caractérisée par:
ios
Y _unaxe conjonctif riche en capillaires volumineux, dont
certains appliqués directement sur le syncytiotrophoblaste Vestine attain
Artreombicate
au niveau des régions dépourvues de noyaux.
la quasi disparition du cytotrophoblaste;
Y _unsyncytiotrophoblaste plus mince, d'épaisseur inégale
avec par endroits des amas nucléaires. Ce
syncytiotrophoblaste présente, en surface, des
microvillosités. Cordon ombilical (C.T)
Vers la fin de la grossesse, des processus de dégénérescence du syncytiotrophoblaste se
produisent. Ces régions sont remplacées par une couche fibrincide. Le syncytiotrophoblaste perd
<
eine ombiale
son activité fonctionnelle. L'essentiel des échanges se fait presque au travers de la paroi du
capillaire
U'examen ultrastructural de la paroi des villosités montre :
Y une lame basale interposée entre le syncytiotrophoblaste et le conjonctif;
Y _laprésence de nombreuses vésicules de pinocytose qui traduisent lintensité des
échanges;
Y de nombreuses mitochondries responsables de l'apport énergétique;
Yun ergastoplasme tras développé traduisant une
activité de synthése protéique (élaboration calles
d'hormones);
Y des cellules de LANGHANS situées entre la lame basale
et le syncytiotrophoblaste. Les cellules semblent avoir
le réle de cellules souches pouvant intervenir au cours
de phénomanes de réparation.
'¥ Enfin "examen histologique d'une cloison intercotylédonaire
montre : ; ,
Y le syncytiotrophoblaste & la périphérie; ‘veerme terran)
une épaisse couche fibrinoide avec des cellules.
cytotrophoblastiques;
Y des cellules déciduales du chorion cytogene au centre ;
des vaisseaux maternels.
B= COMPORTEMENT DU PLACENTA AU MOMENT DE L’ACCOUCHEMENT.
'¥ Les contractions utérines augmentent Ia pression du liquide contenu dans la cavité
~amniotique appelée "poche des eaux" par les obstétriciens. Cela entraine une rupture de
la paroi de la cavité amniotique. Le foetus est expulsé entrainant le cordon ombilical.
'¥ Quelques minutes aprés ligature, et section du cordon, un plan de clivage apparait dans
| épaisseur de la caduque utéroplacentaire qui se poursuit dans |'épaisseur de la caduque
pariétale (avant I'accouchement, la caduque ovulaire et la caduque pariétale avaient
fusionné). Le placenta et les caduques sont expulsés en bloc. C'est le phénomene de la
délivrance.
'¥ Lamince couche d'endomatre demeurée en contact avec le myométre reconstituera la
muqueuse utérine.
C= ROLE DU PLACENTA
1-Réle métabolique
Le placenta assure tous les échanges entre le foetus et 'organisme
maternel Il assure ainsi la respiration, la nutrition et 'élimination
'¥ Ces échanges portent sur un grand nombre de substances ects aa
Eau, C02, 02, molécules organiques (glucide, lipide, protide) ELECTROLYTES,
él és Glucides
éléments minéraux. rues
'¥ Ces échanges se font au niveau des villosités entre les deux Provdes
itomines|
systémes circulatoires & travers la barridre placentaire de plus
en plus mince, au fur et & mesure que la grossesse évolue.
'¥ Ces échanges seront également favorisés parle trés grand
nombre de villosités qui développent en tout, une surface de
plusieurs métres carrés, et parla présence de microvillosités 8
la surface du syncytiotrophoblaste.
'¥ Grace 8 ces échanges, le sang foetal repart vers I'embryon enrichi de substances nutritives et
oxygene et débarrassé de ses substances de déchets.
'¥ Certaines substances passent facilement:
Y Eau, Oxygéne, Gaz carbonique
¥ _ Eléments minéraux
Y Acides aminés
Y Glucides
Y Vitamines hydrosolubles (B-C), iln'en est pas de méme des vitamines liposolubles (A-D-E-K).
'¥ D’autres substances traversent la barrire placentaire aprés des phénoménes métaboliques plus
‘ou moins complexes. (lipides et protéines)
'¥ Les anticorps passent la barriére placentaire. Cela explique que le foetus puisse étre immunisé
contre certaines maladies infectieuses pour lesquelles la mére est immunisée (diphtérie,
scarlatine, variole, rougeole). Par contre, aucune immunité n'est acquise pour la varicelle, la
coqueluche.
'¥ Le placenta normalement représente une barriére protectrice vis-avis des bactéries et des
parasites. Cependant, il laisse passer une bactérie, 'agent de la syphilis, le TREPONEME et un
parasite le TOXOPLASME.
'¥ Le placenta laisse passer la plupart des médicaments, certains d'entre eux se sont avérés
tératogénes. Le placenta laisse passer les virus.
¥ Parailleurs, s'il est classique de considérer qu'il n'y a pas de mélange des sangs maternel et foetal
dans le placenta, il semble bien que des hématies foetales puissent parfois passer dans la
Circulation maternelle. Ce passage nous explique le mécanisme d'apparition de la maladie foetale
la plus fréquente : 'anémie hémolytique par incompatibilité sanguine faeto-maternelle liée au
facteur Rhésus.
Hormone gonadotrophine chorionique ou | Hormone lactogéne,hormone _| Hormones stéroidiennes (oestrogénes
He ‘somato-mammotrophique etprogestérone)
chorionique (H.C'S).
'¥ Cest une hormone élaborée parle
syneytiotrophoblaste désladeuxieme | ¥ Crestune hormone sécrétée | ¥ Les sécrétions sont faibles au début,
sem; elle présente un maximum de dés la 6@me semaine en faible | elles augmentent ensuite
sécrétion entre le 28me et le 38me mois. quantité, Sa concentration rogressivement
Son taux diminue ensuite rapidement, s'éleve jusqu'au 92me mois | w Les oestrogenes ne proviennent pas
rg Calfe Karmane carcbe lataniare exterae de grossesse. seulement du corps jaune et du
Gescelules rophoblestiques sur laquelle. | ¥ El Favorise le maintien du placenta, mais également de
tle agit comme une couche de protection | corPsiaune nombreux follicules cavitaires qui se
immunitaire lle empéche le rejet du | ¥ Elle agitsurlaglande développent autour du corpsjaune et
blastocyste et facilite son implantation. mammaire maternelle et qui persistent pendant la grossesse.
S$: Ele aasire a aint eh caro atin prépare la lactation. '¥ Laprogestérone inhibe les
son développement etsa trancformetion | ¥ So dosage dansle sang contractions utérines, donc évite
en corps gestatit. maternel renseigne sur Vavortement.
¥ Des taux tbs élevés de H.C.G, sont Irévolution de la grossesse. ¥ Les oestrogenes provoquent le
sécrétés dans les tumeurs du placenta développement de la gtinde:
(méle hydatiforme - chorio carcinome). mammaire en vue de la lactation
D-Grossesse gémellaire
Faux jumeaux ou jumeaux dizygotes (7 4 11% sur 1000 naissances)
'¥ llyadouble ovulation et double fécondation. Les ressemblances entre les faux jumeaux sont les
mémes que chez des fratries d’ges différents,
'¥ organisation des annexes embryonnaires dépend de I'impiantation.
'¥ Siles jumeaux s/implantent loin de l'autre, on obtient 2 annexes embryonnaires indépendantes.
On parle de jumeaux dizygotes di-amniotiques dichoriaux.
'¥ Ilarrive que les 2 blastocystes s'implantent céte & céte. Dans ce cas, les chorions fusionnent mais
chacun garde sa propre cavité amniotique. On parle de jumeaux dizygotes di-amniotiques
monochoriaux
Vrais jumeaux ou jumeaux monozygotes (3 a 4%)
'¥ lly aune seule ovulation, une seule fécondation, on obtient done
un seul zygote qui va se cliver pour donner naissance & 2 jumeaux
parfaitement identiques.
'¥ Sile clivage se produit tras tat dans la segmentation (ex: 2
blastomeres), on obtient 2 blastocystes. Siis simplantent loin I'un
de autre, on obtient des jumeaux monozygotes di-amniotiques.
dichoriaux
¥ _ Sile clivage se produit plus tard (ex : stade masse cellulaire
interne), bien aprés la formation du trophoblaste et du chorion,
les jumeaux ont un méme placenta. On parle de jumeaux
monozygotes di-amniotiques monochoriaux.
Sie clivage se produit tras tardivement, aprés la formation de la
cavité amniotique (ex : stade disque embryonnaire),
on obtient des jumeaux monozygotes mono-
amniotiques monochoriaux.
¥ Sile clivage ne se fait qu’a la 3éme semaine, durant la
gastrulation, les jumeaux ont en commun une partie
de leur corps. Plus le clivage est tardif, plus la partie
en commun est importante. On parle de jumeaux
conjoints ou siamois
‘Thoracopage Pygopage Craniopage
Vous aimerez peut-être aussi
- Compte RenduDocument12 pagesCompte RenduMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Rapport SFE Les Huileries Du Souss BelhassanDocument38 pagesRapport SFE Les Huileries Du Souss BelhassanMohamed ECHAMAI100% (2)
- Seance 4Document8 pagesSeance 4Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Cour Après Deux VideosDocument9 pagesCour Après Deux VideosMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Réponses Aux Questions À Propos de La BactériologieDocument2 pagesRéponses Aux Questions À Propos de La BactériologieMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Controles Et Examens BCG S4Document211 pagesControles Et Examens BCG S4Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- TD 1Document11 pagesTD 1Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- 1 Pathologie de La MitoseDocument25 pages1 Pathologie de La MitoseMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Les Peptides BenchakrounDocument90 pagesLes Peptides BenchakrounMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Microbio Normale 2022Document11 pagesMicrobio Normale 2022Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Vaisseaux Du CoeurDocument2 pagesVaisseaux Du CoeurMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Isa 2020Document1 pageIsa 2020Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Cytogénétique HumaineDocument128 pagesCytogénétique HumaineMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- 2.paroi Thoracique BjijouDocument86 pages2.paroi Thoracique BjijouMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- AA Structure-Enzymologie-MétabolismeDocument28 pagesAA Structure-Enzymologie-MétabolismeMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Isa 2020Document1 pageIsa 2020Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Aorte ThoraciqueDocument17 pagesAorte ThoraciqueMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Université Hassan II de Casablanca - Faculté Des Sciences Et Techniques de MohammediaDocument1 pageUniversité Hassan II de Casablanca - Faculté Des Sciences Et Techniques de MohammediaMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Metabolisme Et Nutrition BacteriensDocument22 pagesMetabolisme Et Nutrition BacteriensMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Etude de La Diversité Métabolique Des Micro-Organismes Des Sources Hydrothermales OcéaniquesDocument206 pagesEtude de La Diversité Métabolique Des Micro-Organismes Des Sources Hydrothermales OcéaniquesMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- La Culture in Vitro Astuces Et Pratiques: November 2015Document43 pagesLa Culture in Vitro Astuces Et Pratiques: November 2015Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Iaa (Oral)Document2 pagesIaa (Oral)Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Isa 2020Document1 pageIsa 2020Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Les Processus de Fabrication Du Farine Á Partir Du Mais-3Document3 pagesLes Processus de Fabrication Du Farine Á Partir Du Mais-3Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- TD Chimie Gbi Serie 1 2 3 4 5Document7 pagesTD Chimie Gbi Serie 1 2 3 4 5Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Appel À Candidature Concours FI 1ere Année 2019 2020Document2 pagesAppel À Candidature Concours FI 1ere Année 2019 2020Mohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- La FumonisineDocument6 pagesLa FumonisineMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation