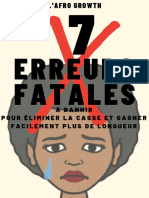Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
MS - Cdet - T - Arc - V1
MS - Cdet - T - Arc - V1
Transféré par
beldjehemTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
MS - Cdet - T - Arc - V1
MS - Cdet - T - Arc - V1
Transféré par
beldjehemDroits d'auteur :
Formats disponibles
CDET_T_ARC_V1
L'ARC ELECTRIQUE
CODIFOR AFPI INTERNATIONALE
1/19
CDET_T_ARC_V1
SOMMAIRE
1. PRINCIPE................................................................................................. 4
2. LE MATERIEL : DIFFERENTS TYPES DE GENERATEURS ................ 5
2.1. LES TRANSFORMATEURS STATIQUES ....................................................... 5 2.2. LES TRANSFORMATEURS REDRESSEURS.................................................. 5
3. LES ELECTRODES ................................................................................. 6
3.1. DEFINITION ............................................................................................ 6 3.2. CLASSIFICATION SUIVANT LEPAISSEUR DE LENROBAGE ............................ 6 3.3. CLASSIFICATION DES ELECTRODES PAR LA NATURE DE LENROBAGE .......... 7 3.3.1. Enrobage basique .................................................................. 7 3.3.2. Enrobage rutile ....................................................................... 7 3.3.3. Enrobage volatil ou cellulosique ............................................. 7 3.3.4. Enrobage oxydant .................................................................. 7 3.3.5. Enrobage acide ...................................................................... 7 3.3.6. Enrobages divers.................................................................... 8 3.3.7. Electrodes apport par lenrobage et lectrodes poudre de fer..................................................................................... 8 3.4. ROLE DE LENROBAGE............................................................................. 9 3.4.1. Rle lectrique........................................................................ 9 3.4.2. Rle mtallurgique.................................................................. 10 3.4.3. Rle mcanique et opratoire................................................. 10 3.5. CONSERVATION ET ETUVAGE DES ELECTRODES ....................................... 12 3.5.1. Dtrioration mcanique ........................................................ 12 3.5.2. Absorption dhumidit ............................................................. 12 3.6. CLASSIFICATION NORMALISEE DES ELECTRODES ...................................... 13
2/19
CDET_T_ARC_V1
4. LES TECHNIQUES SPECIALES............................................................. 19
4.1. LE SOUDAGE PAR GRAVITE ..................................................................... 19 4.2. LE SOUDAGE EN DESCENDANT ................................................................. 19
3/19
CDET_T_ARC_V1
1. PRINCIPE
Le mtal dapport est transfr par un arc lectrique jaillissant entre lme de llectrode enrobe et le mtal des bords assembler. La chaleur dgage par larc lectrique fait fondre simultanment, le mtal de base, lme et lenrobage de llectrode, crant ainsi le bain de fusion qui recueille les gouttes de mtal dapport et de laitier fondu transfres dans le plasma de cet arc. Une partie des constituants de llectrode est volatilise, contribuant crer latmosphre dans laquelle larc jaillit. Lenrobage fondu, de faible densit, recouvre le bain de fusion formant le laitier qui protge le mtal dpos pendant et aprs la solidification. (1) Le passage du mtal de lme jusquau bain de fusion sopre par gouttes de mtal en fusion. Ces gouttes sont plus ou moins fines suivant la nature de lme et la nature de lenrobage. Dans tous les cas, la finesse des gouttes crot avec lintensit du soudage (Is). Parfois, si les gouttes sont trop volumineuses, il y a court-circuit entre lme et la pice : llectrode risque de coller. (2) La notion de pntration est complexe. Pour un mme type dlectrode, la pntration crot avec le diamtre et lintensit de soudage. Une faible vitesse davancement augmente sa valeur, mais faiblement. La pntration est essentiellement fonction de la nature de lenrobage qui conditionne la tension en charge de llectrode (tension aux bornes de larc - Us). En principe, plus cette dernire est leve, plus la pntration est grande. Sauf dans le cas du soudage en forte pntration, il est inutile et nfaste de rechercher une pntration trop importante : ses rles essentiels sont de refondre superficiellement les couches de soudure antrieures en liminant toute trace ventuelle de laitier, dobtenir une pntration la racine en angle, de fondre le talon du chanfrein en soudage bord bord. (3) Technologiquement, le rle du cratre de la chenille est important : il doit tre de forme rgulire, peu profond, lisse, brillant, exempt de toute piqre ou crique. (4) Les stries : leur finesse et leur forme dpendent essentiellement du type dlectrode. Toutefois, la vitesse davancement, lintensit de soudage, la tension vide du poste, la mthode de soudage jouent un rle important.
4/19
CDET_T_ARC_V1
2. LE MATERIEL : DIFFERENTS TYPES DE GENERATEURS
2.1. LES TRANSFORMATEURS STATIQUES
Ce sont des transformateurs monophass ou triphass (avec bobine d'quilibre). La bobine d'quilibre est un bobinage complmentaire qui permet d'utiliser les trois fils d'un rseau triphas pour alimenter un bobinage monophas. Elle peut tre incorpore dans le poste ou livre sparment pour tre raccorde extrieurement au poste. Le secondaire du poste fournit du courant alternatif 50 Hz. L'organe de rglage permet d'adapter l'intensit de soudage pour fondre l'lectrode suivant son diamtre, sa nature et sa position d'emploi. Le transformateur statique est l'appareil le plus simple qui puisse exister et le plus conomique du point de vue achat et exploitation. De plus, il ne ncessite pratiquement aucun entretien.
2.2. LES TRANSFORMATEURS REDRESSEURS
Ils se composent d'un transformateur triphas dont le courant alternatif du secondaire est redress par des redresseurs. Le courant dbit est donc du courant continu redress, c'est--dire trs lgrement ondul et prsentant des proprits de soudage identiques celles du courant continu. Ces postes triphass quilibrent naturellement la charge sur le rseau et sont de prix infrieur celui des groupes courant continu, bien que procurant les mmes avantages au point de vue soudage. En tant que postes statiques, ils ne ncessitent pratiquement aucun entretien. Comme appareils producteurs de courant continu, ils reprsentent la solution idale. De plus, c'est le type de poste qui absorbe le moins de courant au primaire quoique quilibrant le rseau.
5/19
CDET_T_ARC_V1
3. LES ELECTRODES
3.1. DEFINITION
Cest un produit compos de deux parties bien distinctes : Lme : partie centrale en fil rond, gnralement en acier au C. Mn ou faiblement alli ou alli (parfois en cuivre, en monel, en bronze, etc....) dont le rle est de concourir "conduire" le courant lectrique et constituer le mtal dpos (mtal "apport"). Une partie extrieure : cylindrique et rigoureusement concentrique lme, dnomme enrobage. Sa constitution physique et chimique est trs complexe. Le diamtre de lenrobage, pour une me de 4, peut varier de 4,6 mm 6,8 mm ; jusqu 10 mm pour des lectrodes haut rendement. La qualit dune lectrode, lors de sa cration, est certes primordiale, mais son maintien dans le temps, cest dire "la constance de fabrication" est lapanage de socits disposant de moyens dtudes, de fabrication et de contrle trs importants. Lenrobage est constitu dun mlange trs complexe "de produits support" (rutile, carbonate de chaux, etc...) de "produits actifs" (ferro-alliages, etc....) et dun "liant" (silicates) qui sera dterminant pour la qualit du joint soud. Ce sont notamment les premiers qui caractrisent le type denrobage et lui confrent ses proprits fondamentales (enrobage rutile, enrobage basique, etc....) ainsi que sa facilit dutilisation soit en courant continu soit en courant alternatif.
3.2. CLASSIFICATION SUIVANT LEPAISSEUR DE LENROBAGE
Lpaisseur de lenrobage aura peu dinfluence sur les caractristiques du mtal dpos compar la nature mme de lenrobage. Les anciennes normes classaient les enrobages en mince, semi-pais, et pais. Voir linfluence de lpaisseur au paragraphe 3.3.3. Cette classification a t abandonne dans la norme NF EN 499 (indice de classement NFA 81 309) qui ne parle que denrobage pais compar aux enrobages normaux. Un enrobage est considr comme pais lorsque le rapport : Diamtre de lenrobage 1,6 Diamtre de lme
6/19
CDET_T_ARC_V1
3.3. CLASSIFICATION LENROBAGE
DES
ELECTRODES
PAR LA
NATURE
DE
3.3.1. Enrobage basique Les lectrodes base de carbonate de calcium enrob dun fondant ont dexcellentes proprits mcaniques. Leur fusion dgage un minimum dhydrogne permettant ainsi dobtenir de meilleurs rsultats pour le soudage des aciers au C. Mn et faiblement allis. Du fait de sa nature, lenrobage est trs hygroscopique ce qui ncessite un tuvage 300 C environ avant lemploi. Les lectrodes enrobage basique prsentent les meilleures caractristiques mcaniques, notamment en ce qui concerne la rsistance la rupture fragile. Elles sont utilises pour les assemblages de haute scurit et chaque fois que lon a affaire des aciers difficilement soudables (aciers fortement chargs en carbone et manganse, aciers faiblement allis, etc). 3.3.2. Enrobage rutile Les lectrodes base doxyde de titane (TiO2), possdent de bonnes caractristiques mcaniques. Le dgagement dhydrogne d la combustion de lenrobage limite leur emploi lassemblage des aciers doux. Il sagit dlectrodes demploi gnral ; trs maniables en toutes positions, elles fonctionnent en courant continu ou alternatif. 3.3.3. Enrobage volatil ou cellulosique Il donne peu de laitier, mais un souffle forte teneur en CO2 rsultant de la combustion de la cellulose dans larc. Llectrode enrobage volatil ou cellulosique est utilise principalement pour lexcution des premires passes de pntration en position descendante pour le soudage des gazoducs et oloducs. 3.3.4. Enrobage oxydant Les lectrodes enrobage oxydant fournissent un laitier lourd, compact, autodtachable. Les soudures ont un bel aspect, mais les caractristiques sont mdiocres. 3.3.5. Enrobage acide Le laitier fourni par les lectrodes enrobage acide est abondant et fluide, utilisable en courant continu ou alternatif. Laspect du cordon est trs satisfaisant. Ces lectrodes sont utilises en menuiserie mtallique, en soudage plat. Les caractristiques mcaniques obtenues sont trs moyennes.
7/19
CDET_T_ARC_V1
3.3.6. Enrobages divers Des variantes sont apportes aux enrobages par des mlanges appropris en fonction des utilisations prvues, des caractristiques mcaniques recherches, des positions de soudage, de la facilit dutilisation, du type de courant de soudage de la tension du gnrateur, etc. On trouve sur le march des lectrodes : enrobage rutilo-basique enrobage rutilo-cellulosique. 3.3.7. Electrodes apport par lenrobage et lectrodes poudre de fer Ces dernires, les plus employes ce jour, font partie de la famille des lectrodes dites apport par lenrobage, dsignes parfois tort sous le nom dlectrodes synthtiques. Il est en effet possible dlaborer, dans une certaine limite, en partant dune me acier doux, un mtal dpos de nuance dfinie : aciers lgrement allis, fortement allis, fonte, etc..... Les lments : chrome, nickel, molybdne, manganse, etc... sont alors introduits par lenrobage, sous forme de poudres mtalliques ou de ferro-alliages. Le cas particulier des "lectrodes poudre de fer" est particulirement intressant. Dposant un acier au carbone, elles ont pour but essentiel dapporter plus de mtal. Ce principe dlaboration, appliqu aux lectrodes enrobage basique et rutile, permet donc de prendre toute sa signification la notion rendement dune lectrode : il varie alors de 115 - 120 % 210 %. Le rendement dune lectrode est dfini par le rapport : Poids Mtal Dpos x 100 Poids Mtal Fondu Tout type dlectrode de ce genre prsente un ensemble de caractristiques originales trs intressantes : Son enrobage, toujours pais trs pais, est par ailleurs, plus "conducteur" quun enrobage ordinaire. Les intensits admises sont donc plus leves et il sensuit un taux de dpt plus lev donc une plus grande vitesse de soudage. Son amorage est plus facile, plus "franc". La pntration est obtenue plus facilement, notamment en soudage dangle, quand le diamtre utilis est normal. Toutefois, dans ce cas,
8/19
CDET_T_ARC_V1
toutes prcautions doivent tre prises pour que laccessibilit des lectrodes en fond de chanfrein soit obtenue. Il est possible ou recommand suivant les cas, de lutiliser en soudage "automatique manuel", dans dexcellentes conditions, notamment en angle intrieur. Cette mthode est parfois dsigne par "soudage par contact", tort car, en fait, lenrobage est seul en "contact" avec la pice. Larc est donc relativement long et la tension en charge plus leve : elle peut atteindre 35 50 volts. Par consquent, les postes tant gradus en intensits conventionnelles, lindication dintensit du poste nest plus valable. Elle est plus faible que lintensit rellement utilise. Il est donc recommand : de contrler lintensit, ventuellement, dans chaque cas particulier, de prvoir lutilisation de postes largement dimensionns. Les cordons obtenus avec des lectrodes basiques haut rendement sont trs rguliers, plats concaves, donc de trs bel aspect.
3.4. ROLE DE LENROBAGE
3.4.1. Rle lectrique Grce laction ionisante des silicates, le passage du courant alternatif est considrablement facilit entre lextrmit de llectrode et la pice souder : la colonne dair est "craque" lors de lamorage sous la diffrence du potentiel (tension vide du poste Uo). Un fil nu ne samorce pas en courant alternatif. Cet amorage constitue le premier stade de lopration de soudage. En effet, chaque type dlectrode possde "un potentiel dionisation" qui lui est propre (tension damorage : Ua) : il faut que Uo Ua pour que la continuit de fusion soit assure afin dobtenir la stabilisation de larc. Lenrobage permet donc : lutilisation de tensions vides faibles en courant alternatif (40 80 V.) : abaissement du prix du poste, de la consommation primaire et augmentation de la scurit humaine. la continuit donc la stabilit de larc. Le processus est le mme en courant continu mais les "tensions vide" peuvent tre seulement de 40 50 volts.
9/19
CDET_T_ARC_V1
"Tension d'amorage et "tension vide" normales ne sont pas suffisantes. Il faut une certaine intensit de soudage (Is) permettant d'apporter suffisamment de chaleur pour "fondre l'lectrode" ; le soin apport son rglage sur le poste est donc primordial.
3.4.2. Rle mtallurgique Lenrobage en fondant cre un "cratre" et une atmosphre gazeuse protgeant la fusion de lme contre lOxygne et lAzote de lair. Il dpose un laitier plus lger que le mtal fondu sur lequel il surnage et quil protge, non seulement contre loxydation et la nitruration, mais galement contre un refroidissement trop rapide, le laitier constituant un isolant thermique. Cette action a notamment un double effet : permettre aux gaz emprisonns au sein du mtal dpos de se librer sans crer de soufflures. viter au mtal dpos un risque de durcissement par trempe, conscutif une forte vitesse de refroidissement. Le "laitier" provenant de la fusion de lenrobage joue donc un rle de protection important : il ne doit donc tre limin quaprs refroidissement complet. protection contre l'oxygne protection contre lazote apport de compensation en lments Mn - Cr, etc protection par formation dun LAITIER protection par atmosphre gazeuse
Les produits actifs de lenrobage (ferro-manganse, ferro-sillicium, etc....) compensent les pertes invitables subies par lme au cours de la fusion, non seulement par "oxydation" mais galement par "volatilisation". Dans certains cas, ils permettent dintroduire volontairement des lments spciaux (chrome, nickel, manganse, molybdne, etc...) dans le mtal dpos en lui confrant ainsi de hautes proprits, soit mcanique, soit de rsistance la corrosion, etc... Cest ainsi quil est possible de dposer un acier 13 % de manganse ou un acier 20 % de chrome, 10 % de nickel et 3 % de molybdne en partant dune me en acier Martin doux. Lopration est identique celle dun four dacirie mais lacier spcial obtenu est "plus fin". 3.4.3. Rle mcanique et opratoire Toute lectrode de qualit prsente en cours de fusion, son extrmit, une "dpression" : cest le "cratre". La profondeur de ce cratre a une influence directe sur la facilit demploi de llectrode en position ainsi que la grosseur des gouttes et la viscosit du laitier. Llectrode tant bien tudie, le cratre est dautant plus profond et les gouttes plus fines que lenrobage est plus pais. Lintensit ncessaire crot avec le diamtre
10/19
CDET_T_ARC_V1
denrobage, la forme des chenilles ( plat) et des cordons (en angle) tend alors tre plate ou mme concave.
Profondeur guide les gouttes
Role mcanique Souplesse de fonctionnement Automatisme manuel possible Le cratre constitue un isolant lectrique Soutien du mtal en fusion par le laitier (en positions) : Le laitier par sa viscosit constitue un "Balcon".
11/19
CDET_T_ARC_V1
Enrobage Diamtre d'enrobage et profondeur de cratre
Pelliculaire ou mince
Semi-pais
Epais
Trs Epais
Pas de cratre
Cratre moyen
Cratre profond
Cratre trs profond
Forme des chenilles et cordons Is moyen
gnralement bomb
bomb
bomb plat ou
trs plat
Is = 130 A
Is = 150 A
Is = 170 A
Is = 200 A
3.5. CONSERVATION ET ETUVAGE DES ELECTRODES
Les lectrodes enrobes ncessitent certains gards tant pour leur manipulation que pour le stockage sous peine de mettre en cause la qualit du joint. Il est recommand de prendre les prcautions ncessaires car lenrobage des lectrodes risque dtre endommag. soit par dtrioration mcanique soit par absorption dhumidit
3.5.1. Dtrioration mcanique Les enrobages sont dune robustesse telle, quils peuvent supporter des manipulations normales. Seuls des chocs particulirement violents peuvent les endommager. Dans ces cas, les dgts sont suffisamment vidents (enrobage fissur ou caill) pour prendre le risque dutiliser de telles lectrodes.
3.5.2. Absorption dhumidit Les enrobages prsentent, leur sortie dusine, une certaine teneur en eau. Cette dernire soigneusement dose et contrle, est partie intgrante des caractristiques de fabrication et variable selon le type denrobage. Les lectrodes rutile ou cellulosique sont trs peu sensibles au problme dhumidit. Par contre, les lectrodes basiques : dune part doivent tre utilises trs sches
12/19
CDET_T_ARC_V1
dautre part sont trs hygroscopiques, cest--dire quelles absorbent trs facilement de lhumidit. Il faut donc veiller tout particulirement aux conditions de stockage et demploi. Les lectrodes avec enrobage sensible aux reprises dhumidit doivent tre entreposes dans des locaux o la temprature est suprieure ou gale 10 et avec une humidit relative infrieure 50 %. Toutefois, certains assemblages doivent prsenter de hautes caractristiques, il est impratif dutiliser des lectrodes trs sches : soit tre utilises dans les heures suivant louverture des tuis soit tre tuves. Pour les lectrodes basiques, un tuvage normal se fait 300/350 pendant 1 H 30 ou 200 pendant 8 heures minimum. ATTENTION : Un tuvage 300/350 ne doit pas tre prolong au-del de 1 H 30 ou tre renouvel car il y a risque de dtrioration de lenrobage.
Aprs tuvage, les lectrodes peuvent tre stockes prs du soudeur dans des "carquois" chauffants une temprature de 80/100 pour viter toute reprise dhumidit. Pour les conditions exactes dtuvage, il est souhaitable de consulter le fournisseur dlectrodes.
3.6. CLASSIFICATION NORMALISEE DES ELECTRODES
Les lectrodes sont dfinies par des normes en fonction du mtal dpos. EN 499 - Indice de classement NF A 81 - 309 Electrodes mtalliques enrobes pour le soudage manuel lectrique l'arc des aciers non allis ou faiblement allis. Produits d'apport NF A 81 - 340 Electrodes mtalliques enrobes pour le soudage manuel lectrique l'arc dpassant un mtal haute limite d'lasticit. Symbolisation - produits d'apport. NF A 81 - 343 Electrodes mtalliques enrobes pour le soudage manuel lectrique l'arc dposant un mtal inoxydable et rfractaire. Symbolisation - produits d'apport.
13/19
CDET_T_ARC_V1
NF A 81 - 345 Electrodes mtalliques enrobes pour le soudage manuel lectrique l'arc dposant un mtal rsistant chaud. Symbolisation - produits d'apport. NF A 81 - 347 Electrodes mtalliques enrobes pour le soudage manuel lectrique l'arc dposant un mtal pour utilisation basse temprature symbolisation - produits d'apport. Nous allons seulement tudier la norme EN 499 et expliciter les indications portes sur les paquets d'lectrodes. La classification repose sur les proprits du mtal fondu obtenu par une lectrode enrobe comme indiqu ci-dessous : La classification est base sur une lectrode de 4 mm l'exception du symbole de la position de soudage qui est base sur des lectrodes dont le diamtre est dfini par la norme EN 1597 - 3. La classification est divise en huit parties 1re partie : Symbole du produit et/ou procd identifier 2me partie : Symbole de la rsistance et de l'allongement du mtal fondu 3me partie : Symbole de la rsistance la flexion par choc du mtal fondu 4me partie : Symbole de la composition chimique du mtal fondu 5me partie : Symbole du type d'enrobage de l'lectrode 6me partie : Symbole du rendement et du type de courant 7me partie : Symbole de la position de soudage 8me partie : Symbole de la teneur en hydrogne du mtal fondu
1re partie : Lettre E place en tte de la dsignation complte.
14/19
CDET_T_ARC_V1
2me partie : Symbole de la limite lastique, de la rsistance la traction et de l'allongement. E N/mm2 355 380 420 460 500 R N/mm2 440 - 570 470 - 600 500 - 640 530 - 680 560 - 720 A % 22 20 20 20 18
Symbole 35 38 42 46 50
3me Partie : Symbole de la rsistance la flexion par choc Temprature moyenne correspondant une Energie de rupture en flexion par choc moyenne maximale de 47 j Aucune exigence + 20 0 - 20 - 30 - 40 - 50 -60
Symbole
Z A 0 2 3 4 5 6
15/19
CDET_T_ARC_V1
4me Partie : Symbole de la composition chimique du mtal fondu
Symbole Mn Aucun symbole Mo Mn Mo 1 Ni 2 Ni 3 Ni Mn 1 Ni 1 Ni Mo Z 2.0 1.4 1.4 - 2.0 1.4 1.4 1.4 1.4 - 2.0 1,4 0,3 - 0,6 Toute autre composition convenue Composition Chimique Mo / 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 / / / Ni / / / 0,6 - 1,2 1,8 - 2,6 2,6 - 3,8 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2
5me Partie : Symbole du type d'enrobage Symbole A C R RR RC RA RB B Dsignation Enrobage acide Enrobage cellulosique Enrobage au rutile Enrobage pais ou rutile Enrobage cellulosique ou rutile Acide au rutile Basique ou rutile Basique
16/19
CDET_T_ARC_V1
6me partie : Symbole du rendement et du type de courant Symbole 1 2 3 4 5 6 7 8 Rendement % 105 105 105 - 125 105 - 125 125 - 160 125 - 160 > 160 > 160 Type de courant c.a. + c.c. c.c c.a. + c.c. c.c c.a. + c.c. c.c c.a. + c.c. c.c
7me partie : Symbole de la position de soudage. Le symbole donn ci-aprs indique la position de soudage dans laquelle l'lectrode a t essaye suivant l'EN 1599 - 3. Symboles 1 2 3 4 5 Dsignation Toutes positions Toutes positions descendante sauf verticale
Bout bout plat, gouttire, angle plat Bout bout plat, gouttire Verticale descendante + correspondant au symbole 3 positions
17/19
CDET_T_ARC_V1
8me partie : Symbole de la teneur en hydrogne du mtal fondu Teneur en hydrogne ml/100 gr du mtal fondu maxi 5 10 15
Symbole H5 H 10 H 15
18/19
CDET_T_ARC_V1
4. LES TECHNIQUES SPECIALES
4.1. LE SOUDAGE PAR GRAVITE
On a cherch automatiser le soudage manuel essentiellement en soudage dangle de faon gagner du temps en jouant sur deux facteurs. Tout dabord, le rendement propre des lectrodes avec des lectrodes poudre de fer de longueur 600 au lieu de 450. Ensuite, le facteur de marche en utilisant des supports de 4 ou 5 lectrodes, chacune des lectrodes amorant la suivante. Cette technique est utilise dans les industries ayant des cordons dangle de grandes longueurs telles que la construction navale et le wagonnage. Un oprateur conduit sans difficults deux supports ("sauterelles") en mme temps ce qui correspond un facteur de marche de lordre de 100 %.
4.2. LE SOUDAGE EN DESCENDANT
Cest une technique manuelle utilise : pour des cordons dangle de faible gorge avec des lectrodes rutiles spciales. Lintensit est suprieure de 10 % 20 % celle utilise plat. Il faut signaler toutefois que dans ce cas, la pntration est faible. pour les soudures bout bout avec des lectrodes cellulosiques. Lapplication presque unique de ce procd est le soudage sur chantier des tubes de pipe-line. Il permet dobtenir des soudures de premire passe parfaitement pntres en un temps trois quatre fois moins long quen verticale montante.
19/19
Vous aimerez peut-être aussi
- Expo FissurationDocument46 pagesExpo Fissurationkhadim tall100% (1)
- Fiche de Poste Technicien SAVDocument3 pagesFiche de Poste Technicien SAVSalim BouhlelPas encore d'évaluation
- Fiche de Stock Journaliere Des BoissonsDocument2 pagesFiche de Stock Journaliere Des BoissonsSteeve Bikoi100% (1)
- Guide Eau de Pluie 2019 PDFDocument22 pagesGuide Eau de Pluie 2019 PDFHassan ARROPas encore d'évaluation
- Catalogue ATZ - 2023Document10 pagesCatalogue ATZ - 2023Manong ShegueyPas encore d'évaluation
- 06 Molecules Rep CorDocument5 pages06 Molecules Rep CorhhedfiPas encore d'évaluation
- SSLIADocument2 pagesSSLIAkotozone3452Pas encore d'évaluation
- Projet D'hydraulique Dimensionnement Du Chateau de Lendi Alex 16Document46 pagesProjet D'hydraulique Dimensionnement Du Chateau de Lendi Alex 16DUCLAIR DJIOFACKPas encore d'évaluation
- Documentation Lavabos Aseptiques Tous ModèlesDocument5 pagesDocumentation Lavabos Aseptiques Tous ModèlesWassim DjennanePas encore d'évaluation
- Flambement 1Document14 pagesFlambement 1Leo Fabiola NGHAPPas encore d'évaluation
- Logan ST BulletinDocument4 pagesLogan ST BulletinZero TwoPas encore d'évaluation
- couRS 2 PDFDocument13 pagescouRS 2 PDFdamn tweetsPas encore d'évaluation
- Rapport de ClasseDocument10 pagesRapport de ClasseAhmed AminePas encore d'évaluation
- Ressources CPS Enfants - Jeunes - AdultesDocument11 pagesRessources CPS Enfants - Jeunes - AdultesPère DelaunayPas encore d'évaluation
- Solvabilité 2 - Courtage 2 : Les Conséquences de Solvabilité 2 Pour Les Courtiers, Les Délégataires de Gestion Et Les GrossistesDocument10 pagesSolvabilité 2 - Courtage 2 : Les Conséquences de Solvabilité 2 Pour Les Courtiers, Les Délégataires de Gestion Et Les GrossistesWael TrabelsiPas encore d'évaluation
- Cour CNSSDocument56 pagesCour CNSSTouaiti RabiiPas encore d'évaluation
- MAN-074 Microsed MANUELDocument26 pagesMAN-074 Microsed MANUELCharlys RajaobelinaPas encore d'évaluation
- ElectricitéDocument12 pagesElectricitéamical1955Pas encore d'évaluation
- Sti2d Juin 2021 AcDocument36 pagesSti2d Juin 2021 AcPascal NOURYPas encore d'évaluation
- La Pensée en Terme de RésultatDocument22 pagesLa Pensée en Terme de RésultatMEDO BESTPas encore d'évaluation
- A9 10 11 Globul Roug Blanc PlakDocument8 pagesA9 10 11 Globul Roug Blanc PlakFernando KollaPas encore d'évaluation
- d0000B5 Solerm Thermique BasicDocument4 pagesd0000B5 Solerm Thermique BasicCornel IliescuPas encore d'évaluation
- Emplois Technique1111sDocument62 pagesEmplois Technique1111sMourad KellouPas encore d'évaluation
- 40 Hadiths QoudsiDocument9 pages40 Hadiths QoudsiSokhna Maryam Bousso SowPas encore d'évaluation
- 7 Erreurs (Growth Ton Afro)Document9 pages7 Erreurs (Growth Ton Afro)sp7hfdgf57Pas encore d'évaluation
- OVNI - 1999 Ou Dieu Prit Sur Le Fait - Frédéric Weskamp-Lorenz - 1997Document206 pagesOVNI - 1999 Ou Dieu Prit Sur Le Fait - Frédéric Weskamp-Lorenz - 1997choupettejoliePas encore d'évaluation
- Capture D'écran, Le 2023-03-22 À 8.15.27 A.M.Document46 pagesCapture D'écran, Le 2023-03-22 À 8.15.27 A.M.Lydia BenchekhchoukhPas encore d'évaluation
- ExempleDocument3 pagesExempleNeila AslyPas encore d'évaluation
- Fikarakarana VoloDocument28 pagesFikarakarana VoloRABEHAJAINA GeorginoPas encore d'évaluation
- Cours Geologie - Planche 1Document31 pagesCours Geologie - Planche 1Papa Ndiaye100% (1)