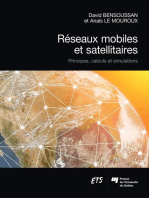Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bible NGN
Bible NGN
Transféré par
Tel ScuTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bible NGN
Bible NGN
Transféré par
Tel ScuDroits d'auteur :
Formats disponibles
REPUBLIQUE FRANAISE _______________________________________________________________________________________
Etude technique, conomique et rglementaire de lvolution vers les rseaux de nouvelle gnration (NGN, Next Generation Networks)
Etude ralise par le cabinet Arcome pour le compte de l'Autorit de rgulation des tlcommunications
- Septembre 2002 -
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Table des Matires
1 Introduction Objectifs de ltude ......................................................................................................... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Le contexte et les enjeux des rseaux et services de nouvelle gnration ..................................... 6 Objectifs de la prsente tude ......................................................................................................... 8 Mthodologie adopte par Arcome .................................................................................................. 9 Organisation du document ............................................................................................................... 9 Approche gnrale et concepts communs..................................................................................... 11 Une vision plus ou moins homogne chez les constructeurs ........................................................ 11 Une vision plus contraste chez les oprateurs et fournisseurs de services................................. 13 Conclusion...................................................................................................................................... 15 Introduction : larchitecture cible..................................................................................................... 16 Impact des volutions de la couche Accs .................................................................................... 18 Vers un rseau de Transport IP, multiservices et haut dbit ......................................................... 32 Vers un Contrle dappel en mode IP sur des serveurs ddis et une gestion indpendante des fonctions de transport..................................................................................................................... 53 Les Services : des plates-formes unifies et des interfaces ouvertes ........................................... 84 La mutation des terminaux........................................................................................................... 103 Problmatiques transverses associes aux NGN........................................................................ 119 Conclusion technique : des lments technologiques structurants ............................................. 131 Introduction : un foisonnement dorganisations impliques ......................................................... 138
NGN : concepts communs et dclinaison ........................................................................................... 11
NGN : une nouvelle vision des rseaux et services ........................................................................... 16
3.10 Les organismes de normalisation traditionnels : un rle fdrateur ?...................................... 142 3.11 LIETF : une organisation incontournable..................................................................................... 145 3.12 Le W3C World Wide Web Consortium : lorganisme ddi aux technologies Web .................... 149 3.13 Les forums et groupements dintrts au cur des NGN ........................................................... 150 3.14 De multiples organisations spcialises ou connexes ................................................................. 153 3.15 Quelques programmes de recherche et exprimentations NGN ................................................. 154 3.16 Conclusion : les problmatiques de la normalisation des NGN ................................................... 157 4 Acteurs et conomie des NGN : tendances et impacts .................................................................... 159 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Introduction : mthodologie, primtre et prambule................................................................... 159 Enjeux de lvolution du march vers les NGN............................................................................ 161 Economie des NGN : opportunits et nouveaux modles ........................................................... 172 Constructeurs : acteurs et positionnement................................................................................... 179 Offres NGN : maturit et cots..................................................................................................... 195 Oprateurs et fournisseurs de services : acteurs et positionnement ........................................... 200 Migration vers les NGN : des visions contrastes........................................................................ 207 Conclusion : vers une mutation des relations entre acteurs ........................................................ 219 Introduction : tendances ressortant des entretiens et axes de rflexion ...................................... 227 Les acteurs................................................................................................................................... 229 Les perspectives techniques ........................................................................................................ 235 Les perspectives conomiques.................................................................................................... 240 Evolution des services dintrt gnral....................................................................................... 246 Conclusion : champs dactions prioritaires pour la rgulation ...................................................... 251
NGN : quelles perspectives pour la rgulation ? .............................................................................. 227
Autorit de rgulation des tlcommunications
Conclusions : une volution mergente vers les NGN, aux multiples facettes, et anticiper .... 254 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Distribution de lintelligence en priphrie du rseau................................................................... 254 Activits de normalisation et standardisation au cur des dbats.............................................. 255 Evolution du march .................................................................................................................... 256 Maturit des offres et cots associs .......................................................................................... 257 Les diffrentes approches de migration....................................................................................... 257 Vers une mutation des relations entre acteurs ............................................................................ 259 Chantiers dvolution pour la rgulation....................................................................................... 260
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Liste des Figures
Figure 1 : Principe gnral darchitecture dun rseau NGN (Source : Arcome) ............................................. 15 Figure 2 : Architecture physique dun cur de rseau NGN (Source : Arcome) ............................................. 16 Figure 3 : Architecture physique dun cur de rseau NGN (Source : Arcome) ............................................. 32 Figure 4 : la structure en couches actuelle utilise dans les rseaux WAN, RAN et MAN (Source : Arcome) 34 Figure 5 : Exemples de commutation dans un rseau de donnes (Source : Arcome) .................................. 37 Figure 6 : Exemple dun rseau de commutation IP/MPLS (Source : Arcome) ............................................... 41 Figure 7 : La structure en couches dun rseau NGN WAN ou RAN fond sur une solution GMPLS / WDM (Source : Arcome) .......................................................................................................................... 43 Figure 8 : Exemple de reconfiguration dun rseau de transmission WDM sous le contrle dun rseau de commutation MPLS (Source : Arcome) ......................................................................................... 44 Figure 9: Architecture simplifie des NGN (source Arcome) ........................................................................... 54 Figure 10 : Architecture H.323 (Source Arcome) ............................................................................................. 57 Figure 11 : Etablissement dappel en mode FastStart (source Intel) ......................................................... 59 Figure 12: Initiation dun appel avec le protocole SIP (source Arcome) .......................................................... 61 Figure 13 : Enregistrement dun terminal SIP (source :Radvision) .................................................................. 63 Figure 14 : Initiation dun appel avec SIP (source : Radvision)........................................................................ 64 Figure 15: RTP/RTCP dans la suite de protocole pour services multimdia (source Arcome) ....................... 67 Figure 16 : Positionnement de MGCP et H.248/MEGACO dans les NGN (source Arcome)........................... 70 Figure 17 : Protocole de commande impliqus dans les NGN (source Arcome) ............................................ 72 Figure 18 : Couche dadaptation M2UA fournie par SigTran (source Arcome) ............................................... 73 Figure 19 : Protocole de signalisation entre Media Gateway Controller (source Arcome)......................... 75 Figure 20: Interconnexion de rseaux (source Arcome) .................................................................................. 76 Figure 21 : Architecture domaine circuit UMTS release R4 (source : 3GPP TR 23.821) ................................ 79 Figure 22 : Architecture de rfrence Release 2000 (source : 3GPP TR 23.821)........................................... 80 Figure 23 : Rle de linterface OSA (source API group) .................................................................................. 85 Figure 24 : Architecture dun rseau avec linterface OSA (source ETSI/GA38) ............................................. 86 Figure 25: Positionnement des API JAIN dans larchitecture OSA/Parlay (source Arcome) ........................... 87 Figure 26: Dtail de linterface OSA/Parlay (source API group)....................................................................... 88 Figure 27 : Architecture du modle Web services (source ETSI/GA38).................................................... 90 Figure 28: Suite de protocoles impliqus dans limplmentation des Web services (source IBM)............ 92 Figure 29 : Exemple de service fourni par les protocoles SIP et SOAP (source Ubiquity) .............................. 93 Figure 30 Usages des terminaux mobiles de nouvelle gnration. (Daprs Sminaire Journe J2ME Sun Microsystems)....................................................................................................................... 104 Figure 31 Les trois classes spcifies par MExE. (Daprs le MExE Forum)............................................. 109 Figure 32 JavaPhone au sein de la pile logicielle dun terminal tlphonique. (Source : Sun Microsystems)110 Figure 33 : Schmas de connexion Bluetooth. (Daprs Bluetooth SIG) ....................................................... 117 Figure 34:Fonctionnement du protocole ENUM (Source : Arcome) .............................................................. 120 Figure 35:Classes de service pour les communications multimdia proposes par lETSI (Source : Groupe de travail TIPHON) ............................................................................................................................ 126
Autorit de rgulation des tlcommunications
Figure 36:Modle de gestion de la qualit de service de bout en bout (Source : TIPHON- ETSI) ................ 127 Figure 37 : Principe darchitecture dun cur de rseau NGN (Source : Arcome)........................................ 132 Figure 38: Positionnement dune partie des organisations de normalisation (source : Arcome)................... 139 Figure 39 : Segmentation des acteurs NGN (Source : Arcome).................................................................... 229 Figure 40 : Nouveaux types dacteurs dans le contexte NGN. (Source : Arcome) ........................................ 234 Figure 41 : Interconnexions verticales et horizontales au sein des NGN (source : Arcome)......................... 242 Figure 42 : Interconnexions entre un NGN et un rseau traditionnel (source : Arcome)............................... 242
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
1 Introduction Objectifs de ltude
1.1 Le contexte et les enjeux des rseaux et services de nouvelle gnration
Lvolution progressive du monde des tlcommunications vers des rseaux et des services de nouvelle gnration est aujourdhui une tendance forte qui suscite lintrt dune majorit dacteurs. Elle rsulte de la conjonction dun ensemble de facteurs favorables dont : Les volutions profondes du secteur des tlcommunications : La drgulation des marchs (du transport longue distance la boucle locale). Le cadre rglementaire actuel tend encourager la comptition et a permis un certain nombre doprateurs alternatifs de se positionner par rapport loprateur historique et de le concurrencer sur les marchs des donnes, de la voix, des services Internet et plus rcemment sur la boucle locale. Des tendances plus nouvelles, comme le recours lexternalisation, que ce soit pour le matriel ou les applicatifs, et la recherche doptimisation des rseaux. Le dveloppement massif de loutsourcing sur le march des utilisateurs professionnels a gnr ou dvelopp de nouveaux mtiers dans les tlcoms : oprateurs de rseau priv virtuel ou de bande passante, infogrance, ASP (Application System Provider), centres dappels, services Centrex La recherche dconomies dchelle est une notion prsente dans plusieurs concepts tlcoms qui font aujourdhui lactualit : lvolution de la tlphonie vers lIP, la convergence voix/donnes, la flexibilit rseau, les oprateurs virtuels et le partage dinfrastructure (MVNO dans le monde mobile) ou encore les nouvelles gnrations de rseaux mobiles conomes en ressources spectrales. Lmergence de nouveaux acteurs et de nouveaux modles conomiques afin de dvelopper de manire viable et optimise les services et les contenus : dveloppement du march des purs fournisseurs de services, partenariats entre les oprateurs de transport / accs et les fournisseurs de services. Cette tendance est favorise par les nouveaux standards (ex. : interfaces OSA Open Service Architecture en UMTS, et travaux du groupe Parlay). Elle rend dautant plus cruciales les problmatiques dinteroprabilit et de facturation.
Le dveloppement de gammes de services nouveaux : lessor des services Internet et multimdia, la recherche de mobilit et daccessibilit totale. Il est raisonnable de penser que lvolution massive des services constate ces dernires annes est loin dtre termine. Le march des systmes de communications lectroniques sapprte vivre encore de nouvelles rvolutions et des volutions fortes en terme de services proposs : Laccentuation du succs mondial dInternet et lexplosion du volume de donnes gres, stockes et transfres. Le besoin toujours plus fort des utilisateurs dune accessibilit totale aux donnes et aux services (Internet mobile, UMTS, WLAN, mobilit entre rseaux daccs ou terminaux de technologies diffrentes, ) potentiellement couple des services haute valeur ajoute utilisant la golocalisation.
Autorit de rgulation des tlcommunications
Le dveloppement de contenus et services multimdia, de plus en plus interactifs et temps rel, que lon devine mais qui restent pour la plupart dfinir. Ils ncessitent techniquement dassurer diffrents modes daccs, et de dvelopper de nouveaux terminaux hybrides et multi-fonctions. Le dveloppement invitable du commerce lectronique, qui pose des problmes techniques lis aux transactions temps rel, au paiement scuris, au dveloppement de solutions de porte-monnaie virtuel. Limportance cruciale et croissante de la relation client pour acqurir et fidliser les clients, qui gnre le dveloppement massif des centres dappel et du couplage tlphonie-informatique (CTI Computer-TelephonyIntegration). Dventuels produits nouveaux, rpondant des besoins non encore identifis, qui seront le fruit de lacclration de lvolution des services aujourdhui constate. Cela implique pour les acteurs un besoin croissant de souplesse et de ractivit pour rpondre aux attentes des utilisateurs.
Enfin, on constate depuis quelques annes des progressions technologiques denvergure dans le domaine des rseaux de donnes : Lvolution des rseaux de transport, et notamment des couches optiques, vers le trs haut dbit (commutation optique, multiplexage en longueur donde WDM). La gnralisation du protocole IP et lmergence de la nouvelle version de ce protocole, IPv6, qui permettra notamment den amliorer les capacits dadressage et de gestion et de la scurit. Larrive maturit de technologies nouvelles comme le MPLS, qui permet de vhiculer de manire diffrencie des flux IP avec une meilleure gestion de la qualit de service. Ces volutions permettent denvisager de manire souple la diffusion sur IP de contenus temps rel avec des contraintes de qualit de service fortes.
Il rsulte de ce contexte le besoin - et la faisabilit technique - dune volution vers un nouveau modle de rseaux et de services appel NGN (Next Generation Networks). Afin de sadapter aux grandes tendances qui sont la recherche de souplesse dvolution de rseau, la distribution de lintelligence dans le rseau, et louverture des services tiers, les NGN sont bass sur une volution progressive vers le tout IP et sont modliss en couches indpendantes dialoguant via des interfaces ouvertes et normalises : La couche Accs , qui permet laccs de lutilisateur aux services via des supports de transmission et de collecte divers : cble, cuivre, fibre optique, boucle locale radio, xDSL, rseaux mobiles. La couche Transport , qui gre lacheminement du trafic vers sa destination. En bordure du rseau de transport, des media gateways et des signalling gateways grent respectivement la conversion des flux de donnes et de signalisation aux interfaces avec les autres ensembles rseau ou les rseaux tiers interconnects. La couche Contrle , qui se compose de serveurs dits softswitch grant dune part les mcanismes de contrle dappel (pilotage de la couche transport, gestion des adresses), et dautre part laccs aux services (profils dabonns, accs aux plates-formes de services valeur ajoute). La couche Services , qui regroupe les plates-formes dexcution de services et de diffusion de contenus. Elle communique avec la couche contrle du cur de rseau via des interfaces ouvertes et normalises, indpendantes de la nature du rseau daccs utilis. Les services et contenus eux-mmes sont par ailleurs dvelopps avec des langages convergents et unifis.
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Cette volution poussera les acteurs construire de nouveaux modles techniques et conomiques : Les rseaux de tlcommunications traditionnels volueront vers un modle ouvert, distribu, fortement bas sur le protocole IP et la transmission en mode paquet en gnral. Cette volution technologique se fera de manire progressive pour les oprateurs et transparente pour les utilisateurs. Simultanment, un bouleversement et une rorganisation des acteurs sopreront dans le domaine des rseaux et services tlcoms. Lapparition de fournisseurs de rseaux et de fournisseurs de services, entre autres, aura pour consquence la rorganisation des flux conomiques entre les acteurs.
Alors que les dbats sur lvolution vers le tout IP ou les conditions de mise en uvre de modles conomiques viables pour les oprateurs et fournisseurs de services dans le cadre de lUMTS, de lxDSL ou de la boucle locale radio alimentent la presse spcialise, les constructeurs, de leur ct, font dmonstration de leurs nouveaux produits et se disent mrs sur le plan technologique pour accompagner le passage de leurs clients aux rseaux de nouvelle gnration.
1.2 Objectifs de la prsente tude
Les objectifs de ltude tels quils avaient t dfinis par lART taient les suivants : Synthtiser les diffrentes dfinitions des rseaux de nouvelle gnration dans le but den obtenir une dfinition globale. Identifier les technologies nouvelles directement associes la notion de NGN, en dveloppant plus particulirement les volutions associes aux couches hautes (couche 3 et suprieures) des rseaux et services : Rseaux de transport unifis (transport en mode paquet IP ou ATM, MPLS, multiplexage en longueur donde, ). Sparation des fonctions des commutateurs traditionnels en softswitch pour le contrle dappel et en media gateways pour lacheminement du trafic. Protocoles associs pour le dialogue entre ces softswitch et media gateways (MEGACO, MGCP). Protocoles de contrle et dappel entre softswitch (BICC, SIP, H.323). Interfaces normalises de dialogue entre le rseau et les services (OSA/Parlay, Web services). Evolutions des plates-formes applicatives et convergence des langages de dveloppements de services (XML, Java, ). etc
Evaluer le degr de maturit des technologies NGN et identifier les points de rupture par rapport aux rseaux traditionnels. Evaluer les diffrences de cots actuelles et prvisionnelles des NGN par rapport aux rseaux traditionnels, tant en termes dinvestissement que de fonctionnement. Identifier les moteurs et les freins la migration vers les NGN (sur les plans technologique, conomique et rglementaire). Identifier des nouveaux modles conomiques qui seront associs et valuer leur adquation et leur prennit. Raliser, sur les plans national et europen, un tat des lieux des acteurs en place et identifier les potentiels de nouveaux acteurs : constructeurs, oprateurs, fournisseurs de contenu. Dcrire la stratgie dun panel reprsentatif dacteurs par rapport aux NGN.
Autorit de rgulation des tlcommunications
Confronter le concept de NGN avec le cadre rglementaire actuel et le nouveau cadre rglementaire europen, et identifier les points susceptibles de ncessiter des adaptations.
1.3 Mthodologie adopte par Arcome
Afin de rpondre pleinement aux attentes de lART, Arcome a propos quatre axes danalyse : Une tude technologique a permis de dcrire et comprendre lensemble des concepts nouveaux globalement dsigns sous lappellation NGN. Elle inclut une synthse des volutions technologiques majeures et le dtail des nouveaux concepts lis aux NGN. Un tat de lart de la normalisation et des projets de recherche et dexprimentation des constructeurs et oprateurs accompagne cette partie. Une tude qualitative du march des constructeurs dquipements de nouvelle gnration, complte par des entretiens dtaills avec un panel reprsentatif de 11 constructeurs, a permis de comprendre la position des diffrents acteurs (acteurs tablis issus de la tlphonie, de lInternet et acteurs de niche technologique) et de mesurer la disponibilit des quipements et logiciels. Un des principaux objectifs a t dvaluer le degr de maturit des offres. Une tude conomique des NGN a permis de saisir la position des acteurs (oprateurs, ISP, fournisseurs de services et de contenus) et leur stratgie vis vis des NGN, de comprendre les grands principes des business models associs, les types de partenariats envisags, les lments moteurs et perturbateurs pour la migration, ce aussi bien dans une phase de migration qu plus long terme. Arcome a ralis une recherche documentaire complte par des entretiens dtaills avec un panel reprsentatif de 9 oprateurs et fournisseurs de services. Une tude prospective des impacts probables des NGN sur le cadre rglementaire et de linfluence de la rglementation sur le dveloppement des NGN a t mene. Elle recense les principales thmatiques rglementaires qui seront potentiellement impactes par les NGN et des interrogations qui se poseront trs probablement.
Afin dalimenter la rflexion, Arcome a collect des informations au cours dchanges avec des acteurs choisis pour leur implication forte dans les solutions de nouvelle gnration ou pour leur influence forte sur le monde des tlcommunications1. Les principales communications sur les sujets connexes aux NGN (presse spcialise, tudes, rapports, ) ont t analyses paralllement ces entretiens. Lensemble de ltude a t mene en collaboration troite avec lAutorit de Rgulation des Tlcommunications.
1.4 Organisation du document
Le rapport dtude est organis de la manire suivante : Le chapitre 2 prsente une synthse des dfinitions donnes pour les NGN par les diffrents acteurs interviews, avec mise en exergue des thmes cl associs ce concept. Il sen dgage une vision commune, avec des variantes dinterprtation selon le domaine dactivit des acteurs. Le chapitre 3 prsente ltude technologique dtaille des NGN. Il part de larchitecture gnrale cible (dcomposition en couches), puis analyse en dtail les volutions majeures associes chaque couche de rseau. Les technologies
1 La liste des acteurs rencontrs est prcise dans la suite du document, et fournie en annexe.
10
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
ventuellement concurrentes sont prsentes, avec une valuation de la manire dont ce paysage technologique voluera vraisemblablement. Dans certains cas une certaine convergence moyen terme se dgage, dans dautres au contraire il pourra persister plusieurs modles qui cohabiteront. Les domaines identifis sont : La couche accs. La couche transport. La couche contrle. La couche services. Les terminaux. Les problmatiques transverses.
Le chapitre 4 prsente un panorama des organismes de normalisation et de standardisation particulirement pertinents dans le cadre des NGN, et leur rle associ. Il recense aussi un certain nombre de programmes de recherche et dexprimentation europens. Le chapitre 5 analyse les tendances et les impacts des NGN sur les acteurs du march et lconomie du secteur des communications. Il restitue notamment de manire globale les lments qui ressortent des changes avec les constructeurs, les oprateurs et les fournisseurs de services tudis et interrogs. Ce chapitre sattache notamment mettre en exergue les points de convergence et les diffrences de perception entre constructeurs dune part, et fournisseurs de services et oprateurs dautre part. En effet, les premiers sont impliqus trs en amont dans llaboration des nouvelles solutions techniques et des nouveaux produits. Ils sont donc plus sensibiliss la faisabilit dun projet et laccompagnement du client. En revanche, les seconds ont des problmatiques diffrentes puisque ce sont eux qui auront mettre en uvre ces solutions ; ils seront confronts aussi bien au besoin qu la faisabilit technique et surtout conomique de lvolution vers les NGN, et aux consquences oprationnelles de cette migration. Les thmes traits sont : Lvolution du partenariats. march des constructeurs : acteurs, positionnement,
Une valuation densemble des offres orientes NGN, notamment en termes de maturit et de cot. Lvolution du march des oprateurs et fournisseurs de services : acteurs et positionnement, partenariats. Les enjeux de lvolution vers les NGN : dclencheurs, dfis, freins et moteurs technologiques et conomiques. Les opportunits et nouveaux modles conomiques apports par les NGN : nouveaux acteurs, nouveaux services, volution des relations entre acteurs. La vision des acteurs sur la problmatique de migration vers les NGN.
Le chapitre 6 recense lensemble des problmatiques rglementaires souleves par lmergence des NGN, au niveau franais et europen. Il identifie les thmes devant tre analyss, voire adapts, en priorit. Ce chapitre rsulte des avis exprims par les constructeurs, oprateurs et fournisseurs de services interrogs, et dune rflexion complmentaire dArcome. Le chapitre 7 prsente les grandes conclusions de ltude et la vision dArcome sur lvolution des rseaux et services vers les NGN : la maturit des offres, les diffrentes approches des acteurs, le degr de convergence vers ce nouveau modle, etc...
Les annexes du rapport restituent dans le dtail, avec une approche qualitative et quantitative mais de manire non nominative, les lments apports par les diffrents acteurs interrogs dans le cadre de cette tude.
Autorit de rgulation des tlcommunications
11
2 NGN : concepts communs et dclinaison
2.1 Approche gnrale et concepts communs
LETSI a prsent les rseaux de nouvelle gnration comme un concept permettant de dfinir et dployer des rseaux volutifs et favorisant pour les fournisseurs de services et les oprateurs la cration et la gestion de services innovants. Ils reposent sur une architecture en couches indpendantes (transport, contrle, services) communiquant via des interfaces ouvertes et normalises. Les services doivent tre volutifs et accessibles indpendamment du rseau daccs utilis.(Daprs : Rapport de lETSI-NGN Starter Groupe, compte-rendu de lassemble GA38 des 20-21/11/01). Cette dfinition reflte globalement celles qui nous ont t donnes durant les diffrents entretiens que nous avons effectus. Nous avons cependant constat des variantes suivant lactivit et le positionnement des acteurs (constructeurs, oprateurs). Notamment, au-del de la sparation entre domaine dorigine tlcoms ou donnes , on peut tout naturellement distinguer des thmes et des centres dintrt privilgis selon que lacteur est positionn principalement sur les couches basses (transport), moyennes (contrle) ou suprieures (services, et particulirement le domaine logiciel). Ces diffrentes visions ne sopposent pas mais se compltent.
Au regard des rponses apportes, l'ensemble des acteurs s'accorde globalement pour dfinir les NGN comme un rseau de transport en mode paquet permettant la convergence des rseaux Voix/donnes et Fixe/Mobile ; ces rseaux permettront de fournir des services multimdia accessibles depuis diffrents rseaux daccs. Le protocole IP sera l'lment fdrateur, le concept rseau tout-IP ayant t frquemment abord bien que nuanc parfois par les acteurs du monde des tlcoms considrant que cette solution n'est pas actuellement assez mature pour offrir un niveau de qualit de service satisfaisant, et que le recours ATM est indispensable court terme.
2.2 Une vision plus ou moins homogne chez les constructeurs
De par leur positionnement, les constructeurs ont une analyse technique pousse des NGN, mme sils ont en gnral pris soin de laccompagner dune analyse conomique et oprationnelle afin de mieux accompagner leurs clients. Il est communment admis quil sera ncessaire dassocier IP des protocoles garantissant la qualit de service. Pour les constructeurs issus des rseaux de donnes, la mise en uvre directe dun transport IP, avec lutilisation des classes de services (mcanisme DiffServ) associ au protocole MPLS, nativement conus pour fonctionner avec IP, est une solution envisageable ds prsent ; lvolution de la solution IP/MPLS sera apporte, plus long terme, par le protocole G-MPLS qui simplifie la gestion du rseau de transport.
12
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Pour les constructeurs tlcoms gnralistes, mme si certains orientent fortement leur discours commercial vers le tout-IP , la solution passe gnralement par ATM court terme, avant dventuellement se tourner vers des solutions tout-IP . De plus, ATM est encore trs prsent au niveau de la boucle locale (xDSL, BLR, UMTS pour les premires versions) ; cependant les constructeurs issus du monde des rseaux de donnes pensent que les solutions bases sur Ethernet permettront dadresser les besoins de bande passante pour la boucle locale et les rseaux rgionaux ou MAN (Metropolitan Area Network) . Les nouveaux acteurs positionns exclusivement sur des quipements NGN ont une conception moins tranche. Ils supportent en gnral les deux solutions. Ils insistent particulirement sur le fait que lessentiel pour une solution de rseau NGN est de migrer la signalisation sur IP natif, le transport du trafic IP lui-mme pouvant tre ralis indiffremment sur une couche IP, ATM, ou mme sur un rseau TDM traditionnel.
Lvolution du cur de rseau vers une architecture en couches spares (transport, contrle, services) est un principe partag par tous.
La seule distinction notable est, chez un nombre marginal dacteurs, la diffrenciation entre une couche Services supports par loprateur et une couche Services, ouverte aux tiers. Mais cette distinction relve plus dune vision organisationnelle que dune divergence technique de fond. Cette nouvelle architecture en couches se traduit galement avec le remplacement des commutateurs traditionnels par de nouveaux quipements, les Softswitches ou Serveurs d'appel (couche contrle), les Media Gateway et Signalling Gateway (couche Transport), et lutilisation de nouveaux protocoles de signalisation associs. Les constructeurs prsentent des variantes dimplmentation physique de cette architecture, en termes de dcomposition / spcialisation, ou de localisation physique de certaines fonctions logiques. Peu de constructeurs disposent en propre dune offre globale
Limportance relative entre lvolution tout IP et la sparation du rseau en couches diffre selon les acteurs. Mais une majorit saccordent dire que le concept majeur des NGN est bien lvolution tout IP , la sparation en couches ntant quune tape, ou une ncessit pour optimiser les rseaux.
Les constructeurs s'accordent aussi dire que ces rseaux NGN permettront de dvelopper plus rapidement et de fournir plus aisment de nouveaux services multimdia haut dbit et simples dusage incluant la donne, la voix et la vido indpendamment du rseau d'accs.
En ce sens, les NGN permettront une volution des services disponibles sur le rseau Internet d'aujourd'hui. Ces nouveaux services devront tre accessibles partir des diffrents rseaux daccs.
Cependant, deux modles complmentaires se dgagent quant la fourniture de services : lun orient softswitch (i.e. sappuyant fortement sur les fonctions de la couche Contrle) plutt support par les acteurs tlcoms, et lautre orient services web (i.e. plus distribu) promu par les acteurs issus du monde Internet.
Autorit de rgulation des tlcommunications
13
Le modle orient softswitch promu par les constructeurs tlcoms gnralistes propose une architecture o lintelligence est centralise par les softswitchs et les autres serveurs de la couche Contrle (ex. : serveur de localisation, plate-forme de rseau intelligent). Ceux-ci grent les quipements du rseau de contrle et de transport et donnent laccs aux plates-formes de services via des interfaces standardises du modle OSA/Parlay. Ce modle est plutt adapt aux services tlcoms ncessitant une coopration forte du rseau (appel aux fonctions Service Capability Features via des Service Capability Servers ). Le modle orient services Web est mis en avant par les acteurs issus du monde des services informatiques et rseaux. Il repose sur une architecture distribue similaire au rseau Internet, lintelligence tant rpartie sur les diffrents serveurs. Ce modle est plus adapt aux services excuts de manire transparente aprs tablissement dune connexion IP, et ncessitant une coopration plus forte du terminal.
2.3 Une vision plus contraste chez les oprateurs et fournisseurs de services
Lapproche des oprateurs et fournisseurs de services vis--vis des NGN donne naturellement la priorit aux aspects stratgiques, conomiques et oprationnels plutt qu la technique pure.
Sur le sujet des NGN , les oprateurs et, dans une moindre mesure, les fournisseurs de services ont une rflexion beaucoup moins avance i.e. moins structure et moins globale - que les constructeurs, ce qui explique des dfinitions moins compltes, et moins spontanes.
Dailleurs le terme NGN est trs peu utilis. Cependant, tous saccordent sur les grands thmes lis aux NGN : la convergence des rseaux qui doit permettre de raliser des conomies dchelles grce la flexibilit des solutions et des architectures et la simplification des rseaux ( plus ou moins long terme, les avis diffrent suivant les oprateurs). Pour eux, lvolution vers le tout IP semble inluctable .
Cependant, alors que les ISP et les fournisseurs de services et contenus rflchissent dj des services bass sur des solutions IP natives, les oprateurs tlcoms pensent quil est encore ncessaire dattendre la maturation de ces solutions ou dutiliser lATM.
Les NGN vont permettre de proposer des nouveaux services multimdia, tel que la tlphonie sur IP, la messagerie unifie, la diffusion de contenu. Les services NGN sont aussi trs lis au concept de mobilit ; bien videmment cause de lvolution des rseaux mobiles vers le GPRS et lUMTS mais aussi dans le sens de portabilit des services sur les nombreux terminaux et daccessibilit depuis les diffrents rseaux daccs.
Louverture des rseaux de multiples fournisseurs de services tiers est un des grands principes partags, mais elle semble tre le point le plus dlicat mettre en uvre, autant sinon plus pour des raisons conomiques et stratgiques que techniques.
14
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Les fournisseurs de services et de contenus pensent que les NGN permettent la fourniture des services par des tiers (autres que les oprateurs), grce larchitecture ouverte et la standardisation des NGN ; cest pour eux le seul modle conomique viable, avec des exemples tels que le i-mode au Japon et le contre-exemple du WAP. Les oprateurs, quant eux, ne montrent que peu de signes douverture des rseaux des partenaires pour la fourniture de services, peu de volont de le faire, peu de rflexions sur les modles conomiques associs. Par ailleurs, une rflexion globale sur lvolution de la nature, de la structuration et de la valeur des contenus semble ncessaire. La vision des NGN quont ce jour les oprateurs et fournisseurs de services est fortement influence par le contexte conomique actuel o les capacits de financement rduites et le retour sur investissements rapide sont de rigueur Concernant la migration vers les NGN, la position des oprateurs et fournisseurs de services est trs pragmatique : ils voluent actuellement dans un contexte conomique peu favorable une stratgie ou une rvolution NGN et doivent donc rentabiliser leurs infrastructures existantes en investissant le moins possible.
Ils estiment donc ce jour que la mise en uvre de lvolution vers les NGN, guide davantage par des facteurs conomiques (conomies dchelles et optimisations de rseau) que par le marketing des services, sera lente et que la coexistence avec les rseaux actuels persistera pendant une longue priode. Cela ne les empche pas de mener des exprimentations, voire de commencer dployer (quoique en gnral encore faible chelle) des solutions NGN.
Par ailleurs, la nature, ltendue et lanciennet des rseaux existants sont un lment cl qui guidera la migration des oprateurs vers les NGN.
On constate donc une disparit importante des approches et des sensibilits. Si les oprateurs dj relativement tablis considrent plutt les NGN comme une volution moyen/long terme, certains acteurs (quelques oprateurs prcurseurs des architectures NGN, ou des purs fournisseurs de services notamment dans le domaine dInternet) considrent que les NGN sont les rseaux daujourdhui.
Autorit de rgulation des tlcommunications
15
2.4 Conclusion
La dfinition des NGN varie suivant la nature des acteurs (constructeurs, oprateurs, fournisseurs de services). Cependant, le concept des NGN sarticule autour de tendances globalement admises par tous.
Le NGN sera un systme offrant des services multimdia en sappuyant sur un rseau support mutualis et caractris par plusieurs lments essentiels: Un cur de rseau unique et mutualis pour les diffrents types daccs et de services. Une architecture de cur de rseau en 3 couches : Transport, Contrle et Services. Une volution du transport en mode paquet (IP, ou ATM court terme avec une convergence progressive vers IP). Des interfaces ouvertes et normalises entre chaque couche, et notamment au niveau des couches Contrle et Services afin de permettre la ralisation de services indpendants du rseau. Le support dapplications multiples, multimdia, temps rel, en mobilit totale, adaptables lutilisateur et aux capacits des rseaux daccs et des terminaux.
Couche Service (oprateur et tiers) Interfaces ouvertes et normalises Couche Contrle
Primtre NGN
Interfaces ouvertes et normalises Couche Transport (mode paquet)
Cur de rseau
Connexe aux NGN
Rseaux d'Accs multiples
Terminaux
Figure 1 : Principe gnral darchitecture dun rseau NGN (Source : Arcome)
16
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3 NGN : une nouvelle vision des rseaux et services
3.1 Introduction : larchitecture cible
Le NGN sera un systme offrant des services multimdia en sappuyant sur un rseau support mutualis. Pour cela, plusieurs lments sont essentiels et globalement partags par tous : Un cur de rseau unique et mutualis pour tous types daccs et de services. Une architecture de cur de rseau en 3 couches : Transport, Contrle et Services. Une volution du transport en mode paquet (IP, ou ATM court terme avec une convergence progressive vers IP). Des interfaces ouvertes et normalises entre chaque couche, et notamment au niveau des couches contrle et services afin de permettre la ralisation de services indpendants du rseau. Le support dapplications multiples, multimdia, temps rel, en mobilit totale, adaptables lutilisateur et aux capacits des rseaux daccs et des terminaux. La prise en compte de rseaux daccs multiples. La prise en compte de terminaux multiples.
Le schma ci-dessous prsente, de manire trs simplifie, larchitecture physique dun rseau NGN, et le primtre couvert par chacun des chapitres de cette partie danalyse technologique des NGN.
Couche Services
Service 1 (type OSA) Problmatiques transverses => Chapitre 3.7 Interfaces OSA Service Capability Servers
Service 2 (type web services)
Services => Chapitre 3.5
Couche Contrle
Bases de donnes
Serveur d'appel
Rseau de transport
mutualis en mode paquet
Contrle, sparation des fonctions d'un commutateur traditionnel => Chapitre 3.4
Interconnexions rseaux tiers (RTC, Internet, rseaux NGN)
Couche Transport
=> Chapitre 3.3 SGW/MGW
SGW/ MGW SGW/MGW
Rseau d'accs
Accs fixe
Accs sans fil
Accs mobile
Accs => Chapitre 3.2
Terminal
Terminaux => Chapitre 3.6
Figure 2 : Architecture physique dun cur de rseau NGN (Source : Arcome)
Autorit de rgulation des tlcommunications
17
Cette partie a pour but de dtailler les volutions technologiques lies aux NGN et les grandes tendances de convergence dans chaque sous-domaine : Les volutions au niveau des rseaux daccs, qui sont connexes la notion de NGN mais fortement impactantes, sont dcrites au chapitre 3.2. Y sont dtailles notamment les problmatiques suivantes : multiplication des technologies, volutions vers le haut dbit et vers des interfaces ATM ou IP avec le cur de rseau. Les volutions au niveau de la couche transport sont dcrites au chapitre 3.3. Ce chapitre explique notamment comment les backbones sont susceptibles dvoluer afin de supporter le trs haut dbit, mais surtout le transport unifi de flux mixtes voix / donne / multimdia avec la qualit de service adquate. Les volutions au niveau de la couche contrle, dcrites dans le chapitre 3.4, sont majeures. Ce chapitre aborde tous les nouveaux mcanismes et protocoles en jeu ainsi que larchitecture qui en dcoule. Le chapitre dtaille notamment les activits de normalisation de ces nouvelles solutions, et expose en dtail les technologies concurrentes, leur maturit et lventuelle convergence vers une solution unique. Les volutions au niveau de la couche services sont dcrites dans le chapitre 3.5. Elles sont, elles aussi, majeures. Le chapitre expose la nouvelle architecture NGN pour les services, notamment concernant le dialogue avec la couche contrle, et le dveloppement dinterfaces ouvertes et normalises permettant de dvelopper et fournir des services adaptatifs, indpendamment du rseau. Les deux modles de services NGN qui se dessinent, OSA et web services, sont prsents en dtail. Les volutions des terminaux, bien que connexes aux NGN, sont relativement indissociables des volutions au niveau des services. En effet, les terminaux changent de par la nature des nouveaux services supporter, mais aussi afin dintgrer une partie de lintelligence des services et de sadapter aux volutions de la couche contrle. Le chapitre 3.6 expose donc un aperu des volutions attendues, tant pour les terminaux fixes que les terminaux mobiles, et des problmatiques qui en dcoulent du point de vue de la migration vers les NGN. Enfin, le chapitre 3.7 expose des problmatiques transverses, non traites spcifiquement par le concept de NGN mais impactes par lvolution des rseaux vers les NGN : notamment les volutions de ladressage et du nommage dans les rseaux, la gestion de la mobilit inter-systmes, lvolution des systmes dinformation associs aux rseaux et services, la qualit de service de bout en bout et la scurit.
18
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.2 Impact des volutions de la couche Accs
3.2.1 Foisonnement des rseaux daccs alternatifs, transport paquet haut dbit et mobilit : un contexte typiquement NGN
La multiplication et les volutions des rseaux daccs sont identifies par une trs grande majorit des acteurs interrogs dans le cadre de cette tude comme un lment dclencheur majeur - et un moteur essentiel - de lvolution des rseaux vers les NGN.
Si lon analyse les volutions majeures apportes par ces diffrentes technologies daccs, la tendance actuelle est : la multiplication des technologies daccs, lvolution vers le haut dbit, des technologies de transport multi-services en mode paquet (IP, ou plus frquemment ATM), la convergence fixe/mobile, avec la prise en compte du nomadisme et la suppression des cblages, du fait de lessor des rseaux daccs mobiles et des rseaux locaux sans fil.
Ces quatre axes dvolution des rseaux daccs sinscrivent parfaitement dans le contexte des nouveaux rseaux et services NGN, et en favoriseront donc vraisemblablement lmergence.
Paralllement, la drglementation du secteur a permis la multiplication des oprateurs et des acteurs sur ces deux marchs. De fait, les besoins et usages du grand public et des entreprises se sont dvelopps et diversifis pour prendre en compte les nouveaux modes daccs et services (slection du transporteur, dgroupage de la boucle locale, Internet, mobile, transmission de donnes haut dbit, intgration voix/donnes, portage des applications dans un environnement nomade), les performances nouvelles des offres daccs proposes par les oprateurs, et les multiples possibilits de choix (maintenant non exclusifs) entre loprateur historique et les oprateurs alternatifs. Les chapitres suivants prsentent de manire non exhaustive les principales technologies daccs actuellement connues dont la gnralisation contribuera alimenter le besoin et le dveloppement des NGN. Un accent particulier est mis sur les tendances fortes en cours ou venir en termes dvolution de leur usage.
3.2.2 Les rseaux daccs fixes
Les rseaux daccs fixes sadaptent progressivement au support de services de donnes haut dbit : Le rseau tlphonique commut, initialement support des services voix, a permis une ouverture des services voix/donnes haut dbit grce aux technologies xDSL accessibles aux nouveaux oprateurs par le biais du dgroupage de la boucle locale. Laccs Ethernet, initialement conu pour fournir des services de donnes (IP) en entreprises, voit son usage stendre en termes de dbit, de primtre dutilisation et de services transports (voix et donne, multimdia).
Autorit de rgulation des tlcommunications
19
Enfin, il existe dautres mdias permettant par nature indiffremment le support de services voix et/ou donnes : on citera notamment les rseaux cbls, la technologie fibre optique, dj prouve mais dont lusage volue, et beaucoup plus rcemment la technologie des courants porteurs en ligne, qui utilise le rseau de desserte lectrique.
3.2.2.1 Le rseau tlphonique commut (RTC)
Le rseau public de tlphonie, qui utilise une paire de cuivre comme support physique et tait historiquement utilis pour fournir des services de voix analogique, a intgr les technologies numriques autorisant de nouveaux services. Le RNIS (Rseau Numrique Intgration de Services) est un service de tlphonie numrique qui permet de fournir des services voix et donnes des dbits de 64 ou 128 kbit/s en utilisant la paire de cuivre traditionnelle. Le rseau daccs tlphonique comme le rseau de transport longue distance associ restent aujourdhui des rseaux ddis bass sur la commutation de circuits (TDM). Ils possdent de nombreuses interconnexions afin de grer les communications internationales, fixe vers mobile ou encore dun oprateur un autre pour une mme communication. Avec la drglementation des tlcommunications (notamment lintroduction de la slection du transporteur), plusieurs oprateurs alternatifs ont dvelopp des infrastructures pour offrir des services voix leurs clients. Paralllement, ces mmes oprateurs ont tendu leurs offres de services afin de proposer leurs clients, majoritairement des entreprises, le transport de donnes.
Ce type doffre a amen les oprateurs alternatifs prsents sur les deux types de march (voix et donnes) dvelopper des rseaux convergents de type paquets, afin doptimiser leur infrastructure.
Le RTC est aussi de plus en plus utilis pour un accs Internet en mode commut. Loprateur historique doit alors effectuer la collecte de ce trafic vers les diffrents fournisseurs de services Internet (ISP), qui sont en gnral des acteurs issus du monde de la donne. Or, dans ce domaine, les quipements amens interfonctionner avec des rseaux tlphoniques utilisant de la signalisation SS7 implmentent gnralement sparment les fonctions lies la gestion du trafic et de la signalisation.
La gnralisation de laccs Internet commut a t loccasion pour les oprateurs historiques de faire voluer leurs offres dinterconnexion afin daccepter la gestion de la signalisation quasi-associe (i.e. transport spar de la signalisation et du trafic vers deux quipements distincts). Ce schma dinterconnexion se reproduira relativement souvent dans le cas des rseaux NGN, pour lesquels certains fournisseurs implmentent sparment les fonctions media gateway et signalling gateway (Cf. chapitre 3.4 couche Contrle).
20
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.2.2.2 Dgroupage de la paire de cuivre : les technologies xDSL
Les technologies xDSL permettent dutiliser les paires de cuivre du rseau public de tlphonie afin doffrir des services de donnes haut dbit. Diffrents types de technologies xDSL, offrant des dbits symtriques ou non, ont t dvelopps ou sont en cours de spcification afin doffrir ladquation entre les technologies utilises et les services souhaits, ainsi quune augmentation des dbits utilisables. Une contrainte forte de lxDSL est la distance parcourir sur la paire de cuivre entre le terminal du client et le DSLAM de loprateur. LADSL est actuellement la plus rpandue ; pour une distance de 2700m, elle permet un dbit de transmission de donnes montant de 640 kbit/s et un dbit descendant de 8 Mbit/s (2 Mbit/s une distance de 4600m). La technologie daccs ADSL, apparue vers la fin des annes 1990, est maintenant mature mais la gnralisation au grand public reste difficile. Nanmoins, ce type daccs illimit Internet permet un changement dans la perception des utilisateurs : la notion de dure de connexion tendra disparatre au profit de la notion daccs des services haut dbit, la demande, et sur la base dune dure non limite. Pour les offres dinterconnexion ADSL, linterface du rseau de collecte xDSL vers le cur de rseau sappuie sur des flux IP, eux-mmes en gnral vhiculs sur des technologies de transport ATM (Cf. offres dinterconnexion Turbo IP ou Connect ATM de France Telecom). Cette technologie permet donc une interconnexion simple et rapide pour les services de donnes. Mais la voix sur ADSL est un service qui a aussi vocation se dvelopper. La technologie permet en effet de transporter en mode paquet jusqu 16 communications sur un lien DSL. Un oprateur alternatif peut ainsi proposer une installation destine un groupe dutilisateurs (PME/PMI) pour leur tlphonie complte et leur accs Internet haut dbit.
LADSL est indniablement un moteur pour lintroduction des NGN : de nombreux contrats NGN portent dailleurs sur des services de voix sur ADSL, qui reprsentent un exemple actuellement oprationnel de convergence entre un rseau de type donnes et un service de type voix . Cependant lutilisation dATM comme protocole de transport des flux IP linterconnexion peut terme tre un frein lvolution tout IP des oprateurs.
3.2.2.3 Les rseaux de donnes IP et Ethernet
Les rseaux de donnes se composent traditionnellement dun rseau local (LAN) sur lequel sont rattachs les quipements terminaux ou postes clients, de commutateurs ou routeurs, et dun rseau distant (WAN) compos de liaisons de donnes qui interconnectent les diffrents sites. Le protocole de transport de donnes maintenant le plus largement utilis est IP. Ethernet est la technologie LAN la plus commune, qui utilise historiquement des cbles coaxiaux ou des paires torsades pour des dbits de transmission jusqu' 10 Mbit/s, et plus rcemment 100 Mbit/s (Fast Ethernet). Rcemment, le Gigabit Ethernet (dbits de 1 Gbit/s avec une volution 10 Gbit/s) sur fibre optique est apparu dans les offres des constructeurs. IP sur Ethernet via la fibre optique ouvrira la porte aux applications bases sur des rseaux haut dbit qui fourniront des services intgrs pour la voix, les donnes, la vido sur demande ou l'imagerie mdicale. Cette technologie devrait se dmocratiser dans les transmissions WAN/MAN et dans la boucle locale, aux endroits o la fibre est disponible.
Un rseau Ethernet est conu pour transporter des flux IP natif. Par ailleurs, ses volutions vers le trs haut dbit et un support physique
Autorit de rgulation des tlcommunications
21
optique permettent maintenant dutiliser Ethernet comme technologie daccs, voire de transport longue distance. Ces deux aspects en font une technologie particulirement pertinente dans le cadre des NGN.
3.2.2.4 Les liaisons par fibre optique
Cette technologie a t dveloppe pour permettre un transport de trafic trs haut dbit. Elle ncessite cependant une infrastructure lourde dployer vers les sites des clients finaux, ce qui explique quelle ait t lorigine surtout utilise : Pour les rseaux longue distance. En effet, une fibre optique monomode peut supporter des transferts allant jusqu 200 Gbit/s sur des dizaines de kilomtres sans rpteur. Ainsi tous les rseaux longue distance reposent sur le support optique et utilisent les technologies PDH ou SDH sur DWDM. Plus rcemment pour linterconnexion des sites dentreprises aux rseaux des oprateurs, pour les services de donnes, en complment au rseau tlphonique.
Or depuis quelques annes la fibre optique est dploye pour constituer un rseau de boucle locale afin de desservir directement les sites clients. Le dploiement de boucles locales en fibre optique permet ainsi au client de pouvoir prtendre des dbits plus importants mais impose galement loprateur dinvestir lourdement sur son rseau afin den dvelopper la capillarit. Sur ces boucles locales peuvent tre multiplexs des services voix et donnes.
La fibre optique, incontournable de manire gnrale dans les rseaux de transport trs haut dbit, est un support de boucle locale neutre , aussi bien adapt au transport de services voix (TDM) que donnes (IP), et permettant un trs haut dbit. Elle est donc pertinente dans le cadre de lvolution vers les NGN.
3.2.2.5 Laccs par cble - HFC
Le cble est le rseau large bande le plus dploy en Europe de l'Ouest. L'offre de nouveaux services a contraint les oprateurs de cble un effort important de mise niveau de leurs rseaux, gnralisant l'architecture de transport mixte de type HFC (Hybrid Fibre Coax) et activant une voie de retour bande troite. L'architecture HFC a t reconnue comme l'une des plus fiables, tant techniquement qu'conomiquement, car elle combine les avantages de la large bande passante de la fibre optique (utilise au plus prs de labonn) et les cots faibles de la technologie cble coaxial (utilise pour la desserte terminale). Le HFC utilise typiquement une bande passante de 750 MHz, avec jusqu 250 MHz rservs pour un usage ultrieur. Ce spectre rsulte de lexpansion du spectre traditionnel pour la vido analogique afin de rserver de la capacit pour les services vido numriques, la signalisation dans le sens montant pour les services interactifs (bande passante 5-42 MHz uniquement, car le HFC a initialement t conu pour les services de diffusion), et la tlphonie. Les dbits autoriss par les rseaux cbls de type HFC pour des services de transmission de donnes en complment de services de diffusion TV sont importants : en thorie 10 Mbit/s en voie descendante, et 760 kbit/s en voie remontante, soit plusieurs centaines de fois suprieures celle dun modem classique utilisant la ligne tlphonique. Lutilisation du HFC pour la transmission de donnes uniquement permet datteindre des dbits de lordre de 5 Gbit/s avec les modulations actuelles les plus performantes. Le HFC est compatible avec tout type de technologie de transmission actuelle ou venir : ATM, Frame Relay, SDH, multiplexage en longueur donde DWDM
22
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Malgr sa couverture limite, laccs cble, de par ses possibilits techniques de transmission de services haut dbit en complment de la diffusion TV, reprsente un rel potentiel de services NGN (et donc de nouveaux acteurs). On constate dailleurs dj une diversification des activits de services des cblo-oprateurs en ce sens.
La France est dans la situation du modle "pay-TV" o l'oprateur de cble est un fournisseur de services de tlvision. Il slectionne et facture un ensemble de chanes qu'il diffuse l'abonn par le rseau.
Sur le plan conomique, les cblo-oprateurs sont donc dj familiariss avec un modle ouvert de relations entre oprateur de rseau et fournisseurs de services. Ils disposent par ailleurs dune lgitimit naturelle pour la fourniture de services multimdia (services TV, pay-per-view , et plus rcemment accs Internet).
3.2.2.6 Les courants porteurs en ligne (CPL)
La technologie CPL (Courant Porteurs en Ligne) ou PLC en anglais (PowerLine Communication) connat un regain dintrt en Europe dans le cadre dun accs la boucle locale dabonn dans des zones non desservies par dautres techniques par exemple. La simplicit apparente de sa mise en uvre et la capillarit du rseau lectrique Basse Tension existant prsentent des perspectives intressantes pour la desserte locale du client final. Au stade actuel de dveloppement de la technologie CPL, il nexiste pas encore de normes techniques relatives linteroprabilit des quipements, do des solutions propritaires. Par ailleurs, lexprimentation du CPL montre des limitations dutilisation, notamment pour un usage autre que local un btiment. La premire gnration des spcifications du PLC autorisera des dbits de transmission de donnes dans les btiments de lordre de 5 10 Mbit/s, ce qui permet aisment denvisager des applications comme le streaming audio ou multimdia et la voix sur IP. La technologie CPL pourrait donc ventuellement jouer un rle dans la diffusion de contenus multimdia de proximit (ex. : video streaming) ou lADSL lintrieur des btiments. Exemple de produit ADSL utilisant la technologie CPL : La start-up bretonne LEA a dvelopp un botier intgrant un modem ADSL et un transformateur adaptant le signal ADSL au rseau lectrique. Ce point daccs reoit les donnes Internet en provenance du rseau tlphonique et les transmet travers le rseau lectrique dun btiment. Il permet aussi de raliser un rseau local dont il devient le serveur central. Le dbit maximum est de 10 Mbit/s thorique (en pratique, environ 500 kbit/s). Ce type de produit, qui sadresse aux particuliers et aux PME, attend encore un cadre normatif europen pour tre lanc sur le march. (Daprs : ZDNet Week, semaine du 25 au 31 Mars 2002).
3.2.3 Les technologies daccs fixe sans fil / radio
Plusieurs technologies permettent de fournir des services voix et donnes fixes en utilisant un accs radio. On citera notamment la boucle locale radio, les rseaux locaux sans fil et Bluetooth. Ces technologies sont globalement rcentes (pas plus de quelques annes), voire leurs balbutiements, mais apparaissent trs prometteuses et promises des volutions et un dveloppement trs importants. Quant aux rseaux satellitaires,
Autorit de rgulation des tlcommunications
23
plusieurs tentatives de dploiement dj relativement anciennes ont men des checs (avant tout dordre conomique du fait des cots particulirement levs de dploiement), mais ils pourraient, dans les prochaines annes, trouver enfin leur place parmi les rseaux daccs effectivement utiliss pour fournir des services fixes .
Ce sont par essence des technologies convergentes voix-donne (technologie de transport neutre ou orient donnes) et/ou fixemobile (nomadisme), qui joueront donc un rle cl dans lmergence des rseaux et services NGN.
3.2.3.1 La boucle locale radio (BLR)
Aujourdhui, la technologie BLR permet aux oprateurs alternatifs de saffranchir de lutilisation de la boucle locale de loprateur historique. Elle a lavantage de la souplesse, de la rapidit et de la progressivit du dploiement (du fait de lutilisation de la technologie radio) et permet des dbits levs ainsi que des services varis. Elle est donc vue comme une concurrente des technologies daccs xDSL. Le principe de la BLR consiste remplacer les derniers kilomtres de lignes filaires arrivant au foyer de l'abonn par des liaisons radio directives en mode point--multipoint entre une station de base (BS) relie au rseau oprateur et plusieurs stations terminales (TS) relies aux rseaux clients. Le lien radio ne peut couvrir quune distance maximale de 5 ou 6 kilomtres dans la bande des 26 GHz et dune dizaine de kilomtres dans la bande 3,5 GHz. La BLR est une technologie sans-fil large bande qui autorise la fourniture de services voix et donnes fixes haut dbit. Le rseau BLR se contente dencapsuler les donnes dans des trames et ainsi ne limite aucunement les types de services pouvant tre offerts. La technologie utilise pour la transmission est le LMDS (Local Multipoint Distribution Services) qui a initialement t dvelopp pour la diffusion de programmes tlvisuels. Aujourdhui, les services utilisant la technologie LMDS prvus selon les dclarations des oprateurs BLR couvrent une large gamme de services de communication, savoir : Laccs Internet haut dbit, Les liaisons loues, La tlphonie de base, Les rseaux privs virtuels (VPN) et linterconnexion de LAN, Le transfert de fichier en temps rel, le video streaming
Cependant, actuellement seules les offres daccs Internet et de liaisons loues sont disponibles, les autres types de services tant moins rpandus ou non disponibles. Les dbits proposs pour les offres daccs Internet sont gnralement des dbits symtriques de lordre de 128 kbit/s 2 Mbit/s, caractristique entre autres trs intressante dans le cadre dutilisation de certains services multimdia en ligne (ex. : vidoconfrence). Certains oprateurs proposent galement des dbits asymtriques. Les interfaces disponibles sur les quipements ct usager sont, par exemple, des liaisons 2 Mbit/s trames ou non, des interfaces pour la tlphonie analogique de base, des liaisons ATM, des liens Ethernet, des liens SDH (STM-1, STM-4).
Pour le raccordement des stations de base au cur de rseau, toutes les offres de produits BLR de premire gnration fournissent des interfaces ATM, protocole adapt au transport des services voix et donnes avec une qualit de service garantie et des
24
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
dbits contrls. Le support dIP natif nest prvu que dans un horizon plus lointain.
Ce choix est logique si lon considre que la BLR utilise dj le transport ATM sur linterface radio (protocole Wireless ATM ). En cela, elle se rapproche de lUMTS (Cf. paragraphe 3.2.4.2). Sur le plan conomique, notons en complment quaprs leffervescence lie aux attributions de licences BLR en France, le march a subi dimportantes volutions (retraits, rachats). Le dploiement de la BLR en France est donc encore incertain, et risque dtre contrast en termes de couverture gographique et de clients viss.
3.2.3.2 Laccs satellite
Au-del de son march traditionnel de la diffusion TV et radio, le satellite pourrait galement se positionner de faon tout fait intressante sur le march de lInternet, et plus particulirement sur les applications "multicast", qui devraient reprsenter une part croissante du trafic Internet. Le satellite est en effet par nature adapt ce type de transmissions point--multipoint. Il permet de saffranchir du rseau Internet traditionnel et donc de garantir un certain dbit de bande passante, ce qui est particulirement important pour des applications de streaming mdia en temps rel. Deux grands types de satellites peuvent tre distingus : les satellites de diffusion, dits traditionnels, et les satellites multimdia de nouvelle gnration. Les satellites multimdia sont gnralement bidirectionnels, cest--dire permettant une voie de retour (qui peut aussi tre terrestre). Lobjectif de ces satellites large bande est de diffuser un contenu spcifique un utilisateur (configuration "unicast"), ou un groupe dutilisateurs (configuration "multicast"). On citera par ailleurs le rle venir important de la norme DVB-RCS (Digital Video Boradcast Return Channel for Satellite), vers laquelle les organisations europennes semblent converger pour le dveloppement de terminaux compatibles avec les diffrentes technologies satellites utilises, afin de fournir des services interactifs. Grce ce type de satellites, trois grandes familles de service peuvent tre envisages : les services "multicast" bass sur la diffusion point--multipoint, les services la demande bass sur une diffusion point--point, et les services daccs Internet bidirectionnel. Cette nouvelle gnration de satellites multimdia pourrait moyen ou long terme relancer les programmes de fourniture de services de communications par satellite, qui ont jusquici t pour la plupart des checs de par leur cot et ltroitesse du march vis, mais plutt avec une approche de services fixes .
Autorit de rgulation des tlcommunications
25
3.2.3.3 Les rseaux locaux sans fil (WLAN)
Les technologies WLAN permettent d'tablir des rseaux locaux IP sans fil, entre des ordinateurs et priphriques. Le march vis pour la technologie WLAN est en tout premier lieu le march professionnel. Les services offerts aux clients sont les mmes que ceux pour les accs fixes en mode IP : email, accs un Intranet d'entreprise, accs Internet, tlchargement de fichiers Lapplication initiale tait plutt oriente vers des rseaux privs dentreprise, mais certains oprateurs dploient des rseaux WLAN publics (plusieurs projets en Asie, et plus rcemment en Europe). Les WLAN, comme les systmes cellulaires, utilisent des stations de base pour communiquer avec des ordinateurs portables. A la diffrence de la BLR, les rseaux WLAN permettent de grer la mobilit des utilisateurs au niveau IP. Les dbits de transmission de donnes sont par ailleurs trs suprieurs ceux des rseaux cellulaires, prsents plus loin. Actuellement, le march des WLAN est partag entre le standard 802.11b (appel aussi Wi-Fi) et des technologies propritaires. Le standard 802.11b est maintenant une technologie mature avec des produits existants qui rpondent aux attentes du march. De futures volutions des WLAN devraient permettre des dbits plus levs (jusqu' 54 Mbit/s) dans la bande 5 GHz. Il existe deux principales technologies concurrentes pour cette gnration future : 802.11a (standardis par lIEEE aux Etats-Unis, successeur de 802.11b) et HIPERLAN2 (standardis par lETSI en Europe, vise concurrencer la technologie 802.11a grce de meilleures performances). Son prdcesseur, HIPERLAN1, n'a pas rencontr le succs commercial escompt). partir de 2002/2003, le march devrait se focaliser essentiellement autour de 802.11a et HIPERLAN2. lhorizon 2005, on entrevoit dj leurs remplaants : des technologies qui opreront dans des bandes de frquence plus leves (> 50 GHz) et qui fourniront des dbits encore plus levs (> 100 Mbit/s).
La technologie WLAN, mature et promise des volutions fortes en termes de dbit, de couverture et dusage, permet la fourniture de services IP natif, trs haut dbit, avec un usage nomade, trois lments cl de la dfinition dun service NGN. Les interfaces avec le cur de rseau sont elles aussi IP natif, ce qui facilitera lorientation des oprateurs WLAN voulant dployer un cur de rseau NGN vers un transport IP natif plutt quATM.
On notera par ailleurs des projets visant favoriser les services multi-rseaux daccs incluant le WLAN (Cf. projet INTERNODE visant exprimenter un service de VPN scuris via accs GPRS et WLAN, expos plus en dtail dans le chapitre 3.7).
3.2.3.4 Laccs sans fil Bluetooth
Contrairement aux technologies WLAN ou BLR qui sappuient sur une architecture centralise, Bluetooth ne ncessite pas de point daccs puisque les connexions peuvent tre directement effectues entre les appareils. Initialement, lutilisation de Bluetooth est prvue pour des connexions de trs courte porte (dialogue entre priphriques concept de rseau personnel -, ou desserte de lordre de quelques mtres). Les caractristiques essentielles de Bluetooth et son usage dans le cadre de lvolution des terminaux sont prsents plus en dtail dans le chapitre 3.6. Cependant, Bluetooth pourrait voluer pour tre utilis comme rseau daccs afin doffrir des services similaires ceux du WLAN. On citera notamment le constructeur Ericsson, grand promoteur de Bluetooth, qui commence proposer aux oprateurs une
26
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
offre daccs allant dans ce sens, sappuyant sur des bornes de service Bluetooth utilises en complment des accs rseaux mobiles (GSM/GPRS, UMTS) afin de desservir des sites dentreprises.
3.2.3.5 Tlphonie sans fil : le DECT
Largement adopte bien au-del de l'Union Europenne puisquil est actuellement adopt dans plus de 110 pays, le DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) a vocation couvrir les domaines dapplication de la tlphonie sans-fil domestiques (domaine dapplication initial), de la tlphonie sans-fil d'entreprise (solutions de PABX sans-fil domaine o le DECT est maintenant massivement dploy et a supplant les systmes concurrents), et des systmes d'accs sans-fil pour les abonns aux rseaux de tlcommunications publics (usage encore trs marginal). Le DECT est une norme europenne d'accs radio cellulaire numrique sans fil dont la premire version a t publie par lETSI en 1992, qui sappuie sur un mode daccs TDMA (Time Division Multiple Access) / FDD (Frequency Division Duplex). Il bnficie de procdures de scurit (authentification, chiffrement) importantes. Les principales diffrences du DECT par rapport aux principaux systmes cellulaires numriques (GSM, DCS1800) sont que : Alors que les systmes cellulaires sont dvelopps pour une large couverture gographique, la norme DECT est optimise pour une couverture locale (20300m) avec une forte densit d'utilisateurs. La slection et lallocation des canaux de fonctionnement pour une communication sont automatiques, et ne ncessitent aucune planification de frquences, et la gestion de la mobilit en DECT est plus restreinte, son domaine dapplication tant le sans fil (rseaux locaux) plutt que le mobile .
Depuis 1995, la norme DECT a en effet t constamment tendue pour supporter : un service de transmission de donnes asynchrone en mode paquet appel DPRS (DECT Packet Radio Service). Les dbits supports sont de 552 kbit/s actuellement, avec une volution prvue jusqu 2 Mbit/s. Le DPRS supporte notamment les connexions V.24 et Ethernet TCP/IP. dautres modes de transmission de donnes, comme la transmission isosynchrone 32 kbit/s, ou des services de messaging analogues au GSM : DECT-SMS (Short Message Service), EMS (Enhanced Message Service) ou MMS (Multimedia Message Service). des services multimdia. Les systmes DECT ont t enrichis d'un DECT Multimedia Access Profile (DMAP) incluant le GAP (profil daccs des terminaux pour la voix) et le DPRS (pour les donnes). Le WAP (Wireless Access Protocol). Le DECT a en effet t intgr comme rseau daccs possible dans les spcifications du protocole WAP. Linteroprabilit avec les rseaux mobiles 3G. Lvolution des services de donnes du DECT vers le haut dbit est une des raisons pour lesquelles le DECT fait partie des normes de rseaux daccs regroups au sein de la famille IMT2000 pour les services mobiles de nouvelle gnration. Cest mme la seule technologie de cette famille qui dispose de produits commercialement disponibles et prouvs.
La complmentarit de cette norme avec lUMTS pourrait par exemple permettre une utilisation plus grande pour les particuliers et le DECT pourrait devenir un rseau daccs mobile doprateur performant dans des zones localises, au mme titre que le WLAN.
Les volutions rcentes de la norme DECT permettent les changes de donnes avec des dbits allant jusqu 2 Mbit/s, les services multimdia, et linteroprabilit avec les rseaux mobiles 3G. Le
Autorit de rgulation des tlcommunications
27
support simultan de ces services, associ un haut niveau de scurit et une maturit importantes des produits donneront potentiellement une place importante au DECT dans un environnement de rseau local sans fil convergent, et permettront peut-tre le dveloppement doffres de services doprateurs. Cependant, linterfonctionnement fort entre le DECT et le GSM, prvu dans la norme initiale, na pas donn lieu un dveloppement important des offres allant dans ce sens. Limportance du DECT dans le cadre des NGN est donc soumise la stratgie des constructeurs.
3.2.4 Les rseaux daccs mobiles
Plusieurs rseaux daccs radio fournissant des services de radiocommunications mobiles publics sont ici prsents. Le GSM est une technologie historiquement oriente vers les services voix et donnes bas dbit mature et trs largement rpandue, mais volue actuellement avec lajout de services de transmission de donnes en mode paquet (GPRS), et court terme avec lmergence de la nouvelle gnration convergente voix/donnes/multimdia : lUMTS. NB : les tentatives dutiliser des rseaux satellites afin de fournir des services mobiles ont pour linstant abouti des checs techniques et commerciaux.
3.2.4.1 Radiocommunications : le GSM et le GPRS
Le GSM (Global System for Mobile communications) est une norme europenne de systme de radiocommunications numrique. Cette technologie connat un trs fort succs, qui stend l aussi au-del de lEurope, avec une explosion du march vers la fin des annes 1990. Le systme GSM avait initialement vocation la fourniture de services voix dans un environnement mobile. Larchitecture de rseau repose donc sur un ensemble dquipements spcifiques aux rseaux mobiles, mais le GSM ayant t spcifi dans loptique dun raccordement avec les rseaux RTC ou RNIS, la commutation de trafic seffectue en mode circuit TDM 64 kbit/s dans le cur de rseau. Le GPRS (General Packet radio Service), spcifi par l'ETSI en 1991, est un nouveau service mobile de transmission de donnes en mode paquet utilisant la technologie daccs radio GSM.
28
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Le GPRS est incontestablement une technologie prometteuse pour la convergence entre tlphonie mobile et Internet car : Le GPRS rutilise, moyennant quelques adaptations techniques, les rseaux daccs radio GSM et les lments de rseaux ainsi que les procdures puissantes dauthentification et de gestion de la mobilit implmentes dans le cur de rseau et les terminaux GSM, ce qui en simplifie le dploiement. Par rapport au GSM, il permet une augmentation significative des dbits de transmission de donnes, entre 30 et 40 kbit/s dans une premire phase et plus de 100 kbit/s moyen terme (vitesse maximale thorique : 171,2 kbit/s). Le GPRS repose sur un transport des donnes en mode paquet et utilise le protocole IP (Internet Protocol) au niveau du cur de rseau, ce qui garantit une compatibilit maximale avec les rseaux Intranet et Internet. Le GPRS autorise le dveloppement de nouveaux usages bass par exemple sur une connexion permanente ( always on ), et sur une facturation des services en fonction du dbit de donnes transmis, et non plus de la dure de connexion comme en GSM.
En revanche, les volutions ncessaires au niveau de linterface radio GSM pour supporter la transmission de donnes en mode GPRS imposent notamment le remplacement des terminaux existants par des appareils totalement GPRS ou plus gnralement bi-mode, GSM/GPRS. La technologie GPRS est communment appele 2,5 G car elle est vue comme une transition essentielle de la transmission de donnes bas dbit en mode circuit du GSM (systme mobile de deuxime gnration), vers la transmission de donnes en mode paquet trs haut dbit de lUMTS (systme mobile de troisime gnration).
La mise en uvre du GPRS, qui est rcente ou imminente dans la plupart des rseaux GSM europens, sera pour les oprateurs mobiles une tape cl qui leur permettra de mettre en uvre des architectures de cur de rseau (transport IP) et des services de transmission de donnes en mode paquet haut dbit que lon peut qualifier de pr-UMTS ou pr-NGN . A cette occasion, les partenariats entre oprateurs mobiles et fournisseurs de services pourront aussi tre amens voluer.
3.2.4.2 Les rseaux 3G UMTS
L'expression "Universal Mobile Telecommunications System" (UMTS) dsigne la norme cellulaire numrique de troisime gnration retenue en Europe. Atteignant terme 2 Mbit/s dans certaines conditions, les vitesses de transmissions offertes par les rseaux UMTS seront nettement plus leves que celles des rseaux de seconde gnration. Cette technologie ncessite le dploiement de nouveaux quipements radio par rapport au GSM et au GPRS : lUTRA (UMTS Terrestrial Radio Access). Elle utilise de nouvelles bandes de frquences. Lvolution de linterface radio permettra daugmenter les dbits disponibles pour les utilisateurs finaux en utilisant la technologie daccs CDMA (Code Division Multiple Access), qui offre des amliorations importantes en terme defficacit spectrale. LUTRA utilise un transport ATM sur la voie radio, et les interfaces vers le cur de rseau sont, du moins initialement, bases sur un transport ATM (ATM/AAL2 pour la voix, ATM/AAL5 pour la donne).
Autorit de rgulation des tlcommunications
29
LUMTS constitue par rapport au GSM/GPRS plusieurs volutions majeures : Lutilisation dun nouveau rseau radio adapt pour un transport convergent des services voix et donnes en mode ATM de la voie radio jusquau cur de rseau (une volution vers IP est envisage long terme). Un cur de rseau unifi pour les services voix et donnes, avec un transport en ATM ou IP. Lintroduction progressive du concept de VHE (Virtual Home Environment) qui permet ladaptation des services toute situation de mobilit (par rapport au rseau, lutilisateur ou au terminal). A moyen terme, une sparation des couches Transport et Contrle du cur de rseau, ainsi que des couches Contrle et Services dialoguant via des interfaces normalises OSA (Open Service Architecture) A moyen terme, lintroduction de nouveaux services nativement IP multimdia bass sur le protocole de contrle dappel SIP. Pour tre complet sur le primtre technique de lUMTS, notons par ailleurs que la norme UMTS prvoit plusieurs rseaux daccs possibles. En complment de lUTRA, une composante daccs satellite est prvue, mais ses dveloppements et sa maturit sont encore incertains. Par ailleurs, il est prvu une interoprabilit des services mobiles 3G entre plusieurs rseaux daccs utilisant les mthodes de multiplexage CDMA, TDMA et/ou FDMA, regroups au sein de la famille IMT2000. Le DECT en fait partie.
Le systme mobile de troisime gnration UMTS est le premier systme global entirement normalis (du moins dans sa deuxime phase) avec une architecture de rseau et de services NGN : une volution vers le tout IP , des services multimdia trs haut dbit en mobilit tendue, un transport unifi et une sparation du rseau en couches dialoguant via des interfaces normalises, ainsi quune interoprabilit avec des rseaux daccs multiples. Lutilisation massive du transport ATM dans le sous-systme radio UMTS fait que, en fonction de leur existant, les oprateurs UMTS sorienteront vraisemblablement pour leur cur de rseau soit vers un transport convergent voix/donnes en ATM, soit vers un transport de la voix sur TDM (rutilisation du backbone GSM) et de la donne sur IP (rutilisation du backbone GPRS).
Alors que les exprimentations UMTS sont en cours, les premiers dploiements oprationnels sont attendus pour 2002-2003. Cette technologie ncessite de nouveaux terminaux adapts linterface radio UTRA, et multimodes GSM/GPRS afin de pouvoir fonctionner en repli sur les rseaux 2G dans les zones non couvertes et UMTS. Nous reviendrons plus en dtail sur cette technologie en tudiant notamment larchitecture du cur de rseau UMTS dans le chapitre 3.4 sur la couche Contrle.
3.2.4.3 Complmentarit avec les rseaux daccs fixes sans fil
Il ressort du panorama ralis que deux technologies daccs fixe sans fil sont particulirement proches des rseaux mobiles, et permettent denvisager une relle complmentarit dutilisation, dans une optique de convergence fixe/mobile : Le DECT, historiquement conu pour supporter des services de tlphonie, au mme titre que le GSM, intgre les mmes volutions que ce dernier avec lintroduction du service de transmission de donnes en mode paquet DPRS (
30
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
comparer au GPRS pour le GSM). De mme que des terminaux bi-modes DECT/GSM avaient t spcifis, les volutions du DECT prvoient un interfonctionnement avec les rseaux UMTS qui sont les successeurs du GSM/GPRS. Le WLAN, historiquement conu pour supporter des services de donnes IP, pourrait permettre grce lutilisation de ce protocole IP fdrateur et notamment ses fonctions Mobile IP , de mettre en uvre un interfonctionnement des services avec les rseaux GPRS, et ultrieurement UMTS, qui offrent des services identiques en mobilit tendue.
Si les exprimentations en ce sens ont commenc (Ex. projet INTERNODE pour des services GPRS et WLAN), le succs commercial de la mise en uvre de services mixtes entre rseaux sans fil et mobile est encore incertain, et dpendra notamment de lvolution des offres de terminaux dune part, et du contexte rglementaire dautre part.
3.2.5 Conclusion : de laccs au cur de rseau
Bien que ne pouvant pas tre qualifies de NGN, les nouvelles technologies daccs haut dbit sont une composante connexe trs importante car elles influeront sur la rapidit dintroduction et les modalits techniques dtailles de mise en uvre des curs de rseau NGN.
Les diffrentes technologies de rseaux daccs examines dans le prsent chapitre sont complmentaires en termes dusages et de services, et ont donc chacune un rle jouer dans le dveloppement effectif des services IP multimdia de nouvelle gnration. Elles prsentent des caractristiques diverses qui en feront des lments technologiques et conomiques moteurs pour le dveloppement des rseaux NGN, selon : Leur niveau de maturit (existence de produits) et le potentiel de march quils couvrent en termes dutilisateurs et denvironnement. Le support de services temps rel bass sur IP et les dbits de transmission de donnes offerts. Le support du nomadisme ou de la mobilit, et de linterfonctionnement des services entre plusieurs rseaux daccs. La nature des interfaces de transport (normalises ou disponibles auprs des industriels) entre le rseau daccs et le cur de rseau. Cet lment impactera naturellement les choix des oprateurs en termes de protocole de transport convergent au sein du cur de rseau (Cf. chapitre 3.3).
Ainsi, si les technologies daccs WLAN ou Ethernet orientent plutt loprateur vers une solution de transport unifi en IP natif dans le cur de rseau, les technologies xDSL, BLR ou UMTS lorientent plutt, du moins court/moyen terme, vers une solution ATM.
Les technologies daccs fibre optique, cble, CPL, satellite, ou Bluetooth tant du niveau liaison , elles sont neutres en termes de protocole de transport et nentreront a priori pas en compte dans le choix de la solution de transport unifi des oprateurs. Le tableau suivant prsente une synthse des caractristiques des technologies daccs qui sont pertinentes analyser afin den valuer le potentiel dutilisation ou dinfluence dans le cadre des NGN :
Technologie daccs Maturit Dbit de donnes Commutation / Potentiel NGN (ordre de grandeur) interface vers le cur de rseau
Autorit de rgulation des tlcommunications
31
Rseaux daccs fixes RTC, Trs mature < 64 ou 128 kbit/s RNIS xDSL 0,5 50 Mbit/s ADSL : moyenne Autres : faible
TDM (circuit)
Ethernet Fibre optique
+++ interconnexion ATM, ou IP sur ATM Trs mature LAN : 10-100 Mbit/s IP natif +++ WAN : 1-10 Gbit/s Mature Plusieurs centaines Neutre ++ de Gbit/s si WDM (niveau liaison)
HFC (Cble) CPL
Mature
Faible
Si TV : 0,5-10 Mbit/s. Donnes seul : ~5 Gbit/s Jusqu 10 Mbit/s
++ Donnes : orient IP (norme Docsis) Neutre + (niveau liaison) ++ +
Paquetisation de la voix (transport), puis services VoIP Oprateurs alternatifs, interfaces IP, voix sur xDSL Extension aux rseaux MAN/WAN Extension aux boucles locales. WAN : gnralisation WDM et commutation optique Diversification vers services VoIP, donnes, Internet Services de proximit
Rseaux daccs fixes sans fil / radio BLR Moyenne / Jusqu > 500 Mbit/s ATM initialement faible DVB Moyenne Jusqu 30 Mbit/s Donnes : (Satellite) orient IP
WLAN
Mature, volutif
Jusqu 11 Mbit/s (vol. > 50 Mbit/s)
IP natif
+++
Bluetooth DECT
Faible Mature, volutif
Jusqu 1 Mbit/s 0,5 Mbit/s, (vol. : 2 Mbit/s)
Neutre (niveau liaison) TDM (circuit) ou IP (paquet)
+ +
Tous services fixes, voix et donnes Services fixes de diffusion, la demande, ou ventuellement bidirectionnels Services nomades de transmission de donnes haut dbit, complment aux rseaux mobiles Essentiellement ct terminaux Rseaux dentreprises, (Oprateurs : complment aux rseaux mobiles 3G) Paquetisation de voix (transport) la
Rseaux daccs mobiles TDM (circuit) + GSM Mature < 15 kbit/s (vol. ~70 kbit/s avec HSCSD) IP (paquet) ++ GPRS (vol. GSM) 10-150 kbit/s Faible (vol. ~380 kbit/s avec HSCSD) UMTS Trs faible ~380 kbit/s Paquet. ATM +++ (vol. 2 Mbit/s) (vol. IP terme)
Services donnes mobiles en mode paquet, Transport IP Serv. donnes mobiles multimdia, cible = rseau 100% NGN
32
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.3 Vers un rseau de Transport IP, multiservices et haut dbit
Prambule - Avertissement : Dans le modle darchitecture NGN, les quipements de cur de rseau sont spars en deux fonctions, lune appartenant la couche transport (les Media Gateways) et lautre la couche contrle (les serveurs de contrle dappel). Cest pourquoi la description technique et fonctionnelle des Media Gateways ne peut tre dissocie de celle des serveurs de contrle dappel.
Pour des raisons de cohrence et de facilit de rdaction, la description du rle et des caractristiques techniques des Media Gateways sera donc prsente dans le chapitre 3.4 suivant, traitant de la couche Contrle.
Nous traiterons donc dans cette partie des autres volutions du rseau de transport, principalement concernant les technologies de transmission et de commutation utilises sur les liaisons qui interconnectent les rseaux daccs au cur de rseau (i.e. aux Media Gateways) dune part, et les Media Gateways entre elles dautre part.
Couche Contrle
Bases de donnes
Service Capability Servers
Serveur d'appel Contrle, sparation des fonctions d'un commutateur traditionnel => Chapitre 3.4 SGW/ MGW MGW
Interconnexions rseaux tiers (RTC, Internet, rseaux NGN)
Rseau de transport
Couche Transport mutualis en mode paquet
=> Chapitre 3.3 MGW
Rseau d'accs
Accs fixe
Accs sans fil
Accs mobile
Figure 3 : Architecture physique dun cur de rseau NGN (Source : Arcome)
Autorit de rgulation des tlcommunications
33
3.3.1 Introduction
Tout dabord, avant daborder ce chapitre, une distinction doit tre faite, dans un rseau de transport (ici appel couche transport ), entre le niveau rseau de transmission et le niveau rseau de commutation : Le rseau de transmission correspond au rseau physique de liens et de nuds qui dessert une zone (un immeuble, une ville, une rgion, un pays ou un continent). Le rseau de commutation correspond certains nuds qui permettent dacheminer une communication travers le rseau de transmission en fonction de sa destination. Dans les architectures traditionnelles, un oprateur possde (ou loue) un rseau de transmission sur lequel sappuient en gnral plusieurs rseaux de commutation, lun ddi la commutation de la voix, lautre ddi la commutation de donnes. Lide qui sous-tend les NGN est de fusionner ces deux rseaux en un seul.
Le problme est donc le suivant : les techniques utilises en grande majorit dans les rseaux de transmission et de commutation pour le transport des flux voix ont t optimises pour cet usage ? Comment faire voluer ce rseau pour mieux ladapter rseau de transport et de commutation de donnes ? Ce chapitre tudiera les tendances de choix techniques venir pour la mise en uvre de ces rseaux de transport de nouvelle gnration . On peut mettre en vidence deux volutions majeures des rseaux de transport : Concernant les rseaux de transmission, comme on la dj remarqu, les techniques dominantes sont remises en cause. En effet, le multiplexage TDM (Time Division Multiplexing), utilise en grande majorit dans les rseaux actuels, est une technique de transmission adapte pour la commutation de circuits. Or le rseau de commutation de paquets sappuie (surtout en priphrie) majoritairement une transmission TDM, qui na pas t conue pour cela. La tendance actuelle est de migrer les rseaux de transmission actuels vers un rseau de transmission unique, neutre, voire favorable la commutation de paquets. Les rseaux de commutation sont lobjet de grands projets de dploiement. En effet, concernant la commutation de la voix, la technique utilise reste trs largement la commutation de circuits. La base de commutateurs installs est norme, volue assez peu, et rend un service parfaitement adapt ce qui lui est demand (la tlphonie de point point). Dun autre ct, la commutation de donnes utilise des techniques de commutation de paquets qui permettent, entre autres, dconomiser de la bande passante par rapport lutilisation dune commutation de circuits. L encore, les rseaux de commutation de paquets rendent avec efficacit des services de consultation de base de donnes, de messagerie, etc. La solution dutiliser les rseaux de commutation de circuits comme rseau de commutation unique ayant dj t voque et teste ( travers lexprience du RNIS), puis abandonne face des limitations techniques rdhibitoires, la solution du rseau de commutation de paquets sest alors impose. La tendance actuelle est donc de dvelopper un rseau de commutation unique, sappuyant sur lactuel rseau de commutation de paquets, qui permettrait de transporter tout type de trafic (voix, vido, donne, etc.).
Toute la question est alors : quelles sont ces tendances en termes de choix technologiques autour des rseaux de commutation de paquets et de transmission en vue de leur faire supporter tout type de trafic ?. Pour rpondre cette question, une tude des rseaux de transport actuels est tout dabord ncessaire. Ce chapitre abordera ensuite les tendances qui se dessinent pour les annes venir.
34
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.3.2 Les rseaux de transport actuels
Si lon visualise les technologies en jeu en sappuyant sur le modle en couches OSI (Open System Interconnection), la sparation entre rseau de transmission et rseau de commutation est trs nette. Le schma ci-dessus visualise la structure en couches qui modlise actuellement un rseau doprateur :
Voix
Vido
Donnes
IP
ATM Frame Relay
MPLS PoS
G-MPLS
Ethernet
SDH / PDH
WDM Cuivre Fibre optique
Coax
Figure 4 : la structure en couches actuelle utilise dans les rseaux WAN, RAN et MAN (Source : Arcome)
Note : Lacronyme PoS (Packet over SDH) dsigne la commutation IP sur TDM.
3.3.2.1 Evolutions en cours dans les rseaux de transmission actuels
On distingue communment dans un rseau de transmission les diffrents niveaux de desserte gographique suivants : Le LAN (Local Area Network) qui concerne un immeuble, un groupement dimmeubles ou un campus. La boucle locale, qui permet datteindre le client, dite aussi rseau daccs . Le MAN (Metropolitan, Area Network) qui dessert un quartier ou une ville. Le RAN (Regional Area Network) qui couvre une communaut urbaine ou une rgion. Le WAN (Wide Area Network) qui parcourt un pays ou un continent.
Cette partie sintressera aux trois derniers segments, le WAN, le RAN et le MAN.
Autorit de rgulation des tlcommunications
35
Les rseaux de transmission longue distance (WAN) et rgionaux (RAN) Concernant les rseaux de transmission longue distance et rgionaux actuels, on peut en dgager les caractristiques suivantes : Concernant le mdium physique, la fibre optique est largement utilise. Concernant le multiplexage, plusieurs tendances se dgagent : ! Le multiplexage TDM sest impos largement dans tous les rseaux WAN et surtout RAN des oprateurs. Ce multiplexage ncessite de hirarchiser les dbits au sein du rseau. Les hirarchies SDH (Synchronous Digital Hierarchy) et PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) ont t normalises au niveau europen ; en effet, cette normalisation facilite grandement linterconnexion des rseaux de transport de deux oprateurs par une taille normalise des tuyaux interconnecter. Cette hirarchie offre des dbits granulaires allant de 2 Mbit/s (dans les MANs) 10 Gbit/s (dans les WANs). ! Avec lapparition de la technologie POS (Packet Over SDH/Sonet), les rseaux SDH peuvent vhiculer de manire isole des conduits de trafic circuit et paquet. Le SDH na donc pas vocation disparatre court terme. Le multiplexage WDM (Wavelenght Division Mulitplexing) sest impos dans les rseaux WAN de longue ou trs longue distance. Cette technique multiplexe des longueurs donde diffrentes. Elle permet dobtenir des dbits trs levs de lordre du Tbit/s. Ce multiplexage est le plus souvent rserv des rseaux continentaux ou intercontinentaux, et encore peu utilis sur des artres nationales ou rgionales. En gnral, des flux TDM sont multiplexs, un flux tant associ une longueur donde.
Les rseaux de transmission mtropolitains (MAN) Concernant le mdium physique, la fibre optique est largement utilise, mais lutilisation de la paire de cuivre (analogue aux paires de cuivre aboutissant nimporte quelle habitation) et du cble coaxial est de plus en plus visible. Concernant le multiplexage, la hirarchie PDH est la plus utilise. Elle permet des dbits granulaires allant de 64 kbit/s 565 Mbit/s. On peut noter aussi lapparition de la technique Ethernet qui permet de dbits hirarchiss de 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s et 10 Gbit/s sur des distances de plus en plus grandes.
Inadquation entre les hirarchies PDH et SDH, et la commutation de paquets Il faut noter que les hirarchies numriques fondes sur le multiplexage TDM sont trs prsentes dans les rseaux de transmission doprateur, surtout en bordure de rseau ; mais elles sont contestes par une partie des organisations du monde Internet. En effet, les hirarchies normalises SDH et PDH sont issues dorganisations du monde des tlcommunications traditionnelles (lorganisation de normalisation IUT-T par exemple) qui ont fond leur travail de normalisation sur les profils de dbit quelles connaissaient, savoir, par exemple, un dbit de 64 kbit/s comme dbit de base pour le transport des communications voix. Le fait quune partie de la structure du rseau de transmission actuel soit adapte pour un rseau de commutation de circuits qui nen est maintenant plus le seul utilisateur du fait de la croissance du trafic de donnes est fortement contest, et des alternatives, qui seront tudies plus loin, sont ltude pour mieux adapter le rseau de transmission la commutation de paquets.
36
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.3.2.2 Evolutions en cours dans les rseaux de commutation de paquets actuels
Concernant les rseaux de commutation de paquets, plusieurs tendances se dgagent : La commutation IP (Internet Protocol), commutation de paquets en mode datagramme, est devenue la technique universelle et ncessaire linterconnexion de rseaux de commutation diffrents. De plus, elle se positionne maintenant en tant que commutation part entire , cest--dire quelle ne se rduit plus exclusivement linterconnexion de rseaux, mais elle peut aussi jouer le rle dune technique de commutation de paquets de bout en bout. La commutation IP est gnralise dans la version 4 du protocole. Alors quil y a quelques annes le routage IP (niveau 3) tait fortement utilis, les nuds de commutation modernes reposent maintenant de plus en plus sur une commutation de niveau 2 qui savre plus efficace. Les protocoles ATM (Asynchronous Transfer Mode) ou FR (Frame Relay) sont pour cela largement utiliss. Larrive de la commutation MPLS (Multiprotocol Label Switching) a renforc cette tendance. Cette technique a, entre autres avantages, celui de pouvoir crer des circuits virtuels afin de matriser lacheminement du trafic, et celui davoir des dlais dacheminement plus courts du fait de labandon de la gestion des procdures de mise jour de tables de routage, calcul de mtriques, dcouverte de rseau, etc... qui caractrisent le routage IP de niveau 3. Comme corollaire lextension de lusage de la commutation de niveau 2, la gnralisation de la commutation de paquets en mode circuit virtuel (commutations ATM, FR et MPLS) au dtriment de la commutation de paquets en mode datagramme (ou commutation IP). En effet, si la commutation de paquets en mode datagramme est ncessaire linterconnexion des rseaux, dans un rseau doprateur longue distance la commutation en mode circuit virtuel est plus rapide (elle permet doffrir une qualit de service au niveau rseau), plus souple dans la gestion des liens (pour crer un VPN, par exemple) et dans ce quon appelle le traffic engineering , cest--dire la gestion de la bande passante et de lacheminement du trafic sous contrainte.
Ainsi, on peut dgager plusieurs types de nud de commutation, utiliss actuellement dans les rseaux longue distance : Le commutateur ATM ou FR ; Le commutateur (appel plus communment routeur ) IP, par nature sans matrice de commutation ; Le commutateur MPLS.
Bien sr, un quipement physique de commutation peut offrir plusieurs types de commutation (IP, ATM, FR, MPLS.) Le schma suivant illustre des exemples de mise en uvre de diffrents types de commutation dans un rseau de donnes :
Autorit de rgulation des tlcommunications
37
Routeur IP Routeur IP Routeur IP Routeur IP
Rseau de commutation MPLS
Niveau RAN/ WAN
Rseau de commutation IP
Circuits virtuels Routeur IP
Routeur IP
Rseau de commutation ATM
Niveau LAN/ Boucle locale/ MAN
Rseau de commutation Ethernet
Circuits virtuels
Figure 5 : Exemples de commutation dans un rseau de donnes (Source : Arcome)
Concernant la couche rseau en environnement mtropolitain, la prsence de la commutation nest pas systmatique dans toutes les villes. Seul dans les grandes villes, un nud de commutation est prsent. Cependant, une tendance se dgage : par exemple, plutt que de gaspiller des liens sur PDH pour relier le client au premier commutateur disponible (dans la ville en question ou dans une autre ville plus importante), lutilisation dEthernet, jusqualors rserve aux rseaux locaux, est de plus en plus visible dans les MANs afin doffrir une commutation dans toutes les villes. Lacheminement du trafic au niveau 3 (IP) est donc remplac par un acheminement au niveau 2 (Ethernet). Cette technique a lavantage de rendre transparent le rseau WAN, de permettre de mettre en uvre simplement des VPN, dacclrer les temps de latence, et aussi davoir un cot de mise en uvre infrieur du fait de la grande maturit des produits Ethernet. En fait, cette solution est utilise pour permettre une commutation au plus prs du client, et par l lui fournir des services, comme le VPN, de bout en bout sur Ethernet.
3.3.2.3 Evolutions en cours dans les rseaux de commutation de circuits actuels
Dans le cadre des NGN, les rseaux de commutation de circuits tant progressivement amens tre abandonns au profit de la commutation de paquets, ce point ne sera pas trs dtaill. Fonctionnellement, la commutation de circuits na pas volu depuis longtemps. On constate dailleurs une grande stabilit fonctionnelle des commutateurs voix (peu voire plus dengagement des constructeurs et R&D sur ce type de produits). Les dploiements de commutateurs TDM des oprateurs sont marginaux (utilisation de surcapacit quipe et non exploite), ou contourns (ex. : paquetisation de la voix en ATM pour le transit). On peut mme anticiper des excdents de capacit chez les oprateurs voix (ex. : dcroissance du trafic voix au profit du trafic de donnes, dploiement des NAS derrire les commutateurs locaux librant de la capacit de transit circuit).
38
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Enfin, par une politique commerciale agressive et afin de conserver leur clientle, les constructeurs poussent au remplacement des anciens quipements renouveler pour cause dobsolescence par les gammes dquipements de nouvelle gnration, et ce des tarifs similaires voire infrieurs.
3.3.3 Les tendances des rseaux de transport dans le cadre des NGN
Cette partie tudiera tout dabord les volutions possibles au niveau transmission, puis abordera les volutions de la commutation, en prsentant en particulier une option, le GMPLS, qui concerne les deux niveaux.
3.3.3.1 Transmission : extensions du WDM et dEthernet
Dune faon gnrale, on assiste de nombreux dveloppements autour du multiplexage WDM. En effet, la technique TDM est plus lourde que la technique WDM : elle fonctionne en mode trame et oblige des oprations de multiplexage et de dmultiplexage assez lentes ; un rseau de transmission TDM est en gnral assez difficile administrer. De son ct la technique WDM permet dassocier chaque flux provenant dun lien une longueur donde. Cette technique vite les mcanismes fastidieux du TDM et apporte la souplesse du brassage de signaux optiques. Enfin, la technique TDM permet datteindre avec des performances raisonnables des dbits limits de lordre du Gbit/s, alors quavec le WDM, le Tbit/s est facilement atteint. De manire plus dtaille, plusieurs volutions lies loptique et au WDM se dgagent concernant les rseaux de transmission : Concernant les rseaux WANs continentaux ou intercontinentaux, la technique de multiplexage WDM est largement majoritaire. Concernant les rseaux nationaux, le WDM simpose doucement face la concurrence du TDM qui a lavantage dtre en place depuis longtemps et dont les quipements sont maintenant produits en grande srie, mais qui fournit des dbits limits par rapport aux besoins croissants. Concernant les RANs ou les MANs, la technique WDM y est encore peu prsente. Cependant, certains acteurs prvoient, en consquence de la baisse de prix et de lapparition de brasseurs et multiplexeurs WDM performants, lapparition progressive du multiplexage WDM dans ces zones. Le dveloppement du multiplexage dit CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing), technologie WDM simplifie permettant le multiplexage dun nombre restreint de longueur dondes (mais nanmoins suffisant pour un usage mtropolitain. Ex. : 4 longueurs donde) et ayant pour elle latout dune complexit moindre, donc de prix trs infrieurs au DWDM, va dans ce sens.
Si lusage du DWDM et de la commutation optique stend, ces techniques sont adaptes du trs haut dbit, donc encore chres. Cest pourquoi des versions plus basiques du multiplexage en longueur donde se dveloppent (le CWDM) : moins puissantes mais nettement moins chres, elles sont plus adaptes la desserte des boucles rgionales ou mtropolitaines. Par ailleurs, la location de plusieurs fibres optiques peut encore savrer dans certains cas moins coteuse pour un oprateur que lquipement dune liaison optique en WDM.
De nouveaux produits permettant une commutation optique directement en DWDM sont apparus rcemment. Ils devraient renforcer lattrait de la technologie car ils permettent de configurer de manire logicielle un brassage des longueurs dondes, sans intervention physique sur les quipements WDM. On pourra citer
Autorit de rgulation des tlcommunications
39
notamment dans ce domaine les constructeurs Lucent Technologies (leader) et Network Photonics (challenger). Exemples dutilisation du WDM : Loprateur Storm Telecommunications offre des liens interurbains europens (Paris Berlin, Paris Milan, etc.) un forfait mensuel fixe quel que soit le dbit demand. Cette offre sappuie sur un rseau de transmission WDM o la ressource rare est la longueur donde, qui peut alors supporter tout dbit. En effet, une fois une longueur donde immobilise par un client, que ce client demande un dbit de 155 Mbit/s ou de 10 Gbit/s, cette longueur donde est immobilise et nest plus revendable . De trs nombreux autres oprateurs utilisent aussi cette technologie, pour leurs besoins internes ou parce quils sont oprateurs doprateurs et grent des rseaux de trs haut dbit.
Le multiplexage en longueur donde dmultiplie considrablement les capacits de trafic vhicules sur une fibre optique. La dmocratisation de cette technologie rend dfinitivement caduque lapproche consistant valuer la capacit de transmission optique dun oprateur en fonction du nombre de fibres optiques utilises, et abaisse progressivement la valeur commerciale des infrastructures optiques fibre nue , qui ne sont plus considres comme des ressources rares (quand elles sont disponibles sur un trajet donn).
La technique Ethernet sur fibre optique a vocation se dvelopper dans les rseaux longue distance MAN, voire WAN, notamment travers le standard Gigabit Ethernet et bientt 10 Gigabit Ethernet, qui offre des dbits de lordre de plusieurs Gbit/s. On pourra citer des constructeurs tels que Nortel, Foundry Networks ou Atrica. La modulation DWDM devrait favoriser le dveloppement dEthernet pour ces usages, car elle permet le transport de l'Ethernet sur de longues distances et un dbit trs lev. Par ailleurs, le protocole MPLS, qui se gnralise dans les rseaux WAN (Cf. paragraphe suivant), est transparent aux protocoles LAN et apporte une flexibilit de gestion de la bande passante, ce qui en fait un support efficace pour les services dinterconnexion de LAN de manire transparente.
Exemples de dploiement dEthernet en cur de rseau : Yipes Communications (USA), Storm Telecommunications (Europe et USA) et Neos (UK) ont annonc le 19/02/02 un partenariat afin doffrir des connexions Gigabit Ethernet la demande internationales des dbits de 1 Mbit/s 1 Gbit/s entre les principaux centres daffaires europens et amricains. Le service Ethernet on-demand de Storm est dj disponible entre Londres, New York, Paris, Francfort et Amsterdam, et sera tendu 8 autres villes en 2002. Neos fournit des services similaires au Royaume-Uni sur son rseau DWDM/MPLS qui sappuie notamment sur des routeurs compatibles MPLS de Riverstone Networks (Daprs : MPLS World News). Level 3 Communications a annonc en dcembre 2001 avoir lanc son service de liaisons prives scurises Ethernet aux USA et en Europe (33 villes) (Daprs : MPLS World News).
Le dveloppement doffres de transport bases sur Ethernet reprsente des comptences nouvelles pour les oprateurs tlcoms. Sa simplicit de mise en uvre du point de vue de lutilisateur (transparence du WAN), ainsi que lextensibilit et la souplesse apportes par son association avec le WDM et MPLS pour loprateur
40
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
sont deux facteurs cl du succs venir de cette technologie. Mais surtout, Ethernet est invitablement associ au transport de flux IP, qui est le protocole de transport convergent des rseaux NGN.
3.3.3.2 Commutation : vers le MPLS puis le GMPLS 3.3.3.2.1 Diffusion progressive de la commutation MPLS
Suite ltude des rseaux de transport actuels, il apparat clairement que la commutation MPLS est une des techniques de commutation candidates pour simposer dans les rseaux de transport futur. Les principaux avantages de cette commutation sont les suivants : Larchitecture MPLS sappuie sur une commutation de paquets en mode circuit virtuel . Comme on la dj soulign, ce type de commutation est plus rapide quune commutation de paquets en mode datagramme de type IP avec une squence des trames MPLS respecte. Larchitecture MPLS a t taille sur mesure la topologie dadressage IP. Un plan contrle permet de grer les circuits virtuels de manire logicielle, sans administration manuelle lourde. Plus gnralement, la commutation MPLS est la plus adapte au transport des paquets IP.
Ce passage la commutation MPLS se fait de plusieurs manires, selon la nature de la base technique de commutation initialement installe chez loprateur : Si sa base de commutateurs repose sur des commutateurs ATM ou FR, ou des routeurs IP, une mise jour logicielle des commutateurs est possible pour les rendre compatibles MPLS. La plupart des constructeurs commencent proposer cette fonctionnalit dans les dernires versions de leurs logiciels. La mise en uvre rapide de MPLS peut par ailleurs savrer trs bnfique pour acqurir les comptences dans lutilisation et la gestion de MPLS avant que lutilisation de MPLS ne devienne un rel besoin pour loprateur. Enfin, loprateur peut dployer directement ou progressivement de nouveaux commutateurs MPLS natifs indpendants. Cest a priori la solution cible.
Le schma suivant montre un exemple darchitecture globale dun rseau de commutation MPLS.
Ainsi on peut prvoir (et on constate dj Cf. exemples de projets ou doffres commerciales ci-dessous) une diffusion progressive de la commutation MPLS dans les rseaux de transport.
Autorit de rgulation des tlcommunications
41
Rseau IP
Routeur IP compatible MPLS
Routeur IP compatible MPLS
Routeur IP compatible MPLS
Rseau de commutation ATM ou FR compatible MPLS, ou MPLS natif Rseau IP
Circuits virtuels MPLS Routeur IP compatible MPLS
Rseau IP
Rseau IP
Figure 6 : Exemple dun rseau de commutation IP/MPLS (Source : Arcome)
Quelques-uns des nombreux exemples de dploiement de MPLS : Equant fournira dans les 60 pays o il est prsent des services de tlphonie IP au cours du deuxime trimestre 2002. Le service de voix pour VPN IP est dj disponible. Equant est en mesure de fournir ces services voix grce son rseau global homogne et sa solution de VPN IP base sur MPLS, qui permet de traiter les flux voix et donnes avec des priorits diffrentes en utilisant des classes de services. Le rseau IP VPN dEquant bas sur la technologie MPLS de Cisco est le plus grand rseau de ce type dploy, avec une disponibilit dans 125 pays. La dcision de gnraliser le dploiement de MPLS dans le backbone IP dEquant a t prise en Juin 2000 (Daprs : MPLS World News). Teleglobe a annonc en Juin 2001 avoir achev la gnralisation de MPLS Packet over Sonet (PoS) dans son infrastructure de rseau IP global, avec des dbits pouvant aller jusqu OC-192. Cette volution amliore les temps de latence en simplifiant les couches rseau, et permet loprateur et ses clients de mettre en uvre un traitement du trafic bas sur les paramtres de qualit de service et la priorisation en fonction de classes de services (Daprs : MPLS World News). Tiscali a utilis des systmes Cisco pour lextension de son rseau IP pour laccs Internet commut et la voix sur IP en Italie. Le rseau a t tendu 14 nouveaux POP et la capacit du backbone a t double afin de permettre cette infrastructure de fournir la bande passante ncessaire pour fournir ultrieurement des services IP de nouvelle gnration comme les VPN bass sur MPLS, la qualit de service IP et la vide sur IP. Tiscali implementera aussi la technologie MPLS de Cisco dans son futur rseau IP multiservices au Royaume-Uni (Daprs : MPLS World News).
[] Due to the development of LambdaNet's network, the decision was taken very early to use MPLS as a basis for services instead of ATM. This choice was based on the scalability and the cost-effectiveness of MPLS technology, which leverage competitive advantages for LambdaNet in regards to its positioning in the Carrier's Carrier Market. MPLS deployment has been a positive and innovative answer to the crisis, by decreasing the cost of the network and increasing revenue opportunities. [] We have deployed, with Juniper's support, our MPLS network during
42
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
the first Quarter 2001. Our Layer 2 VPN offer, l-Net-Data-Link , was launched and ready for service on September 4th, 2001 and already, our first customers are up and running. (Source :
MPLS World News, Interview de Romain Delavenne, Directeur Marketing Lambdanet Communications France, Octobre 2001)
Cable & Wireless a annonc en Dcembre 2001 avoir mis en service une liaison transatlantique OC-192 utilisant MPLS et raccordant 7 villes aux USA, en Europe et au Royaume-Uni, ce qui constitue la premire tape dune volution globale de son rseau IP entre les villes de Washington, New York, Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Francfort. Le rseau IP globald e Cable & Wireless sappuie sur des routeurs MPLS de Juniper, qui fournissent des services intelligents de routage MPLS et de commutation 10 Gbit/s (Daprs : MPLS World News). Level 3 prvoit de fournir des services ATM et Frame Relay bass sur MPLS dbut 2002. (Daprs : MPLS World News)
3.3.3.2.2 Les fonctions offertes par MPLS
Cette technique offre plusieurs fonctions, qui sont autant darguments favorables larchitecture MPLS pour supporter tous types de flux applicatifs :
La qualit de service
Au niveau de la qualit de service, la norme Diffserv (Differentiated Services) a dfini un ensemble de niveaux de qualit de service qui permettent de mettre tous les acteurs dun rseau (oprateurs, fournisseurs daccs, utilisateurs, etc.) daccord sur des niveaux de service communs. Au niveau du transport, cela se traduit par lapplication un des champs dune trame MPLS de ces valeurs de qualit de service, qui dfinissent alors les trames prioritaires et le traitement adapt ces trames par un commutateur MPLS. Diffserv sappuie sur les modles mathmatiques des files dattente et est plus simple que sa concurrente Intserv (Integrated Services), qui est trop ambitieuse (allocation dynamique de ressources rseau avec une notion dappel) et ne favorise lextensibilit du rseau auquel elle sapplique. De plus, la commutation MPLS permet un contrle de congestion beaucoup plus fin que la commutation IP classique.
Lingnierie de trafic
La commutation MPLS rend possible une ingnierie de trafic performante (optimisation de la capacit disponible en transmission et commutation), qui nest pas possible actuellement en commutation IP.
La diffusion
La commutation MPLS permet facilement de crer des services de diffusion par la cration de circuits virtuels MPLS de point multipoint associs une adresse IP de diffusion.
La scurit
Au niveau de la scurit, le simple fait que la commutation MPLS utilise des circuits virtuels garantit la scurit. De plus, sur un rseau public, IPsec garantit lui aussi la scurit. Cette volution se fera car le protocole IPsec, situ juste en-dessous du protocole IP, permet une gestion souple de la scurit pour tout type dapplications.
Le plan de contrle cration de circuits virtuels
En regard du dveloppement de la commutation de paquets en mode circuit virtuel , la question de la signalisation se pose pour la cration de ces circuits. Si, en ATM, cette signalisation existe et est bien matrise, en MPLS, la signalisation utilise un mcanisme original, parfaitement adapt la structure des rseaux Internet.
Autorit de rgulation des tlcommunications
43
Comme en ATM, la norme MPLS dfinit un plan contrle et un plan usager . Le plan usager fonde la commutation MPLS classique. Le plan contrle utilise quant lui des protocoles de signalisation qui permettent de configurer, de faon dynamique, des circuits virtuels. La possibilit technique de leur cration est spcifie dans la norme travers le protocole de signalisation RSVP (Ressource ReserVation Protocol). Associ aux mcanismes de qualit de service Diffserv, la signalisation RSVP permet de crer la demande des circuits virtuels et de leur associer un niveau de qualit de service.
Ce plan contrle permet loprateur, de crer dynamiquement et de manire logicielle des circuits virtuels par dfaut entre routeurs externes au rseau MPLS. Cette souplesse, que lon ne trouve pas dans la commutation ATM, facilite grandement lvolution de la configuration physique du rseau (interconnexion un autre rseau ou ajout dun nouveau client par exemple).
3.3.3.2.3 Du MPLS au GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching)
Des constructeurs de commutateurs IP et MPLS travaillent sur la gnralisation du plan de contrle tous les nuds du rseau, incluant les nuds de transmission. Cette ide permettrait de configurer les circuits virtuels entre commutateurs MPLS, mais aussi de configurer (ou de reconfigurer) les liens entre des nuds de multiplexage TDM ou WDM. Un rseau de transmission, compos de brasseurs et de multiplexeurs TDM ou WDM se configurerait alors sous le contrle du plan contrle MPLS. Ce schma montre la structure en couches qui modlise un rseau WAN ou RAN doprateur qui opterait pour une solution MPLS en commutation et WDM en transmission :
Voix, donnes, video, etc IP G-MPLS WDM Fibre optique
Figure 7 : La structure en couches dun rseau NGN WAN ou RAN fond sur une solution GMPLS / WDM (Source : Arcome)
Ce schma montre un exemple de reconfiguration dun rseau de transmission WDM sous le contrle dun rseau de commutation GMPLS :
44
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Commutateur MPLS
Fibre optique Une longueur d onde
1- ce lien est trop occup
Brasseur WDM
2- Reconfiguration par le plan contrle du chemin pris par la longueur d onde
Figure 8 : Exemple de reconfiguration dun rseau de transmission WDM sous le contrle dun rseau de commutation MPLS (Source : Arcome)
Cette solution apporterait une grande souplesse de gestion et une grande volutivit du rseau de transport, qui sadapterait parfaitement au profil de son trafic actuel et futur, tant au niveau de la commutation (ce quil fait dj avec la commutation MPLS), quau niveau de la transmission.
On peut dores et dj imaginer quelques exemples de nouveaux services optiques pouvant tre apports par GMPLS : la gestion dynamique de longueurs donde, la reconfiguration automatique de rseau en fonction des besoins de trafic, les VPN optiques dynamiques, la restauration automatique de la transmission optique, etc. Ainsi, des jeunes pousses amricaines comme Caspian Networks ou Village Networks proposent des solutions matrielles fondes sur une architecture mixte MPLS et WDM.
On peut cependant prvoir que, compte tenu de la rvolution induite par cette architecture et du relatif manque de maturit de cette technique, les oprateurs ne commenceront pas dployer des architectures GMPLS avant au moins 5 ans (2006).
Avis doprateurs sur GMPLS :
[]
In the long run, Equant is planning to support multiple types of switching including packet switching, TDM, wavelength and fiber switching. GMPLS will allow us to take up these challenges. On top of IP and MPLS, GMPLS will bring intelligence to the optical network. For example, it will allow for automatic network topology discovery and route circuits (whether SONET/SDH framed circuits, wavelengths, bundle of wavelengths, fibers) based on constraints specified by the operator. Network operators will simply have to provision circuits without thinking about wasting bandwidth. As GMPLS spans all layers and distributes the intelligence, it unifies all layers in an overlay or peer model with a standard based, universal control plane. This will allow us to define a global Protection &
Autorit de rgulation des tlcommunications
45
Restoration strategy with various link protection capabilities being advertised throughout the network using GMPLS extensions to IGP, and intelligent routing decisions being made on the spot. [] Besides all the benefits GMPLS will bring in terms of operation and management simplification, and its great potential for new services, it also introduces a new challenging way to control, operate and secure optical networks, which may frighten some operators. [] GMPLS isn't mature yet, and not even fully specified. Work is going on at the IETF with a draft currently complemented to cover all aspects regarding routing and signaling in a unified multi-layer environment. Some pieces exist and can already be demonstrated, but in a proprietary implementation only. (Source : MPLS World News, extraits de linterview de Didier Duriez, Chief Engineer, Customer Service & Network Group, Equant, Nov. 2001).
[] As long as GMPLS is not ready for deployment commercially, it is difficult to express final statements. However, looking ahead, GMPLS is clearly the next step for us after the deployment of MPLS. Moreover, as LambdaNet is an actor in the Carriers Market, it has to face the transportation and the management of very high capacities. In regards with this challenge, the introduction of GMPLS is a necessity in the following years. For this reason, we are evaluating this technology with our suppliers. (Source : MPLS World News, Interview de Romain
Delavenne, Directeur Marketing Lambdanet Communications France, Octobre 2001).
3.3.3.3 Commutation : persistance de la commutation ATM
Lvolution actuelle des rseaux daccs influence le dveloppement du rseau de transport. Un certain nombre de faits est notable pour lavenir du rseau de transport :
La technique daccs DSL, appele un large dploiement, utilise pour la gestion de sa bande passante la commutation ATM. En DSL, un circuit virtuel permanent est cre entre le DSLAM (qui est en gros un commutateur ATM unidirectionnel ) et le BAS (Broadband Access Server), qui offre les fonctions dites AAA (Authentication, Authorization, Accounting). De mme, larchitecture daccs BLR utilise pour la gestion de sa bande passante et le transport des donnes la commutation ATM. Les constructeurs de tlcommunications proposent des architectures UMTS de bout en bout aux oprateurs, incluant un rseau de transport. La plupart de ces constructeurs ont nou des partenariats avec des acteurs de monde Internet, proposant des routeurs IP et commutateurs MPLS, pour le cur des rseaux UTMS. Cependant, la norme UMTS spcifie dans ses premires versions, elle aussi, lutilisation de la commutation ATM en accs pour la gestion de la bande passante et le transport de la voix.
Cette utilisation assez large dATM dans les nouveaux rseaux daccs pose donc la question de la concurrence ventuelle entre les deux techniques de commutation ATM et MPLS en cur de rseau.
Un fournisseur daccs DSL ou BLR, sil a choisir entre deux oprateurs longue distance, lun offrant un transport sur ATM, lautre offrant un transport sur MPLS, ne choisira-t-il pas le premier plutt que le second ? En effet, des services comme le VPN ou la voix sur DSL (VoDSL), qui permet doffrir sur la ligne DSL le transport la fois de la voix et de la donne, pourront alors utiliser directement les mcanismes de cration de circuits virtuels ou de qualit de service de lATM. De mme, il semblerait que lUMTS favorise la polarisation du march des commutateurs de rseau long distance autour des techniques ATM et MPLS, mais sans en favoriser aucune. Rappelons cependant que la technologie MPLS ne se limite pas tre une technologie concurrente dATM. Lobjectif initial de MPLS tait de simplifier lintgration dATM et des routeurs. Ainsi, un oprateur peut trs bien implmenter le protocole MPLS au-dessus dATM afin de bnficier de ses services dingnierie de trafic.
46
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Toujours dans cette mme optique de recherche dhomognit, un oprateur dont le trafic est lorigine (en sortie du rseau daccs) majoritairement ATM ne verre pas forcment dintrt migrer vers un rseau IP natif, et sera enclin conserver une pine dorsale ATM.
Ainsi, pour mieux connecter des clients accds par DSL ou BLR, et face larrive de lUMTS ou encore afin de conserver une certaine tanchit entre des flux pour en simplifier la gestion, il semble que certains oprateurs conserveront encore pour plusieurs annes une commutation ATM dans leurs rseaux de transport.
Exemples de maintien dATM dans les rseaux de transport : Sprint (USA) a annonc dbut 2002 quil allait renforcer son rseau ATM pour transporter les flux de services, de plus en plus nombreux en accs, en voix sur IP. Fin 2002, Sprint a annonc lattribution dun contrat Nortel pour lvolution de son rseau de tlphonie locale (3,6 millions de lignes) vers une technologie paquet NGN. Cette volution, qui doit commencer en Janvier 2003, stalera sur 4 ans. Elle sappuiera sur des technologies softswitch et ATM. (Daprs diffrents communiqus de presse de Sprint). Un reprsentant de loprateur KPNQwest prsent lors de la confrence de Novamdia sur les NGN du 29 au 31 Janvier Paris a par ailleurs exprim la stratgie de KPNQwest, et affirm que loprateur ne fusionnerait pas les couches physique et transport (via ladoption de MPLS directement sur WDM ou fibre optique), mais conserverait une couche ATM ou SDH pour des questions de robustesse de rseau et de simplicit de gestion de flux (isolement complets de certains flux de nature diffrente). (Daprs KPNQwest, Confrence Novamdia)
Les choix stratgiques des constructeurs confirment que cette tendance est bien relle. Il y a en effet un partage entre certains quipementiers qui dlaissent le march de lATM pour se concentrer sur la fourniture de solutions de migration rapide vers IP / MPLS (ex. : Lucent) et dautres qui continuent dinvestir dans ce domaine, et pensent que les oprateurs conserveront un cur de rseau ATM, tout en migrant en douceur vers IP / MPLS (ex. : Alcatel, Nortel).
Avis dexperts : Nous prvoyons une stagnation des quipements de cur de rseau IP, avec un march en baisse de 3% en 2002, estime ainsi Jean-Charles Doisneau, de l'Idate. Paralllement, le secteur des commutateurs de cur de rseau ATM devrait progresser de plus de 15 % cette mme anne (Source : Rseaux & Tlcoms, 23/11/01).
Autorit de rgulation des tlcommunications
47
3.3.3.4 Commutation IP : migration dIPv4 IPv6
3.3.3.4.1 La commutation IP actuelle (IPv4)
Le protocole IP a connu plusieurs versions successives au cours de sa normalisation et la version qui est utilise dans le monde entier est la version 4 (on parle de protocole IPv4). Len-tte dun datagramme IPv4 contient peu dinformations ; entre autres, il contient :
Les adresses source et destination ; Un champ ToS (Type of Service) qui est utilis par des mcanismes de qualit de service.
3.3.3.4.2 DIPv4 IPv6 : les volutions cl
Pour amliorer ce protocole, une version 5 puis 6 ont t normalises lIETF (Internet Engeeniring Task Force), lorganisme de normalisation de fait des techniques de lInternet. La version 6 est actuellement ltat de norme et fait lobjet dun consensus gnral propos de ses amliorations et de son applicabilit. Les principales amliorations sont les suivantes :
Lamlioration du champ ToS - renomme CoS pour Classe of Service dans len-tte du datagramme et lajout dun champ identifiant de flux. Lintgration par dfaut du protocole de scurit IPsec (Internet Protocol Security). IPsec fournit un service de scurit la couche transport (et donc toutes les applications). Une nouvelle dfinition des adresses de diffusion, ainsi que lintgration par dfaut et lamlioration des mcanismes de traitement de ces adresses au niveau des commutateurs. Cette fonction sera particulirement favorable aux nouveaux services multimdia de diffusion de contenu. Lintgration par dfaut et lamlioration du protocole de mobilit Mobile IP (Mobile Internet Protocol) qui permet la mobilit, via lutilisation dune adresse IP temporaire associ ladresse IP fixe du mobile et dun mcanisme dencapsulation.
Il faut noter que tous ces mcanismes sont aussi possibles en IPv4, mais ny sont pas inclus par dfaut et ont t lgrement amliors en IPv6.
Toutes les fonctions dIPv6 sont disponibles en version 4 par une mise jour logicielle du routeur ou du terminal. Par exemple, le protocole Mobile IP est possible en IPv4 par une mise jour des routeurs et des terminaux concerns. Ce protocole a t lgrement amlior dans sa nouvelle version.
La diffusion massive du protocole IPv6 permettrait dans le mme temps de diffuser dune manire gnralise et normalise les fonctions dcrites ci-dessus.
En revanche, un intrt majeur dIPv6 et incontournable par rapport IPv4 rside dans son plan dadressage qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus granulaire. Le passage des formats dadresses IP de 32 128 bits agrandit lespace dadressage disponible. Il permet aussi de crer de nombreux niveaux hirarchiques dans ladressage des rseaux et ainsi doptimiser le routage.
Le nouveau plan dadressage IPv6 permettra de rsoudre le problme de manque dadresses IP dans le monde dans les prochaines annes ou dcennies selon les rgions du monde.
48
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Constructeurs dquipements IPv6 La plupart des constructeurs dquipements IP tablis fournissent maintenant des produits compatibles IPv6. Cependant, cette nouvelle version du protocole peut tre loccasion dun certain renouvellement du march avec lmergence de nouveaux acteurs, comme 6Wind, spcialis dans la conception et la commercialisation de routeurs daccs IPv6.
3.3.3.4.3 DIPv4 IPv6 : la migration
Le protocole IPv6 est soutenu par de nombreuses autorits publiques pour des raisons de politique la fois technique et conomique :
En Asie, lorganisme APNIC (Asia Pacific Network Information Centre), organisme sous lautorit de lIANA (Internet Assigned Names Authority), a pour rle de grer lallocation dadresses IP dans la rgion Asie / Pacifique qui inclue la Chine, lInde, la Japon et la Core du Sud par exemple. Sur les 5 milliards dadresses IPv4 disponibles, environ 100 millions dadresses (2 % du total) ont t alloues lAPNIC pour une rgion reprsentant plus de la moiti de la population mondiale. Particulirement en Core du Sud et au Japon, la pnurie dadresses IP est sensible et le lancement de services Internet sur les tlphones mobiles y renforce cette crainte. Les gouvernements de cette rgion du monde mettent en place des politiques incitatives vis--vis des organisations conomiques et universitaires pour tester et utiliser le protocole IP dans sa version 6 plutt que dans sa version 4. Aux Etats-Unis, lorganisme ARIN (American Registry for Internet Numbers), organisme sous lautorit de lIANA, a pour rle de grer lallocation dadresses IP dans la rgion Amrique et Afrique Subsaharienne. Prs de 4 milliards dadresses ont t alloues lARIN et les autorits publiques de cette zone et les contraintes techniques ou conomiques ne semblent pas pousser vers une migration des rseaux vers lIPv6. En Europe, lUnion Europenne, qui regroupe 15 pays, voit dans IPv6 un moyen de prendre un avantage technique et conomique sur les Etats-Unis par la diffusion rapide dune technique qui pourrait tre le moteur dune dynamique conomique europenne dans le domaine des tlcommunications. On pourra se rfrer au chapitre 4.6 qui dcrit notamment le primtre de lIPv6 Task Force, et les actions rcentes de la Commission Europenne afin de favoriser le dveloppement rapide dIPv6 en Europe.
La crainte dune pnurie rapide dadresses IPv4 est moins sensible en Europe quen Asie, lorganisme RIPE (Rseaux IP Europens) stant vu allouer un grand nombre - 1 milliard - dadresses. En fait, il semble que ce sera principalement larrive prochaine de lUMTS qui pourrait forcer la migration des rseaux en gnral et les rseaux de transport en particulier - vers IPv6, dans loptique de pouvoir allouer chaque terminal une adresse IP fixe. Cette migration se fera donc aussi au niveau des rseaux de transport.
Autorit de rgulation des tlcommunications
49
Exemples de migration vers IPv6 : Loprateur sudois Telia a annonc quil allait faire migrer son rseau internet vers IPv6 pour tre prt rpondre aux besoins des oprateurs et ISP (et notamment mieux supporter les flux provenant des futurs systmes UMTS), ainsi quaux demandes des organismes de R&D. Loffre initiale sera un pur service de transport avec un accs fixe, restreint un nombre limit dutilisateurs. Telia affiche la volont dtre le premier oprateur europen fournir un service commercial IPv6. La premire phase de cette migration a t acheve mi-2001. (Daprs : Telia, communiqu de presse du 6 Juin 2001). Quelques oprateurs comme BT ou NTT exprimentent et testent depuis plusieurs annes IPv6 et les problmatiques de cohabitation avec IPv4. Les organismes de gestion de rseaux acadmiques ont galement test ces techniques de coopration IPv4 et IPv6. Si les tests se droulent d'abord dans un primtre national, l'interconnexion des backbones IPv6 s'organise au sein du consortium exprimental 6Bone (IPv6 backbone). (Daprs : Rseaux & Tlcoms). En Asie, loprateur chinois Smartone, oprant Hong-Kong, a ralis, avec la collaboration de BT Wireless et Ericsson fin 2000, un test grande chelle de services Internet sur un rseau accs mobile utilisant la technique IPv6. Nous avons essay dutiliser IPv6 sur des rseaux accs mobile tels que les rseaux locaux sans fil et les rseaux cellulaires tendus. Des essais ont t conduits pour des applications reposant sur IPv6 sur un cur de rseau GPRS. Dautres scnarios comme litinrance, linterconnexion IPv4 / IPv6 ont t tests , prcise Chrix Fenton, directeur dveloppement et test des services 3G. Cet essai facilitera aussi le dveloppement dune nouvelle gnration dappareils mobiles qui offriront des services nouveaux fonds sur une vritable qualit de service rendue possible par ladoption de la technique IPv6 , dit Ulf Ewaldssson, directeur technique adjoint chez Ericsson. (Daprs : Ericsson, communiqu de presse du 14 Novembre 2000).
Ainsi on peut prvoir un dbut de diffusion massive du protocole IPv6 dans la zone Asie / Pacifique (zone regroupant, entre autres, la Chine, lInde, le Japon, la Core du Sud et lAsie du Sud-Est) rapidement, cest--dire ds lanne 2003. Il est en revanche plus difficile de se prononcer pour les autres zones car mme larrive de lUMTS en Europe ne permet pas de se prononcer dfinitivement et formellement sur la date de ncessit de migration vers IPv6 pour des questions de limitation dadressage. En effet, les mcanismes dallocation dadresse IP dynamique ou de translation dadresse (NAT) actuellement utiliss, qui permettent de diminuer le nombre dadresses IP ncessaires pour connecter une population, ne trouveront leurs limites que si lusage des services UMTS se dveloppe massivement, ce dont un certain nombre dacteurs doutent encore ce jour. Par ailleurs, lintgration dIPv6 en natif dans la norme UMTS nest prvue que dans la phase 2 (release R5, Cf. chapitre 3.4.7) et la disponibilit des offres matrielles conformes cette version de la norme, comme la vitesse de transition des oprateurs UMTS vers cette nouvelle architecture, sont incertaines.
Il est donc probable que le besoin rel dIPv6 en Europe se situera plutt autour de 2004-2005, voire plus tard en fonction de la rapidit de lessor de lUMTS.
50
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Cependant, il est indispensable pour tous les acteurs danticiper cette volution vers IPv6 en adoptant au plus vite des mesures conservatoires :
Notamment, il semble raisonnable dliminer progressivement les quipements IP qui ne sont pas compatibles avec IPv6 (cest--dire, qui ne peuvent pas voluer par simple mise jour logicielle pour supporter des services IPv6) pour les remplacer par des quipements IP ayant une capacit de gestion de flux mixtes IPv4 / IPv6, et/ou de migration complte vers IPv6. En effet, il suffit que certaines catgories dacteurs du rseau Internet migrent en IPv6 pour que, potentiellement, tous les autres acteurs soient impacts et aient traiter des problmatiques dinterfonctionnement entre IPv4 et IPv6. La plupart des fabricants de routeurs disposent du logiciel IPv6 pour leurs produits. Certains ont mme annonc, voire commenc livrer des produits intgrant IPv6 en standard. Par ailleurs, tous les acteurs doivent, en prparation cette chance, acqurir des comptences sur IPv6 et sur les solutions de gestion dinterfonctionnement entre IPv4 et IPv6. Do limportance des programmes dexprimentation en grandeur relle, largement promus par la Commission Europenne (Cf. chapitre 4 Normalisation). La cohabitation avec IPv4 implique en effet la mise en oeuvre d'une batterie de mcanismes de transition. Le premier dispositif, dnomm DSTM (Dual Stack Transition Mechanism), mise sur la gestion d'une double pile IP. Le second repose sur l'encapsulation des paquets IPv6 dans ceux d'IPv4 ; des lots IPv6 s'interconnectent alors travers une infrastructure IPv4. Un troisime mcanisme prconise une conversion des en-ttes IP au format IPv6.
Il est certain qu terme, cette migration sera ncessaire, ne serait-ce que pour simplifier le routage IP. Cependant, la migration complte vers IPv6 promet dtre trs longue. Certains acteurs doutent mme de la faisabilit de cette convergence. Notons cependant que lvolution vers IPv6 est indpendante de lvolution vers une architecture de rseaux et services NGN en couches spares et de lintroduction des nouveaux protocoles de contrle dappel associs (SIP ou H.323).
3.3.4 En conclusion
En rsum, ils existent plusieurs tendances autour des rseaux de transport des oprateurs :
Lextension de lusage de la commutation optique, et du multiplexage en longueur donde (DWDM, CWDM) dans les rseaux de transmission tendus, y compris mtropolitains, au dtriment du multiplexage TDM. Lapparition de commutateurs Ethernet dans les rseaux longue distance mtropolitains, voire nationaux ou internationaux. Ces commutateurs permettent une connectivit de bout en bout en Ethernet ; Au niveau du rseau de commutation pour le transport du trafic IP, on peut anticiper la diffusion progressive des commutateurs MPLS, avec les tendances suivantes qui se dgagent :
Une tendance plus forte vers une commutation MPLS seule Une tendance moindre vers un rseau mixte ATM et MPLS (persistance dune commutation ATM, qui permettra une interconnexion avec les rseaux daccs fonds sur larchitecture DSL, BLR ou UTMS ). A plus long terme lapparition du GMPLS (MPLS sur WDM). Au niveau dun ventuel plan de contrle du rseau global de transport, le GMPLS propose une solution audacieuse, mariant le contrle des rseaux de commutation et de transmission. Cependant le GMPLS nest encore qu ltat de projet et ne
Autorit de rgulation des tlcommunications
51
devrait pas tre oprationnel avant quelques annes (5 ans selon lun des constructeurs dquipements de curs de rseaux de donnes interrogs dans le cadre de cette tude).
Lincertitude au sujet de la date dvolution de la commutation IP de sa version 4 actuelle vers sa version 6. La version 6 amliore des fonctionnalits dj existantes dans la version 4. Mais, mis part lAsie o la forte pnurie dadresses IPv4 va forcer les oprateurs migrer leurs rseaux, la date de migration dans le reste du monde reste incertaine.
Lobjectif de ces diffrentes volutions est de rpondre quatre impratifs : ladquation aux nouveaux besoins de services, le support de trs haut dbit, une garantie de qualit de service, et une gestion optimise du rseau de transport.
Impratif
Solution fonctionnelle
Technologie
IPv6 Adquation aux Plan dadressage tendu nouveaux besoins Fonctions de diffusion de services Amlioration de la gestion de la mobilit Trs haut dbit Multiplexage en longueur dondes Amlioration des performances des technologies LAN Garantie de Garantie de bande passante qualit de service Gestion de classe de service Extensibilit des rseaux Diminution des temps de latence Simplification du routage Gestion optimise Gestion de circuits virtuels du rseau de Simplification de gestion de rseau via transport un plan de contrle unifi Matrise des capacits du rseau ou ingnierie de trafic Flexibilit de gestion des ressources rseau DWDM, CWDM Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet MPLS ou ATM MPLS ou ATM IP commutation optique IPv6 MPLS et ATM MPLS et G-MPLS MPLS et G-MPLS MPLS, G-MPLS et dans une moindre mesure ATM
On peut pressentir des scnarios dvolution diffrents suivant les acteurs, lun sappuyant sur une commutation mixte ATM/MPLS, et lautre sur une commutation MPLS native.
Les oprateurs ayant une grosse base de commutateurs ATM et de routeurs IP, passeront lentement la commutation MPLS. Ils resteront longtemps sur une architecture mixte ATM / MPLS. La diffusion rapide des techniques daccs DSL renforce ce mouvement conservateur vis--vis de larchitecture native MPLS. En revanche, des nouveaux entrants, voulant profiter de la commutation de paquets en mode circuit virtuel , choisiront sans doute la commutation MPLS native. Parfaitement adapt au transport de lIP, ayant une gestion des circuits virtuels lui permettant de supporter des changements frquents de topologie et de profil de trafic (en anglais, on parle de scalable network ), la commutation MPLS sera clairement
52
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
favorise par rapport la commutation ATM. De plus, elle promet, travers ses mcanismes de qualit de service, de transporter de la voix et de la donne.
En synthse, les volutions cl au niveau Transport, dans le cadre des NGN, sont : - lvolution globale vers des technologies de transmission et de transport haut dbit, en mode paquet, avec une qualit de service adapte - la sparation des fonctions Transport et Contrle du cur de rseau. En effet, la notion de rseau de transport, au sens NGN, est plus large quau sens traditionnel. Elle inclut, en complment des liaisons physiques et de linfrastructure passive de transport, lapparition des fonctions Media Gateway et Signalling Gateway, qui effectuent la conversion et lacheminement du trafic et de la signalisation sous le contrle des serveurs dappel.
La sparation des fonctions Transport et Contrle du cur de rseau, et les nouveaux quipements quelle induit, est prsente dans le chapitre suivant 3.4.
Autorit de rgulation des tlcommunications
53
3.4 Vers un Contrle dappel en mode IP sur des serveurs ddis et une gestion indpendante des fonctions de transport
3.4.1 Introduction : Evolution des entits et protocoles du cur de rseau NGN 3.4.1.1 Principe gnral et vue densemble
Les principales caractristiques des rseaux NGN (Cf. chapitre 2 Dfinitions) sont lutilisation dun unique rseau de transport en mode paquet (IP, ATM,) ainsi que la sparation des couches de transport des flux et de contrle des communications, qui sont implmentes dans un mme quipement pour un commutateur traditionnel.
Ces grands principes se dclinent techniquement comme concernant les quipements actifs du cur de rseau NGN :
suit
1. Remplacement des commutateurs traditionnels par deux types dquipements distincts : dune part des serveurs de contrle dappel dits Softswitch ou Media Gateway Controller (correspondant schmatiquement aux ressources processeur et mmoire des commutateurs voix traditionnels), et dautre part des quipements de mdiation et de routage dits Media Gateway (correspondant schmatiquement aux cartes dinterfaces et de signalisation et aux matrices de commutation des commutateurs voix traditionnels), qui sappuient sur le rseau de transport mutualis NGN.
2. Apparition de nouveaux protocoles de contrle dappel et de signalisation entre ces quipements (de serveur serveur, et de serveur Media Gateway)
Le schma page suivante prsente le principe darchitecture physique dun rseau NGN.
54
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Serveurs dapplications
Passerelle de signalisation
Softswitch
MGC
Interfaces de service dapplication (API)
Rseau SS7
SIGTRAN SG
SIP H.323
MGCP H.248
Terminaux H.323/ SIP
RTC/ rseau mobile
Flux Mdia ( RTP /RTCP )
MG
Figure 9: Architecture simplifie des NGN (source Arcome)
Le prsent chapitre dtaille les diffrentes entits fonctionnelles dun cur de rseau NGN ainsi que les diffrents protocoles en concurrence pour le contrle dappel, la commande entre serveurs dappel et Media Gateways, et la signalisation de transit entre serveurs dappels NGN.
3.4.1.2 Les entits fonctionnelles du cur de rseau NGN
La Media Gateway (MG)
La Media Gateway est situe au niveau du transport des flux mdia entre le rseau RTC et les rseaux en mode paquet, ou entre le cur de rseau NGN et les rseaux daccs. Elle a pour rle :
Le codage et la mise en paquets du flux mdia reu du RTC et vice-versa (conversion du trafic TDM IP). La transmission, suivant les instructions du Media Gateway Controller, des flux mdia reus de part et d'autre.
La Signalling Gateway (SG)
La fonction Signalling Gateway a pour rle de convertir la signalisation change entre le rseau NGN et le rseau externe interconnect selon un format comprhensible par les quipements chargs de la traiter, mais sans linterprter (ce rle tant dvolu au Media Gateway Controller). Notamment, elle assure ladaptation de la signalisation par rapport au protocole de transport utilis (ex. : adaptation TDM IP). Cette fonction est souvent implmente physiquement dans le mme quipement que la Media Gateway, do le fait que ce dernier terme est parfois employ abusivement pour recouvrir les deux fonctions MG + SG.
Autorit de rgulation des tlcommunications
55
Les Gateways ont un rle essentiel : elles assurent non seulement lacheminement du trafic, mais aussi linterfonctionnement avec les rseaux externes et avec les divers rseaux daccs en ralisant : - la conversion du trafic (entit fonctionnelle Media Gateway), - la conversion de la signalisation associe (entit fonctionnelle Signalling Gateway).
Le serveur dappel ou Media Gateway Controller (MGC)
Dans un rseau NGN, cest le MGC qui possde l'intelligence . Il gre :
Lchange des messages de signalisation transmise de part et d'autre avec les passerelles de signalisation, et linterprtation de cette signalisation. Le traitement des appels : dialogue avec les terminaux H.323, SIP voire MGCP, communication avec les serveurs dapplication pour la fourniture des services. Le choix du MG de sortie selon l'adresse du destinataire, le type d'appel, le charge du rseau, etc. La rservation des ressources dans le MG et le contrle des connexions internes au MG (commande des Media Gateways).
Dans larchitecture des rseaux NGN, le serveur dappel, aussi appel Softswitch ou Media Gateway Controller (MGC) est le nud central qui supporte lintelligence de communication.
Modularit des implmentations physiques
Il est noter que la MG et le MGC sont des entits fonctionnelles et peuvent donc tre intgres dans un mme quipement mais aussi tre des lments indpendants ; cest le grand avantage apport par la dissociation des couches Contrle et Transport. La MG et la SG sont aussi des entits fonctionnelles spares, cependant elles sont souvent implmentes dans le mme quipement. Sur le plan de la localisation gographique des quipements, les Media Gateways peuvent tre par exemple rparties au plus prs du trafic (interconnexions, points de concentration vers les rseaux daccs), et les serveurs dappels peuvent tre groups sur un ou deux sites centraux. Les deux types dquipements communiqueront alors via le rseau de transport IP et le protocole de commande de Media Gateway. Le dimensionnement des gateways et des serveurs est aussi indpendant : si les gateways sont avant tout dimensionnes en fonction de la capacit de trafic couler, les serveurs sont, eux, dimensionns en fonction de la charge de traitement de communications supporter (tablissement de connexions, activit de mobilit des utilisateurs, etc.).
La dcomposition des fonctions du cur de rseau en couches et entits fonctionnelles indpendantes rend les constructeurs et les oprateurs plus libres sur limplmentation physique de ces fonctions dans les divers quipements, et leur localisation gographique. Elle permet aussi doptimiser les ressources, les diffrentes entits tant partages, mais pouvant tre dimensionnes sparment.
56
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.4.1.3 Les familles de protocoles dun rseau NGN
La convergence des rseaux voix/donnes ainsi que le fait dutiliser un rseau en mode paquet pour transporter des flux multimdia, ayant des contraintes de temps rel , a ncessit ladaptation de la couche Contrle. En effet ces rseaux en mode paquet taient gnralement utiliss comme rseau de transport mais noffraient pas de services permettant la gestion des appels et des communications multimdia. Cette volution a conduit lapparition de nouveaux protocoles, principalement concernant la gestion des flux multimdia, au sein de la couche Contrle. On peut classer les protocoles de contrle en diffrents groupes :
Les protocoles de contrle dappel permettant ltablissement, gnralement linitiative dun utilisateur, dune communication entre deux terminaux ou entre un terminal et un serveur ; les deux principaux protocoles sont H.323, norme de lUIT et SIP, standard dvelopp lIETF. Les protocoles de commande de Media Gateway qui sont issus de la sparation entre les couches Transport et Contrle et permet au Softswitch ou Media Gateway Controller de grer les passerelles de transport ou Media Gateway. MGCP (Media Gateway Control Protocol) de lIETF et H.248/MEGACO, dvelopp conjointement par lUIT et lIETF, sont actuellement les protocoles prdominants. Les protocoles de signalisation entre les serveurs de contrle (ou Media Gateway Controller) permettant la gestion du plan contrle :
-
au niveau du cur de rseau avec des protocoles tels que BICC (Bearer Independant Call Control), SIP-T (SIP pour la tlphonie) et H.323. linterconnexion avec les rseaux de signalisation SS7, gnralement via des passerelles de signalisation ou Signalling Gateways par lutilisation de protocole tel que SIGTRAN.
De plus, linterconnexion de ces rseaux de donnes avec les rseaux existants de tlphonie (TDM avec signalisation SS7) a ncessit le dveloppement de protocoles ddis linterconnexion des rseaux et au transport de la signalisation SS7 sur des rseaux en mode paquet.
3.4.2 Contrle dappel : deux protocoles candidats
Historiquement, la recommandation H.323 de lUIT est devenue le standard de base pour les communications voix sur les rseaux en mode paquet. Pratiquement tous les PC possdent par dfaut un terminal H.323 (Ex. : logiciel NetMeeting de Microsoft). Tous les constructeurs proposent des matriels annoncs conformes H.323. Cependant, bien quvoluant, H.323 est relativement pauvre au niveau des services offerts en comparaison de la tlphonie classique. La plupart des fournisseurs a donc dvelopp des protocoles propritaires permettant doffrir les services standards en tlphonie , ce qui limite linteroprabilit entre les quipements. De plus de nouveaux protocoles, apparus ces dernires annes (ex : SIP, MGCP) semblent plus appropris et sont soutenus par de nombreux constructeurs.
3.4.2.1 Le protocole historique : H.323
La recommandation H.323 de lUIT dcrit les procdures pour les communications audio et vido point point ou multipoint sur des rseaux en mode paquet. Cest une adaptation des procdures de vidoconfrence sur RNIS (H.320) aux rseaux sans garantie de service. Plusieurs entits sont ncessaires la ralisation dun service de communication multimdia sur des rseaux de donnes :
Autorit de rgulation des tlcommunications
57
Les terminaux H.323 sont des systmes multimdia (tlphone, PC) permettant de communiquer en temps rel . Le gatekeeper gre les terminaux H.323 (identification et traduction dadresses) et les tablissements dappels La passerelle H.323 (gateway) permet dinterfacer le rseau IP avec le rseau tlphonique classique. Lunit de contrle MCU (Multipoint Controller Unit) gre les connexions multipoint (ex. : appels de confrence). Il se dcompose en un Multipoint Controller (MC), affect la signalisation, et un Multipoint Processor (MP), ddi la transmission proprement dite.
Gatekeeper Passerelle H.323/RTC
Terminal H.323
Rseau en mode paquet
Rseau de commutation de circuits
MCU
Terminal H.323
MCU
Figure 10 : Architecture H.323 (Source Arcome)
3.4.2.1.1 Les terminaux H.323
Les terminaux sont des clients dans un rseau H.323. Ce sont des systmes daudio (Tlphone IP, PC) ou de vido confrence utiliss pour communiquer en temps rel. Le standard H.323 requiert que chaque terminal supporte un certain nombre de fonctions et de codeurs qui ont t dfinis par lITU, tels que :
H.225, qui effectue la signalisation des appels et la synchronisation. H.245, qui est le protocole utilis pour lchange des capacits entre les terminaux, la ngociation de canal et le contrle de flux mdia entre les terminaux H.323. Q.931, qui est un protocole de signalisation pour tablir et clore les appels. RAS (Registration/Admission/Status) Channel, qui est utilis par les terminaux pour communiquer avec le gatekeeper. RTP/RTCP (Real Time Protocol/Control Protocol) qui est un protocole utilis pour transporter les donnes temps rel sur un rseau IP. (Cf. paragraphe 3.4.2.4).
Les terminaux H.323 peuvent aussi avoir des fonctionnalits supplmentaires, tels que des codeurs audio/vido, le protocole T.120 pour la data-confrence et des fonctionnalits de qualit de service. Cependant, la multiplicit des options rend difficile linteroprabilit des diffrents terminaux H.323.
3.4.2.1.2 Gatekeeper
Le gatekeeper, qui est un quipement optionnel dans un systme H.323, fournit un service de contrle dappel pour les terminaux H.323. Plusieurs gatekeepers peuvent tre prsents sur un rseau et communiquer les uns avec les autres. Le gatekeeper est
58
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
spar des autres terminaux, cependant il peut tre physiquement implment avec un terminal, une gateway ou un autre lment du rseau non-H323. Le gatekeeper fournit les services suivants :
Traduction dadresse : Le gatekeeper fait la traduction de lalias H.323 en une adresse de transport (adresse IP + port) Cela est effectu grce une table qui est rafrachie par les messages denregistrement (Registration message). Contrle dadmission : Le gatekeeper autorise laccs au rseau par les messages H.225 (ARQ/ACF/ARJ). Ce contrle peut tre bas sur lautorisation dappel, la bande passante disponible ou dautres critres fixs par ladministrateur. Gestion de zone : Le gatekeeper doit garantir tous les services dcrits prcdemment pour les terminaux enregistrs. Contrle de bande passante : Le gatekeeper peut refuser ltablissement dun appel pour cause de limitation de bande passante. Signalisation de contrle dappel : Le gatekeeper peut choisir de faire la signalisation dappel avec le terminal par lui-mme ou de rediriger le terminal pour quil tablisse un canal de signalisation directement avec lautre terminal. De cette faon, cela permet dviter au gatekeeper de grer les appels H.225. Autorisation dappel : Par lintermdiaire de la signalisation H.225, le gatekeeper peut accepter ou refuser une demande dappel mise par un terminal. Gestion des appels : Le gatekeeper peut recenser les appels en cours dans la zone quil gre et connatre ltat dans lequel les diffrents appels se trouvent.
3.4.2.1.3 Gateway
La passerelle ou gateway gre linterconnexion entre le rseau IP et le rseau tlphonique classique ; elle fournit une traduction entre des formats de transmission aussi bien de signalisation que de flux multimdia. La gateway tablit et termine les appels aussi bien du ct du rseau IP que du ct du rseau tlphonique. La passerelle peut aussi effectuer le transcodage entre les formats audio, vido ou data. Une passerelle possde les mmes fonctionnalits quun terminal H.323 sur le rseau IP, et aussi celles dun terminal tlphonique sur le rseau de tlphonie. Les gatekeepers diffrencient les terminaux standards des passerelles par lintermdiaire des messages denregistrement envoys par les terminaux H.323.
3.4.2.1.4 Adressage H.323
Adresse rseau
Chaque lment H.323 doit avoir au moins une adresse rseau. Cette adresse identifie chaque lment sur le rseau. Cette adresse est spcifique au rseau dans lequel il est localis.
Adresse alias
Chaque terminal peut aussi tre associ une ou plusieurs adresses. Ces adresses alias peuvent tre du type E.164, noms alphanumriques (H.323 ID) ou dautres formats dfinis dans la norme H.225.0. Cependant chaque adresse alias doit tre unique dans une zone (gre par un gatekeeper). Quand il ny a pas de gatekeeper sur le rseau, le terminal appelant joint lappel directement son adresse transport par lintermdiaire du canal de signalisation.
Autorit de rgulation des tlcommunications
59
Sil y a un gatekeeper dans la zone, lappelant cherche contacter lappel par lintermdiaire de son adresse alias. Cette demande est faite auprs du gatekeeper qui traduit, lui-mme, ladresse alias en adresse transport .
Enregistrement dun terminal H.323
Par le processus denregistrement, le terminal H.323 se joint une zone gre par un gatekeeper, auquel il transmet son adresse transport et son adresse alias . Ces requtes denregistrement sont transmises au gatekeeper par le protocole RAS.
H.323 version 2
La version 2 de H.323 (1998) apporte des amliorations la version prcdente notamment au niveau de ltablissement dappel. Cette mthode, appele FastStart, tablit une communication mdia en un aller-retour.
Cette volution permet une connexion similaire celle dun appel tlphonique classique, loppos de la procdure trs longue de la version initiale de H.323.
Figure 11 : Etablissement dappel en mode FastStart (source Intel)
H.323v2 permet aussi dutiliser de nouveaux types dadresses telles que les adresses email et les URLs sous lesquelles les terminaux peuvent senregistrer. De nouvelles fonctionnalits ont t ajoutes H.245, ce qui permet dutiliser un panel doutils mdia plus important.
60
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Il est aussi possible dutiliser des paramtres de qualit de service (RSVP) lorsque que les flux mdia sont initis.
H.323 versions 3 et 4
H.323 v3 a apport quelques amliorations, principalement concernant linterconnexion avec le RTC et lextensibilit du protocole pour un rseau de grande taille. La version 4, dernire version de H.323 finalise en 2000, apporte des amliorations importantes concernant principalement deux points :
Les services supplmentaires (Cf. paragraphe 3.4.2.1.6 ci-dessous) La dcomposition des gateways en deux lments distincts : la Media Gateway (MG) et le Media Gateway Controller (MGC) ; ce dernier commandant les MG via le protocole H.248.
La version 4 de H.323 permet une dissociation des couches Transport et Contrle : cest une mutation de la norme H.323 vers les NGN. Cela apporte au protocole H.323 la capacit dtre utilisable sur des rseaux oprateurs, alors quil avait t conu lorigine pour des rseaux locaux.
3.4.2.1.5 Communications multi-utilisateurs
Les communications multi-utilisateurs sont mises en uvre en tablissant les communications des diffrents utilisateurs avec le MCU, charg de centraliser et de synchroniser les flux puis de les retransmettre chaque participant.
3.4.2.1.6 Services supplmentaires
Une famille de recommandations a t dveloppe pour les services supplmentaires. H.450.1, H.450.2 et H.450.3 sont bass sur le protocole QSIG qui est utilis pour les PBX. Les services initiaux qui ont t dfinis sont le transfert dappel (H.450.2) et le renvoi dappel (H.450.3). Dautres services ont t normaliss :
les appels en attente (H.450.4) le parquage dappels (H.450.5) le signal dappel (H.450.6) le service didentification (H.450.8) le renvoi dappel (H.450.9) la tarification dappel (H.450.10) le service dintrusion (H.450.11)
3.4.2.1.7 FAX sur H.323
Deux terminaux H.323 (version 2) peuvent changer des fax en utilisant TCP ou UDP par lintermdiaire de la norme T.38.
3.4.2.2 Le protocole alternatif : SIP- Session Initiation Protocol
Le protocole SIP (Session Initiation Protocol, RFC 2543), de lIETF, est un protocole de signalisation pour ltablissement dappel et de confrences temps rel sur des rseaux IP. Propos comme standard lIETF en 1999, SIP est rapidement apparu
Autorit de rgulation des tlcommunications
61
comme une alternative H.323. Ainsi, dans ses dernires versions de systme dexploitation, Microsoft propose un client SIP. Chaque communication doit pouvoir inclure diffrents types de donnes telles que laudio et la vido. SIP est indpendant du protocole de transport utilis. Il utilise le protocole SDP (Session Description Protocol) pour la description des communications mdia.
3.4.2.2.1 Etablissement dappel SIP directement de terminal terminal
Un client SIP peut contacter un autre terminal SIP en envoyant une simple requte Invite . Ce message Invite contient assez dinformations pour permettre au terminal appel dtablir une communication mdia avec lappelant. Ces informations listent les diffrents types de mdia que lappelant peut recevoir et envoyer, ainsi que ladresse transport (adresse IP et port) sur laquelle lappel pourra tablir la connexion mdia utilisant le protocole RTP. Le terminal appel doit alors indiquer quil accepte la demande. Comme la requte tait une invitation, lacceptation du demand (OK message) contient aussi ses capacits ainsi que ladresse sur laquelle il attend les donnes mdia. Lappelant conclut cet change pour un message dacquittement (ACK message). Une communication mdia peut donc tre tablie en un aller-retour et demi ce qui permet un tablissement de connexion trs rapide par rapport H.323 v1 (6 7 aller-retour) mais comparable la mthode FastStart de H.323 v2. Les terminaux SIP peuvent utiliser indiffremment UDP ou TCP comme protocole de transport.
INVITE (@IP, port,codec) TONALITE 200 OK (port,codec) TONALITE ACK COMMUNICATION
Figure 12: Initiation dun appel avec le protocole SIP (source Arcome)
3.4.2.2.2 Larchitecture du protocole SIP
L'architecture de SIP est base sur des relations client/serveur. Les principales composantes sont le terminal (User Agent), le Proxy Server, le Redirect Server et le Registrar. Les terminaux sont considrs comme clients lorsqu'ils effectuent une requte, et comme des serveurs lorsqu'ils y rpondent. Les terminaux peuvent communiquer directement entre eux ou par l'intermdiaire d'autres serveurs. Les serveurs SIP intermdiaires peuvent se comporter comme proxy serveur ou serveur de redirection (redirect server).
62
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Proxy server
Le proxy server joue le rle de serveur dun ct (rception de requte) et de client de lautre (envoi de requte). Un proxy server peut transmettre une requte, sans changement, la destination finale ou ventuellement modifier certains paramtres. Le proxy server renseigne le champ via chaque fois quune requte passe par lui afin que la rponse puisse prendre le mme chemin au retour ; ce qui ne serait pas possible avec le protocole UDP.
Redirect server
Un redirect server rpond une requte SIP Invite . Il tablit la correspondance entre ladresse SIP du terminal appel et la ou les adresses o il pourra effectivement tre joignable. Le redirect server nest pas charg daccepter les appels ni dmettre des requtes. Il ne fait que rpondre aux requtes mises par des terminaux SIP appelants.
Autorit de rgulation des tlcommunications
63
Exemples :
Rponse 300 lURL SIP peut tre contacte diffrentes adresses (ex :sip :robert_gsm@arcome.fr, sip :robert_home@family.org) Rponse 301 lURL SIP ne peut plus tre contacte cette adresse mais la nouvelle adresse indique Rponse 302 redirection du client vers une adresse mais de faon provisoire.
Registrar server
Un registrar est un serveur qui traite les requtes Register et peut aussi avoir la fonction de proxy. Sa fonction est de connatre lendroit o se trouve un usager et de fournir cette information au proxy et au redirect server. En effet pour pouvoir joindre un usager partir dune adresse SIP, il faut faire une correspondance avec une adresse IP qui peut tre variable (mobilit IP) : cest le rle du registrar.
Requte Rponse
Protocole Non-SIP
Figure 13 : Enregistrement dun terminal SIP (source :Radvision)
3.4.2.2.3 Localisation dun usager
La localisation physique dun usager seffectue en deux tapes. LURL SIP permet lusager appelant de localiser le SIP server. Celui-ci sera la destination du message Invite initial. Soit le serveur connat ladresse physique de lusager appel et il permettra ltablissement dune connexion, soit il redirige la requte vers un autre lieu o il sait que lappel pourra tre joint. Le fait que lURL SIP pointe sur un serveur et non sur lusager terminal donne ce dernier une plus grande mobilit. Cela permet aussi de soulager le serveur DNS qui na qu connatre ladresse du serveur et non de tous les terminaux relis au serveur.
3.4.2.2.4 Session Description Protocol (SDP)
Le protocole SDP (RFC 2237) est un protocole qui dcrit les sessions audio, vido et multimdia. SDP utilise des caractres ASCII et donne les informations ncessaires ltablissement dune communication multimdia telles que lidentit de linitiateur de la session, la bande passante disponible, les codeurs utiliss.
64
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.4.2.2.5 Adressage
Les adresses URL utilises par le protocole SIP sont similaires celles du Web o la forme ressemble une adresse email de la forme user@host. Les URL SIP peuvent prendre diffrentes formes :
Martin@arcome.fr qui est ladresse du PC de Martin dans le domaine arcome. 0146124200@arcome.fr ; user=phone qui correspond ladresse dun tlphone accessible par une passerelle. guest312@arcome.fr qui est ladresse dun utilisateur nomade connect sur le LAN dArcome.
Requte Rponse
Protocole Non-SIP
Figure 14 : Initiation dun appel avec SIP (source : Radvision)
3.4.2.2.6 Communications multi-utilisateurs
Les communications multi-utilisateurs peuvent tre inities, par SIP, en utilisant le mode multicast ou en tablissant les communications des diffrents utilisateurs avec un serveur (quivalent du MCU en H.323) charg de centraliser et de synchroniser les flux puis de le retransmettre chaque participant.
Autorit de rgulation des tlcommunications
65
3.4.2.3 Comparaison de SIP et H.323
Il apparat que deux protocoles de commande dappel de deux origines trs diffrentes sont en concurrence. Comparaison des deux protocoles de contrle dappel candidats Spcifications : organisme, date, nombre de pages Modle dorigine Applications vises Services de tlphonie Protocole de transfert de donnes multimdia Codecs supports Syntaxe Implmentation Extensibilit SIP H.323
IETF, 1999, ~ 200 p. Internet / WWW VoIP, multimdia Encore limits RTP / RTCP Nouveaux + standardiss Texte (ASCII) Simple (ASCII, protocoles IP : http, DNS, adresses URL)
UIT, 1996 (V1. 2000 pour la V4), > 800 p. Tlphonie : RNIS, Q.SIG VoIP, video streaming Elabors (inspirs de QSIG)
Standardiss Abstraite (ASN.1) Plus complexe
Oui (+ fonction de repli des Faible (complexe, forte terminaux permettant de signaler augmentation du les requtes non comprises) volume de code) Eleve Faible (services, produits). Mais choisi pour UMTS et de plus en plus support Limite (options) Bonne (produits)
Interoprabilit entre constructeurs Maturit
Dun ct, H.323 est issu dune adaptation des protocoles de tlphonie classique sur RTC au rseau en mode paquet. De lautre SIP est bas sur des technologies issues du monde de lInternet, ce qui permet de prsumer quil aura une diffusion plus grande, notamment pour le dveloppement dapplications et de services.
H.323 a eu le mrite dtre le premier standard simposer pour la gestion des communications multimdia sur des rseaux en mode paquet, bien que sa complexit originelle ntait pas adapte ce type de rseau. Cependant de nombreuses amliorations ont t apportes pour simplifier les procdures dappel, augmenter le nombre de services offerts et permettre le dploiement du standard sur des rseaux doprateurs (intgration de H.248). SIP est un protocole beaucoup plus rcent qui a lavantage dutiliser nativement des protocoles utiliss sur les rseaux IP : Cela lui apporte une simplicit dintgration et une utilisation des nouveaux outils existant. De plus SIP a t choisi comme protocole de contrle dappel pour la voix sur IP dans la release R5 de la norme UMTS. SIP a aussi t retenu par Microsoft comme protocole dtablissement dappel pour ses serveurs et ses terminaux. Enfin, SIP est le protocole de contrle dappel sur lequel
66
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
sappuie larchitecture Web services qui est lun des deux modles de services NGN (Cf. chapitre 3.5 sur la couche Services). Cependant, les services proposs par SIP ne sont pas encore un niveau suffisant pour offrir les services de tlphonie classique ; lajout de ces nouvelles fonctionnalits alourdira inluctablement le protocole. Finalement, bien que les protocoles H.323 et SIP soient issus de contextes trs diffrents, ils tendent tous les deux vers un modle leur permettant dintgrer au mieux les nouveaux outils du monde Internet . Ainsi ces protocoles permettront doffrir de nouveaux services (mobilit, service multimdia multi-terminaux), en plus de ceux dj existants sur les rseaux classiques.
La plupart des constructeurs propose les deux solutions mais semble privilgier la convergence vers SIP. Cependant, court et moyen terme, lutilisation de H.323 parat incontournable. Il reste une interrogation quant linteroprabilit entre les deux protocoles, qui nest pratiquement pas tudie.
3.4.2.4 Gestion de la qualit de service de bout en bout avec SIP ou H.323 : protocoles RTP et RTCP
Le protocole IP permet de transporter les paquets IP travers un rseau IP mais ne fournit aucun mcanisme pour grer les flux IP dune session entre des terminaux IP. Cette fonction est gnralement effectue par les protocoles TCP ou UDP, chargs de vrifier que la transmission et la rception des paquets seffectuent correctement. Cependant, ces protocoles noffrent aucune fonctionnalit permettant de grer les flux temps rel, audio ou vido, qui sont prsents dans toutes les communications multimdia.
Les protocoles RTP et RTCP garantissent la qualit des communications multimdia en mode paquet (gestion et contrle des flux temps rel). Pouvant tre mis en uvre au-dessus dIP ou dATM, ils sont utiliss par les deux protocoles de contrle dappel SIP et H.323.
RTP (Real Time Protocol, IETF RFC 1889), permet le transport des donnes temps rel tels que les flux audio et vido. Il est bas sur les protocoles IP/UDP. UDP est prfr TCP pour les transmissions temps rel ; en effet la priorit est donne la rapidit plus qu qualit de transmission. Les retransmissions effectues par le protocole TCP, pour grer la qualit de services, sont en effet incompatibles avec des contraintes temps rel . RTP fournit des services tels que le squencement temporel, la dtection des pertes, la scurit et lidentification du contenu. Ce protocole a t dfini pour diffuser aussi bien en mode multicast quen mode unicast. Il peut donc aussi bien tre utilis pour le transport unidirectionnel (broadcast) de vido sur demande que pour la tlphonie sur IP. RTP est utilis en association avec le protocole de contrle RTCP (Real Time Control Protocol) qui fournit les informations ncessaires sur la qualit de transmission des donnes et sur les participants aux sessions multimdia. Cependant RTP ne fournit pas de lui-mme les mcanismes ncessaires la gestion des informations temps rel . Pour cela, les couches protocolaires infrieures doivent mettre en uvre des solutions ncessaires ces donnes sensibles au dlai.
Fonctionnement de RTP (Real time Transport Protocol)
Comme nous lavons vu, IP est un rseau partag en mode paquet. Les paquets envoys sur un rseau IP ont une gigue et un dlai de transmission imprvisibles. Cependant les applications multimdia requirent des caractristiques appropries la transmission et la gestion des applications dites temps rel . RTP fournit, pour chaque paquet, un
Autorit de rgulation des tlcommunications
67
marquage temporel, un numro de squence et dautres paramtres permettant doffrir un transport, de bout en bout, des donnes temps rel sur un rseau en mode paquet. Le marquage temporel ( timestamping ) est linformation la plus importante pour les applications temps rel . Lmetteur envoie un marqueur temporel qui donne linstant o le premier octet du paquet a t trait. A larrive, le rcepteur utilise le marqueur temporel pour reconstruire le flux multimdia de sorte quil puisse tre correctement prsent, dans un dlai appropri, lutilisateur final. Cependant, ce nest pas RTP lui-mme qui gre la synchronisation des paquets, il fournit simplement les outils. La synchronisation est effectue au niveau de la couche applicative. Comme UDP ne fournit pas forcment les paquets dans lordre dans lequel ils ont t mis, les numros de squence sont utiliss pour ordonner les paquets larrive. Ils sont aussi utiliss pour la dtection des paquets perdus. Lidentifiant du type de donnes ( payload type identifier ) spcifie le format des donnes contenues dans le paquet. La connaissance de cette information permet lapplication rceptrice de savoir comment grer les donnes utiles du paquet. Les diffrents types de donnes sont dfinies dans la RFC 1890. A un instant donn, lmetteur de flux RTP ne peut envoyer quun type de donnes, cependant il est possible den changer lors dune transmission, du fait , par exemple, dune congestion rseau. RTP donne aussi un identifiant de lmetteur permettant au rcepteur de connatre la provenance des donnes. Les paquets RTP et RTCP sont gnralement transports sur UDP/IP, cependant ces protocoles sont dfinis indiffremment du mode de transport si bien quils peuvent tre utiliss sur des protocoles tels que AAL5/ATM. Pour dbuter une session RTP, lapplication dfinit une paire particulire dadresses transport (adresse IP et port UDP) de destination. Dans une session multimdia, chaque mdia est transport sur une session RTP diffrente pour laquelle sont mis des paquets de contrle (RTCP). Ainsi laudio et la vido sont transports sur des sessions diffrentes, ce qui permet lutilisateur final de choisir le mdia quil dsire recevoir.
Application multimdia Codecs Codecs Protocole de audio video contrle dappel (SIP ou H.323) RTP/RTCP ATM UDP IP TCP ATM
Figure 15: RTP/RTCP dans la suite de protocole pour services multimdia (source Arcome)
Fonctionnement de RTCP (Real-Time Control Protocol)
RTCP est un protocole dfini pour tre utilis en addition de RTP. Il est standardis par la RFC1889 et RFC 1890. Dans une session RTP, chaque participant envoie priodiquement des paquets RTCP donner des informations sur la qualit de la transmission. Il existe 5 types de paquets pour transporter cette information de contrle :
68
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
RR: receiver report . Les rapports des rcepteurs sont envoys par les terminaux qui ne sont pas des participants actifs la communication. Ils contiennent des informations sur les donnes reues, dont le numro du dernier paquet reu, la valeur moyenne de la gigue et le marqueur temporel qui permettra de calculer le dlai de transmission entre lmetteur et le rcepteur. SR: sender report . Les rapports des metteurs sont mis par les terminaux actifs. En plus des informations donnes par le receiver report , ils donnent des informations concernant la synchronisation inter-mdia, le nombre de paquets et doctets mis. SDES: source description items . Contient des informations dcrivant la source mettrice. BYE: indique la fin de la participation dun participant une session. APP: fonction utilise par des applications spcifiques.
Grce ces donnes, RTCP fournit des informations pour les services de gestion de la qualit de service et contrle de congestion de niveaux suprieurs. Cest la principale fonction de RTCP. Ce protocole fournit lapplication les informations sur la qualit de la distribution des donnes. Ces informations de contrle sont ncessaires pour les metteurs et les rcepteurs. Lmetteur peut ajuster sa transmission suivant le rapport du rcepteur. Les rcepteurs peuvent dterminer si la congestion est locale ou globale. Les informations de description des sources mettrices peuvent inclure des donnes en format texte telles que le nom de lutilisateur, le numro de tlphone et ladresse email.
Comme cela est dtaill dans le chapitre 3.7, la gestion de la qualit de service de bout en bout impacte toutes les couches dun rseau NGN, depuis les terminaux jusquaux applications, en passant par les protocoles de gestion de niveau intermdiaire (situs entre les couches Contrle et Service) comme RTP et RTCP.
3.4.3 Contrle des Media Gateways : deux protocoles candidats
La ncessit dinterconnecter les rseaux de tlphonie classique aux NGN, ainsi que la flexibilit apporte par la sparation des couches Transport et Contrle ont conduit la distinction des fonctions de Media Gateway (MG) et de Media Gateway Controller (MGC). Il a donc t ncessaire de dvelopper un protocole permettant aux MGC de piloter les MG.
Le protocole de commande de passerelle : l'interface MGC-MG
Le protocole de commande de passerelle permet la communication entre la MG et le MGC : cest le canal de communication utilis pour coordonner le plan Contrle et le plan Transport. Les principales fonctions de ce canal sont :
La rservation des ressources de la MG par le MGC ncessaire pour satisfaire les demandes reues par les messages de signalisation. Le traitement des connexions dans la MG par le MGC. La modification des paramtres internes de la MG. La remonte par la MG des rponses aux actions demandes par le MGC. La notification par le MG dvnements survenus au niveau mdia (dtection DTMF...). Le contrle du lien MG-MGC (scurit du lien, basculement vers un autre MGC ou MG).
Ces nouveaux protocoles sont apparus en 1998 avec le IPDC et le SGCP qui ont rapidement fusionner en MGCP. LIETF cra dans le mme temps un groupe de travail
Autorit de rgulation des tlcommunications
69
appel MEGACO (MEdia GAteway COntrol) pour standardiser un protocole pour linterface MGC-MG. Finalement, lUIT et lIETF dcidrent en 1999 de collaborer sur un protocole commun nomm H.248 pour lUIT et MEGACO pour lIETF.
3.4.3.1 Le protocole historique : MGCP
Le Media Gateway Control Protocol (MGCP, RFC 2705), protocole dfini par lIETF, a t conu pour des rseaux de tlphonie IP utilisant des passerelles VoIP. Il gre la communication entre les Media Gateway et les Media Gateway Controller. Ce protocole traite la signalisation et le contrle des appels, dune part, et les flux mdia dautre part. Les diffrents lments qui utilisent MGCP sont :
La Signalling Gateway qui ralise linterface entre le rseau de tlphonie (signalisation SS7) et le rseau IP. Elle termine les connexions des couches basses de SS7 et transmet les messages ISUP la MGC. Le Media Gateway Controller (MGC) ou Call Agent qui opre lenregistrement, la gestion et les contrles des ressources des Media Gateway. Elle coordonne ltablissement, le contrle et la fin des flux mdia qui transitent par la Media Gateway. La Media Gateway (MG) qui est le point dentre ou de sortie des flux mdia linterface avec les rseaux IP et tlphoniques. Elle effectue la conversion des mdias entre le mode circuit (tlphonique) en le mode paquet (IP).
3.4.3.2 Le protocole alternatif : MEGACO/H.248
Le groupe de travail MEGACO (MEdia GAteway COntrol) a t constitu en 1998 pour complter les travaux sur le protocole MGCP au sein de lIETF. Depuis 1999, lUIT et lIETF travaillent conjointement sur le dveloppement du protocole MEGACO/H.248 ; cest un standard permettant la communication entre les Media Gateway Controller (MGC) et les Media Gateway (MG). Il est driv de MGCP et possde des amliorations par rapport celui-ci :
Support de services multimdia et de vidoconfrence Possibilit dutiliser UDP ou TCP Utilise le codage en mode texte ou binaire
Une premire version de H.248 a t adopte en juin 2000 (RFC 3015 de lIETF). Limplmentation de H.248 permet une grande modularit ; en effet, ce protocole est tendu par des packages rpondant des besoins spcifiques. Ce systme permet de couvrir un nombre trs important dapplications, mais complique aussi grandement les interfonctionnements dquipements dorigine diffrente. Ainsi un constructeur peut implmenter, suivant ses besoins, tel ou tel package qui ne sera pas obligatoirement choisi par un autre constructeur.
70
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Passerelle SS7
Passerelle SS7
SS7
SG
MGC
MGC
SG
SS7
ISUP
M GCP ou H.248/Mgaco
M GCP ou H.248/M gaco
ISUP
Rseau IP
RTC MG RTC
Flux Mdia (RTP /RTCP)
MG
Figure 16 : Positionnement de MGCP et H.248/MEGACO dans les NGN (source Arcome)
3.4.3.3 Comparaison de MGCP et MEGACO/H.248
MGCP et MEGACO/H.248 ont la mme architecture mais sont cependant des protocoles trs distincts. La principale diffrence est quavec H.248 les commandes sappliquent des terminaisons et des contextes, plutt qu des connexions individuelles en MGCP. Le tableau page suivante prsente une comparaison des deux protocoles de contrle dappel candidats.
Actuellement les solutions de commande de passerelle utilisent le plus frquemment le protocole MGCP.
Ceci pour des raisons historiques car il fut le premier protocole tre dvelopp. Il na cependant pas t normalis (statut de standard lIETF uniquement) ce qui semble tre un handicap. Il a tout de mme t reconnu par lUIT comme protocole de rfrence pour la tlphonie sur les rseaux cbls.
Il semble que la mise en place de H.248 pousse les acteurs converger moyen terme vers ce protocole : cest en effet le seul protocole ayant le statut de norme puisquil est reconnu non seulement lIETF (MEGACO) mais aussi lUIT (H.248).
Mais lensemble de ses packages laisse la possibilit trs large dimplmentation qui rendra dautant plus difficile linterfonctionnement entre quipements de constructeurs diffrents.
Il est donc encore difficile de savoir lequel de MGCP ou H.248 sera LE protocole de commande de Media Gateway, ou plus exactement si (et quand) H.248 parviendra simposer comme le standard.
Autorit de rgulation des tlcommunications
71
Comparaison des deux protocoles de contrle dappel candidats Spcifications : organisme, date, nombre de pages Modle dorigine
MGCP
H.248/MEGACO
IETF, 1998 (RFC 2705)
UIT (SG16) et IETF (WG MEGACO), 2000. v1 : RFC 3015 pour IETF MGCP (IETF) et MDCP
SGCP (Simple Gateway Control Protocol) et IPDC (Internet Protocol Device Control)
Applications vises Services
Contrle distance de Media Gateway (MG) par les Media Gateway Controller (MGC). Etablissement de communication et confrences multimdia IP-TDM. Possibilit de grer des terminaux (ex: tlphone MGCP) Une communication = un terminal (interface IP ou TDM dune MGC) et une connexion 1 transaction = 1 commande Etablissement de communication et confrences multimdia IP-TDM ou IP-IP
Modle de connexions
Une communication = deux terminaisons et un contexte regroupant les terminaisons dun mme appel. 1 transaction = N actions 1 action = N commandes Codage Texte (ABNF) Binaire (ASN1)
Syntaxe
Codage Texte (BNF) 1
Transport du protocole Implmentation
UDP/IP ou ATM Diffrentes implmentations pour rseaux IP et ATM. Le standard offre un certain nombre de fonctionnalits
TCP,UDP,SCTP sur IP ou ATM ou MTP Implmentation unique pour tout type de rseau de transport paquet. La norme spcifie les rgles de cration de package permettant dintgrer de nouvelles fonctionnalits Beaucoup de tests effectus mais la grande libert dimplmentation peut poser des problmes Faible (services, produits) Mais de plus en plus implment dans les solutions constructeurs.
Extensibilit
Interoprabilit entre constructeurs
Le standard IETF offre linteroprabilit pour les fonctions et les commandes spcifies Bonne (produits). Cest le protocole utilis actuellement pour les systmes MG/MGC.
Maturit
72
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.4.3.4 Relation entre MGCP, H.248, SIP et H.323
MGCP et H.248 sont des protocoles complmentaires SIP et H.323. Ils sont dfinis spcialement comme un protocole interne entre MGCs et MGs. Dans ce modle, les MGCs grent le traitement des appels du rseau IP en communiquant avec les lments de signalisation IP (gatekeeper H.323 ou serveur SIP), souvent co-localiss avec le MGC, et le rseau tlphonique via une passerelle de signalisation.
Passerelle SS7
Softswitch
MGC
Serveur SIP/H.323
Rseau SS7
SG
ISUP
MGCP ou H.248/Megaco
Rseau paquet
Flux Mdia ( RTP /RTCP )
SIP ou H.323
Terminaux SIP ou H.323
RTC MG
Figure 17 : Protocole de commande impliqus dans les NGN (source Arcome)
3.4.4 Transport de la signalisation SS7 sur rseaux IP : le protocole SCTP (SIGTRAN)
Concernant plus spcifiquement le transport des messages de signalisation SS7 et RNIS sur des rseaux IP, un groupe de travail de lIETF appel SIGTRAN (SIGnalling TRANsport, informational RFC 2719) a t dvelopp. Ce groupe SIGTRAN dfinit le protocole de contrle entre :
Les Signalling Gateways, qui reoivent la signalisation SS7 sur TDM, et la convertissent en SS7 sur IP. Les Media Gateway Controllers, qui interprtent la signalisation SS7 sur IP. Et les signalling points du rseau IP (serveurs de contrle dappel).
Ce protocole utilise une nouvelle couche de transport appele Stream Control Transmission Protocol (SCTP) permettant de pallier les dfauts du protocole TCP pour la gestion des messages de signalisation.
Associ des couches dadaptation spcifiques chaque protocole de signalisation dorigine (gnralement SS7), le protocole SCTP doit permettre de transporter les messages de signalisation de faon transparente sur des rseaux IP.
Autorit de rgulation des tlcommunications
73
Les couches dadaptation dfinies par SIGTRAN ont toutes des objectifs communs :
Le transport des protocoles de signalisation des couches suprieures, bas sur un transport IP fiable. La garantie dune offre de services quivalente celle propose par les interfaces des rseaux RTC. La transparence du transport de la signalisation sur un rseau IP : lutilisateur final ne se rend pas compte de la nature du rseau de transport. La possibilit de pouvoir supprimer ds que possible les couches basses du protocole SS7.
SIGTRAN a dj dfini plusieurs couches dadaptation :
La couche dadaptation M2UA qui fournit le service MTP2 dans une relation client/serveur telle que la communication entre SG et MGC.
Couche dadaptation SIGTRAN
Passerelle SS7
MGC
M2UA SCTP IP
Rseau SS7
ISUP MTP-3 MTP-2 MTP-1
SIGTRAN
SG
ISUP/ IP
ISUP MTP-3 M2UA SCTP IP
MGC
Figure 18 : Couche dadaptation M2UA fournie par SigTran (source Arcome)
La couche dadaptation M2PA qui fournit le service MTP2 dans une relation peer to peer (dgal gal) telle que la communication entre SG et SG. La couche dadaptation M3UA qui fournit le service MTP3 dans une relation client/serveur ou peer to peer (dgal gal).
3.4.5 Plusieurs protocoles candidats pour la signalisation de transit entre serveurs dappel
Les oprateurs de tlcommunications, voyant la monte en puissance du trafic de donnes, ont mis le souhait de pouvoir utiliser des solutions de signalisation de transit pour les rseaux en mode paquet. Pour cela, il tait ncessaire de dfinir un protocole permettant la communication entre MGC (Media Gateway Controller). Ce protocole ne remet pas en cause les protocoles de commande de passerelles, mais au contraire, permet dlargir le domaine daction des protocoles tels que MGCP ou H.248/MEGACO. Trois protocoles sont candidats pour cette utilisation : BICC, H.323 et SIP-T.
74
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.4.5.1 Bearer Independent Call Control (BICC)
Le protocole BICC a pour objectif la gestion de la communication entre serveurs d'appel, indpendamment du type de support, permettant aux oprateurs de raliser une migration de leurs rseaux RTC/RNIS vers des rseaux en mode paquet. En vue, donc, dune migration des rseaux tlphoniques (SS7) vers une architecture NGN, une recommandation de lUIT, le protocole BICC, doit tendre le protocole de signalisation actuellement implment sur les rseaux tlphoniques, lISUP. En effet BICC est en grande partie issu de lISUP ; les recommandations font dailleurs directement rfrence lISUP, quant sa dfinition mais aussi pour linteroprabilit avec H.323. La premire version de ce protocole, BICC CS1 (BICC Capability Set 1) dfinit le transport de signalisation sur un rseau ATM en tant que rseau de transit. La seconde version de ce protocole, BICC CS2, largit normment son rayon daction et les capacits. Il permet :
Lutilisation dun rseau IP comme rseau de transit. Il sagit de tunnelling de messages de signalisation par le protocole BICC sur un rseau de transport IP, de passerelle passerelle (Signalling Gateway), donc transparent pour les MGC du rseau IP. Linterfonctionnement avec les rseaux H.323
La prochaine version de BICC (CS3) portera principalement sur le rseau daccs et linterfonctionnement avec SIP.
Le protocole BICC est donc (ou sera court terme) compatible aussi bien avec les protocoles de contrle dappel SIP et H.323 quavec un transport en mode IP ou ATM. Cest donc un candidat potentiel srieux qui prend a priori en compte toutes les configurations de rseau (tendance donnes ou tlcoms ).
3.4.5.2 Protocole H.323 entre Media Gateway Controller
3.4.5.2.1 Sur des rseaux IP
Dans les rseaux IP, la norme H.323 utilise les standards H.225 et H.245 pour la gestion des commandes dappel. A lorigine, ces canaux de signalisation taient crs entre le terminal H.323 (tlphone ou passerelle H.323/ RNIS) et le serveur dappel H.323. Lvolution de la norme H.323, par la possibilit de communiquer entre serveurs dappel H.323 et par la sparation en lments distincts des fonctions MG et MGC, a quelque peu modifi la norme. Il est tabli que la signalisation des appels et la synchronisation (H.225) se passent entre MGC ; par contre le protocole utilis pour lchange des capacits entre les terminaux, la ngociation de canal et le contrle de flux mdia entre les terminaux H.323 (H.245) peut seffectuer entre MG ou MGC.
Autorit de rgulation des tlcommunications
75
3.4.5.2.2 Interfonctionnement de H.323 avec les protocoles SS7
Interconnexion avec des rseaux SS7 (ISUP)
Linterfonctionnement de H.323 avec le protocole ISUP a t dfini rcemment (annexe C de H.246). Il tabli la correspondance entre les messages ISUP et H.323 pour les appels IP-RTC et RTC-IP, ainsi que linteraction de certains services tlphoniques (ex : mise en attente dappel, restriction et autorisation de divulgation de lidentifiant de lappelant).
Encapsulation ISUP dans H.323
Dans le cas o le rseau IP est utilis comme rseau de transit, il ne semble pas pertinent de raliser deux interconnexions (H.323/ISUP puis ISUP/H.323) avec une perte dinformation (H.323 est bas sur Q.931, protocole daccs et non de transit). La transmission des messages ISUP, de manire transparente sur le rseau IP est la solution plus pertinente. Une premire bauche de solution est propose dans la version 4 de H.323 par encapsulation des messages ISUP dans H.225.
3.4.5.3 Protocole SIP entre Media Gateway Controller : SIP-T
LInternet Draft SIP-T (SIP pour la tlphonie) de lIETF dfinit la gestion de la tlphonie par le protocole SIP ainsi que linterconnexion avec le RTC : cependant uniquement avec le protocole SS7 ISUP. SIP-T prconise :
lencapsulation des messages ISUP lintrieur de messages SIP, permettant la transmission de faon transparente de la signalisation ISUP dans le cas de transit par un rseau IP. le renseignement de len-tte du message SIP par les informations contenues dans le message ISUP, permettant dacheminer le message correctement travers le rseau IP et de terminer les appels sur un terminal SIP.
3.4.5.4 Devenir des trois protocoles
Le schma montre le niveau auquel est utilise la signalisation entre Media Gateway Controllers, pour laquelle les trois protocoles BICC, SIP-T et H.323 sont en concurrence.
Passerelle SS7 SIGTRAN Rseau SG ISUP/ IP
MGC
MGC
MGC BICC ou SIP-T ou H.323
MGC
SS7
ISUP
MGCP ou H.248 RTC MG
Rseau paquet
Flux Mdia (RTP /RTCP)
SIP ou H.323
MGCP ou H.248 MG
RTC
Figure 19 : Protocole de signalisation entre Media Gateway Controller (source Arcome)
Actuellement, les constructeurs utilisent plutt des solutions de contournement leur permettant dviter dimplmenter un protocole
76
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
de signalisation entre serveurs dappels. Cette situation transitoire, qui est envisageable dans le cadre de petits rseaux avec un faible nombre de serveurs, nest pas compatible avec une industrialisation et une exploitation grande chelle des solutions de rseau NGN.
Lintgration de ces diffrents protocoles est annonce par les constructeurs ; il est cependant difficile de connatre la maturit des solutions (car trs peu sont en service oprationnel) et linteroprabilit des solutions entre elles. De plus, le choix des protocoles implments est variable suivant les solutions. Ces lments ne permettent pas de dgager un protocole prdominant.
Cependant, au vu des tendances moyen/long terme concernant le choix du protocole de contrle dappel (plutt SIP au dtriment de H.323) et au vu du support important de BICC dans le domaine tlcoms, le choix du protocole de signalisation entre serveurs dappel NGN se fera vraisemblablement entre BICC et SIP-T.
3.4.6 Cohabitation des rseaux existants et NGN
Il semble que les rseaux actuels persisteront pour une priode relativement longue et donc que la coexistence des rseaux actuels et NGN sera effective pendant plusieurs annes, voire dcennies.
Switch voix + services IN
Softswitch
MGC
Serveur dapplications
SG
Rseau TDM/SS7
MG
Rseau paquet
Figure 20: Interconnexion de rseaux (source Arcome)
Autorit de rgulation des tlcommunications
77
3.4.6.1 Le transport de la voix sur des rseaux paquet
Ce type de cohabitation des deux gnrations de rseaux est dj effectif, comme le montrent les exemples dutilisation ci-dessous.
En effet plusieurs oprateurs, gnralement internationaux, proposent leurs services de transit de trafic tlphonique sur des rseaux IP : les flux voix passent au dpart et larrive de ce rseau de transit IP par des passerelles de transport IP/TDM et de signalisation (SS7). On voit galement se dvelopper des acteurs offrant des services de voix sur Internet (ITSP ou Internet Telephony Services Provider), principalement pour les particuliers : ces services noffrent pas de garantie de qualit de service trs importante mais, cet inconvnient est compens par les prix trs attractifs. Ces offres ont vocation se dvelopper grce laugmentation de la bande passante disponible par utilisateur lamlioration de la qualit de service et lapparition de services tels que la messagerie unifie.
3.4.6.2 Linterconnexion des rseaux
Des services tel que le Centrex IP sont galement rendus possibles grce lapparition des VPN-IP (rseau priv virtuel IP) et des Softswitches. Ces services offrent la possibilit aux entreprises, dexternaliser, en terme de ressources mais aussi dquipements, leur rseau voix dentreprise qui est alors gr par un oprateur. Ainsi, les oprateurs commencent utiliser leurs rseaux paquet pour les services tlphoniques. Cependant, il est aujourdhui obligatoire dutiliser la technologie TDM/SS7 pour linterconnexion des rseaux entre oprateurs.
Une volution rcente offre la possibilit de dissocier les liens dinterconnexion de signalisation des liens de transport de la voix (sparation des couches transport et contrle), ltape suivante sera, aussi bien au niveau technologique que rglementaire de pouvoir effectuer des interconnexions de rseaux interoprateurs natives NGN.
Des efforts importants sont actuellement fournis, au niveau des organismes de normalisation et des constructeurs pour dvelopper des solutions et des protocoles de contrle standardiss ; ces systmes devraient tre oprationnels dans les annes venir. Les points ncessitant encore des amliorations sont notamment :
la maturit et la convergence des protocoles de signalisation entre serveurs dappel (Cf. chapitre 3.4.5), lamlioration des performances de qualit de service dans les rseaux de transport en mode paquet (Cf. chapitre 3.2) et la mise en uvre du contrle de la qualit de service de bout en bout (Cf. chapitre 3.7), lexistence doffres de transit et dinterconnexion IP pour les services donnes, mais aussi voix.
78
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.4.7 Exemple darchitecture de systme global NGN : lUMTS
Dans le domaine des rseaux mobiles, il est prvu que le systme UMTS, dans sa deuxime phase, volue dans sa globalit vers une architecture type NGN, tant sur le plan de larchitecture physique que pour le choix des protocoles. NB : Le prsent chapitre focalise sur les volutions au sein du cur de rseau. Les aspects de la norme UMTS lis laccs UTRA, aux services et aux terminaux sont traits dans les chapitres concerns.
3.4.7.1 UMTS release 99 : lhritage du GSM/GPRS
Larchitecture UMTS telle que dcrite dans la release 99 du 3GPP (organisme de normalisation de lUMTS) sappuie sur une nouvelle interface radio, lUTRA, et une volution des curs de rseau GSM et GPRS (adaptation des quipements existants ou nouveaux quipements) pour grer les flux des domaines circuit et paquet. Dans larchitecture UMTS R99 :
Les interfaces de lUTRA avec le cur de rseau sont bases sur un transport ATM (AAL2 pour la voix, AAL5 pour les donnes). Le transport dans le cur de rseau peut ensuite tre effectu (au choix de loprateur) soit en ATM pour lensemble des flux, soit en ATM puis TDM pour les flux circuit et en IP pour les flux paquet. La signalisation linterface avec lUTRA est transporte soit dans des circuits virtuels ATM, soit avec le protocole de transport de SS7 sur IP SIGTRAN. Les appels multimdia sont supports, mais de manire transparente. En effet, les messages de signalisation multimdia sont transports de manire transparente dans une connexion circuit ou dans un contexte PDP (tunnel GTP entre SGSN et GGSN), ce qui vite dintroduire des fonctions multimdia dans les quipements GSM et GPRS, limitant les impacts aux terminaux et lajout de serveurs multimdia (gatekeepers). Les protocoles de contrle dappel multimdia retenus sont H.323 pour le domaine paquet et H.324-M pour le domaine circuit, choix plus conforme la maturit actuelle des protocoles (par rapport SIP). Cependant, le transport de la signalisation multimdia tant transparent, SIP pourrait a priori tre support de la mme manire.
La R99 prpare donc lvolution vers la solution cible tout IP en introduisant ds les dbuts de lUMTS un transport convergent des flux voix et donnes.
Les versions ultrieures de la norme UMTS intgrent une volution encore plus nette vers une architecture de type NGN. La release R4 (ex-R99) est la premire tape vers un cur de rseau tout IP, et la release R5 finalise cette volution.
3.4.7.2 UMTS releases R4/R5 : lvolution vers le tout IP multimdia avec une architecture NGN
Alors que la release 99 UMTS a principalement pour vocation de grer une transition douce avec le GSM/GPRS, la release 4 (anciennement dnomme release 2000) de lUMTS propose une architecture rsolument novatrice afin dvoluer vers le tout IP multimdia. Suite aux discussions techniques au sein du 3GPP et afin de prendre en compte la maturit des produits et solutions nouvelles, les volutions de lUMTS prvues dans cette version ont t chelonnes dans le temps et rparties sur deux versions successives, rebaptises R4 et R5.
Autorit de rgulation des tlcommunications
79
3.4.7.2.1 UMTS Release R4 : sparation des couches transport et contrle
Conformment lun des concepts de base des NGN, la version R4 de la norme UMTS prvoit une volution optionnelle du domaine circuit, sous la forme dune restructuration fonctionnelle des MSC pour introduire une sparation des couches Transport (Media Gateway) et Contrle dappel (MSC server).
Le MSC server a les mmes caractristiques quun MGC (Media Gateway Controller), avec en complment des fonctions spcifiques mobile. Il est ainsi en mesure de dialoguer avec les autres MSC server en utilisant le protocole BICC ou SIP-T selon que le protocole de transport utilis est ATM ou IP, mais conserve notamment des liens de signalisation utilisant le protocole MAP avec les HLR. La signalisation de commande entre MSC server et MGW utilise le protocole H.248 avec des extensions spcifies par le 3GPP. Cette signalisation peut tre transporte en utilisant le protocole MTP3b si le transport sappuie sur une couche ATM, ou SIGTRAN (SCTP) si le transport sappuie sur IP.
Signalling Interface Signalling and Data Transfer Interface HLR D MSC server C
MAP
MAP SS7 sur autre T-SGW SS7 sur TDM
PSTN/ Legacy/External
protocole
BICC ou SIP-T
Nc
Iu
GMSCserver
RANAP
UTRAN
H.248
Mc
H.248 IP, ATM ou autre
Nb MGW
Mc
ATM
Iu_CS
MGW FONCTION MSC
Figure 21 : Architecture domaine circuit UMTS release R4 (source : 3GPP TR 23.821)
Par ailleurs, lapprobation en Mars 2001 de ltude de faisabilit effectue par le 3GPP concernant la sparation des couches transport et contrle dans le domaine paquet (quipements SGSN et GGSN) permet certains constructeurs de proposer des variantes dimplmentation. Le protocole H.248 est alors pressenti, de manire similaire au domaine circuit, pour assurer la signalisation entre les serveurs paquet et les MGW.
3.4.7.2.2 UMTS Release R5 : ajout du domaine IP multimdia
La release R5 introduit un nouveau domaine, lIP Multimdia (IM) Subsystem, sappuyant sur les services du domaine paquet pour fournir des services de communications convergents (voix sur IP, donnes, multimdia) en IP natif. Ainsi, les communications multimdia ne sont plus supportes de manire transparente mais deviennent le mode de communication cible de lUMTS. Ce nest que pour des raisons de compatibilit avec les rseaux GSM/GPRS et UMTS R99 et avec les terminaux non IP multimdia que le domaine circuit (MSC servers et MGW associes) est maintenu.
Le coeur de rseau UMTS IP multimdia utilise le protocole SIP pour grer les sessions IP multimdia, et le protocole IP pour le transport du trafic et de la signalisation associs. Il supporte linterfonctionnement avec les rseaux voix et donnes IP fixes et mobile existants, y compris Internet.
80
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Le choix du protocole de contrle dappel pour les appels VoIP et multimdia a fait lobjet de longues discussions, mais SIP a fini par simposer au 3GPP grce son caractre IP natif et son apparente simplicit compar H.323. Le protocole SIP de lIETF doit cependant tre enrichi pour prendre en compte certaines volutions spcifies par le 3GPP pour un usage dans le cur de rseau UMTS, notamment concernant les spcificits lies la gestion de la mobilit.
Alternative Access Network
Applications & Services *) SCP Mh
Legacy mobile signallingNetwork
R-SGW *) Mw Ms Cx CSCF Mr MRF Gi GGSN Gn Gi Mg
CSCF Mm
Multimedia IP Networks
DOMAINE PAQUET
CAP HSS *) Gr
DOMAINE IP MULTIMEDIA Gi MGCF Mc PSTN/ Legacy/External T-SGW *)
ACCES RADIO
EIR Gf
BSS/ Iu GERAN
Gc
Gi
TE R TE R
MT Um
Gb Iu
SGSN
Iu MT Uu
UTRAN
A MGW
MGW Nb Mc Nc GMSC server DOMAINE CIRCUIT
Iu
Mc MSC server CAP Applications & Services *)
T-SGW *)
CAP
D HSS *)
C R-SGW *) Mh *) Ces lments appartiennent la mme entit logique
Signalling Interface Signalling and Data Transfer Interface
Figure 22 : Architecture de rfrence Release 2000 (source : 3GPP TR 23.821)
Pour assurer le contrle dappel et la gestion de la signalisation dans ce nouveau domaine, de nouvelles entits sont ajoutes, ou des quipements existants sont modifis. Le tableau ci-aprs en fait une synthse, ainsi quune correspondance avec les fonctions NGN prsentes plus haut dans le rapport.
Autorit de rgulation des tlcommunications
81
Fonction UMTS
Rle
Correspondance architecture NGN Serveur SIP volu (ajout fonctions spcifies par le 3GPP)
CSCF (Call State Control Server)
Contrle dappel multimdia. Dialogue avec le MGCF avec le protocole SIP-T.
MGCF (Media Gateway Controller Function) T-SGW (Transport Signalling Gateway)
Contrle de la ou des Media Gateways Media Gateway Controller qui lui sont rattaches, avec le (Cf. IETF, groupe Megaco) protocole H.248 (+ extensions 3GPP).
Gestion de linterfonctionnement de la signalisation avec le rseau commut fixe (adaptation des couches basses)
Signalling Gateway
R-SGW (Roaming Gestion de litinrance entre le rseau Signalling UMTS R4/R5 et les rseaux UMTS Gateway) R99, GSM et GPRS, avec adaptation des couches basses de signalisation MRF (Multimedia Resource Function) HSS (Home Subscriber Server) Gestion des appels multimdia multiparties et de confrence
Signalling Gateway spcifique mobile
Fonction MCU dans H.323 (fonction MCU ou utilisation du multicast dans SIP) Fonction SIP registar
Evolution du HLR pour incorporer la gestion du profil de services IP multimdia de lutilisateur (fonction serveur UMS User Mobility Server)
En terme de gestion de la mobilit, le HSS UMTS est charg de la mise jour du profil utilisateur, et peut intgrer ou cooprer avec des entits standards dans le monde IP, comme un serveur distant dauthentification et dautorisation (RADIUS) ou un serveur grant la rsolution dadresse et lallocation dynamique dadresse IP (fonctions DNS et DHCP).
Avec la R5 UMTS, le transport IP se gnralise progressivement lensemble du rseau, et IPv6 est introduit dans le cur de rseau :
Il est noter que les interfaces de transport en sortie de lUTRA, qui taient de type ATM en R99, voluent en IP en R5 (lvolution du transport en IP au sein de lUTRA et sur la voie radio tant prvue pour des tapes ultrieures de la norme). Le protocole de transport spcifi pour le domaine paquet est IP (entre RNC, SGSN et GGSN), avec support des options IPv4 et IPv6. Au sein du domaine IP Multimdia (lments IP multimdia du cur de rseau + quipements terminaux associs), la norme spcifie lutilisation exclusive dIPv6, et un usage optimal dIPv6 doit tre fait. Interoprabilit IPv4/IPv6 : les quipements terminaux IP multimdia doivent pouvoir accder des applications IPv4 et IPv6, et le cur de rseau doit assurer si ncessaire linteroprabilit entre son transport IPv6 et un rseau IPv4 externe.
82
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.4.7.3 Influence de lUMTS sur la stabilisation du concept NGN
LUMTS aura un rle potentiel fort sur lmergence et la stabilisation du concept NGN.
LUMTS est le premier systme global qui intgre dans ses spcifications futures (releases R4/R5) des options dvolution vers une architecture rellement NGN.
Les protocoles choisis terme par le 3GPP sont :
SIP pour le contrle dappel, Megaco/H.248 pour le contrle des Media Gateways, SIGTRAN pour le transport de la signalisation SS7 sur IP. Pour la signalisation entre Media Gateway Controllers, le choix reste ouvert, mais le protocole BICC est cit nommment et semble mis en avant.
Si lUMTS rencontre un dveloppement et un succs important, et si les rseaux UMTS migrent rapidement vers une architecture conforme aux spcifications des versions R4/R5, les choix technologiques effectus par le 3GPP ne manqueront pas dinfluer sur le choix global des protocoles dans un rseau NGN, tous domaines confondus, fixe et mobile. Cela semble particulirement vrai pour les protocoles SIP et IPv6.
3.4.8 En conclusion
Il ressort de notre analyse quau niveau de la couche Contrle, les principales incertitudes concernent le choix des protocoles. En effet, pour chaque domaine concern, deux protocoles sont en gnral en lice, lun plus ancien et plus proche de lhritage tlphonie , et lautre plus rcent et plutt hrit du monde Internet. Cette situation soulve immanquablement la question de linteroprabilit court/moyen terme entre solutions implmentant des protocoles diffrents.
Signalisation de contrle dappel : SIP vs H.323 SIP semble tre le protocole choisi par la plupart des acteurs pour sa simplicit et son utilisation des technologies et format web . Cependant ce protocole apparat comme ntant pas encore mature pour des dploiements en masse. H.323 est identifi comme un protocole plus lourd que SIP, notamment pour la gestion du transit, mais est actuellement le protocole le plus implment car il fut, historiquement, le premier standard disponible.
Signalisation de commande des Media Gateways : Megaco/H.248 vs MGCP Bien que les avis soient plus partags, la tendance concernant ces protocoles est comparable SIP vs H.323 : Megaco/H.248 semble tre la cible identifie par la plupart des acteurs. Mais du fait de la plus grande maturit des offres (du moins pour certains constructeurs), MGCP pourrait tre largement utilis court terme.
Autorit de rgulation des tlcommunications
83
Signalisation de transit : BICC vs SIP-T BICC prvu initialement pour le transport de la signalisation entre serveurs de contrle sur ATM, et SIP-T sur IP. Les deux protocoles voluent en fait pour supporter les deux modes de transport. Il est possible que le consensus qui se dessine autour de SIP pour le contrle dappel bnficie terme SIP-T.
Par ailleurs, certains constructeurs proposent des variantes dimplmentation de ces nouvelles technologies, chacune pouvant tre pertinente ou avantageuse pour loprateur en fonction de son architecture de rseau et de son modle conomique.
Solutions call server globales ou spcialises : Les deux solutions existent. Les petites socits nouvelles dveloppant des softswitch semblent privilgier des solutions call server spcialises, avec sparation des fonctions call agent (gestion de linterface avec le rseau tiers, pilotage des media gateways) et des fonctions spcifiquement Class IV (contrle dappel de niveau transit) ou Class V (contrle dappel de niveau accs).
Signalling gateway spare, ou intgre : La fonction Signalling Gateway peut tre implmente de diffrentes manires. Elle peut tre :
Implmente sur un quipement ddi, ce qui ncessite notamment une gestion des interconnexions spcifique (signalisation quasiassocie : acheminement spar du trafic et de la signalisation). Ce type darchitecture est encore mal connu des oprateurs tlphoniques classiques. Intgre dans les Media Gateways, auquel cas le trafic et la signalisation aboutissent physiquement sur le mme quipement. Intgre dans les serveurs dappel (avec en gnral transit via les Media Gateways), ce qui aboutit une architecture physique similaire au cas prcdent.
Les trois options dimplmentation sont proposes selon les constructeurs, en fonction de leur offre de plates-formes matrielles et de leurs orientations stratgiques. Elles peuvent impacter larchitecture des oprateurs mais a priori pas les fonctions rendues.
Concernant les rseaux mobiles, ils semblent prendre en compte l'volution vers les NGN de manire plus explicite en termes de normalisation (Cf. chapitre 3.4.7 ci-dessus sur la normalisation du systme UMTS), la maturit des offres de produits (Cf. chapitre 5.5) fait que les premiers dploiements NGN s'effectuent plutt dans le domaine des rseaux et services fixes.
84
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.5 Les Services : des plates-formes unifies et des interfaces ouvertes
Actuellement, les services sont ddis un type de rseau : services Rseau Intelligent sur le rseau tlphonique pour les terminaux tlphoniques (fixes ou mobiles), et services mail, web, news sur les rseaux IP. Lapparition des nouveaux rseaux daccs, tels que lUMTS, le GPRS, lxDSL, lEthernet longue distance, les rseaux cbls (Cf. Chapitre 3.2 couche daccs), et la multiplication des terminaux communicants (tlphone mobile GPRS/ UMTS, PDA,) et la convergence des curs de rseaux, poussent une transformation de larchitecture des plates-formes de services. Cette nouvelle architecture doit offrir la possibilit aux clients daccder aux services, quels que soient la nature des terminaux et le type de protocole utilis pour accder aux plates-formes de services, via un rseau de transport unifi, en mode paquet. Le service rendu doit tre adapt aux besoins et aux moyens des clients.
La ncessit doffrir des services multi-rseaux et multi-terminaux a conduit la dfinition de nouveaux concepts et fonctions : La portabilit et ladaptabilit des applications qui permet de fournir les services sur diffrents terminaux tout en gardant son environnement personnalis (portail, Virtual Home Environment) Pour offrir ces services, adaptables et portables , il est ncessaire de dployer de nouveaux protocoles et de nouvelles architectures qui feront le lien entre les plates-formes de services et les utilisateurs connects aux rseaux NGN. Ces nouveaux outils (architectures et protocoles) doivent tre utilisables dans des contextes trs divers et seront donc des outils ouverts et convergents permettant de simplifier les communications entre terminaux et entre terminaux et serveurs dapplications.
Deux modles principaux et complmentaires mergent de ces besoins dvolution darchitecture de la couche Services :
Une architecture centre sur le Softswitch , base sur linterface de services normalise du modle OSA/Parlay. Ce modle est plutt adapt pour des services de type tlcoms ncessitant une coopration forte du rseau de contrle dappel (serveurs, bases de donnes). Un modle orient Web Services , bas sur les technologies et des protocoles issus du monde Internet (XML, SOAP) avec une architecture distribue plus adapte la fourniture de services en mode transparent sur IP, avec une coopration forte du terminal.
Alors que le modle web services sappuie explicitement sur le protocole de contrle dappel SIP, le modle OSA est a priori indpendant du protocole de contrle dappel retenu, mais semble plus souvent voqu dans un contexte dutilisation de SIP que de H.323.
Autorit de rgulation des tlcommunications
85
3.5.1 Le VHE ou Virtual Home Environment
Le VHE ou Virtual Home Environment est un concept denvironnement de services personnaliss (Personal Service Environment ou PSE) qui a t dfini par le 3GPP dans le cadre de la normalisation de lUMTS. Il comprend :
la personnalisation des services pour des utilisateurs de profils diffrents la portabilit de lenvironnement personnalis de services (PSE) travers divers rseaux daccs (fixe, mobile, IP) et sur des terminaux de natures diffrentes.
Ainsi les utilisateurs pourront accder leurs services et leur environnement personnalis quels que soient le rseau et le terminal quils utilisent. Pour cela la cration des services est base sur des outils standardiss comme les interfaces OSA/Parlay (Cf. chapitre 3.5.2 suivant), les protocoles CAMEL (Cf. paragraphe 3.5.5.9 ci-dessous), MExE (Cf. chapitre 3.6 concernant les terminaux), JAVA (Cf. paragraphe 3.5.7.1), CORBA (Cf. paragraphe 3.5.7.3).
Dans son principe, le modle VHE na rien de spcifique aux rseaux mobiles. Donc il pourrait tre aisment transpos au domaine des rseaux fixes, domaine qui est dailleurs inclus dans le champ dapplication de VHE (hormis les outils CAMEL et MexE, qui sont spcifiques mobile).
3.5.2 Le modle OSA/Parlay
Larchitecture OSA (Open Service Access) propose une interface standardise, par les API (Application Programming Interface), pour les applications en vue dutiliser les capacits du rseaux sans avoir besoin de connatre les technologies utilises.
Applications (indpendantes des rseaux de transport et de contrle utiliss)
Application 1 Application 2
..
Application N
Parlay/OSA API
Interface OSA
Adaptation aux protocoles de rseau
La complexit du rseau est cache aux applications.
Rseau Contrle / Transport
Figure 23 : Rle de linterface OSA (source API group)
Linterface OSA a pour objectif de cacher la complexit du (des) rseau(x) aux platesformes de services.
86
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Service Service Application Service Application Application Service Control Point(SCP) INAP Service Switching Point (SSP)
OSA/PARLAY
API Interface Adapter API API Media Gateway Controller Signalling Gateway SIP SIP server SIP
API
Integrated Service Node
SS7 over IP MGCP or H.248 Media Gateway Voice over RTP
ISUP or PRI
Circuit-switched network
IP-based network
Figure 24 : Architecture dun rseau avec linterface OSA (source ETSI/GA38)
Ce modle est spcifi et standardis par le Joint API Group qui fdre les travaux du 3GPP, de lETSI, du JAIN (Java APIs for Interoperable Networks) et du Parlay Group . Lobjectif de ce groupe de travail tant de proposer une interface standardise unique pour lensemble des besoins, chaque organisme sest align sur ce modle fdrateur : le 3GPP travers SA1 et SA2, ETSI par le SPAN 14 SPAR, et Parlay par le groupe Parlay.
Le modle OSA est donc partag et soutenu par un nombre important dorganisations issues du monde des tlcommunications mobiles et fixes (3GPP, ETSI, Parlay Group) ou transverses aux mondes tlcoms et Internet (JAIN).
3.5.2.1 3GPP / OSA
Le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) est le fruit dune collaboration de plusieurs organismes de standardisation ainsi que la plupart des constructeurs ayant pour objectif me de dfinir un ensemble de spcifications techniques pour les systmes mobiles de 3 gnration. En particulier, le 3GPP demande la dfinition dune architecture permettant doffrir le concept VHE (Virtual Home Environment) ; il a identifi le modle OSA comme un des outils ncessaires la mise en place du concept VHE.
3.5.2.2 Le groupe Parlay
Le groupe Parlay est un forum ouvert ayant pour objectif de dfinir les spcifications dune API (Application Programming Interface) pour le modle OSA. Cette interface doit permettre aux diffrents acteurs, oprateurs, programmeurs et fournisseurs de services, de dvelopper des applications multi-technologies et multi-rseaux : cest le lien entre les services et les rseaux. LAPI permet de supporter les services dune tierce partie (ASP), en dfinissant une infrastructure grant les changes scuriss entre clients et serveurs.
3.5.2.3 JAIN (Java APIs for Interoperable Networks)
Lobjectif de JAIN Initiative est de crer un ensemble ouvert, depuis les fournisseurs de services tiers, en passant par les oprateurs et les constructeurs, jusquaux fabricants de
Autorit de rgulation des tlcommunications
87
terminaux et aux clients finaux. Cet ensemble est dfini pour tre distribu depuis nimporte quel protocole et middleware tels que RMI (Remote Method Invocation), CORBA (Common Object Request Broker Architecture) et DCOM (Distributed Common Object Model). Larchitecture JAIN sappuie sur les dveloppements du langage de programmation JAVA.
Le service de contrle dappel de JAIN est bas sur celui dfini par le groupe Parlay . Ainsi, la technologie Java et larchitecture JAIN servent doutils pour les ralisations des lments du modle OSA.
Larchitecture JAIN Initiative sarticule autour de deux axes :
Les spcifications des Protocol API qui dfinissent linterface avec les protocoles de signalisation des rseaux fixes, mobiles et IP. Ce sont les API TCAP, ISUP, MAP, INAP, MGCP, SIP, H.323, MEGACO, ENUM, SDP,
Les spcifications des Applications API en charge de la dfinition des API ncessaires la cration de service, avec laide de Java, pour tous les protocoles couverts par les Protocol API . Ce sont les API permettant de grer linterface avec les systmes de contrle dappel mais aussi de dvelopper des services tels que la gestion de la prsence et de la disponibilit, la gestion de la fourniture de services, la gestion des utilisateurs ou la cration denvironnement utilisateurs.
Services, Applications
Fonctionnalits dadministration
(Gestion, activation des services, back office)
Applications
APIs
Couche Contrle Protocols APIs Couche Transport
Figure 25: Positionnement des API JAIN dans larchitecture OSA/Parlay (source Arcome)
3.5.2.4 Larchitecture du modle OSA/Parlay
La spcification OSA/Parlay dfinit une architecture permettant aux applications de services dutiliser les ressources du rseau telles que le contrle dappel, la gestion de confrence, les informations de localisation. Concrtement, linterface standardise ouverte OSA/Parlay :
est le lien des plates-formes de services avec la couche Contrle pour la signalisation (et avec la couche Transport pour le trafic) et facilite laccs au rseau pour les applications de services.
88
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
offre des outils ncessaires au bon fonctionnement des services, tels que la gestion de la scurit (authentification, autorisation), des utilisateurs (profil, tat) et le contrle dappel.
La passerelle OSA/Parlay se compose de diffrentes fonctions :
Le Framework , responsable du contrle daccs au service et de la gestion des ressources attribues ces services. Les SCS ou Service Capability Servers qui fournissent linterface vers les applications. Chaque SCS est vu par les applications comme un ou plusieurs SCF. Les SCF ou Service Capability Features qui adaptent les services aux capacits du rseau accessible par lAPI OSA/Parlay.
Serveur da pplication Applica tion
OSA API
Framework
User Call control Service capability servers Location
interface class
Non standardis
API OSA Interne
HLR
CSE
WGW WPP
Serveurs Ex : Serveur de localisation Serveur de facturation
Figure 26: Dtail de linterface OSA/Parlay (source API group)
Autorit de rgulation des tlcommunications
89
3.5.2.5 Linterface OSA
Ce chapitre dtaille les trois types dinterfaces qui composent lAPI OSA :
Les interfaces entre les applications et le Framework qui fournit les fonctionnalits de base (ex : authentification, autorisation) pour accder aux fonctionnalits des rseaux. Les interfaces entre les applications et les SCF, qui sont les outils ncessaires aux utilisateurs pour accder, via linterface OSA, aux services dlivrs par des tiers. Les interfaces entre le Framework et les SCF qui offre la possibilit de grer les environnements dquipements provenant de constructeurs diffrents.
3.5.2.5.1 Framework
Lun des SCS de linterface Parlay/OSA est appel le Framework . Il est indispensable au bon fonctionnement des services car il gre :
Les fonctions dauthentification des applications pour accder au rseau. Les fonctions dautorisation pour les applications utiliser certains SCF et donnes clients, et, pour les clients, utiliser une application (vrification dinscription). Les fonctions de dcouverte des SCF, permettant aux applications dobtenir des informations sur les SCF accessibles. La gestion dtablissement de services pour les applications qui doivent accepter en ligne le contrat doffre de services. La gestion de lintgrit des services : gestion de la qualit du service rendu. La gestion de lenregistrement des SCF.
3.5.2.5.2 SCF
Les SCF sont linterface entre les services et le rseau et donc les utilisateurs. Les fonctionnalits des SCF sont donc focalises sur la gestion des utilisateurs et des sessions daccs aux services. Les SCF actuellement dfinies et implmentes sont :
Linteraction avec lutilisateur pour obtenir des informations sur celui-ci, lui transmettre des messages crits ou vocaux. La localisation et les caractristiques de lutilisateur final Le traitement des caractristiques du terminal utilis Le contrle des sessions avec lutilisateur La gestion de laccs la messagerie La gestion de la qualit de service La gestion des comptes client
Les prochaines volutions concerneront principalement :
Lvolution du contrle dappel multimdia Le service de prsence La recherche des capacits rseaux La gestion des profils des usagers
90
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.5.3 Les WEB SERVICES : Une architecture alternative au modle OSA/Parlay
Alors que le modle OSA/Parlay est orient vers larchitecture centre sur les Softswitches, un autre modle de fourniture de services pour les rseaux NGN apparat. Celui-ci, bas sur une architecture et des protocoles orients web , dfinit un modle beaucoup plus distribu : ce sont les Web Services . En lan 2000, le W3C (World Wide Web Consortium) a cr le XML Protocol Activity pour standardiser un protocole de communication inter-applications bas sur XML. En 2002, sous limpulsion notamment de Microsoft, IBM, Sun et Oracle, laction de ce groupe a t tendue lensemble des aspects des Web services et IP et sappelle dsormais le Web Services Activity . Un Web service est une interface ouverte qui dcrit un ensemble doprations qui sont accessibles dans le rseau en utilisant un format standard de messages XML. La description du Web service dfinit lensemble des interactions avec le service, incluant le format des messages, les protocoles de transport et de localisation. Cette interface permet dimplmenter les services indpendamment des plates-formes logicielles et matrielles sur lesquelles ils sont installs et des langages dans lesquels ils ont t crits. Alors que le Web permet une interaction entre un utilisateur et un programme, les Web services permettent dtablir un moyen de communications entre programmes.
SIP client emulator Protocol adapter SCP emulator
Session Control Gateway
SIP SIP
INAP Service Switching Point (SSP) Service SIP Application SIP server SIP ISUP ou PRI Rseau commutation de circuits TE or PBX SIP emulator server Media Gateway SIP
Service Application SIP server SIP SIP SIP
ENUM DNS
Voice over RTP Rseau IP
Figure 27 : Architecture du modle Web services (source ETSI/GA38)
Laccs ces Web services peut seffectuer directement dans une simple session client/serveur, cependant il semble que lon soriente vers un accs aux services travers des portails qui seront chargs des fonctions dauthentification des clients, des recensements des services et de facturation de services. Pour offrir une relle interaction entre programmes, les web services sont bass sur des standards existants ou mergents, tels que HTTP, XML (Extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language) et UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).
Ce modle de fourniture de services est fortement associ au protocole SIP. En effet, il est indispensable, pour accder aux Web
Autorit de rgulation des tlcommunications
91
services , dtablir une session client/serveur : cest le rle du protocole de commande dappel, SIP.
Exemple : les Web Services .NET (de Microsoft), Websphere (dIBM) et J2EE (de Sun) La stratgie .NET de Microsoft a pour objectif de crer un architecture oriente vers les web services . Cela inclut : Les serveurs sur lesquels repose linfrastructure. Les Web services , architecture permettant laccs format linformation multimdia et la cration dapplications web. Les outils permettant la cration des web services (Visual Studio .NET) Les briques de base : authentification (Passport .NET), gestion du calendrier, de la messagerie unifie. Par exemple, loffre .NET Passport dcline la notion daccs en mobilit / depuis nimporte quel rseau aux services et aux contenus Internet. Elle est aussi lie au dveloppement croissant des services de type e-commerce. Elle inclut des services de connexion unique scurise, de portefeuille lectronique, de contrle de confidentialit des donnes transmises.
IBM propose aussi des solutions Web services avec sa gamme Websphere. Le WebSphere Telecom Application Server dIBM est une plate-forme de cration et de dveloppement de services pour les NGN, indpendante des rseaux et des solutions de transport, qui sappuie sur la technologie Java (API JAIN). Des interfaces de selfprovisioning de services peuvent tre dveloppes via la solution Websphere Studio. La solution sintgre aux rseaux tlphoniques, ainsi quaux autres plates-formes de la suite Websphere dIBM (Commerce Suite, Voice Server). De mme, Sun Microsystems propose lui aussi des solutions Web services avec J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Cette plate-forme permet de dvelopper des applications dentreprises distribues et portables dans diffrents environnements, bases sur des composants standards et modulaires. Elle sappuie notamment sur les technologies Java, Corba et XML.
Contrairement au modle OSA, le modle Web Services est dj mis en application par de grands industriels du domaine logiciel (bien que cette mise en uvre se limite laccs Internet). Cela sexplique par larchitecture-mme de ce modle de services qui sont distribus, donc relativement indpendants du rseau et excutables de manire transparente avec un niveau douverture faible des rseaux.
3.5.3.1 Les protocoles utiliss pour les Web services
Les Web Services reposent sur des protocoles qui forment la couche dadaptation pour la fourniture des services. Il sagit de protocoles utilisant le format XML :
SOAP (Simple Object Access Protocol): qui dfinit la structure du message XML utilis par les services Web pour dialoguer entre-eux et automatiser ce dialogue. WSDL qui est un format de description des composants (c'est--dire des services eux-mmes) invocables par le biais de messages XML au format SOAP. Il permet
92
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
de reconnatre les schmas XML utiliss et d'tablir une connexion entre consommateur et fournisseur.
UDDI qui s'appuie lui-mme sur des services Web pour proposer un annuaire mondial d'entreprises. Il fournit ainsi un outil pour communiquer tout type de coordonnes (adresse gographique, numro de tlphone, fax, adresse de site, etc.)
Static Direct
UDDI UDDI WSDL SOAP
Service Discovery Service Publication Service Description XML-Based Messaging Network
Quality of Service Management
Security
HTTP, FTP, email, MQ, IIOP, etc...
Figure 28: Suite de protocoles impliqus dans limplmentation des Web services (source IBM)
3.5.3.1.1 SOAP
SOAP est un protocole pour lchange dinformations dans un environnement dcentralis et distribu, comme Internet par exemple. Il a t pris en compte comme note par le W3C. SOAP permet linvocation de mthodes, de services, de composants et dobjets sur des serveurs distants. SOAP peut normalement fonctionner sur de nombreux protocoles mais il opre particulirement bien avec le protocole HTTP. SOAP repose sur lutilisation combine de :
XML pour la structuration des requtes et des rponses, reprsentant les paramtres des mthodes, les valeurs de retours et les ventuelles erreurs lies aux traitements. HTTP comme mcanisme dinvocation de mthodes. Pour ce faire, il repose sur un jeu rduit de paramtres prciss dans les en-ttes HTTP, facilitant le filtrage par les proxy et firewall.
Autorit de rgulation des tlcommunications
93
Il est donc bas sur lutilisation de XML pour structurer la nature dun change dont on peut distinguer :
Une enveloppe, qui propose un framework visant dcrire ce qui est prsent dans un message (la requte) et la faon dont il doit tre trait. Un ensemble de rgles de codage permettant de dcrire les instances des types de donnes lies lapplication. Une convention pour reprsenter les appels aux procdures distantes ralisant le traitement et les rponses.
De plus, SOAP est un protocole bas sur du texte. Bas sur HTTP et tant orient ASCII, il pose moins de problmes dintgration avec les quipements de scurit.
Serveur WEB dapplications de traduction SOAP Method Call Urn : xmethodsBabelFish
2 SOAP
1 SIP
Message sip : martin@france.fr ; translate=en_fr SIP/2.0
3 SIP
Message sip : martin@france.fr ; translate=en_fr SIP/2.0
Serveur SIP
Hello World
Bonjour Monde
Figure 29 : Exemple de service fourni par les protocoles SIP et SOAP (source Ubiquity)
Lexemple ci-dessus donne une illustration des services possibles en associant le protocole dtablissement de communication SIP SOAP :
Un utilisateur envoie un message Martin. Cependant ce message en anglais Hello World doit tre traduit pour tre compris. Pour cela, il suffit dajouter au message SIP, un en-tte translate = en_fr , qui sera alors interprt par le serveur SIP/SOAP. Celui-ci envoie alors une requte SOAP un serveur Web qui sera capable dexcuter la mthode xmethodsBabelFish pour effectuer la traduction du message. Ce serveur Web, retournera un message SOAP contenant le message mettre au destinataire. Celui-ci recevant le message traduit en franais, dune manire transparente.
94
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.5.3.1.2 WSDL ou Web Services Description Language
WSDL (Web Services Description Language) est un format XML de prsentation actuellement soumis au W3C. Un document WSDL dfinit les services comme un ensemble de ports (points du rseau). Pour cela WSDL utilise plusieurs lments permettant de dfinir les services offerts sur le rseau. WSDL permet les descriptions des ports de services, indpendamment du format des messages et des protocoles de rseaux utiliss.
3.5.3.1.3 UDDI ou Universal Description, Discovery, and Integration
Lanc par IBM, Ariba et Microsoft, le projet UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) n'est pas vraiment un standard pour les Web Services. En fait, UDDI s'appuie lui-mme sur des services Web pour proposer un annuaire mondial d'entreprises. Il fournit ainsi un outil applicatif pour communiquer tout type de coordonnes (adresse gographique, numro de tlphone, fax, adresse de site, etc.), mais galement la rfrence des spcifications permettant de faire dialoguer entre-eux les Web Services ou les places de march. Les spcifications UDDI sont en cours de finalisation. La version 2 des spcifications devrait tre publie d'ici la fin de l'anne. Bien que ce type dannuaire puisse grer notamment des numros dappel et adresses diverses, il sagit dune fonction dannuaire de niveau applicatif, et non de niveau rseau. Ce mcanisme nest donc pas directement li des mcanismes dadressage rseau comme ladressage SIP ou ENUM ou les fonctions DNS.
3.5.4 Comparaison des modles OSA/Parlay et Web Services
Les deux modles, OSA/Parlay et Web Services , ont un mme objectif : permettre un accs personnalis aux services multimdia adapts au terminal utilis. Pour cela, il est ncessaire dutiliser une couche dadaptation permettant de grer linterface entre les applications fournissant les services et les ressources rseaux : cest linterface API OSA/Parlay pour le modle OSA et une suite de protocole, SOAP, WSDL et UDDI, pour les Web Services . Cependant, ces deux modles de services NGN diffrent dans leur architecture :
Le modle OSA/Parlay (3GPP, Parlay, JAIN) est orient vers une architecture base sur un softswitch, qui, tant le nud central de la couche contrle, est le passage obligatoire pour accder aux services, via linterface OSA/Parlay.
Le modle OSA/Parlay semble donc plutt adapt aux services fortement dpendants de fonctions de la couche Contrle du rseau (ex. : demande dinformation sur la localisation, ou sur les caractristiques du terminal).
Le modle Web Services prconis par le W3C est, comme son nom lindique, bas sur des technologies Web dont larchitecture est distribue. Linitiation des sessions est prise en charge par le protocole SIP (Session Initiation Protocol). La couche dadaptation, ncessaire pour laccs aux services, est prise en charge par un ensemble de protocole web , tels que XML, SOAP, WSDL et UDDI.
Autorit de rgulation des tlcommunications
95
Le modle web services est, lui, plutt adapt aux services relativement transparents au rseau (communication universelle entre terminal et serveur, ou entre terminaux, ou entre serveurs, une fois la connexion rseau tablie entre les deux entits). Il sappuie sur des concepts dj anciens dinformatique distribue. Son introduction impacte essentiellement la couche Services et dans une moindre mesure les terminaux, mais peu le rseau. Cest ce qui explique quil est dj mis en uvre dans le domaine Internet, et pourra aisment tre largi aux autres domaines.
A priori, ces deux modles ne sont pas concurrents mais complmentaires. On peut en effet imaginer des applications mixtes bases sur le modle web services mais faisant appel pour certains services des requtes de type OSA/Parlay. Le modle OSA sera par ailleurs plus long et difficile mettre en uvre du fait de sa forte dpendance du rseau. Il devrait avoir vocation se dvelopper avec lessor des rseaux et services UMTS.
3.5.5 Exemples de services offerts
Les NGN offrent les capacits, en termes dinfrastructure, de protocole et de gestion, de crer et de dployer de nouveaux services multimdia sur des rseaux en mode paquet. La grande diversit des services est due aux multiples possibilits offertes par les rseaux NGN en termes de :
support multimdia (donnes, texte, audio, visuel). mode de communication, Unicast (communication point point), Multicast (communication point-multipoint), Broadcast (diffusion). mobilit (services disponibles partout et tout le temps). portabilit sur les diffrents terminaux.
De plus, la notion de personnalisation et dadaptation de services aux utilisateurs est trs prsente dans le concept de fourniture de services par les rseaux NGN. Plusieurs lments-cls communs ressortent, comme limportance des bases de donnes (notamment pour la gestion de personnalisation des contenus, des paiements, de la localisation), et la gnralisation du fonctionnement transactionnel et temps rel. Ce chapitre donne un aperu non exhaustif des services particulirement pertinents dans le cadre des NGN. Les services sont amens voluer fortement et de nouveaux services non connus ce jour apparatront.
96
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.5.5.1 La messagerie unifie
Le service de messagerie unifie est lun des services les plus avancs : cest le premier exemple de convergence et daccs linformation partir des diffrents moyens daccs. Le principe est de centraliser tous les types de messages, vocaux (tlphoniques), crits (email, SMS), multimdia sur un serveur ; ce dernier ayant la charge de fournir un accs aux messages adapt au type du terminal de lutilisateur. Ainsi un email peut tre traduit en message vocal par une passerelle text-to-speech ou inversement un message vocal sera traduit en mode texte.
3.5.5.2 La messagerie instantane
Cette application a dj un grand succs auprs des internautes : elle permet de dialoguer en temps rel, plusieurs, sur un terminal IP (gnralement un PC) ayant accs Internet via une interface texte. Cependant, il est ncessaire dinstaller sur son terminal un logiciel propritaire permettant de se connecter un fournisseur daccs ; il nest alors possible de communiquer quavec les utilisateurs souscrivant au mme service. Lvolution des rseaux devrait permettre la standardisation de cette application et la communication entre tous (ouverture du service) partir de nimporte quel terminal. Cest lvolution du service SMS, par lapport de linteractivit et du multimdia (MMS).
3.5.5.3 La diffusion de contenus multimdia
La diffusion de services multimdia est un des services qui commence merger et qui prendra une place de plus en plus importante avec lvolution de la bande passante laccs et la capacit de traitement des terminaux. La diffusion de contenu multimdia regroupe deux activits ; lune focalise sur la mise en forme des contenus multimdia, lautre centre sur lagrgation de ces divers contenus via des portails. Les outils technologiques, tels que le multimdia streaming (gestion dun flux multimdia en termes de bande passante, de synchronisation des donnes) et le protocole multicast (diffusion point-multipoint), doivent permettre de fournir un service de diffusion de contenu aux utilisateurs finaux. Cependant il ne sera pas possible de penser la diffusion de vido haute dfinition sur rseau paquet tant que les rseaux daccs ne pourront pas fournir des dbits de plusieurs dizaines de Mbit/s par utilisateur.
3.5.5.4 La voix sur IP
La voix sur IP est un service directement li lvolution vers les rseaux NGN. Cest une application qui est apparue depuis longtemps mais qui na pas encore eu le succs escompt, et cela pour diffrentes raisons :
La jeunesse des protocoles de signalisation (SIP, H.323, Megaco) de voix sur IP et la gestion de la qualit de service qui commence seulement maintenant tre mature ne permettaient pas de dployer de services tlphoniques sur IP. Le seul fait de transporter la voix sur IP napporte pas de valeur ajoute pour lutilisateur final, par rapport au service de voix classique. Les services associs la voix sur IP nont pas encore la maturit ncessaire pour pousser lvolution vers ces nouveaux rseaux. La ncessit dinterconnecter les rseaux IP aux rseaux TDM/SS7 implique des cots lis aux quipements dinterconnexion (passerelles) et le prix des terminaux (IP phones) annihile lavantage financier apport par le transport en IP. Le cot des terminaux IP reste encore suprieur celui des quipements classiques (pas encore dconomies dchelle suffisantes).
Autorit de rgulation des tlcommunications
97
Cependant lvolution de la technologie et des protocoles et lapparition de services associs au monde IP devraient permettre lmergence de la voix sur IP. De plus, lvolution des terminaux communicants multimdia est un argument supplmentaire lvolution des rseaux tlphoniques vers la voix sur IP ; ainsi lUMTS, dans la release 5, gnralise le transport en IP au rseau voix.
3.5.5.5 Les services associs la golocalisation
La possibilit de localiser gographiquement les terminaux mobiles a t rapidement perue comme une source de revenus supplmentaires. En effet, la golocalisation permet de proposer aux utilisateurs finaux des services trs cibls haute valeur ajoute lis au contexte (ex :horaire, climat) et au lieu. Dans ce contexte, un forum nomm LIF (Location Inter-operability Forum), initi par les constructeurs de rseaux mobiles, a pour but de dfinir, via les organismes de standardisation et de spcifications, une solution commune de services de golocalisation. Actuellement plusieurs solutions techniques existent et sont mme en cours dimplmentation dans les rseaux doprateurs mobiles. Cependant, si ces solutions offrent la capacit de localiser les terminaux mobiles, il nexiste pas encore dinterfaces permettant lexploitation de ces donnes par les applications de services, ou de relle volont des oprateurs douvrir leurs serveurs de localisation des fournisseurs de services tiers, afin dutiliser cette fonction de localisation comme service capability server (lment de base servant de support la ralisation des services).
3.5.5.6 Les services fournis par des tiers ou ASP (Application Service Providers)
Les NGN, par lvolution et louverture des rseaux, doivent favoriser lvolution de lutilisation des services considrs comme classiques . Ainsi lutilisation des logiciels, la messagerie peuvent tre grs par un fournisseur de service travers le rseau. Ce mode de fourniture de services permet une flexibilit beaucoup plus importante et une rduction de cots grce lexternalisation.
3.5.5.7 Le-commerce et le m-commerce
Lvolution des terminaux vers des services intelligents et le dveloppement de solution de paiement scuris devraient favoriser le commerce en ligne . Dans cette optique, le Mobey Forum, a t cr en 2000 par des banques et des constructeurs de rseaux mobile pour dvelopper les services financiers (tlpaiement, gestion de portefeuille boursier) en favorisant louverture des solutions et leur interoprabilit.
3.5.5.8 Le stockage de donnes
Laugmentation de capacit des rseaux et la gestion des flux permettent de proposer des services de stockage de donnes, en tant que sauvegarde de donnes critiques sur des sites protgs, mais aussi en tant quaccs local un contenu (serveur proxy ou cache ). En effet, les volumes de donnes voluant de faon exponentielle, la ncessit doffrir les services partir des serveurs locaux semble indispensable. Cet aspect semble notamment indispensable pour les applications de tlvision interactive et de video on demand.
3.5.5.9 Lvolution du rle des services intelligents (IN) dans les NGN
Plusieurs volutions des protocoles de services de rseau intelligents sont prvues par les normes afin de prendre en compte les volutions vers les services de donnes
98
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
dune part, et dautre part afin dassurer une meilleure interoprabilit des services IN entre rseaux.
Illustration avec le cas des services IN mobiles : Les spcifications du groupe CAMEL (appartenant la GSM Association), qui normalisent linterfonctionnement des services IN entre rseaux mobiles diffrents comportent plusieurs phases. La phase 2 inclut des volutions pour prendre en compte la facturation temps rel en fonction des services, et enrichit les critres de dclenchement de services ainsi que les services eux-mmes. La phase 3 ajoute des fonctions lies la localisation et la gestion de la mobilit, la gestion des donnes utilisateur, au support des services de transmission de donnes paquet GPRS et du SMS-MO. NB : En UMTS, CAMEL fait partie intgrante du concept de Virtual Home Environment (VHE), au mme titre que les technologies Mobile station Execution Environment (MExE) and SIM Application Toolkit (SAT).
Cependant, dans un environnement multi-rseaux qui caractrise les NGN, il semble que lIN, qui se voulait un outil permettant une cration de services simple et une interoprabilit forte de ces services entre rseaux, nait pas fait ses preuves sur ces deux points. En effet :
lenvironnement de cration de services reste spcifique chaque constructeur, et complexe apprhender pour un non-initi , ce qui a limit la porte des dveloppements aux oprateurs, en relation troite avec leur fournisseur. Il existe ce jour trs peu de cas de mise en uvre dinterfonctionnement de services IN entre rseaux, du fait de sa complexit de mise en uvre et des protocoles spcifiques sur lesquels lIN sappuie (ex. : cas des rseaux mobiles sappuyant sur le protocole CAP issu des spcifications CAMEL, mais aussi cas des rseaux fixes sappuyant sur le protocole INAP).
Plusieurs constructeurs ont mme identifi lIN comme non pertinent dans le cadre des NGN , arguant que leur utilisation dans le cadre des NGN se limitera progressivement leur consultation comme bases de donnes . Dans le modle NGN OSA, les plates-formes IN ne sont dailleurs pas identifies comme des plates-formes de services part entire, mais comme des service capability servers (serveurs rseau sur lesquels les plates-formes de services sappuient pour lexcution des services).
3.5.6 Les outils ncessaires la fourniture de ces services
Les diffrents services voqus ci-dessus offrent la capacit de communiquer et daccder des contenus multimdia. Cependant, pour offrir ces services, il est ncessaire de prsenter :
Au client, des garanties (confidentialit, scurit), Aux fournisseurs de services, des outils permettant la gestion des services (facturation, authentification, gestion des paiements).
Pour les clients, la confidentialit et la scurit, sont grs par des mcanismes de cryptage au niveau du rseau de transport IP (IPsec), ou par des protocoles applicatifs (SSL, TLS). Pour les fournisseurs des services, les outils des gestion des services sont fournis par les modles OSA/Parlay et Web services .
Autorit de rgulation des tlcommunications
99
3.5.7 Les langages et protocoles convergents de dveloppement de services et contenus
Les deux modles de fournitures de services OSA/Parlay et Web services , sappuient sur des outils leur permettant doffrir ces interfaces pour standardiser et adapter la fourniture des services. Ce sont des langages tels que JAVA (OSA/Parlay, Web services), XML (Web services) et des protocoles tels que CORBA (OSA/Parlay) sur lesquels reposent les diffrents lments des interfaces.
Ces trois types de langages sont dj largement utiliss dans le domaine de linformatique industrielle et dInternet, et leur extension au domaine tlcoms (mobile en particulier) est en cours.
3.5.7.1 JAVA
Il sagit dun langage cr en 1991 par Sun Microsystem dans le but initial de dvelopper des logiciels embarqus pour contrler des appareils lectroniques et leur permettre de communiquer entre eux. Ce langage devait permettre de crer des applications sres et excutables sous diverses plates-formes (Windows, Macintosh, ) sans modification des applications. Depuis 1995, JAVA a connu un trs grand succs et est intgr dans la plupart des navigateurs et sur la plupart des plates-formes. JAVA est un langage de programmation orient objet. Driv du C++, JAVA peut sexcuter sous n'importe quelle plate-forme, pour autant que celle-ci intgre un interprteur JAVA (programme ou logiciel comprenant le langage ; le navigateur Web peut en tre un).
JAVA est utilis pour la cration des API JAIN de larchitecture OSA mais aussi pour les Web Services . Il sagit donc dun point de convergence entre ces deux modles de services.
JAVA est un langage la fois compil et interprt. La compilation du JAVA produit un fichier en langage intermdiaire entre le binaire et le code saisi. Ce fichier sera en suite interprt par une "machine virtuelle", fonctionnant, elle, dans un environnement particulier. On appelle donc communment de telles machines virtuelles "interprteur JAVA". Le langage JAVA permet de produire 2 types de programmes :
Les Applications qui s'excutent directement dans lenvironnement graphique de lordinateur o il est lanc. Les Applets qui sont des applications fonctionnant sur les navigateurs. Ils sont introduits dans une page HTML et excuts distance sur le terminal, via un navigateur Web.
3.5.7.2 XML ou eXtensible Markup Language
XML est un ensemble de rgles pour la conception de formats texte permettant de structurer des donnes. Il a t dvelopp par le XML Working Group sous la tutelle du World Wide Web Consortium (W3C) ds 1996. Depuis 1998, les spcifications XML1.0 sont reconnues comme recommandation par le W3C. Alors que HTML est un langage part entire, XML peut tre considr comme un mta-langage permettant de dfinir d'autres langages. Comme HTML, XML utilise les balises seulement pour dlimiter les lments de donnes et laisse l'entire interprtation des donnes l'application qui les lit. En d'autres termes, un "<p>" dans un fichier XML, peut tre un prix, un paramtre, une personne
100
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Lintrt de XML rside dans sa capacit pouvoir dcrire n'importe quel domaine de donnes grce son extensibilit. Il va permettre de structurer, poser le vocabulaire et la syntaxe des donnes qu'il va contenir. XML se caractrise par les points suivants :
Lisibilit : on ne doit pas avoir besoin de connatre le mtier pour apprhender le contenu d'un document XML Extensibilit Une structure arborescente : cette structure de base permet de modliser des contenus hirarchiss (par exemple afin dafficher plus ou moins de contenus en fonction des capacits du terminal utilis) Universel et portable : les diffrents jeux de caractres sont pris en compte Dployable : il peut tre facilement distribu par n'importe quel protocole mme de transporter du texte, comme HTTP Un des domaines les plus prometteurs de XML est l'change de donnes ou documents entre sites distants ou applications diffrentes, en utilisant XML comme un format pivot garant des donnes changes malgr la possible htrognit des bases de donnes ou logiciels mis en jeux.
De fait XML est le format standard utilis par les protocoles implments dans les Web Services .
3.5.7.3 CORBA ou Common Object Request Broker Architecture
La norme CORBA ou Common Object Request Broker Architecture est ne dans les annes 1990 du besoin de faire communiquer ensemble des applications en environnement htrogne (plusieurs systmes et plusieurs langages). C'est la solution apporte par l'OMG (Object Management Group) au besoin d'interoprabilit face la prolifration des machines et des logiciels disponibles sur le march.
CORBA 1.1 dfinit l'IDL (Interface Definition Language) et les API (Application Programming Interface) qui permettent l'interaction des objets client-serveur, l'aide de l'ORB (Object Request Broker). CORBA 2.0 finalise en 1995, dfinit un plus dans l'interoprabilit en spcifiant comment des ORB diffrentes peuvent collaborer.
CORBA reprsente les spcifications de l'ORB (Object Request Broker), qui est l'entit principale par laquelle toutes les commandes vont transiter, ou vont tre adresses. L'ORB est un middleware, qui tablit la relation client-serveur entre des objets. En utilisant un ORB, un client peut de faon transparente invoquer une mthode sur un objet serveur, qui peut tre sur la mme machine ou, au travers d'un rseau, sur une machine distante. L'ORB est responsable de trouver l'objet qui implmente cette requte, de lui passer les paramtres, puis d'invoquer la mthode, et enfin de retourner le rsultat. En faisant cela, l'ORB fournit l'interoprabilit entre des applications situes sur diffrentes machines dans un environnement distribu htrogne, et interconnecte des systmes d'objets multiples. L'ORB fournit la flexibilit, il permet au programmeur de choisir le systme d'exploitation, l'environnement d'excution, et mme le langage de programmation utiliser pour chaque composant d'un systme en construction.
CORBA est la brique de base sur lequel est implmente linterface OSA/Parlay.
Autorit de rgulation des tlcommunications
101
3.5.8 Conclusion
Lvolution des rseaux, aussi bien au niveau de la couche Transport que de la couche Contrle, permet le dveloppement de nouveaux services. Les rseaux daccs haut dbit, la gestion de la mobilit, la golocalisation sont autant doutils disponibles pour la cration de services multimdia encore plus interactifs et adaptables aux besoins des utilisateurs. La convergence et la flexibilit des couches de Transport et de Contrle se retrouvent invitablement au niveau des services fournis par les NGN. Cela se traduit au niveau de la couche service par la personnalisation et ladaptabilit des services proposs en fonction des profiles clients et des terminaux utiliss. Pour fournir ces services modulables, il est ncessaire, face la multiplication des rseaux daccs et des terminaux communicants, de dfinir une nouvelle architecture daccs aux services. Deux modles mergent : une architecture OSA/Parlay centre sur le Softswitch , et un modle orient Web Services distribu. Ces modles sont bass sur des protocoles et des interfaces ouvertes et standardises facilitant lmergence des fournisseurs tiers de services, mais aussi linteroprabilit entre les solutions. Cependant, ces deux modles sont issus dapproches trs diffrentes :
Le modle OSA/Parlay, bas sur linterface de services normalise du modle OSA/Parlay prconis par le 3GPP, a fdr un grand nombre de constructeurs tlcoms et doprateurs historiques. En effet, larchitecture, centre sur le Softswitch permet lvolution des rseaux tlcoms actuels. Le modle prconis par le W3C, les Web services , est, pour sa part, avanc et dj mis en uvre par les acteurs venant du monde Internet et informatique. Cette approche est base sur les technologies et des protocoles (XML, SOAP) issus du monde Internet avec une architecture distribue. Il est noter que le protocole de contrle dappel utilis dans cette architecture est le protocole SIP.
102
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
La relative jeunesse de ces modles ne permet pas de se prononcer formellement sur le succs de lun ou/et lautre des modles. Il ressort cependant : que lapproche OSA/Parlay est incontournable pour les acteurs tlcoms tablis voluant vers les NGN. Mais le succs du modle OSA se confirmera (ou sinfirmera) vraiment avec lessor des rseaux et services UMTS. que lapproche des Web services est moins complexe implmenter et donc plus accessible des fournisseurs de services tiers que linterface OSA/Parlay. La preuve en est lexistence ce jour des premiers services issus de ce modle. que les deux approches sont complmentaires, un services pouvant tout fait tre mixte (service Web services ayant recours des requtes OSA au cours de son excution). quelles ont au moins un point de convergence : lutilisation du langage de programmation JAVA. Que ces nouveaux modles de services reclent des opportunits fortes de nouveaux acteurs, que lon ressent dj dans le cadre des web services avec lmergence dacteurs issus de ldition de logiciels en qualit de fournisseurs de services NGN . Ces acteurs ont la particularit de se positionner sur une offre internationale, et dtre encore relativement inconnus des rgulateurs dans le domaine des rseaux et services de communications lectroniques.
Le succs de ces nouvelles architectures de services NGN est li la volont des acteurs de cooprer pour dvelopper des standards qui permettront de produire des outils et des quipements rellement interoprables. Mais noublions pas que lobjectif dune telle architecture aussi louverture des plates-formes et des interfaces des nouveaux acteurs. Cest, au vu de nombreux exemples, lunique solution pour avoir un march dynamique, ouvert et viable.
La question est de savoir si les acteurs tablis dsirent rellement ouvrir leurs infrastructures des acteurs tiers, qui seraient dans le mme temps des concurrents potentiels.
Autorit de rgulation des tlcommunications
103
3.6 La mutation des terminaux
Lvolution des terminaux fixes ou mobiles nest pas neutre dans le contexte des NGN. En effet, les rseaux et services de nouvelle gnration ne pourront prendre forme qu travers la disponibilit et ladoption effective de nouvelles familles de terminaux capables de les supporter et de les rendre attractifs. Les terminaux doivent donc ncessairement :
En premier lieu, sadapter au support des nouveaux services spcifis par les oprateurs et fournisseurs de services (point non spcifique aux NGN). Lvolution des services est donc en premire approche le dclencheur de lvolution des terminaux. Ce point est celui qui gnre les volutions les plus visibles pour lutilisateur et les plus diverses. En retour, les plates-formes de services devront ensuite tre en mesure de grer cette diversit des terminaux et assurer la compatibilit / ladaptation des services au terminal. Dans un second plan (ce point est en effet indispensable au fonctionnement mme des communications de base, mais transparent pour lutilisateur), intgrer les volutions des protocoles de contrle dappel des curs de rseaux NGN
Ainsi, dune manire gnrale, les terminaux seront amens voluer vers :
Le support de services multimdia (capacits daffichage et de stockage des donnes accrues, intgration de logiciels applicatifs labors mais peu gourmands en ressources locales, priphriques spcifiques). Le dport dune partie de lintelligence de service et de lexcution des services dans le terminal, ce qui permet une architecture de services distribue et plus efficace, en limitant les changes de flux avec le rseau. La gestion de fonctions nouvelles telles que le nomadisme ou la golocalisation pour les terminaux mobiles. Lutilisation des nouveaux protocoles de contrle dappel employs dans le rseau pour dialoguer de bout en bout avec les plates-formes de services et avec les autres terminaux. A terme une part importante des terminaux seront vraisemblablement nativement IP multimdia.
Alors que la visibilit est relativement bonne sur les volutions des terminaux mobiles, elle lest beaucoup moins concernant les terminaux fixes. Notons cependant une tendance commune : une spcialisation de plus en plus grande des terminaux par usage.
3.6.1 Les terminaux mobiles de nouvelle gnration
Le terminal UMTS (ou mdia-phone ), et dans une moindre mesure le terminal GPRS, est lillustration du terminal qui volue pour offrir des services nouveaux. Si le terminal GSM assurait principalement la fonction de communication, le terminal UMTS y rajoutera les fonctions dinformation (en push ou en pull), les fonctions commerciales et les fonctions ludiques.
104
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Communication
Information
Commerce
Jeux & loisirs Jeux vido Paris Loteries Multi-joueurs Concours Chat Communauts MP3/MPEG/DivX Images Vido ...
Push & Pull Tlphonie M-commerce News Messaging Enchres Mto SMS, EMS, MMS Billettique Voyage Alertes Programmes TV Payement en ligne Mess. Instantane Micro-paiements Bourse Visio confrence Porte-monnaie Pages jaunes Marketing direct virtuel Dictionnaire Services d'urgence Bases de donnes Gestion de compte Localisation Virements Applications mtier ... ... PIM ...
Figure 30 Usages des terminaux mobiles de nouvelle gnration. (Daprs Sminaire Journe J2ME Sun Microsystems)
Au vu des concept phones et prototypes UMTS prsents par les constructeurs, et des terminaux mobiles de nouvelle gnration dj disponibles au Japon (pays prcurseur dans ce domaine), il semble acquis aujourdhui que, pour garantir son succs, tant sur le march grand public que sur le march professionnel, le terminal mobile de nouvelle gnration devra se distinguer du terminal GSM actuel par des possibilits matrielles et logicielles accrues : cran plus larges avec un affichage couleur haute dfinition, ergonomie plus grande, capacits mmoire embarque, priphriques divers (camra ou photographie numrique, lecteurs de codes barres, module GPS, ), etc Afin de garantir un dmarrage rapide des services UMTS et dassurer la transition du GSM vers lUMTS, la norme UMTS prvoit que les terminaux seront multi-modes GSM/GPRS + UMTS, et utilisent des mcanismes de repli. Ces terminaux hybrides permettraient de dmarrer les services UMTS et renouveler le parc de mobiles progressivement sans crer de rupture : continuer utiliser les infrastructures GSM/GPRS, dans les zones gographiques o la couverture et les services UMTS ne sont pas disponibles, sans freiner lquipement en terminaux UMTS. La norme prvoit 4 classes de terminaux pouvant fonctionner simultanment ou en alternance sur ces deux types de rseau, avec un basculement automatique ou manuel. Le repli effectif sur un rseau offrant notamment des conditions de dbit (voire de qualit de service) infrieures est ngoci entre le rseau et lapplication utilisant la connexion. Dans la mesure du possible, la continuit de service lors du passage dun rseau lautre est garantie par le biais de mcanismes dits de soft handover . Concernant plus gnralement la problmatique des terminaux multi-modes compatibles avec des rseaux daccs multiples et de nature diffrente, on se rfrera au chapitre 3.7 Problmatiques transverses associes aux NGN et notamment lexemple donn des terminaux radio logiciels de quatrime gnration. Les annonces des diffrents constructeurs dans la presse laissent penser que les premiers quipements GPRS (puis UMTS) pourront comporter les lments suivants :
Une fonction terminal vocal comparable aux terminaux GSM actuels. Une fonction PDA multi-browser, incluant un cran de taille confortable plus de 20 000 pixels, qui pourra tre intgre au terminal mobile (PDA communicant), ou tre distincte du terminal mobile (ventuellement reli ce dernier via la technologie Bluetooth). Des fonctions graphiques permettant de visionner des images fixes ou de la vido basse dfinition (MPEG) coupl un cran couleur.
Autorit de rgulation des tlcommunications
105
Des applications PIM (Personal Information Manager) : e-mail, agenda personnel et collaboratif, annuaires Des modules logiciels dcriture prdictive (ex. : T9), de reconnaissance de lcriture et ventuellement de reconnaissance et de synthse vocale.
Les smartphones Les smartphones sont des terminaux mobiles voix qui intgrent des fonctionnalits de PDA. Dans le concept smartphone, loutil de communication voix tend vers loutil de traitement de linformation. Les smartphones ont lavantage dtre bien plus compacts que les PDA traditionnels et les PDA communicants mais prsentent des fonctionnalits moins riches (pas de possibilit dajouts logiciels). Ils embarquent (gnralement dans la mmoire ROM du portable ou dans une mmoire Flash) un navigateur Internet. Les principaux constructeurs de terminaux mobiles ont largi leurs gammes aux smartphones : Ericsson (R380), Nokia (9210), Motorola (Accompli 008), Alcatel (One Touch POCKET) De nouveaux acteurs pourraient galement entrer sur le march des smartphones : loccasion du 3GSM World Congress 2002, lannonce dun accord entre Microsoft et Intel pour la cration de terminaux smartphones a t faite. (Source : Wall Street Journal) Les PDA communicants Par opposition aux smartphones, les PDA communicants sont des PDA qui ont volu vers les fonctions de communication. Les premiers appareils sur le march proposent la navigation sur lInternet (en mode dgrad). Lassistant personnel intgre alors un module de tlphonie mobile ou est reli un tlphone portable par un cble, une liaison infrarouge ou une liaison Bluetooth. Les PDA communicants ont lavantage de possder des systmes dexploitation connus (Palm OS, Windows CE, ) pour lesquels une gamme significative dapplications ont t dvelopps. De plus, les capacits mmoire (configuration de base et capacit dextension) sont gnralement plus importantes que celles des smartphones. Exemples de nouvelle gnration de PDA communicant : Handspring propose un module amovible appel VisorPhone qui permet denrichir un PDA de la gamme Visor dune fonction de telephone mobile bi-bande GSM et plus rcemment GPRS. Ce module permet lutilisateur daccder Internet en mobilit (Daprs : Handspring). Syncsys proposera au dbut de lt 2002 un PDA baptis Vovid de type PocketPC, intgrant en standard une carte pour rseau sans fil WLAN (802.11b) et permettant de tlphoner sur IP grce un micro et un haut-parleur intgrs. En connectant une camra sur lun des ports dextension, il sera possible dajouter limage au son, voire dtablir une vidoconfrence. En plus des applications habituelles livres avec ce genre de matriels, Syncsys ajoute un lecteur de fichier MPEG-4 et une machine virtuelle Java. En option, Syncsys propose une station daccueil qui incorpore un combin tlphonique, et un clavier. (Daprs : Dcision Micro & Rseaux, 4/03/02).
Les nouveaux terminaux annoncs se caractrisent par lajout de priphriques multimdia, intgrs ou amovibles : microphone mains-libres sans fil, camra ou appareil numrique, lecteur de fichiers son MP3 (fonction walkman ), claviers pour jeux interactifs, etc Enfin, certains terminaux pourraient tre dots de fonctionnalits annexes telles le porte-monnaie lectronique ou des applications de CRM. Afin de sadapter la gestion de contenus multimdia, les terminaux volueront aussi pour intgrer des logiciels divers (logiciels de lecture de flux en audio ou video streaming, logiciels de traitement dimages ou de sons, navigateurs web ou WAP) et des capacits mmoire plus importantes afin de stocker ces programmes ainsi que les
106
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
donnes tlcharges par les utilisateurs. Ces capacits mmoire pourront tre intgres ou extractibles (ex. : cartes dextension mmoire). Dans le but de proposer des services plus labors, une certain nombre de terminaux embarquent des piles logicielles drives de la micro-informatique ou de lInternet linstar de Java. Ces plates-formes permettent lexcution en local de certaines tches (tches rcurrentes, animations graphiques, ) et peuvent aider limiter les changes de donnes. Plusieurs technologies permettant le dport dune partie de lintelligence de service et de lexcution des services dans le terminal pourront tre intgres bord des terminaux UMTS. Parmi elles, on pourra citer des technologies qui avaient t dveloppes pour le GSM et qui trouvent leur place dans le terminal UMTS comme MExE et SIMToolKit (Cf. paragraphes 3.6.2.1 et 3.6.2.3 ci-dessous) ou encore le concept VHE (Cf. paragraphe 3.5.1). Toutes ces volutions rapprochent les terminaux mobiles du monde informatique. La complexit des nouveaux lments matriels et logiciels grer au sein dun terminal a amen les constructeurs y implmenter un rel systme dexploitation. Actuellement, il existe un certain nombre de systmes dexploitation propritaires, mais certains standards commencent simposer, ce qui facilitera la compatibilit des logiciels et le dveloppement dapplications compatibles avec des terminaux multiples. On citera :
Symbian. Symbian est un consortium cr en Juin 1998 qui regroupe Ericsson, Nokia, Matsushita (Panasonic), Motorola, Psion, et plus rcemment Fujitsu. Son systme d'exploitation pour tlphones mobiles, smartphones et PDA, est utilis par ses actionnaires mais aussi licenci d'autres constructeurs. Le premier mobile utilisant lO.S. Symbian, le Nokia Communicator 9210, a t commercialis au premier semestre 2001. Windows CE 3.0 (PocketPC), le systme dexploitation de Microsoft pour les PDA, qui est maintenant intgr par certains constructeurs dans leurs PDA communicants. Dbut 2002, Microsoft a annonc la sortie de Windows CE.Net, successeur de Windows CE 3.0. Cette nouvelle version intgrera ds l'origine le support des priphriques sans fil tels que l'IEEE 802.11x et Bluetooth. Smartphone 2002, le tout nouveau systme dexploitation de Microsoft, un driv du systme dexploitation Windows CE 3.0 de Microsoft pour les PDA. Il sagit dune version allge adapte aux mobiles.
Autorit de rgulation des tlcommunications
107
La varit des systmes dexploitation et des logiciels, qui deviennent maintenant indispensables lexcution des services multimdia, amne plusieurs remarques sur les risques lies linterpntration de plus en plus troite et complexe entre terminal, rseau et services, et donc entre utilisateur, oprateur et fournisseur de services :
le risque technique de non-interoprabilit des services dlivrs par les plates-formes de services certains terminaux. Do la ncessit pour loprateur et/ou le fournisseur de services de pouvoir connatre la nature du terminal utilis par son client, afin dtre en mesure dadapter les caractristiques du services aux capacits du terminal. Cependant, dans le cas dune volution du march des terminaux vers une trop grande diversit denvironnement, cet objectif pourrait savrer difficilement ralisable. Le risque conomique de cration de nouvelles positions dominantes, en particulier dans le domaine des systmes dexploitation, ce qui pourrait induire des restrictions dans la richesse des offres logicielles (et donc des services) compatibles pour un type de terminal donn. Le risque conomique dinterpntration ou de conflit entre les intrts des oprateurs (qui choisissent traditionnellement les terminaux accepts / valids sur leur rseau, en fonction essentiellement de ses caractristiques dinterface avec le rseau) et des fournisseurs de services (qui sont plus lies aux composants logiciels du terminal). La consquence en serait la restriction de primtre dapplication des services offerts par un fournisseur de services donn sur un rseau donn. Le risque conomique dune restriction des possibilits de choix du terminal par les utilisateurs en fonction de son choix doprateur et de fournisseur(s) de services.
Le terminal mobile de nouvelle gnration est appel tre dou de fonctions diverses et multiples. Il est de ce fait possible que le terminal mobile gnraliste soit remplac par une grande varit de terminaux spcialiss : une corrlation forte serait faite entre le besoin, les services offerts et le design des terminaux. Certains priphriques et fonctions (agenda, reconnaissance graphique, ) seraient rservs des terminaux de type professionnel alors que dautres (video streaming, game-pad, ) seraient rserv un usage plus ludique. La contrepartie ces sophistications et lextension future de lutilisation dune connexion de transmission de donnes permanente sera vraisemblablement :
un prix plus important des terminaux mobiles de nouvelle gnration par rapport aux terminaux GSM actuels, du fait de la complexit grandissante des composants, des besoins en capacit de stockage mmoire, de lintgration de composants logiciels, de lajout dcrans haute performance et de priphriques multimdia, etc. A titre indicatif, les terminaux GPRS dentre de gamme se situent autour de 400 (soit environ 2 500 F) et un PDA communicant GPRS a aujourdhui un prix approximatif de 1 000 (soit environ 6 500 F) hors priphriques multimdia. Un autre lment daugmentation du prix sera la ncessit des terminaux multimodes (Cf. paragraphe 3.7.2.1). Cet aspect financier jouera un rle essentiel pour le renouvellement des terminaux. et une baisse dautonomie des terminaux, ou la ncessit dun progrs technologique significatif dans les batteries.
108
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Evolutions des batteries Les appareils nomades du futur seront deux trois fois plus gourmands en nergie que les appareils actuels. Les dfis relever sont donc la miniaturisation, loptimisation des rendements nergtiques et du stockage, la gestion des fortes variations de puissances en arrt/veille/fonctionnement, et la rduction des cots de fabrication. Pour cela, ils utiliseront des micro-piles combustibles (PAC). Le principe de ces piles est llectrolyse de lhydrogne (fourni par une recharge) et de loxygne provenant de lair ambiant, produisant ainsi de leau. Le CEA vient, cet gard, de dmarrer deux projets, lun franais et lautre europen, en association avec France Telecom, le CNRS et des industriels franais et belges. Des industriels comme Toshiba prsentent ds aujourdhui des prototypes, et les premiers produits commerciaux sont attendus entre 2003 et 2005. Cependant, les batteries rechargeables au lithium ont encore de beaux jours devant elles, et peuvent savrer complmentaires des PAC (Daprs : LUsine Nouvelle, 14/03/02).
Dans loptique de la migration vers les rseaux et services mobiles 3G, les volutions des terminaux soulvent les problmatiques suivantes :
limportance cl de la disponibilit commerciale des terminaux multimodes 2G/3G pour le succs des services 3G, que ce soit en phase de lancement mais aussi de manire encore plus complexe - lorsque les terminaux 3G deviendront IP multimdia (les terminaux 2G restant inchangs). Sur ce point, mme si les oprateurs peuvent jouer un rle moteur, ils sont dpendants des constructeurs. La mise en uvre du renouvellement du parc de terminaux, ncessaire au dcollage des nouveaux services. La demande des utilisateurs suivra-t-elle loffre de services et terminaux ? Quelle stratgie les oprateurs mobiles vont-ils adopter ? La subventions des terminaux reviendra-t-elle dactualit ? pour loprateur comme pour lutilisateur, une plus grande complexit de gestion de ces nouveaux terminaux (O.S., logiciels, mmoire, services tlchargs), qui compliquera les processus de spcification, dassemblage et dapprovisionnement des terminaux, mais aussi les mthodes, savoir-faire et outils de vente puis de relation client. pour les oprateurs, lindispensable mise en uvre de mcanismes permettant aux plates-formes de services davoir connaissance de la nature (terminal traditionnel ou IP multimdia) et des capacits du terminal et de la carte SIM, afin dadapter le contenu et lergonomie du service invoqu aux capacits effectives du terminal. Pour cela, des adaptations des plates-formes de services et/ou du systme dinformation de loprateur mobile sont donc ncessaires. pour les oprateurs, une nouvelle conception distribue des services, qui se rpartit en fait entre les plates-formes de services elles-mmes, et le terminal, capable dexcuter localement certains services. Cette approche devra tre intgre dans la spcification, le dveloppement et la maintenance des services.
Au-del de lvolution des terminaux mobiles de nouvelle gnration, les problmatiques indirectes souleves par leur introduction sont : la disponibilit commerciale et le renouvellement effectif du parc de terminaux mobiles, ainsi que la prise en compte dune complexit de gestion croissante de cette diversit des terminaux, sur le plan technique (nouvelle conception des services : architecture distribue, adaptation aux capacits du terminal) et oprationnel (ex. : assistance lutilisateur).
Autorit de rgulation des tlcommunications
109
3.6.2 Technologies embarques dans les terminaux mobiles
Les terminaux mobiles de nouvelle gnration mettront en jeu un ensemble considrable de technologies nouvelles quil nest pas possible de prsenter de manire exhaustive ici. Nous dveloppons donc quelques exemples significatifs : MexE, JavaPhone, SIMToolkit, golocalisation et volution vers des terminaux nativement IP multimdia.
3.6.2.1 MExE
MExE (Mobile station application EXecution Environment) est une spcification technique manant du 3GPP qui a pour but de dcrire un environnement applicatif standardis pour me les terminaux mobiles de 3 gnration. MExE inclut un ensemble de technologies dont Java et le protocole WAP, et spcifie un cadre grant les aspects suivants :
Gestion de profils utilisateurs multiples. Adaptation du contenu au terminal et processus de ngociation entre le rseau et le terminal. Bureau virtuel / Portail. Journal des changes avec le rseau. Contrle daccs aux applications disponibles sur le rseau.
La mise en uvre de la technologie MexE est indispensable pour grer le concept de VHE, ou mobilit tendue (rseau, terminal, utilisateur), un concept cl des rseaux et services mobiles de 3ime gnration qui peut tre gnralis aux NGN.
MExE a hrit de Java la notion de classes et trois dentre-elles ont t dfinies :
MexE Classe 1
Capacit grer 3 lignes de 15 caractres alphanumriques Accs un clavier numrique Capacit recevoir des donnes de taille rduite Utilisation de ressources rseau bas dbit en mode data
MexE Classe 2
Utilise les capacits de calcul du terminal pour excuter des applications en local Possde des outils graphiques (mode point) Ncessite une capacit mmoire Ncessite des ressources rseau plus importantes
MexE Classe 3
Excute des applets Java peu gourmands en ressources Exploite au mieux les ressources (dbit) des rseaux 3G
Bas sur le protocole WAP
Bas sur Personal Java. Inclut lAPI JavaPhone
Bas sur Java 2 ME CLDC
Figure 31 Les trois classes spcifies par MExE. (Daprs le MExE Forum)
110
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Notes :
PersonalJava est lenvironnement applicatif standard optimis quipements accdant lInternet et destins au grand public.
pour
les
JavaPhone est une extension de la plate-forme PersonalJava qui inclut les API grant la tlphonie, la messagerie, les applications de type PIM. Personnal Java peut simplmenter sur un ensemble de terminaux : mediaphone, smartphone, PDA communicant, Java 2 ME CLDC est une volution de la plate-forme Java destin la microinformatique embarque. Elle sadresse aux appareils de consommation courante et aux appareils de taille rduite. Elle inclut des outils pouvant grer divers profils et sessions.
3.6.2.2 JavaPhone
JavaPhone est une API qui a t dveloppe sur la plate-forme PesonalJava. Elle tourne au dessus dune plate-forme Java et a t conue pour grer des fonctionnalits propres au monde de la tlphonie :
Contrle des fonctions de tlphonie. Messaging en mode paquet. Carnet dadresses et calendrier. Contrle de puissance. etc
Applications et Applets API JavaPhone Plate-forme Java Systme d'exploitation Drivers hardware Terminal (hardware)
Figure 32 JavaPhone au sein de la pile logicielle dun terminal tlphonique. (Source : Sun Microsystems)
Une composante spciale (JTAPI Mobile) est comprise dans JavaPhone pour grer tous les aspects lis la mobilit.
La technologie JavaPhone est une mise en application, dans le domaine des terminaux, de lun des concepts de base des NGN, qui est la standardisation et louverture des interfaces.
Lutilisation de lAPI permets aux constructeurs de rduire le cycle de conception des terminaux en utilisant des briques logicielles prtes lemploi et prouves. JavaPhone est utilisable sur diffrents matriels :
Autorit de rgulation des tlcommunications
111
Mediaphones (terminaux UMTS). Smartphones et PDA communicants Terminaux fixes : IP phones, Screenphones2, PC-based phones,
Par extension, les terminaux embarquant la technologies JavaPhone sont dsigns par le terme Javaphone .
Java Card Le standard Java Card, dfini par Sun Microsystems et lETSI, permet lexcution de la technologie Java sur des cartes puce et dautres quipements capacit mmoire restreinte, dont les cartes SIM utilises dans les rseaux mobiles. La technologie Java Card technology prserve la plupart des bnfices du langage de programmation Java, tout en tant optimise pour en terme de volume de mmoire ncessaire pour un usage sur des cartes puces. LAPI Java Card garantit la compatibilit des applications dveloppes avec tous les types de carte puce Java Card. Le Java Card Application Environment (JCAE) est fourni sous licence OEM des fabricants de cartes puce (Daprs Sun Microsystems)
3.6.2.3 SIM Application ToolKit
La technologie SIM Application ToolKit, option spcifie dans la norme GSM 11.14 Phase 2+, est indpendante du constructeur de terminal et de la carte SIM elle-mme car seule linterface avec la carte SIM est normalise. Elle a t mise au point pour tre intgre dans les cartes SIM des terminaux GSM, do son nom. SIM Application Toolkit offre la possibilit de modifier certaines informations embarques, de tlcharger des applications de taille raisonnable et de les excuter, de personnaliser le menu dun tlphone... Les supports de transmission utilisables sont varis : SMS (le plus rpandu ce jour), GPRS, messages de signalisation de broadcast ou USSD (Unstructured Supplementary Services Data). Enfin, lusage de SIM Application Toolkit ninterdit pas lusage parallle dune autre technologie. Les principaux avantages de la technologies peuvent tre rsums comme suit :
La technologie est mature et a t prouve sur les terminaux mobiles 2G. Elle a t intgre commercialement dans les offres de la plupart des grand constructeurs de terminaux mobiles et offre dj des services tels que la banque distance ou le-mail. Elle est supporte par une majorit de rseaux 2G et sera supportes par lensemble des rseaux 3G. Elle permet de lire les informations de la carte SIM qui contient des informations sur lusager permettant de lui fournir un service personnalis. Elle permet de mettre en uvre des mcanisme dauthentification, de confidentialit et dintgrit de lutilisateur qui sont essentiels toute application de commerciale (commerce lectronique, applications bancaires). Elle a t construite en sinspirant de larchitecture client-serveur dans le but de saffranchir des limitations dues aux ressources du terminal.
La technologie SIM Application Toolkit, dj disponible dans les rseaux 2G GSM, est une opportunit de diffrenciation doffres de services pour les oprateurs, et particulirement pour les nouveaux acteurs et les MVNO.
2 Un screenphone est un terminal dot dun cran (gnralement tactile) et dun clavier (optionel). En plus des fonctions de tlphonie, il offre laccs lInternet.
112
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.6.2.4 Fonctions de golocalisation
Les fonctions de golocalisation seront la base de plusieurs services valeurs ajoute :
Du traage la localisation sur une carte et linfo trafic. Du marketing cibl (gographiquement) aux applications ludiques. etc
Elles sont bas sur des techniques appartenant trois grandes familles : Type de technologie Identification de la cellule Technologie Avantages et inconvnients
Cell-ID
Cette technique a lavantage de ne ncessiter que peu dinvestissement. Elle prsente par contre linconvnient dtre peu fiable : toute les cellules ne sont pas de taille et de forme gale, ce qui rend difficile linterprtation de linformation, un mobile peut tre situ gographiquement dans une cellule mais attach momentanment une autre du point de vue rseau.
Triangulation TDOA (Time difference of arrival)
Ces techniques offrent un degr de prcision suprieur. Leur inconvnient rsident en le fait que des upgrades doivent tre consentis dans le rseau E-OTD (Enhanced observed time difference) et/ou le terminal.
AOA (Angle of arrival) GPS Ces techniques offrent un degr de prcision dans la localisation qui permet D-GPS (Differential GPS) toutes les applications, sous rserve de rception du signal satellite GPS. La prsence du GPS augmente sensiblement le prix du terminal. A-GPS (Assisted GPS)
La varit des techniques de localisation envisageables (prcision, impacts sur les terminaux et le rseau, ajout de modules GPS) pose clairement le problme de son interoprabilit entre rseaux et entre terminaux. Les serveurs de localisation des oprateurs et leurs interfaces normalises (OSA) vers des fournisseurs de services tiers joueront pour cela un rle essentiel.
3.6.2.5 A terme : des terminaux mobiles IP multimdia
La mouvance actuelle nous pousse penser que les futurs terminaux mobiles (mais aussi fixes) seront dots dune interface IP native (terminaux clients SIP). Toutefois cette volution, bien que prvisible, na pas encore sa place dans les spcifications actuelles (UMTS Release 5, Cf. Chapitre 3.4.7).
Larrive de nouveaux terminaux mobiles IP multimdia posera de manire importante le problme de linteroprabilit des services entre terminaux htrognes (entre un terminal traditionnel et un terminal IP multimdia). Pour assurer cette interoprabilit, les Media
Autorit de rgulation des tlcommunications
113
Gateways et Signalling Gateways, charges entre autres de la conversion et de ladaptation des protocoles de transport et de signalisation, joueront un rle essentiel. Lexprience acquise sur ce plan avec les terminaux IP multimdia fixes (VoIP, CTI, volutions des PC), qui devraient apparatre plus rapidement que dans le domaine mobile, sera alors fort utile.
3.6.3 Les terminaux fixes de nouvelle gnration
La visibilit actuelle sur ce que seront les terminaux fixes de nouvelle gnration est moins grande que sur le domaine mobile. En effet, pour beaucoup, les services multimdia de demain restent inventer, et les terminaux associs en dcouleront. De plus, le cycle de dveloppement et de renouvellement des terminaux fixes est historiquement plus lent que dans le domaine mobile. Toutefois trois tendances semblent se dgager :
Les lments de notre cadre de vie actuel vont devenir des objets communicants : notre tlphone pourra offrir plus de fonctions, notre environnement pourra tre command distance (domotique sur Internet), nos quipement pourront prendre la parole (alertes diverses). Les terminaux communicants se fondront dans notre habitat : pour se faire il pourront se rendre discrets (intgration dans le cadre de vie) ou se mutualiser pour prendre moins de place (accs Internet sur tlviseur interactif). La scission des terminaux fixes en deux types doffres : dune part des terminaux rellement fixes, mais vraisemblablement ddis des usages particuliers, et dautre part des terminaux convergents fixe/mobile (accs sans fil, mobilit restreinte, roaming avec les rseaux mobiles).
3.6.3.1 IP-phones et couplage tlphonie-informatique
Les IP-phones sont des terminaux tlphoniques muni dune interface IP. Il jouent le rle de clients dans un modle de rseau H.323 ou SIP. Les IP-phones ont aujourdhui des interfaces utilisateurs quasi identiques aux postes tlphoniques classiques (certains constructeurs proposent des terminaux identiques ne diffrant que par l'interface de raccordement, classique ou IP). Cela ne permet pas aux clients de les diffrencier et peut donc expliquer en partie un certain manque dattrait pour ces nouvelles solutions. Il existe une demande dvolution vers de nouvelles fonctionnalits venues du monde mobile (affichage graphique couleur, logiciels utilitaires, PIM, ). Les normes H.323 et SIP ont t enrichies par la spcification dun certain nombre de services tlphoniques (exemple : transfert d'appel, renvoi, mise en attente). Nanmoins, ces services sont encore peu nombreux et restent trs loin du niveau de services offerts en tlphonie classique. Aujourdhui, la grande majorit des IP-phones sont des postes reli un PABX intgrant une interface IP (IP-PBX ou CPBX). Il fonctionnent selon des protocoles propritaires drivs de H.323 (et de plus en plus de SIP), ce qui a pour effet dinterdire linteroprabilit des postes de constructeurs diffrents.
Les terminaux tlphoniques IP nen sont qu leurs dbuts. Il doivent encore voluer pour : Offrir un niveau de qualit de service au moins quivalent celui de la voix traditionnelle.
114
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Offrir de nouvelles interfaces utilisateur, des capacits de traitement multimdia, et des fonctionnalits de confort. Sintgrer harmonieusement dans le cadre de vie. Converger vers des protocoles standardiss permettant linteroprabilit en environnement multi-constructeurs.
Les terminaux tlphoniques IP doivent galement permettre une interaction plus grande entre les terminaux issu de la tlphonie et ceux issus de linformatique en facilitant les services de type CTI. (Lacronyme CTI dsigne l'ensemble des services et fonctions permettant un systme informatique de dialoguer avec un systme tlphonique et/ou de le piloter). Lintgration de terminaux IP dans ce domaine doit apporter un avantage rel par rapport aux systmes classiques : facilit de mise en uvre, services avancs moindre cot, possibilits de personnalisation accrues.
3.6.3.2 Ordinateurs personnels
La micro-informatique devrait poursuivre les tendances actuelles, dont certaines sont naturellement orientes vers IP et les NGN depuis louverture lInternet.
Les ordinateurs personnels sont aujourdhui les terminaux capables daccder les NGN les plus aboutis. Les volutions technologiques hardware visent innover moins en terme de fonctionnalits quen terme de performance pure : vitesse du processeur, capacits mmoire, Les priphriques vont poursuivre leur sophistication : dmocratisation des crans plats, remplacement des priphriques (claviers, souris, tablettes Voir Zoom Technologique Windows CE Net et Mira ci-dessous.) par leurs homologues sans fil (hertzien, Bluetooth), multiplication des webcams et appareils photographiques numriques, Les systmes dexploitation et les logiciels intgreront des fonctionnalits orientes vers les NGN limage de Microsoft Windows XP. (Voir zoom technologique Windows XP ci-dessous.) Lquipement micro-informatique se devra dtre esthtique : cette proccupation est illustre par la commercialisation dune nouvelle version re-designe de liMac dApple.
De plus, il est possible que dautres usages apparaissent sur le terminal (utilisation comme matriel Hi-Fi, comme tlviseur, ). Lordinateur personnel aurait lavantage de concentrer un ensemble dusage sur un mme quipement. Toutefois, on pourra se demander quel point ce type dusages drivs de lordinateur personnel nest pas rserv un public technophile.
Windows XP Support de fonctionnalits de base NGN (Bluetooth, Ipv6) Le support de Bluetooth sera intgr dans le systme d'exploitation Windows XP au second semestre 2002. L'approche de Microsoft sera toutefois diffrente de l'approche d'autres fournisseurs (Nokia, Ericsson, TDK, ), Windows XP nintgrant qu'une partie de la norme : les fonctionnalits PAN (Personal Area Network). Microsoft met ainsi l'accent sur les changes IP entre quipements, plutt que sur les autres moyens de communication galement prvus dans la norme. Le PC est de ce fait mis au centre de toutes les liaisons, les communications entre les autres quipements ntant pas autorises. Microsoft annonce que Windows XP, et les fonctions PAN intgres, ne supporteront qu'IPv6, et non pas l'actuel IPv4. Microsoft prvoit de faire une dmonstration de
Autorit de rgulation des tlcommunications
115
fonctionnement de sa pile Bluetooth sur IPv6 lors de la Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) de Seattle en avril 2002.
(Daprs : Microsoft, Confrence dAndy Grass, Responsable du programme Bluetooth, le 11 dcembre 2001, lors de la Bluetooth Developers Conference)
Gnralisation des priphriques sans fil - Windows CE.Net et Mira Successeur de Windows CE 3.0, Windows CE.Net, auparavant dnomm Talisker, est une volution du systme dexploitation qui intgre le support des priphriques sans fil 802.11x et Bluetooth. Windows CE.Net cible les PDA, les tablettes interactives, les tlphones intelligents et plus globalement lensemble des terminaux lgers. Son successeur, baptis Macallan, est dores et dj annonc pour le milieu de l'anne 2003. Microsoft a prsent une tablette graphique dtachable, baptise Mira, base sur Windows CE Net. Avec un cran d'environ quatorze pouces, la tablette sert normalement de moniteur lorsqu'elle est fixe sur son socle. Une fois dtach, l'cran devient un terminal autonome reli au PC par une liaison sans fil 802.11b.
(Daprs : Reuters)
3.6.3.3 Autres types de terminaux fixes
Pour simposer au grand public il semble que les terminaux de nouvelle gnration devront tre abordables tous et faciles dutilisation. Les concepts avancs sont aujourdhui divers :
Les quipements multimdia interactifs, spcialiss selon lusage : tlviseurs interactifs (iTV), consoles de jeux avec modules daccs Internet, juke-box MP3 Les quipements communicants :
!
La domotique : le concept qui na pas su convaincre jusqu prsent pourrait tre relanc. Certains constructeurs en lectronique lancent aujourdhui sur le march des quipement lectriques commands via un site Internet, alors que des appareils lectromnager (aujourdhui encore ltat de concept) sont capables dmettre des alertes (demandes de rapprovisionnement, pannes,). Lautomobile intelligente : au del du concept de voiture communicante (accessibilit Internet depuis lhabitacle, golocalisation, ), des fonctions de scurit pourraient voir le jour (roues relie lautomobile via Bluetooth, systmes dalerte, ). Etc
Les technologies Bluetooth ou WLAN pourraient, terme, relier ces diffrents quipements entre eux.
Exemples de projets industriels et doffres de services en domotique : En Dcembre 1999, Ericsson a cr la socit e2 Home en association avec Electrolux afin de dvelopper des solutions domotiques. Microsoft a ouvert en automne 2001 une division e-home et compte bien sappuyer sur son systme dexploitation Windows pour populariser la domotique. De son ct, France Telecom, associ au groupe dlectricit Legrand, a cr Macaza, une entreprise qui proposera ds Avril 2002 des services de domotique cls en mains, via un abonnement mensuel.
116
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.6.3.4 Terminaux fixe et mobilit en espace restreint
Lvolution de certains types de terminaux fixes pourrait bien effacer la frontire entre le monde fixe et le monde mobile. Du sans-fil la substitution en passant par la convergence fixe/mobile, les prmisses de ce grand mouvement se ressentent dj depuis plusieurs annes.
Plusieurs arguments peuvent argumenter cette thse :
Des offres de substitution fixe / mobile ont t testes et lances par des oprateurs (postes fixes incluant une carte SIM, tarification la cellule). Ces concepts qui nont pas connu aujourdhui de grand succs pourraient bien tre relancs par la tendance NGN. Les terminaux fixes intgrent de plus en plus la notion de mobilit confine un primtre restreint, grce aux technologies infra-rouge, Bluetooth, DECT, WLAN, (cf. Partie 3.2 Accs) De plus, lide dun terminal multi-canaux intgrant un module terminal fixe et un terminal mobile , qui a dj vu le jour avec les technologie GSM et DECT et qui sinscrit parfaitement dans la philosophie NGN, pourrait tre relance.
3.6.4 Raccordement sans fil de priphriques : Bluetooth
Bluetooth est une technologie de transmission sans fil qui aura trs probablement sa place dans les terminaux de nouvelle gnration, quils soient fixes ou mobiles. Elle rendra plus ergonomique et plus souple la gestion des priphriques et permettra lessor du concept de rseau personnel .
Son but est de permettre une liaison sans fil (canal hertzien) de courte distance (maximum de 10 mtres) entre deux appareils ou deux composant dun mme terminal. Le projet Bluetooth fut initi en 1998 par plusieurs grands constructeurs, dont Ericsson, IBM, Intel, Nokia et Toshiba, qui se runirent au sein du Bluetooth Special Interest Group qui regroupe aujourdhui plus de 2 400 membres. Aujourdhui le cahier des charges de Bluetooth est ouvert et rgi par le Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth repose sur une puce de 9 mm. de cot facilement intgrable mme dans les quipements de taille rduite. La technologie utilise des ondes radio dans la bande de frquences des 2,4 GHz (ISM). pour atteindre un dbit thorique de lordre de 1 Mbit/s. Bande de frquence utilise Europe3 et USA France4 Espagne 2400 2483,5 MHz. 2446,5 2483,5 MHz. 2445 2475 MHz. Nombre de canaux (1MHz.) disponibles 79 23 23
Linterface radio utilise la modulation de frquence GFSK couple avec une fonction TDD : les entits Matre et Esclave transmettent alternativement dans des intervalles de temps (de 625 s.), le Matre dans les intervalles pairs, l Esclave
3 Sauf France et Espagne. 4 Sont autorises en France les installations dans la bande 2400- 2483,5 MHz, avec une puissance limite
10 mW. (10dBm) l'intrieur des btiments et 2,5 mW. (4dBm) l'extrieur. (Dcision ART parue au J.O. du 16 juin 2001)
Autorit de rgulation des tlcommunications
117
dans les intervalles impairs. Cette technologie utilise le saut de frquences et ne ncessite pas de planification de frquences, contrairement aux technologies cellulaires. Bluetooth a par ailleurs lavantage de fonctionner mme lorsque les deux entits en communication ne sont pas en visibilit directe. Les liaisons infra-rouge noffrent pas cette possibilit. Diffrents schmas de connexion sont envisageables :
Liaison entre deux entits Matre Esclave
Liaisons entre N entits Matre - Esclaves
Liaisons entre N entits Matres - Esclaves
Le matre peut grer Le schma le plus simple plusieurs esclaves . Il a alors la charge est une liaison entre deux dorganiser les liaisons entits, lune matre , entre lui-mme et les lautre esclave . Cest le matre qui initialise esclaves ainsi que les conversations entre et gre la connexion. esclaves .
Dans un schma plus complexe, un esclave aura la possibilit davoir plusieurs matres . De plus, un quipement esclave dans une relation aura la possibilit dtre matre dans une autre relation (sans toutefois crer de boucle).
Figure 33 : Schmas de connexion Bluetooth. (Daprs Bluetooth SIG)
Le nombre dentits dans un schma (appel piconet ) reste limit huit. Les piconets peuvent eux mmes tre regroups au sein de rseaux plus larges : les scatternets . Le protocole Bluetooth utilise une combinaison de commutation paquet (liens ACL , Asynchronous Connection-Less) et circuit (liens SCO , Synchronous ConnectionOriented). Une liaison Bluetooth peut supporter simultanment :
une connexion de donnes asynchrone (symtrique avec un dbit jusqu 434 kbit/s, ou asymtrique 723 kbit/s descendant 57 kbit/s montant), ou jusqu 3 communications voix en mode circuit 64 kbit/s, ou une connexion mixte donnes asynchrone / voix synchrone.
Le mode ACL permet de privilgier un sens de transmission par rapport lautre, lorsque, par exemple, le taux de download est suprieur au taux dupload, comme dans les communications Internet. La spcification inclut par ailleurs trois niveaux de scurit (niveau 1 : pas de processus de scurisation, niveau 2 : scurisation au niveau service, niveau 3 : authentification lors de ltablissement de la liaison.
3.6.5 Conclusions : les terminaux au cur de la migration vers les NGN
Bien que ne faisant pas partie intgrante du rseau NGN, les terminaux jouent un rle cl tant dans le dveloppement des nouveaux services que des nouvelles architectures de rseau NGN. En effet :
118
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Lmergence de terminaux mme de permettre un usage simple et attractif des services de nouvelle gnration est une condition indispensable lessor desdits services. Afin de permettre une homognit technologique pour les communications de bout en bout, il est ncessaire que les terminaux sadaptent pour assurer la compatibilit avec les volutions prvues dans les curs de rseaux, notamment en termes de nouveaux protocoles de contrle dappel IP multimdia (H.323 ou plus vraisemblablement SIP). Pour les mmes raisons, ils doivent aussi sadapter sur le plan matriel et logiciel afin dintgrer le traitement de nouveaux flux (streaming, image, vido, Internet) et de nouveaux langages de dveloppement de services (XML, Java).
De par leur maturit, leur diversit, leur cot et leur rapidit de diffusion, les terminaux jouent un rle dcisif pour permettre et faciliter la migration vers des rseaux et services NGN.
Il sera en effet ncessaire pour tous les acteurs de prendre en compte les points cl suivants :
La non-rgression fonctionnelle par rapport aux terminaux traditionnels concernant les applications de voix sur IP, et particulirement dans le domaine de la tlphonie fixe. Linteroprabilit des services du fait de lexistence de terminaux htrognes, et en particulier pour les communications entre terminaux dancienne et terminaux de nouvelle gnration (IP multimdia), ou pour les communications entre une plate-forme de services et des terminaux disposant de capacits de traitement multimdia, systmes dexploitation et/ou logiciels diffrents. Le prix des terminaux fixes et mobile de nouvelle gnration, qui sera initialement lev, niveau de service gal, et le restera tant que le march ne sera pas rentr dans une production de masse. Enfin et surtout, la vitesse et les processus de renouvellement du parc de terminaux actuels. Alors que le renouvellement du parc est relativement rapide, mais aussi anticip et favoris par les oprateurs dans le monde mobile, la problmatique est trs diffrente dans le cadre des terminaux fixes. Il est donc probable que ce processus sera long, et sappuiera plus fortement sur lessor de nouveaux terminaux adapts des usages spcifiques que sur un simple remplacement.
Autorit de rgulation des tlcommunications
119
3.7 Problmatiques transverses associes aux NGN
Ce chapitre aborde des problmatiques transverses importantes dans le cadre de lvolution vers les NGN, mais qui ne peuvent pas tre spcifiquement rattaches une couche de rseau particulire. Il sagit notamment de :
la gestion de ladressage et du nommage dans un environnement converg entre tlphonie et donnes (convergence vers le protocole IP), la gestion de la mobilit inter-systmes, qui gnre des impacts tous niveaux, depuis les terminaux aux plates-formes de services, en passant par la couche Contrle, les volutions des systmes dinformation rseau, des problmatiques techniques globales telles que la gestion de la scurit et de la qualit de service de bout en bout, les volutions des systmes dinformation commerciaux, les problmatiques rglementaires (listes ici pour mmoire, et dveloppes en dtail dans le chapitre 6).
3.7.1 Problmatiques dadressage, nommage et numrotation
La convergence des rseaux implique linterfonctionnement des rseaux, y compris concernant les rgles dadressage et de nommage, qui devront notamment permettre la convergence vers IP, lvolution des usages de services, et la cohrence entre ladressage des rseaux IP et tlphoniques (E.164). Note : au niveau de la signalisation, ladressage des entits de rseau par le systme de points smaphore sera maintenu pour permettre la communication aux interfaces entre rseaux NGN et traditionnels.
3.7.1.1 Gnralisation des mcanismes IP de rsolution dadresse (DNS)
Avec la gnralisation dIP comme protocole de transport au sein des rseaux NGN et lvolution des terminaux vers IP natif, les diffrents rseaux convergeront vers une utilisation de plus en plus massive de mcanismes de base dj largement utiliss dans les rseaux IP traditionnels afin de grer ladressage et le routage des connexions.
La fonction DNS (Domain Name Server) est utilise pour ltablissement du routage dune connexion IP, afin de convertir lidentifiant logique du service demand (ex. : lURL dun site web : www.arcome.fr) en adresse IP du serveur destination. La connaissance de cette rsolution dadresse au sein du rseau Internet est organise de manire hirarchique, de manire calque sur la structure des noms de domaines. Un serveur DNS connat donc les adresses IP correspondant aux services hbergs sous un nom de domaine particulier, et en rfre un DNS matre pour les noms de domaines dont il na pas la connaissance dtaille. On voit une illustration de la gnralisation de cette fonction aussi bien avec les rseaux implmentant des services de voix sur IP, quavec les rseaux mobiles GPRS (et ultrieurement UMTS) qui couplent au niveau du cur de rseau des procdures spcifiques au monde mobile avec ces techniques de base IP.
120
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.7.1.2 Evolution vers un adressage IP statique des terminaux grce IPv6
Dans un rseau IP, il est possible dallouer des adresses de manire statique (une adresse IP alloue de manire permanente un terminal) ou dynamique (allocation dune adresse IP provisoire un terminal pour la dure dune connexion). Cependant, pour des raisons dconomies de ressources en adresses IP, ladressage dynamique est largement employ. Cette technique a nanmoins des inconvnients en termes de lourdeur de gestion : dlais supplmentaires et complexification du processus dtablissement de connexion, recours parfois ncessaire la traduction dadresse lors de la traverse de rseaux diffrents Cet tat de fait ainsi que la gnralisation massive dIP (et donc la multiplication du nombre et des types de terminaux IP Cf. chapitre 3.6 sur les terminaux) pousseront les oprateurs voluer vers des solutions dadressage statique, o une adresse IP permanente est alloue chaque terminal IP. Si une pnurie dadresses IPv4 se confirme en Europe, lvolution vers IPv6 (Cf. dtails dans le chapitre 3.3 sur la couche Transport) permettra de rsoudre les limitations venir de lespace dadressage IP, donc de gnraliser ladressage statique des terminaux IP de toutes sortes.
3.7.1.3 Compatibilit entre adressage IP et numrotation tlphonique : le standard ENUM
Le standard ENUM, dcrit dans le RFC 2916 de lIETF, dfinit le protocole et larchitecture reposant sur le systme de nom de domaine permettant de crer un identifiant de service, correspondant au numro de tlphone E.164. Ces adresses pourront tre utilises pour le service de messagerie, les adresses URL, adresse SIP, Une structure de DNS (Domain Name Server), ayant le nom de domaine ddi ( e164.arpa est pressenti), sera rserv aux clients ENUM et grera linteroprabilit entre les deux systmes dadressage. Ce protocole pourra fonctionner aussi bien avec le protocole H.323 quavec SIP.
Rponse: N fax : 33 5 46 52 45 63 N mobile : 33 6 "2 45 85 23 Email : jean.martin@nom-de-domaine.fr Site web : www.nom-de-domaine.fr Requte Serveur SIP 4.3.2.1.0.9.6.4.5.3.3.e164.arpa
Requte de lutilisateur: + 33 5 46 90 12 34
Serveur DNS
Figure 34:Fonctionnement du protocole ENUM (Source : Arcome)
Exemple :
Un utilisateur compose le + 33 5 46 90 12 34 Lordre des chiffres est invers : 43 21 09 64 5 33 Un point est plac entre chaque chiffre : 4.3.2.1.0.9.6.4.5.3.3 Le nom de domaine e164.arpa est ajout la fin : 4.3.2.1.0.9.6.4.5.3.3.e164.arpa
Autorit de rgulation des tlcommunications
121
La mise en uvre dENUM est considre par certains acteurs comme un point cl pour assurer avec succs le dploiement gnralis de la voix sur IP.
Alors que les premiers dploiements commerciaux dENUM sont envisageables courant 2002, il y a encore des incertitudes sur la manire dont la technologie sera utilise dans loptique de gnrer des revenus et donc ces revenus seront partags. La dtention et lexploitation des bases de donnes ENUM reprsente un potentiel certains de revenus, mais la manire dont ces bases de donnes seront mises en uvre et gres, et notamment le degr dintervention des organismes gouvernementaux et le niveau de rgulation de cette activit, ne sont pas encore tranchs.
3.7.2 La mobilit inter-systmes
Dans le concept mme de NGN figure laccs aux services via des rseaux daccs multiples. Lvolution vers les NGN implique donc une double gestion de litinrance :
Itinrance horizontale (au sein dun mme type de rseau). Ce type ditinrance sappuiera vraisemblablement encore longtemps sur les protocoles spcifiques chaque rseau daccs. Itinrance verticale ou globale (entre rseaux daccs de nature diffrente).
La mise en uvre de litinrance verticale nest pas sans avoir des impacts sur les terminaux (compatibilit avec des rseaux daccs multiples) et les applications (fourniture de services indpendants du rseau daccs et adaptation de ces services aux capacits du rseau daccs et du terminal), mais aussi sur le contrle dappel (gnralisation des mcanismes cl de gestion dadressage et de contrle dappel IP, intgration de nouvelles fonctions comme le mobile IP , coopration entre curs de rseau afin de grer de manire cohrente la localisation de lutilisateur).
3.7.2.1 Impacts sur les terminaux
Afin de mettre en uvre laccs aux services via des rseaux daccs multiples, les terminaux doivent ncessairement voluer pour tre compatibles avec ces diffrents rseaux daccs. cela favorise la complmentarit entre plusieurs technologies, voie est indispensable lessor de certaines nouvelles technologies daccs. Cela peut tre mis en uvre de diffrentes manires :
Lutilisation de terminaux multi-modes, cest--dire intrinsquement capables de fonctionner sur plusieurs rseaux daccs. Ex. : terminaux GSM/GPRS + UMTS, terminaux GSM + DECT Lutilisation de terminaux modulaires disposant de modules dextension spcifiques chaque rseau daccs (ex. : cartes dinterface GPRS, WLAN ou Bluetooth au format PCMCIA ou autre). A terme, des terminaux adaptatifs sappuyant sur des solutions purement logicielles permettant de grer diffrents rseaux daccs radio sont aussi envisages. Voir dtails dans lencadre ci-dessous.
122
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Les terminaux radio logiciels (terminaux mobiles de quatrime gnration) sont une solution qui semble incontournable terme pour mettre en oeuvre de la manire la plus complte possible la mobilit inter-systme et simplifier la conception et la production des terminaux universellement multi-modes. Ils reprsentent par ailleurs une relle opportunit de fourniture de services multiaccs.
Par ailleurs, lors du changement de rseau daccs, le terminal devra avoir un rle actif afin dinitier les mcanismes ditinrance spcifiques (dtection du nouveau rseau daccs, gestion de lauthentification et de linscription sur ce rseau, obtention dune nouvelle adresse IP au sein de ce rseau en cas dadressage IP dynamique).
Exemple : Les terminaux radio logiciels de quatrime gnration Les terminaux mobiles de quatrime gnration permettront lutilisateur de bnficier avec un terminal unique des avantages en termes de couverture, dbit, facturation de tous les rseaux daccs disponibles. Pour cela, ils reconnatront les diffrents rseaux radio accessibles, et slectionneront le rseau daccs le plus adapt aux besoins de lutilisateur avant de se connecter. La mise en uvre de ces super-terminaux multimodes sappuiera sur des solutions de radio logicielle dveloppes lorigine pour des applications militaires, qui permettent de raliser toutes les oprations de traitement du signal spcifiques par des composants logiciels programmables. Il reste cependant de nombreux dfis technologiques surmonter pour russir traiter des signaux sur une trs large bande de frquences, typiquement de 900 MHz pour le GSM 5,7 GHz pour HiperLan2. Cette technologie permettra aux oprateurs de proposer des services innovants en offrant le choix entre deux rseaux radio aux caractristiques techniques diffrentes, par exemple GSM/GPRS/UMTS dune part, et rseaux locaux sans fil dautre part. Alors que les industriels sengageront en Avril 2002 dans la seconde tape du projet TRUST (Transparently Reconfigurable Ubiquitous Terminal), les premiers terminaux oprationnels de ce type devraient voir le jour vers 2005, et la technologie atteindre sa pleine maturit aux alentours de 2010.
(Daprs : LUsine Nouvelle, 14/03/02 article Le logiciel rend le terminal radio universel ).
3.7.2.2 Impacts sur la couche contrle : gnralisation des mcanismes IP dauthentification et dallocation dadresse
Litinrance globale entre systmes ncessite lintgration et linteroprabilit des processus de gestion de mobilit spcifiques chaque rseau. IP tant identifi comme le protocole de la convergence, la gestion de la mobilit globale entre les diffrents rseaux convergera vers une utilisation de plus en plus massive de mcanismes de base dj largement utiliss dans les rseaux IP traditionnels afin de grer lauthentification et ladressage des terminaux IP :
Le protocole IETF Radius (Remote Authentification Dial In User Service) est utilis dans un rseau IP afin dauthentifier et dautoriser une connexion tlphonique. Le serveur Radius dialogue donc avec le serveur NAS (Network Access Server) qui effectue la conversion de la connexion du mode circuit en IP. La fonction DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), qui permet de grer lallocation, dynamique et temporaire, dadresse IP un terminal, sera elle aussi gnralise.
Autorit de rgulation des tlcommunications
123
Au niveau des protocoles de contrle dappel, la convergence vers H.323 ou SIP (Cf. prsentation dtaille dans le chapitre 3.4 sur la couche Contrle) indpendamment du rseau daccs permettra de grer la mobilit des terminaux IP, en sappuyant sur les fonctions gatekeeper de H.323, ou proxy server / redirect server / registrar de SIP. Lvolution vers IPv6 facilitera lutilisation du protocole Mobile IP qui permet de grer la correspondance entre ladresse IP mre dun terminal IP et son adresse IP temporaire.
Les serveurs DHCP, Radius, SIP ou H.323 des diffrents rseaux seront donc amens dialoguer entre eux, et assurer linterfaage avec les fonctions qui resteront spcifiques chaque rseau daccs (notamment concernant lauthentification).
3.7.2.3 Impacts sur les services
La couche services doit aussi sadapter afin de prendre en compte cette possibilit pour des utilisateurs daccder un service via des rseaux daccs divers. On citera notamment :
Le dveloppement de nouveaux services tels que le numro unique universel ( UPT ) ou des services de VPN multi-rseaux daccs (projet INTERNODE). Cf. dtails ci-dessous. La ncessit de coopration entre les disponibles dans diffrents rseaux golocaliss de manire homogne et daccs utilis. Ce point est dvelopp Couche Services serveurs de localisation ventuellement daccs, afin de fournir des services la plus transparente possible au rseau plus spcifiquement dans le chapitre 3.5
Le problmatique dadaptation du contenu dlivr en fonction des capacits du terminal et du rseau daccs. Ce point est dvelopp plus spcifiquement dans le chapitre 3.5 Couche Services
Exemple de service sur rseaux daccs multiples : le numro personnel universel UPT (Universal Personal Telecommunications) Le concept UPT (Universal Personal Telecommunications) est dfini dans la recommandation F.850 de lITU-T. Il offre laccs aux services de tlcommunications en permettant la mobilit de lutilisateur final. Le UPT user dfinit lensemble des services auxquels il veut souscrire et reoit un UPT number unique. Ainsi lutilisateur peut mettre et recevoir des appels sur la base de son profil, en utilisant de faon transparente, diffrents rseaux, fixes ou mobiles (y compris IP), quelque soit le lieu dans les limites des fonctionnalits offertes par le rseau et des caractristiques du terminal utilis. De plus, les utilisateurs, nutilisant pas le services UPT , peuvent communiquer avec un client UPT . LITU a allou le code pays +878 et la tranche 10 (+10 chiffres), cest dire les numros : +878 10 xx xx xxx xxx lorganisation VisionNG, charge de promouvoir une architecture ouverte pour les services multimdia sur IP en sappuyant sur les spcifications de TIPHON (ETSI). Il ne faut pas confondre le numro UPT avec la portabilit du numro. En effet, le numro personnel est un service alors que la portabilit du numro est une fonctionnalit dun service existant. Par ailleurs, le numro personnel utilise une association temporaire entre ce numro et le numro de tlphone du terminal sur lequel lappel est dirig, alors que dans le cas de la portabilit du numro , lassociation est quasi-permanente.
124
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Exemple de services unifis lexprimentation INTERNODE
sur
rseaux
daccs
GPRS
et
WLAN
Le projet Internode (INTERworking of NOmadic multi-Domain sErvices) est un projet de recherche et dveloppement, qui a pour objectif de tester la mise en uvre dune solution intgre permettant un fournisseur de services indpendant de grer des rseaux privs virtuels (VPN) IP mobiles chelle europenne. Ce service vocation offrir aux utilisateurs :
Un accs scuris leur rseau dorigine Une accessibilit via une adresse unique Litinrance entre des rseaux daccs htrognes (GPRS et WLAN) qui supportent le service ce VPN, via diffrents types de terminaux (ex. : PDA, PC), et ce de manire transparente.
De plus amples dtails concernant le projet INTERNODE sont fournis dans le chapitre 4 sur la normalisation.
3.7.3 Impacts sur les systmes dinformation rseau
Au sein du rseau dun mme oprateur ou fournisseur de services, des modifications importantes du systme dinformation rseau seront induites par lvolution vers les NGN :
Sur laspect protocoles, donc compatibilit avec un SI rseau unique, elles vont apparemment plutt dans le sens de la simplification. En effet, du fait de lvolution gnralise progressive vers le tout IP , depuis les plates-formes de services jusquau terminal en passant par le cur de rseau permet de penser que les protocoles tlcoms du modle OSI et TMN (Telecommunications Management Network) seront abandonns progressivement pour converger vers les protocoles hrits d'Internet et IP SNMP (Simple Network Management Protocol) et lutilisation du concept de MIB (Management Information Base). Cela dautant plus que le modle TMN, qui se voulait de rendre interoprable ladministration des rseaux tlcoms entre quipements htrognes, na pas fait ses preuves, du fait notamment de sa complexit. Cette opinion a dailleurs t corrobore par plusieurs constructeurs, qui ont mme prcis quils ressentaient dj une demande importante des oprateurs pour aller dans ce sens. En revanche, il est ncessaire de prendre en compte une plus grande diversit dquipements superviser et administrer. La visibilit sur les services de bout en bout est aussi un point qui mrite une grande attention particulire et fait lobjet dun groupe de travail de lETSI (Cf. chapitre 3.7.5 ci-dessous, et chapitre 4 sur la normalisation) . Par ailleurs, comme pour les systmes dinformation commerciaux, la problmatique dinterfonctionnement et dinterconnexion des SI rseau des diffrents acteurs se gnralisera. Cependant, la ncessit nest pas de fournir tous ses partenaire une visibilit sur lensemble de son rseau et/ou de ses platesformes de services, mais de schanger les informations minimales ncessaires la supervision de bout en bout du service. Le SI commercial pourrait donc servir de mdiation pour lchange de ces donnes techniques essentielles.
Les systmes dinformation rseau NGN subiront donc une volution duale : dune part une simplification des protocoles de gestion, hrite dIP, et dautre part une complication de lenvironnement
Autorit de rgulation des tlcommunications
125
technique (diversit des quipements, vision de bout en bout) et oprationnel (interconnexion des SI rseau des diffrents acteurs)
3.7.4 La scurit
La problmatique de la scurit est trs prsente dans les rseaux NGN. En effet les changes de donnes sur les rseaux en mode paquet ncessitent de mettre en place des mcanismes de scurit tout les niveaux.
La scurit au niveau rseau par la cration de circuit virtuels (ex :MPLS, ATM) ou de rseaux virtuels (ex : VPN IP) permettant de sparer de faon logique les flux en mode paquet. Le cryptage au niveau rseau, tel que IPSec, qui permet de garantir lintgrit, la confidentialit et lauthenticit des paquets IP sur des rseaux publics (ex : accs un site distant via Internet.) Le cryptage au niveau applicatif (ex :SSL ou Secure Socket Layer) qui offre lintgrit, la confidentialit et lauthenticit des sessions applicatives. Ces mcanismes sont notamment utiliss pour les paiements en ligne.
Ces mcanismes de cryptage peuvent tre accompagns de gestion des cls, ncessaires au cryptage, de faon dynamique par des solutions tels que les PKI (Public Key Infrastructure).
Les diffrents niveaux de scurit sont complmentaires. Ils devront tre mis en uvre par les diffrents acteurs (oprateurs de rseau, fournisseurs de services et clients eux-mmes) en fonction des exigences de confidentialit et dintgrit des services aux utilisateurs.
3.7.5 La qualit de service de bout en bout
Les services multimdia ont de fortes contraintes temps rel, exigences renforces dans le cas de services interactifs (communications multimdia). Pour offrir les services temps rel sur des rseaux en mode paquet, des paramtres quantifiables, directement lis la qualit de service de bout-en bout, sont utiliss :
Le temps de latence, qui correspond au temps coul entre le moment o la source envoie un signal et le moment o le destinataire final le reoit. La gigue ( jitter en anglais) qui est la variation du temps de latence des paquets mis pour une mme conversation La perte de paquets qui reprsente linformation arrivant pas destination dans un dlai compatible avec les flux temps rel.
La gestion des classes de services (DiffServ, MPLS) et des flux temps rel (RTP/RTCP, voir paragraphe 3.4.2.4) au niveau du rseau de transport offrent les outils permettant le support de communications multimdia mais aussi doffrir plusieurs qualits pour un mme service.
126
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
C la s s
L is te n e r S p e e c h Q u a l it y (O n e -w a y N o n c o n v e r s a t io n a l ) E n d - to -e n d D e l a y ( G .1 1 4 ) O v e ra ll T r a n s m is s io n Q u a li t y R a t in g (R )
W id e b a n d H ig h
B e tte r th a n G .7 1 1 E q u i v a le n t o r b e t te r th a n G .7 2 6 a t 3 2 k b i t /s < 100m s
N a r ro w b a n d M e d iu m
E q u i v a le n t o r b e tt e r th a n G S M -F R < 150m s
A c c e p ta b le
U n d e f in e d
U n g u a ra n te e d ( B e s t E ffo rt )
U n d e fin e d
< 100m s
< 400m s
< 400m s*
N .A .
> 80
> 70
> 50
> 50*
Figure 35:Classes de service pour les communications multimdia proposes par lETSI (Source : Groupe de travail TIPHON)
La gestion de la qualit de service par la seule couche transport , base sur des rseaux mutualiss en mode paquet et sans connexion ( loppos des rseaux TDM), noffre pas de garantie de qualit de service ni de gestion de la qualit de service de bout en bout. En rponse ce problme, deux mthodes sont alors possibles :
Le dimensionnement de rseaux, associ la gestion de classes de service de la couche transport, permettant doffrir une trs bonne qualit de service de bout en bout. Cette solution ncessite un surdimensionnement des capacits du rseau et ne peut donc tre ni suffisante ni satisfaisante terme. La mise en place dune entit ddie, permettant de garantir la qualit de service de bout en bout. Ce systme, devant avoir une vision globale et transverse du rseau, doit se situer au niveau de la couche contrle et/ou services . Cette solution est prconise par le groupe de travail WG5 au sein du projet TIPHON de lETSI.
Autorit de rgulation des tlcommunications
127
Service Domain 1
Service Domain 1
Application Plane Transport Plane
Transport Domain 1 Transport Domain 2
Transport Domain 3
Packet Flow QoS Signalling Call Signalling
Figure 36:Modle de gestion de la qualit de service de bout en bout (Source : TIPHON- ETSI)
Dans ce modle, la couche de transport (Cf. chapitre 3.3 sur la couche Transport) doit fournir un service de qualit de service associ la couche service (fournisseur de services). Il a dailleurs t propos (Groupe de travail TIPHON) dajouter un agent ddi la qualit de service dans une volution des protocoles SIP et H.323. Cependant, actuellement il ny a pas de solution sur le march permettant la gestion de la qualit de service sur le rseau en mode paquet La gestion de la qualit de service de bout en bout dans le cadre des NGN est un concept ambitieux qui devra prendre en compte lhistorique des domaines tlcoms et donnes :
Dans le domaine tlcoms, le concept TMN (Telecommunications Management Network) normalis par lETSI sest avr complexe mettre en uvre, notamment du fait de la ncessit dinteroprabilit entre des quipements trs diffrents et multi-constructeurs. Les dpoiements oprationnels sont peu nombreux et se heurent souvent des implmentations propritaires. A linverse, dans le domaine des donnes (IP), le principe de base retenu est la simplicit. Un nombre limit doutils de supervision ont donc t dvelopps (SNMP Simple Network Management Protocol, MIB Management Information Base) avec des extensions de primtre progressives. Linteroprabilit de la solution est donc mieux assure, mais les fonctionnalits offertes sont moins volues, notamment concernant la vision de bout en bout .
Les travaux de lETSI sur la spcification dune entit de rseau ddie pour garantir la qualit de service de bout en bout pour tous les
128
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
types de services multimdia sont indispensables. Dans lattente de la disponibilit oprationnelle de cette solution, une gestion rigoureuse de la qualit couche par couche (et notamment au niveau transport) devra tre mise en uvre. Le risque court terme est un surdimensionnement temporaire des rseaux NGN, qui relativiserait les optimisations dues la mutualisation du transport sur un rseau en mode paquet.
3.7.6 Impacts sur les systmes dinformation commerciaux 3.7.6.1 Ouverture et interconnexion des SI commerciaux
Un certain nombre dvolutions fonctionnelles du systme dinformation commercial sont ncessaires du fait du nouveau modle NGN. En effet, un seul acteur nest pas matre de la gestion du profil client et de la fourniture des services. Louverture des rseaux saccompagne invitablement dune ouverture de certaines fonctions du systme dinformation commercial tels que :
lactivation des comptes clients. Loprateur doit par exemple grer dans une certaine mesure linscription de ses abonns des services tiers. lauthentification des clients et le contrle dautorisation daccs aux services. Loprateur doit par exemple grer dans une certaine mesure les droits daccs de ses abonns des services tiers, ou inversement le fournisseur de services ne peut pas se contenter de vrifier les droits daccs du client son service sans stre assur au pralable de ses droits daccs au rseau support utilis. la gestion et la relation client, qui se complexifie du fait de lintervention de plusieurs acteurs pour la fourniture de services de bout en bout. Ce point est crucial depuis les tapes de commercialisation jusquau support et lassistance technique la remonte dans le SI commercial dinformation rseau et services provenant des systmes dinformation techniques des diffrents acteurs impliqus dans la fourniture des services la facturation pour compte de tiers, qui semble tre un service invitable fournir de la part des oprateurs dune part, et dautre part des fournisseurs de services qui font de lagrgation de contenus (modle portail). Elle concerne aussi bien laccs aux services eux-mmes que lutilisation des Service capability features du rseau de loprateur par les fournisseurs de services (ex. : fourniture dinformations de localisation). la facturation des accs aux serveurs daccs aux services . Une difficult majeure rsidera dans le fait de trouver un mode viable de tarification de ces prestations entre les diffrents acteurs
Autorit de rgulation des tlcommunications
129
Pour la russite du modle NGN, il est vital que linterconnexion et linterfonctionnement des SI commerciaux se gnralisent et se dveloppent avec succs. Cette ncessaire ouverture des systmes dinformation nest prise en compte que partiellement dans les diffrents modles darchitecture de fourniture de services (OSA/Parlay ou web services), et ne couvre que les problmatiques techniques. Elle constitue un facteur de risque technique et oprationnel important, encore mal identifi, ou sous-estim, par les diffrents acteurs. Elle ncessitera des volutions lourdes des systmes dinformations commerciaux, tant sur le plan fonctionnel que technique, volutions qui doivent tre anticipes notamment par les oprateurs.
3.7.6.2 Evolution fonctionnelle de la facturation
Le modle mme de facturation des nouveaux services convergents doit voluer (ou mme, est encore crer ce jour). En effet, la tarification la dure hrite des services voix traditionnels, ou le modle de fourniture dun service gratuit hrit dInternet ne sont pas viables pour ces nouveaux services. De nouveaux modes de facturation adapts aux besoins, aux usages et aux moyens des clients doivent donc tre dvelopps par les oprateurs et fournisseurs de services. On pourra citer notamment la facturation au volume, lusage, lacte, ou en fonction de la valeur ajoute du service. Par ailleurs, de nombreuses nouvelles sources dinformations de taxation sont prendre en compte, comme les serveurs IP et les plates-formes de services. Ces volutions des parties collecte dinformations de taxation et valorisation du SI commercial ne sont pas mineures.
Enfin, les acteurs du march saccordent dire que les fonctions de facturation pour les accords dinterconnexion IP manquent de sophistication et de standards par rapport la complexit des besoins engendrs par les nouveaux services et les nouveaux modles de relations entre acteurs.
En effet, le modle basique dchange de flux IP par peering ne peut pas tre pertinent et suffisant sur le moyen terme. Ce point est aussi rapprocher de la difficult de mesurer de manire efficace la qualit de service dans un rseau IP. Des facteurs cl dvolution dans ce domaine seront sans doute le dploiement en masse doffres de voix sur IP dune part, et dautre part lmergence doffres dinterconnexion IP spcifiques (GRX GPRS roaming Exchange) dans le cadre de la mise en uvre des services de roaming international GPRS.
3.7.7 Problmatiques rglementaires
Potentiellement, lintroduction des NGN posera invitablement des problmatiques dadaptation du contexte rglementaire, et notamment sur les thmes suivants :
Obligations des oprateurs de rseaux et de services Interconnexion Droits des utilisateurs (dont la qualit de service) Protection des donnes et des contenus
130
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Rgulation des contenus, proprit et copyright Scurit, signature lectronique Interception lgale (Cf. WG NGN ETSI)
Ces problmatiques rglementaires sont traites en dtail dans le chapitre 6 du rapport.
3.7.8 Conclusion
Les points essentiels et prioritaires retenir de cet expos des problmatiques transverses associes aux NGN sont : la ncessit dune rflexion de fond et globale sur lvolution du concept de numrotation et lharmonisation des processus dattribution et de gestion des ressources dadressage, nommage et numrotation, le tout dans une optique de convergence tlphonie / donnes (vers IP) et de convergence fixe / mobile (vers le mobile). Cf. chapitre 6 Rglementation. La prise en compte dune complication des terminaux afin de grer la mobilit entre rseaux daccs, qui est un des principes cl des NGN, en intgrant notamment les problmatiques de disponibilit commerciale et de renouvellement du parc (Cf. conclusions du chapitre 3.6 sur les terminaux) Le risque mal identifi de blocage de louverture des rseaux des fournisseurs de services tiers du fait des impacts techniques et organisationnels lis la ncessaire interconnexion des systmes dinformation des partenaires. Techniquement, la gnralisation des mcanismes IP, tant pour ladressage que pour la rsolution dadresse ncessaire ltablissement dune connexion IP ou pour la supervision et ladministration des rseaux et services, et la ncessit dune rflexion plus pousse concernant la matrise et le contrle de la qualit de service de bout en bout, sous lgide dorganismes de normalisation fdrateurs.
Autorit de rgulation des tlcommunications
131
3.8 Conclusion technique : des lments technologiques structurants
La conception et la dfinition de larchitecture des rseaux de nouvelle gnration est variable suivant les acteurs ; ces diffrences sont naturellement lies lorigine ( tlcoms, rseaux, services) et lexistant de chacun ( acteurs historique, nouvel entrant,) Cependant de grandes tendances se dgagent et des concepts communs mergent.
Le NGN sera un systme offrant des services multimdia en sappuyant sur un rseau support mutualis et caractris par plusieurs lments essentiels: Un cur de rseau unique et mutualis pour les diffrents types daccs et de services. Une architecture de cur de rseau en 3 couches : Transport, Contrle et Services. Une volution vers un transport convergent en mode paquet (flux IP transports en IP natif, ou sur ATM court terme avec une convergence progressive vers IP). Des interfaces ouvertes et normalises entre chaque couche, et notamment au niveau des couches Contrle et Services afin de permettre le dveloppement et la ralisation de services indpendants du rseau. Le support dapplications multiples, multimdia, temps rel, en mobilit totale, adaptables lutilisateur et aux capacits des rseaux daccs et des terminaux.
Pour les constructeurs issus des rseaux de donnes, la mise en uvre directe dun transport IP, avec lutilisation des classes de services (mcanisme DiffServ) associ au protocole MPLS, nativement conus pour fonctionner avec IP, est une solution envisageable ds prsent ; lvolution de la solution IP/MPLS sera apporte, plus long terme, par le protocole G-MPLS qui simplifie la gestion du rseau de transport. Pour les constructeurs tlcoms gnralistes, la solution passe gnralement par ATM court terme, avant dventuellement se tourner vers des solutions tout-IP . De plus lATM est encore trs prsent au niveau de la boucle locale (xDSL, BLR, UMTS pour les premires versions). Les nouveaux acteurs positionns exclusivement sur des quipements NGN supportent en gnral les deux solutions. Ils insistent particulirement sur le fait que lessentiel pour une solution de rseau NGN est de migrer la signalisation sur IP natif, le transport du trafic IP lui-mme pouvant tre ralis indiffremment sur une couche IP, ATM, ou mme sur un rseau TDM traditionnel.
132
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Couche Services Couche Contrle
IN
Services lis la localisation
Messagerie unifie UPT
IN
Web Services
Softswitch Switch voix
SG
(*)
MGC
Location server
Base Clients Base Clients
DNS
ENUM
Rseau paquet NGN
Rseau traditionnel TDM/SS7
Couche Transport
Media Gateway
Rseau daccs
(*) Services IN : bien que faiblement pertinents en qualit de "services NGN", indispensables pour l'interconnexion au niveau Services avec les rseaux traditionnels
Figure 37 : Principe darchitecture dun cur de rseau NGN (Source : Arcome)
Limportance relative entre lvolution tout IP et la sparation du rseau en couches diffre selon les acteurs. Mais une majorit saccordent dire que le concept majeur des NGN est bien lvolution tout IP , la sparation en couches ntant quune tape, ou une ncessit pour optimiser les rseaux.
Afin de garantir linterfonctionnement et la qualit de service (et en particulier la non rgression des services tlphoniques par rapport a leur gestion en mode circuit), la mise en uvre des rseaux NGN devra galement saccompagner : dune rflexion globale sur lvolution des concept de numrotation dadressage et de nommage et lharmonisation des processus dattribution et de gestion de ces ressources, le tout dans une optique de convergence tlphonie / donnes (vers IP) et de convergence fixe vers mobile. De la mise en uvre de mcanismes de qualit de service standardiss de bouten-bout, Defforts minimisant les risques de blocage de louverture des rseaux des fournisseurs de services tiers du fait des impacts techniques et organisationnels lis la ncessaire interconnexion des quipements mais aussi des systmes dinformation des partenaires.
Autorit de rgulation des tlcommunications
133
3.8.1 La Couche daccs, un moteur pour lintroduction des NGN
La multiplication et les volutions des rseaux daccs sont identifies comme un lment dclencheur majeur - et un moteur essentiel - de lvolution des rseaux vers les NGN. Si lon analyse les volutions majeures apportes par ces diffrentes technologies daccs, la tendance actuelle est :
la multiplication des technologies daccs, lvolution vers le haut dbit, des technologies de transport multi-services en mode paquet (IP, ou plus frquemment ATM), la convergence fixe/mobile, avec la prise en compte du nomadisme du fait de lessor des rseaux daccs mobiles et des rseaux locaux sans fil.
Ces quatre axes dvolution des rseaux daccs sinscrivent parfaitement dans le contexte des nouveaux rseaux et services NGN, et en favoriseront donc vraisemblablement lmergence. LxDSL et la BLR, de par leur capacit de transmission haut dbit, constituent indniablement un moteur pour les NGN : les services de voix sur ADSL ou sur cble reprsentent un exemple oprationnel de convergence entre des rseaux ; lutilisation de lATM dans ces technologies nempche pas de fournir des services tout-IP . Les rseaux daccs cbles, Ethernet optiques ou WLAN associent capacit de transmission de services haut dbit et de flux IP natifs. Ces deux aspects en font des technologies particulirement pertinentes dans le cadre des NGN. La mise en uvre du GPRS sera pour les oprateurs mobiles une tape cl qui leur permettra de mettre en uvre des architectures de cur de rseau (transport IP) et des services de transmission de donnes en mode paquet haut dbit que lon peut qualifier de pr-UMTS ou pr-NGN . Le systme mobile de troisime gnration UMTS est le premier systme global entirement normalis (du moins dans sa deuxime phase) avec une architecture de rseau et de services NGN. Lutilisation massive du transport ATM dans le soussystme radio UMTS, en phase initiale, fait que, en fonction de leur existant, certains oprateurs sorienteront vraisemblablement initialement pour leur cur de vers un transport de la voix sur TDM (rutilisation du backbone GSM) et de la donne sur IP (rutilisation du backbone GPRS).
Bien que ne pouvant pas tre qualifies de NGN, les nouvelles technologies daccs haut dbit sont une composante connexe trs importante car elles influeront sur la rapidit dintroduction et les modalits techniques dtailles de mise en uvre des curs de rseau NGN, notamment concernant le choix du protocole de transport de cur de rseau.
134
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.8.2 Rseau de transport
Lobjectif de ces diffrentes volutions du rseau de transport est de rpondre quatre impratifs pour le transport convergent des flux IP multimdia dans un rseau NGN : ladquation aux nouveaux besoins de services, le support des trs haut dbit, la garantie de qualit de service, surtout concernant les flux temps rel (voix, vido), la gestion optimise du rseau de transport. Pour rpondre ces problmatiques, une volution samorce vers des rseaux convergents utilisant des technologies de transmission et de transport haut dbit, en mode paquet, avec une qualit de service adapte aux diffrents services.
De plus, larchitecture NGN dfinit la sparation des fonctions Transport et Contrle du cur de rseau. En effet, la notion de rseau de transport, au sens NGN, inclut, en complment des liaisons physiques et de linfrastructure passive de transport, lapparition des fonctions Media Gateway et Signalling Gateway, qui effectuent la conversion et lacheminement du trafic et de la signalisation sous le contrle des serveurs dappel. Plusieurs tendances peuvent tre observes autour des rseaux de transport :
Lextension de lusage de la commutation optique et du multiplexage en longueur donde (DWDM, CWDM) dans les rseaux de transmission tendus, y compris mtropolitains, au dtriment du multiplexage TDM. Lapparition de commutateurs Ethernet dans les rseaux mtropolitains, voire nationaux ou internationaux. Ces commutateurs permettent une connectivit de bout en bout en Ethernet. Au niveau du rseau de commutation pour le transport du trafic IP, on peut anticiper la diffusion progressive des commutateurs MPLS, avec les tendances suivantes qui se dgagent :
une tendance forte vers une commutation MPLS seule. une tendance moindre vers un rseau mixte ATM et MPLS (persistance dune commutation ATM, notamment en priphrie du cur de rseau, qui permettra une interconnexion avec les rseaux daccs xDSL, BLR ou UTMS ). plus long terme lapparition du GMPLS (MPLS sur WDM) offrira une solution mariant le contrle des rseaux de commutation et de transmission. Lincertitude au sujet de la date dvolution de la commutation IP de sa version 4 actuelle vers sa version 6. Mis part lAsie o la forte pnurie dadresses IPv4 va forcer les oprateurs migrer, la date de migration dans le reste du monde reste incertaine. La problmatique de la pnurie dadresse se posera terme avec lessor de lUMTS.
On peut pressentir des scnarii dvolution diffrents suivant les acteurs, lun sappuyant sur une commutation mixte ATM/MPLS, et lautre sur une commutation MPLS native. Quel que soit le protocole de transport utilis, les flux qui transiteront pas les rseaux NGN seront tout IP .
Autorit de rgulation des tlcommunications
135
3.8.3 La Commutation NGN : sparation des couches Transport et Contrle
La mise en uvre de larchitecture NGN au niveau de la couche contrle se traduit techniquement par : 1. Le remplacement des dquipements distincts : commutateurs traditionnels par deux types
dune part des serveurs de contrle dappel dits Softswitch ou Media Gateway Controller assurant le contrle des communications et des ressources des autres quipements de la couche contrle, et dautre part des quipements de mdiation et de routage dits Media Gateways qui assurent non seulement lacheminement du trafic, mais aussi linterfonctionnement avec les rseaux externes et avec les divers rseaux daccs en ralisant la conversion du trafic (entit fonctionnelle Media Gateway) et la conversion de la signalisation associe (entit fonctionnelle Signalling Gateway). 2. Lapparition de nouveaux protocoles de contrle dappel et de signalisation entre ces quipements (de serveur serveur, et de serveur Media Gateway)
Signalisation de contrle dappel : SIP vs H.323 SIP semble tre le protocole choisi par la plupart des acteurs pour sa simplicit et son utilisation des technologies et format web . Cependant ce protocole apparat comme ntant pas encore mature pour des dploiements en masse. H.323 est identifi comme un protocole plus lourd que SIP, notamment pour la gestion du transit, mais est actuellement le protocole le plus implment car il fut, historiquement, le premier standard disponible.
Signalisation de commande des Media Gateways : Megaco/H.248 vs MGCP Megaco/H.248 semble tre la cible identifie par la plupart des acteurs, mais du fait de la plus grande maturit des offres (du moins pour certains constructeurs), MGCP pourrait tre largement utilis court terme.
Signalisation de transit : BICC vs SIP-T BICC tait prvu initialement pour le transport de la signalisation entre serveurs de contrle sur ATM, et SIP-T sur IP. Les deux protocoles voluent en fait pour supporter les deux modes de transport. Il est possible que le consensus qui se dessine autour de SIP pour le contrle dappel bnficie terme SIP-T.
Protocole dadaptation : SIGTRAN (SIGnalling TRANsport) SIGTRAN utilise une nouvelle couche de transport appele Stream Control Transmission Protocol (SCTP), la place de TCP, pour transmettre la signalisation SS7 dune faon transparente sur les rseaux IP.
Il ressort de notre analyse quau niveau de la couche Contrle, les principales incertitudes concernent le choix des protocoles. En effet, pour chaque domaine concern, deux protocoles sont en gnral en lice, lun plus ancien et plus proche de lhritage tlphonie , et lautre plus rcent et plutt hrit du monde Internet. Cette situation soulve immanquablement la question de linteroprabilit court/moyen terme entre solutions implmentant des protocoles diffrents.
136
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.8.4 La Couche Services des NGN
Lvolution des rseaux, aussi bien au niveau de la couche Transport que de la couche Contrle, permet le dveloppement de nouveaux services. Les rseaux daccs haut dbit, la gestion de la mobilit, la golocalisation et la personnalisation sont autant doutils disponibles pour la cration de services multimdia encore plus interactifs et adaptables au type de terminal utilis et aux besoins des utilisateurs. Pour fournir ces services modulables, il est ncessaire, face la multiplication des rseaux daccs et des terminaux communicants, de dfinir une nouvelle architecture daccs aux services. Deux modles issus dapproches diffrentes, mais complmentaires, mergent : une architecture OSA/Parlay et un modle Web Services . Tous deux sont bass sur des protocoles et des interfaces ouvertes et standardiss facilitant lmergence des fournisseurs tiers de services, mais aussi linteroprabilit entre les solutions.
Le modle OSA/Parlay, bas sur linterface de services normalise du modle OSA/Parlay prconis par le 3GPP, a fdr un grand nombre de constructeurs tlcoms et doprateurs historiques. En effet, larchitecture, centre sur le Softswitch, permet lvolution des rseaux tlcoms actuels. Ce modle est plus adapt aux services ncessitant une forte coopration des serveurs dappel et bases de donnes du cur de rseau (ex. : services tlphoniques, golocalisation) Le modle prconis par le W3C, les Web services , est, pour sa part, avanc et dj mis en uvre par les acteurs venant du monde Internet et informatique. Cette approche est base sur les technologies et des protocoles (XML, SOAP) issus du monde Internet avec une architecture distribue. Le protocole de contrle dappel utilis dans cette architecture est le protocole SIP. Ce modle est plus adapt aux services raliss de manire transparente aprs tablissement dune connexion IP.
La relative jeunesse de ces modles ne permet pas de se prononcer formellement sur le succs de lun ou/et lautre des modles. Il ressort cependant que : lapproche OSA/Parlay est incontournable pour les acteurs tlcoms tablis voluant vers les NGN. Mais le succs du modle OSA se confirmera (ou sinfirmera) vraiment avec lessor des rseaux et services UMTS. lapproche des Web services est moins complexe implmenter et donc plus accessible des fournisseurs de services tiers que linterface OSA/Parlay. La preuve en est lexistence ce jour des premiers services issus de ce modle. les deux approches sont complmentaires, un services pouvant tout fait tre mixte (service Web services ayant recours des requtes OSA au cours de son excution).
Mais noublions pas que lobjectif dune telle architecture est aussi louverture des plates-formes et des interfaces des nouveaux acteurs. Cest, au vu de nombreux exemples, lunique solution pour avoir un march dynamique, ouvert et viable. La question essentielle est donc de savoir si les acteurs tablis dsirent rellement ouvrir leurs infrastructures des acteurs tiers, qui seraient dans le mme temps des concurrents potentiels.
Autorit de rgulation des tlcommunications
137
3.8.5 les terminaux au cur de la migration vers les NGN
Lvolution des terminaux fixes ou mobiles nest pas neutre dans le contexte des NGN. En effet, les rseaux et services de nouvelle gnration ne pourront prendre forme qu travers la disponibilit et ladoption effective de nouvelles familles de terminaux capables de les supporter et de les rendre attractifs. Les terminaux doivent donc ncessairement :
En premier lieu, sadapter au support des nouveaux services spcifis par les oprateurs et fournisseurs de services (point non spcifique aux NGN). Dans un second plan, intgrer les volutions des protocoles de contrle dappel des curs de rseaux NGN.
Ainsi, dune manire gnrale, les terminaux seront amens voluer vers :
Le support de services multimdia. Le dport dune partie de lintelligence de service qui permet une architecture de services distribue et plus efficace. La gestion de fonctions nouvelles telles que le nomadisme ou la golocalisation pour les terminaux mobiles. Lutilisation des nouveaux protocoles de contrle dappel utiliss pour dialoguer avec les plates-formes de services et avec les autres terminaux. A terme une part importante des terminaux seront vraisemblablement nativement IP multimdia.
Alors que la visibilit est relativement bonne sur les volutions des terminaux mobiles, elle lest beaucoup moins concernant les terminaux fixes. Notons cependant une tendance commune : une spcialisation de plus en plus grande des terminaux par usage. Il sera galement ncessaire pour tous les acteurs de prendre en compte les points cl suivants :
La non-rgression fonctionnelle par rapport aux terminaux traditionnels. Ladaptation matrielle et logicielle des terminaux afin dintgrer le traitement de nouveaux flux (streaming, image, vido, Internet) et de nouveaux langages de dveloppement de services (XML, Java). Linteroprabilit des services du fait de lexistence de terminaux htrognes, et en particulier pour les communications entre terminaux dancienne et terminaux de nouvelle gnration (IP multimdia). Le prix des terminaux fixes et mobile de nouvelle gnration, qui sera initialement lev, niveau de service gal, et le restera tant que le march ne sera pas rentr dans une production de masse. Enfin et surtout, la vitesse et les processus de renouvellement du parc de terminaux actuels.
De par leur maturit, leur diversit, leur cot et leur rapidit de diffusion, les terminaux jouent un rle dcisif pour permettre et faciliter la migration vers des rseaux et services NGN.
3.8.6 Migration vers les NGN : diversit des approches et facteurs de choix
Comme on la vu, il existe tous les niveaux dun rseau NGN des diversits dimplmentation possibles. Les principaux facteurs qui influenceront ces choix sont :
138
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Lavancement et la convergence des travaux de normalisation autour des architectures et protocoles NGN. La maturit et le cot des produits NGN par rapport leurs quivalents dancienne gnration et par rapport aux dites normes. Les offres de produits NGN sont rcentes, et ces deux aspects sont donc amens voluer rapidement. Linfrastructure existante des oprateurs et fournisseurs de services, qui influera sur les choix de ces derniers tant du point de vue technique quconomique, ainsi que leurs prvisions dvolution dactivits vis--vis de leurs clients et de leurs partenaires. Les avantages attendus de la migration vers les NGN, les risques potentiels associs et le contexte conomique et rglementaire dans lequel se situent les prises de dcisions de ces acteurs.
Hormis le premier point qui est trait dans le chapitre 4 suivant traitant de la normalisation, ces aspects sont dvelopps dans la partie conomique (chapitre 5) et la partie rglementaire (chapitre 6) de ltude.
3.9 Introduction : un foisonnement dorganisations impliques
3.9.1 Segmentation des organisations en jeu
Les NGN couvrant un trs grands nombre de domaines, de multiples organisations sont impliques dans les actions de normalisation autour de ce thme. En faire une liste exhaustive serait quasi impossible. Toutefois on peut distinguer plusieurs catgories dorganismes impliqus, en accord galement avec les indications releves lors des entretiens. Une premire classification peut tre tout dabord faite suivant le sujet trait par ces organisations :
Des organismes traitant seulement dune partie des composants ncessaires aux NGN (protocole, architecture, interface). Des organisations traitant du sujet NGN dans son ensemble.
Une deuxime classification peut galement tre ralise suivant le mode dintervention des organisations :
Des organisations historiquement impliques dans les activits de normalisation, avec un fonctionnement bas sur des dcisions majoritaires (votes) et une reprsentativit par pays ou par organisation membre. Des organisations plus tournes vers une standardisation de facto par consensus des membres participants et prsentant en gnral un fonctionnement de type forum.
Sans prtendre lexhaustivit, quelques organisations ont t places sur le schma cidessous afin dillustrer cette double segmentation.
Autorit de rgulation des tlcommunications
139
Normalisation globale
NGN Initiative ETSI : NGN-SG
Normalisateur historique
UIT-T : SG4, SG11, SG13, SG16 ETSI : TIPHON, AT, SEC, SPAN, TMN, ...
Standardisation de fait, forum
IETF W3C Parlay
ISC, MSF 3GPP ATM-F IPv6 Forum DSL-F
Normalisation partielle
Figure 38: Positionnement dune partie des organisations de normalisation (source : Arcome)
3.9.2 Grandes tendances ressortant des entretiens
Les entretiens mens avec un panel de constructeurs, oprateurs et fournisseurs de services ont permis aux acteurs rencontrs dexprimer leurs attentes et stratgies en normalisation et standardisation, ainsi que les organismes cl auxquels ils participent ou sur lesquels ils sappuient dans ces domaines.
Interrogs sur les organismes quils considrent comme pertinents dans le cadre de la normalisation / standardisation des NGN, les constructeurs ont cit massivement lIETF, organisme o se standardise Internet, qui apparat comme lorganisme incontournable. A un degr moindre viennent des organismes comme le 3GPP, lUIT ou lISC, puis lETSI, le MSF, le W3C, le Parlay Group ou le consortium OMA.
Toutefois ce classement masque des disparits importantes entre organisations. Les constructeurs ne placent pas tous ces organismes sur un mme plan et leur attribuent des spcificits :
LIETF est vu quasi unanimement comme le lieu du travail de standardisation technique effectif pour les NGN. Un certain nombre dorganismes sont prsents comme des lieux de normalisation ddis : 3GPP pour travailler sur lUMTS, Parlay Group pour dfinir linterface entre le rseau et les fournisseurs de services Les forums ISC et MSF sont vus comme des lieux plus tourns vers lchange marketing et moins axs sur les discussions techniques. LUIT et lETSI ont t cits la fois comme des organisations de normalisation historiques et comme des lieux de travail effectifs tourns vers les NGN. Le W3C est lorganisme de rfrence pour la standardisation des technologies web.
Cette profusion des organisations accueillant aujourdhui des discussions autour des NGN rend compte de la diversit des initiatives des constructeurs et oprateurs. Plusieurs constructeurs interviennent dans de multiples forums mais nont pas fourni de liste plus dtaille, ce qui soulve la question du risque de dispersion des initiatives. Des cooprations plus ou moins formelles se nouent galement entre organismes impliqus dans les NGN. A titre dexemple on peut citer :
140
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Une coopration formelle, base sur la signature dun MoU : ETSI/ATM Forum/UITT SG13. Des comits communs afin daboutir un objectif prdfini :Parlay/3GPPCN5/ETSI SPAN/JAIN pour OSA
Dans le cadre du dveloppement de leurs offres de produits NGN, les constructeurs interrogs plbiscitent le recours systmatique aux normes et standards quand ils existent. Le recours aux dveloppements propritaires est principalement utilis pour assurer le dveloppement de services innovants. Il saccompagne alors dune publication systmatique, et trs frquemment dun travail de standardisation.
Autorit de rgulation des tlcommunications
141
Les oprateurs sont trs peu impliqus dans les organismes de normalisation. Cependant pour la plupart dentre eux, la conformit des solutions utilises avec les normes et les standards est essentielle. Ils attendent des constructeurs quils proposent des solutions normalises, mais les normes permettant diffrentes interprtations, les oprateurs demandent que ces solutions soient interoprables.
Les constructeurs interrogs plbiscitent le recours systmatique aux normes et standards quand ils existent. Les oprateurs sont trs peu impliqus dans les organismes de normalisation. Cependant pour la plupart dentre eux, ils attendent des constructeurs quils proposent des solutions normalises et interoprables.
3.9.3 Normalisation et rglementation
Concernant le rle des rgulateurs dans les processus de normalisation, les attentes des acteurs sont logiquement diffrentes, bien que se rejoignant sur le besoin de coordination :
Pour les constructeurs : Une coordination des rgulateurs avec les organismes de normalisation permettra aux acteurs, constructeurs et oprateurs, de mieux apprhender le dveloppement de nouvelles solutions dans le cadre dfini par la rglementation.
Pour les oprateurs : Il ressort que le besoin de rgulation au niveau europen est de plus en plus pressant, notamment parce que les oprateurs sont trs souvent paneuropens. Dans cette optique, le package 2000 semble tre bien peru, pour ceux qui en connaissent lexistence, dans lvolution vers les NGN. Le rgulateur doit intervenir sur le sujet de la normalisation dans le cas o celle ci met en pril le respect de la concurrence ; cela pourrait se traduire par :
une collaboration plus troite avec les organismes de normalisation pour sassurer de la neutralit des dcisions technologiques une vrification de la conformit des oprateurs avec les normes en vigueur, au moins concernant les interconnexions et les services proposs par les acteurs majeurs.
Pour les constructeurs, une coordination des rgulateurs avec les organismes de normalisation permettrait de mieux adapter les nouvelles solutions aux attentes de la rglementation. Les oprateurs attendent des rgulateurs une collaboration plus troite avec les organismes de normalisation pour sassurer de la neutralit des dcisions technologiques pour vrifier la conformit des oprateurs majeurs avec les normes en vigueur.
142
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.10 Les organismes de normalisation traditionnels : un rle fdrateur ?
Les organisations historiquement impliques dans la normalisation sont lUIT-T (au niveau mondial) et lETSI (au niveau europen). Leur implication dans les NGN aujourdhui est base sur des programmes spcifiques NGN (NGN-Starting Group lETSI) et travers les multiples sous-groupes travaillant sur des domaines intgrs ou connexes aux NGN.
Toutefois lETSI et lUIT-T sont peu cits dans les publications relatives aux NGN ou dans les entretiens ou confrences. Leur influence semble limite sur ce sujet. Les acteurs du march des NGN les voient comme des organismes permettant la consolidation et la diffusion de standards une fois leur spcification effectue auprs dautres instances, dont les forums par exemple, et ayant un rle important jouer pour la consolidation ou la dfinition dune architecture gnrale commune ainsi que la vrification de linteroprabilit des solutions NGN. La ncessit dune forte ractivit dans un domaine qui volue de plus en plus rapidement est une des explications les plus probables de cet tat de fait actuel.
3.10.1 Niveau europen : LETSI
LETSI (European Telecommunications Standards Institute) est lorganisation europenne de standardisation pour les Tlcommunications. En novembre 2001, lETSI compte 873 membres en provenance de 54 pays : constructeurs (52%), oprateurs (15%), fournisseurs de services et autres (23%), administrations (7%) Les thmes traits lETSI sont dclins au travers de Comits Techniques sur un sujet donn (ex : AT Access and Terminals) ou sur une architecture donne (ex : TIPHON Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks). Des groupes ponctuels peuvent tre crs pour clairer lassemble gnrale de lETSI sur un thme donn. Dans ce cadre, un groupe NGN-SG a men en 2001 un travail de rflexion sur les NGN.
3.10.1.1
NGN-SG
Partant du constat que la normalisation lie aux NGN tait parse travers de multiples sous-groupes de lETSI et de multiples forums extrieurs, lAssemble Gnrale de lETSI a dcid de crer un groupe Starter Group charg de faire un tat des lieux et de proposer des points dactions lETSI. Ce Starter Group (NGN-SG) a principalement travaill par change de mails entre ses membres et a rendu son rapport lors de lAssemble Gnrale (GA 38) des 20 et 21 Novembre 2001 :
La premire tche des 200 membres participants a t de dfinir les NGN (cette dfinition figure dans le chapitre 2 Dfinitions du prsent rapport). Ensuite un tat des lieux a rvl que la standardisation autour du domaine des NGN tait parpille dans un nombre consquent de comits techniques, internes ou externes lETSI. Cet tat de fait conduisant une absence de visibilit sur les domaines ncessitant une normalisation, des adoptions de standards contradictoires ou un gaspillage de ressources par suite de recherches similaires menes plusieurs endroits. Cela est reconnu lintrieur de plusieurs forums.
Autorit de rgulation des tlcommunications
143
Toutefois le sujet des NGN est trop vaste pour tre trait dans un seul forum et lETSI devra donc participer plusieurs initiatives pour couvrir le sujet en entier. Le NGN-SG propose donc que lETSI joue un rle de fdrateur des initiatives autour des NGN.
Le NGN-SG a de plus identifi un certain nombre de points ncessitant une action spcifique : Larchitecture NGN, les dfinitions de rfrence et les protocoles de contrle. La qualit de service de bout en bout. La cration de service, le contrle et la personnalisation. La gestion des rseaux NGN. Les interceptions lgales.
Pour chacun de ces points les comits de discussion les plus avancs (internes ou extrieurs lETSI) ont t identifis par le NGN-SG ainsi quune proposition de collaboration fournir par lETSI sur le sujet.
3.10.1.1.1
Architecture NGN
Larchitecture propose par le groupe TIPHON de lETSI peut tre propose comme dbut de rflexion pour la dfinition de larchitecture des NGN. Les autres organisations importantes identifies par le NGN-SG comme intervenant dans la partie architecture sont :
ISC (architecture softswitch) IETF SIP (protocoles) MSF (architecture base sur la sparation) Parlay, 3GPP, JAIN, ETSI SPAN12 (contrle dappel et API pour contrle de service) 3GPP (accs UMTS) ETSI TIPHON (architectures gnriques et interoprabilit avec RNIS, RTC et SIP) ETSI SPAN (volution et interoprabilit avec RNIS) UIT-T SG9, 11, 13, 15 et 16 (standardisation de terminaux, protocoles de signalisation, architectures, codecs, multimdia, SS7, protocoles Internet).
3.10.1.1.2
Qualit de service de bout en bout
Il est important daboutir une normalisation de la qualit de service de bout en bout pour les services voix avant de traiter nimporte quel autre type de trafic. Pour le NGN-SG les organisations impliques dans cette problmatique sont :
ETSI TIPHON et STQ ont dores et dj abouti un document (TS 101 329-1) portant sur la dfinition de classes de services harmonises pour la tlphonie. Ces travaux sont suivis par lUIT-T SG11 et 16 pour la ngociation de ces classes entre systmes. ETSI TIPHON et lUIT-T SG16 ont dbut un travail concernant la dfinition de classes de services pour le multimdia. Ce sujet intresse galement lIETF et le DVB.
144
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Concernant les mcanismes de ngociation entre couches basses, le NGN-SG recommande que lIETF soit considr comme le leader pour le protocole IP et lATM-Forum pour le protocole ATM. Les travaux de lETSI pourront utilement contribuer dans ces deux structures.
3.10.1.1.3
Cration de service, personnalisation
Le NGN-SG reconnat quil est important de disposer darchitectures ouvertes et dinterfaces compatibles et harmonises. Dans ce cadre les travaux relatifs lAPI OSA sont considrer comme un point de dpart et une discussion doit souvrir avec Parlay Group, 3GPP, JAIN, et ETSI SPAN.
3.10.1.1.4
Gestion des rseaux NGN
Le NGN-SG recommande de complter les spcifications et dfinitions dj existantes par apport dinformations spcifiques aux NGN. Cela peut concerner des textes mis par lUIT, lIETF et lETSI.
3.10.1.1.5
Interceptions lgales
Le NGN-SG recommande que ce point soit trait en collaboration avec les diffrents comits et experts, puisque larchitecture ouverte des NGN autorise les services tre fournis sur plusieurs piles de protocoles, rendant le travail dinterception plus complexe.
3.10.1.2 TIPHON : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks
Le projet TIPHON est souvent cit par le NGN-SG comme pivot central de rflexion sur les NGN. Ce projet a t cr en 1997 afin de coordonner les efforts dinterfonctionnement et dinteroprabilit entre les diffrents protocoles. Il a pour objectif de dvelopper un protocole de communications gnralis pour les services de voix sur IP sur des rseaux de tlphonie publique ; ce mta-protocole tant indpendant des protocoles de transport utiliss. TIPHON doit aussi grer linterfonctionnement entre SIP et H.323 ainsi que de ceux-ci avec ISUP pour fournir linteroprabilit avec les rseaux de commutation de circuits. Ce projet na pas pour objectif de dfinir de nouveaux standards, mais plutt des concepts permettant de faire voluer les rseaux en facilitant la migration et linteroprabilit des rseaux de diffrentes natures. TIPHON est aussi en contact troit avec lIETF, le MSF et lISC. Actuellement, il est compos de huit groupes de travail :
WG1 : Dfinition des caractristiques des services WG2 : Architecture de la solution WG3 : Dfinition des protocoles WG4 : Adressage et nommage WG5 : Qualit de service WG6 : Vrification et dmonstration WG7 : Mobilit WG8 : Scurit
Autorit de rgulation des tlcommunications
145
3.10.1.3
Les autres comits de lETSI impliqus dans les NGN
De trs nombreux groupes techniques de lETSI sont impliqus dans les NGN, comme la identifi le NGN-SG :
ETSI AT (Access and Terminals) : traite des aspects lis aux terminaux. ETSI BRAN (Broadband Radio Access Networks) : ce projet ETSI a dvelopp les standards des rseaux Hyperlan et travaille sur les standards concernants les rseaux radio daccs large bande en environnements varis. ETSI HF (Human Factors): travaille sur le sujet Common Identification Schemes for NGN (DEG/HF-00038) ETSI SEC (Security) : groupe transverse sassurant que les aspects scurit sont bien pris en compte dans lensemble des travaux de l'ETSI. ETSI SES (Satellite Equipment and Systems) : prpare les spcifications darchitecture pour un rseau satellitaire supportant des services large bande. ETSI SPAN (Services and Protocol for Advanced Networks) : comit technique comptent pour tous les aspects lis la standardisation des rseaux fixes et qui traite galement des rseaux IP. Ce comit prend en charge la mobilit dans les rseaux fixes. ETSI STQ (Speech processing, Transmission and Quality aspects) : coordonne et produit les documents relatifs la qualit de la voix, dans les rseaux fixes ou mobiles. ETSI TMN (Telecommunications Management Network) prend en charge les problmatiques de gestion des rseaux de tlcommunications mais ne se limite pas aux systmes de gestion.
3.10.2 Niveau international : LUIT-T
LUIT-T a engag une rflexion autour des NGN, la fois en termes techniques (quels protocoles, quelle normalisation) mais galement en terme de place de lUIT-T dans ce processus de migration des rseaux et de convergence des services.
A lintrieur de lUIT-T plusieurs groupes sont aujourdhui concerns par la problmatique NGN. Le principal groupe est le SG13 (Multi-protocol and IP-based networks and their internetworking) qui prend galement en charge linteroprabilit entre NGN et rseaux IP. Mais il faut citer galement :
SG4 (Telecommunications management including TMN) SG9 (Integrated broadband cable networks and television and sound transmission) SG11 (Signalling requirements and protocols) SG16 (Multimedia services and systems) : en charge en particulier des protocoles H.323 et H.248 (MEGACO) SSG IMT2000 : ce groupe spcial dtude (Special Study Group) prend en charge les aspects rseaux de la rflexion IMT2000 (International Mobile Telecommunications 2000 and beyond).
3.11 LIETF : une organisation incontournable
Le principal organisme cit par les acteurs dans le cadre de la normalisation/standardisation des NGN est lIETF, ce qui est rapprocher de limportance prise par le protocole IP dans les NGN.
146
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
LIETF (Internet Engineering Task Force) regroupe lensemble des intervenants concerns par lvolution dInternet. Cette communaut accueille des personnes morales mais aussi des individus. Des groupes de travail organiss par thmes travaillent principalement par change de courriers lectroniques.
LIETF est concern par lensemble des aspects lis la standardisation des protocoles, mais na que peu dinfluence sur les aspects architecture des NGN.
3.11.1 Prsentation gnrale
LIETF est le plus important groupe de standardisation des techniques de l'Internet. Des groupes de travails organiss par thmes travaillent principalement par change de courriers lectroniques. LIETF est concern par lensemble des aspects lis aux protocoles mais na que peu dinfluence sur les aspects architecture des NGN. LIETF a t cr, en 1986, par des chercheurs amricains. Les runions de lIETF, ouvertes tous, ont rencontrs un grand succs depuis le dbut des annes 90. En 1992, lInternet Society fut cr, en partie pour donner un statut lgal aux activits de lIETF. LInternet Society est une organisation internationale ayant pour objectif la promotion de lInternet dans les rgions du globe o il nest pas encore trs dvelopp. Pour participer, il suffit de trouver un sujet digne d'intrt puis de constituer un groupe de travail, lequel laborera sa propre charte en accord avec l'IESG (Internet Engineering Steering Group) ; les participants ne reprsentent ni leur employeur ni leur pays d'origine. Actuellement, sur les quelque 1800 des participants l'IETF, seulement un tiers n'est pas originaire des Etats-Unis ou du Canada (environ 300 Europens, dont une vingtaine de Franais).
3.11.1.1
Les tapes de cration dun RFC
Tous ces changes poursuivent un mme objectif : laborer un RFC (Request For Comments), document dont l'objet initial est de dfinir un standard pour les rseaux IP, c'est--dire un lment de l'ensemble de ces protocoles de communication. Les RFC ont des attributs qui dcrivent leur niveau de standardisation et leur importance. Numrots chronologiquement et par ordre croissant, les RFC peuvent tre regroups en trois grandes catgories :
RFC d'information - RFC mis au point par une autre organisation de normalisation/standardisation et intgre la communaut de Internet, RFC exprimental - RFC conue pour faire des expriences. Un RFC exprimental n'est pas oprationnel, RFC standardis - RFC ltat de standard.
Autorit de rgulation des tlcommunications
147
3.11.1.2
Les tapes du passage dun RFC ltat de standard
Pour rejoindre cette dernire catgorie, le RFC doit franchir trois tapes successives :
ltape protocole propos pour passer ltat de standard . Le protocole peut devenir l'avenir un protocole standardis, ltape protocole standardis ltat de brouillon . Le protocole subit de nombreux tests et tudes pour devenir un protocole standardis, ltape protocole standardis . Le protocole est alors un standard officiel dInternet, donc applicable.
Toutes ces tapes sont vises par l'IAB (Internet Architecture Board), conseiller technique de l'IETF et responsable en dernier ressort de la publication des RFC. Les groupes de travail (plus dune centaine) sont organise en plusieurs entits (areas) : Applications, Internet, Operations and Management, Routing, Security, Operations and Management, Sub-IP, Transport, User Services. Ces entits sont diriges par des directeurs qui sigent lIESG (Internet Engineering Steering Group). LIESG est le bureau dapprobation des standards. De plus, des membres de lIAB (Internet Architecture Board) ont le rle de conseillers de lIESG pour la cration des groupes de travail et concernant les problmatiques darchitecture pour les travaux mens lIETF. LIETF est trs actif dans llaboration des nouveaux protocoles pour les rseaux IP. Dailleurs plusieurs sont dj devenus des standards de fait dans les rseaux actuels et joueront un rle majeur dans les futurs rseaux. Une liste des plus significatifs est prsente ci-dessous.
3.11.1.2.1
Applications area
Instant Messaging and Presence Protocol
3.11.1.2.2
Internet area
Historiquement, le protocole IPv4 a t dfinitivement standardis par lIETF en septembre 1981 (RFC 791, Internet Protocol Darpa Internet Protocol Specification). Le protocole IPv6 a lui t standardis en dcembre 1998 (RFC 2460, Internet Protocol Version 6 Specification).
3.11.1.2.3
Security
La scurit est un problmatique trs importante sur les rseaux IP ; lIETF est lorigine de plusieurs mcanismes de scurit :
Le protocole IPSec (IP Security Protocol, RFC 2401) pour le cryptage et lauthentification des donnes. Le protocole PKI (Public Key Infrastructure X.509, RFC 2459 ) dfinit la gestion des certificats dauthentification et des cls de cryptage sur un rseau public. Un groupe de travail dveloppe galement un mode de signature digitale pour le protocole XML, protocole sur lequel sont bass les Web services
3.11.1.2.4
Sub-IP
Le protocole MPLS (Multiprotocol Label Switching, RFC 3031) a t dvelopp pour la gestion de la qualit de service des flux IP et de lingnierie de trafic des rseaux IP. Ce protocole est de plus en plus utilis sur les curs de rseau de oprateurs en particulier pour proposer des services de VPN-IP.
148
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.11.1.2.5
Transport area
Cest lune des entits la plus implique dans le domaine des NGN : elle englobe les problmatiques de la couche Transport mais aussi de la couche Contrle. Le mcanisme de classification des paquets IP, DiffServ (Differentiated Services, RFC 2474) est utilis dans la grande majorit des rseaux IP offrant de la qualit de service.
RTP (Real time Transport Protocol, RFC1889) et RTCP (Real Time Control Protocol, RFC 1890) sont les protocoles devenus standards de fait pour la gestion du transport des flux media temps rel. Propos comme standard lIETF en 1999, le protocole SIP (Session Initiation Protocol, RFC 2543), de lIETF, est un protocole de signalisation pour ltablissement dappel et de confrences temps rel sur des rseaux IP. LInternet Draft SIP-T (SIP pour la tlphonie) de lIETF dfinit la gestion de la tlphonie par le protocole SIP ainsi que linterconnexion avec le RTC . Concernant plus spcifiquement le transport des messages de signalisation SS7 et RNIS sur des rseaux IP, un groupe de travail de lIETF appel SIGTRAN (SIGnalling TRANsport, informational RFC 2719) a t dvelopp. Le but est de dfinir le protocole de contrle entre les signalling gateway, les Media gateway controllers et les signalling points du rseau IP. MGCP (Media Gateway Control Protocol, RFC 2705). LIETF cra dans le mme temps un groupe de travail appel MEGACO (MEdia GAteway COntrol) pour standardiser un protocole pour linterface Media Gateway Controller Media Gateway. Depuis 1999, lUIT et lIETF travaillent conjointement sur le dveloppement du protocole MEGACO/H.248. Une premire version de H.248 a t adopt en juin 2000 (RFC 3015 de lIETF). Le standard ENUM, dcrit dans le RFC 2916 de lIETF, dfinit le protocole et larchitecture reposant sur le systme de nom de domaine permettant de crer un identifiant de service, correspondant au numro de tlphone E.164. Ces adresses pourront tre utilises pour le service de messagerie, les adresses URL, adresse SIP,
LIETF est devenu lorganisme incontournable pour toutes les problmatiques lies aux rseaux IP et donc aux NGN. Cet organisme a montr sa capacit dfinir des standards pour les rseaux IP : depuis les protocoles IPv4 et IPv6 en passant par IPSec jusquau MPLS. De nombreux groupes de travail concernant les NGN ont t crs pour llaboration de protocoles de contrle (MEGACO, SIP, SIGTRAN), dadressage (ENUM), de transport de flux temps rel (RTP/RTCP) auxquels se rallient de trs nombreux acteurs.
Autorit de rgulation des tlcommunications
149
3.12 Le W3C World Wide Web Consortium : lorganisme ddi aux technologies Web
Le World Wide Web Consortium a t cr en 1994. Il a pour objectif de dvelopper des protocoles communs, de promouvoir lvolution et dassurer linteroprabilit du World Wide Web. Le W3C regroupe plus de 500 organisations dans le monde. Les activits du W3C sont gnralement organises en groupes de travail rpartis dans cinq domaines :
Le Architecture Domain qui est responsable de dvelopper les technologies sur lesquelles sappuie le Web. Le Documents Formats Domain qui travaille sur les formats et les langages utiliss pour la mise en forme des informations prsentes lutilisateur final. Le Interaction Domain charg de lamlioration de lergonomie du Web. Le Technology and Society Domain qui dveloppe les infrastructures Web permettant dappliquer les rgles lgales et publiques. La Web Accessibility Initiative (WAI) qui travaille la promotion de solutions permettant laccs au Web pour les personnes handicaps.
Le W3C (World Wide Web Consortium) a cr le XML Protocol Activity pour standardiser un protocole de communication inter-applications bas sur XML. En 2002, sous limpulsion de Microsoft, IBM, Sun et Oracle, notamment, ce groupe a t tendu lensemble des aspects des Web services et sappelle dsormais le Web Services Activity.
150
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.13 Les forums et groupements dintrts au cur des NGN
Autour des organismes de normalisation historiques et de lIETF, plusieurs forums interviennent de faon plus spcialise. Ces forums sont prsents par les acteurs des NGN comme des lieux o se ralise aujourdhui le travail effectif de standardisation, en gnral autour de solutions consensuelles.
Les forums sont porteurs dune image de ractivit et le travail sy fait majoritairement via discussions lectroniques. Toutefois certains acteurs majeurs peuvent influencer de manire importante ces forums et restreindre laccs aux informations pour les autres participants.
3.13.1 La vision mobile des NGN (UMTS) : le 3GPP
Le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) est le fruit de la collaboration de plusieurs organismes de standardisation ainsi que de la plupart des constructeurs concerns. Lobjectif du 3GPP est de dfinir un ensemble de spcifications techniques pour les me systmes mobiles de 3 gnration UMTS (norme de la famille IMT-2000 retenue en Europe).
Le 3GPP joue un rle jug important dans le cadre des NGN, puisquil a la charge de normaliser lUMTS, premier systme spcifi dans sa globalit selon une architecture NGN (norme UMTS phase 2, voir chapitre 3.4.7).
Le 3GPP2 est le pendant du 3GPP pour la dfinition des spcifications techniques pour me les systmes mobiles de 3 gnration nord-amricains et asiatiques supports par lANSI, le TIA et lEIA-41, et eux aussi issus de linitiative IMT-2000.
3.13.2 Les organismes lis la spcification des interfaces entre rseau et services
Comme nous lavons vu dans le cadre de ltude technique en chapitre 3.5 sur la couche Services, deux modles de services NGN semblent devoir cohabiter : le modle OSA/Parlay dune part, et le modle web services dautre part. Cette dualit se retrouve au niveau des organismes significatifs pour la standardisation des interfaces entre rseaux et plates-formes de services NGN.
3.13.2.1
Le modle de services OSA/Parlay
3.13.2.1.1
Parlay Group
Le Parlay Group est un forum organis dans le but de crer des interfaces API ouvertes afin de faciliter le dveloppement dapplications sur de multiples rseaux. Cette dfinition prendra la forme dune API (Application Programming Interface) pour le modle OSA (Open Service Access).
3.13.2.1.2
JAIN Initiative
Lobjectif de JAIN (Java APIs for Interoperable Networks) Initiative est de crer un ensemble ouvert, depuis les fournisseurs de services tiers, en passant par les oprateurs et les constructeurs, jusquaux fabricants de terminaux et aux clients finaux.
Autorit de rgulation des tlcommunications
151
Cet ensemble est dfini pour tre distribu depuis nimporte quel protocole et middleware .
3.13.2.1.3
Joint API Group
Lobjectif de ce groupe de travail tant de proposer une interface standardise unique pour, lensemble des besoins, chaque organisme sest align sur ce modle fdrateur : le 3GPP travers SA1 et SA2, ETSI par le SPAN 14 SPAR, et Parlay par le Parlay Group.
Le modle douverture des rseaux aux services tiers OSA/Parlay est spcifi et standardis par le Joint API Group qui fdre les travaux du 3GPP, de lETSI, du JAIN (Java APIs for Interoperable Networks) et du Parlay Group.
3.13.3 Le modle Web services : le W3C
Le W3C (World Wide Web Consortium) a cr le XML Protocol Activity pour standardiser un protocole de communication inter-applications bas sur XML. En 2002, sous limpulsion de Microsoft, IBM, Sun et Oracle, notamment, ce groupe a t tendu lensemble des aspects des Web services et sappelle dsormais le Web Services Activity.
Le W3C est lorganisme en charge la standardisation des Web Services . Les Web Services sont bass sur une architecture de services distribue, ouverte et utilisant des protocoles orients web. Cest un modle auquel se rallie des constructeurs majeurs du monde du logiciel et des solutions Web.
3.13.4 Les organismes de promotion et de tests dinteroprabilit des NGN
Nous avons identifi trois organismes particulirement en charge de la promotion et des tests dinteroprabilit des solutions NGN : lIMTC, lISC et le MSForum. A noter que sur le point des tests dinteroprabilit, un nombre important de constructeurs mettent en place par eux-mmes des programmes de tests complmentaires selon une approche systmatique (surtout pour les nouveaux acteurs spcialiss) ou plus frquemment par partenariats (ex. : accord de partenariat OEM) ou encore plus souvent en fonction de projets de leurs clients. Ils mettent alors disposition de leurs clients et prospects des tableaux de test et de conformit. Ces bonnes initiatives ont nanmoins linconvnient de ne pas bnficier de la caution dun organisme rellement indpendant.
3.13.4.1
Le consortium IMTC
LIMTC (International Multimedia Telecommunications Consortium) est une organisation qui a pour objectif de promouvoir et de faciliter le dveloppement et limplmentation des solutions de communications multimdia bases sur des standards internationaux. LIMTC a plus dune centaine de membres, incluant des constructeurs, des oprateurs, des fournisseurs de services et est ouvert toute organisation ayant un lien avec les tlcommunications multimdia. Plusieurs sessions de tests dinteroprabilit de produits sont rgulirement organises.
152
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Les travaux portent particulirement sur H.323, H.320, T.120, SIP et H.248/Megaco. Pour cela, lIMTC travaille en collaboration avec les organismes tels que lUIT-T, lETSI et lIETF mais aussi avec des forums tels que le MS Forum.
3.13.4.2 LISC (International SoftSwitch Consortium) et le MSForum (Multiservice Switching Forum)
Ces deux organisations figurent parmi les organisations actives pour la promotion des NGN. Elles sont impliques dans linteroprabilit entre quipements de multiples constructeurs. LISC a t cre en 1999 et son objectif est la coordination de linterfonctionnement pour les communications et les applications multimdia bases sur des technologies Internet . Le MSForum a t fond en 1998 et a pour objectif de dvelopper des architectures ouvertes ainsi que des plates-formes de communications multiservices. Ces deux organisations sont organises en plusieurs groupes de travail :
Pour lISC les groupes de travail portent sur : les applications, les quipements de contrle, le marketing, la gestion de session, le protocole SIP et les problmatiques dinterception lgale. Le MSForum, pour dfinir larchitecture des NGN, sorganise autour des thmes suivants : marketing et comit sur lducation, comit technique, architecture, interoprabilit, gestion, contrle des flux Media , contrle de la commutation.
Alors que lISC compte un grand nombre de membres mais peu de gros oprateurs IP, le MSForum compte moins de membres mais reprsente des socits de taille plus importante, et prsente un quilibre entre oprateurs et constructeurs. Une autre diffrence entre les deux organisations repose sur linfrastructure propose pour la technologie softswitch : lISC base ces services sur une infrastructure IP alors que le MSForum fait la promotion dun architecture utilisant une infrastructure ATM.
Enfin, le MSForum publie des Implementation agreements (ex. : protocole MEGACO) et des Architecture frameworks, alors que lISC ne semble pas avoir vocation publier des documents techniques de rfrence.
Autorit de rgulation des tlcommunications
153
3.14 De multiples organisations spcialises ou connexes
Ce tour dhorizon des institutions lies la normalisation des NGN se termine sur les forums et organisations trs nombreuses qui interviennent soit au titre dun protocole (exemple : ATM Forum) soit au titre dune association de constructeurs (exemple : ECMA). Sans prtendre lexhaustivit, il nous parait utile de prsenter les organisations ci-aprs, qui sont directement impliques dans une technologie lie aux NGN (mais pas spcifique) ou qui ont t cits par des acteurs rencontrs en entretien :
Le MPLS Forum regroupe les diffrents constructeurs et utilisateurs du protocole MPLS. Les sujets discuts dans ce forum portent sur linteroprabilit entre constructeurs, les accords dimplmentation et les programmes de formation. LATM-Forum est une organisation internationale sans but lucratif fonde en 1991 compose de plus de 500 membres et dont le but est dacclrer le dveloppement et le dploiement massif des technologies large bande ATM. Le forum IPv6 na pas pour mission de dvelopper des normes. Cet aspect est ddi lIETF. Par contre lIPv6 Forum a pour but dassurer la promotion du protocole en assurant la circulation de linformation ncessaire. Le DSL Forum est une organisation fonde en 1994 et qui compte aujourdhui plus de 330 membres. Initi dans le but de dfinir les technologies DSL, ce forum a maintenant pris en charge le suivi du dploiement des technologies normalises (ADSL et SHDSL), la mise au point des technologies haut dbit (VDSL et autres) et la circulation dinformation entre constructeurs. Le projet DVB (Digital Video Broadcasting) est un consortium qui runit plus de 300 membres en provenance de 35 pays (diffuseurs, constructeurs, oprateurs de rseaux, rgulateurs) afin de dfinir des standards globaux de diffusion de tlvision numrique et des services data. Packet Cable est une initiative issue de lassociation CableLabs afin de dvelopper des spcifications techniques dinterface pour la diffusion de services multimdia sur le cble, bas sur le protocole IP. Ce projet insiste particulirement sur les aspects dinteroprabilit entre produits de diffrentes sources. LECMA (European Computer Manufacturers Association) est une association europenne de 45 constructeurs fonde en 1961 dans le but daider au dveloppement et la diffusion de standards et de normes en collaboration avec les organisations existantes. Toutes les publications de lECMA sont mises disposition gratuitement afin den assurer la plus grande diffusion possible. A lorigine destine uvrer dans le domaine de linformatique, lECMA sest progressivement ouverte aux technologies de linformation. LECMA intervient dans le domaine des NGN au travers en particulier de son comit technique TC32TG17 : IP-based multimedia communications.
154
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
3.15 Quelques programmes de recherche et exprimentations NGN
Les principaux programmes de recherche et exprimentations europens sont mens sous lgide de la Commission Europenne. En voici quelques exemples significatifs.
3.15.1 NGN Initiative
Le projet NGN Initiative a t officiellement lanc le 1 janvier 2001 avec un financement de la Commission Europenne. Ouvert toute organisation sintressant au sujet des NGN, le projet fonctionne comme un lieu dchange ouvert pour tous les aspects lis aux NGN. Les lments ainsi collects seront diffuss travers les forums, les organisations de standardisation et toute autre organisation intervenant sur le sujet.Ce projet regroupe des constructeurs et oprateurs, ainsi que de nombreux organismes de recherche, universits et coles. Concrtement le projet prvoit :
er
De mettre en place une expertise internationale reconnue sur le thme des NGN afin de fdrer les initiatives associes que ce soit au sein des projets IST ou autour des programmes internationaux comme Internet 2, NGI, Optical Internet Forum De raliser un benchmark des rsultats des activits et des dveloppements NGN dans le monde et den publier les rsultats. De contribuer la mise au point de normes. De raliser et publier des prvisions sur les tendances lies aux NGN.
Ce travail sera men bien au sein de groupes de travail (TWG : Topic Working Groups). Les premiers thmes identifis ont port sur les infrastructures et rseaux optiques, la qualit de service et la gestion du trafic, le gestion des rseaux Le projet NGN Initiative a annonc ds le dbut vouloir travailler en collaboration troite et stratgique avec plusieurs organisations : NGI (programme amricain Next Generation Internet), EURESCOM, COST, IETF, ETSI, Internet 2, UMTS Forum, IPv6 Forum, 3GPP, NMF, OMG,
3.15.2 TERENA - Task Force NGN
TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) est rsultat de la fusion en octobre 1994 des projets RARE (Rseaux Associs pour Recherche Europenne) et EARN (European Academic and Research Network) dans but de promouvoir et de participer au dveloppement dune infrastructure pour recherche et lducation. le la le la
Les membres de TERENA sont des rseaux de recherche nationaux europens (pour la France : RENATER) et des organismes de recherche internationaux (CERN, ECMWF). Un nombre limit dentreprises prives sont acceptes en qualit de membres associs (laboratoires, constructeurs comme Cisco et IBM, oprateurs comme Teleglobe) afin dapporter les comptences ncessaires. La Commission Europenne est observateur permanent du programme. En novembre 2000 une Task Force NGN a t lance en vue dtudier lutilisation des nouvelles technologies dans les futurs rseaux de recherche europens. Pour ce faire la Task Force :
Dispose dun forum dchange des expriences et des comptences Ralise la promotion et les tests des nouvelles technologies innovantes
Autorit de rgulation des tlcommunications
155
Dfinit, dveloppe et teste les nouveaux services qui pourrait tre introduit dans les rseaux nationaux ou dans le cur du rseau europen.
Les sujets qui sont traits par la Task Force concernent tous les aspects lis aux NGN dont : Ipv6, la qualit de service, les services bass sur DiffServ, les rseaux optiques, lanalyse de performance des rseaux,
3.15.3 Projet INTERNODE
Le projet INTERNODE (INTERworking of NOmadic multi-Domain sErvices) est un projet de recherche et dveloppement dune dure de 2 ans initi en Septembre 2000 et cofinanc par la Commission Europenne dans le cadre du programme ISP. Y participent 7 organismes europens (oprateurs, constructeurs, entreprises, universitaires). Ce projet a pour objectif de tester la mise en uvre dune solution intgre permettant un fournisseur de services indpendant de grer des rseaux privs virtuels (VPN) IP mobiles offrant aux utilisateurs :
Un accs scuris leur rseau dorigine Une accessibilit via une adresse unique Litinrance entre des rseaux daccs htrognes (GPRS et WLAN) qui supportent le service de VPN, via diffrents types de terminaux (ex. : PDA, PC), et ce de manire transparente.
Ce service sappuie sur une plate-forme de service indpendante des rseaux daccs et des curs de rseaux utiliss pour vhiculer le trafic des utilisateurs. Ses objectifs sont de :
Tester et amliorer des technologies efficaces pour la fourniture de ce service. Raliser une interconnexion transparente entre les technologies GPRS et WLAN. Intgrer de nouvelles technologies dans une plate-forme de dmonstration : GPRS, IPSec, mobile IP et PKI. Exprimenter deux tudes de cas : laccs distant un rseau dentreprise via des rseaux GPRS et WLAN, et laccs en mobilit via GPRS une application bancaire scurise. Mettre en uvre ces services dans un rseau oprationnel. Contribuer la standardisation et la diffusion des rsultats de cette exprimentation.
3.15.4 IPv6 Task Force
Mis en place en avril 2001, ce groupe de travail a pour but de prparer le passage des rseaux de IPv4 IPv6 le plus rapidement possible et avant 2005 pour permettre la mise me en place des rseaux mobiles de 3 gnration. Compos de fournisseurs daccs Internet, doprateurs de tlcommunications (fixes et mobiles) et de constructeurs dquipements, ce groupe examine les actions entreprendre en vue de disposer de services bass sur IPv6 ds la fin 2003 et davoir totalement bascul les rseaux doprateurs fin 2005. Dans la continuit des travaux de cette task force, la Commission Europenne a mis le 21 fvrier 2002 une communication Priorits dactions dans la migration vers le nouveau protocole Internet IPv6. Parmi les actions engager et en complment aux travaux mens par la task force IPv6, la Commission Europenne prconise en particulier une contribution active la promotion des travaux de normalisation, et lintgration de IPv6 dans tous les plans stratgiques concernant lutilisation de nouveaux services Internet, ceci afin de renforcer la comptitivit de lUnion Europenne.
156
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
En conclusion de sa communication, la Commission Europenne renouvelle le mandat dlivr la task force IPv6 en lui confiant les missions suivantes :
Assurer la liaison effective entre les organismes de normalisation et de gouvernance de lInternet. Elaborer un panorama et un plan daction sur le dveloppement et les perspectives de lIPv6 en Europe afin de coordonner les efforts europens. Mettre en place les collaborations et les relations de travail avec les initiatives similaires dans les autres rgions du monde.
Autorit de rgulation des tlcommunications
157
3.16 Conclusion : les problmatiques de la normalisation des NGN
Les NGN sont bass sur le modle de louverture des interfaces et des systmes, permettant denrichir la fourniture de services et de simplifier la gestion des infrastructures. Pour mettre en application ce concept, un effort trs important de normalisation est ncessaire.
De nombreux organismes, pousss par les constructeurs effectuent dimportant travaux pour finaliser les concepts et les protocoles qui seront implments dans les NGN ; mme si certaines solutions apparaissent comme standardises, un certain dlai est ncessaire pour permettre la maturation des solutions.
Les organismes de standardisation incontournables sont : lIETF pour les rseaux IP et protocoles associs le W3C pour les protocoles et technologies Web le 3GPP pour larchitecture globale et les protocoles des rseaux mobiles de troisime gnration UMTS
Les organismes de normalisation historiques , tels que lETSI et lUIT sont (et doivent rester) trs impliqus dans la dfinition darchitecture globale des NGN interoprables avec les rseaux actuels. Ils ont aussi un rle de coordination jouer qui est essentiel au vu de la multiplicit (et donc du risque de dispersion) des initiatives lies la normalisation/standardisation des NGN. Il serait souhaitable quils assurent la diffusion aise et gratuite des normes et standards une fois consolids. Les forums compltent utilement laction de ces organismes en sattachant des domaines ou protocoles spcifiques.
Cependant, on voit se dessiner deux tendances correspondant aux deux mondes impliqus dans les NGN : le monde des tlcoms (historiquement de la tlphonie), et le monde des rseaux informatiques et de lInternet. Ainsi on saperoit qu tous les niveaux de larchitecture, on retrouve une dualit au niveau des protocoles ou des concepts : au niveau des protocoles de contrle dappel (H.323 vs SIP) ou de commande de Media Gateways (MGCP vs H.248/MEGACO), au niveau des interfaces de services (OSA-Parlay vs Web Services).
Les organismes de normalisation se scindent en deux tendances : celle des tlcoms (ETSI, UIT) et celle de lInternet et des rseaux IP (IETF, W3C). Cela implique une dualit sur certains concepts et protocoles qui ne facilitera pas court terme linteroprabilit des solutions. Celles-ci peuvent cependant savrer complmentaires.
158
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
La coopration entre les deux tendances est toutefois de plus en plus importante (ex. : protocole H.248/MEGACO dvelopp conjointement par lUIT et lIETF), et on peut anticiper une relativement bonne convergence moyen terme vers le choix de concepts et protocoles unique.
La proccupation principale des acteurs interviews (principalement les oprateurs) est de sassurer de linteroprabilit entre offres de plusieurs constructeurs, soit lintrieur dun mme rseau soit entre rseaux diffrents en particulier aux interconnexions. En plus de la dfinition technique de cette interoprabilit, il sera important den dfinir les moyens de contrle. En effet, les normes ntant pas toujours trs matures, les constructeurs implmentent parfois des solutions en partie propritaire pour pallier la jeunesse des standards. Un autre sujet trs sensible, directement li linteroprabilit, la qualit de service, est bien la problmatique technique phare chez les constructeurs actuellement. Que ce soit en tant que point technique spcifique ou travers les oprations lies la migration de rseaux existants et lexigence de non-dgradation de performances, il apparat essentiel que les discussions techniques dbouchent rapidement sur des propositions pouvant tre proposes en implmentation.
Les constructeurs interrogs plbiscitent le recours systmatique aux normes et standards quand ils existent. Les oprateurs sont trs peu impliqus dans les organismes de normalisation. Cependant pour la plupart dentre eux, ils attendent des constructeurs quils proposent des solutions normalises et interoprables. Cette standardisation des solutions doit faciliter la migration vers les NGN et offrir la garantie de la qualit de service de bout en bout, priorit des oprateurs.
Cependant il est vident que cet important effort de normalisation ne peut compenser la jeunesse des normes qui ne permettront dimplmenter des solutions interoprables dans un premier temps. Au del de la ncessit de linterfonctionnement des solutions techniques rseau , linteroprabilit des systmes de facturation et de gestion des base de donnes clients sannonce galement comme un gros chantier.
Concernant limplication des rgulateurs dans la normalisation : plusieurs constructeurs pensent quune coordination des rgulateurs avec les organismes de normalisation permettrait de mieux adapter les nouvelles solutions aux attentes de la rglementation. Certains oprateurs et fournisseurs de services attendent des rgulateurs une collaboration plus troite avec les organismes de normalisation pour sassurer de la neutralit des dcisions technologiques, et pour vrifier la conformit des oprateurs majeurs avec les normes en vigueur. Globalement, les acteurs ont un besoin danimation autour dun dbat national.
Autorit de rgulation des tlcommunications
159
4 Acteurs et conomie des NGN : tendances et impacts
4.1 Introduction : mthodologie, primtre et prambule
4.1.1 Mthodologie et primtre
Ce chapitre prsente une synthse de certains des thmes abords lors des entretiens raliss par Arcome avec un panel reprsentatif de constructeurs et doprateurs / fournisseurs de services issus du monde des tlcommunications, de laudiovisuel et dInternet, choisis pour leur forte implication dans les solutions de nouvelle gnration ou pour leur influence importante sur le monde des tlcommunications. Ces entretiens ont t complts par une recherche documentaire. Les neuf constructeurs interviews en face face, sur la base dun questionnaire dtaill labor par Arcome, sont : Alcatel, Cisco, Comverse, Ericsson, IBM, Juniper, Microsoft, NetCentrex, Nokia. Deux autres constructeurs ont, en outre, accept de rpondre au questionnaire par crit : Cirpack et Zhone technologies. Huit oprateurs et fournisseurs de services ont t interviews en face face selon la mme mthodologie : 9 Tlcom, e-TF1, Externall, Firstmark, Kaptech, Noos, SFR/Cegetel, Tiscali. France Telecom a par ailleurs fourni une rponse crite au questionnaire. Sont abords notamment dans le prsent chapitre :
La structuration et lvolution du march des constructeurs dans le cadre des NGN : types dacteurs (dont nouveaux acteurs), positionnement et stratgie, partenariats technologiques et stratgiques. Lvaluation des offres NGN, notamment en termes de prise en compte des normes et standards, de maturit et de cot. La structuration et lvolution du march des oprateurs et fournisseurs de services dans le cadre des NGN : types dacteurs (dont nouveaux acteurs), positionnement et stratgie, partenariats et nouvelles relations. Les problmatiques lies lintroduction des NGN : lments dclencheurs, dfis, risques, freins et moteurs technologiques et conomiques. Lvaluation de lconomie des NGN : avantages et opportunits attendus, nouveaux acteurs, nouveaux services innovants, volution des modles conomiques entre acteurs, apports par les NGN. La vision des acteurs sur la problmatique de migration des oprateurs et fournisseurs de services vers les NGN : anticipation ncessaire, modalits de migration selon le type dacteur, gestion de la cohabitation entre NGN et rseaux traditionnels, ventuelle convergence terme vers ce nouveau modle, ainsi quun panorama des pays et acteurs prcurseurs pour lexprimentation ou le dploiement de solutions NGN.
Un accent particulier est mis sur les points de convergence, ou au contraire de divergence de vues entre les constructeurs dune part, et les oprateurs et fournisseurs de services d'autre part. Les thmes lis la dfinition des NGN et la rglementation sont restitus dans des parties diffrentes : le premier dans le chapitre 2, le second dans le chapitre 6. Par
160
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
ailleurs, le thme sur la normalisation est dvelopp de faon plus dtaille dans le chapitre 4. La catgorisation des acteurs interviews, des donnes dencadrement les concernant, ainsi quune description plus dtaille de la mthodologie employe pour la prparation, la ralisation et lexploitation des entretiens sont fournies en annexe 2. Lensemble des tableaux de rsultats des entretiens raliss se trouve en annexe 3 pour les constructeurs et en annexe 4 pour les oprateurs.
4.1.2 Prambule : rendu des entretiens
Dans la suite du document, nous prsentons globalement les avis de la catgorie des constructeurs et de celle des oprateurs au sens large (incluant les oprateurs et les fournisseurs de services et contenus). Au vu des lments des entretiens, nous constatons un diffrentiel important entre les constructeurs et les oprateurs sur leur vision des NGN.
4.1.2.1 Vision et positionnement des constructeurs
La plupart des constructeurs interrogs nous paraissent clairement avancs et matures dans leur rflexion lies aux NGN :
Le terme NGN est connu et reconnu en tant que tel et nous avons t directement guids vers les bons interlocuteurs (pas de difficults majeures dans les prises de rendez-vous). Il existe des personnes, voire des ples identifis au sein des constructeurs travaillant sur les NGN. Il y a donc une relle structuration autour des NGN chez les constructeurs. La plupart des constructeurs ont prsent spontanment ds lintroduction des interviews leurs rflexions en cours sur les NGN. Par ailleurs, les constructeurs ont un vritable discours NGN et proposent des approches compltes aux oprateurs, allant jusqu dfinir les roadmap de services et les business modles de ces derniers.
La plupart des constructeurs a des produits NGN en cours dexprimentation avec des clients oprateurs, qui seront disponibles pour la vente industrielle courant 2002. Les constructeurs sont convaincus que le march mergent des NGN va tre pouss chez les oprateurs par le haut dbit, les nouveaux services offrir et les besoins du march. Pour y rpondre, les oprateurs, sils veulent se dvelopper et crer de la valeur, devront aller vers louverture des tiers, sous forme notamment de nombreux partenariats. Pour eux, lvolution ncessaire du positionnement des oprateurs est claire : ils vont devenir des Service Enablers l o la valeur se fera (sur les services et non plus laccs). Ces derniers ne seront plus des purs oprateurs de rseau. Pour cela, ils iront vers de la sous-traitance des fournisseurs de services et contenus. Les constructeurs ont le sentiment que les oprateurs nont pas encore toutes les comptences sur les NGN. Pour y remdier, ils ont donc dvelopp une palette de services support.
4.1.2.2 Vision et positionnement des oprateurs et fournisseurs de services
Concernant les oprateurs, la rflexion est beaucoup moins mre que celle des constructeurs. Notamment :
Autorit de rgulation des tlcommunications
161
Le terme NGN est plus ou moins connu aux yeux des oprateurs mais nest pas utilis en tant que tel. Il est apparu plusieurs reprises dans les entretiens que le terme nest pas parlant, voire ne veut rien dire en soi, et quil est difficile didentifier les concepts quil couvre. Les oprateurs parlent plutt de convergence voix/donnes. Contrairement aux constructeurs, il est assez difficile didentifier la personne qui soccupe des NGN, sauf lorsque loprateur a dj men une rflexion NGN, ce qui nest vrai que chez peu dacteurs. De plus, une fois identifie, il a t parfois difficile de rencontrer cette personne. Ceci semble sexpliquer par un souci de cohrence des oprateurs sur un discours NGN externe commun, du fait de rflexions en cours mais non forcment abouties sur le sujet, ou bien par une volont de ne pas communiquer sur un sujet jug encore trop amont et stratgique.
La migration vers les NGN est cependant en cours chez plusieurs oprateurs. Les exprimentations et dploiements se font, non pas par souci de la nouveaut mais plutt pousss par des raisons conomiques et lattrait de conditions commerciales probablement favorables (cots identiques voire infrieurs des solutions traditionnelles) proposes loccasion dextensions ou de renouvellements de matriels par les constructeurs, qui achtent ainsi leur premire rfrence NGN sur le march. Dans le contexte actuel de concentration du march et de rorganisation, lapproche sur les NGN est vraiment perue comme permettant soit de valoriser une infrastructure, soit de faire des conomies par souci de profitabilit rapide (ROI), mais moins comme une possibilit de diffrenciation des services, de dveloppement de nouveaux services ou de rponses des besoins clients. Cela explique donc que les rflexions en cours soient plutt tires par les services techniques que par les services marketing. Dailleurs, chez les oprateurs, le marketing est lheure actuelle quasiment absent des rflexions NGN. En fait, les NGN ne sont pas vus par les oprateurs comme une rvolution ou une rupture. Il sagit plutt dune volution dans la continuit qui va permettre de consolider les services existants et non dans limmdiat de booster de nouveaux services innovants. Seuls quelques acteurs notamment au niveau du contenu et des services voient des possibilits de dveloppements rapides de nouveaux services lis aux NGN. Mme si les oprateurs commencent prendre conscience que leur positionnement sur la chane de valeur va vers un rle de Service Enabler et non plus uniquement doprateur de rseaux afin de conserver leurs clients et gnrer du revenu, ils nen sont quau dbut de leurs rflexions et se posent encore beaucoup de questions sur louverture des acteurs tiers et sur les modles conomiques mettre en place. Afin de comprendre davantage lapproche de lensemble des acteurs vers les NGN, nous aborderons les thmatiques suivantes :
Les enjeux des NGN, Lconomie des NGN, Le positionnement des constructeurs vis vis des NGN Les offres NGN et leur maturit Le positionnement des oprateurs vis vis des NGN Leur stratgie de migration vers les NGN
4.2 Enjeux de lvolution du march vers les NGN
Cette partie aborde les thmes suivants :
Elments dclencheurs de NGN Dfis technologiques associs
162
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Avantages et risques Freins et moteurs technologiques Freins et moteurs conomiques
4.2.1 Elments dclencheurs du besoin des NGN
Globalement, lensemble des acteurs (constructeurs et oprateurs) ont une opinion convergente sur les lments dclencheurs du besoin des NGN. Ces lments dclencheurs sont avant tout conomiques et lis :
au dveloppement des usages autour des donnes On constate un accord massif des constructeurs sur limportance cl de lessor dInternet (augmentation des utilisateurs, diffusion grand public) et des services de donnes sur IP en gnral (croissance des dbits ncessaires, nombre dutilisateurs, applications, temps dutilisation). Ces services en viennent concurrencer les services voix, selon certains constructeurs. Cest le dclencheur principal pour les constructeurs. Les oprateurs, eux, considrent galement comme un dclencheur le dveloppement de lInternet, dIP, du haut dbit et du trafic donnes ct utilisateurs mais avec une importance moindre.
au besoin de crer de nouveaux services et applications Ces nouveaux services sont ncessaires selon les constructeurs pour rpondre aux nouveaux besoins des utilisateurs (multimdia, terminaux volus, nomadisme, multi-environnements, connexion permanente). Quant aux oprateurs, lobjectif est avant tout de crer de nouveaux marchs et donc de nouveaux revenus en offrant ces nouveaux services aux utilisateurs.
la ncessit de rduire les cots Cest un lment dclencheur majeur pour les oprateurs, fortement li au contexte conomique actuel, que ce soit pour lacquisition de solutions NGN ou pour leur exploitation, afin damliorer la rentabilit de la socit et la rapidit du retour sur investissement. Pour les constructeurs, cest un besoin doptimisation du rseau dans un but de rduction des cots (mutualisation des liens et des quipements, optimisations CAPEX/OPEX).
Ces lments dclencheurs sont aussi techniques avec un besoin de convergence voix/donnes :
Selon les constructeurs, elle impose de rorganiser larchitecture des rseaux doprateurs afin de transporter des flux htrognes, et dintroduire de nouveaux services. Il permet ainsi une souplesse des rseaux (infrastructure unique, dimensionnement en capacit, architecture dcentralise et distribue, ouverture, fourniture de packages de services intgrs). Pour les oprateurs, cest le deuxime dclencheur important avec la rduction des cots car elle permet de proposer lensemble des services sur un seul rseau, avec un seul protocole.
Parmi les autres dclencheurs cits par les constructeurs, on trouve notamment le dveloppement massif des rseaux mobiles et des concepts de mobilit au sens large (bien que sur ce critre les avis soient trs partags), le dveloppement de laccs large bande, la drglementation des tlcoms ou encore lvolution des technologies et des rseaux. Les capacits des processeurs ou encore les protocoles de transport sont galement cits avec une moindre importance.
Autorit de rgulation des tlcommunications
163
Pour les oprateurs, viennent de faon moins marque : le besoin de renouvellement et douverture des quipements, le besoin dune solution volutive et extensible qui permet un dimensionnement la demande, la mobilit et lUMTS. Des facteurs comme la demande du march et la reprise des investissements sont galement cits.
Les constructeurs et les oprateurs ont des avis convergents sur les principaux lments dclencheurs du besoin dvolution vers les NGN. Ces lments dclencheurs sont avant tout conomiques : le dveloppement des usages, le besoin de crer de nouveaux services et revenus, la ncessit de rduire les cots. Ils sont aussi techniques avec un besoin de convergence des rseaux voix/donnes.
4.2.2 Dfis technologiques
Lensemble des acteurs (constructeurs et oprateurs) sont galement daccord sur les grands dfis technologiques lis aux NGN. Deux thmes transverses sont jugs comme primordiaux :
La matrise de la qualit de service, qui est encore non mature, notamment pour atteindre des niveaux identiques ce qui se fait sur ATM. Cest un des principaux dfis, notamment pour les constructeurs. La normalisation ou standardisation des interfaces et protocoles, qui sont au cur des proccupations de la majorit des acteurs. Les corollaires de ce deuxime point sont les problmatiques dinterconnexion et dinteroprabilit des solutions et des services et, qui recueillent elles aussi de nombreuses voix. Ces grandes thmatiques que sont la normalisation, la standardisation et linteroprabilit constituent les principaux dfis pour les oprateurs et un dfi aussi important que la qualit de service pour les constructeurs.
Il est surprenant de constater la varit des lments identifis par les constructeurs comme des dfis technologiques pour les NGN. Lvolution de lexpertise, notamment des oprateurs voix vers le monde de la donne et des constructeurs optiques vers IP, est par exemple un dfi identifi par quelques acteurs. Concernant les diffrents niveaux du rseau, sont jugs comme dfis technologiques importants par plusieurs constructeurs :
Aux niveaux Accs et Terminaux : laccs trs haut dbit pour un trs grand nombre de clients finaux (les technologies notamment cites sont xDSL, VDSL, GPRS, UMTS, Ethernet, PON ou encore C-WDM). Ce dfi a galement t identifi comme important par les oprateurs, notamment lavnement du haut dbit dans la boucle locale et les rseaux mobiles de dernire gnration. Aux niveaux couches Transport et Contrle : la robustesse, fiabilit et disponibilit des protocoles et rseaux, lingnierie efficace du rseau de transport et linterconnexion des rseaux IP avec les rseaux TDM/SS7. Au niveau couche Services : la gestion des services de diffusion (besoin des mcanismes de multicast IP). Louverture des services (multi-sources, multivendeurs) avec lintgration dIP a galement t juge comme un dfi par les oprateurs.
Dautres dfis technologiques ont galement t identifis de faon minoritaire par les oprateurs comme IPv6, la maturation globale des solutions (facturation, robustesse) ou encore la convergence data/voix.
Lensemble des acteurs sentend sur les principaux dfis technologiques lis au NGN, qui sont transverses au NGN : la matrise de la qualit de service ; la standardisation et
164
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
normalisation des interfaces et protocoles. En corollaire de ce dernier dfi, linteroprabilit est galement au cur des proccupations des acteurs.
4.2.3 Les avantages et les risques lis aux NGN
Il a t demand aux constructeurs les risques et avantages lis aux NGN On constate que les risques cits rejoignent la fois les dfis et les freins technologiques ou conomiques dtaills dans la suite du rapport.
La qualit de service, un des deux dfis forts identifis prcdemment, est en fait clairement vue comme un risque par la majorit des acteurs. Il est probable que ce sera le risque majeur.
Un nombre important de risques sont galement voqus sur les quipements, en particulier sur leur dimensionnement, leur volutivit en capacit, leur fiabilit, leur prennit, leur disponibilit, linteroprabilit entre constructeurs, ou encore le manque de connaissance des offres de la part des futurs clients. Cela dmontre le manque encore important de maturit de ce march, tant sur le plan des produits industriels que sur la matrise quen ont les clients utilisateurs. Notamment, les quipements, de premire gnration NGN semblent tre encore difficilement en mesure de rivaliser avec les quipements traditionnels pour les gros rseaux fort trafic. Pour ce qui est des avantages, si les constructeurs arrivent bien analyser les dclencheurs (et dans une moindre mesure, comme on le verra, les opportunits) des NGN, ils sont remarquablement peu bavards sur les avantages de ces nouveaux rseaux. Cependant les avantages avancs confirment l encore les dclencheurs dj identifis. Est cite en premier la rduction des cots dinfrastructure, puis la recherche doptimisation de rseau (simplicit, volutivit, flexibilit) et la cration de valeur avec lintroduction de nouveaux services et marchs. Un large choix de fournisseurs de matriels et logiciels est galement peru comme un avantage par quelques acteurs. La problmatique financire et conomique est donc au cur du dbat. Les autres arguments avancs semblent des dclinaisons de ces deux facettes.
Autorit de rgulation des tlcommunications
165
4.2.4 Freins et moteurs technologiques 4.2.4.1 Les freins technologiques
Il est intressant de constater que les dfis technologiques cits ci-dessus se recoupent en partie avec les principaux freins technologiques dvolution vers les NGN. Cependant, les avis entre constructeurs et oprateurs sont davantage contrasts sur ces freins technologiques. Ainsi, la qualit de service est vue comme un des principaux freins pour lensemble des acteurs alors que la standardisation, la normalisation et linteroprabilit sont identifies comme des freins importants uniquement par les oprateurs. La maturation des solutions ressort galement de faon minoritaire chez les oprateurs. Les autres principaux freins technologiques qui ressortent de faon importante chez les constructeurs sont :
Le poids de lexistant en quipements et rseaux ATM et TDM. Cet lment ressort aussi chez les oprateurs mais de faon bien moindre. Au niveau accs et terminaux : les limitations actuelles des rseaux daccs et du dgroupage de la boucle locale (qualit de service, dbit). La complexit des terminaux est cite de faon minoritaire par les oprateurs. Au niveau transport : la transition tardive et difficile vers IPv6. Ce frein apparat galement de faon minoritaire chez les oprateurs.
Dans les freins qui sont voqus galement par plusieurs oprateurs, on trouve : la scurit, juge comme un frein technologique aussi important que linteroprabilit. Certains oprateurs nidentifient pas de freins technologiques (avec un nombre quivalent de rponses). En fait, il sagit des purs fournisseurs de services.
Les avis sur les freins technologiques aux NGN sont un peu plus contrasts entre les acteurs. Cependant, il ressort fortement que les principaux dfis technologiques sont aussi aujourdhui les principaux freins, savoir la qualit de service pour lensemble des acteurs et la normalisation, standardisation et interoprabilit pour les oprateurs. Le poids de lexistant et IPv6 sont galement jugs comme des freins par les acteurs. Enfin, les limitations des rseaux daccs et la scurit sont vues comme des freins selon chaque type dacteurs.
4.2.4.2 Les moteurs technologiques
Lensemble des acteurs a identifi des moteurs technologiques communs :
Lvolution des boucles locales vers le haut dbit qui est un des moteurs principaux pour les constructeurs. Plus globalement laccs haut dbit est identifi par les oprateurs comme un moteur important (en cohrence avec les freins technologiques lis laccs identifis plus haut). Les technologies daccs (Boucle locale, BLR, WLAN, WDM, UMTS, Ethernet longue distance, public hiperlan). En particulier, pour les constructeurs, la technologie ATM, qui, si elle est identifie comme un frein, est aussi court terme un moteur (pour sa qualit de service et sa maturit). Il en est de mme pour lUMTS et lADSL. Ces technologies permettent damorcer lvolution, mme si elles ne correspondent pas exactement la cible NGN. Enfin, lvolution tout IP et IPv6 en particulier est galement vue la fois comme un frein et un moteur par les constructeurs. Une volution vers un
166
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
protocole IP unique constitue galement un moteur dans une moindre mesure pour les oprateurs. Les oprateurs identifient galement les langages parmi les principaux moteurs technologiques, au mme titre que les technologies daccs. Enfin, ces acteurs voient dans une moindre mesure la qualit de service sur IP, une fois mature, comme moteur lvolution vers les NGN, ainsi que la standardisation (en cohrence avec les freins technologiques lis laccs, identifis plus haut).
Les principaux moteurs technologiques identifis de faon commune par les acteurs sont : laccs haut dbit au sens large, la plupart des technologies daccs (ATM, UMTS, ADSL,) ainsi que lvolution vers le tout IP . Les langages sont galement vus par les oprateurs comme un lment moteur dans les NGN.
4.2.4.3 Liste exhaustive des freins et moteurs technologiques
Au-del des points majeurs voqus ci-dessus, et au vu de la diversit des rponses, il nous a sembl intressant de restituer sur ce thme essentiel des freins et moteurs technologiques cits par les diffrents acteurs. Dans le tableau page suivante, les arguments cits sont classs par ordre dcroissant doccurrence globale (oprateurs et constructeurs), avec une indication entre parenthses du score obtenu sur 20 acteurs interrogs. Ces freins et moteurs technologiques sont galement prsents par type dacteur dans les annexes 3 (pour les constructeurs) et 4 (pour les oprateurs).
Autorit de rgulation des tlcommunications
167
Freins technologiques aux NGN Gnral
Moteurs technologiques aux NGN
Qualit de service sur IP (7) Standardisation et normalisation (4) Scurit (3) Existant ATM, et conservatisme, entretenu au moins court terme par lUMTS. LATM ne permet pas lextensibilit ncessaire un march de masse (2) - Existant en commutation TDM (2) - Interoprabilit (2) - Dualit des comptences Voix / donne (2) - Evolution de la topologie des rseaux vers une architecture distribue contrairement une vision hirarchique actuelle (impact comptences, process techniques) (1) - Manque de maturit des produits (1) - Faible capacit de serveurs dappel (1) - APIs peu normalises Aux niveaux accs et terminaux - Limitations actuelles des rseaux daccs et du dgroupage de la boucle locale (dbit, qualit de service) (5) - Terminaux de nouvelle gnration (cots, fonctionnalits, renouvellement du parc) (2) - Abondance des technologies (UMTS, WLAN,etc) : si leur usage est rglement (1) Au niveau transport - IPv6 : Peur, adoption lente, compatibilit avec IPv4 (4) - Manque de maturit dIP (dont qualit de service) (1)
Langages (XML, Java) (3) Standardisation (en particulier du hardware) (3) Technologies dentreprises (peuvent voluer plus rapidement que les rseaux doprateurs, et acclrer la migration de ces derniers) (3) Normalisation des protocoles et ouverture des interfaces (2) UMTS (si cest un succs) (1) Convergence (1) Open sources Linux (1) Rseaux Peer to Peer (1) Les constructeurs (1)
Technologie daccs (Boucle Locale, BLR, WLAN, WDM, UMTS, xDSL, Ethernet Longue Distance, Public Hiperlan) et surtout la gnralisation du haut dbit laccs (7) Maturit des technologies VoDSL (1) Abondance des technologies (UMTS, WLAN,etc) : si autorises et faiblement rglementes (1) Evolution tout IP , simplicit dutilisation apporte par IPv6 (4) Maturit et qualit de service ATM (2) Qualit de service sur IP (2) PABX IP (1) SIP : maturit et consensus sur le march autour de ce protocole (2) Centralisation des quipements (1) Besoins de services avec qualit de service (1)
Au niveau contrle - Manque de fonctions Class V dans les softswitch (1) Au niveau services - Facturation des services (nouveaux modles) (1) - Applications de + en + complexes (1)
168
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.2.5 Freins et moteurs conomiques 4.2.5.1 Les freins conomiques
Hormis laspect rmunration des services large bande trouver (modles conomiques et mode de facturation) qui est voqu comme un frein conomique pour les deux types dacteurs, les freins voqus par les uns et les autres sont assez diffrents. Pour les constructeurs, deux freins conomiques majeurs ressortent nettement :
Le manque de maturit industrielle des offres NGN et notamment des terminaux et les quipements PC, do un cot encore lev court terme (effet volume pas encore atteint). Les cots et la disponibilit de boucles locales alternatives haut dbit (dgroupage).
Les oprateurs, quant eux, ont avanc de trs nombreux freins conomiques :
Les plus significatifs portent sur lexistant : son poids et son amortissement, et dans une moindre mesure le poids des gros acteurs, les surventes dquipements effectus avec la bulle spculative boursire ou encore le cot du backhaul. Ce frein est identifi par les constructeurs mais de faon moindre. Cependant, les acteurs voient aussi de nombreux freins dans les usages des utilisateurs (parc dquipements, taux de pntration Internet et haut dbit, attentisme du march), et la rentabilit des investissements (financement des infrastructures, rentabilit UMTS, prix de passage de lATM IP) ou encore des lments socio-culturels, politiques et rglementaires.
Les avis divergent sur les principaux freins conomiques entre les types dacteurs sauf sur un point : trouver un modle conomique et un modle de facturation viable. Pour les constructeurs, les principaux freins sont lis au manque de maturit industrielle des offres NGN ainsi quaux limitations de dveloppement des boucles locales haut dbit. Pour les oprateurs, les principaux freins voqus sont plus nombreux et portent surtout sur le poids de lexistant et son amortissement, les usages des utilisateurs, la rentabilit des investissements ou encore des lments socio-culturels, politiques et rglementaires.
4.2.5.2 Les moteurs conomiques
Lensemble des acteurs est en phase sur les principaux moteurs conomiques lis aux NGN :
La demande du march Les constructeurs estiment que lvolution vers les NGN sera avant tout tire principalement par les besoins et usages des utilisateurs au niveau data et Internet, et en particulier ceux des entreprises (elles demanderont terme naturellement de nouveaux services, et les rseaux dentreprises volueront vraisemblablement plus rapidement que les rseaux doprateurs). Le rle cl des utilisateurs professionnels, plus demandeurs de nouveaux services et disposant de budgets importants pour faire voluer leurs rseaux dentreprises, a en effet t cit par plusieurs constructeurs comme moteur dans les NGN notamment vis--vis des oprateurs.
Autorit de rgulation des tlcommunications
169
Pour les oprateurs, cest la demande des utilisateurs, en particulier de services multimdia (video on demand, visioconfrence) qui est moteur ainsi que les usages (Internet, externalisation, tltravail).
Loffre de services Le dveloppement des nouveaux services data large bande accessibles tous les segments de clientle est voqu par les constructeurs. Les oprateurs voient quant eux les nouveaux services offerts de type VoIP, VPN IP, messagerie unifie, comme moteurs pour dynamiser le march des NGN.
et dans une moindre mesure les conomies fonctionnement de rseau sont galement moteurs.
dinvestissements
et
de
Par ailleurs, les lments lis la rmunration des services ainsi que les facteurs politiques et rglementaires, qui taient vus comme des freins par les oprateurs sont galement vus par ces derniers comme des moteurs sils aboutissent positivement.
Lensemble des acteurs est en accord sur les principaux moteurs conomiques qui correspondent aux besoins et usages du march au niveau des services donnes, Internet et multimdia (en particulier ceux des entreprises selon les constructeurs) et loffre de nouveaux services convergents et large bande.
4.2.5.3 Liste exhaustive des freins et moteurs conomiques
De manire similaire aux freins et moteurs technologiques, au-del des points majeurs voqus ci-dessus et au vu de la diversit des rponses, il nous a sembl intressant de restituer sur ce thme essentiel des freins et moteurs conomiques cits par les diffrents acteurs. Dans le tableau page suivante, les arguments cits sont classs par ordre dcroissant doccurrence globale (oprateurs + constructeurs), avec indication entre parenthse du score obtenu sur 20 acteurs interrogs. Ces freins et moteurs conomiques sont galement prsents par type dacteur dans les annexes 3 (pour les constructeurs) et 4 (pour les oprateurs).
170
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Freins conomiques aux NGN
Lexistant / Les acteurs existants
Moteurs conomiques aux NGN
Amortissement des rseaux dj existant (en particulier des quipements TDM) (3) Parc existant (2) Poids des gros acteurs (1) Survente dquipements NGN avec bulle spculative aux nouveaux acteurs (1) Cot du backhaul (1) Fermeture des rseaux des oprateurs (1) Dsaccord sur larchitecture de service (1) Faible parc dquipements grand public (1) Taux de pntration rsidentiel (1) dInternet en
Concentration des acteurs => moins de socits mais mieux finances (1) Constructeurs : moteurs des NGN en proposant offres NGN en remplacement des anciens quipements (1)
Les usages
Haut dbit doit devenir une commodit (1) Attentisme du public sur nouveaux services, pas de demandes spontanes du march dans lattente dune normalisation (1)
Besoins et usages des utilisateurs au niveau Data et Internet, et en particulier des entreprises (elles demanderont naturellement de nouveaux services, et les rseaux dentreprises volueront vraisemblablement plus rapidement que les rseaux doprateurs (5) Demande de certains services multimdia : video on demand, visioconfrence (3) Besoins accrus en nomades, Tltravail, collaboratif (2) Internet (1) Externalisation (1) Diffusion massive de lInternet sur PC chez les particuliers, do la possibilit doffrir un large public des services de tlcommunications (1) services travail
Les services et leurs rmunrations
Mode de facturation des services trouver (visio-video on demand) (3) Modle conomique trouver (1) Manque de crativit et de capacit crer de nouveaux services (1)
Dveloppement des services data large bande accessibles tous les segments de clientle, augmentation du trafic de donnes (4) Nouveaux services multimdia (VPN IP, VOIPVPN, Messagerie unifie, extranet) (4) Cration de valeur (1) Accs plus facile et naturel aux services (1) Effet volume (1) Business model si rmunrateur pour lditeur (1)
Autorit de rgulation des tlcommunications
171
Freins conomiques aux NGN
Elments conomiques
Moteurs conomiques aux NGN
Cot et disponibilit du rseau daccs, difficults du dgroupage et lente diffusion du haut dbit (DSL) (4) Pas encore de maturit industrielle des produits (effet de volume) do un cot encore lev court terme, notamment pour les terminaux et les quipements PC (4) Financement des infrastructures NGN (1) Rentabilit UMTS du fait des cots des licences (1) Prix du passage de lATM IP sur les quipements dautant plus brutal si impos par les constructeurs (1) Manque de moyens de financement des acteurs (1) Rgime des ayants-droits pour diffusion des contenus (rglementaires) (1) Impact des NGN sur lorganisation des oprateurs historiques (donne un avantage pour les nouveaux entrants) (1) Socio-culturels et politiques (1) Etat (1)
Economie des rseaux, baisse des cots de maintenance et dopration (3) Baisse des prix de passante IP en gros (1) Interoprabilit (1) la bande
Elments socio-culturels, politiques et rglementaires
Rgulateur si favorise dveloppement du march (1)
le
Existence daides gouvernementales (1) Acclration du dgroupage (1) Concurrence non rgule sur IP et Internet (1) Mesure damnagement du territoire pour favoriser Internet (1)
172
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.3 Economie des NGN : opportunits et nouveaux modles
Cette partie aborde les thmes suivants :
Les opportunits apportes par les NGN. Le potentiel de nouveaux acteurs. De nouveaux services innovants. La ncessit de nouveaux modles conomiques et relations entre acteurs.
4.3.1 Opportunits apportes par les NGN
Une question globale a t pose sur la pertinence des lments suivants dans le contexte NGN :
Nouveaux modles conomiques. Optimisation, conomies. Possibilit dexternalisation. Nouveaux acteurs. Souplesse, ractivit.
Les avis varient entre les deux types dacteurs. En effet, alors que les constructeurs jugent lensemble des critres comme pertinents la majorit, les avis sont beaucoup plus contrasts chez les oprateurs, notamment sur les modles conomiques et lapparition de nouveaux acteurs. Pour les constructeurs, bien que la tendance ne soit pas nette, on voit que les NGN sont considrs plutt comme source de nouveaux modles conomiques que de nouveaux acteurs. Cela rejoint lopinion exprime assez souvent par les constructeurs interviews, qui estiment que les acteurs actuellement dominants le resteront, et que le paysage ne sera donc pas fondamentalement chang mme si de nouveaux acteurs arrivent notamment sur la couche applicative. Lobjectif doptimisation et dconomies semble galement dominant sur celui de la souplesse et de la ractivit. Cela rejoint lopinion exprime par ailleurs par un nombre important de constructeurs sur lapproche de la migration vers les NGN : laspect conomique et financier est actuellement essentiel, un retour sur investissements le plus rapide possible tant requis. Enfin, la possibilit dexternalisation est galement juge comme trs pertinente, ce qui est confirm par lopinion de plusieurs constructeurs sur le dveloppement de loutsourcing de services et applications, telle que prsente ci-dessous. Pour les oprateurs, il est intressant de constater que ce sont les critres doptimisation, et les conomies ralises ainsi que la souplesse et ractivit qui sont au yeux de la majorit des acteurs considrs comme les plus pertinents. La possibilit dexternalisation est galement juge pertinente dans une moindre mesure. En revanche, les business modles et lapparition de nouveaux acteurs lis au NGN font lobjet davis beaucoup plus partags. Ces lments confortent donc les opportunits mises en avant de faon spontane. Cette vision diverge assez fortement de lavis des constructeurs pour qui ces deux items (surtout celui des modles conomiques) sont particulirement pertinents.
Autorit de rgulation des tlcommunications
173
Les nouveaux services et revenus associs ont galement t voqus par quelques oprateurs comme des critres pertinents.
Les avis des deux types dacteurs sont assez diffrents sur leur vision dvolution du march et les avis des oprateurs beaucoup plus contrasts notamment sur la cration de nouveaux modles conomiques , les possibilits dexternalisation et lapparition de nouveaux acteurs. Les constructeurs sont globalement beaucoup plus optimistes que les oprateurs. Le critre optimisation et conomies ralises est vu comme tout fait pertinent par lensemble des acteurs. Le critre souplesse et ractivit est galement jug comme pertinent par les constructeurs et comme trs pertinent par les oprateurs. Le critre possibilit dexternalisation est vu comme plutt trs pertinent par les constructeurs, un peu moins par les oprateurs. Le critre nouveaux modles conomiques est jug comme trs pertinent pour les constructeurs, mais les avis des oprateurs sont trs partags sur sa pertinence. Enfin, le critre nouveaux acteurs est jug comme assez pertinent chez les constructeurs alors que les avis sont beaucoup plus contrasts chez les oprateurs sur sa pertinence.
Lorsque lon pose la question des opportunits gnres par les NGN, les acteurs apportent spontanment de nombreuses rponses lies aux nouveaux services, nouveaux acteurs, nouveaux modles et nouvelles relations entre acteurs, mme si ces rponses sont assez diffrentes entre les types dacteurs. Les principales opportunits signales par les oprateurs rsident dans :
Le dveloppement du march et des revenus pour les oprateurs mais surtout pour les fournisseurs de services et contenus. le dveloppement de nouveaux services lis au haut dbit et multimdia, notamment les services de streaming et dans une moindre mesure les services lis la mobilit et la convergence voix/donnes. La baisse des cots grce une mutualisation, une optimisation des couches basses, une simplification dans la conception des rseaux.
Lopinion sur larrive de nouveaux acteurs est assez contraste puisque si certains voient lapparition de nouveaux acteurs positionns sur des niches, qui seront terme associs de plus gros acteurs, un nombre quivalents dacteurs nidentifient pas de nouveaux acteurs arriver sur le march pour linstant. Ceci confirme la vision prcdente des acteurs sur la pertinence de nouveaux acteurs. Il est important de noter que plusieurs acteurs ne voient galement aucune opportunit, ou encore aucun service innovant li au NGN. En particulier, les NGN vont plutt permettre une consolidation des services existants et une rationalisation des ressources quun dveloppement de services innovants, en tout cas court et moyen terme. Leffet time to market et leffet volume sont cits dans une moindre mesure comme tant dterminants dans le succs des services mis en place auprs du grand public, notamment parce que les budgets des clients restent limits. Un certain nombre
174
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
dlments galement voqus par les constructeurs, plus orients vers des problmatiques fonctionnelles, ont trait la thmatique de flexibilit et rapidit de dveloppement des offres de services, et leur simplicit de gestion comme le self provisionning (lutilisation de protocoles IP pour le contrle des services permet dutiliser des interfaces Web extranet pour acheter et configurer son installation tlphonique et les services associs). La cration des services se fera soit en propre par loprateur, soit grce des relations de partenariats avec des fournisseurs de services tiers avec reversements (loprateur tant alors oprateur de base de donnes clientle ). Parmi les opportunits mises, et mme sils en ont conscience, peu doprateurs envisagent une volution des relations entre acteurs et voient un intrt immdiat aller vers des partenariats. Cela confirme lide que les oprateurs ne sont pas encore rentrs dans une rflexion de fond sur leur positionnement sur la chane de valeur, sur les nouveaux modles conomiques possibles et sur des partenariats nouer avec des fournisseurs de services. Parmi les opportunits les plus cites en spontan par les constructeurs, ressortent les nouveaux services et mtiers associs. Viennent ensuite les nouvelles relations entre acteurs et les modles de facturation trouver pour les services de donnes. Les constructeurs ont mis beaucoup davis sur les typologies de services qui sont sources dopportunits (dveloppement dusage et/ou nouveaux mtiers ou acteurs). En fait, le sujet monopolise lessentiel des rponses, avec comme services les plus cits : les services multimdia, les contenus au sens large, loutsourcing de services et dapplications. Il faut noter galement une grande prudence des constructeurs qui, sils identifient un fort potentiel de nouveaux acteurs (surtout pour les purs fournisseurs de services sans infrastructure) et services, rajoutent aussitt que ce dveloppement est conditionn au fait de trouver un modle conomique permettant de les financer (mode de reversement trouver avec les oprateurs notamment).
Les avis exprims spontanment par les acteurs confortent et renforcent leur vision sur la pertinence des diffrents critres exprime ci-dessus : Les constructeurs sont assez avancs dans leurs rflexions sur les opportunits de nouveaux services et mtiers, les nouveaux acteurs et les nouvelles relations entre acteurs. Les oprateurs voient avant tout comme opportunits le dveloppement de leurs revenus, les nouveaux services dvelopper ou encore la baisse de leurs cots. Ils sont plus contrasts sur lapparition de nouveaux acteurs, et moins avancs dans leurs rflexions sur les nouveaux modles conomiques et relations entre acteurs.
Autorit de rgulation des tlcommunications
175
4.3.2 Le potentiel de nouveaux acteurs
Bien que les avis sur lapparition de nouveaux acteurs soient assez divergents entre les deux types dacteurs, tous sont assez daccord sur les types dacteurs qui pourraient apparatre ou se dvelopper :
Les fournisseurs de services et de contenus. Les oprateurs virtuels et les acteurs de loutsourcing : ASP, acteurs de esourcing, call centers, CRM, centres serveurs, centres dappel virtuels, VNO dont mobiles ou encore NMSP (gestion du rseau dun client).
Les constructeurs ont galement identifi :
Les ISP. Les oprateurs spcialiss dans la fonction transport ou contrle dappel (du fait de la sparation en couche des rseaux).
Un oprateur a galement identifi :
Les agrgateurs de contenus quil dnomme les kiosqueurs (rle intermdiaire entre oprateurs et diteurs).
Le potentiel de nouveaux acteurs se situe chez les fournisseurs de services et contenus, les acteurs de loutsourcing ou encore les oprateurs virtuels. Il existe cependant quelques variantes : Les agrgateurs de contenus ct oprateurs et les oprateurs spcialiss dans la fonction transport et contrle dappel ct constructeurs.
4.3.3 De nouveaux services innovants ?
Les acteurs ont des avis assez proches sur les types de services qui devraient se dvelopper avec les NGN :
Les services lis la communication haut dbit multimdia, temps rel, conversationnels et convergents voix/donnes/image : vidoconfrence, TV interactive, portails multimdia, messagerie unifie, messagerie instantane, VoIP, VoDSL, etc Les services lis au contenu en gnral et la gestion de contenus distribus en particulier (ex. : streaming audio et video). Loutsourcing de services clients (en particulier les entreprises) chez loprateur : services de VPN IP multi-services, services de messagerie unifie, Intranet, Centrex, centres dappel virtuels, serveurs vocaux hbergs, CRM, ASP, firewall externalis, etc Les services lis la golocalisation, les services contextuels et applications lis la mobilit.
Ont galement t voqus par les oprateurs :
Les services personnaliss. Les services lis la scurit. Les services de transport de donnes aux entreprises.
176
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Quant aux constructeurs ils ont galement identifi :
Les services de-sourcing (mise en ligne de parties dutilitaires, facturables lusage). Les services doprateurs virtuels (VNO), dont mobiles. De nouveaux services de transport pour les oprateurs : bande passante la demande au niveau du cur de rseau, rseaux virtuels optiques. Le dveloppement de services bass sur le protocole SIP (simple, standardis et favorise donc la cration de nouveaux services, notamment pour les tiers, grce aux API ouvertes).
Les services qui seront favoriss par les NGN sont les services large bande, convergents voix/donnes/image, lis la communication multimdia temps rel et transactionnelle ; les services lis au contenu (notamment gestion distribue) ; les services lis lexternalisation et les services contextuels lis la mobilit et golocalisation.
4.3.4 La ncessit de nouveaux modles conomiques et nouvelles relations entre acteurs
Cela pourrait paratre paradoxal mais ce sont les constructeurs qui sont les plus bavards sur les nouveaux modles conomiques et surtout les nouvelles relations que cela va permettre entre les diffrents acteurs. En effet, comme dj prcis, cela confirme que les constructeurs ont une rflexion plus aboutie que les oprateurs, en particulier sur ce sujet. Au niveau des modles conomiques, trois lments ressortent de faon importante chez les oprateurs :
La valeur va progressivement se dplacer de laccs vers les services. Les fournisseurs de services vont donc prendre une place de plus en plus importante et le rapport de force avec les oprateurs pourrait terme sinverser. Les oprateurs, bien positionns sur ce march puisquils disposent de bases clients et SI sont en train de prendre conscience que sils veulent continuer se dvelopper et ne pas passer ct du march, ils vont devoir aller vers plus de services innovants et un time to market de plus en plus rapide. Comme ils ne pourront pas tout faire seuls, leur seule chance est de trouver des ressources externes et en particulier de souvrir des fournisseurs de services et contenus, notamment sous forme de partenariats, pour permettre doffrir plus de services aux utilisateurs et le plus vite possible. Le rapprochement entre ces deux types dacteurs va donc se renforcer condition que le business modle soit satisfaisant pour les fournisseurs de services, sachant quaujourdhui les oprateurs sont encore rticents lide que les fournisseurs de services facturent directement les clients finaux ou encore que la rmunration des fournisseurs volue leur dtriment. Ils ne sont donc pas encore prts externaliser massivement le dveloppement de services.
Sils sont encore peu aboutis dans leur rflexion sur les relations avec les fournisseurs de services, ils le sont beaucoup plus sur les relations avec les constructeurs. En effet, les NGN vont permettre de nouvelles relations entre oprateurs et constructeurs. Les oprateurs pourront en effet aller de plus en plus vers des solutions multi-constructeurs et pourront plus facilement en changer sils ne sont pas satisfaits. Les NGN devraient galement favoriser larrive de tiers de confiance et doutils de facturation standardiss avec automatisation des process (intressant pour facturation de petites sommes).
Autorit de rgulation des tlcommunications
177
Ces lments sont confirms par les visions des constructeurs, qui vont encore plus loin dans leurs rflexions avec de nombreux lments de rponses de leur part :
Les oprateurs devront voluer pour sparer leurs prestations :
de services, de rseau (transport / contrle), de possesseurs de clients.
Dans le cas de services fournis par des tiers, les oprateurs deviennent des service enablers ou oprateurs de base clientle vis--vis des fournisseurs de services.
Les oprateurs devront souvrir de plus en plus des fournisseurs de services tiers (facteurs : demande de nouveaux services des utilisateurs, ncessit de rduire le temps de dveloppement de ces services Risques : complexit des architectures). Il sera pour cela ncessaire dtablir des rgles afin dempcher loprateur de transport dobtenir un monopole de fait sur les services, voire denvisager une intervention rglementaire afin dobliger les oprateurs souvrir des fournisseurs de services et de contenus tiers. On observe dj un intrt croissant des oprateurs envers les acteurs et services tiers. Les oprateurs externalisent dj de plus en plus de fonction comme le billing, les plate-formes de services, avec en contrepartie un recentrage sur la marque Les partenariats vont se renforcer dune manire globale entre tous les types dacteurs : oprateurs, diteurs logiciels, constructeurs de matriels, fournisseurs de services et contenus. Ils seront la fois partenaires et concurrents. Il faut viabiliser les fournisseurs de services et contenus en leur garantissant des sources de revenus (reversements oprateurs, type kiosque ou pourcentage de revenus) et une possibilit de retour sur investissements. La cl du succs sera pour les oprateurs la capacit conserver, voire conqurir des abonns plutt que de garder la mainmise sur lintgralit des revenus. Les modles conomiques entre oprateurs et fournisseurs de services seront diffrents suivant la prennit des services : loprateur aura tendance fournir lui-mme des services de base comme lEmail, et tissera un rseau de partenaires pour des services plus volatiles. Les nouveaux business models sont cependant encore crermais au final, ils seront plutt favorables aux oprateurs puisque ces derniers matrisent labonn final par laccs et sont donc en position de force sur la chane de valeur et dans leurs ngociations avec les fournisseurs de services. La facturation des services est un lment cl. La facture pour le client final ne peut pas augmenter dmesurment. Or, le nombre et le cot des services sont en forte croissance. Il est donc probable quon aboutisse une valorisation des informations en fonction de leur degr de valeur ajoute. Le modle conomique actuel (bas sur lInternet gratuit) nest pas viable pour les services large bande. La fourniture de services sera au cur des nouveaux modles conomiques. La facturation lusage va se dvelopper. Les relations doprateur oprateur vont galement se dvelopper :
les NGN vont permettre aux oprateurs de se louer du trafic et des services plus facilement car les rseaux ne seront plus ddis. Ils permettront dadapter du dbit la demande.
178
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Besoin daccords forts entre les oprateurs de tous types pour proposer des services globaux accessibles tous les utilisateurs (interconnexions, voire investissement dans des plates-formes de services communes). Cependant, peu de modifications des modles conomiques et de la nature des relations entre oprateurs. Les acteurs dj en place garderont une place prpondrante : les grands constructeurs seront les contractants principaux, et intgreront des technologies dveloppes par des socits plus petites et plus ractives. La fin des technologies propritaires voix rapprochera le march des infrastructures voix du modle conomique Data, avec un large choix de fournisseurs (quipements / services, vente / installation / maintenance).
Le march des constructeurs voluera peu.
Il ressort de cette analyse que les relations entre oprateurs et fournisseurs de services sont au cur de la problmatique NGN. Ces derniers sont dpendants du bon vouloir douverture dune part, et de partage de revenus dautre part, des oprateurs. Mme si lon sent dj des prmices douverture chez les oprateurs, il ne sagit pas encore dune tendance de fond et les modles conomiques associs sont encore quasiinexistants. En parallle, les relations entre oprateurs vont sintensifier, mais dans la continuit par rapport aux modles conomiques existants. Quant au march des constructeurs, il risque dvoluer de manire masque aux clients pour la fourniture de matriels, et acquerra une plus grande souplesse propre la culture Internet.
La valeur va se redistribuer progressivement de laccs vers les services, donnant ainsi un peu plus de poids aux fournisseurs de services et contenus : Les oprateurs, pour conserver leur clients et dvelopper leurs revenus vont devoir souvrir des partenariats avec ces fournisseurs de services et contenus. Les oprateurs devront viabiliser les fournisseurs de services et contenus en leur garantissant des sources de revenus.
Il sera pour cela ncessaire dtablir des rgles afin de faciliter cette ouverture. Mais aujourdhui cela ne peut se faire quen trouvant un modle conomique gagnant-gagnant entre les partenaires.
Autorit de rgulation des tlcommunications
179
4.4 Constructeurs : acteurs et positionnement
4.4.1 Introduction : Tendances de fond du march des constructeurs NGN
Les constructeurs sont plutt vus par les oprateurs comme moteurs sur le march, en arrivant auprs des oprateurs et fournisseurs de services avec des solutions NGN.
Bien que certains acteurs travaillent llaboration de produits et solutions NGN depuis plusieurs annes (environ cinq ans selon lun des acteurs interviews), ce march en est encore ses balbutiements et est en pleine structuration.
Il est cependant possible de dgager de grandes tendances, que nous dvelopperons dans la suite de ce chapitre :
On peut distinguer deux domaines majeurs en fonction de lorigine des fournisseurs : lun data-centric et lautre telephony-centric . Cette distinction se ressent aussi bien sur les offres de produits, que sur la vision technologique et stratgique de lvolution vers les NGN des fournisseurs. On la retrouve aussi dailleurs au niveau des oprateurs et fournisseurs de services. On observe une volution de la nature des offres, qui ne sont plus uniquement constitues de matriels, mais aussi de logiciels. Les platesformes matrielles changeant aussi de nature pour voluer dune architecture lectronique vers une architecture informatique . Le positionnement commercial des offres types NGN est en cours dlaboration (suite un travail de R&D dmarr il y a dj quelques annes), notamment pour les acteurs dj en place sur le march. Mais globalement les constructeurs font dj preuve dune prparation et dune maturit importantes sur le sujet NGN. Les constructeurs dmontrent (et cest logique vu la nature amont du sujet) une plus grande maturit par rapport aux NGN que leurs clients. Tous les constructeurs identifient un fort potentiel et lmergence de nombreux nouveaux acteurs, notamment concernant les couches contrle et services, avec des produits qui sont de nature plutt logicielle/informatique. Cependant, ce march est mergent, encore trs peu structur, et mettra plusieurs annes se stabiliser. Les offres NGN recouvrent donc des perspectives de mouvements conomiques importants dans les annes venir. Les diffrents acteurs, dj tablis ou nouvellement arrivs sur ce march, semblent encore chercher leur positionnement, et dimportants mouvements sont encore prvoir, notamment par le jeu des partenariats et fusions/acquisitions. Il nest pas sr qu moyen terme un grand nombre de nouveaux acteurs perdure sur ce march.
4.4.2 Typologie des acteurs et structuration du march
Dans le cadre des NGN, le march des constructeurs sarticule autour de plusieurs concepts :
Le positionnement des acteurs tlcoms et donnes dj tablis. Lmergence de nouveaux acteurs issus des NGN. Limportance croissante des partenariats entre acteurs.
180
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.4.2.1 Structuration du march NGN et concurrence
Les NGN apparaissent clairement comme une opportunit dmergence de nouveaux acteurs, dveloppant leurs activits en leur nom propre ou par le biais de partenariats.
De nouveaux petits fournisseurs de produits spcifiques comme les gateways ou les softswitchs (trs nombreux, beaucoup damricains, souvent positionns sur des niches, souvent issus du monde informatique). Leurs points forts sont linnovation, la comptence et la ractivit. Ils sont surtout prsents sur les couches contrle et applications. Leurs points faibles sont la prennit financire et commerciale, ce qui explique quils recourent fortement des partenariats dintgration (OEM) avec de grands constructeurs disposant dune offre globale et dune visibilit forte. Un trs fort potentiel est aussi identifi pour de nouveaux fournisseurs sur la couche Applications et plates-formes de Services (diteurs et intgrateurs), notamment du fait de lmergence du protocole SIP. Cependant les constructeurs constatent quune multiplication des acteurs a prcd la concentration actuelle.
Les grands constructeurs gnralistes tlcoms sont pour la plupart bien implants sur ce nouveau march, avec lnorme avantage davoir la capacit proposer des solutions de bout en bout cls en mains (en propre ou par le biais de partenariats), et de disposer de bases de clients importantes.
Ils ont malgr tout quelques faiblesses : des solutions plus souvent propritaires et bases sur ATM, une faiblesse de loffre sur certains produits (ex. : softswitch), des comptences data et IP restreintes ou rcemment acquises. Do le recours frquent des partenariats avec des acteurs du domaine des rseaux de donnes ou avec de nouveaux acteurs spcialiss. Par ailleurs, un nombre restreint dacteurs a une stratgie hsitante sur les NGN, qui pourraient constituer un risque de cannibalisation de leur march historique. Certains se sont mme rcemment retirs de ce march.
Les oprateurs et fournisseurs de services devront prendre en compte le fait que les acteurs issus du monde des donnes en gnral auront un rle cl sur le march des solutions NGN, tant sur le plan des matriels, que des logiciels et des prestations.
Ils sont plutt positionns :
sur les solutions de transport (IP et/ou ATM). sur les nouvelles solutions de tlphonie dentreprises. au niveau des solutions de services, de rseau et de terminaux. Dans ces domaines, les grands diteurs de logiciels et systmes dexploitation sont de plus en plus incontournables.
Cependant, les fournisseurs de solutions globales, quils soient dorigine Tlcom ou IP, sont peu nombreux. La ncessit de partenariats est grandissante.
Autorit de rgulation des tlcommunications
181
Les diffrents types de constructeurs sont trs partags sur leur vision de la concurrence : on constate un quilibre des rponses entre ceux qui ne se sentent pas concurrents de fournisseurs appartenant une autre famille (car le march vis ou les produits sont diffrents) et ceux qui avouent avoir prouv sur le terrain une nouvelle forme de concurrence avec des acteurs plus rcents et plus innovants.
Il semble donc que le march des NGN soit ouvert tous, avec une place privilgie pour chaque constructeur auprs de sa clientle historique, et un rle indniable de challengers des nouveaux acteurs. Les nouveaux oprateurs et fournisseurs de services seront donc trs courtiss, car ce sont eux qui feront le plus jouer la concurrence transverse, et qui auront le pouvoir de bouleverser lordre tabli.
Pour les oprateurs et fournisseurs de services :
aujourdhui tous les constructeurs (tablis ou nouveaux acteurs, origine tlcom ou donnes ) ont une vision assez proche des NGN. La seule diffrence remarquable se fait sur la couche transport (ATM ou IP mme si tous saccordent dire qu terme ce seront des offres tout IP). Mais les offres ne sont pas encore matures, elles restent partielles.
On constate par ailleurs que les acteurs interviews semblent faire plutt confiance dans leur volution vers les NGN des constructeurs dorigine IP ou des nouveaux entrants, plutt qu des constructeurs dorigine tlcoms, ce qui pourrait modifier significativement la rpartition du march.
Lintrt de ces oprateurs et fournisseurs de services pour les nouveaux constructeurs porte sur la possibilit dinvestir peu et de disposer dquipements scalables cest dire volutifs. Les constructeurs vus comme les plus matures par les oprateurs et fournisseurs de services sont :
Cisco, constructeur dorigine IP. Cirpack, nouvel entrant spcialis dans les passerelles softswitch. Ericsson et Nortel, constructeurs tlcoms. Au sein de cette famille, Ericsson semble actuellement leader du march NGN : le constructeur revendique 70% du march NGN en Europe avec une soixantaine de contrats, et 40% lchelle mondiale.
Plusieurs autres acteurs sont galement cits mais de faon moins marque.
4.4.2.2 Cohabitation entre constructeurs tlcoms et donnes et nouveaux acteurs
Il ressort de notre analyse du march des constructeurs ayant une offre NGN que deux mtiers de base y sont historiquement reprsents, en fonction de leur activit tlcoms ou donnes .
182
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
La distinction peut ensuite tre faite entre :
Les acteurs tablis (proposant plutt des volutions de leurs produits existants, et en gnral une solution plus ou moins de bout en bout). Les nouveaux acteurs (proposant de nouveaux produits, et en gnral spcialiss sur une niche) apparaissent, du moins en premire approche, comme inclassables : ils ont en gnral adopt pour dvelopper leurs produits une approche fonctionnelle tlcoms (nature des services offerts, comptence technique) et une solution produit donnes (logiciels, plate-forme informatique).
Type de constructeurs Les constructeurs orients solutions tlcoms
Exemples Constructeurs tablis, plutt gnralistes.
Ex. : Alcatel, Ericsson, Fujitsu, Lucent Technologies, Nokia, Siemens, Nortel
Constructeurs tablis mais spcialiss (plates-formes de services) :
Les constructeurs orients solutions donnes
Ex. : Comverse, CMG, Unisys
Constructeurs orients offres matrielles et rseau :
Ex. : Cisco, Juniper, 3COM, Cienna, 6Wind
Constructeurs orients solutions logicielles (niveau services) : Ex. : Microsoft, IBM, Sun
De nouveaux Nouveaux acteurs (plus spcialiss, et souvent orients vers des acteurs solutions nouvelles forte dominante logicielle pour fournir des inclassables services tlcoms) :
Ex. : Cirpack, NetCentrex, Sonus, Nuera, Clarent, Zhone Technologies, Riverstone, Extreme Networks, Cosmocom, Longboard
4.4.2.3 Points forts et positionnement des acteurs tlcoms et donnes
Dans le domaine tlcoms les constructeurs tablis se positionnent surtout sur les couches contrle et dans une moindre mesure services, tout en acqurant plus ou moins fortement les comptences pour fournir aussi des solutions transport (recours des acquisitions ou partenariats dans le domaine data ). Dans le domaine donnes , les constructeurs tablis fournissent principalement des solutions pour les couches transport et services, moins pour la couche contrle (ou alors dans un environnement spcifique, par exemple la tlphonie dentreprises). Ils apparaissent comme de plus en plus prsents sur des marchs rputs tlcoms , ce qui dmontre leur lgitimit nouvellement acquise.
Il apparat donc que les deux grandes familles ne sont pas directement concurrentes sur les matriels des couches transport et contrle (ce qui est conforme lopinion des acteurs interviews eux-mmes). Ils ont dailleurs souvent recours des partenariats stratgiques afin de fournir au client une solution globale, o chacun conserve et affiche sa spcificit.
Autorit de rgulation des tlcommunications
183
Par exemple, Cisco ou dans une moindre mesure Juniper semblent incontournables pour bon nombre de constructeurs tlcoms qui ont recours eux pour fournir leurs clients une infrastructure de transport ATM ou IP. La complmentarit et la relative non-concurrence entre ces deux grandes familles de constructeurs tablis sont confirmes par lanalyse quen font les oprateurs et fournisseurs de services, qui considrent que les constructeurs dorigine voix ont lavantage de matriser la qualit de service sur ATM pour les offres voix, alors que les constructeurs dorigine de la donne ont, eux, latout de matriser la technologie IP. En revanche, il nen est pas de mme concernant la couche services. Malgr les tentatives plus ou moins rcentes et plus ou moins russies des constructeurs tlcoms pour se positionner sur ce crneau, du fait de lvolution des services tlcoms vers des protocoles (et donc des architectures) hrits du monde des donnes, ils sont l logiquement en concurrence frontale avec les constructeurs et diteurs de solutions informatiques.
Chacune des deux familles aura son rle jouer sur ce march, et il est probable que leurs offres se complteront, mais moyen/long terme il est possible que les acteurs donnes prennent un rle de leader au niveau des produits NGN associs la couche Services.
Ils sont en effet trs actifs dans le domaine de la spcification et/ou de la normalisation des protocoles et langages de dveloppement de services de tlcommunications de demain, et sappuient en cela sur les solutions dj spcifies il y a plusieurs annes et prouves sur le terrain dans le domaine des dveloppements dapplications informatiques (ex. : CORBA). Les acteurs traditionnels ont t frquemment critiqus par les nouveaux acteurs dont nous parlons plus loin. Ils ont t jugs par leurs challengers comme :
mettant en avant un discours NGN sans proposer aucun vrai produit NGN . soucieux avant tout de prserver leur base installe de clients et de matriels. source de perplexit de la part des oprateurs, avec pour consquence une dcrdibilisation des constructeurs ayant une offre NGN.
Ces remarques sexpliquent naturellement par le fait que les constructeurs tablis sont plus positionns dans la continuit ( NGNisation en douceur des rseaux et services existants) alors que les nouveaux acteurs se placent plus dans une optique de rupture technologique ( rvolution NGN).
4.4.2.4 Des nouveaux acteurs au profil mixte visant un march spcialis
Dans le domaine des matriels donnes , le march cras par son leader Cisco laisse peu de place aux nouveaux entrants, hormis sur des marchs spcialiss, voire de niche (Juniper qui domine Cisco sur les routeurs de trs haute capacit, 6Wind spcialis sur les routeurs IPv6, Cienna sur les rseaux optiques) Il en est un peu de mme pour le domaine des solutions donnes logicielles. En revanche, la nature de ce positionnement laisse peut-tre une place plus grande aux jeunes pousses ou aux socits spcialises. Il est en effet moins vital de confier une application une socit encore peu connue que son rseau backbone, par lequel transite tout son trafic.
184
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
La plus forte mergence de nouveaux acteurs, mme de concurrencer les acteurs tlcoms tablis, est en fait constate sur les fournisseurs de solutions tlcoms spcialises, et trs axes logiciel (serveurs dappel, plates-formes de services mais aussi media gateways).
On pourra distinguer les socits proposant des solutions uniquement logicielles (ex. : Softswitch NetCentrex) ou combines matriel / logiciel (ex. : Cirpack). Le march amricain notamment est trs actif dans ce domaine. Selon les constructeurs interviews, ces nouveaux acteurs ont t classifis soit dans le domaine tlcoms (pertinent au vu de la finalit de services de leurs solutions), soit dans le domaine donnes (pertinent aussi au vu de la nature logicielle et informatiques des plates-formes retenues pour limplmentation). Ce sont en gnral des socits disposant de la double comptence, et leur coloration dominante dpend souvent du profil de leurs fondateurs. Cest pourquoi nous prfrons les dcrire comme inclassables . Comme le march NGN est en phase de balbutiement et que les efforts de normalisation rendent les dveloppements de produits plus accessibles, il nest pas tonnant de voir fleurir une multitude de nouvelles socits cherchant se positionner. Un des acteurs interviews a cit le chiffre dune cinquantaine de constructeurs dans le seul domaine des softswitchs. Cependant, malgr une profusion apparente :
La spcialisation de ces acteurs les rend trs sensibles des problmatiques dintgration de leurs solutions avec les autres acteurs de la chane NGN. Il semble que beaucoup de nouveaux acteurs soient positionns sur des solutions NGN spcifiques laccs, ce qui limite potentiellement le choix des oprateurs pour les solutions de cur de rseau. Cette impression est renforce par le recours frquent de ces petits nouveaux acteurs des partenariats de type OEM avec des constructeurs plus tablis. Dans ce contexte et au vu de la conjoncture prsente ou mme les gros peinent survivre, des regroupements (et des faillites) seront invitables. Par ailleurs, les marchs amricains (zone ANSI) et europens (zone ETSI) semblent encore actuellement tanches ces nouveaux acteurs. Selon lun de ces nouveaux acteurs interviews, les acteurs amricains sont trs peu prsents en Europe (et vice versa) pour des questions dinteroprabilit et de gestion de la signalisation. Comme ces acteurs sont galement les plus mdiatiques, leur faible crdibilit sur le march europen ajoute la confusion des oprateurs .
Ces lments ne seront pas sans poser des problmes de prennit de ces nouveaux constructeurs et donc de confiance des oprateurs. Certains des constructeurs interviews (grands constructeurs gnralistes bien sr) vont mme jusqu penser que ces nouveaux acteurs pourraient ne pas survivre en tant que tels.
Autorit de rgulation des tlcommunications
185
Il est certain que ces nouveaux acteurs devront faire preuve de fortes capacits financires ou mettre en uvre des partenariats solides pour rsister. Cependant, lmergence des NGN sera sans doute moyen / long terme loccasion dun certain renouvellement du march, bien que ce point semble mis en retrait par les constructeurs interrogs, du fait de la conjoncture actuelle dans les tlcoms.
Les oprateurs ont une vision de lvolution du march des constructeurs NGN cohrente avec cette analyse faite par les constructeurs eux-mmes :
Ils ont constat lapparition de quelques acteurs de niche qui se dmarquent par leur activit sur la partie contrle (softswitchs), et dont le rle peru est de crer des passerelles entre gros constructeurs et oprateurs. Alors que les gros constructeurs tablis migrent en douceur vers les NGN avec des solutions hybrides, ces nouveaux constructeurs spcialiss se positionnent directement sur les technologies NGN. Ces acteurs, dont le plus connu des oprateurs interrogs est Cirpack, ont cependant leurs yeux une dure de vie limite et seront probablement lappt de gros constructeurs (dorigine voix ou donnes) qui en profiteront pour acqurir les comptences NGN ncessaires leur volution. A terme, les oprateurs voient donc eux aussi le march se reconcentrer, laissant la place quelques acteurs majeurs, probablement dj existants et tablis.
4.4.2.5 Foisonnement des partenariats technologiques et stratgiques
Face lacclration de lvolution des technologies, il est ncessaire pour les constructeurs doprer un largissement trs rapide de leur savoir-faire, do le recours de plus en plus indispensable des acquisitions stratgiques et tout un rseau de partenariats.
4.4.2.5.1 Fusions/acquisitions et partenariats : sunir pour prparer lre NGN
Lvolution vers les NGN est une tendance prpare depuis plusieurs annes par les constructeurs les plus importants, avec tout un jeu de fusions/acquisitions, notamment pour pouvoir se positionner sur la totalit de la chane de produits. Ainsi les acquisitions par des constructeurs tlcoms de socits spcialises sur les couches transport ATM ou IP sont nombreuses. Les acquisitions sont cependant trs dpendantes de la stratgie et du positionnement des socits : certaines y recourent fortement, dautres avec beaucoup de modration et de manire trs cible dans un but dacqurir une comptence nouvelle.
En revanche, la conjoncture actuelle des tlcoms, qui veut que lensemble des acteurs soient de plus en plus innovants et ractifs pour le dveloppement de nouvelles solutions, rend les partenariats entre acteurs incontournables. Cela est dautant plus vrai dans le domaine des NGN, qui est mergent. Les partenariats y foisonnent et mme les acteurs majeurs y ont recours afin de complter leurs comptences.
186
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
On pourra noter les tendances suivantes concernant les partenariats :
Les partenariats pertinents dans le cadre des NGN sont en gnral primtre restreint, et non-exclusifs. Leur objectif nest pas de fusionner deux lignes produits, mais dutiliser bon escient certains produits ou concepts dun tiers pour la cration de produits spcifiques les plus adapts possible la demande du march, et dans les dlais les plus courts possibles. Le partenaire peut par ailleurs tre un concurrent dans un domaine connexe. Des partenariats, encore atypiques il y a quelques annes, apparaissent sous le signe du multimdia et de la convergence (voix/donnes/image, tlcoms/ audiovisuel/internet). Des acteurs tlcoms sallient des acteurs issus de domaines totalement autres. Ainsi, un constructeur tlcoms peut sallier un constructeur spcialis dans les produits photos ou vido ou dans la production de contenus musicaux pour dvelopper des produits et services multimdia communicants spcifiques. On peut malgr tout noter lexistence dun nombre trs restreint de constructeurs qui semblent miser sur lautonomie et la croissance interne, et avoir une stratgie de partenariats trs limite (ex. : Nokia).
4.4.2.5.2 Les diverses formes de partenariats mises en uvre
Les partenariats dvelopps par les constructeurs peuvent prendre des formes diverses :
Partenariats stratgiques. Ces partenariats ont en gnral vocation complter loffre dun constructeur par celle dun tiers positionn sur un segment de produits diffrents afin de pouvoir fournir au client une solution globale, sans pour autant dvelopper doffre commune ou masquer lexistence et le nom du partenaire. Les partenaires stratgiques sont donc en gnral des noms prestigieux et des leaders incontests dans leur domaine. Exemples :
Ericsson a renforc en 2000 son partenariat stratgique avec Juniper Networks, dont lobjectif est la fourniture et le support pour la construction dinfrastructures internet mobile 3G. Il consiste en une joint-venture (EJN Mobile IP) qui dveloppe notamment un quipement GGSN pour les rseaux GPRS et UMTS, et un accord exclusif de distribution des routeurs IP de cur de rseau de Juniper par Ericsson auprs des ISP et oprateurs mobiles. La mme anne, un autre partenariat de ce type a t conclu entre Compaq Computer Corporation et Ericsson afin de dvelopper et produire conjointement des Softswitchs pour la nouvelle gnration de la gamme de commutateurs fixes et mobiles AXE dEricsson, bass sur les serveurs haute disponibilit AlphaServer de Compaq et la technologie Tru64 UNIX. Un partenariat similaire lie Compaq avec NetCentrex pour la ligne de produits pour rseaux convergs voix-donne VoIP/RTC de ce dernier. Groupements dintrts et forums. Il sagit dune relation ouverte, o il ny a pas forcment de leader trs marqu. Un groupe dacteurs issus du mme march ou de marchs connexes et ayant identifi, dans un domaine ou une technologie mergente, une opportunit de nouveau march, sallient pour la spcification, le dveloppement et la promotion de solutions nouvelles. Le dveloppement de standards est de plus en plus incontournable et ncessite des partenaires amont, des alliances. Ce type de partenariat est troitement li lactivit de normalisation, qui est dveloppe dans le chapitre 4 du rapport.
Partenariats technologiques :
Autorit de rgulation des tlcommunications
187
Exemples : Le LIF (Location Inter-operability Forum) est un forum cr initialement par Motorola, Nokia et Ericsson (rejoints depuis par de nombreux autres constructeurs) afin de dfinir et promouvoir, via les organismes de standardisation et de spcification, une solution de services de localisation commune, interoprable, simple et scurise. Cette solution permettra aux fournisseurs de services et dapplications dobtenir des informations de localisation des oprateurs mobiles, indpendamment de leurs interfaces radio et de leurs systmes de golocalisation. Lalliance OMA (Open Mobile Architecture) a t cre en Novembre 2001 linitiative de Nokia, dans le but de dfinir et implmenter des interfaces de programmation (API) qui permettront aux dveloppeurs d'applications de disposer d'outils standards pour le dveloppement d'applications internet mobiles. Les socits lorigine de ce groupement sont : AT&T Wireless, Cingular Wireless, MM02, NTT DoCoMo, Telefonica Moviles, Vodafone, Fujitsu, Matsushita, Mitsubishi Electric, Motorola, NEC, Nokia, Samsung, Sharp, Siemens, Sony Ericsson, Toshiba, et Symbian. Les grands leaders des serveurs d'applications Java, Hewlett-Packard, IBM, Oracle, Sun Microsystems, ainsi que BEA et Borland ont rejoint le groupement en Dcembre 2001. Ils vont notamment travailler sur un jeu d'extensions mobiles pour la plate-forme serveur J2EE (Java 2, Enterprise Edition).
Consortiums : cest laboutissement le plus fort dun partenariat technologique, qui volue en gnral vers un partenariat conomique. Lassociation des constructeurs en jeu est identifie comme crant un domaine nouveau, qui est dvelopp et exploit commercialement par une entit conjointe sans que cela nuise lactivit dorigine des diffrents partenaires. Exemples : Alcatel et le constructeur japonais Fujitsu ont cr en 2000 une joint venture, dans laquelle Alcatel est majoritaire, pour dvelopper une me solution de rseau mobile de 3 gnration. Loffre dquipements radio UMTS issue de ce partenariat est commercialise sous le nom dEvolium. Symbian est une joint venture entre Ericsson, Matsushita, Motorola, Nokia et Psion cre en Juin 1998 afin de dvelopper et commercialiser le systme dexploitation EPOC32 pour terminaux mobiles smartphones , driv du produit de Psion.
Partenariats commerciaux :
Accords de commercialisation croise ou conjointe de solutions complmentaires, en gnral positionnes sur le mme segment. En gnral entre acteurs denvergure ou de renomme quivalente afin de bnficier de la visibilit des deux marques. Exemple : Dans le cadre de son programme de partenariats Spark Alliance , Comverse (constructeur de rseaux, services et applications multimdia : messagerie, communication personnelle, services et jeux mobiles) a dvelopp avec Clarent Corporation (constructeur de softswitches, gateways, gatekeepers et centres de commande NGN) une solution commune combinant les offres des deux fournisseurs, afin de fournir une solution globale permettant une transition douce dun rseau tlphonique traditionnel vers un rseau hybride ou IP natif (VoIP). Comverse a dvelopp des partenariats technologiques similaires avec les socits Sylantro et Sonus.
188
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Accords OEM (Original Equipment Manufacturer) dintgration de composants matriels ou logiciels dun constructeur au sein dun produit plus global dun autre constructeur, et commercialisation par ce dernier sous son nom. Ces accords sont de plus en plus frquents. Ils garantissent une viabilit et des dbouchs immdiats au partenaire positionn sur une niche ou pouvant difficilement commercialiser ses produits de manire indpendante. Le constructeur leader en retire aussi des avantages puisquil bnficie de la technologie et des comptences pointues de son partenaire, et est mme de fournir au client une solution globale plus performante. Un inconvnient de ce type daccord est quil peut terme mettre le partenaire dans une position de faiblesse sil ne dispose pas dautres partenariats ou de marchs directs. Un autre inconvnient est quil nest pas forcment public ou identifiable, et quil est mme parfois symtrique, ce qui limite la visibilit des clients sur la nature exacte des produits achets. Exemples : Telcordia (constructeur amricain de solutions rseau et logicielles) a sign dbut 2001 un accord de partenariat OEM avec Nokia, qui commercialisera donc les produits ISCP (plate-forme de dveloppement et de dploiement de services de rseau intelligent IN) et Network Engineer (logiciel dinventaire rseau) de Telcordia au sein de son portfolio de produits. Ce partenariat permet Nokia denrichir ses solutions pour la fourniture de plates-formes IN et de composants OSS supportant CAMEL Phase 3 et la fonctionnalit OSA. Un partenariat OEM a t conclu entre Ericsson, et Zhone Technologies Inc. dans le domaine des rseaux daccs large bande NGN pour les oprateurs tlcoms. La gamme de produit ENGINE dEricsson est ainsi enrichie avec la ligne de produits daccs large bande de Zhone.
Accords dutilisation et de commercialisation de solutions sous licence (notamment dans le domaine logiciel). Le constructeur autorise des tiers sappuyer sur son produit, non pas simplement pour lintgrer, mais pour dvelopper en son nom propre des produits qui en sont drivs, en change dun intressement aux recettes lies leur vente. Exemples : Nokia a annonc fin 2001 qu'il va licencier ses technologies de tlphone mobile et ses plates-formes logicielles d'autres fabricants de terminaux mobiles. Le constructeur prvoit notamment de vendre ses technologies clientes de messagerie MMS et SMS, son navigateur WAP/XHTML et son moteur de synchronisation SyncML. Il va galement mettre sur le march une plate-forme de rfrence base sur le systme d'exploitation Symbian. Baptise Series 60, cette plateforme est destine l'laboration de tlphones intelligents, capables de naviguer sur Internet et dots de fonctions de messagerie et de gestion de contacts avances. Toutes ces technologies seront fournies par Nokia sous forme de codes sources, ce qui permettra leurs acheteurs de les modifier. Ericsson a sign fin 2000 un accord de licence de sa technologie Bluetooth avec Intel. Cet accord permet Intel de complter son portfolio de solutions de communication sans fil en y intgrant les briques technologiques Bluetooth dEricsson.
Autorit de rgulation des tlcommunications
189
Partenariats de services : Les constructeurs ont de plus en plus recours des partenaires intgrateurs, qui sont forms sur leurs solutions et certifis mme de concevoir et dployer les produits du constructeur chez le client final. Cette pratique, trs rpandue dans le domaine informatique, se gnralise aux tlcoms. Exemple : NetCentrex a dvelopp des partenariats avec de nombreux intgrateurs rseau et systmes, notamment : Atos Origin, Cap gemini Ernst & Young, Coheris, CS Communications & Systmes, Sema, Teamlog.
4.4.3 Stratgie et positionnement des constructeurs
Les technologies NGN ne sont ignores par aucun des constructeurs interviews :
Sur le fond, ils prennent en compte cette volution dans leur stratgie, de manire plus ou moins marque et globale Sur la forme, seul un constructeur interrog na pas encore labor de stratgie de communication NGN, mais son offre dmontre une relle et forte prise en compte des concepts NGN dans llaboration de ses produits et de sa stratgie de partenariats.
4.4.3.1 Part des NGN dans la stratgie des constructeurs
On constate une position unanime et trs proactive des nouveaux acteurs ainsi que des acteurs du domaine logiciel (intgrateurs et diteurs) par rapport aux NGN :
Pour les nouveaux acteurs, il ressort que la stratgie et les technologies de ces socits sont compltement tournes vers les NGN, qui sont mme souvent lorigine de la cration de la socit. Pour les acteurs du domaine logiciels, il sagit dune volution de fond, lorigine dun positionnement nouveau. Le concept NGN est trs prsent et compltement intgr dans les offres. La plupart des produits est oriente NGN.
Le positionnement des gros constructeurs, quils soient dorigine tlcoms ou donnes, est plus nuanc.
Pour la grande majorit, lvolution des offres vers les NGN est dcrite comme constituant une volution majeure qui sous-tend les stratgies de dveloppement et est lorigine dune communication forte, dun positionnement nouveau, de nouvelles gammes de produits (avec une migration en douceur et une adaptation des quipements existants) voire de produits compltements nouveaux. Cependant, il est difficile de qualifier le degr de nouveaut des produits NGN des constructeurs sans entrer fortement dans le dtail de leur offre. A noter quun certain nombre de ces constructeurs sattache rendre lvolution vers les NGN transparente aux utilisateurs, au point de ne pas en faire un argument commercial, car :
Soit les NGN constituent une simple volution des rseaux traditionnels (auquel cas le constructeur sattache avant tout maintenir entre son ancienne et sa nouvelle gamme une continuit dans lergonomie, la plate-forme matrielle de base et les fonctions et interfaces de gestion ou dadministration). Cette position est avance par certains acteurs tlcoms. Soit le constructeur ne considre pas le mot NGN comme un argument commercial car il sagit dune problmatique encore trop amont, et prfre axer sa communication sur la fourniture de services IP multimdia, les quipements ayant dj depuis leur origine une architecture interne qui les rend NGN-ready . Cette position est avance par certains acteurs spcialiss sur des plates-formes de services.
190
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Soit le constructeur a un positionnement plus global et ne souhaite pas senfermer dans une image uniquement NGN. Cette position est avance par certains fournisseurs dquipements de rseaux de donnes.
4.4.3.2 Domaines couverts par les offres NGN des constructeurs interrogs
Afin dvaluer la compltude de loffre des constructeurs interrogs, nous avons distingu les domaines suivants : terminaux, rseaux daccs, transport, contrle dappel, services et applications, systmes dinformation.
Les nouveaux acteurs (3 sur 11)
Les nouveaux acteurs spcialiss se positionnent essentiellement sur des lments spcifiques des rseaux NGN : les softswitchs (2 sur 3), ou laccs, les Media Gateways et les Call Agents (1 sur 3). Ils ont en gnral une offre de plates-formes de services associe (2 sur 3) et plus rarement une offre de supervision (1 sur 3). Ils ont notamment tous recours des partenariats OEM avec de grands constructeurs pour commercialiser leurs offres (3 sur 3).
Les intgrateurs et diteurs de logiciels donnes (2 sur 11)
Ces acteurs ont essentiellement une offre de services NGN orients web (modle Web Services ). Lun des deux est, en complment, clairement positionn sur les offres lies aux terminaux (systmes dexploitation, applicatifs).
Les gros constructeurs donnes (2 sur 11)
Le positionnement des deux constructeurs de donnes interrogs est diffrent : alors que les deux fournissent une solution de transport, seulement lun dentre eux offre une solution complte de tlphonie sur IP destination des entreprises. Les deux disposent de partenariats stratgiques avec des constructeurs tlcoms dans le cadre desquels ils fournissent (en leur nom) des solutions de transport.
Les gros constructeurs tlcoms (3 sur 11)
Les trois acteurs interrogs ont une solution relativement globale, de bout en bout (une ou plusieurs offres pour chaque domaine). A noter :
le recours frquent des partenariats avec des constructeurs donnes pour fournir tout ou partie des offres de transport (si la socit na pas acquis la comptences auparavant par le jeu dune acquisition). la diversification des activits du constructeur typ mobile interrog (quipements ADSL, accs WLAN). mme si les trois ont une offre de plates-formes de services multimdia, on peut constater des degrs de maturit diffrents de ces offres.
Les constructeurs tlcoms spcialiss (1 sur 11)
Le seul acteur interview a essentiellement une offre de plates-formes de services vocales, convergentes, et multimdia. Il complte cette offre via des partenariats technologiques avec des constructeurs dinfrastructures NGN.
Autorit de rgulation des tlcommunications
191
4.4.4 Analyse globale des clients de solutions NGN
Il est vital pour les constructeurs laborant une offre NGN de bien analyser et connatre leur clientle afin de pouvoir rpondre ses attentes. Or, selon la majorit des constructeurs interviews, les clients potentiels des offres NGN nont pas encore acquis une maturit importante par rapport ces produits et les constructeurs se prparent donc les accompagner. Il ressort des entretiens avec les constructeurs les points suivants :
Un besoin daccompagnement amont des clients plus fort que pour les solutions traditionnelles (prestations de formation, de conseil technique et stratgique, de modlisation de business model et de retour sur investissement) ; point que la plupart des constructeurs interrogs a identifi, et sur lequel ils travaillent en adaptant leur offre de services et le primtre de leurs prestations avant-vente, tant du point de vue technique quconomique. Une trs faible minorit de constructeurs na cependant pas encore mis en place de stratgie de communication et daccompagnement de ses clients spcifiquement oriente NGN. Considrant que leur clientle nest pas encore mre pour entendre ce discours, ils communiquent uniquement en fonction du besoin en insistant sur le fait que leurs solutions sont NGN-ready . Cette position, acceptable court terme pour un constructeur spcialis ne semble cependant pas tenable moyen terme, et pour un constructeur gnraliste. De manire encore plus marque que le march des constructeurs, le march des clients NGN nest pas encore mature. Ces clients sont dailleurs pour linstant essentiellement les oprateurs tlcoms et dans une moindre mesure les fournisseurs de services Internet. En revanche, les oprateurs mobiles et les purs fournisseurs de services ne reprsentent encore ce jour quun potentiel de nouveaux clients. Selon plusieurs socits interroges, les grands comptes utilisateurs (entreprises essentiellement) auront certainement leur rle jouer pour acclrer la maturit et les offres NGN des oprateurs.
On ressent donc un grand diffrentiel entre : La maturit des constructeurs par rapport aux NGN, et celle de leurs clients, do un besoin plus grand de prestations daccompagnement amont. La nature du potentiel de nouvelle clientle NGN tel quidentifi par les constructeurs, et la clientle NGN effectivement prospecte et/ou acquise, ce qui montre que le march des purs fournisseurs de services nen est encore qu ses balbutiements.
192
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.4.4.1 Evolution des offres de services aux clients
Il ressort des entretiens avec les constructeurs que, dans le cadre des NGN, les clients sont nettement plus demandeurs de services d'accompagnement stratgique, technique et financier (besoin identifi par la plupart mme si tous les constructeurs nont pas rpondu explicitement ce point).
Certains constructeurs ont dj mis en uvre les volutions de leurs prestations (ventuellement en ayant recours des partenariats spcifiques) pour rpondre cette demande :
En premier plan, un renforcement des discussions amont sur les moyens daugmenter les revenus, ltude de marchs et de business models se concrtise par un accompagnement plus fort avec des prestations de conseil, marketing et expertise financire (montage de business plans, ROI). Dans un contexte conomique contraignant, les clients potentiels demandent des preuves dun retour sur investissement rapide et sr. A un degr moindre, les constructeurs proposent des prestations techniques complmentaires : prototypage de services, dveloppement de fonctionnalits spcifiques, ingnierie de rseau, tests et implmentation, dveloppement de spcifications et de logiciel, prestations dintgration / outsourcing de systmes. Ces mesures peuvent saccompagner dun renforcement du service aprs-vente.
4.4.4.2 Arguments de vente
Les principaux arguments de vente mis en avant par les constructeurs interrogs pour leurs offres de produits NGN sont :
En premier lieu, le dveloppement des usages et des nouveaux services innovants, la fourniture de services indpendamment du rseau et du terminal utiliss, rponse aux exigences de time to market des oprateurs. Les perspectives dconomies financires (limitation des CAPEX et OPEX, retour sur investissement plus rapide, quipements moins coteux). Viennent ensuite des arguments techniques (capacit grer du trs haut dbit, flexibilit, volutivit et qualit de service, optimisations), et les comptences et les rfrences du constructeur.
Les constructeurs sadaptent donc pour mettre en avant auprs de leurs clients des arguments plus marketing (services et usages) et financiers que techniques.
4.4.4.3 Types de clients de solutions NGN
En toute logique, les clients potentiels viss par les solutions NGN des constructeurs devraient tre ceux quils identifient soit comme acteurs devant anticiper la migration (en priorit les oprateurs de backbones surtout IP et internationaux, et les nouveaux oprateurs), et/ou comme acteurs les plus moteurs pour les NGN (en priorit les ISP, et les oprateurs de backbones IP internationaux oprateurs, et les oprateurs mobiles qui sont aussi identifis comme une cible essentielle, notamment dans le cadre des dploiements de rseaux UMTS). Or, dans les faits, tous les segments de constructeurs visent en priorit les oprateurs au sens large, avec une domination du domaine Tlcoms sur le domaine
Autorit de rgulation des tlcommunications
193
Internet (notamment nouveaux acteurs, avec une mention particulire pour certains oprateurs historiques, les oprateurs mobiles, et les nouveaux oprateurs ADSL et ISP).
En revanche, les nouveaux acteurs de la couche Services (purs fournisseurs de services, ASP, MVNO), identifis par beaucoup comme tant un vivier important de nouveaux clients NGN potentiels, nont pas encore merg : ils ne sont encore ce stade que des clients marginaux, voire des prospects. Limportance de ces nouveaux types de clients nest donc pas quantifiable ce jour. Par ailleurs, bien quelles ne soient pas vises par tous les constructeurs, les entreprises ressortent cependant comme des clients bien rels pour des solutions NGN convergentes de voix sur IP. Ce point confirme lopinion donne par plusieurs constructeurs que les entreprises auront un rle moteur pour faire voluer les offres des oprateurs vers les NGN.
4.4.4.4 Positionnement des clients face aux constructeurs multiples
La majorit des oprateurs et fournisseurs de services saccorde dire que leur solution globale cible sera multi-constructeurs. Quelques acteurs voquent cependant lide dun constructeur unique par domaine dactivit NGN ou sur un type particulier dquipement NGN.
Les raisons voques pour la solution multi-constructeurs sont surtout lies au fait qu court terme aucun na rellement de solution globale, que chaque acteur est bon dans son domaine propre, ou encore la facilit de cohabitation grce aux fortes capacits dinteroprabilit et aux standards. Les raisons voques pour la solution mono-constructeur rsident dans la rduction des cots indirects (frais de supervision, maintenance, formation levs do cots dautant plus levs pour plusieurs constructeurs) ou dans la recherche dune interoprabilit (au moins court terme).
Seul un acteur a voqu la possibilit davoir un constructeur unique comme prime contractor , en fait un leader qui aura en charge de rechercher les quipements complmentaires (intgration de produits dautres constructeurs), assurer linteroprabilit de bout en bout, et grer les projets. Techniquement, tous saccordent pour dire quaujourdhui ils utilisent ATM, qui est plus mr et dispose dune qualit de service satisfaisante, mais que demain IP sera le protocole de rfrence. Plusieurs acteurs signalent galement le fait davoir terme une mixit des protocoles IP/ATM si ncessaire.
194
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Lobjectif de larchitecture de rseau NGN, qui est la facilitation des solutions multi-constructeurs par le biais dinterfaces standardises, ne semble pas ais atteindre court terme pour les oprateurs. Dans un premier temps, les rseaux NGN seront donc vraisemblablement mono-constructeur (du moins par type dquipement) pour des raisons de cots et dinteroprabilit. Cela reprsente un avantage court terme pour les oprateurs, mais pourra se rvler moyen terme tre un inconvnient du fait de la dpendance dun fournisseur unique. Il existe par ailleurs une certaine demande de fourniture de solution globale, par le biais de partenariats et de prestations dintgration (constructeur contractant principal).
Autorit de rgulation des tlcommunications
195
4.5 Offres NGN : maturit et cots
Deux lments cl influeront sur les dcisions et processus dintroduction des solutions NGN dans les rseaux et services de communications :
La maturit des produits NGN : elle savre ce jour ingale en fonction des quipements rseau envisags (ex. : Media Gateways / serveurs dappel), des couches concernes (ex. : Transport / Contrle / Services), et des environnements dutilisation (ex. : fixe ou mobile). Le cot de ces offres, tant en termes dinvestissement que de fonctionnement : des conomies sur ces deux postes sont attendues des NGN, mais elles sont nuancer dans le temps et en fonction de lenvironnement initial de loprateur.
4.5.1 Une maturit des produits encore contraste
Dans lensemble, aux yeux des constructeurs, les technologies NGN semblent matures, ou en passe de ltre rapidement (sous 3 ans). Les domaines o les produits leur semblent actuellement dj matures sont :
Les rseaux daccs traditionnels (hors trs haut dbit). Le transport optique haut dbit (hors G-MPLS). Les Media Gateways. Les rseaux intelligents. Les solutions de supervision et dadministration de rseau.
Les domaines o les produits leur semblent les moins matures (plutt sous 1 3 ans) sont : Les terminaux (notamment fixes, surtout en termes de cot, et de fonctionnalits par rapport aux terminaux mobiles). La facturation des services (une problmatique cependant plus commerciale que technique, afin de trouver le modle adquat des nouveaux services data multimdia). Le dveloppement des services multimdia (en fait, plus un problme de crativit pour trouver les killer services quun problme technique). Et surtout les logiciels applicatifs (disponibilit dans une fourchette de 1 5 ans). Les contenus et briques de base sont jugs matures, mais pas les technologies et les mcanismes de consolidation de ces contenus. Ce point est aussi mettre en relation avec le manque de maturit des terminaux et de SIP.
196
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Dans une moindre mesure, doivent encore progresser :
Les rseaux daccs (volutions haut dbit). LIP (notamment la qualit de service et IPv6). Les serveurs de contrle dappel (surtout pour la gestion du raccordement des abonns laccs fonctions ClassV, et pour lvolution vers de hautes capacits). La supervision et ladministration, mme si elle est juge plus facile terme grce la convergence vers des mcanismes hrits dIP.
A noter que les technologies IN et ATM ont t cites par certains constructeurs comme non pertinentes dans le cadre des NGN.
Il ressort clairement que les produits les moins matures sont ceux qui touchent plus ou moins directement (cas des terminaux) aux Services.
4.5.2 Une optimisation des cots variable selon le contexte
Un des points importants pour les processus de dcision et de mise en uvre de la migration vers les NGN sera limpact financier de ces nouveaux quipements sur les cots dinvestissement et de fonctionnement des oprateurs et fournisseurs de services.
Au premier abord, les solutions NGN sont en gnral prsentes comme moins onreuses quiper et exploiter que les solutions traditionnelles. Dans le dtail, lvaluation que font les constructeurs et les oprateurs de ces avantages financiers est plus contraste (voire parfois divergente) en fonction notamment de lenvironnement technique (rseau) et conomique (relations oprateurs / constructeurs) de dpart considr, de lchelle de temps prise en compte et de la couche rseau voque.
4.5.2.1 Cots dinvestissements (CAPEX)
Vision des constructeurs
Hormis pour la couche services o les cots actuels sont identifis comme suprieurs (plate-formes plus chres en environnement htrogne, cot de dveloppement des services NGN plus cher initialement), les constructeurs ont des avis trs divergents sur les cots dinvestissements actuels des rseaux NGN. En effet, les avis se partagent entre ceux qui pensent que les cots dacquisition sont plus importants, ceux qui pensent quils sont comparables, voire lgrement infrieurs et ceux qui pensent quils sont infrieurs ceux des solutions traditionnelles.
Autorit de rgulation des tlcommunications
197
Il semble cependant que cela dpende fortement de deux lments :
Du contexte actuel et notamment de lexistant grer : le cot des NGN est bien sr infrieur sil sagit dun nouveau rseau (sans existant) que dune migration (cots de migration ajouter). De lapplication envisage : les solutions de tlphonie IP sont encore plus chres que les solutions traditionnelles (poids du cot des terminaux et de laccs), mais cela semble tre linverse pour les applications de transit.
Des conomies indirectes dinvestissement semblent nanmoins ralisables ds maintenant (dimensionnement plus efficace grce la mutualisation du rseau, cot des extensions infrieur, lments priphriques comme les systmes de facturation moins coteux). En revanche, terme, une baisse massive des cots dachat des solutions NGN est prvue par tous, notamment lie aux conomies dchelle (production de masse des quipements NGN) et loptimisation des rseaux (convergence) et aux gains de capacit des quipements. Elle est cependant difficilement quantifie (certains avancent des baisses de lordre de 30% sur laccs et 50% sur le cur de rseau) et date (le dlai de 3 5 ans est voqu timidement). Quant la couche services, l aussi plusieurs constructeurs saccordent pour dire quelle sera terme moins chre quaujourdhui grce la pluralit des acteurs et la rduction des cots de dveloppement des services NGN terme (des baisses de lordre de 20 80% sont voques !).
Vision des oprateurs et fournisseurs de services
Comme pour les constructeurs, les avis des oprateurs sont plutt partags sur les cots des solutions NGN et galement assez proches de ceux des constructeurs. Effectivement, les cots dinvestissement NGN actuels dpendent fortement de larchitecture existante ou mettre en place :
Les acteurs alternatifs qui navaient pas dexistant considrent le ticket dentre (investissement initial minimal) de 10 30% moins cher quune solution traditionnelle. Pour ceux qui ont un existant, la solution NGN est juge comme quivalente en termes de cots la solution traditionnelle, surtout du fait des offres commerciales actuelles des constructeurs qui souhaitent acqurir leurs premires rfrences sur le march en cassant les prix de vente, voire comme plus chre en renouvellement dquipements.
Les cots dacquisition dquipements rseau devraient baisser terme, grce la mise en place dun monde open source selon un des acteurs. La mutualisation des services et le dveloppement sur des plates-formes communes devraient permettre galement une baisse des cots des services. Lintrt des solutions NGN est le dimensionnement des capacits des quipements (scalabilit) en fonction de la demande et la possibilit dvolution rapide des capacits en cas de forte croissance. Cest un lment important dans la prise en compte des cots et savre pertinent pour de nouveaux acteurs forte croissance.
198
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Concernant les cots dinvestissements NGN, les avis des constructeurs et des oprateurs sont globalement cohrents : A court terme, des montants fortement dpendants de lexistant de loprateur et de ses relations commerciales avec le(s) constructeur(s), mais globalement quivalents ou lgrement suprieurs sil sagit dune migration, et dj significativement infrieurs sils sagit dun dploiement initial. A moyen/long terme, une baisse forte des cots dachat des solutions NGN est prvue par tous, notamment lie aux conomies dchelle, la convergence des rseaux, aux gains de capacit des quipements et la mutualisation du dveloppement des services NGN. Ces gains pourraient tre de lordre de 50% par rapport aux solutions traditionnelles.
4.5.2.2 Cots de fonctionnement (OPEX)
Vision des constructeurs
Concernant les cots rcurrents et les prestations associes (dploiement, exploitation, administration, maintenance), les constructeurs sont quasiment unanimes pour dire que les solutions NGN semblent apporter des gains immdiats significatifs, valus selon les postes de cots entre 20 et 70% des dpenses. A terme, ils estiment que les cots de fonctionnement vont encore baisser, ainsi que les cots des prestations. En effet, les intgrateurs de systmes vont dvelopper leurs comptences sur les quipements dinfrastructure voix des oprateurs.
Vision des oprateurs et fournisseurs de services
Les avis des oprateurs et fournisseurs de services sur les cots rcurrents divergent et ceci contrairement aux constructeurs qui taient plutt unanimes en faveur dune baisse :
Les cots de fonctionnement sont vus pour plusieurs dentre eux comme plus levs, notamment cause de la jeunesse de la technologie et une qualit de service assurer, renforant notamment les cots indirects de personnels pour les dveloppements. Les cots dexploitation et de maintenance sont vus pour un nombre quivalent dacteurs comme moins levs. Enfin, dans une moindre mesure, les cots de maintenance sont vus comme quivalents.
Conformment lavis des constructeurs, plusieurs oprateurs et fournisseurs de services pensent que ces cots rcurrents devraient terme baisser.
Autorit de rgulation des tlcommunications
199
Concernant les cots rcurrents lis aux solutions NGN, les avis des constructeurs et des oprateurs sont en revanche moins convergents : Les constructeurs sont quasiment unanimes pour dire que les solutions NGN apporteront des gains immdiats significatifs. Les avis des oprateurs et fournisseurs de services sont moins enthousiastes et plus contrasts, certains mettant notamment en avant court terme des surcots indirects lis au manque de maturit de la technologie.
4.5.2.3 Cots indirects
La mise en place des quipements et services NGN impliquera des cots connexes qui pourront savrer non ngligeables.
Parmi les cots induits par les NGN, les lments suivants ont t cits par les constructeurs et/ou oprateurs et fournisseurs de services :
La modification des comptences des quipes avec la cl des cots lis la rorganisation interne des quipes, ainsi qu la formation ou au renouvellement des personnes. Le cot des services associs et comptences (y compris capital leasing ) vendus par les constructeurs en complment de leurs solutions.
200
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.6 Oprateurs et fournisseurs de services : acteurs et positionnement
Cette partie prsente les thmes suivants :
Tendances de fond sur les NGN. Typologie des acteurs et structuration du march. Stratgie, positionnement et offres de services NGN.
Lensemble des lments relatifs la stratgie de migration sont abords dans le chapitre 5.7 sur la migration vers les NGN.
4.6.1 Tendances de fond sur les NGN
Contrairement au march des constructeurs, plutt matures et en avance de phase sur le sujet des NGN, lapproche des oprateurs sur ce sujet est encore mergente aussi bien sur la partie conomique (modles) que sur la partie technique (migration).
Cependant, nous avons dgag un certain nombre de tendances fortes de lvolution des acteurs vers les NGN, dont les principaux lments sont les suivants :
Le contexte conomique actuel avec une problmatique de financement renforce joue un rle important dans les positions des acteurs. Il fait ressortir un besoin de rentabilit rapide avec une diminution des cots et une volont de gnrer toujours plus vite des revenus. Ceci se traduit donc pour les acteurs rencontrs par une stratgie NGN compltement pousse par la volont de rduction des cots, la vision marketing de dveloppement de nouvelles offres passant plutt au second plan. Lvolution vers les NGN sera une volution lente et non une rupture, au fil de leau, avec une cohabitation longue des diffrentes technologies. Les services NGN seront des services de convergence, multimdia et lis la mobilit des utilisateurs. Les acteurs ont tous conscience que la valeur est en train de basculer de laccs vers les services et devraient entraner une modification de la chane de valeur, des modles conomiques et des modes de facturation. Cependant, les oprateurs tlcoms sont encore peu enclin ouvrir leur base abonns et leur rseau des tiers, mme sils commencent prendre conscience que pour survivre, il faudra aller dans cette direction, dans laquelle ils sont bien positionns aujourdhui. Pour y arriver, ils devront probablement aller vers une certaine culture dopportunits quils nont pas forcment aujourdhui, contrairement de nouveaux acteurs, car le time to market sera cl sur ce march des services et contenus. Aujourdhui ils nont pas encore vraiment rflchi la manire daborder ce nouveau march, ni en terme de politique de partenariats (trs peu avance globalement entre oprateurs et fournisseurs de services et contenus), ni en terme de modle de reversement entre acteurs de cette nouvelle chane de valeur, ni en terme de facturation aux clients (aussi bien les modes que les circuits de facturation). Une prcision enfin : le terme NGN nest pas utilis voire inexistant chez ces acteurs aussi bien en interne quen externe.
Autorit de rgulation des tlcommunications
201
4.6.2 Typologie des acteurs et structuration du march
Le march actuel des oprateurs et fournisseurs de services est actuellement en pleine phase de reconcentration.
Le choc aura t assez brutal puisque la multitude de nouveaux entrants sur le march des tlcommunications lie louverture la concurrence, ainsi que lexplosion des jeunes pousses dans les domaines connexes, lie leuphorie dInternet et la bulle spculative boursire des deux dernires annes ont finalement laiss place une poigne dacteurs sur ce march. Les exemples sont nombreux : LD COM a rachet les oprateurs Kaptech, Belgacom France ou encore Fortel ; Tisacli a rachet Infonie, Worldnet, Freesbee et Libertysurf.
Ce contexte ne favorise gure les nouveaux investissements. Cependant lorsquils ont lieu, ils favorisent lvolution vers les NGN, notamment pour des nouveaux entrants qui voient avant tout les possibilits de flexibilit et dvolutivit rapide des quipements en fonction de la demande, les nouveaux services quils permettent ou encore la rduction globale des cots apporte par ces solutions.
Ce march est structur autour de quelques grandes familles dacteurs :
Loprateur historique : France Tlcom (et ses filiales Orange, Wanadoo, Equant,), qui possde des avantages certains sur ce march, lis son monopole exerc pendant de nombreuses annes. Les oprateurs tablis et plutt gnralistes : ils ont merg avec la fin du monopole et ont atteint aujourdhui une taille critique, assurant une certaine prennit de leurs activits. Ils sont prsents au mme titre que loprateur historique sur les rseaux longue distance et boucles locales, au travers dune large palette de services (fixe, mobile, Internet, Data) et auprs dune large cible de clientle (particuliers, entreprises, collectivits...). Ce sont des acteurs comme SFR/Cegetel. On peut considrer quun acteur comme LDCom Networks ou Bouygues Telecom appartient cette catgorie. Les oprateurs alternatifs, souvent qualifis de nouveaux entrants sur le march : ce sont des acteurs dorigine voix ou donnes, arrivs sur le march ces dernires annes avec louverture la concurrence. Ils sont plutt positionns sur des offres aux entreprises, plutt PME-PMI avec des offres de tlphonie classique, de transport de donnes et de services Internet. Ils ont mis en place des rseaux de boucle locale (notamment BLR, xDSL, etc ) et/ou des rseaux longue distance. Certains ont une envergure soit nationale, soit europenne soit internationale. Cependant, ils nont pas encore atteint une taille vraiment critique et capable de les rendre prennes et autonomes sur le march mme sils sont prsents depuis plusieurs annes. Cette catgorie dacteurs est lheure actuelle la plus vise par les rachats du fait de besoins de financement ncessaires leurs activits. Ce sont par exemple des oprateurs comme Firstmark, Completel, 9 Tlcom ou encore rcemment Kaptech, Belgacom France avant leur rachat. Les oprateurs alternatifs interrogs se considrent plutt comme des acteurs dj tablis sur le march et non comme nouveaux entrants.
Les oprateurs de backbone : ce sont en gnral des oprateurs internationaux, qui ont mis en place des rseaux de transit tout IP ou des rseaux longue distance pour une cible doprateurs. Par exemple, ce sont des acteurs comme Cable et Wireless, Level 3, Global Crossing,etc.. Certains acteurs sont la fois des oprateurs de rseaux et fournisseurs de services. Ils ont dvelopp des offres destines une cible plutt rsidentielle mme sils disposent doffres spcifiques pour les petites entreprises. De part leurs activits (ISP et cblo-oprateurs), ils disposent doffres plus naturellement bties
202
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
autour dInternet, des services et des contenus. Certains ont en plus une activit multimdia importante au travers des offres tlvisuelles. Ils oprent galement des rseaux de tlcommunications. Ce sont par exemple des acteurs comme Noos ou Tiscali.
Enfin, les purs fournisseurs de services et contenus : ce sont des acteurs qui noprent pas de rseaux mais dveloppent des services et des contenus autour des tlcoms (notamment Internet et mobile). En fait, cette catgorie regroupe une multitude dacteurs, plutt positionns sur des niches et qui, aprs une phase deuphorie (priode des start-up), doivent aujourdhui rassurer le march sur leur prennit et la viabilit de leurs business models. Ce sont des acteurs de type oprateurs virtuels (MVNO par exemple), acteurs de loutsourcing (ASP, centres dappels, etc) ou encore les agrgateurs de contenus (portails). Ce sont par exemple des socits comme e-TF1, Externall, etc Cest principalement dans cette catgorie que se trouve le vivier des nouveaux acteurs NGN identifis par le march.
4.6.3 Stratgie, positionnement et offres de services NGN 4.6.3.1 Part des NGN dans la stratgie des acteurs
Il faut tout dabord noter que le terme de NGN nest pas identifi en tant que tel comme stratgie chez les oprateurs et fournisseurs de services. Dailleurs, plusieurs acteurs nous ont prcis que la notion de NGN nest pas utilise en interne et vis--vis de lextrieur . Cette notion est mme quasiment inexistante chez la plupart des oprateurs et fournisseurs de services. La part des NGN dans la stratgie des oprateurs et fournisseurs de services de ces acteurs est cependant intgre : des rseaux NGN sont existants ou en cours de mise en place chez plusieurs acteurs. Certains acteurs parlent mme de AGN (Actual Generation Network). Les NGN sont par contre plutt vus comme un moyen utilis pour mettre en place une stratgie et, sur ce point, les avis divergent en fonction des types dacteurs (oprateurs et purs fournisseurs de services).
En effet, pour les oprateurs, les NGN sont pour linstant plutt guids par une stratgie conomique et technique. Llment qui ressort de faon majeure et qui avait dj t mis en avant auparavant, cest le souci de rduction des cots, qui explique dailleurs une forte implication technique et non marketing, pour amliorer la gestion et lexploitation du rseau avec la convergence et pour optimiser la bande passante couche basse pour focaliser sur les services aux entreprises. Pour les purs fournisseurs de services, les NGN sont guids avant tout par la recherche dun protocole IP unique et les nouveaux services contenus multimdia mettre en place.
La notion de NGN est quasiment inexistante chez les oprateurs et fournisseurs de services. Cependant des rseaux NGN sont en cours de dploiement ou en exprimentation chez une majorit dacteurs. Les rseaux NGN recouvrent des stratgies diffrentes selon les types dacteurs : essentiellement guids par lconomie de cots chez les oprateurs, ils sont davantage mis en avant par les fournisseurs de services comme vecteurs de nouveaux services contenu multimdia.
Autorit de rgulation des tlcommunications
203
4.6.3.2 Les services NGN envisags
Mme si les acteurs ont aujourdhui une proccupation plus conomique que marketing, tous saccordent penser qu terme la stratgie dvolution vers les NGN sera pousse par les nouveaux services. Les services NGN sont dfinis par la grande majorit des acteurs comme des services valeur ajoute, notamment riches en contenu et en multimdia et temps rel. Ces services sont galement fortement vus comme prenant en compte les aspects de mobilit et localisation gographique (aspect contextuel). Enfin, ils sont galement convergents, mixant voix, donnes, images et multi-supports avec une indpendance laccs. La personnalisation a galement t cite par une minorit dacteurs. Les services favoriss par les NGN que la majorit des acteurs pensent dvelopper court ou moyen terme sont les services avec architecture distribue : notamment les services de streaming :
Video on demand (programme, film, missions la demande). Streaming en temps rel (retransmission en live) ou tlchargement payant de programmes vido. Multicast sur IP. Visioconfrence.
Un acteur prcise cependant que pour faire du streaming, une architecture NGN nest pas obligatoire. Un acteur voque galement tous les services conversationnels de type : travail collaboratif, visiophonie, messagerie instantane et prcise que les services conversationnels multimdia (communication bi-directionnelle) seront nettement favoriss par les NGN la diffrence du streaming. Ces deux derniers avis confortent donc lopinion sur lvolution non obligatoire des acteurs vers les NGN, aborde dans la suite du document. Sont galement en prparation des offres de convergence voix/donnes avec des offres de voix sur IP et Tlphonie sur IP. Les fournisseurs de contenus citent quant eux des services de distribution multimdia ou encore des services audiovisuels sur ADSL pour diffusion multimdia sur Internet et TV haut dbit.
Pour la majorit des acteurs, le service NGN se dfinit comme un service valeur ajout, convergent, contextuel, temps rel, riche en contenu multimdia et li la mobilit. Les services qui seront favoriss par les NGN seront : les services architecture distribue et en particulier les services temps rel et conversationnels, les services de voix sur IP pour les oprateurs ; les services de distribution multimdia et audiovisuel pour les fournisseurs de contenus.
204
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.6.3.3 Modles conomiques envisags
4.6.3.3.1 Quelle relation entre acteurs dans le contexte NGN ?
Les oprateurs ont conscience dune volution de la valeur, qui va basculer de laccs vers plus de services et contenus. Cependant, davantage proccups par un contexte actuel difficile, et mme sils ont fait le constat de lchec des modles conomiques de lInternet gratuit, les oprateurs ne sont quau dbut de leurs rflexions sur lvolution des nouveaux modles conomiques. Il a donc t difficile dobtenir de leur part une vision sur leur positionnement court ou moyen terme sur la chane de valeur, ainsi que sur le type de relations souhait avec les autres acteurs, ou encore sur les modes de facturation des services envisags. Disposant du rseau (donc de laccs direct au client final) et riche dune base de clients valorisable, les oprateurs sont pour linstant les mieux placs sur le march. Cependant, ils ne pourront pas forcment dvelopper tous les nouveaux services seuls pour des raisons de cots et de time to market . Le sens de lhistoire va donc vers une ouverture des oprateurs vers les fournisseurs de services et contenus et les nouveaux acteurs venir. Cela va donc renforcer le poids de ces derniers et leur pouvoir de ngociation auprs des oprateurs. Cependant, ils restent pour linstant dpendants du bon vouloir de ces derniers. Tant quune dynamique des oprateurs naura pas lieu dans ce sens, et quun modle de reversement et un mode de facturation nauront pas t trouvs, permettant de viabiliser les fournisseurs de services et contenus, les politiques de partenariats resteront floues. Parmi les solutions envisages, la prfrence est tout de mme clairement donne aux associations entre acteurs sous forme de partenariats et non aux fusions-acquisitions. Aujourdhui, il apparat que les oprateurs tlcoms nont pas encore de rflexions de partenariats entames ou abouties avec dautres types de partenaires que les constructeurs. Seuls les oprateurs mobiles et les fournisseurs de services sont dj entrs dans cette logique, ce qui nest pas encore le cas doprateurs plus gnralistes. Les fournisseurs de services et contenus, jusque-l dpendants de ces acteurs majeurs pour leur dveloppement, ont bien conscience quune stratgie douverture vers les oprateurs mais aussi vers les autres acteurs du march est une force pour assurer sa prennit et grossir sur le march. Ils sallient davantage et avec des partenaires assez varis : outre les constructeurs, les fournisseurs de contenus sont largement viss, mais aussi les diteurs de logiciels, les autres fournisseurs de services, les ISP, les oprateurs mobiles, les broadcasters,Cependant, les fournisseurs de services prcisent que les partenariats tablis ne sont pas forcment dus aux NGN mais les NGN les favorisent, voire mme assurent une certaine crdibilit sur le march.
Le sens de lhistoire pour les oprateurs va vers une ouverture vers de nombreux fournisseurs de services et contenus. Les oprateurs nen sont quau dbut de leurs rflexions sur cette stratgie douverture et nont pas encore mis en place de partenariats de ce type dans le cadre des NGN. Les fournisseurs de services et contenus sont davantage avancs sur ce point.
4.6.3.3.2 Quel avenir pour les nouveaux acteurs dans le cadre des NGN ?
Les avis sont trs partags quant larrive de nouveaux acteurs (oprateurs et fournisseurs de services) sur ce march. En effet, suite la gnration start-up, le contexte conomique aidant, beaucoup sont sceptiques sur le financement de ces nouveaux acteurs.
Autorit de rgulation des tlcommunications
205
Cependant, si nouvel acteur il y a, ce ne sera probablement pas un oprateur mais plutt un fournisseur de services ou contenus, qui se dveloppera sur une niche. En effet, comme dj mentionn, la dynamique du rapprochement entre oprateurs et fournisseurs de services en vue doffrir des services toujours plus riches et avant les autres sera probablement moteur dans lapparition de ces nouveaux acteurs. Ils seront galement pousss par le march et la demande de services des entreprises et du grand public, des prix attractifs permettant de gnrer rapidement un seuil de volume important, do limportance de trouver les bons modes de facturation et modles de reversement. Outre les nouveaux acteurs dj cits dans le document, dautres nouveaux acteurs pourraient apparatre, notamment ceux qui vont graviter autour des terminaux communicants et diteurs de logiciels, comme la dailleurs signal un des gros diteurs de logiciels rencontr. Tous les acteurs interviews pensent que ces nouveaux acteurs, sils russissent, seront seront rapidement intgrs, soit de plus gros fournisseurs de services, soit des oprateurs qui acquireront ainsi de nouvelles comptences et une plus grande matrise sur la chane de valeur. Les acteurs qui trouveront une killer application sur ces niches pourront devenir des gros, au dire dun des acteurs diteur de logiciels.
Les nouveaux acteurs se trouvent principalement dans la catgorie des fournisseurs de services et contenus, notamment ceux qui graviteront autour des terminaux communicants. Ces acteurs, sils russissent sur le march, seront rapidement intgrs soit de plus gros fournisseurs de services soit des oprateurs souhaitant avoir une meilleure matrise de la chane de valeur, soit pourquoi pas des diteurs de logiciels.
4.6.3.3.3 Quelle facturation pour les services NGN ?
Les avis sont trs partags sur la facturation des services.
Plusieurs acteurs pensent quil ny aura pas de modification du mode de facturation actuelle et que les trois modes de facturation actuels vont perdurer (acte, volume,dure). Un nombre identique dacteurs pense que la facturation actuelle va tre remplace de plus en plus par une facturation au contenu (volume) ou lacte (usage). Cette vision est conforte par lopinion de plusieurs acteurs qui sont daccord pour dire que la facturation la dure daccs va disparatre du fait notamment du haut dbit. Enfin, une minorit dacteurs pense que le march ira vers un modle de type kiosque.
206
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
La facture globale va rester constante voire augmenter mme si le prix de bande passante baisse, car elle va prendre en compte de nouveaux lments (augmentation de la consommation, nouveaux revenus lis de nouveaux services valeur ajoute...). Cest une difficult dans la mesure o le budget des clients notamment rsidentiels va plutt aller la baisse, car mme si le budget global de communication des mnages augmente, le nombre de services augmentent galement (mobiles, abonnement Internet, abonnement tlphone fixe, Cble, TV payantes), ne faisant donc pas augmenter le budget par services. Cette ide est partage par plusieurs constructeurs. Peu dacteurs mettent des hypothses sur qui va facturer les clients finaux : un acteur met lhypothse que le fournisseur de services pourrait tre amen facturer le client final. Un autre acteur pense que la facturation par loprateur ou le fournisseur de services ne sera pas exclusif mais dpendra du type doffres. Enfin, dautres pensent que, dans tous les cas, cest loprateur qui restera matre de la facturation au client final. Enfin les problmatiques dautomatisation des processus de facturation, notamment autour des petites sommes et de paiement par Internet doivent encore tre tudies.
Les avis sont trs partags sur la facturation des services NGN. Certains ne voient aucun changement aux modes de facturation actuels, dautres pensent quune volution va se faire dune facturation la dure vers une facturation au volume ou lacte. Enfin, certains voquent lide dun modle de type kiosque. Peu davis sont mis concernant le circuit de facturation et l encore les avis divergent totalement. Ces sujets paraissent finalement un peu trop amont par rapport aux rflexions actuelles des oprateurs. Plusieurs acteurs sont tout de mme daccord pour dire que la facture globale devrait rester la mme pour les clients finaux, NGN ou pas.
Autorit de rgulation des tlcommunications
207
4.7 Migration vers les NGN : des visions contrastes
Cette partie aborde les thmes suivants :
Evolution ou rvolution annonce ? Anticipation ncessaire ou non vers les NGN ? Mthode de migration des acteurs tablis et nouveaux acteurs. Mthode de migration des acteurs interrogs. Modalits de cohabitation entre NGN et rseaux traditionnels. Cohabitation longue ou convergence terme ? Pays, acteurs prcurseurs et impact du contexte international. Quelques exemples de contrats NGN.
Le constat est que, l encore, les constructeurs sont plus avancs dans leurs rflexions que les oprateurs.
4.7.1 Evolution ou rvolution annonce ?
La vision quont les oprateurs interviews sur lvolution vers les NGN confirme les tendances dj dgages chez les constructeurs eux-mmes. Les NGN sont vus en majorit comme une volution naturelle et lente du march plutt que comme une rvolution et un march de rupture, mme si une minorit dacteurs considre que la convergence est une rupture en soi et quil sagit dune rupture importante pour les oprateurs voix. Un acteur prcise galement que les solutions NGN constitueront une rupture importante par rapport aux solutions traditionnelles si elles sont capables de fournir des interfaces ouvertes et normalises (de type API) des fournisseurs de services tiers. Pour un des acteurs interrogs, certains nouveaux entrants ont eu au dpart une approche de rupture, nayant pas dexistant. Cependant, ce nest plus le cas maintenant puisque les nouveaux entrants se sont rarfis. Le poids des investissements rentabiliser raliss par les oprateurs et les constructeurs jusque l est prendre en compte dans lvolution de ce march. Ceci pourrait notamment expliquer lvolution lente et continue du march vers les NGN.
Les NGN sont vus comme une volution et non une rvolution par les oprateurs.
4.7.2 Anticipation ncessaire vers les NGN ?
Globalement les avis sont assez contrasts sur le caractre obligatoire ou non de lvolution de la migration vers les NGN, plusieurs acteurs pensant que tous devront anticiper la migration du fait dun phnomne irrversible vers les NGN et voluer sous peine dtre condamns sur le march, dautres insistant sur le fait que la migration nest pas une obligation. Ce contraste est particulirement vrai pour les oprateurs, mais moindre chez les constructeurs. Quant aux acteurs vus comme devant anticiper leur migration vers les NGN, les avis sont trs diffrents entre constructeurs et oprateurs. Notamment, les constructeurs sont en majorit daccord pour dire que les principaux oprateurs identifis comme devant (ou pouvant plus aisment) anticiper lvolution vers les NGN sont :
208
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Les oprateurs de backbones (transport longue distance et transit), IP notamment, qui ne disposent pas de commutation daccs. Lintroduction des NGN sera donc plus facile pour eux. Et les nouveaux oprateurs, qui nont pas dexistant et un potentiel de forte croissance. Dautres types dacteurs trs varis sont galement identifis mais de faon trs minoritaire par les constructeurs et les oprateurs : Les ISP, les oprateurs mobiles, les oprateurs globaux voix/donnes proposant de larges gammes de nouveaux services, notamment large bande, les oprateurs qui contrlent une base abonns importante, les oprateurs qui sont dans une problmatique dinstallation ou de renouvellement dquipements, les oprateurs historiques, les oprateurs tablis, les oprateurs tlcoms, les oprateurs de boucle locale, les fournisseurs de services, les nouveaux entrants et les constructeurs.
Les avis des oprateurs sont trs varis (beaucoup plus que ceux des constructeurs) et semblent fortement lis au contexte de chaque acteur. Parmi les acteurs qui nvolueront pas sont cits essentiellement les oprateurs historiques et les oprateurs qui ne sont pas dans une problmatique de renouvellement ou dinstallation dquipements, les oprateurs ayant essentiellement du trafic voix et qui ne pensent pas changer de positionnement dans les 2 ou 3 ans venir, les oprateurs qui ont beaucoup investi, trop rcemment, dans les technologies TDM et ne les ont pas encore amorties et les oprateurs ayant dj un accs boucle locale bas dbit et des commutateurs daccs Classe 5. Enfin, un acteur prcise que les constructeurs noffriront bientt plus que des solutions de type NGN et donc tout le monde devra aller vers les NGN.
Les avis sont assez partags sur lobligation des oprateurs anticiper ou non vers une migration NGN. Globalement cest quand mme une ide dvolution irrversible vers les NGN qui prdomine, pousse par lvolution des offres constructeurs et les nouveaux services terme. Paradoxalement, plusieurs acteurs reconnaissent que les services envisags dans les roadmap ne ncessitent pas forcment dans limmdiat un rseau NGN. Cependant, sur les types dacteurs qui devront anticiper ou non, les rponses sont trs varies. Les constructeurs sont plusieurs penser que ce sont en premier les oprateurs de backbone IP et les nouveaux oprateurs qui devront anticiper.
Autorit de rgulation des tlcommunications
209
4.7.3 Mthode de migration des acteurs tablis et des nouveaux acteurs
Les constructeurs ont globalement une vision homogne et cohrente de la mthode probable de migration des acteurs vers les NGN.
4.7.3.1 Approche probable des acteurs tablis
Lapproche des acteurs tablis sera probablement lente pour migrer vers les NGN. Les constructeurs estiment que les oprateurs tablis (oprateurs historiques) nvolueront pas rapidement vers les NGN (voire nvolueront pas), principalement pour les raisons suivantes :
Leurs rseaux ont cot trs cher dployer, mais sont dj amortis et leur apportent des revenus rguliers et stables. Or, nous sommes dans une priode o le retour sur investissement est critique. Leurs rseaux sont extrmement tendus gographiquement. Leur trs grand nombre de clients et le problme des terminaux renouveler ralentissent cette migration et la rendent complexe. Leur migration totale sera longue. Ils attendront latrophie naturelle du rseau TDM/SS7 et garderont des produits en fin de vie mais rentables.
Il semble que, bien que les oprateurs tablis ne subissent pas outre mesure la concurrence des autres oprateurs, les besoins des clients et les nouveaux acteurs les pousseront commencer migrer vers les NGN moyen terme afin doffrir de nouveaux services innovants. Un acteur prcise que pour les services de tlphonie classiques, les acteurs tablis nenvisageront une telle migration que si lobsolescence des technologies de commutation synchrone est avre, ce qui nest pas le cas aujourdhui. Les opinions des oprateurs interrogs convergent avec celles des constructeurs pour dire quune des principales raisons de migration lente des acteurs tablis est le poids de lexistant, avec des investissements lourds dj raliss sur des systmes classiques, qui ne poussent pas un volontarisme de ces acteurs et amnera un remplacement naturel et progressif des quipements. Par ailleurs, lattentisme est aussi envisag du fait dune qualit de service non satisfaisante, les problmes dinterconnexion et de standardisation. Enfin le contexte financier peut aussi expliquer le phnomne. Cette migration sappuiera plutt sur une solution de transport ATM, sera vraisemblablement partielle, et longue (> 10 ans), les acteurs tablis se focalisant court terme sur le dveloppement de nouveaux services sur les infrastructures existantes. Lordre de migration des services que les constructeurs imaginent pour les acteurs tablis est le suivant :
En priorit :
de nouveaux Services de Voix, directement sur IP, avec des applications nativement IP, indpendante de lIN et des points dinterconnexion vers le RTC. Ce sont en effet lexplosion du trafic IP et le dveloppement de nouveaux services qui tireront les besoins dinfrastructure, et donc la ncessit pour les acteurs tablis de migrer leurs rseaux existants. le transport de la voix sur IP dans le backbone entre les commutateurs de Classe 4 (Transit), afin damliorer lefficacit de transmission et de faire des conomies.
210
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
En dernier, lvolution vers le transport VoIP entre les commutateurs de Classe 5 (accs).
Les acteurs tablis auront probablement une approche de migration lente vers les NGN du fait du poids de lexistant. Leur migration sera longue et partielle et sappuiera plutt sur des solutions en transport ATM avec un ordre de migration prioritaire des nouveaux services de voix directement sur IP.
4.7.3.2 Approche probable des nouveaux acteurs
Les constructeurs et les oprateurs estiment que la stratgie NGN des nouveaux acteurs dpendra fortement du type dacteur et de la culture dorigine de son personnel. Plusieurs constructeurs identifient mme un risque de conservatisme li aux personnes, et la difficult pour elles de ne pas reproduire un schma dj connu. Les acteurs qui migreront rapidement vers les NGN seront ceux dont les responsables sauront faire abstraction de leur ventuelle culture Tlcom/Voix. Les difficults rencontres pour ces nouveaux acteurs volontaires dans la migration sont lies au type d'acteur, sa culture et sa capacit financire. Dautres problmatiques sont galement avancs par les oprateurs : la dpendance vis vis de la volont des gros oprateurs ouvrir leurs rseaux aux tiers et les modles de rmunration non encore rsolus (particulirement vrais pour les fournisseurs de services) ; lobligation pour les nouveaux entrants tlcoms doffrir des services classiques notamment voix aux utilisateurs finaux et donc une qualit de service qui doit tre identique celle existante mais qui pose aujourdhui encore problme avec les NGN. Ces acteurs raliseront leur dploiement de rseaux directement dans une architecture NGN, ou progressivement avec des exprimentations avant dploiement. Leurs solutions sappuieront plutt sur IP directement, bien que cela nexclut pas des dploiements mixtes et bass sur ATM. Les fournisseurs de services Internet (ISP) sont identifis par la majorit des constructeurs et des oprateurs comme des acteurs moteurs et une cible dutilisateurs privilgis des architectures NGN. Elles sont en effet adaptes la diversification de leurs services, historiquement bass sur IP. Un acteur prcise cependant que les NGN doivent fournir des interfaces ouvertes et normalises ces acteurs pour leur permettre de dvelopper des services hors des quipements du rseau et sans considrer les ressources de transport utilises. Dans une moindre mesure, les acteurs de rseaux de donnes comme les oprateurs de transport IP ( carrier-to-carriers , ull IP suppliers ) et les oprateurs DSL et cble sont aussi mis en avant par les deux types dacteurs. Les nouveaux entrants et notamment les oprateurs alternatifs sont galement vus comme moteurs par les acteurs. Le choix des NGN est identifi par tous avant tout comme une ncessit pour les nouveaux acteurs dassurer leur comptitivit face aux acteurs dj en place, tant sur le plan technique, oprationnel, ou marketing. En effet, grce aux NGN, ils pourront rduire leurs cots, gagner en flexibilit de dploiement et introduire de nouveaux services. Cest aussi loccasion pour les acteurs data de se diversifier en capitalisant sur leur savoir-faire technologique. Ce type de stratgie peut, selon un constructeur, bouleverser lordre tabli et voir rapidement un nouvel acteur merger et acqurir une position forte sur le march.
Les fournisseurs de services Internet, plus globalement les acteurs de donnes IP, les oprateurs DSL et Cble et les nouveaux oprateurs
Autorit de rgulation des tlcommunications
211
entrants sont considrs comme les acteurs les plus moteurs dans la migration vers les NGN. Cependant la difficult pour eux est lie la culture mme de lacteur et sa capacit ne pas reproduire un schma connu et scurisant. Pour ces acteurs, le dploiement se fera directement sur des solutions NGN base dIP afin dassurer leur comptitivit.
4.7.3.3 Problmatiques gnrales lies la migration
Certains constructeurs ont attir notre attention sur les points suivants :
La migration se fera initialement en rendant les quipements classiques convergents. A terme (horizon 2005), les nouveaux investissements se feront sur les NGN pour arriver une architecture uniquement paquets. En cas de services mixtes, la question se pose de garder une double architecture de rseau (que ce soit pour les acteurs historiques ou les nouveaux acteurs). Les rseaux de transport ne vont voluer que trs lentement. Les oprateurs vont introduire des fonctions de contrle dappels bases sur IP mais le transport continuera se faire en SDH ou en ATM. Raisons : problme de qualit de service sur IP, pas de problme de capacit sur les rseaux de transport donc pas besoin doptimiser tout prix, complexit de la migration des rseaux de transport.
4.7.4 Approche migration des oprateurs interrogs 4.7.4.1 Existant : frein ou moteur ?
Les oprateurs voient davantage de moteurs que de freins dans leur existant vis--vis dune migration NGN. Notamment, llment moteur le plus mis en avant est le fait davoir dj un rseau NGN ou en partie NGN ou en cours de migration. Les freins identifis par les acteurs sont lis lexistant (investissements dj raliss et parc dabonns sur des offres classiques) et aux services (obligation doffrir des services classiques comme la voix dont la qualit de service doit tre maintenue).
4.7.4.2 Mode dintroduction
Les oprateurs prcisent que leur mode dintroduction des NGN (comme dj prcis dans le document) a dabord t conomique et technique, notamment chez les oprateurs alternatifs. En particulier, lapproche vers les NGN a t avant tout guide par la rduction des cots, le retour rapide sur investissement ou la volont de valoriser une infrastructure rseau en vue dune revente. Souvent, lapproche migration est faite au niveau du service technique, sans que le service marketing soit impliqu. Pour deux des acteurs interrogs (qui sont des purs fournisseurs de contenus), lapproche est faite par les contenus. Cependant la plupart des acteurs reconnaissent qu moyen terme la migration sera davantage pousse par les nouveaux services et donc le marketing. Lordre de migration est trs variable en fonction des acteurs et non significatif. La dure de la migration est plutt envisage sur du long terme (5 10 ans) et ne commencera rellement chez les oprateurs que vers 2003, 2004.
212
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.7.4.3 Etat davancement
La majorit des acteurs est en cours de dploiement dune solution de type NGN ou en cours dexprimentations. Plusieurs acteurs font de la veille technologique autour des NGN, paralllement des exprimentations ou en phase amont de rflexion. Cisco, qui tait vu comme le constructeur le plus mature faire voluer les acteurs vers des solutions NGN, est galement le plus cit parmi les constructeurs utiliss. Viennent ensuite Lucent et Juniper qui sont galement voqus par quelques acteurs. Ce sont donc plutt des acteurs du monde de la donne, auxquels font confiance les acteurs pour leur migration. Lordre de migration se fera du transport en mode paquet vers le contrle qui permettra louverture de nouveaux services. La migration des rseaux des acteurs est pour certains en partie termine ou en cours de dploiement. Deux acteurs prvoient une migration sur 2 ans. Cest plutt une migration partielle qui est faite par les acteurs et non une migration totale vers les NGN. Globalement, lensemble des acteurs sont daccord pour dire que la transparence sera l pour les clients finaux. Cependant, cela veut dire une migration sans faille, ce qui est encore rarement le cas aujourdhui. Donc cest plutt de lordre du souhait que de la ralit.
Lexistant des oprateurs est plutt vu comme moteur dans une migration vers les NGN. Lapproche de migration a t avant tout conomique technique. Dans un deuxime temps, elle sera marketing. et
La majorit des acteurs est en phase dexprimentation ou de dploiement. Pour leur migration, les acteurs font davantage confiance aux acteurs dorigine des donnes. La migration se fait du transport en mode paquet vers le contrle, permettant ainsi louverture de nouveaux services. Les migrations faites sont plutt rapides (sur 2 ans), partielles et lobjectif est dassurer une transparence pour les utilisateurs.
Autorit de rgulation des tlcommunications
213
4.7.5 Modalits de cohabitation entre NGN et rseaux traditionnels
Les avis des constructeurs et oprateurs sont assez proches sur les modalits de cohabitation entre rseaux NGN et traditionnels. Les difficults identifies par les constructeurs pour assurer la cohabitation entre les rseaux NGN et les rseaux traditionnels sont de deux ordres :
La principale concerne la fourniture des services :
La continuit des services dj connus (RNIS, SS7) sur les NGN, ainsi que linteroprabilit au niveau accs semblent difficiles. Cela est li ltat actuel de maturit des solutions softswitch qui sont plutt matures pour un usage au niveau de la commutation Class iV (transit) que Class V (accs). la fourniture de services NGN de qualit sur des rseaux htrognes promet dtre difficile, voire impossible, ou alors trs coteuse.
La seconde est beaucoup plus sujette controverses. En effet, si la majorit des constructeurs ne considre pas que linterconnexion et linteroprabilit entre rseaux htrognes soient une difficult (car elles sont prvues par les normes ), un tiers de ceux qui se sont exprims sur le sujet les identifie comme des difficults. Ce risque semble cependant bien rel, vu quune grande part des constructeurs a tabli des programmes de test dinteroprabilit de leurs produits NGN avec des solutions traditionnelles ou des produits NGN concurrents.
Selon les oprateurs, les difficults sont surtout ressenties au niveau de la capacit organiser cette cohabitation en termes de comptences voix/data, dinteroprabilit, dinterconnexion entre rseaux et de qualit de service minimum. Un acteur indique que certains oprateurs vont probablement dvelopper deux rseaux en parallle. Un autre considre que lexprimentation est un moyen danticiper et de rsoudre les difficults.
Lorganisation de la cohabitation, la continuit des services, la fourniture dune qualit de service, linterconnexion et linteroprabilit sont vues comme des difficults majeures dans la cohabitation entre NGN et rseaux traditionnels.
4.7.6 Cohabitation longue, ou convergence terme ?
Globalement cest lide dune cohabitation trs longue (10 20 ans, voire permanente) entre rseaux NGN et traditionnels qui prdomine chez les acteurs. Aucun des constructeurs ne croit en une convergence complte du march vers les NGN. Ce qui rejoint lide dj voque plus haut quil ny a pas dobligation voluer vers les NGN. Il y a par ailleurs un certain ralisme prendre en compte : le fait que les technologies sont en perptuel mouvement. Ainsi, un petit nombre de constructeurs anticipe mme sur le fait que les NGN seront supplants encore par une nouvelle version, ou par de nouvelles technologies. Les oprateurs partagent ces opinions.
214
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Cependant, il est intressant de noter que contrairement aux constructeurs, plusieurs oprateurs pensent quune convergence est possible :
Convergence totale avec mise disposition dun protocole de convergence (IP et qualit de service). Convergence, une fois la technologie NGN compltement stabilise. Il ne sagit pas dune cohabitation mais le terme utilis est la transition avec basculement vers IP.
Cest lide dune cohabitation trs longue entre rseaux NGN et traditionnels qui domine parmi les acteurs, probablement supplante nouveau par une nouvelle version des NGN. Contrairement aux avis des constructeurs, quelques oprateurs envisagent tout de mme terme la convergence des rseaux.
4.7.7 Pays et acteurs prcurseurs, impact du contexte international
Les pays prcurseurs identifis par lensemble des acteurs sont europens : les pays scandinaves (Sude, Danemark) et la Grande Bretagne (BT et ses filiales notamment), et plus rcemment lAllemagne (les pays o le trafic est au rendez-vous , comme la rsum un des constructeurs). LEurope semble en avance sur les Etats-Unis pour cette volution, du fait de ses rseaux plus modernes, de ses exigences de qualit de service dans les rseaux publics, et de la forte pntration de la tlphonie mobile. Il y a cependant plusieurs cas de mises en uvre hors Europe. Elles portent plutt sur le transit, avec chez un nombre trs restreint doprateurs des objectifs plus long terme de remplacement des commutateurs locaux. Le march de la tlphonie fixe aux USA est vu par deux acteurs comme prcurseur des NGN ainsi que lIPv6 en Asie (Japon, Core et Chine). La France semble globalement en retrait (du moins sur les projets lis lvolution de laccs) mme si quelques acteurs ont t cits comme Kaptech, France Tlcom ou encore les oprateurs cbles comme prcurseurs dans les NGN. Peu davis ont t donns sur limpact du contexte international sur la situation en France, qui ne semble donc pas essentielle sur le plan technologique mais plutt relever dune approche stratgique doprateurs globaux qui souhaitent mettre en uvre des solutions homognes, ou qui sont en situation doprateur historique dans leur pays mais se retrouvent en position de nouvel entrant dans dautres pays.
Les pays les plus prcurseurs identifis sont europens : pays scandinaves, Grande Bretagne, et Allemagne. Hors Europe, ce sont lAsie (Japon, Chine, Core) et les USA qui arrivent en tte. La France semble globalement en retrait.
Autorit de rgulation des tlcommunications
215
4.7.8 Quelques exemples de contrats NGN 4.7.8.1 En France
La France nest pas un pays prcurseur en matire dexprimentation et de dploiement de rseau de nouvelle gnration. Cependant, quelques exemples montrent lvolution des services et des rseaux ; de plus par les constructeurs (ex : Alcatel, NetCentrex, Cirpack) et les filiales des oprateurs (ex : Equant), on voit que les acteurs franais ne sont pas absents de cette volution vers les NGN.
Loprateur Kaptech a dploy son rseau de commutation avec des produits softswitch de Cirpack (source : Kaptech, Cirpack).
Le rseau de Kaptech, dont le dploiement a dbut en 1998, sappuie intgralement sur des quipements NGN du constructeur Cirpack (plus de 150 Media Gateways et plus de 30 softswitchs Class-V (accs)), et sur un transport ATM vhiculant des flux TDM, ATM et IP. Il est interconnect avec des commutateurs TDM de transit dautres oprateurs. Les principaux services supports par ce rseau sont la tlphonie, la connexion de PBX, la voix sur DSL et laccs Internet.
France Telecom dploie des centres de transit internationaux NGN dEricsson (Janvier 2002)
Daprs une publication date de Janvier 2002, France Telecom est lun des premiers oprateurs au monde introduire des centres de transit internationaux de quatrime gnration. Les quipements Transgate dEricsson, dont la capacit de trafic saccrot de 50% tous les ans, seront utiliss. Cela permet France Telecom doffrir une plus grande slection doprateurs destination et de fournir aux oprateurs des services amliors et adapts avec un plan de routage spcifique. Cette solution apporte aussi une plus grande flexibilit et efficacit. Les trois nouveaux quipements dEricsson, localiss Paris et Reims, remplacent 13 commutateurs MT20 rpartis sur le territoire. Le dploiement de ces commutateurs sest tal entre Septembre 1999 et Juillet 2001. Un MT20 sera maintenu en service pendant une courte priode pour les pays ne disposant pas encore de signalisation SS7.
France Tlcom va offrir des services de VoIP avec des solutions Alcatel (Mars 2002)
Alcatel a annonc le 13/03/02 avoir sign un contrat avec France Telecom pour la fourniture de solutions de rseaux bases sur Alcatel 5020 Softswitch et la plate-forme OSP (Open Service Platform) ddie aux applications IN (rseaux intelligents), permettant de lancer un service dappels tlphoniques en attente sur Internet. Les souscripteurs ce service pourront, lorsquils sont connects Internet, tre avertis des appels entrants et pourront y rpondre soit sur leur ligne fixe, soit en utilisant la technologie Voix sur IP ou en les renvoyant vers leurs systmes de messagerie unifie. (Daprs : le fil MC des Tlcoms).
4.7.8.2 En Europe
Les pays ayant la rflexion la plus avance dans le domaine des NGN sont la GrandeBretagne et les pays nordiques. Concernant les rseaux mobiles, lvolution seffectue principalement au niveau des services (ex. : portails multi-accs) et des terminaux. En revanche, aucune annonce nest effectue concernant lUMTS. Pour les rseaux fixes, la migration seffectue au niveau du rseau de transport (principalement IP/MPLS ).
216
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.7.8.2.1 Rseaux et services mobiles
mmO2 (Groupe British Telecom) lance un nouveau tlphone O2 XDA utilisant le logiciel Pocket PC 2002 de Microsoft (Mai 2002).
Le terminal O2 XDA mobile quip dun PDA, tlphone et du logiciel PocketPC 2002 de Microsoft sera disponible en Mai 2002 sur tout le rseau de mmO2 (Filiale mobile de British Telecom). Cest le premier produit GPRS supportant le logiciel Pocket PC 2002. Les services disponibles seront laccs Internet en couleur, la messagerie instantane, e-mail, news, services lis la golocalisation, entre autres.
Telefnica Mviles lance son portail multi-accs, nouveau concept de lInternet mobile (2002).
Ce portail sera accessible partir dun tlphone portable, un PDA ou un ordinateur portable et permettra des services messagerie, daccs Internet et aux services de fournisseurs de services et de contenus.
4.7.8.2.2 Rseaux fixes
Ericsson fournit des solutions de tlphonie sur IP Telia (Octobre 2000).
Selon un communiqu dat dOctobre 2000, Ericsson devait fournir deux Call server et 13 media gateways de la solution ENGINE pour le rseau international de tlphonie de Telia.
Tiscali met en place un rseau IP/MPLS pour fournir des services multimdia sur IP
Tiscali a utilis des systmes Cisco pour lextension de son rseau IP pour laccs Internet commut et la voix sur IP en Italie. Le rseau a t tendu 14 nouveaux POP et la capacit du backbone a t double afin de permettre cette infrastructure de fournir la bande passante ncessaire pour fournir ultrieurement des services IP de nouvelle gnration comme les VPN bass sur MPLS, la qualit de service IP et la vido sur IP. Tiscali implmentera aussi la technologie MPLS de Cisco dans son futur rseau IP multiservices au Royaume-Uni (Daprs : MPLS World News).
LambdaNet Communications propose un service de bande passante la demande bas sur IP/MPLS, et est trs intress par le GMPLS.
LambdaNet Communications lance son service de bande passante la demande, entirement base sur un rseau IP/MPLS et est disponible en France et Allemagne, et bientt dans plus de 60 villes en Europe. Ce nouveau type de service de connexion de bout en bout permettra aux oprateurs de transit, ISPs (Internet Service Providers), ASPs (Application Service Providers) et fournisseurs de services de bnficier dune bande passante flexible. Aprs la mise en place dun rseau IP/MPLS, LambdaNet dit clairement que la prochaine tape de lvolution de leur rseau sera limplmentation du G-MPLS ; les solutions G-MPLS ntant pas actuellement oprationnelles, LambdaNet travaille avec les constructeurs sur le G-MPLS (Cf. dtails chapitre 3.3 sur la couche Transport).
Autorit de rgulation des tlcommunications
217
4.7.8.3 Dans le Monde
Au niveau mondial, on voit se dessiner deux grandes tendances :
Lvolution des rseaux de transport (gnralement IP/MPLS) sur lesquels des offres de services multimdia commencent tre dployes (ex. : Equant). La refonte des rseaux existants pour les pays en forte croissance (ex. : Chine) ou les plus en avance (ex. : Sprint aux Etats-Unis).
Equant propose un service de tlphonie sur IP
Equant fournira dans les 60 pays o il est prsent des services de tlphonie IP au cours du deuxime trimestre 2002. Le service de voix pour VPN IP est dj disponible. Equant est en mesure de fournir ces services voix grce son rseau global homogne et sa solution de VPN IP base sur MPLS, qui permet de traiter les flux voix et donnes avec des priorits diffrentes en utilisant des classes de services. Le rseau IP VPN dEquant bas sur la technologie MPLS de Cisco est le plus grand rseau de ce type dploy, avec une disponibilit dans 125 pays. La dcision de gnraliser le dploiement de MPLS dans le backbone IP dEquant a t prise en Juin 2000 (Daprs : MPLS World News).
Equant slectionne NetCentrex pour les softswitches (Mars 2002)
Pour apporter de lintelligence son infrastructure IP MPLS, Equant a retenu la solution sofswitch de NetCentrex permettant de grer 18000 appels simultanment avec deux plates-formes (une plate-forme en Europe et une aux Etats-Unis).
Teleglobe offre un service de transport IP avec qualit de service et prioritisation
Teleglobe a annonc en Juin 2001 avoir achev la gnralisation de MPLS Packet over Sonet (PoS) dans son infrastructure de rseau IP global, avec des dbits pouvant aller jusqu OC-192. Cette volution amliore les temps de latence en simplifiant les couches rseau, et permet loprateur et ses clients de mettre en uvre un traitement du trafic bas sur les paramtres de qualit de service et la priorisation en fonction de classes de services (Daprs : MPLS World News).
Sprint et Nortel Networks sallie pour dployer un rseau de nouvelle gnration.
Sprint et Nortel Networks vont associer leurs comptences pour dployer un rseau permettant doffrir une nouvelle gnration de services. Ce programme doit permettre la simplification des rseaux doprateurs (convergence voix/donnes) et limplmentation de nouveaux services.
China Telecommunications dploie un solution de tlphonie sur IP de Nortel Networks (Avril 2002).
China Telecommunications a sign un contrat avec Nortel Networks pour le dploiement de solution de Voix sur IP Beijing, Shanghai, Guangzhou and Shenzhen. Ce rseau utilisera des quipements Networks Succession Communication Server 2000 et 3000 , des softswitches Interactive Multimedia Server et des Passport Packet Voice Gateway .
Alcatel signe un contrat de fourniture de rseau NGN en Chine (Avril 2002).
Alcatel a sign un contrat avec Guangxi Telecom et China Telecom pour la fourniture dune solution complte NGN. Ce rseau permettra doffrir des applications multiservices. De plus, il doit permettre de fournir des services de tlphonie sur paquets (IP ou ATM) et des services multimdia. La solution Alcatel comprend les softswitches 5000 et 5020 , les passerelles daccs Litespan 1540 et les media gateway 7505 .
La solution ENGINE dEricsson slectionne par China Telecom (2002)
218
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Ericsson va fournir ses solutions NGN ENGINE China Telecom. Le dploiement concerne dans un premier temps deux grandes villes, Guangzhou et Shenzhen. NB : Ericsson revendique de nombreux contrats NGN dans le monde pour sa gamme ENGINE. Beaucoup dentre eux portent sur lvolution du rseau de transit voix ou du rseau de collecte de trafic ADSL vers un rseau multi-services unifi sappuyant sur un transport ATM.
Autorit de rgulation des tlcommunications
219
4.8 Conclusion : vers une mutation des relations entre acteurs
4.8.1.1 Enjeux des NGN
Les enjeux de lvolution du march des NGN se traduisent par les lments dclencheurs, les dfis technologiques ainsi que les freins et moteurs technologiques et conomiques associs aux NGN identifis par les diffrents acteurs interrogs (constructeurs et oprateurs).
Lensemble de ces lments dmontre le manque encore important de maturit de ce march, tant sur le plan des produits industriels que sur la matrise quen ont les clients utilisateurs. Notamment, les quipements de premire gnration NGN semblent tre encore difficilement en mesure de rivaliser avec les quipements traditionnels pour les gros rseaux fort trafic. Par ailleurs, la problmatique financire et conomique est au cur du dbat. Les autres arguments avancs semblent des dclinaisons de ces deux facettes.
Le dclenchement vers les NGN est avant tout conomique avec le dveloppement des usages, la cration de valeur (introduction de nouveaux services et marchs) et la volont de rduire les cots dinfrastructure. Il est galement technique avec la convergence des rseaux voix/donnes, qui se traduit par un besoin doptimisation des rseaux (simplicit, volutivit, flexibilit). Les deux principaux moteurs technologiques aux NGN sont lis laccs haut dbit au sens large et les technologies associes (ATM, UMTS, ADSL,) ainsi qu lvolution vers le tout IP . Quant aux moteurs conomiques, ils viennent confirmer la vision des acteurs sur le dclenchement conomique vers les NGN : besoins et usages du march au niveau des services donnes, Internet et multimdia (en particulier ceux des entreprises selon les constructeurs) et offres de nouveaux services convergents et large bande.
Les principaux dfis technologiques lis aux NGN sont la matrise de la qualit de service, la standardisation et la normalisation des interfaces et protocoles. En corollaire de ce dernier dfi, linteroprabilit est galement au cur des proccupations des acteurs. Ces deux dfis forts identifis prcdemment, sont en fait clairement vus comme des risques par la majorit des acteurs. Il est probable que ce seront des risques majeurs.
Il ressort par ailleurs que ces principaux dfis technologiques sont aussi aujourdhui les principaux freins technologiques. Le poids de lexistant et IPv6 sont galement jugs comme des freins par les acteurs. Quant aux freins conomiques, ils sont diverses selon les intrts sauf sur un point : trouver un modle conomique et un modle de facturation viable. Les constructeurs sont plutt davis que la maturit industrielle des offres NGN ainsi que les limitations de dveloppement des boucles locales haut dbit sont des freins importants. Pour les oprateurs, les principaux freins voqus sont plus nombreux et portent surtout sur le poids de lexistant et son amortissement, les usages des utilisateurs, la rentabilit des investissements ou encore des lments socio-culturels, politiques et rglementaires.
220
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
4.8.1.2 Economie des NGN
Concernant lconomie des NGN, il apparat que les acteurs ont une vision trs nuance, qui confirme l encore un dcalage entre les constructeurs, assez avancs et optimistes dans leurs rflexions sur les opportunits de nouveaux services et mtiers, les nouveaux acteurs, les nouvelles relations entre acteurs, et les oprateurs, qui voient avant tout des opportunits pour eux-mmes, identiques aux dclencheurs identifis prcdemment, comme le dveloppement de leurs revenus, les nouveaux services dvelopper ou encore la baisse de leurs cots. Ces derniers restent par contre trs sceptiques, contrasts, voire peu matures dans leurs rflexions sur lapparition de nouveaux acteurs, de nouveaux modles conomiques ou encore de nouveaux modes de facturation.
Il est important de noter que les oprateurs sont plusieurs ne voir aucune opportunit, aucun acteur ou encore aucun service innovant li aux NGN. Les services qui seront favoriss par les NGN sont les services large bande, convergents voix/donnes/image, lis la communication multimdia temps rel et transactionnelle ; les services lis au contenu (notamment gestion distribue) ; les services lis lexternalisation et les services contextuels lis la mobilit et golocalisation.
La valeur va se redistribuer progressivement de laccs vers les services, donnant ainsi plus de poids aux fournisseurs de services et contenus : la fourniture de services sera donc au cur des nouveaux modles conomiques.
Le potentiel de nouveaux acteurs identifi se situe avant tout chez les fournisseurs de services et contenus, notamment les acteurs de loutsourcing, les oprateurs virtuels, ou encore les agrgateurs de contenus, qui joueront un rle de plus en plus important. Certains voient lapparition de nouveaux acteurs positionns sur des niches, qui seront terme associs de plus gros acteurs.
Les oprateurs, pour conserver leurs clients et dvelopper leurs revenus vont devoir souvrir des partenariats avec ces fournisseurs de services et contenus. En particulier, les oprateurs vont voluer sur la chane de valeur pour devenir des service enablers ou oprateurs de base clientle vis--vis des fournisseurs de services. Pour ces derniers, la cl du succs sera la capacit conserver, voire conqurir, des abonns plutt qu garder la mainmise sur lintgralit des revenus. Il sera pour cela ncessaire dtablir des rgles afin de faciliter cette ouverture.
Les oprateurs devront viabiliser les fournisseurs de services et contenus en leur garantissant des sources de revenus. Mais aujourdhui cela ne peut se faire quen trouvant un ou des modles conomiques gagnant-gagnant entre les partenaires. Ces modles sont encore crer.
Autorit de rgulation des tlcommunications
221
La facturation des services est galement un lment cl. La facture pour le client final ne peut pas augmenter dmesurment. Or, le nombre et le cot des services sont en forte croissance. Il est donc probable quon aboutisse une valorisation des informations en fonction de leur degr de valeur ajoute.
Les NGN devraient galement favoriser larrive de tiers de confiance et doutils de facturation standardiss avec automatisation des process (intressant pour la facturation de petites sommes). Les relations doprateur oprateur vont galement se dvelopper : les NGN vont permettre aux oprateurs de se louer du trafic et des services plus facilement car les rseaux ne seront plus ddis. Ils permettront dadapter du dbit la demande. Il y aura galement un besoin daccords forts entre les oprateurs de tous types pour proposer des services globaux accessibles tous les utilisateurs (interconnexions, voire investissement dans des plates-formes de services communes). Cependant, peu de modifications des modles conomiques et de la nature des relations entre oprateurs ne sont envisages.
Il ressort de cette analyse que les relations entre oprateurs et fournisseurs de services sont donc au cur de la problmatique NGN. Ces derniers sont dpendants du bon vouloir douverture dune part, et de partage de revenus dautre part, des oprateurs. Mme si lon sent dj des prmices douverture chez les oprateurs, il ne sagit pas encore dune tendance de fond et les modles conomiques associs sont encore quasi-inexistants. En parallle, les relations entre oprateurs vont sintensifier, mais dans la continuit par rapport aux modles conomiques existants. Quant au march des constructeurs, il risque dvoluer de manire masque aux clients pour la fourniture de matriels, et acquerra une plus grande souplesse propre la culture Internet. Le positionnement des gros constructeurs, quils soient dorigine tlcoms ou donnes, est plus nuanc.
4.8.1.3 Positionnement des constructeurs
Bien que certains acteurs travaillent llaboration de produits et solutions NGN depuis plusieurs annes (environ 5 ans selon lun des acteurs interviews), ce march en est encore ses balbutiements et est en pleine structuration.
4.8.1.3.1 Etat du march
Les grands constructeurs gnralistes tlcoms sont pour la plupart bien implants sur ce nouveau march, avec lnorme avantage davoir la capacit proposer des solutions de bout en bout cls en mains (en propre ou par le biais de partenariats), et de disposer de bases de clients importantes. Les acteurs issus du monde des donnes en gnral auront cependant un rle cl sur le march des solutions NGN, tant sur le plan des matriels, que des logiciels et des prestations. On constate par exemple que les acteurs interviews semblent faire plutt confiance dans leur volution vers les NGN des constructeurs dorigine IP ou
222
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
des nouveaux entrants, plutt qu des constructeurs dorigine tlcoms, ce qui pourrait modifier significativement la rpartition du march. Cependant, il apparat que les deux grandes familles ne sont pas directement concurrentes sur les matriels des couches transport et contrle (ce qui est conforme lopinion des acteurs interviews eux-mmes). Ils ont dailleurs souvent recours des partenariats stratgiques afin de fournir au client une solution globale, o chacun conserve et affiche sa spcificit. Chacune des deux familles aura son rle jouer sur ce march, et il est probable que leurs offres se complteront, mais moyen/long terme, il est possible que les acteurs donnes prennent un rle de leader au niveau des produits NGN associs la couche Services.
4.8.1.3.2 Emergence de nouveaux acteurs
Les NGN apparaissent clairement comme une opportunit dmergence de nouveaux acteurs, dveloppant leurs activits en leur nom propre ou par le biais de partenariats. La plus forte mergence de nouveaux acteurs, mme de concurrencer les acteurs tlcoms tablis, est en fait constate sur les fournisseurs de solutions tlcoms spcialises, et trs axes logiciel (serveurs dappel, plates-formes de services mais aussi media gateways). Il est certain que ces nouveaux acteurs devront faire preuve de fortes capacits financires ou mettre en uvre des partenariats solides pour rsister. Cependant, lmergence des NGN sera sans doute moyen / long terme loccasion dun certain renouvellement du march, bien que ce point semble mis en retrait par les constructeurs interrogs, du fait de la conjoncture actuelle dans les tlcoms. Les constructeurs tablis sont plus positionns dans la continuit ( NGNisation en douceur des rseaux et services existants) alors que les nouveaux acteurs se placent plus dans une optique de rupture technologique ( rvolution NGN).
4.8.1.3.3 Pas encore de solutions globales
Les fournisseurs de solutions globales , quils soient dorigine Tlcom ou IP, sont peu nombreux, et ces offres masquent en fait des partenariats technologiques. La conjoncture actuelle des tlcoms, qui veut que lensemble des acteurs soient de plus en plus innovants et ractifs pour le dveloppement de nouvelles solutions, rend les partenariats entre acteurs incontournables. Cela est dautant plus vrai dans le domaine des NGN, qui est mergent. Les partenariats y foisonnent et mme les acteurs majeurs y ont recours afin de complter leurs comptences. Il ressort des entretiens avec les constructeurs que, dans le cadre des NGN, les clients sont nettement plus demandeurs de services d'accompagnement stratgique, technique et financier (besoin identifi par la plupart mme si tous les constructeurs nont pas rpondu explicitement ce point). Les constructeurs sadaptent donc pour mettre en avant auprs de leurs clients des arguments plus marketing (services et usages) et financiers que techniques.
4.8.1.3.4 Les nouveaux acteurs de la couche Services encore ltat de prospects
Les nouveaux acteurs de la couche Services (purs fournisseurs de services, ASP, MVNO), identifis par beaucoup comme tant un vivier important de nouveaux clients NGN potentiels, nont pas encore merg : ils ne sont encore ce stade que des clients marginaux, voire des prospects. Limportance de ces nouveaux types de clients nest donc pas quantifiable ce jour. Par ailleurs, bien quelles ne soient pas vises par tous les constructeurs, les entreprises ressortent cependant comme des clients bien rels pour des solutions NGN convergentes de voix sur IP. Ce point confirme lopinion donne par plusieurs constructeurs que les entreprises auront un rle moteur pour faire voluer les offres des oprateurs vers les NGN. Lobjectif de larchitecture de rseau NGN, qui est la facilitation des solutions multiconstructeurs par le biais dinterfaces standardises, ne semble pas ais atteindre
Autorit de rgulation des tlcommunications
223
court terme pour les oprateurs. Dans un premier temps, les rseaux NGN seront donc vraisemblablement mono-constructeur (du moins par type dquipement). Il existe par ailleurs une certaine demande de fourniture de solution globale, par le biais de partenariats et de prestations dintgration (constructeur contractant principal).
Le march des constructeurs va peu voluer. Les acteurs dj en place garderont une place prpondrante : les grands constructeurs seront les contractants principaux, et intgreront des technologies dveloppes par des socits plus petites et plus ractives. La fin des technologies propritaires voix rapprochera le march des infrastructures voix du modle conomique Data, avec un large choix de fournisseurs (quipements / services, vente / installation / maintenance). Il semble donc que le march des NGN soit ouvert tous, avec une place privilgie de chaque constructeur auprs de sa clientle historique, et un rle indniable de challengers des nouveaux acteurs. Les nouveaux oprateurs et fournisseurs de services seront donc trs courtiss, car ce sont eux qui feront le plus jouer la concurrence transverse, et qui auront le pouvoir de bouleverser lordre tabli.
4.8.1.4 Les offres NGN et leur maturit
Les domaines o les produits semblent les moins matures (plutt sous 1 3 ans) sont :
Les terminaux (notamment fixes, surtout en termes de cot et de fonctionnalits par rapport aux terminaux mobiles). La facturation des services (une problmatique cependant plus commerciale que technique, afin de trouver le modle adquat des nouveaux services data multimdia). Le dveloppement des services multimdia (en fait, plus un problme de crativit pour trouver les killer services quun problme technique). Et surtout les logiciels applicatifs (disponibilit dans une fourchette de 1 5 ans). Les contenus et briques de base sont jugs matures, mais pas les technologies et les mcanismes de consolidation de ces contenus. Ce point est aussi mettre en relation avec le manque de maturit des terminaux et de SIP.
Il ressort donc clairement que les produits les moins matures sont ceux qui touchent plus ou moins directement (cas des terminaux) aux Services.
Au premier abord, les solutions NGN sont en gnral prsentes comme moins onreuses quiper et exploiter que les solutions traditionnelles. Dans le dtail, lvaluation que font les constructeurs et les oprateurs de ces avantages financiers est plus contraste (voire parfois divergente) en fonction notamment de lenvironnement technique (rseau) et conomique (relations oprateurs / constructeurs) de dpart, de lchelle de temps prise en compte, de la couche rseau voque. Concernant les cots dinvestissements NGN, les avis des constructeurs et des oprateurs sont globalement cohrents :
A court terme des montants fortement dpendants de lexistant de loprateur et de ses relations commerciales avec le(s) constructeur(s), mais globalement quivalents ou lgrement suprieurs sil sagit dune migration, et
224
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
dj significativement infrieurs sil sagit dun dploiement initial (de lordre de 10 30%).
A moyen/long terme (3-5 ans), une baisse des cots dachat des solutions NGN est prvue par tous, notamment lie aux conomies dchelle, la convergence des rseaux, aux gains de capacit des quipements et la mutualisation du dveloppement des services NGN. Ces gains pourraient tre de lordre de 30% sur laccs et 50% sur le cur de rseau par rapport aux solutions traditionnelles.
Concernant les cots rcurrents lis aux solutions NGN, les avis des constructeurs et des oprateurs sont en revanche moins convergents :
les constructeurs sont quasiment unanimes pour dire que les solutions NGN apporteront des gains immdiats significatifs (des chiffres de 20-30%, voire 50% sont voqus). Les avis des oprateurs et fournisseurs de services sont moins enthousiastes et plus contrasts, certains mettant notamment en avant court terme (dans les deux ans) des surcots indirects (des chiffres de lordre de 20% sont voqus) lis au manque de maturit de la technologie. Ils identifient aussi que la mise en place des quipements et services NGN impliquera des cots connexes (formation, rorganisations) qui pourront savrer non ngligeables. Cependant, terme (3-5 ans) tous sont daccord pour dire que les cots rcurrents vont baisser. On peut alors imaginer se rapprocher des chiffres indiqus par les constructeurs, qui sont des conomies de 20 70% selon les postes de cots.
Lanalyse sur les cots des solutions NGN confirme quaujoudhui le march se structure et que les solutions ne sont pas encore stabiliss pour avoir une visibilit claire et suffisante sur les cots.
4.8.1.5 Positionnement des oprateurs
Contrairement aux constructeurs, plus matures et en avance de phase sur le sujet des NGN, lapproche des oprateurs sur ce sujet est encore mergente aussi bien sur la partie conomique (modles) que sur la partie technique (migration).
Le march actuel des oprateurs et fournisseurs de services est actuellement en pleine phase de reconcentration. Ce contexte ne favorise gure les nouveaux investissements. Cependant lorsquils ont lieu, ils favorisent lvolution vers les NGN, notamment pour des nouveaux entrants qui voient avant tout les possibilits de flexibilit et dvolutivit rapide des quipements en fonction de la demande, les nouveaux services quils permettent ou encore la rduction globale des cots apportes par ces solutions. Des rseaux NGN sont en cours de dploiement ou en exprimentation chez une majorit doprateurs et fournisseurs de services, mme si la notion de NGN nest pas utilise comme argument marketing chez ces derniers. Les rseaux NGN desservent cependant des stratgies diffrentes selon les types dacteurs : essentiellement guids par lconomie de cots chez les oprateurs, ils sont davantage mis en avant par les fournisseurs de services comme vecteurs de nouveaux services contenu multimdia. Pour la majorit des acteurs, le service NGN se dfinit comme un service valeur ajout large bande, convergent, contextuel, temps rel, riche en contenu multimdia et li la mobilit. Les services favoriss par les NGN et dvelopps
Autorit de rgulation des tlcommunications
225
court terme par les acteurs sont : les services architecture distribue et en particulier les services temps rel et conversationnels (streaming, visioconfrence, vido la demande, travail collaboratif, visiophonie,etc), les services de voix sur IP pour les oprateurs ; les services de distribution multimdia et audiovisuel pour les fournisseurs de contenus. Comme nous lavons dj dit, le sens de lhistoire pour les oprateurs va vers une ouverture vers de nombreux fournisseurs de services et contenus. Les oprateurs nen sont quau dbut de leurs rflexions sur cette stratgie douverture et nont pas encore mis en place de partenariats de ce type dans le cadre des NGN. Les fournisseurs de services et contenus sont davantage avancs sur ce point. Les nouveaux acteurs identifis se trouvent principalement dans la catgorie des fournisseurs de services et contenus, notamment ceux qui graviteront autour des terminaux communicants. Ces acteurs, sils russissent sur le march, seront rapidement intgrs soit de plus gros fournisseurs de services soit des oprateurs souhaitant avoir une meilleure matrise sur la chane de valeur, soit pourquoi pas des diteurs de logiciels. Les avis sont trs partags sur la facturation des services NGN. Certains ne voient aucun changement aux modes de facturation actuels, dautres pensent quune volution va se faire dune facturation la dure vers une facturation au volume ou lacte. Enfin, certains voquent lide dun modle de type kiosque. Peu davis sont mis concernant le circuit de facturation et l encore les avis divergent totalement. Ces sujets paraissent finalement un peu trop amont par rapport aux rflexions actuelles des oprateurs. Plusieurs acteurs sont tout de mme daccord pour dire que la facture globale devrait rester la mme pour les clients finaux, NGN ou pas.
4.8.1.6 Stratgie de migration vers les NGN
Les NGN sont vus comme une volution et non une rvolution par les oprateurs. Les avis sont assez partags sur lobligation des oprateurs anticiper ou non vers une migration NGN. Globalement cest quand mme une ide dvolution irrversible vers les NGN qui prdomine, pousse par lvolution des offres constructeurs et les nouveaux services terme. Paradoxalement, plusieurs acteurs reconnaissent que les services envisags dans les roadmaps ne ncessitent pas forcment dans limmdiat un rseau NGN (comme le streaming). Cependant, sur les types dacteurs qui devront anticiper ou non, les rponses sont trs varies. Les constructeurs sont plusieurs penser que ce sont en premier les oprateurs de backbone IP et les nouveaux oprateurs qui devront anticiper.
226
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Les acteurs tablis auront probablement une approche de migration lente vers les NGN (elle commencera dici 1 2 ans) du fait du poids de lexistant. Leur migration sera longue (5 10 ans) et partielle et sappuiera plutt sur des solutions en transport ATM avec un ordre de migration prioritaire des nouveaux services de voix directement sur IP. Les fournisseurs de services Internet, plus globalement les acteurs de donnes IP, les oprateurs DSL et Cble et les nouveaux oprateurs entrants sont considrs comme les acteurs les plus moteurs dans la migration vers les NGN. Cependant la difficult pour eux est lie la culture mme de lacteur et sa capacit ne pas reproduire un schma connu et scurisant. Pour ces acteurs, le dploiement se fera directement sur des solutions NGN base dIP afin dassurer leur comptitivit. Lexistant des oprateurs est plutt vu comme moteur dans une migration vers les NGN. Lapproche de migration a t avant tout conomique et technique. Dans un deuxime temps, elle sera marketing. La majorit des acteurs est en phase dexprimentation ou de dploiement. Plusieurs prcisent une dure de migration sur 2 ans donc plutt rapide. Pour leur migration, les acteurs font davantage confiance aux acteurs dorigine des donnes. La migration se fait du transport en mode paquet vers le contrle, permettant ainsi louverture de nouveaux services. Les migrations faites sont plutt partielles et lobjectif est dassurer une transparence pour les utilisateurs.
Lorganisation de la cohabitation, la continuit des services, la fourniture dune qualit de service, linterconnexion et linteroprabilit sont vues comme des difficults majeures dans la cohabitation entre NGN et rseaux traditionnels.
Cest lide dune cohabitation trs longue (10 20 ans) entre rseaux NGN et traditionnels qui domine parmi les acteurs, probablement supplante nouveau par une nouvelle version des NGN. Contrairement aux avis des constructeurs, quelques oprateurs envisagent tout de mme terme la convergence des rseaux. Les pays identifis comme les plus prcurseurs dans les NGN sont europens : pays scandinaves, Grande Bretagne, et Allemagne. Hors Europe, ce sont lAsie (Japon, Chine, Core) et les USA qui arrivent en tte. La France semble globalement en retrait.
Autorit de rgulation des tlcommunications
227
5 NGN : quelles perspectives pour la rgulation ?
5.1 Introduction : tendances ressortant des entretiens et axes de rflexion
Il ressort des diffrents entretiens que pour beaucoup dacteurs, et notamment pour les oprateurs, nous abordons la problmatique rglementaire des NGN de manire trs prcoce. Souvent, la rflexion engage sur ce thme en est ses dbuts. Il en rsulte que :
Tous les acteurs nont pas souhait mettre davis sur la question. Certains acteurs listent de multiples pistes de rflexions sans ncessairement hirarchiser les priorits, ou faire une diffrence entre les problmatiques clairement associes aux NGN et celles qui sont connexes (ex. : les rseaux daccs). Lventail des sujets abords est de ce fait large. Les positions des acteurs ne sont pas encore figes. Il est par consquent possible que des problmatiques importantes soient sous-estimes ce jour. Certains acteurs souhaitent voir le rgulateur intervenir le moins possible : uniquement pour garantir un march concurrentiel.
Enfin nous soulignons le fait que certains acteurs peroivent les NGN comme une volution qui doit effacer ou attnuer le clivage actuel oprateur historique / nouveaux entrants et que la composante animation de march se renforce dans la rgulation.
Les principaux lments ayant rapport une problmatique rglementaire (ou identifis comme tels par les interviews) qui ont cits par les oprateurs et constructeurs consults sont (Cf. dtail en annexe) :
La ncessit dun cadre rglementaire cohrent garantissant le droit linterconnexion entre fournisseurs de services et fournisseurs de rseaux (ouverture), ainsi que linteroprabilit des rseaux. La demande que la rglementation favorise les investissements long terme (partage dinfrastructures, ). Une demande forte douverture de la boucle locale (dgroupage, cblages dans les immeubles, autres ) et des services sur les boucles locales. La ncessit dun cadre rglementaire transverse aux tlcommunications, lInternet et laudiovisuel, notamment concernant la rgulation des contenus, et dune acclration des processus de dcision.
A un moindre niveau, ont t mis en avant les points suivants :
La ncessit de (re)dfinir rapidement les conditions lies la fourniture de services audiovisuels et multimdia, et plus globalement lies la rgulation des contenus. Le besoin de simplification et dassouplissement de la rglementation (textes de rfrence, rgime des autorisations, cadre rglementaire technologiquement neutre).
228
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
La ncessit de redfinir certains services (acclration et largissement de la portabilit, largissement du service universel de nouveaux services, redfinition des services dinterception lgale,). La ncessit de faire voluer le catalogue dinterconnexion (vritables offres NGN, nouveaux modes de facturation, largissement aux quipements de transport et de routage ATM et/ou IP des quipements accepts en cohabitation). Une demande dimplication plus amont du rgulateur dans les activits de normalisation, au titre de coordinateur et danimateur du march. Une demande de transposition rapide des nouvelles Directives Europennes, et la ncessit dharmoniser les cadres rglementaires europens (pour les rseaux et services transnationaux).
Ces points sont enrichir avec les lments ressortant de ltude technologique qui impacteront potentiellement le rgulateur, notamment concernant lvolution des ressources de numrotation et dadressage.
Nous cherchons dans cette partie comprendre quelles seront les problmatiques lies la rgulation et la rglementation qui seront induites par larrive des NGN. Nous nous attacherons essentiellement recenser diffrents axes de rflexion possibles, sans pour autant pouvoir aujourdhui avoir la prtention dapporter les rponses associes. La rflexion sarticule autour de quatre axes :
Les acteurs qui feront les NGN, leurs positions relatives et les liens qui les unissent. Les perspectives techniques dont notamment linterfonctionnement des rseaux et plates-formes, la numrotation et les quipements terminaux. Les aspects conomiques : les diffrentes interconnexions et les flux montaires associs. Les services dintrt public dont le service universel, les services durgence et la protection des utilisateurs.
Autorit de rgulation des tlcommunications
229
5.2 Les acteurs
Nous chercherons dans cette partie comprendre les potentialits de dveloppement, et la position relative des grands types dacteurs NGN vis--vis du cadre rglementaire :
Acteurs Acteurs de de la la couche couche "services" "services"
Acteurs
"rseaux d'accs"
Localisation
Messagerie unifie
Web services
etc
Acteurs Acteurs de de la la couche couche "rseaux "rseaux de de contrle" contrle" Acteurs Acteurs de de la la couche couche "rseaux "rseaux de de transport" transport"
UMTS ADSL WLAN etc
Figure 39 : Segmentation des acteurs NGN (Source : Arcome)
5.2.1 Oprateurs de rseaux de transport et de contrle
Dans le cadre des NGN, les oprateurs sont amens sparer lacheminement pur et la couche de contrle. Dans la suite, nous sparons sur certains points les couches transport et contrle pour traiter lensemble des hypothses. Lensemble des remarques sapplique un oprateur qui oprerait sur les deux couches.
La fonction rseau de transport dans un NGN est prise en charge dans un rseau traditionnel par loprateur dinfrastructure. Ce type doprateur possderait des Media Gateways et/ou Signalling Gateways interconnectes entre elles et avec des rseaux tiers, et sappuierait sur des changes de signalisation IP avec des serveurs de contrle dappel possds par un ou plusieurs autre(s) oprateur(s).
NB : La notion doprateur de transport, au sens NGN, est plus large quau sens traditionnel. En effet, elle inclut, en complment des liaisons physiques et de linfrastructure passive de transport, les fonctions Media Gateway et Signalling Gateway, qui effectuent la conversion et lacheminement du trafic et de la signalisation sous le contrle des serveurs dappel.
La fonction rseau de contrle dans un NGN est prise en charge dans un rseau traditionnel par loprateur dinfrastructure. Ce type doprateur possderait en propre des serveurs de contrle dappel, et sappuierait sur des changes de signalisation IP avec des Media Gateways et/ou Signalling Gateways (fournissant linterconnexion avec des rseaux tiers) possds par un ou plusieurs autre(s) oprateur(s).
Partant de ce constat, deux hypothses entrent en concurrence :
Lensemble des oprateurs de rseaux peut conserver les deux fonctions dans leur activit. Cette hypothse semble la plus probable, les oprateurs de transport/transit ne souhaitant pas se sparer du contrle des communications qui reprsente un lment cl du mtier actuel dun oprateur. Des acteurs spcialiss transport et des acteurs spcialiss contrle peuvent apparatre sur le march. Si elle parat moins probable actuellement, cette hypothse ne peut toutefois tre totalement exclue.
230
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Exemples :
Un fournisseur de services pourrait ventuellement considrer la signalisation comme un service et glisser de son cur de mtier vers la couche de signalisation. Le modle de services OSA fait aussi apparatre les fonctions Service Capability Features qui, si elles sont mutualises entre plusieurs oprateurs de rseau, pourraient tre opres par un tiers (ex. : serveur de localisation). Enfin, le transit entre rseaux htrognes (prise en charge de la conversion du trafic et de la signalisation, sans prestations volues de routage) peut apparatre comme une activit part entire qui pourrait tre externalise par certains oprateurs, ou confies la maison mre dans le cadre dun groupe international.
La sparation des activits entre oprateur de transport NGN (disposant uniquement de Media Gateways et/ou de Signalling Gateways) et oprateurs de contrle NGN (disposant uniquement de serveurs de contrle dappel) ne sera vraisemblablement pas une tendance massive, mais plutt la source dactivits de niche.
Si lmergence de futurs oprateurs de transport NGN et oprateurs de contrle NGN se confirme, il sera ncessaire que le rgulateur dfinisse sils seront assimils aux actuels exploitants de rseaux ouverts au public, ou si le rgime des autorisations doit voluer pour supporter une nouvelle lecture oriente vers les NGN.
Dans lhypothse o des acteurs diffrencis existeraient bel et bien, leur nombre ainsi que lapparition de deux mtiers et de deux marchs diffrents pourraient amener le rgulateur diffrencier les oprateurs de contrle et les oprateurs de transport en leur octroyant des droits et obligations diffrents associs leurs autorisations.
5.2.1.1 Oprateurs de rseaux daccs
Comme laffirment dj certains fournisseurs de services, la mise en place dun contexte favorable lclosion des NGN passe par laccs aux abonns pour lensemble des acteurs du march (rseaux et services). Parmi les techniques dinterrogations : daccs privilgies, le dgroupage soulve nombre
Le succs du dgroupage en France ne semble pas encore acquis. Pour assurer le succs du dgroupage, certains acteurs proposent des volutions aux offres :
La proprit des derniers mtres de cuivre lintrieur des immeubles est un enjeu fort. La situation sera probablement clarifier. Le dgroupage des sous-boucles locales correspondant aux derniers mtres a t introduit en Autriche et au Royaume-Uni. Une initiative quivalente pourrait tre envisage afin de limiter les investissements des nouveaux entrants sur la boucle locale.
Autorit de rgulation des tlcommunications
231
Enfin, au-del de lADSL, les techniques trs haut dbit sur la paire de cuivre (HDSL,) sont attendues par certains acteurs. Il faudra trs probablement prendre des mesures permettant de faciliter leur apparition pour que ces dernires puissent voir le jour moyen terme.
Certains constructeurs, limage de Cisco, prvoient que lusage des technologies daccs trs haut dbit (Long Reach Ethernet, CWDM, PON, VDSL, ) accompagnera et sera un moteur de la migration vers les NGN.
Le libre accs labonn et les technologies de boucles locales haut dbit sont autant de moteurs pour lapparition des NGN. Toute action favorisant la concurrence sur le march de laccs labonn sera par consquent ressentie comme favorable lmergence des rseaux et services NGN. Toutefois, limportance que les acteurs apportent ces aspects et son degr de corrlation avec le concept de NGN ont trs certainement t amplifis par lactualit riche sur le domaine lors de la priode dinterviews.
5.2.2 Oprateurs de services
Il ressort des entretiens que les oprateurs de rseaux ne pourront continuer se positionner sur lensemble de la chane de valeur, de laccs au rseau en passant par les services. Il y aura donc, plus ou moins long terme, une ncessit pour les oprateurs de souvrir des fournisseurs de services tiers. Do des problmatiques de statut, dinterconnexion et de relations conomiques entre ces deux types dacteurs.
5.2.2.1 Statut de lacteur
Il est difficile de prvoir aujourdhui quel sera le statut dun acteur fournissant des services sur un NGN : oprateur ou fournisseur ? En effet, en fonction du service fourni, lacteur en question pourra ou non :
Etre soumis une rglementation spcifique et voir ses tarifs soumis ou non une rgulation. Bnficier des droits lis au statut doprateur : attribution de ressources en numrotation, accs au Catalogue dinterconnexion,
Plusieurs acteurs soulignent dj que linteraction entre les couches rseaux et services est encadrer de prs pour viter quun fournisseur de rseau ne se retrouve en situation de monopole de fait sur un service et rciproquement quun fournisseur de services ne se retrouve en situation de monopole sur un rseau.
Certains acteurs suggrent linstauration dun droit linterconnexion des fournisseurs de services aux oprateurs de rseaux. Cette interconnexion ne pourra pas tre dissocie dune rflexion sur la mise en uvre de modles conomiques viables pour les deux types dacteurs.
232
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
5.2.2.2 Fournisseurs de services de tlphonie
La fonction de fourniture de services de tlphonie dans un NGN est prise en charge dans un rseau traditionnel par loprateur de services tlphonie. Par ailleurs, les services de voix sur IP sont dj relativement bien dvelopps par rapport dautres services NGN envisageables.
Il sera donc ncessaire danalyser rapidement si les futurs oprateurs de services tlphoniques NGN seront assimilables aux actuels fournisseurs de service tlphonique au public, et si les droits et obligations associs au rgime dautorisations de ces oprateurs devront voluer ou tre adapts un contexte NGN. Sur certains points, il sera potentiellement utile de revoir la dfinition mme du service tlphonique de base.
En effet :
La dfinition actuelle de la ligne tlphonique perd de son sens dans un contexte de dveloppement de la voix sur IP. En cas de situation critique (panne de courant chez labonn, panne de courant dans le rseau,), il parat aujourdhui difficile de garantir le service de base via un NGN.
5.2.2.3 Fournisseurs de services data et fournisseurs de services Internet
La problmatique de lvolution du statut des fournisseurs de services Internet se pose. En effet, il est aujourdhui raisonnable de penser que le courrier lectronique sera terme un outil de communication fondamental, au mme titre que le tlphone.
Dans cette hypothse, on peut supposer que, moyen/long terme, le droit aux services Internet pourrait tre reconnu comme le droit un abonnement tlphonique aujourdhui.
Plusieurs questions se posent alors :
Le Package 2000 qui traite de communications lectroniques laisse une porte ouverte pour que les acteurs de lInternet deviennent des oprateurs de services Internet. Dans le contexte NGN, il sera possible de confondre lensemble des acteurs dans le mme concept global doprateur de communications lectroniques (utilis dans le Package 2000). Dans lhypothse o les acteurs NGN se verraient tous soumis un rgime dautorisations, ce rgime ne devra pas tre une barrire pour les acteurs cherchant entrer sur le march, sous peine de pnaliser ltablissement dune contexte concurrentiel.
Autorit de rgulation des tlcommunications
233
5.2.2.4 Fournisseurs de contenus multimdia
Aujourdhui les fournisseurs de contenus multimdia ne sont pas des oprateurs. Or, avec lapparition des NGN, certains services multimdia qui seront ventuellement amens occuper une place importante dans le partage dinformations, amneront remettre ce statut en question :
La mainmise sur des services de haute importance et qui devront tre accessibles tous pourra entraner une modification du statut des acteurs qui les fournissent. Certains services multimdia pourront figurer au sein dun package minimum accessible tous. Le statut des acteurs pourra tre modul en fonction du contenu multimdia fourni, de son importance, de son appartenance ou non un service minimum.
Le march de la fourniture de contenus multimdia recle un fort potentiel conomique. Or, il est actuellement brid par labsence de volont douverture des oprateurs de rseaux. Les droits basiques de ces acteurs sont donc dfinir rapidement : ces fournisseurs ne peuvent exister sans interconnexion un oprateur de rseau afin bien sr dchanger du trafic, mais aussi de permettre au fournisseur de services daccder des informations lies au client dtenues par loprateur de rseau.
Cette interconnexion est envisageable dans plusieurs contextes. Exemples :
Portails de services et moteurs de recherche indpendants, oprs par un fournisseur de services tiers. Kiosques et accords one-to-one avec les oprateurs de rseau. Modle semi-ferm (portail opr par loprateur de rseau avec accs privilgi aux fournisseurs de contenus rfrencs. Cf. modle de services data mobiles i-mode au Japon).
Elle devra prendre en compte bien sr les besoins dchange de trafic, mais plus globalement les besoins dchange dinformations lies au client (ex. : profil et droits daccs, localisation, caractristiques du terminal, profil utilisateur, capacits du rseau Cf. description des Service Capability Features du modle de services OSA, paragraphe 3.5.2.5.2).
Afin de dvelopper ce march, les modles les plus ouverts possibles, incluant un partage de revenus entre acteurs, seront favoriser.
5.2.2.5 Autres types de fournisseurs de services
Mme si le march na pas encore acquis la maturit ncessaire qui permettrait dimaginer tous les types de fournisseurs de services susceptibles dapparatre dans le cadre des NGN, certains peuvent dj tre identifis. Exemples :
Fournisseurs de numro personnel universel (UPT). Fournisseurs de services de portabilit (ex. : une entit indpendante grant la portabilit nationale pour un groupe doprateurs). Fournisseurs de messagerie unifie, ou de messagerie instantane. Fournisseurs dapplications (ASP) ou de services de stockage de donnes. Fournisseurs de services de commerce lectronique.
234
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Fournisseurs de services multi-rseaux (ex. : accs scuris multi-sites type VPN, offre pr-paye multi-oprateurs).
Pour plus de dtails, on pourra se rfrer au chapitre 3.5 Services .
5.2.3 Les acteurs : conclusion
Le concept de sparation des couches au sein des NGN autorise penser que plusieurs types dacteurs coexisteront : les oprateurs de boucle daccs, les oprateurs de rseaux (avec ventuellement une sparation entre oprateurs de transport et de contrle), les fournisseurs de services.
Couche Services
Service 1 (type OSA) Interfaces OSA Service Capability Servers
Service 2 (type web services)
Fournisseur de services
Couche Contrle
Bases de donnes
Serveur d'appel
Oprateur de contrle
Couche Transport
Rseau de transport
mutualis en mode paquet
=> Chapitre 3.3 SGW/MGW
SGW/ MGW SGW/MGW
Oprateur de transport
Rseau d'accs
Accs fixe
Accs sans fil
Accs mobile
Oprateur de boucle locale
Terminal
Figure 40 : Nouveaux types dacteurs dans le contexte NGN. (Source : Arcome)
Lors de lapparition de ces diffrents acteurs : Une rflexion sur le statut leur donner sera indispensable, ce dernier ayant des impacts structurants sur les droits et les devoirs de chacun envers les autres acteurs et les utilisateurs. Une rflexion particulire devra tre mene sur le traitement de la notion de marchs pertinents dans le cadre des services NGN. En fonction de ces lments, une rvision des droits et obligations associs aux rgimes dautorisations en fonction de cette situation nouvelle et du nouveau contexte rglementaire europen pourra ventuellement tre envisage.
Autorit de rgulation des tlcommunications
235
5.3 Les perspectives techniques
5.3.1 Limitation des risques lis linterconnexion ?
La mutation des rseaux de communications vers les NGN peut tre lorigine de problmes dinterfonctionnement. En effet, la multiplication des acteurs et la varit des standards ou variantes dimplmentation sera potentiellement la base dune multiplication des interfaces proposes. Dans ce contexte, plusieurs scnarii pourraient permettre dassurer un minimum dinteroprabilit entre les acteurs :
Un (ou plusieurs) standard peut apparatre de lui-mme : cette solution aurait lavantage de ne pas ncessiter dintervention, ainsi que de faire disparatre les implmentations propritaires et variantes ralises dans lattente de cette standardisation. Toutefois, le nombre des acteurs sintressant aux NGN et la diversit de leurs origines nous incitent penser quun tel consensus sera difficile trouver. Des normes sont publies sur le sujet : cette solution assurerait linterfonctionnement des architectures sur un certain nombre de points. Elle requiert lintervention dun organisme de normalisation (ETSI,). Cette intervention est aujourdhui dlicate car nous abordons le sujet de manire trs prcoce et les initiatives sont disperses travers de trs nombreux organismes (voir chapitre 4 sur la normalisation).
Lors du processus dlaboration de ces normes et standards, et ds leur stabilisation, leur diffusion est un lment essentiel de leur mise en application. A ce titre, les organismes de normalisation historiques, qui diffusent les normes de manire contrle et payante, pourraient voluer vers le mode de fonctionnement des organismes de standardisation dInternet, qui assurent une mise disposition simple et gratuite de leurs standards. Une fois les solutions dployes, se poseront les problmes lis aux tests dinteroprabilit : les procdures et jeux de tests seront certainement revoir dans ce nouveau contexte. Enfin, soulignons que si des mesures doivent tre prises pour garantir un minimum dinteroprabilit sur les NGN, il sera ventuellement intressant dharmoniser ces mesures au plan europen pour garantir une interoprabilit internationale sur certains points (CLI, IN, SMS, MMS, ).
Une intervention forte dun organisme de normalisation, en accord avec les constructeurs et les oprateurs, apparat comme le moyen le plus efficace pour rduire considrablement les risques lis linteroprabilit. Il est ce jour encore difficile de dire si les organisations telles que lIMTC, lISC et le MSForum rempliront pleinement ce rle. Une coordination de lETSI (prfrable pour le march europen) ou de lUIT semble donc indispensable, afin dassurer la coordination des initialives (notamment dans le cadre de linteroprabilit) et la diffusion des normes et standards.
236
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
5.3.2 Scurit, signature lectronique
Avec la multiplication des contenus et la ralisation de transactions de plus en plus nombreuses, dont certaines ayant un caractre officiel (juridique, administratif), la scurit de ces contenus va devenir un enjeu crucial : on prvoit un dveloppement du commerce lectronique accompagn dune augmentation du nombre de paiements en ligne. Ces aspects lis la scurit peuvent attirer diffrents types dacteurs et crer des problmatiques nouvelles :
La scurit des donnes sur un rseau pourra tre assure par loprateur de rseau ou non : la scurit ainsi que lauthentification et la certification pourront tre considres comme des services ordinaires et potentiellement fournis par des tiers : un acteur spcialis ( clearing house , fournisseur de services type Microsoft .NET Passport), une banque, Le fait de multiplier les acteurs pourra toutefois rajouter autant de failles scuritaires potentielles. Les oprateurs pourront tre considrs par les clients entreprises comme les premiers tiers capables de dtourner les donnes.
La scurit sur les rseaux NGN sera un enjeu majeur et pourra tre assure par diffrents types dacteurs. La concurrence se fera avant tout sur la capacit des acteurs rassurer le client final. Cet aspect recle par ailleurs un potentiel risque de position dominante.
5.3.3 Interceptions lgales
Les interceptions lgales seront plus difficiles oprer sur un rseau IP et plus encore sur un rseau htrogne (indpendamment du fait quil sagisse ou non dun NGN) :
Il reste dfinir auprs de qui seront opres les interceptions :
Auprs de loprateur de transport. Auprs du fournisseur de services tlphoniques.
Les conditions et moyens (les systmes et protocoles sont htrognes dans le contexte NGN) restent eux aussi dterminer. Cette contrainte est intgrer par les constructeurs et les oprateurs ds la conception des produits et rseaux.
Les interceptions lgales seront rendues plus difficiles par le contexte NGN et lhtrognit des rseaux et services, tant sur le point technique quoprationnel. Leur mise en uvre doit donc tre largement anticipe par les constructeurs, oprateurs et fournisseurs de services sur le plan technique, et par le rgulateur sur le plan oprationnel.
Autorit de rgulation des tlcommunications
237
5.3.4 Numrotation
La question de lavenir du plan de numrotation se pose de la faon suivante :
Lutilisation des numros de tlphone (E.164) est concurrence dans le rseau par celle des adresses IP. En particulier, lutilisation dadresses IPv6 prsente lavantage de rsoudre les prochains problmes de pnurie en numros, car tous les acteurs saccordent dire que les NGN risquent dtre gourmands en ressources nouvelles. Dautres formats dadressage pourront galement tre prfrs aux numros de tlphone : une adresse IP, une URL, une adresse mail, une numrotation alphanumrique, un numro ENUM (Cf. formats dadressage SIP ou H.3.2 dcrits dans le chapitre 3.4 sur la couche Contrle et problmatiques dadressage et de nommage dcrites dans le chapitre 3.7 sur les problmatiques transverses). Alors que dans un rseau traditionnel, la connaissance des numros doit tre programme dans les commutateurs des diffrents oprateurs, dans le monde IP elle est rpartie dans des serveurs DNS indpendants, ayant un fonctionnement hirarchique et coopratif.
Par ailleurs, les organismes et mthodes dattribution de ces ressources diffrent fondamentalement :
le rgulateur pour les numros E.164, lUIT (avec dlgation au RIPE) pour les numros ENUM, lICANN et le RIPE pour les noms de domaine Internet et les adresses IP.
Les procdures de traitement, laccs ou non du grand public et des entreprises ces ressources ainsi que le contrle ingal par les organismes gouvernementaux (cas des ressources IP), le niveau de prise en compte ou non de la raret de ces ressources sont autant de points de divergence. Le modle de gestion des ressources dInternet commence par ailleurs montrer ses limites en termes dindpendance et de capacit de traitement. Lutilisation dadresses de ce type sur le rseau fixe aurait toutefois le dsavantage de ne plus situer lappel ou lappelant. La question sous-jacente est de savoir si la numrotation doit continuer ou non comporter une notion de localisation gographique :
Les codes dappels ntant plus gographiques, il sera plus difficile de tarifer les appels avec une modulation gographique et dinformer le consommateur du lieu de destination de lappel et du prix de la communication. De nouveaux systmes devront tre dploys pour organiser la fourniture des services durgence associe des numros non gographiques tout en conservant la qualit vitale pour les usagers. Le financement de ces ncessaires adaptations reste trouver. Un adressage non-gographique nous obligera potentiellement gnraliser rapidement des services de localisation pour pouvoir assurer certains services basiques.
La question se pose aussi de savoir qui seront les attributaires de ces ressources : quel(s) type(s) dacteur(s), oprateur de boucle locale, (oprateur de rseau), et/ou fournisseur de services, pourront lavenir devenir attributaires des nouvelles ressources en numrotation ?
238
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Une autre problmatique autour de la numrotation concerne le concept de portabilit dans le contexte NGN :
Lutilisation de certains formats pourrait favoriser une portabilit gographique nationale non-limite un primtre rduit. La portabilit pourrait devenir un service comme un autre : Lmergence dacteurs nationaux ou internationaux, vritables oprateurs de portabilit, qui greraient des bases de donnes type DNS est envisageable. La portabilit ne sera pas obligatoirement limite au changement doprateur (comme la portabilit des numros non-gographiques). Le concept de portabilit pourra ventuellement tre tendu aux fournisseurs de services. Toutefois, il est difficile de se prononcer aujourdhui sur le fait quun tel changement soit souhaitable.
Des rponses ont dores et dj t avances pour lever les ambiguts relatives aux codes dadressage et la numrotation : ENUM et SIP qui font communiquer le monde IP et le monde de la tlphonie mais aussi des concept novateurs tel UPT.
Les NGN peuvent devenir des lments dclencheurs pour une ventuelle mutation des modes dadressage. Deux scnarii restent envisageables : la cohabitation de la numrotation actuelle et des adresses de nouvelle gnration . ou la disparition de la numrotation actuelle ( long terme) au profit dun nouveau code dadressage universel.
Plusieurs lments poussent penser que la numrotation voluera dans le futur vers des concepts non-gographiques (UPT) : lessor de la tlphonie mobile, la convergence tlphonie / IP, les services de type Centrex Une rflexion de fond du rgulateur sur ces volutions semble ncessaire rapidement. Elle doit cependant sinscrire dans un contexte global (europen, voire mondial).
5.3.5 Terminaux daccs
Lvolution des terminaux est un point important pouvant favoriser ou freiner lvolution des rseaux vers les NGN. Toutefois il existera des volutions non simultanes entre les deux marchs. Les questions de cohabitation de terminaux supportant ou non les nouveaux services avec des rseaux htrognes soulve quelques points majeurs :
La cohabitation dun ensemble de terminaux incompatibles avec les services NGN et dun ensemble de terminaux de nouvelle gnration est invitable. La concurrence entre les diffrents types de terminaux sera probablement arbitre par les utilisateurs. Il sera toutefois important de veiller ce que les capacits dun terminal utiliser certains services soient explicitement spcifies lors de lacte dachat. Il semble primordial pour en assurer le succs que les spcifications daccs dun service NGN soient publies pour que les constructeur le dsirant puissent les intgrer. Les terminaux actuels (non NGN-enabled) pourront tre amens accder aux services NGN via le RTC. Dans ce cas :
Autorit de rgulation des tlcommunications
239
Il sera difficile ds lors dassurer un service de bout en bout. Il serait intressant davertir lappelant quil appelle un terminal non NGN. Il sera juste de ne pas facturer un service NGN lorsquil ne peut tre fourni pour raison technique.
Il est important de souligner ici que la Directive R&TTE (Directive europenne 1999/5/CE) qui sapplique aux quipement terminaux (fixes et mobiles) ne comprend pas de critres lis la qualit des quipements, aux services accessibles ou au bon fonctionnement. Les exigences essentielles sont la scurit des personnes et des biens ainsi que les contraintes de compatibilit lectromagntique (mission, immunit, pollution du rseau et utilisation du spectre pour les terminaux utilisant cette ressource). De ce fait, la concurrence sur le march sera le seul fait du choix des utilisateurs au regard des quipements proposs.
Les terminaux seront un enjeu majeur de la migration vers les NGN. Toutefois les terminaux actuels devront coexister avec les rseaux et les services nouveaux. Il sera certainement bon de surveiller cette cohabitation mme si la concurrence sur ce march reposera essentiellement sur le libre choix des consommateurs.
240
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
5.4 Les perspectives conomiques
5.4.1 Facilitation des investissements
A limage des rflexions actuelles sur les MVNO dans diffrents pays europens, la question du partage des infrastructures ne manquera pas de se poser ds quun investissement lourd sera ncessaire sans certitude dutiliser pleinement ces ressources. Lexemple actuel des backbones UMTS se gnralisera trs certainement aux backbones NGN en gnral et, pourquoi pas, aux plates-formes de services. Pour faciliter les investissements, la mutualisation des plates-formes, notamment de services, est envisageable et ce deux niveaux :
La mutualisation est envisageable entre oprateurs partenaires (ex. : serveurs DNS, serveur de portabilit, serveurs de localisation, UPT, ENUM, messaging). La mutualisation est envisageable entre deux entits partageant les mmes besoins au sein dun mme oprateur. Ainsi, la mutualisation de la couche Transport (Media Gateways et Signalling Gateways + rseau de transport associ) associe plusieurs couches Contrle spcifiques par activit est aussi tout fait envisageable, et constitue mme un des intrts de larchitecture NGN.
Il faudra trs certainement laborer de nouvelles rgles pour permettre et encadrer ces mutualisations. En effet et titre dexemple, la mutualisation de certaines infrastructures (par exemple entre activits fixes et mobiles) ne devrait pas empcher la sparation comptable des activits qui est actuellement inscrite comme obligation des oprateurs dominants .
Rappelons ici que, selon les argumentaires dvelopps par les constructeurs dquipements, les NGN et ladoption de IP de bout en bout vont permettre de rduire fortement les CAPEX (grce la mutualisation et au surbooking). Cet effet sera dautant plus important dans le cas o les oprateurs pourront mutualiser leur trafic sur une mme infrastructure. Les cots et redevances associs aux autorisations (ventuellement nouvelles) seront un lment dterminant dans la dcision des acteurs entrer ou non sur le march des NGN. En effet, un cot trop lev qui rduirait trop fortement les perspectives de retour sur investissement court ou moyen terme serait dcourageant pour la majorit des acteurs. Un quilibre sera donc trouver pour permettre aux acteurs dinvestir dans les infrastructures.
Les acteurs fortement sensibiliss par des conditions de march difficiles sont la recherche de modles conomiques permettant de rentabiliser les investissements le plus rapidement possible. La mutualisation des rseaux et plates-formes de services, qui est une des solutions les plus frquemment voques, sera tudier par le rgulateur afin de soutenir un march actuellement durci, sans pour autant abolir la concurrence.
Autorit de rgulation des tlcommunications
241
5.4.2 Interconnexion
La nouvelle Directive du Parlement Europen et du Conseil relative laccs aux rseaux de communications lectroniques et aux installations associes, ainsi qu leur interconnexion souligne le fait que le secteur des communications lectroniques est caractris par dtroites relations dinterdpendance. Cette directive a t crite pour sadapter tout type de rseau, actuel ou futur, y compris les NGN, puisquelle considre entre autres les services de communication fixes et mobiles de nouvelle gnration [reposant] sur des plates-formes de fourniture ou des rseaux de transport large bande qui utilisent le Protocole Internet (IP) [] .
Il apparat clairement que le march des communications lectroniques ne sera pas suffisamment mature, lorsquil verra lmergence des NGN, pour garantir lui seul une concurrence effective et sans entrave.
Dans ces conditions, il est prvoir que laccs aux rseaux et linterconnexion seront entours de rgles sectorielles (ex ante) limitant lavantage pris par les acteurs dots dune puissance sur le march hrite du pass ou contrlant un goulot dtranglement (rseau daccs, ressource rare, ). Ces rgles seront proportionnes, adaptes la situation et limites la priode ncessaire. Il est fort probable que les NGN ne pourront voir le jour sans un cadre rglementaire favorable, qui encadrera notamment les conditions dinterconnexion entre les acteurs. Les outils de rgulation actuels accompagneront trs probablement la migration des rseaux doprateur vers le concept de NGN, mme si pour ce faire, ils devront probablement intgrer de nouveaux lments. Il est galement prvoir que, dans un second temps, lorsque les forces de ngociations entre acteurs ne seront plus hrites dun pass monopolistique, ces rgles et outils seront appels, long terme, seffacer pour laisser la place un quilibre entre acteurs dict par les seules rgles de la concurrence.
Les outils de rgulations actuels devront voluer pour intgrer les concepts NGN. Ils continueront trs probablement jouer un rle prpondrant pour garantir entre autres des conditions dinterconnexion quitables.
5.4.2.1 Interconnexion dun NGN avec un NGN
Le concept mme dinterconnexion entre NGN reste dfinir. En effet, les NGN favorisant la sparation des concepts de transport, contrle et services, il est probable que nous soyons amens parler dinterconnexions au pluriel : chaque acteur (oprateur de rseau de transport, oprateur de rseau de contrle, fournisseur de services) sinterconnectant avec ses homologues et ses partenaires. Cette interconnexion multiple pose la question du support de cette interconnexion. Sil parat probable que le support physique de linterconnexion entre deux oprateurs de rseau de transport et/ou de contrle soit un lien IP (dont le dbit reste dfinir), ce support doit tre prcis pour les autres acteurs. Dautres interfaces restent dfinir ou claircir :
Les interfaces dinterconnexion entre rseaux de transport. Les interfaces dinterconnexion entre rseaux de contrle. Les protocoles de signalisation utiliss. Les interfaces dinterconnexion entre plates-formes de la couche services.
242
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Les interfaces entre ces trois couches.
NGN 1
Couche Couche "services" "services" Couche Couche "rseaux "rseaux de de contrle" contrle" Couche Couche "rseaux "rseaux de de transport" transport"
NGN 2
Couche Couche "services" "services" Couche Couche "rseaux "rseaux de de contrle" contrle" Couche Couche "rseaux "rseaux de de transport" transport"
Figure 41 : Interconnexions verticales et horizontales au sein des NGN (source : Arcome)
Il reste galement dterminer quels seront les flux montaires associs ces interconnexions. Plusieurs modles de reversement seront mis en concurrence :
Un modle proche du peering ( la capacit) aura lavantage de respecter la philosophie IP troitement lie au concept de NGN et hrite dInternet. Un modle li au dbit aura lavantage dtre plus reprsentatif du trafic effectivement chang. Un modle la minute aura lavantage dtre prouv. Un modle au service rendu (pour la couche services) aura lavantage dtre directement reli lusage de lutilisateur final.
Les interconnexions entre acteurs au sein dune pile NGN ou entre acteurs de mme niveau sont de natures multiples. Lensemble de ces interconnexions devra tre pris en compte par le rgulateur car chacune peut mettre en pril la concurrence sur un march donn.
5.4.2.2 Interconnexion dun NGN avec un rseau traditionnel
Les interconnexions entre les rseaux NGN et les rseaux traditionnels seront courantes, notamment durant la phase de dbut de transition vers les NGN.
NGN
Couche Couche "services" "services" Couche Couche "rseaux "rseaux de de contrle" contrle" Couche Couche "rseaux "rseaux de de transport" transport"
Rseau traditionnel
Couche Couche IN IN Rseau Rseau traditionnel traditionnel
Figure 42 : Interconnexions entre un NGN et un rseau traditionnel (source : Arcome)
Le concept mme dinterconnexion entre un NGN et un rseau traditionnel sera ncessairement plus proche de ce qui est pratiqu actuellement. Il est galement probable que ces interconnexions diminueront au profit des interconnexions inter-NGN au fur et mesure de la migration des rseaux vers les NGN. Cependant, ces phases de
Autorit de rgulation des tlcommunications
243
migration pouvant se rvler trs longues, il importe den tudier soigneusement les interactions. Linterconnexion entre un NGN et un rseau traditionnel ne pourra pas techniquement sloigner de linterconnexion comme nous la concevons aujourdhui. Les rseaux commuts ne pouvant dans un premier temps saffranchir du bloc primaire numrique, il est fort probable que la passerelle entre les deux mondes se fasse en bordure du NGN et que linterconnexion ne soit pas techniquement modifie. En effet, si linterconnexion entre un NGN et un rseau traditionnel ncessite la sparation des flux de communication et des flux de signalisation, ce virage a dj t abord dans le Catalogue dinterconnexion 2002 de France Tlcom avec lintroduction de linterconnexion en mode quasi-associ. Certains risques spcifiques lis la continuit des services ne devront toutefois pas tre ngligs :
Si la communication doit tre assure de bout en bout, il en est de mme pour les liens de signalisation. Les protocoles de test des interconnexions et de la qualit des services seront potentiellement adapter ce cas particulier.
Si techniquement les choses ne sont pas amenes voluer de manire fondamentale, les reversements associs pourront eux subir des bouleversements et l encore toutes les hypothses sont plausibles.
Les interconnexions entre NGN et rseaux traditionnels seront techniquement comparables ce qui est connu aujourdhui. Les outils actuels seront donc mme de rguler ces interconnexions. Lvolution majeure potentielle concernera les reversements associs.
5.4.2.3 Colocalisation
Le concept de colocalisation sera sans doute lui aussi amen changer. Deux hypothses saffrontent :
Les acteurs interconnecteront les uns chez les autres (comme actuellement pour les rseaux voix). Les acteurs interconnecteront chez des carrier hotels spcialiss (comme actuellement pour les acteurs de lInternet).
Un des scnarii probables consisterait voir dans un premier temps les acteurs NGN sinterconnecter (avec loprateur historique) en salle de colocalisation (avec des rgles plus souples allongeant la liste des quipements admis dans cette salle et en particulier : switchs ATM, routeurs IP, ) avant de migrer vers un modle plus proche de lchange de trafic chez un acteur tiers.
La colocalisation pourra tre amene voluer vers des concepts hrits de lIP. Dans cette perspective, les acteurs mettent, dans un premier temps, une forte demande pour obtenir un droit dinstallation dquipements nouveaux (routeurs, switchs) en salle de colocalisation.
244
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
5.4.2.4 Catalogue dInterconnexion, acteurs et services concerns
Comme nous lavons indiqu plus haut, les outils actuels de rgulation du march accompagneront la mise en place des NGN et joueront probablement un rle fondamental. Au premier plan de ces outils, le Catalogue dInterconnexion (RIO Reference Interconnect Offer) devra trs probablement subir des modifications pour pouvoir sappliquer aux NGN. La liste des acteurs soumis la publication dun catalogue dinterconnexion dpend grandement du statut que lon aura donn aux diffrents acteurs (oprateur ou fournisseur de services). Quoi quil en soit, le critre dterminant restera le statut dacteur puissant au vu de ses influences sur un march donn. Les interrogations se portent donc sur les critres qui permettront de dsigner un tel acteur sur les marchs des rseaux de transport, des rseaux de contrle, des services. Une premire rflexion nous amne penser que la lecture des deux premiers marchs pourra se faire selon une grille analogue celle utilise aujourdhui : loprateur historique sera naturellement prsent sur ces marchs et continuera probablement y jouer un rle important. Il est raisonnable de penser que les NGN neffaceront pas sur ces marchs la diffrence entre loprateur historique et les nouveaux entrants, sauf si une convergence fixe/mobile soprait rapidement, ce qui pourrait favoriser lmergence de nouveaux acteurs dimportance notable sur les marchs. La premire question se posant vis--vis des services est de savoir si les acteurs doivent tre considrs comme agissant sur un seul march ou plutt comme intervenant sur plusieurs marchs spcialiss :
Dans la tlphonie. Dans lInternet. Dans le contenu multimdia et/ou la tlvision numrique. Dans les services valeur ajoute (golocalisation, ). etc
Dans les deux cas, la dsignation des acteurs puissants se basera sur la dfinition de la position dominante utilise en droit de la concurrence. De plus, on pourra avoir considrer la position dominante dun acteur sur un segment pour dterminer une position dominante connexe : un acteur dominant sur les marchs des rseaux de transport et des rseaux de contrle pourra utiliser cet avantage comme levier pour asseoir une position dominante sur le segment des services.
Autorit de rgulation des tlcommunications
245
La dfinition des acteurs soumis publication dun Catalogue dInterconnexion pourra tre revoir dans le cadre des NGN, en fonction : - des statuts qui auront t dfinis pour les diffrents acteurs et de lanalyse des marchs de services (Cf. chapitre 6.2). - de lanalyse de positions dominantes induites, notamment entre les couches Rseau et Services.
Par ailleurs, il est fort probable quavec lintroduction des NGN, de nouveaux services feront leur apparition dans le Catalogue dInterconnexion et certains concepts devront tre remanis :
Les diffrents trafics (voix, data, Internet) seront-ils toujours diffrencis ? Comment pourra-t-on effectuer cette diffrenciation ? Quelles offres sont effectivement candidates pour intgrer le catalogue dinterconnexion et pour voir leurs prix rguls ?
Couche de services : diffusion de contenu (multimdia, tlvision numrique), fourniture de services valeur ajoute (golocalisation, ) Ouverture du rseau intelligent. Interfaces SIP et/ou H.323 pour le contrle dappel aux services tiers. Interfaces OSA et/ou Parlay pour les services tiers.
Nous rappelons ici quil ne sera pas ncessaire dinclure dans le Catalogue dInterconnexion les lments qui trouveront naturellement un quilibre. De plus, il est raisonnable de penser que certains acteurs dsirant voir voluer le Catalogue dInterconnexion le feront savoir, et attireront lattention de lART pour intgrer ces points dans sa rflexion. Bien videmment, le Catalogue devra galement voluer en fonction des problmatiques de tarification que nous voquons plus haut.
Les offres dinterconnexion de rfrence devront voluer sur trois axes : les acteurs soumis publication, chacun dominant sur un des marchs NGN, les services inclure dans loffre et les cots qui devront prendre en compte les conomies ralises par les acteurs grce aux NGN.
246
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
5.5 Evolution des services dintrt gnral
Sans prtendre lexhaustivit, nous prsentons ici quelques exemples de services qui seront potentiellement repenser ou renforcer dans le cadre de la migration des rseaux et services vers les NGN.
Avec larrive des NGN, les mthodes, moyens et responsabilits pour la mise en uvre dun certain nombre de services transverses lensemble des acteurs devront tre rexamins : le service universel pourra tre ventuellement tendu de nouveaux services (e-mail,), et les services durgence et dannuaires / renseignement seront aussi potentiellement repenser. De plus, certains droits fondamentaux des utilisateurs (services durgence, protection des donnes et de la vie prive, protection des mineurs et rgulation des contenus,) seront plus difficiles assurer dans le contexte NGN. Les solutions technologiques permettant de rpondre ce problme devront tre implmentes. Par ailleurs, le dveloppement massif de la diffusion de contenus rendra plus aigus les problmatiques de rgulation des contenus et de gestion des droits dauteur.
5.5.1 Services gnraux
Le Service universel, les Services durgence et le Service dannuaire / renseignements sont amens voluer fortement court ou moyen terme. Ces volutions ne sont cependant pas spcifiquement le fait des NGN mais plutt de lvolution des services (ex. : Internet) et des usages (ex. : mobiles). Les NGN nen sont quun acclrateur ou un rvlateur.
5.5.1.1 Service universel (dont abonnement social)
Avec lmergence des NGN, certains nouveaux services pourront tre considrs comme des canaux de communications de base dans notre socit. Il faudra donc dfinir :
Quels sont les services qui devront entrer dans la notion de service universel. De nouveaux services peuvent tre candidats moyen terme, comme laccs au mail ou Internet. Si ces services seront tous fournis par loprateur historique, ou si dautres acteurs puissants seront assujettis la fourniture dun service universel, auquel cas il faudra prciser lequel de ces acteurs pourra se porter garant de la fourniture effective du service. Limpact de ces volutions ventuelles sur le mode de financement du service universel (volution des contributeurs, besoin de fonds supplmentaires pour financer dventuels nouveaux services, redistribution des financements si plusieurs acteurs contribuent la fourniture du service universel).
Autorit de rgulation des tlcommunications
247
Le primtre et les modalits dapplication du service universel seront revoir court/moyen terme en fonction de lvolution des usages et du taux de pntration des nouveaux types de services de communications lectroniques .
5.5.1.2 Services durgence
Dans le cadre dun rseau NGN, il est difficile de dterminer qui est le responsable de lacheminement des appels durgence : loprateur de rseau ou le fournisseur de services tlphoniques. Par ailleurs, les NGN peuvent potentiellement bousculer les rgles de traitement des appels. En effet, des appels manant de numros gographiques, numros nongographiques, numros mobiles, adresses IP, vont transiter sur le rseau. Dans ce contexte, les technologies actuellement utilises ne permettent pas de router lappel sur le centre durgence gographiquement le plus proche. La question nest que partiellement rsolue lorsque des services de golocalisation sont associs aux appels :
Lensemble des appels ne bnficiera pas dun tel service avant longtemps (voire jamais). La granularit de la localisation pour ces services reste dfinir. Les services durgence valeur ajoute sont-il candidats pour entrer dans le service universel ? Ex. : le 119 Allo enfance maltraite . Dans laffirmative, le mode de financement reste dfinir.
La gestion des numros durgence dans le cadre des NGN, et plus gnralement dans un contexte o le march mobile devient dominant par rapport au fixe, ncessite rapidement une analyse complte, au moins au niveau national. Cette obligation historique au sein des rseaux tlcoms devient de plus en plus difficile mettre en uvre. La rflexion pourra aboutir sur des volutions aussi bien techniques et conomiques quoprationnelles, avec des impacts consquents sur lorganisation des oprateurs et fournisseurs de services, mais aussi sur la coordination globale et lorganisation interne individuelle des diffrentes entits dEtat en charge de la fourniture des informations ncessaires (prfectures) et du traitement effectif de ces appels (pompiers, SAMU, Police, Gendarmerie, autres). Dans ce cadre, le rle de coordination des Ministres sera indispensable.
248
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
5.5.1.3 Annuaires / renseignements
La gestion des annuaires dabonns peut galement poser problme. Il sagit avant tout de redfinir le terme dabonn : est-on abonn de loprateur de rseau, de loprateur de boucle locale, et/ou du fournisseur de services (tlphoniques, autres) ? Pour quel service , associ quel renseignement ? On est ensuite amen se demander qui gre les listes dabonns NGN. Soit chaque oprateur gre ses propres abonns et publie ses annuaires, soit lannuaire peut devenir un service part entire gr sparment. Dans les deux scnarios, il faudra analyser quel(s) acteur(s) peuvent / doivent alors assurer le service de renseignements. Enfin, on sera en droit de se demander quels numros ou codes dappels composeront lannuaire du futur :
Au vu de la forte pntration des mobiles, le fixe ne peut plus tre considr comme dominant sur le mobile, et le numro mobile dun abonn lidentifie maintenant tout autant, sinon plus, que son numro fixe. Il est donc pertinent denvisager louverture de lannuaire aux numros mobiles. Les codes dappels non-gographiques (adresses IP, URL, numros ENUM, ventuelle tranches non-gographiques attribues au grand public, ) sont, moyen terme, autant de candidats lentre dans lannuaire. Les numros gographiques en perdant leur statut prpondrant risquent eux, long terme, de sortir de lannuaire.
Le nouveau service de numro personnel universel UPT dfini par lUIT (Cf. paragraphe 3.7.2.3) amne penser que linformation de numro dappel pourrait dans certains cas tre plus logiquement rattache au fournisseur de service de labonn ou labonn lui-mme (Cf. numro personnel universel UPT) qu son oprateur de boucle locale. Au vu de la multiplication et de la diversification des types de numros ou codes dappel grer, il pourrait tre opportun de crer une entit ddie grant par dlgation des oprateurs et fournisseurs de services un annuaire global, et donnant ces acteurs la visibilit sur les donnes afin quils puissent fournir le service de renseignements. Afin daider la rflexion, un tat de lart et un benchmark des solutions envisages dans les autres pays pourraient tre utiles.
5.5.2 Droits des utilisateurs
Les droits des utilisateurs ne seront pas foncirement modifis dans le cadre des NGN. Ils revtiront cependant une importance plus grande avec la gnralisation des services personnaliss et le dveloppement massif des changes dinformations entre oprateurs et fournisseurs de services.
Autorit de rgulation des tlcommunications
249
5.5.2.1 Protection des donnes et vie prive
Les NGN peuvent devenir une plate-forme technique idale pour la fourniture de nombreux services bass sur le traitement des donnes personnelles. Dans loptique o lutilisateur donne son aval un tel traitement, les questions suivantes doivent faire lobjet dun examen approfondi, au regard galement des nouvelles directives europennes :
Les ayants droit aux stockage/traitement des informations sur les utilisateurs sont dfinir. Ltendue de ce droit (traitement marketing des donnes, revente des donnes par exemple entre un oprateur et un pur fournisseur de services, dure de validit ou de premption des donnes, modalits de conservation) est prciser. Lutilisateur devra avoir connaissance de lacteur de la chane auprs duquel il pourra exercer un droit daccs et de rectification. Lanonymat de lappelant lorsque celui-ci le dsire devra pouvoir tre assur. Enfin, il faudra pouvoir vrifier que les services de golocalisation sont bien dlivrs dans le respect de la vie prive des individus (notion daccord pralable, stockage des informations, ).
5.5.2.2 Protection des mineurs
Certains contenus diffuss devront rester inaccessibles certaines tranches dges. Un tel service de protection pourra tout fait tre considr un service NGN part entire (Ex. : offre .NET Passport de Microsoft, offres de certains ISP). Un besoin dencadrement des acteurs se fera trs certainement sentir sur ce point. Les responsabilits en cas de fraude ou dchec du systme devront tre clairement dfinies pour viter les abus : trop de laxisme de la part des fournisseurs de services, attentes trop exigeantes des utilisateurs quant au niveau de performance du systme de protection Un organisme de tutelle / de contrle reste dsigner.
5.5.2.3 Qualit de service
On peut craindre que la qualit de service sur un NGN souffre de la pluralit des acteurs. En cas de dgradation, la question de lentit responsable de la qualit de service fournie au client se pose. Ainsi, plusieurs niveaux de services pourront tre diffrencis :
Le service dacheminement ou dtablissement de connexion (couches Transport et Contrle). Le service applicatif, fonction du serveur, voire du contenu vis par lutilisateur (de bout en bout, incluant la couche Service, ou au contraire ne contenant que la couche Services). Les interfaces, mthodes et critres de mesure devront tre dfinis en fonction des relations entre les diffrents acteurs (partenariat, interconnexion).
Les critres actuels et les valeurs de rfrence actuelles en terme de qualit, majoritairement hrits dun service de tlphonie, seront vraisemblablement adapter. De nouvelles mtriques pourront tre appliques pour mesurer la qualit de service, notamment concernant les flux de nature nouvelle (multimdia). Ce point est rapprocher :
250
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
De la rflexion en cours au niveau des organismes de normalisation (et de lETSI en particulier) sur la gestion de la qualit de service de bout en bout dans un rseau NGN (Cf. chapitre 3.7.5). Et de la cohabitation a priori longue entre rseaux NGN et traditionnels, qui fera quune communication de bout en bout est susceptible de traverser plusieurs rseaux, NGN ou non.
Enfin, il faudra dfinir quelle entit sera en charge de la mesure effective de la qualit de service.
5.5.3 Gestion des contenus
Face lexplosion des changes de donnes dj constate, et lessor attendu des services et contenus multimdia, les droits et obligations lis la diffusion et lchange de contenus quils soient spcifiquement NGN ou non - prendront une importance croissante.
5.5.3.1 Rgulation des contenus
La diffusion de contenu pose la question de la responsabilit des acteurs face ce contenu. Lorsque le contenu est illgal, il faudra dterminer si le responsable de sa diffusion est loprateur de rseau et/ou le fournisseur de service. Ce point dpendra notamment de la nature des relations entre les deux acteurs (ex. : modle ferm de type portail, ou modle ouvert de type Internet). Le concept de convergence complexifie galement la problmatique. En effet, diffrents flux initis par des acteurs venus dhorizons divers (tlcommunications, audiovisuel, Internet, ) vont se mlanger sur les rseaux de tlcommunications. Il deviendra de ce fait trs complexe de dterminer quels organismes auront en charge la surveillance de la bonne conduite de lensemble des acteurs, chaque organisme nayant autorit que sur un maillon de la chane.
5.5.3.2 Droits dauteur
Il est plus que probable quune partie non ngligeable du contenu qui circulera sur les NGN (contenus audio, images, vido, textes) sera soumise au rgime des droits dauteur. La question du reversement de ces droits (acteurs impliqus, modalits dexcution et de contrle) se pose donc. Il est prvoir que le rseau comportera des serveurs cache / proxy contenant des copies du contenu notamment pour garantir une bonne qualit de service lutilisateur final (diffusion de contenu vido par exemple) : le statut lgal de ces copies, notamment par rapport aux droits dauteur, sera dterminer. Sur ce point, le modle Internet a montr ses limites avec par exemple les conflits rcents lis la diffusion gratuite duvres musicales, et les difficults (impossibilits ?) de mise en place dun modle payant. Une rflexion globale du secteur des diteurs de contenus (via les communications lectroniques ou dautres mdias) est ncessaire.
Autorit de rgulation des tlcommunications
251
5.6 Conclusion : champs dactions prioritaires pour la rgulation
Une majorit dacteurs exprime lide que lART aura un rle prpondrant pour la mise en place des NGN lors de la phase de migration et galement lorsque les NGN auront atteint leur maturit, ceci en qualit de rgulateur avec un renforcement du rle danimateur et de facilitateur.
LAutorit aura loccasion dentreprendre plusieurs actions pour faciliter la mise en place des NGN :
Les constructeurs et oprateurs NGN attendent de lAutorit quelle prenne toutes les dispositions ncessaires la mise en place dun contexte favorable aux investissements long terme ; ces investissements sont ncessaires la mise en place des NGN. Le statut qui sera donn aux diffrents acteurs NGN, ainsi que les droits et obligations associs aux autorisations qui en dcoulent, devront tre prciss ds lapparition desdits acteurs. Pour cela, une rflexion amont doit tre initie au plus vite. Ce statut devra prendre en compte lmergence de nouveaux acteurs, conformment au concept de NGN, ainsi que ladaptation la nouvelle rglementation Europenne. Paralllement, des volutions pourront intervenir dans le Catalogue dInterconnexion (nouvelles offres concernes, nouveaux acteurs soumis publications, nouveaux acteurs ayants droit) et influer sur les interactions entre acteurs et les flux montaires associs.
La clarification de ces lments permettra aux acteurs du march dlaborer les nouveaux business models qui seront associs aux NGN et permettront denvisager les investissements plus sereinement. Ds la phase de mise en uvre des premiers rseaux NGN, lAutorit jouera galement un rle prpondrant dans le cadre de linterconnexion :
Linterconnexion entre les NGN et les rseaux traditionnels devra tre assure et associe un modle conomique viable et quitable pour les diffrentes parties. De nouveaux modles dinterconnexion entre NGN devront tre mis en place, conformment larchitecture NGN. LAutorit aura probablement la charge de veiller ce que linterconnexion entre les acteurs oprant des rseaux et les fournisseurs de plates-formes de services soit propose et accepte par les acteurs et puisse se faire dans des conditions techniques et conomiques optimales.
Enfin, lAutorit aura la charge de veiller ce que les services rendus aux utilisateurs, que ce soit sur les rseaux NGN, ou de manire transverse aux rseaux NGN et traditionnels, soient :
Conformes aux droits des utilisateurs et aux obligations des acteurs (qualit de service, service universel, services durgence, annuaires, protection des mineurs). Conformes la rglementation (rgulation des contenus et protection des mineurs, interceptions lgales, protection des donnes personnelles). Proposs dans des conditions optimales, que ce soit lintrieur de rseaux NGN ou entre rseaux htrognes, et que la qualit soit assure effectivement de bout en bout.
252
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Clairement identifis par rapport aux contraintes ventuelles lies aux terminaux utilisables et disponibles sur le march pour un rseau ou un service donn.
LAutorit aura tout au long du processus loccasion de jouer un rle de facilitation de la migration vers les NGN : A court et moyen terme, lAutorit pourra continuer crer un cadre favorable cette migration en menant les rflexions sur les problmatiques souleves par larrive de ces rseaux nouveaux et en adaptant les outils actuels de rgulation du march. A terme, lAutorit sera galement idalement place pour veiller la bonne qualit des services fournis, sur les NGN aussi bien que sur les rseaux traditionnels, conformment au principe de transparence technologique.
La cration et lanimation par lART dun groupe de discussion et de mise en relations des oprateurs et fournisseurs de services dans le cadre des NGN pourrait tre une initiative bien perue par rapport au rle de facilitateur identifi par les acteurs interrogs dans le cadre de ltude. LAutorit pourrait galement entreprendre une rflexion amont sur le devenir du plan de numrotation. En effet, divers lments (dominance du mobile sur le fixe, utilisation dadresses IP, mergence dIPv6, convergence voix/donnes, ) peuvent pousser penser que :
Les adresses IP, jusqu prsent rserves aux donnes (Internet), pourraient, dans le contexte VoIP, prendre le pas sur la numrotation actuelle. Lentre dans lannuaire de certains numros dappels (mobiles) et certaines adresses alphanumriques (URL, ) pourrait savrer pertinente. Les numros de tlphone pour les abonns pourraient terme perdre leur caractre gographique (portabilit nationale, services Centrex, convergence fixe/mobile).
Il semble aussi ncessaire de mener par anticipation une rflexion sur lvolution venir des services gnraux (service universel, services durgences, annuaire / renseignements). De mme que lvolution du plan de numrotation, il sagit de problmatiques transverses, connexes aux NGN (puisque lies avant tout lvolution des usages et des services) mais acclres ou rvles par lmergence de ces rseaux et services de gnration. Enfin, louverture des rseaux des fournisseurs de services tiers dans des conditions techniques et conomiques viables pour tous les acteurs est une des cls essentielles du succs du modle NGN en termes dessor du march et de la concurrence. Dans la mesure o les points de blocage constats sont plus conomiques et stratgiques que techniques (une ouverture tant envisageable ds maintenant sur certains rseaux), et o les fournisseurs de services reprsentent un potentiel de march fort, une anticipation de cette volution des relations entre acteurs pourra tre envisage par lART ds maintenant sur certains rseaux traditionnels ou dits pr-NGN , par le biais de propositions aux acteurs concerns et ventuellement une action de rgulation en cas de blocage.
Autorit de rgulation des tlcommunications
253
Afin de faciliter la prparation dun contexte technique, conomique et rglementaire favorable la mise en uvre du modle NGN, le rle danimation pourrait se traduire court terme par : La cration dun groupe de discussion et de mise en relation des oprateurs et fournisseurs de services dans le cadre des NGN. Louverture de deux sujets de rflexion amont sur lvolution du plan de numrotation, et des services gnraux (service universel, services durgences, annuaire / renseignements). Lencouragement louverture des rseaux des fournisseurs de services tiers dans des conditions techniques et conomiques viables ds maintenant, sur les rseaux actuels ou pr-NGN .
254
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
6 Conclusions : une volution mergente vers les NGN, aux multiples facettes, et anticiper
Globalement, lvolution vers les NGN reprsente encore ce jour un sujet relativement amont, notamment du point de vue des oprateurs (et dans une moindre mesure des purs fournisseurs de services). Il ressort de la prsente tude que la conjoncture actuelle influe fortement sur les positions vis--vis des NGN : les acteurs sont confronts des problmatiques de financement et de prennit, ce qui les met dans un contexte peu favorable des volutions techniques et lapparition de nouveaux business models. Cela explique une certaine frilosit des acteurs interrogs vis--vis des solutions NGN (vision oriente vers une transition douce plutt quune rvolution des rseaux et services), mais qui pourrait se dbloquer rapidement si le contexte conomique volue. A noter aussi que lvolution vers les NGN ne revt pas un caractre obligatoire, malgr lopinion exprime dans le sens contraire par certains acteurs trs engags dans les NGN.
6.1 Distribution de lintelligence en priphrie du rseau
Sur le plan technique, il est possible de dgager une dfinition regroupant des concepts communs sur lesquels tous les acteurs saccordent : un rseau NGN sera un systme tout IP , offrant des services multimdia multi-accs et multi-terminaux en sappuyant sur un rseau support mutualis haut dbit caractris par :
une architecture de cur de rseau en trois couches (Transport, Contrle, Services), un transport convergent en mode paquet (flux IP transports en IP natif, ou sur ATM en transition pour certains acteurs), et des interfaces ouvertes et normalises entre chaque couche.
Des variantes, incertitudes ou divergences techniques ont cependant t dgages :
Au niveau de la couche Transport : il est difficile destimer limportance des extensions dusage des technologies optique (WDM, commutation optique) et Ethernet en cur de rseau, la ncessit et la dure dutilisation dATM comme protocole de transport en transition vers un transport IP natif terme, dvaluer la vitesse de convergence totale de la commutation ATM vers la commutation MPLS, destimer fiablement le besoin effectif et la date de migration vers IPv6. Concernant la sparation des couches Transport et Contrle au sein du cur de rseau : les constructeurs proposent des variantes dimplmentation physique des diffrentes entits fonctionnelles (media gateways / signalling gateways, fonctions serveur dappel spcialises). Au niveau de la couche Contrle : si la convergence terme vers le protocole de contrle dappel IP multimdia SIP semble acquise a priori, il est difficile destimer la dure de cohabitation des deux gnrations de protocoles de contrle dappel et de commande de MGW, les impacts de cette invitable cohabitation en termes dinteroprabilit, et la rapidit de convergence (vers le protocole le plus proche dIP et Internet). Au niveau de la couche Services : les NGN se caractrisent par la normalisation dinterfaces ouvertes pour le dveloppement et lexcution de services
Autorit de rgulation des tlcommunications
255
indpendamment du rseau. Deux modles complmentaires se dessinent pour les services type tlcoms (modle OSA) et donnes (modle Web Services). Le modle OSA est indispensable pour la fourniture de services de tlphonie sur un rseau NGN mais il est moins mature. Le modle Web services, dj oprationnel, nest pas suffisant pour assurer le dveloppement de tous types de services. Toujours concernant les services, mais sur un plan plus qualitatif, les NGN permettront lessor des services multimdia temps rel et transactionnels haut dbit. La complexit et la diversit des nouveaux services multimdia tire le march vers le monde du logiciel (et indirectement, vers les intgrateurs). Si les technologies associes sont mres ou en passe de ltre, les usages restent cependant crer en fonction des spcificits culturelles. On peut par ailleurs anticiper une volution vers une certaine convergence fixe/mobile (nomadisme, convergence des usages). Deux points connexes aux NGN, mais fortement impactants sont aussi prendre en compte :
Le rle moteur et limpact (choix darchitecture et dingnierie de cur de rseau) des volutions des rseaux daccs fixes, mobiles et sans fil vers le haut dbit et le support de services multimdia, avec la fourniture dinterfaces convergentes ATM ou IP vers le cur de rseau. Le rle cl des terminaux de nouvelle gnration : ceux-ci apparaissent clairement comme complmentaires aux plates-formes de services pour lexcution des services multimdia. Ils auront un rle essentiel pour la migration vers les NGN de par leur complexification, leur disponibilit, la richesse et ladquation de leurs fonctionnalits, leur cot, leur vitesse de renouvellement, et linteroprabilit assure entre terminaux htrognes.
6.2 Activits de normalisation et standardisation au cur des dbats
Ces nouvelles technologies convergentes et fortement volutives font ressortir le rle essentiel de la normalisation/standardisation. En effet, louverture des rseaux et services implique lobligation dimplmenter des solutions et interfaces normalises et interoprables. De plus, la mise en uvre des NGN se traduit court terme par lapparition de variantes darchitecture et de gnrations successives de protocoles, ce qui soulve des risques dinteroprabilit et de divergence. Dans ce contexte :
Les organismes de standardisation issus dInternet (notamment lIETF) ressortent comme ayant un rle dominant dans la spcification des protocoles et briques technologiques des NGN, Les organismes de normalisation historiques (ETSI et UIT) doivent cependant prendre leur place dans ce mouvement, afin de fdrer ces initiatives, spcifier une architecture gnrale commune, assurer laccessibilit et la diffusion des normes et standards applicables, et consolider les programmes de tests dinteroprabilit. Dans un contexte dacclration des avances technologiques o les oprateurs et fournisseurs de services tendent sappuyer sur les constructeurs pour la spcification des futures solutions, un rle danimation du rgulateur en vue de coordonner les intrts et avances de lensemble des acteurs au niveau national serait bnfique.
Lun des enjeux sera de rsoudre le paradoxe dun modle de rseaux et services qui se veut ouvert, mais dont la complexit technologique peut savrer un frein la mise en uvre effective de cette ouverture, et donc au libre choix de lutilisateur final, notamment en terme de services. Cette difficult sajoute celle de ladoption de nouveaux modles conomiques qui impliqueront un bouleversement des relations entre les acteurs de lensemble du secteur des communications lectroniques.
256
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
6.3 Evolution du march
Concernant le march des constructeurs, les NGN, technologie prsente comme convergente , ne parviennent pas effacer totalement les diffrences entre les profils dacteurs data et tlcoms : ces derniers conservent malgr tout une stratgie, un positionnement, des produits et solutions, et une cible de clientle diffrents. On observe une monte des acteurs data et en particulier issus du domaine logiciel. Ces types de constructeurs deviendront probablement incontournables sur le march des solutions NGN. En complment cette analyse de premier niveau :
Peu de constructeurs disposent en propre doffres globales compltes, do la ncessit de partenariats stratgiques et technologiques entre acteurs. Un nombre important de nouveaux acteurs au profil mixte se positionnent compltement sur les NGN. On peut nanmoins douter de la prennit de ces acteurs. Des regroupements sont attendre, et il est vraisemblable qu moyen terme, les offres globales seront portes par un nombre restreint dacteurs dominants dj prsents sur le march (plus nombreux en tlcoms quen data). Les nouveaux acteurs resteraient alors positionns sur des marchs de niche, ou auraient recours des partenariats OEM avec les acteurs majeurs. Nombre dentre eux auront vraisemblablement une dure de vie temporaire. Les constructeurs sadaptent aux nouveaux besoins et exigences de leurs clients dans le cadre des NGN : des besoins accrus de prestations (conseil stratgique et financier, prestations avant-vente, intgration / interoprabilit, externalisation). Il existe aussi une certaine demande de montages avec un prime contractor jouant le rle dintgrateur pour son client.
Le march des Fournisseurs de services voluera fortement avec lessor des NGN :
Ces activits reprsentent un trs fort potentiel et des opportunits dacteurs spcialiss et de prestations dexternalisation (ASP, MVNO, Centrex, administration de rseau). Ce potentiel est encourager par des conditions conomiques et rglementaires favorables. Malgr un foisonnement initial prvisible de nouveaux petits acteurs, cette phase sera vraisemblablement suivie de regroupements pour des questions de visibilit client, ce qui lgitime le positionnement rcent des grands diteurs logiciels en qualit de fournisseurs de services NGN, et laisse prsager un rle cl des portails et agrgateurs de contenus. On peut anticiper lmergence et le rle croissant des tiers de confiance (services dauthentification, de paiement, de kiosque ou portail). La modification des relations entre acteurs rendra de plus en plus sensibles les problmatiques dinterconnexion, de redistribution des revenus et de refacturation Les services tant de plus en plus lis aux capacits nouvelles des terminaux et la visibilit commerciale tant importante, la dtention des systmes dexploitation et des logiciels applicatifs clients sera un atout majeur pour le positionnement des grands diteurs logiciels en qualit de fournisseurs de services NGN.
Autorit de rgulation des tlcommunications
257
6.4 Maturit des offres et cots associs
Les offres NGN ont actuellement une maturit contraste :
Un certain nombre de produits NGN nont pas encore atteint leur pleine maturit ou leur stabilit. Cela concerne notamment les fonctions de contrle dappel volues (accs abonn), et surtout les fonctions lies aux services (platesformes, logiciels applicatifs, mais aussi terminaux). Dans certains environnements de services (voix, multimdia temps rel), les solutions de transport IP natif semblent aussi manquer encore de la maturit ncessaire pour assurer la qualit de service adquate, ce qui orientera court terme certains acteurs vers un transport des flux IP sur ATM (voire TDM). Une attention particulire est porter aux capacits initiales des solutions de commutation NGN (qui sont encore infrieures aux solutions traditionnelles), et aux solutions transitoires sappuyant sur des protocoles propritaires ou vous disparition moyen terme. Cette maturit encore faible des solutions impliquera vraisemblablement court terme une orientation vers des solutions mono-constructeur (du moins par type dquipement NGN). Si le domaine mobile prsente des signes plus visibles dvolution vers les NGN (forte visibilit sur lvolution des terminaux et des rseaux, lUMTS tant, dans sa deuxime phase, le premier systme complet spcifi selon une architecture NGN), les premiers dploiements effectifs de solutions NGN sont constats dans le domaine des rseaux fixes (transit voix, voix sur IP, xDSL).
Les conomies financires attendues des offres NGN sont nuancer court terme :
Si moyen/long terme, une baisse forte des cots dachat des solutions NGN est prvue par tous, court terme ces montants sont fortement dpendants de lexistant de loprateur et de ses relations commerciales avec le(s) constructeur(s). Les conomies en investissement induites par les NGN ne sont effectives que pour un dploiement initial sans rseau prexistant. Concernant les cots rcurrents lis aux solutions NGN, les avis des constructeurs et des oprateurs sont en revanche moins convergents : alors que les constructeurs sont quasiment unanimes pour dire que des gains immdiats significatifs seront apports par les solutions NGN, les avis des oprateurs et fournisseurs de services sont moins enthousiastes et plus contrasts, certains mettant notamment en avant court terme des surcots indirects lis au manque de maturit de la technologie. Par ailleurs, la mise en place des quipements et services NGN impliquera des cots connexes qui pourront savrer non ngligeables dans le cas dune relle migration partir dune architecture traditionnelle.
6.5 Les diffrentes approches de migration
Les constructeurs et les oprateurs ont une vision et une analyse des NGN nettement diffrente, tant sur le plan technique quoprationnel :
De par leur implication trs en amont dans la normalisation et la R&D, les constructeurs ont indniablement une maturit plus importante que leurs clients sur les technologies et enjeux NGN. Constructeurs et oprateurs/fournisseurs de services ont des diffrences fortes de vision sur la convergence totale ou non vers les NGN, sur lchelle de temps associe, et sur les perspectives dconomies attendues de telles solutions : alors
258
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
que les constructeurs sont globalement enthousiastes et volontaristes, les oprateurs montre plutt un certain pragmatisme et de la prudence.
Notons cependant que, comme les constructeurs se calent sur leurs clients principaux, ils sont en phase avec leur cible commerciale. On ressent limportance des relations de confiance fortes, avec une certaine appropriation du discours du constructeur historique de la part de certains oprateurs. En revanche, dautres oprateurs annoncent faire plus confiance aux constructeurs data ou aux nouveaux acteurs pour leur migration future vers les NGN, ce qui prsage dun certain renouvellement du march des fournisseurs, notamment dans les activits tlcoms .
La migration vers les NGN apparat comme un processus invitable du fait de la double convergence voix/donnes/image et fixe/mobile. Elle est dj enclenche par un certain nombre dacteurs en France, en Europe et sur dautres continents, et ses impacts doivent donc tre analyss et anticips. Cependant elle sannonce longue (une chelle de temps de 10 20 ans semble raisonnable), incomplte (cohabitation invitable avec les architectures dites traditionnelles) et difficile court terme du fait de lexistence de solutions concurrentes ayant des niveaux de fonctionnalits et de maturit diffrents, et des problmatiques dinteroprabilit de bout en bout. La pertinence des solutions NGN est variable selon les types dacteurs :
Les oprateurs et fournisseurs de services pour lesquels les solutions NGN semblent les plus pertinentes sont les futurs nouveaux acteurs (non encore tablis), Les acteurs du monde des donnes souhaitant diversifier leurs activits (notamment les ISP), les oprateurs anticipant une forte croissance et/ou une diversification rapide de leurs activits (ex. : oprateurs BLR ou xDSL), les oprateurs prvoyant une forte baisse de leur trafic voix au profit du trafic donnes, et les oprateurs mobiles. Les acteurs qui semblent les plus en retrait par rapport aux solutions NGN sont ceux ayant investi fortement et rcemment dans des infrastructures de commutation voix traditionnelle TDM, et les oprateurs ayant dj un accs boucle locale bas dbit et des commutateurs daccs. A noter aussi que lvolution vers les NGN ne revt pas un caractre obligatoire, malgr lopinion exprime dans le sens contraire par certains acteurs.
Mme si les acteurs voient comme dclencheurs importants vers les NGN le dveloppement des usages et la cration de valeur (introduction de nouveaux services et marchs), les arguments immdiats mis en avant dans le cadre de la migration des oprateurs et fournisseurs de services vers les NGN sont fortement influencs par la conjoncture actuelle :
Les arguments techniques (convergence des rseaux voix et donnes, optimisation des rseaux) et conomiques (gains en cots dacquisition et de fonctionnement, avec un retour sur investissement rapide) prdominent par rapport largument marketing dvolution vers de nouveaux services multimdia, qui est fortement mis en avant par les constructeurs et qui narrivera que dans un second temps aux yeux des oprateurs. Le poids des infrastructures existantes et les problmatiques damortissement et de retour sur investissement sont au cur de leurs dcisions dvolution. Le dilemme rsoudre par les acteurs est de dvelopper loffre de services mais en prenant en compte une enveloppe globale de dpenses des clients relativement constante. Il devient ds lors essentiel dconomiser sur les cots techniques lis au rseau pour maximiser les revenus lis aux services. Ces contraintes financires sont a priori moins fortes pour les entreprises que pour le grand public, et les besoins de services des entreprises voluent plus rapidement. Les grands comptes utilisateurs pourraient donc tre moteurs pour lvolution des rseaux doprateurs vers les NGN.
Autorit de rgulation des tlcommunications
259
Enfin, notons que certains acteurs plutt positionns sur la couche Services (notamment les ISP se diversifiant vers des activits voix et les purs fournisseurs de contenus/services) considrent que leurs rseaux actuels sont dj NGN.
La mthode de migration des oprateurs vers les NGN sera a priori dautant plus longue et progressive que ces derniers sont tablis et disposent dun rseau important. La plupart des acteurs interviews saccordent dire que les oprateurs dj tablis favoriseront une migration en douceur sappuyant plutt sur un transport ATM, alors que les nouveaux oprateurs sorienteront plus rapidement vers une solution tout NGN et favoriseront les infrastructures IP natives.
6.6 Vers une mutation des relations entre acteurs
Les NGN seront loccasion dune mutation profonde des relations entre acteurs, et notamment entre oprateurs et fournisseurs de services :
Llment cl de la russite dans un contexte NGN est la matrise de la base client. Cest le point fort historique des oprateurs, mais aussi la source de lgitimit du positionnement potentiel de certains acteurs du domaine logiciel, ou fournisseurs de services et contenus. La concurrence sur les rseaux daccs reprsente encore une relle priorit court terme pour la plupart des acteurs : il y a encore des demandes fortes dvolution vers le haut dbit, dextension de loffre de dgroupage, qui seront rsoudre en relation avec des problmatiques damnagement du territoire. Cette focalisation sur les problmatiques daccs nest cependant pas uniquement lie aux NGN, et masque aussi vraisemblablement labsence actuelle douverture entre rseaux et services. La problmatique de redistribution des revenus entre acteurs est au cur de cette russite : le budget global de communications du consommateur nvoluera pas suffisamment pour viter un changement des modles de revenus et une redistribution lensemble des acteurs de la chane, jusquau fournisseur de services. Cette redistribution, moyen terme, sur la chane de la valeur (de laccs vers les services) est une tendance identifie par tous. Mais sa mise en uvre est soumise au bon vouloir des oprateurs, pour lesquels elle semble cependant invitable moyen terme afin dassurer la fidlisation long terme des clients et la prennit des revenus. Une autre difficult surmonter est de trouver le(s) mode(s) adquat(s) de valorisation des contenus, et de mettre en uvre de nouveaux modes de facturation adapts lusage des clients, le tout dans un environnement convergent voix/donnes alors que ces deux mondes mettent en uvre sur ce point des rfrentiels trs diffrents.
Louverture des services des fournisseurs tiers soulve des problmatiques techniques, oprationnelles, stratgiques et conomiques varies :
De nouveaux modles conomiques sont trouver. Le modle ferm de type pas de porte / portail est envisageable, mais sera-t-il suffisant ? Lapplicabilit des modles ouverts de type kiosque est valuer en relation avec la difficult valoriser les nouveaux services. Un reversement en fonction du trafic gnr serait le modle le plus simple apprhender mais cest un sujet encore soigneusement vit par les oprateurs. Le march voluera donc vraisemblablement vers des modles conomiques combins. En parallle ces modles, la facturation directe par les fournisseurs de services pourra tre combine la facturation des oprateurs pour compte de tiers.
260
Etude NGN Next Generation Networks / septembre 2002
Les impacts de ces nouveaux partenariats sur les systmes dinformation (facturation, provisioning, automatisation des process, micro-paiements, reversements, tiers de confiance, relation clients, gestion des partenaires, interconnexion) sont une difficult sous-estime au niveau technique (et un thme faiblement trait dans la normalisation) comme au niveau conomique et oprationnel. On constate cependant un diffrentiel important entre la vision thorique de partage des rles dans le cadre des NGN, et la ralit : les acteurs tablis (oprateurs) prnent ce modle ouvert sur le principe, mais dans les faits ils dmontrent encore ce jour un certain attentisme et un protectionnisme qui laisse prsager des difficults de mise en uvre. Or, les oprateurs ont de fait la mainmise sur le devenir de lensemble des acteurs, notamment les fournisseurs de services et de contenus. Louverture des rseaux aux fournisseurs de services tiers semble donc plus tre un problme de volont et de business model plutt quun frein technique. Cest pourquoi le rgulateur pourrait sattacher favoriser ds maintenant cette ouverture, sans attendre forcment la mise en uvre des interfaces normalises multi-rseaux (ex. : dans le mobile, le service kiosque SMS en cours dlaboration par les trois oprateurs franais est un dbut douverture).
6.7 Chantiers dvolution pour la rgulation
Lvolution des acteurs vers les NGN bouleversera le panorama technique et conomique des communications lectroniques, et influera invitablement sur la nature et les modalits de ralisation des missions de la rgulation. Les diffrents acteurs ne voient pas pour la rgulation un rle interventionniste fort, mais plutt un renforcement du rle danimation de la rflexion (groupes de travail) et de la participation dans les activits de normalisation, dans un but de surveillance du march et de facilitation dune convergence ncessaire vers des architectures et protocoles unifis. Il est demand la rgulation de mettre en place un contexte technique et conomique favorable aux NGN, avec notamment :
La demande forte dun cadre rglementaire technologiquement neutre, laissant les acteurs libres de leurs choix, conformment au nouveau cadre rglementaire europen. A court terme, la rsolution des difficults actuelles, notamment concernant le dgroupage de la boucle locale et lvolution vers des offres daccs haut dbit. La mise en uvre dun cadre rglementaire favorisant les investissements long terme des acteurs, ainsi que le partage des infrastructures au sens large (entre acteurs et entre activits dun mme acteur).
Les acteurs demandent que les adaptations du contexte rglementaire aux NGN soient avant tout guides par les demandes du march. Il est donc demand, plus quune anticipation, une forte ractivit de la rgulation et une approche oprationnelle forte. Ces besoins dadaptations du contexte rglementaire doivent donc tre, sinon anticips, du moins prpars par la ralisation dtudes et/ou le montage de groupes de travail.
Autorit de rgulation des tlcommunications
261
Plusieurs chantiers dvolution pour la rglementation et la rgulation ont t identifis au cours de cette tude :
Sur le plan de la rglementation :
La transposition rapide des ( package 2000 ) en France.
nouvelles
directives
europennes
La dfinition du statut des futurs diffrents acteurs NGN, notamment les fournisseurs de services, et des droits et obligations associs (notamment les rgimes dautorisation et conditions dinterconnexion). Lvolution prvoir de la surveillance du march, avec une attention particulire porter la problmatique de la qualit de service (au sein dun rseau IP, et de bout en bout), qui est identifie comme un risque important et un point manquant de maturit. Un rle renforc danimation du march et de facilitation des discussions techniques et oprationnelles.
Sur le plan de la rgulation :
Sur le plan de la veille, en prparation une ventuelle volution du cadre rglementaire et de la rgulation :
Une rflexion de fond sur lvolution des ressources et mcanismes de gestion de la numrotation, du nommage et de ladressage au sein des rseaux NGN (volution vers IP). Lvolution ncessaire de certains services gnraux pour prendre en compte un environnement convergent voix/donnes et fixe/mobile, comme la portabilit, les services durgence (en relation avec les problmatiques de golocalisation) le primtre et la dfinition technique des services de base , linterception lgale. Lvolution de linterconnexion des rseaux, services et systmes dinformation, qui soulve des problmatiques de normalisation dinterfaces, dinteroprabilit et de volont stratgique des acteurs pour ouvrir leurs rseaux des partenaires. Il semble opportun, dans lobjectif de prparer un paysage allant dans le sens des NGN, dencourager activement ds maintenant louverture des rseaux doprateurs aux fournisseurs de services tiers, que ce soit dans le cadre des rseaux et services mobiles (ex. : GPRS) ou fixes.
La migration vers les NGN apparat comme un processus invitable du fait de la convergence voix/donnes/image et fixe/mobile. Elle est dj enclenche par un certain nombre dacteurs en France, en Europe et sur dautres continents, et ses impacts doivent donc tre analyss et anticips. Cependant elle sannonce longue (une chelle de temps de 10 20 ans semble raisonnable), incomplte (cohabitation invitable avec les architectures dites traditionnelles) et difficile court terme du fait de lexistence de solutions concurrentes ayant des niveaux de fonctionnalits et de maturit diffrents, et des problmatiques dinteroprabilit de bout en bout.
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Reseaux CiscoDocument21 pagesLes Reseaux CiscoisimgPas encore d'évaluation
- ( Astuces-Top - Blogspot.com ) Livre #160 PDFDocument326 pages( Astuces-Top - Blogspot.com ) Livre #160 PDFHM TalbiPas encore d'évaluation
- Ebook LinkedInDocument67 pagesEbook LinkedInHafsa Madi100% (2)
- Réseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsD'EverandRéseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsPas encore d'évaluation
- Schéma Directeur de La Transformation DigitaleDocument151 pagesSchéma Directeur de La Transformation DigitaleChérif DiopPas encore d'évaluation
- Pyramide Du CIMDocument2 pagesPyramide Du CIMlesocrate100% (2)
- UMTSDocument30 pagesUMTSYAHIAPas encore d'évaluation
- Conception de Base de DonneeDocument270 pagesConception de Base de Donneeapi-3834465100% (12)
- Etude de La Planification Radio D'un Réseau Umts PDFDocument102 pagesEtude de La Planification Radio D'un Réseau Umts PDFMed Amine CherifPas encore d'évaluation
- NGNDocument17 pagesNGNIOmaro IRamou100% (1)
- Conception Et Réalisation D'un Réseau Social DistribuéDocument57 pagesConception Et Réalisation D'un Réseau Social DistribuéDjadja67% (3)
- Mémoire: Enjeux, Mutations Et Évolutions Du Tourisme À L'ère Du NumériqueDocument68 pagesMémoire: Enjeux, Mutations Et Évolutions Du Tourisme À L'ère Du Numériquesarah-hans-559981% (16)
- Chapitre 3 Reseaux Sans FilsDocument8 pagesChapitre 3 Reseaux Sans Filsamc237groupPas encore d'évaluation
- Ch6 Reseaux Mobiles AvancesDocument57 pagesCh6 Reseaux Mobiles Avanceskonan franckPas encore d'évaluation
- L Es Réseaux G SM, 3GDocument26 pagesL Es Réseaux G SM, 3GAnisDamakPas encore d'évaluation
- Etude Et Ingénierie Des Réseaux L3 Télécoms v2Document1 pageEtude Et Ingénierie Des Réseaux L3 Télécoms v2Voundai Mahamat ValamdouPas encore d'évaluation
- Réseaux Nouvelles Générations: Chapitre 2: Transport Mpls Dans NGNDocument47 pagesRéseaux Nouvelles Générations: Chapitre 2: Transport Mpls Dans NGNbelhadj asmaPas encore d'évaluation
- Matière-Téléphonie - Chapitre 1Document13 pagesMatière-Téléphonie - Chapitre 1Noureddine BougreaPas encore d'évaluation
- Les Réseaux Sans Fils - Concepts de Base - Jinene - MoslahDocument20 pagesLes Réseaux Sans Fils - Concepts de Base - Jinene - MoslahRihème LarbiPas encore d'évaluation
- Antenne de GPSDocument14 pagesAntenne de GPSyousfi ferielPas encore d'évaluation
- Mini Projet RNCDocument3 pagesMini Projet RNCsamiahosniPas encore d'évaluation
- Un Reseau Sans FilDocument6 pagesUn Reseau Sans FilSouad BoukaPas encore d'évaluation
- Transmission MPLS Sur WDM, SDH - Chap - 0Document25 pagesTransmission MPLS Sur WDM, SDH - Chap - 0ludovic vedrinePas encore d'évaluation
- CH1 Rappels Des Concepts de BaseDocument67 pagesCH1 Rappels Des Concepts de BaseJoy NessPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Introduction NGNDocument68 pagesChapitre 1 Introduction NGNSelmi Wissem75% (4)
- PFE Hamza ImenDocument90 pagesPFE Hamza ImenOmar SouleyPas encore d'évaluation
- Modulation GSM UMTSDocument20 pagesModulation GSM UMTSMathieu BolléPas encore d'évaluation
- 2745497chaine PDFDocument5 pages2745497chaine PDFEssadik BoukhraisPas encore d'évaluation
- Groupe Sotel Tchad, SADocument12 pagesGroupe Sotel Tchad, SABUSINESS FIFTY100% (1)
- Chapitre II Etude Des Équipements Utilisés en FH: 1. PréambuleDocument13 pagesChapitre II Etude Des Équipements Utilisés en FH: 1. PréambulearsenebessePas encore d'évaluation
- Technique D'accesDocument62 pagesTechnique D'accesKarim HachimPas encore d'évaluation
- Réseaux (05) Glossaire Reseau Et Telecom (WWW - Mayasse.co - CC)Document40 pagesRéseaux (05) Glossaire Reseau Et Telecom (WWW - Mayasse.co - CC)dammakhajer100% (1)
- Devoir de Maison 1 - Chaine de Transmission Numerique - ITMA-IRT3-2023-2024Document3 pagesDevoir de Maison 1 - Chaine de Transmission Numerique - ITMA-IRT3-2023-2024cisseaforePas encore d'évaluation
- DT IntrodutionDocument7 pagesDT IntrodutionN'guessan Dominique KouassiPas encore d'évaluation
- Najla Migration Des Réseaux Traditionnelles Vers Les Réseaux NGNDocument111 pagesNajla Migration Des Réseaux Traditionnelles Vers Les Réseaux NGNAnwer MezriguiPas encore d'évaluation
- Evolution 2G 3G PDFDocument94 pagesEvolution 2G 3G PDFAbderrahmen Abderrahmen100% (1)
- Fracture Numérique Entre Les Zones Rurales Et UrbainesDocument20 pagesFracture Numérique Entre Les Zones Rurales Et UrbainesAicha El Armani100% (1)
- Faisceaux Hertziens PDFDocument71 pagesFaisceaux Hertziens PDFK OuertaniPas encore d'évaluation
- AdHoc Presentation PDFDocument23 pagesAdHoc Presentation PDFBshAekPas encore d'évaluation
- Réseau Sans Fil CHAP1Document41 pagesRéseau Sans Fil CHAP1MYMYPas encore d'évaluation
- Telephonie Mobile 3g Et 4g Expliquees 1123 Mzriaj PDFDocument4 pagesTelephonie Mobile 3g Et 4g Expliquees 1123 Mzriaj PDFLemortPas encore d'évaluation
- Support-Mooc-Semaine1A3 1Document41 pagesSupport-Mooc-Semaine1A3 1Firas Ben BelgacemPas encore d'évaluation
- These Abdellatif BERKATDocument180 pagesThese Abdellatif BERKATmaamriaPas encore d'évaluation
- Le Réseau GPRSDocument9 pagesLe Réseau GPRSmarikoh diakitePas encore d'évaluation
- French ORA000003 CDMA2000 Principle WLL ISSUE4.1Document87 pagesFrench ORA000003 CDMA2000 Principle WLL ISSUE4.1Mensah Bruno100% (2)
- 3G4GDocument152 pages3G4GMouhammed Nizar KacemPas encore d'évaluation
- Configuring Dynamic and Static NATDocument7 pagesConfiguring Dynamic and Static NATtest testPas encore d'évaluation
- Etude Des Mécanismes de Localisation Dans Les Réseaux de Capteurs Sans FilDocument84 pagesEtude Des Mécanismes de Localisation Dans Les Réseaux de Capteurs Sans Filyepmou beaujolaisPas encore d'évaluation
- RL AElleuchDocument53 pagesRL AElleuchraedkit100% (2)
- M Ele - Sy.te 2021 15Document101 pagesM Ele - Sy.te 2021 15Christ Meteo100% (1)
- BDL TDMA CDMA OFDMA 4pDocument31 pagesBDL TDMA CDMA OFDMA 4pTarik BourrouhouPas encore d'évaluation
- Etude Et Caractérisation de La Commutation OptiqueDocument94 pagesEtude Et Caractérisation de La Commutation Optiquehakim1348Pas encore d'évaluation
- CHAPITRE 3 Réseaux Sans FilsDocument5 pagesCHAPITRE 3 Réseaux Sans FilsThierry BoumdaPas encore d'évaluation
- Les Accès Boucles Locale RadioDocument31 pagesLes Accès Boucles Locale Radioemmanuel danra10Pas encore d'évaluation
- Introduction WiMAX N PDFDocument21 pagesIntroduction WiMAX N PDFSonia REZKPas encore d'évaluation
- Techniques - Et - Supports - de - Transmissions - Chapitre9-Elements de Base Dune Communcation Par SatelliteDocument26 pagesTechniques - Et - Supports - de - Transmissions - Chapitre9-Elements de Base Dune Communcation Par SatelliteClaude NyamsiPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument8 pagesIntroductionFranck SimeniPas encore d'évaluation
- Your DocumentDocument209 pagesYour DocumentEtienne SelemaniPas encore d'évaluation
- Document Fratel Couverture Et Qualité de Service Mobiles PDFDocument36 pagesDocument Fratel Couverture Et Qualité de Service Mobiles PDFlaouali Chaibou100% (1)
- Pfe Allou Lydia ImeneDocument128 pagesPfe Allou Lydia ImeneJil MayPas encore d'évaluation
- Majda Athmani - Ali Goumanneh Darar Soutenu Le 17 Juin 2016 Devant Le Jury: MR - Ahiod Belaïd Professeur À La FSR EncadrantDocument55 pagesMajda Athmani - Ali Goumanneh Darar Soutenu Le 17 Juin 2016 Devant Le Jury: MR - Ahiod Belaïd Professeur À La FSR EncadrantadilPas encore d'évaluation
- Rapport PFA Version 5 0 1 2Document45 pagesRapport PFA Version 5 0 1 2benkhadheryassine58Pas encore d'évaluation
- EESS - Gestion Des Cles PubliquesDocument96 pagesEESS - Gestion Des Cles PubliquesTampolla SergePas encore d'évaluation
- Feuilletage 1612Document23 pagesFeuilletage 1612Aladin AladinPas encore d'évaluation
- Le Développement WebDocument2 pagesLe Développement WebMeryem MalakPas encore d'évaluation
- Explorez Le Web Avec Google ChromeDocument13 pagesExplorez Le Web Avec Google ChromelegendneverdieprobestPas encore d'évaluation
- Concevez Votre Site Web Avec PHP Et MySQL (WWW - Worldmediafiles.com)Document418 pagesConcevez Votre Site Web Avec PHP Et MySQL (WWW - Worldmediafiles.com)penuel pahuniPas encore d'évaluation
- AutomatiqueDocument56 pagesAutomatiqueAmadouMalickMouamfonMoumbagnaPas encore d'évaluation
- Projet Administration Avancée Sous Unix - YvesLoloTOULASSIDocument76 pagesProjet Administration Avancée Sous Unix - YvesLoloTOULASSITOULASSI-ANANI Yves LoloPas encore d'évaluation
- Serveur Messagerie Sous Linux: en Master Génie Logiciel Pour Cloud Module J2EDocument87 pagesServeur Messagerie Sous Linux: en Master Génie Logiciel Pour Cloud Module J2EZineb HajariPas encore d'évaluation
- Oracle TuxedoDocument7 pagesOracle TuxedoTed KoffiPas encore d'évaluation
- Formulaire Sponsor Foire Edition 2Document3 pagesFormulaire Sponsor Foire Edition 2jul123456Pas encore d'évaluation
- Glo-3004 H17 20501Document10 pagesGlo-3004 H17 20501Jorge D. NontolPas encore d'évaluation
- Cours HTML CssDocument47 pagesCours HTML CssGeorges AbiadPas encore d'évaluation
- Sns FR SMC Guide D Administration v2.8.1Document121 pagesSns FR SMC Guide D Administration v2.8.1Denis OuPas encore d'évaluation
- M3C5 - Comment Optimiser Un Contenu Pour Le Référencement NaturelDocument22 pagesM3C5 - Comment Optimiser Un Contenu Pour Le Référencement NaturelYvonnig GuéganPas encore d'évaluation
- Gnangbo Serge Ephrem: 20 Ans - Célibataire - IvoirienDocument1 pageGnangbo Serge Ephrem: 20 Ans - Célibataire - IvoirienSerge Ephrem AKEPas encore d'évaluation
- Stratégies D'affaires ÉlectroniquesDocument1 pageStratégies D'affaires ÉlectroniquesliliPas encore d'évaluation
- Chat GPTDocument2 pagesChat GPTroujda52Pas encore d'évaluation
- Architecture Du SiDocument8 pagesArchitecture Du SiZahira JbiraPas encore d'évaluation
- Comment Espionner Un Compte Whatsapp en 5 Minute AfdehcfdddDocument5 pagesComment Espionner Un Compte Whatsapp en 5 Minute AfdehcfdddhxsjjshqiwjxbqkjwPas encore d'évaluation
- Info Capes Epreuveopt1 2000 WWW - Tunisie-Etudes - InfoDocument7 pagesInfo Capes Epreuveopt1 2000 WWW - Tunisie-Etudes - Infolailaguergueb1993Pas encore d'évaluation
- Modules Riadh HajjiDocument9 pagesModules Riadh HajjiWrida Chermiti Ep HajjiPas encore d'évaluation
- FirebaseDocument17 pagesFirebasearonnePas encore d'évaluation
- Quizz Plagiat Et Paraphrase Etudiants 2022 2023Document41 pagesQuizz Plagiat Et Paraphrase Etudiants 2022 2023Taha Yacine DribinePas encore d'évaluation
- Cours D2.2 - FinDocument6 pagesCours D2.2 - Finmiso kimPas encore d'évaluation
- Tech de Web CH4 JavascriptDocument23 pagesTech de Web CH4 JavascriptABDELMOGHIT AKHATARPas encore d'évaluation
- DemoDocument13 pagesDemoAba dialloPas encore d'évaluation
- Industrie 40 Industrie ProcessDocument42 pagesIndustrie 40 Industrie Processmessaoud amiarPas encore d'évaluation
- Cours de Gestion Tresorerie - PolycopeDocument50 pagesCours de Gestion Tresorerie - PolycopelebesguesPas encore d'évaluation