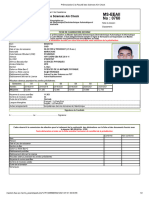Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Document PDF
Document PDF
Transféré par
Oaj YassineTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Document PDF
Document PDF
Transféré par
Oaj YassineDroits d'auteur :
Formats disponibles
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
MISE EN PLACE DU TABLEAU DE
BORD DE GESTION DE LA
FACTURATION RECOUVREMENT :
MEDI TELECOM
Prsent par :
M. OUASS Mohamed
Encadr par :
M. Med BOUMESMAR
Expert Comptable DPLE,
Professeur lISCAE
1
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
REMERCIEMENTS
Entamer une formation suprieure aprs une rupture de quatre ans est
une aventure tentante, fastidieuse mais plaisante.
Tentante car retrouver ltudiant que nous tions est un moment privilgi
avec soi-mme ;
Fastidieuse parce que les contraintes familiales et professionnelles sont
toujours les mmes ;
Plaisante puisquau bout du chemin, on dcouvre que nous ne sommes plus
les mmes.
Un grand Merci lISCAE qui a rendu laventure possible, au corps
professoral, spcialement M.Boumesmar qui a bien accept lencadrement de
ce travail, lassistante du Mastre Mlle. Rhaiti qui a toujours l pour nous
prodiguer assistance et aide, sans oublier mes camarades du mastre qui ont
su rendre laventure agrable.
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
EXECUTIVE SUMMARY...................................................................................................... 5
INTRODUCTION :.................................................................................................................. 7
PARTIE I : FINALITE DES TABLEAUX DE BORD ET DIAGNOSTIC DU
SYSTEME ACTUEL ............................................................................................................. 12
CHAPITRE I : FINALITES ET OBJECTIFS DES TABLEAUX DE BORD ........................................... 12
Section 1 : Contrle de gestion et ractivit .................................................................... 12
Section 2 : Les tableaux de bord, outil du contrle de gestion ........................................ 14
Section 3 : Les fonctionnalits des tableaux de bord ...................................................... 18
Section 4 : Les pralables de la mise en uvre des tableaux de bord ............................ 19
4.1 :Un systme dinformation adapt ......................................................................... 19
4.2 :Une structure organisationnelle adapte ............................................................... 20
4.3 :Un systme dobjectifs adapt ............................................................................. 21
4.4 :Une implication de tous les intervenants .............................................................. 22
Section 5 : Dmarche de mise en place des tableaux de bord ........................................ 22
CHAPITRE II : DIAGNOSTIC DU SYSTEME ACTUEL .................................................................. 24
Section 1 : Prsentation de Mdi Telecom...................................................................... 24
Section 2 : Prsentation de la DGC et du Dpartement Facturation-Recouvrement.... 26
Section 3 : Diagnostic du Processus Facturation........................................................... 28
Section 3 : Diagnostic du Processus Facturation........................................................... 29
3.1- Cartographie du processus Facturation :............................................................... 29
3.2 : Flux informationnels du processus Facturation ................................................... 33
3.3- Reporting du processus Facturation :.................................................................... 33
3.4 : Conclusion diagnostic : ........................................................................................ 34
Section 4 : Diagnostic du Processus Recouvrement ....................................................... 35
A: Processus Recouvrement-Encaissement : ............................................................... 35
A.1 : Cartographie du Processus Gestion des encaissements : ................................ 35
A.2 : Flux informationnels du Processus Gestion des encaissements:..................... 41
A.3 : Reporting du processus Gestion des encaissements :...................................... 41
A.4 : Conclusion diagnostic : ................................................................................... 41
B. :Processus Recouvrement-Relance :........................................................................ 42
B.1 : Cartographie du Processus Relance des factures impayes : .......................... 42
B.2 : Flux informationnels du Processus Relance des factures impayes:............... 49
B.3 : Reporting du Processus Relance des factures impayes: ................................ 49
B.4 : Conclusion diagnostic : ................................................................................... 50
Section 5 : Conclusion du Chapitre II............................................................................. 51
PARTIE II : MISE EN PLACE DU TABLEAU DE BORD DE GESTION DE LA
FACTURATION RECOUVREMENT ................................................................................ 54
CHAPITRE 1 : ANALYSE DES BESOINS DES UTILISATEURS ..................................................... 54
Section 1 : Dpartement Facturation Recouvrement...................................................... 55
Section 2 : Processus Facturation : ............................................................................... 55
Section 3 : Processus Gestion des encaissements :........................................................ 56
Section 4 : Processus de Relance des factures impays................................................... 57
CHAPITRE 2 : ACTIVITES CRITIQUES A CONTROLER ............................................................... 57
Section 1 : Processus de facturation ................................................................................ 58
Section 2 : Processus de Gestion des encaissement......................................................... 58
Section 3 : Processus de Relance des factures impayes................................................. 59
CHAPITRE 3 : DETERMINATION DES INDICATEURS ................................................................. 59
Section 1 : Indicateurs de performance ........................................................................... 60
3
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
1.1
:Processus Facturation...................................................................................... 60
1.2
:Processus Gestion des encaissements : ........................................................... 61
1.3
:Processus Relance des factures impayes :..................................................... 61
Section 2 : Indicateurs de pilotage : ................................................................................ 61
Section 3 : Indicateurs dclairage :................................................................................ 63
CHAPITRE 4 : STRUCTURE DU TABLEAU DE BORD DE GESTION ............................................. 63
Section 1 : Structure logique du Tableau de Bord de gestion.................................... 63
Section 2 : Structure physique du Tableau de Bord de gestion ...................................... 68
CONCLUSION GENERALE : ............................................................................................. 70
BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES : .................................................................................... 72
LISTE DES ANNEXES : ...................................................................................................... 74
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Executive Summary
A partir du constat de la dimension rductrice accorde linformation de
gestion quon utilisait essentiellement pour la justification des ralisations.
Nous avons proposer la mise en place dun Tableau de Bord de Gestion de la
Facturation Recouvrement, pour donner linformation de gestion une nouvelle
dimension en tant quoutil de suivi des activits et de recherche de performance.
En effet, le Tableau de Bord en tant que systme dinformation lger, rapide,
synthtique et en phase avec le dcoupage organisationnel, permet daugmenter
la valeur ajoute de linformation de gestion et de la mettre au profit de la
ractivit de lentreprise et de la motivation de ses acteurs.
Pour mettre en place le Tableau de Bord de Gestion, nous avons adopt
une dmarche structure inspire de la mthode JANUS.
Comme pralable la mise en uvre, nous avons, travers un diagnostic,
tablit une cartographie des processus de la Facturation Recouvrement, que nous
avons dlimit puis dcrit en inventoriant les activits, les acteurs, les outils
supports et les flux dinformation, puis nous avons formalis les processus
laide de diagrammes de flux. Ce diagnostic nous a permis de mettre en relief
les activits critiques qui feront lobjet dindicateurs de suivi.
En nous basant sur notre diagnostic, nous sommes alls vers les
utilisateurs afin danalyser leurs besoins de suivi des activits. A partir de ces
besoins, et par une rflexion collective impliquant tous les utilisateurs, nous
avons dgager des indicateurs de performance proches des activits, des
indicateurs de pilotage plus synthtiques et traduisant une performance globale,
et enfin des indicateurs dclairage dpendants dactivits externes mais ayant
un impact sur les processus tudis.
Cette batterie dindicateurs a constitu la base de la structure de notre
Tableau de Bord de Gestion, dont a dvelopp le ct logique (structure logique)
travers la mise en place de rgles de gestion, dune codification et dune
5
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
documentation par des fiches dindicateurs. La structure physique a fait elle
aussi lobjet dune standardisation : diffrents niveaux de prsentation (premire
page indicateurs de pilotage et dclairage, pages suivantes indicateurs de
performance par processus), prsentation standardise faisant appel au calcul des
carts en pourcentage par aux objectifs et aux ralisations historiques, utilisation
des couleurs pour la mise en valeur des carts.
Notre choix du Tableau de Bord comme rponse notre problmatique de
gestion se justifie par les nombreuses vertus de cet outil de Contrle de Gestion,
par la rapidit de mise en place, et par la possibilit quil offre de se greffer sur
un outil plus global couvrant la totalit des processus de lentreprise notamment
un systme de Tableaux de Bord stratgiques, tel que le Balanced Scorecard.
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Introduction :
Mdi Telecom est le premier oprateur de tlcommunications priv
marocain et ce depuis avril 1999 date dobtention de la deuxime licence GSM.
En Juillet 2005, Mdi Telecom a franchi une nouvelle tape en obtenant la
deuxime licence du fixe ce qui fait de lui le premier oprateur global priv.
Le tour de table de Mdi Telecom est compos doprateurs de tlphonie
europens : Telefonica (32,18%) et Portugal Telecom (32,18%), ainsi que de
holdings marocains : BMCE Bank (18,06%), HOLDCO (9,93%) et la CDG
(7,66%). Le fait que les actionnaires majoritaires de Mdi Telecom soient des
oprateurs leur tour, lui confre un atout stratgique dans un march aussi
spcifique et exigeant que celui des tlcoms.
Le march marocain des tlcommunications est caractris par de
multiples changements issus des tendances technologiques mondiales et des
efforts de mise niveau rglementaire dploys par le rgulateur national ANRT
(Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications).
Le march mondial des tlcommunications a connu, pendant la dernire
dcade, une profusion des nouvelles technologies tant au niveau des standards
(GPRS, UMTS) que au niveau des supports (VoIP, Wi-FI, Wi-Max). Ce
dveloppement technologique fait quon va vers plus de convergence au niveau
du support (Utilisation de lIP pour le transport de la voix) et au niveau du
contenu (Navigation Internet partir dun portable). Les constructeurs,
quipementiers et aussi les rgulateurs dont lUIT (Union International des
tlcommunications) suivent ce progrs, en dveloppant de nouveaux terminaux ;
et en allant vers plus de drgulation des marchs : Introduction du concept de
mobilit restreinte, obligation de dgroupage des infrastructures des oprateurs
historiques.
Le Maroc, en tant que membre de lUIT, a introduit ses recommandations.
Une licence de mobilit restreinte a t vendue dans le cadre de la deuxime
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
licence du fixe, des nouvelles technologies telles que lADSL ou encore le WiMax ont t introduites sur le march marocain.
Ce progrs technologique et rglementaire est la fois une rsultante et
une cause dun comportement client beaucoup plus exigeant. En effet, on assiste
lmergence dun consommateur de plus en plus exigeant, cherchant plus de
mobilit (1) et plus de potentialits de communication ; travers la possibilit de
transfrer nimporte quel type de donnes (Voix, Vido, Data) partir de
nimporte quel point daccs ( Tlphone, PDA, PC).
A la complexit de lenvironnement sajoute la rude concurrence exerce
par loprateur historique. Pour faire face ces dfis majeurs, et atteindre son
objectif ambitieux de devenir loprateur de rfrence . Mdi Telecom a mis une
place une politique sarticulant autour des valeurs suivantes2 :
La performance : Amliorer sans cesse le rseau, les produits et les
services en dveloppant la culture de la qualit pour atteindre le meilleur niveau
de ralisation. Etre lcoute de client pour mieux rpondre ses attentes et les
satisfaire.
Linnovation : Proposer une offre toujours mieux adapte aux besoins du
march, intgrant les dernires innovations technologiques et commerciales.
Lintgrit : Crer, au sein de lentreprise et avec son environnement, des
relations quitables et loyales bases sur lhonntet et la transparence.
Le travail en quipe : Contribuer au dveloppement de chacun et au
progrs de tous en partageant savoir et comptence, en renforant la solidarit et
en capitalisant les expriences.
Le leadership : Pratiquer un management favorisant la prise dinitiative,
dans le respect de la responsabilit professionnelle et morale due tous les
intervenants.
: Le march du fixe connat une stagnation au niveau mondial voir mme une rgression dans certains pays
comme le Maroc qui a enregistr une baisse de 23,36% entre 1999 et 2002 (Source : Rapport annuel de lANRT
anne 2003, page 11. www.anrt.net.ma)
2
: Voir rubrique Nos Valeurs sur le site institutionnel de Mdi Telecom ( Source :www.meditelecom.ma)
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
La concurrence et la complexit de lenvironnement imposent une plus
grande ractivit et par consquent une information de gestion standardise,
pertinente et disponible qui permettrait une prise de dcision rapide et
approprie.
Notre travail de mmoire sinscrit dans cet objectif : Produire une
information plus pertinente travers la mise en place dun tableau de bord de
gestion plus adapt.
A lumire des valeurs Mdi Telecom et dans un souci de performance et
de recherche defficience, nous allons dans le cadre de ce travail nous attaquer
lun des processus oprationnels les plus importants pour toute entreprise : La
Facturation Recouvrement, pour lequel on essaiera de proposer un tableau de
bord standardis, dynamique et mieux adapt aussi bien aux besoins des
intervenants quau nouveau contexte organisationnel de lentreprise.
Aussi, en nous inspirant de la mthode JANUS (Dveloppe par
C.SELMER)3 et aprs une analyse du processus en question et des diffrentes
activits qui le composent, un inventaire de lexistant en termes dinformation
de gestion et un diagnostic des besoins informationnels des diffrents
intervenants nous allons proposer la construction dun nouveau tableau de bord
de gestion du processus Facturation-Recouvrement.
Le choix du thme est justifi par plusieurs considrations :
- La nouvelle configuration organisationnelle de Mdi Telecom en
Business Unit qui fait que la Direction Gestion Client4 est intgre au sein du
ple commercial comme direction support pour les diffrentes BU. Ce qui sest
traduit par la multiplication de ses clients informationnels et donc par la
ncessit dune plus grande matrise de la production de linformation et de sa
qualit.
- La puissance des systmes informatiques et la prsence des technologies
avances, qui facilitent normment la gnration de linformation et
3
C.SELMER, Concevoir le Tableau de Bord. Ed DUNOD, 2003, 2 dition
Le dpartement facturation recouvrement qui gre les processus facturation et recouvrement fait partie de la
DGC
4
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
augmentent sa disponibilit, peuvent inciter la non production en continu de
linformation suivi de performance.
Aussi, le choix du thme se propose comme rponse la problmatique de
la ncessit de passer dun systme de production dinformation la demande,
o cest la justification des rsultats qui prdomine ; un systme de pilotage
par les tableaux de bord, o cest le suivi des activits et la recherche de
performance priment.
10
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Finalit des tableaux de bord
et Diagnostic du systme
actuel
11
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Partie I : Finalit des tableaux de bord et Diagnostic
du systme actuel
Chapitre I : Finalits et objectifs des tableaux de bord
Pour survivre aux mutations rapides de son environnement lentreprise
moderne est tenue dtre ractive.
La ractivit implique dune part la matrise de la gestion (suivi de
lactivit et des rsultats en temps rel) et la prise de dcision approprie en
temps opportun (disponibilit dune information pertinente dans des dlais trs
courts) dautre part.
Le contrle de gestion dont la finalit est bien le contrle-matrise de la
gestion, fait appel diffrents outils, dont les tableaux de bord, pour atteindre
cet objectif de ractivit.
Aussi, dans le cadre ce chapitre nous allons tenter de donner un aperu
thorique sur les tableaux de bord.
En partant du besoin de matrise de la gestion, corollaire de la qute de
ractivit, nous allons montrer la place des tableaux de bord dans le dispositif du
contrle de gestion, leurs caractristiques par rapport aux autres outils et ainsi
ressortir leurs buts et finalits, pour conclure avec leurs conditions de russite et
expliciter la dmarche de construction dun tableau de bord.
Section 1 : Contrle de gestion et ractivit
Dans lintroduction de son ouvrage Contrle de Gestion 5 , M.Gervais
dit : La mission essentielle de la direction gnrale est donc dintgrer au
mieux la complexit externe et la complexit interne,Mais, cette mission ne
5
M.Gervais,Contrle de Gestion, Ed Economica, 2000, 7 dition
12
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
pourra tre accomplie que si le systme-entreprise est sous contrle. Cette
mise sous contrle du systme, ncessaire aux dirigeants pour assurer la
prennit et la ractivit (intgrer les complexits interne et externes) de
lentreprise, est dsigne par lauteur comme le systme de contrle formel des
actions de gestion.
Par consquent, La finalit du contrle de gestion est bien la mise sous
contrle de lentreprise par la matrise de la gestion ou le contrle formel des
actions de gestion.
Cependant, quest ce que le contrle ?
Contrler une situation signifie tre capable de la matriser et de la diriger
dans le sens voulu. Le contrle recouvre la notion de matrise, mais aussi celle
de mesure et vrification, car contrler est aussi mesurer les rsultats dune
action, ou vrifier un tat, par rapport un rfrentiel dtermin ; qui peut tre
une norme, un objectif, etc.
Cette mesure, ce rapprochement avec le rfrentiel suppose le recours
linformation qui nous renseigne sur ltat contrler. Donc, le dploiement du
contrle ncessite lexistence dun systme dinformation.
Cependant, comment peut-on contrler une entreprise ?
Le systme-entreprise est un systme assez complexe de part ses multiples
interactions avec son environnement et aussi de part les complexits
particulires de ses diffrents acteurs, ce qui exclue lide dun contrle
uniforme au sein de lentreprise.
En effet, le contrle dpend troitement de la nature des actions de
gestion et de leur impact. Ainsi, R.N.Anthony6 en se basant sur la nature des
actions de gestion et leur porte propose une classification des processus de
planification et de contrle en trois niveaux :
D. Nanci & B. Espinasse, Ingnierie des systmes dinformation Merise, P58, Ed Sybex, 1996 et aussi
C. Grenier & C. Moine Construire le systme dinformation de lentreprise, Ed Foucher, 2003, p. 11-12
13
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
a) Planification stratgique : Dfinition des objectifs stratgiques.
Prpondrance de la planification sur le contrle. Linformation est surtout
dorigine externe et tourne vers le futur.
b) Contrle managrial : Mise en uvre de la stratgie. La planification
et le contrle ont la mme importance, on parle de pilotage. Linformation
utilise est le plus souvent de nature financire.
c) Contrle oprationnel : Ralisation concrte des oprations rptitives
de gestion. Prpondrance du contrle sur la planification, on parle de rgulation.
Linformation est essentiellement non financire.
Par consquent la nature et le poids du contrle sont diffrents selon la
nature des actions de gestion et la nature de linformation disponible. Aussi,
pour assurer sa mission de contrle formel des actions de gestion le contrle de
gestion fait appel des outils diffrencis couvrant la totalit des niveaux de
lentreprise.
De ce qui prcde, on dduit la ncessit du contrle des actions de
gestion de lentreprise pour assurer sa ractivit. Pour atteindre cet objectif le
contrle de gestion dploie plusieurs outils dont les tableaux de bord.
Section 2 : Les tableaux de bord, outil du contrle de gestion
Dans le cadre de ce dispositif du contrle formel des actions de gestion
qui est le contrle de gestion quelle place occupent les tableaux de bord ?
M.Leroy7, en partant de la dichotomie suivi des prvisions et suivi des
ralisations, trace un inventaire des diffrents outils de contrle des actions de la
gestion, en mettant laccent sur le terme des prvisions et des rsultats (voir
figure 1).
Le tableau de bord est donc un outil de suivi des ralisations, en les
confrontant avec des objectifs pour dgager des carts. Parmi les outils de suivi
des ralisations, le tableau de bord est le plus rapide puisque il se situe trs
7
M.Leroy, Le Tableau de Bord au service de lentreprise, Les ditions dOrganisation, 1991, p.17-19.
14
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
court terme (jusqu j+10), il peut mme recourir lestimation des rsultats
pour sauvegarder cette caractristique de rapidit de gnration ou ddition.
Figure 1 : Les outils de contrle des actions de la gestion8
PLAN STRATEGIQUE
Vocation-objectif global
Long terme
5 10 ans
PLAN OPERATIONNEL
Plan
dinvestissement
PREVISIONS
Plan
de
financement
Comptes de
rsultats
prvisionne
BUDGETS
Budget
dinvestissement
Budget
de
trsorerie
Budget
dexploitation
Moyen terme
2 5 ans
Court terme
1 an
TABLEAU DE BORD
Rsultats
REALISATIONS
COMPTABILIT
E
Gnrale
Objectifs
Ecarts
CONTRLE
BUDGETAIRE
Rsultats rels et/ou
estims
J+1 J+10
Rsultats rels
J+30 J+
Analytique
Voir M.Leroy, op. cit., p.17
15
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Cependant, il faut prciser que mme si le tableau de bord est un outil
ddi au suivi des ralisations, il reste ouvert au suivi des prvisions.
En effet, en utilisant les objectifs comme rfrentiel de contrle et en
mettant en exergue lcart par rapport ces mmes objectifs, il participe au suivi
des prvisions et la dclinaison des objectifs stratgiques en objectifs
oprationnels. Dautre part, le tableau de bord est aussi ouvert aux autres outils
de suivi des ralisations, dans la mesure o il fait souvent appel des
informations provenant de ces outils, notamment la comptabilit de gestion ou
encore la comptabilit gnrale.
En comparant, le tableau de bord aux autres outils on peut dgager
dautres caractristiques spcifiques :
Nature des donnes: Alors que le comptabilit gnrale et de gestion ainsi que
le contrle budgtaire ne prsentent que des donnes exclusivement montaires ;
le tableau de bord prsente des donnes de nature diverses : montaires,
physiques et mme qualitatives.
Cohrence avec lorganigramme : Chaque tableau de bord concerne un
responsable et couvre les points cls de son activit, ce qui constitue un avantage
par rapport la comptabilit gnrale qui adopte une prsentation rglementaire
trs loigne du dcoupage organisationnelle, ou encore par rapport la
comptabilit de gestion9 qui est souvent plus axe sur laffectation des cots.
Prsentation dynamique et pertinente : Chaque tableau de bord prsente au
responsable les indicateurs pertinents par rapport son champ daction et ses
objectifs, mais en additionnant les tableaux de bord dun niveau hirarchique
donn, on peut agrger des indicateurs des niveaux hirarchiques suprieurs.
Ainsi, en sembotant successivement suivant les ligne hirarchiques, les
9
LABC constituerait une exception cette rgle, mais dans le cas o lentreprise elle mme est organise en
processus et activits.
16
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
tableaux de bord traversent tous les
niveaux de contrle : stratgique,
managrial et oprationnel.
De plus, au niveau de la prsentation physique, le tableau de bord adopte
un ton pertinent, en se limitant linformation strictement ncessaire pour
permettre une lecture rapide de la part des destinataires, ce qui constitue un
avantage par rapport une comptabilit trs dtaille et peu comprhensible.
M.Leroy dit propos de la prsentation physique : Ngliger la qualit de la
prsentation physique dun tableau de bord serait une grossire erreur. Les
indicateurs quil contient doivent tre peu nombreux et mis en valeur, car, sa
manire, il sagit dun vritable document pdagogique qui attire lattention sur
limportant, lurgent et le dcisif. 10
Proximit entre linformation et laction : Les indicateurs physiques,
prsents dans un tableau de bord, sont plus prs de laction car on agit
directement sur des variables physiques et non sur des rsultats financiers.
Les indicateurs physiques ont lavantage danticiper les futurs rsultats
financiers tout en indiquant o agir. Ceci permet dapprhender la performance
sous ses aspects autres que financier et dtre ainsi beaucoup plus proche de
lactivit et donc plus ractif.
Dlais de parution rduits : Comme le montre la figure.1 le tableau de bord
est dit dans un dlai maximum de 10 jours, on peut mme estimer les rsultats
pour respecter ce dlai. Ceci fait du tableau de bord un moyen daction rapide
permettant plus de ractivit.
En conclusion, on peut dire que le tableau de bord de part sa cohrence
avec le dcoupage organisationnel, sa prsentation pertinente, dans des dlais
rduits, dune information non exclusivement financire, permet une matrise de
la gestion (finalit du contrle de gestion) beaucoup plus ractive, car plus
rapide et plus proche de laction.
10
M.Leroy, Le Tableau de Bord au service de lentreprise, op. cit., p.27
17
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Section 3 : Les fonctionnalits des tableaux de bord
A partir des caractristiques, prcdemment dveloppes, des tableaux de
bord et de leur composition, on peut les considrer comme un outil dimensions
multiples qui peut assumer les fonctionnalits suivantes :
- Outil de mesure des performances : Le tableau de bord met en vidence
les rsultas physiques ou financiers par rapport aux objectifs prtablis. La
diffrence constitue un cart, exprim en valeur ou en pourcentage, qui traduit la
performance ralise.
- Outil dalerte et de diagnostic : En calculant des carts sur les
indicateurs, le tableau de bord attire lattention des responsables sur les carts
significatifs ou exceptionnels. Ainsi alerts, les responsables chercheront
adopter des actions correctives dautant plus que la zone problme est connue
travers lcart exceptionnel dgag par le tableau de bord.
- Outil de
communication et de dialogue : Le tableau de bord sert
comme base de dialogue entre les diffrents niveaux hirarchiques. Chaque
responsable en se basant sur son tableau de bord commente ses rsultats,
explique les causes des carts constats et les mesures correctives prises son
niveau. Il peut demander, si besoin est, des directives ou des moyens
supplmentaires ou encore la rvision des objectifs initiaux. A ct de cette
communication verticale, le tableau de bord peut aussi tre utilis dans le cadre
dune communication horizontale, en communicant les performances dune
entit aux autres entits du mme niveau pour les galvaniser et les inciter
raliser des performances semblables.
- Outil de motivation : Le tableau de bord en suivant les activits des
responsables et en fournissant des informations objectives sur leurs
performances, leur offre la possibilit de sauto-contrler pour atteindre leurs
objectifs.
18
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Objectifs, qui sils sont bien dclins permettrait lentreprise datteindre ses
objectifs stratgiques. Ainsi, le tableau de bord peut aussi tre un outil de
cohsion autour des objectifs globaux de lentreprise.
- Outil dincitation la dcision et de perfectionnement: En sensibilisant
en permanence les responsables aux points cls de leur gestion, et en soulignant
les carts par rapport aux objectifs, le tableau de bord incite ces responsables
prendre des dcisions. A terme, cette sensibilit aux points cruciaux de lactivit
ainsi que limagination mise en uvre pour trouver les bonnes actions
correctives participent au perfectionnement de laptitude grer et diriger du
responsable.
Comme on vient de le voir, le tableau de bord est un outil aux multiples
dimensions et fonctions trs utiles pour toute entreprise. Cependant, il ne faut
pas croire que ces fonctionnalits sont systmatiques, comme tout projet
dentreprise, la bonne mise en uvre des tableaux de bord requiert des
pralables.
Section 4 : Les pralables de la mise en uvre des tableaux de bord
Une mise en uvre russie
dun systme de tableaux de bord aux
fonctionnalits dveloppes ci-dessus ncessite quatre pralables :
Un systme dinformation adapt
Une structure organisationnelle adapte
Un systme dobjectif adapt
Une implication de tous les intervenants
4.1 :Un systme dinformation adapt
Le systme dinformation peut tre dfini comme un ensemble organis
de mthodes et de moyen humains et matriels destins collecter, mmoriser,
19
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
transmettre les diffrents types de donnes ncessaires au fonctionnement dune
organisation. 11
Comme nous lavons cit, dans de la section 1, pas de contrle sans
systme dinformation. Cependant, force est de constater que pas nimporte quel
systme dinformation permettrait aux tableaux de bord de jouer pleinement
leurs rles.
En effet, pour que le tableau de bord soit un outil dincitation la dcision
et
de communication il faut que le systme dinformation soit ouvert aux
diffrents intervenants et que laccs linformation globale, voir mme
dcisionnelle, soit dmocratique . Car, dune part, cest grce cette
ouverture et cet accs que le responsable pourra prendre, avec plus de
confiance (car il disposera dinformations tayant son choix), des actions
correctives qui soient cohrentes avec les enjeux globaux de lentreprise.
Dautre part, louverture du systme dinformation favorisera lutilisation des
tableaux de bord comme outil de communication horizontale et dincitation
lamlioration des performances.
4.2 :Une structure organisationnelle adapte
La structure organisationnelle dune entreprise conditionne, plus dun
gard, la russite de la mise en uvre des tableaux de bord.
Une organisation pyramidale o la dlgation des responsabilits est
absente ne pourrait pas tirer profit du systme des tableaux de bord tel que nous
lavons prsent.
Par contre, une entreprise dont la structure organisationnelle est oriente
processus et centre de responsabilit serait bien adapte lclosion dun
systme de tableau de bord, dont elle pourras tirer pleinement profit, dautant
plus quelle pourras faire jouer des complmentarits avec les autres outils du
contrle de gestion, tels que le contrle budgtaire ou la comptabilit de gestion.
11
: C. Grenier & C. Moine Construire le systme dinformation de lentreprise, op. cit, p.10
20
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
La dlgation des responsabilits et des pouvoirs est dterminante pour
que les tableaux de bord puissent concrtiser leur finalit de stimuler la
ractivit au sein de lentreprise. Cependant, pour prvenir les drapages,
lentreprise doit absolument disposer dun systme de contrle des finalits et de
la cohrence des actions.
4.3 :Un systme dobjectifs adapt
Cest au systme dobjectif que le contrle des finalits et de la cohrence
des actions, est dvolu.
En effet, cest au systme dobjectif
de faire larbitrage entre la
personnalisation des objectifs, pour que les acteurs puissent se les approprier, et
leur cohrence avec les objectifs de lentreprise, pour coordonner les efforts et
assurer la prennit.
Aussi, les objectifs stratgiques doivent tre bien dclins tant au niveau
managrial, quau niveau oprationnel. La dclinaison des objectifs stratgiques
nest pas une question uniquement de procdures ou de mthodes, mais surtout
de communication et de motivation des intervenants.
Pour faciliter la cohsion et lutilisation dun objectif local (dclin de la
stratgie) comme rfrentiel dans les tableaux de bord, il doit tre12 :
- Born : Exprim dans une dimension de temps finie ;
- Mesurable : Exprim en une unit mesurable ;
- Accessible : Les responsables disposent des moyens ncessaires
pour atteindre lobjectif et les contraintes sont matrisables ;
- Raliste : La mthode daccs ( de ralisation) est raliste ;
- Fdrateur : Lobjectif recueille ladhsion des responsables ;
- Constructif : Lobjectif local contribue aux objectifs globaux.
12
: A.Fernandez, Les Nouveaux Tableaux de Bord pour Piloter lEntreprise, Ed dOrganisation, 1999, p.126-127
21
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
4.4 :Une implication de tous les intervenants
Dans tout projet dentreprise le facteur humain est primordial. Les
tableaux de bord ne font pas exception cette rgle.
De part la large place que le systme des tableaux de bord accorde
lautonomie des responsables, la russite de sa mise en place dpend troitement
de limplication des tous les intervenants tous les niveaux hirarchiques ; mais
aussi de la culture dentreprise, qui son tour conditionne limplication. Est ce
que la culture de lentreprise favorise lautonomie de dcision? Est ce quelle
favorise linnovation? Est ce quelle favorise la performance?
La rponse ces questions est dterminante pour la russite de la mise en
place des tableaux de bord.
Section 5 : Dmarche de mise en place des tableaux de bord
Nous allons essayer de donner une petite prsentation de la dmarche que
nous avons adopte pour la mise en place des tableaux de bord. Cependant, il
faut prciser que toute la deuxime partie de ce travail traitera, en dtail, de la
mise en place.
Dans le cadre de ce travail nous avons opter pour la dmarche de la
mthode JANUS. Mthode propose par Caroline SELMER dans son ouvrage,
Concevoir le tableau de bord13. Notre choix se justifie par la simplicit de la
dmarche et la distinction, trs utile, que la mthode opre entre les indicateurs
de performance et les indicateurs de pilotage. Toutefois, nous nous sommes
aussi penchs sur la mthode GIMSI, dveloppe par Alain Fernandez dans le
cadre de son ouvrage : Les nouveaux tableaux de bord pour piloter lentreprise14,
laquelle nous avons eu recours dans certaines parties du travail.
13
14
C.Selmer, op. cit.
A. Fernandez, op. cit
22
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
La dmarche de la mthode JANUS se dcline comme suit :
- Jalonner les tapes du projet : Dterminer les grandes orientations du
projet conception des tableaux de bord et mettre en place une gestion du projet.
- Justifier dun cadre pour laction : Intgrer les spcificits de
lorganisation, formaliser les missions des responsables et formaliser les enjeux
des processus.
- Analyser les besoins des utilisateurs : Recenser les besoins des
utilisateurs et inventorier les informations existantes.
- Architecturer le rseau des tableaux de bord : Veiller la cohrence des
informations et dfinir des rgles communes de remonte des informations.
- Normaliser les diffrentes mesures de performance : Choisir les
indicateurs de performance appropris.
- Normer les liens entre performance et pilotage : A partir des
dterminants de la performance, dterminer les indicateurs de pilotage pertinents.
- Unifier les modes de reprsentation : Unifier les modes de reprsentation
de linformation afin que tous les intervenants utilisent le mme langage.
- Utiliser un systme informatique adapt : La dmarche de choix du
support informatique.
-
Structurer la mise en uvre du tableau de bord : Formaliser la
procdure de gestion du tableau de bord et dterminer les rgles dajout de
nouveaux indicateurs.
Ce chapitre nous a permis dapprhender les tableaux de bord, en tant que
outil de matrise des actions de gestion au sein du dispositif du contrle de
gestion, et den ressortire ainsi la finalit et les caractristiques par rapport aux
autres outils. Cet aperu thorique a t aussi loccasion dintroduire la
dmarche de mise en place des tableaux de bord, et ce pour prparer le terrain
la deuxime partie qui traitera cet aspect en dtail.
23
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Chapitre II : Diagnostic du systme actuel
Dans le cadre de ce chapitre nous allons dfinir notre primtre daction
en prsentant les processus objet de notre travail savoir la Facturation et le
Recouvrement de Mdi Telecom, et les activits regroupes au sein de ces deux
processus, pour passer par la suite aux diffrents intervenants et aux flux
dinformations caractrisant ces processus.
Cette tape nous permettra de procder un diagnostic des processus en
question et de dgager ainsi les principales activits critiques qui feront lobjet
dindicateurs de suivi au niveau du tableau de bord.
Cependant, avant dentamer le diagnostic des processus de facturation et
de recouvrement, il faudra les situer au niveau de lorganisation de Mdi
Telecom.
Section 1 : Prsentation de Mdi Telecom
Comme indiqu lors de lintroduction Mdi Telecom est le premier
oprateur marocain priv de tlcommunications. Il a dmarr son activit en
avril 2000
Fiche signaltique :
Raison sociale : Mdi Telecom
Forme juridique : Socit Anonyme
Capital : 8 333 867 600 Dh
Effectif : 780 salaris et 10 000 emplois indirects
Parc client : 4 millions de clients dont 120 000 clients post-pay.
Activits : Fourniture de service de tlcommunications fixe et
mobile
24
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Depuis janvier 2005, Mdi Telecom est subdivis en 3 ples : Ple
Financier, Commercial et Technique. A la tte de chaque ple il y a un Directeur
de Ple dont dpendent des Directeurs Centraux qui leur tour supervisent des
Directeurs dunits. Ci-dessous, on prsente lorganigramme gnral de Mdi
Telecom :
Figure 2 : Organigramme gnral de Mdi Telecom15
15
: A partir de lIntranet de Mdi Telecom
25
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Toutefois, et comme il apparat sur lorganigramme, le Ple Commercial
na pas de direction centrale. Il est plutt structur en Business Unit. Chaque
Unit dAffaires a la responsabilit du Marketing et de la Gestion Commerciale
de son activit avec sa tte un directeur. Et afin dassister
les Units
dAffaires, des Units supports ont t mises en place. Cette rorganisation sest
traduit par une multiplication des interlocuteurs des Direction Support, dont la
DGC, qui de deux Directions (Marketing et Commerciale) ont pass 6
Business Unit. Poussant ainsi les Directions Support aller vers une plus grande
matrise de leur circuit de production dinformation et de reporting.
Section 2 : Prsentation de la DGC et du Dpartement FacturationRecouvrement
La Direction Gestion Client (DGC) est lune des Units Support les plus
importantes puisquelle a la responsabilit de certains processus ralisations
client nvralgiques, tels que lactivation, le support client ou encore la
facturation recouvrement.
En effet, la DGC se consacre la gestion et suivi de la relation avec le
client Mditel. Elle est la garante de la qualit du service rendue aux clients.
La DGC intervienne tout au long de la relation client. Cest son niveau
que le service acquis par ce dernier est activ. Cest aussi son niveau que toute
rclamation, demande de modification du service ou encore demande
dinformation sera trait. Cest son niveau que la facture client est tablie.
Cest aussi son niveau que le recouvrement de cette facture va tre pris en
charge et enfin cest son niveau que la rsiliation ventuelle du service sera
effectue.
La DGC est subdivis en 4 dpartements :
Le Dpartement Gestion Trafic et International : Suivi du trafic
clients et aussi du trafic Roaming. Dtection des cas de fraude
26
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Le Dpartement Support Client : Activation et gestion du support
applicatif du Centre Relation Client (Call Center).
Le Dpartement Call Center : Gestion des activits du Centre
Relation Client et supervision des quipes Attento.
Le Dpartement Facturation Recouvrement : Contrle, suivi et
gnration de la facturation client. Gestion du Recouvrement
amiable et pr-contentieux.
Comme nous lavons annoncer ds lintroduction, on sintresserait, dans
le cadre de se travail, particulirement aux processus Facturation et
Recouvrement aussi on va se concentrer sur les activits du dpartement
Facturation Recouvrement.
Le Dpartement Facturation Recouvrement, dont lorganigramme est
prsent dans la page suivante (voir Fig.3), est compos des entits suivantes :
Service Facturation : Responsable de la gestion du processus de
facturation, depuis le transfert des
donnes du trafic, jusqu
lexpdition de la facture au client.
Service Contrle, Process et Banking : Excution et contrle des
process automatique sur SAP. Assurer linterface avec les banques.
Gestion des prlvements bancaires. Edition et mise jour des
procdures. Reporting du dpartement.
Service Recouvrement Particuliers et Entreprises : Assurer le
recouvrement amiable personnalis des Grands Comptes. Lancer et
superviser des campagnes de relance. Gestion des paiements non
identifis et non appliqus.
Service Pr-contentieux : Grer le recouvrement pr-contentieux.
Assurer linterface avec les socits de recouvrement et la Direction
des Affaires Juridiques.
27
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Ci-dessous on prsente lorganigramme du dpartement Facturation
Recouvrement, tout en le situant au sein de la DGC.
Figure 3 : Organigramme DGC-Dpartement Facturation Recouvrement
Directeur Gestion Clientle
Dpartement
Facturation-
Dpartement Gestion Trafic
et International
Dpartement
Support Client
Dpartement Call
Center
Service Facturation
Service Contrle
Process & Banking
Service
Recouvrement
Service
Prcontentieux
28
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Section 3 : Diagnostic du Processus Facturation
Un processus peut tre dfini comme un ensemble dactivits organises
dans le temps produisant un rsultat prcis et mesurable 16. De cette dfinition,
il ressort que : Un processus est compos dactivits qui sont organises donc
prises en charge par des acteurs. Un processus produit un rsultat.
En nous basant sur ces deux axes : Rsultat/Finalit et Activits/Acteurs,
nous allons cartographier les processus Facturation et Recouvrement en deux
temps. Dans un premier temps, on va dlimiter le processus en mettant en
exergue son rsultat final, sa finalit, son client et ses enjeux. Puis, nous allons
dcrire les activits du processus, les acteurs qui les excutes, et les outils quils
utilisent pour les excuter
17
. Enfin, nous allons prsenter les flux
informationnels gnrs par le processus tudi.
3.1- Cartographie du processus Facturation :
a) Dlimiter le processus facturation :
Finalit : Contrler et suivre la production de la facture client depuis la
valorisation de la consommation du client jusqu lenvoi de la facture.
Client : Le client poste-pay Mditel destinataire de la facture. Le service
Contrle et Process et le service Recouvrement peuvent tre considrs comme
des clients internes, du moment cest la facture gnre et valide au travers de
ce processus qui est la base de toute action de recouvrement. De plus cest le
chargement de la facturation sur SAP qui dclenche le processus Recouvrement
(Voir section suivante).
Enjeux : Contrler les donnes de la facturation pour viter toute
anomalie ou erreur sur la facture. Superviser la logistique de production de la
facture afin que les tous les clients reoivent leurs factures.
Rsultat final : Une facture Mditel juste et fiable.
b) Dcrire le processus facturation :
b.1 : Workflow du processus
16
A.Fernandez, op. cit., p.112
Cette approche de cartographie des processus est celle de la mthode JANUS, voir Chap1 Sect 5 de ce rapport
et aussi C.Selmer, op. cit., p.64.
17
29
ISCAE Mastre CG 2004-05
Service gestion du
Trafic (DGC)
Service Facturation
(DGC)
Tarification et mise jour
Elaboration des critres
dchantillonnage
des promotions
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Service
Production (DSI)
Service Systmes
commerciales (DSI)
Gnration des fichiers
correspondants aux critres
(lchantillon)
Edition dun jeu de test
Vrification et
contrle de
lchantillon
Non
Docuprint : Editeur
(Externe)
Edition dfinitive des
factures clients
Anomalie
Oui
Correction de
lanomalie et clture
de lincident
Gnration dune fiche
dincident de
facturation
Mise sous pli et envoi
des factures aux clients
Validation
Enregistrement de la
facturation sur CD
Contrle qualit du
jeu de test dit
30
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
b.2 :Activits :
Nous allons dcrire, dans un ordre chronologique, les activits composant
le processus facturation.
1- Tarification et mise jour des promotions : Le service Gestion de trafic
procde au paramtrage des nouveaux concepts de facturation, conscutifs aux
nouveaux services lancs, et la mise jour des autres concepts ayant subi des
modifications au niveau des tarifs. Ceci permet la valorisation de la
consommation de tous les clients sur le systme.
2- Elaboration des critres dchantillonnage : Le service Facturation, en
fonction des nouveaux concepts de facturation (promotions, nouveaux
services,) et de la composition de la population des clients, labore une grille
de critres pour gnrer lchantillon dont on se servira comme base de contrle
de la vracit et lexactitude des donnes de facturation. Cette grille de critres
est transmise au service Production de la DSI.
3- Gnration des fichiers chantillons : Le service Production, en
fonction de la grille des critres, gnre du systme les donnes de facturation
chantillons et les transmets au service Facturation.
4- Vrification et contrle de lchantillon : Le service Facturation, aprs
stre assur de ladquation entre la grille des critres et les donnes reues,
procde au contrle de lchantillon. Ce contrle permet de vrifier si lors de la
valorisation de la consommation tous les nouveaux concepts de facturation ont
t bien pris en considration, et de dtecter ainsi les ventuelles anomalies.
5- Gnration dune fiche dincident de facturation : En cas danomalie
une fiche dincident, identifiant lanomalie et les concepts concerns, est tablie
par le service Facturation qui la transmet au service Systmes Commerciales de
la DSI pour rsolution.
6- Clture de lincident de facturation : Le service Systmes
Commerciales rsout lanomalie, renvoi le fichier corrig au service facturation
et clture lincident.
31
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
7- Validation de la facturation : Aprs le contrle de lchantillon et la
clture des incidents de facturation, le service facturation donne sa validation.
8- Enregistrement des donnes de la facturation sur CD : Le service
Production, aprs validation de la facturation, enregistre les fichiers print de la
facturation sur CD qui, aprs contrle du service Facturation, seront transmis
lditeur.
9- Edition dun jeu de test : Lditeur sous-traitant dite , dans un premier
temps juste un jeu de test des factures qui sera transmis au service Facuration.
10- Contrle de ldition des factures : Le jeu de test des factures dites
par lditeur sera contrl par le service Facturation qui donnera son aval pour
la suite du processus.
11- Edition dfinitive des factures : Aprs la validation du service
Facturation, lditeur procde limpression de la totalit de la facturation
Mditel.
12- Mise sous pli et envoi des factures : Aprs ldition, les factures
seront mises pli, affranchies puis expdies par lditeur aux clients.
b.3 :Acteurs :
1- Le service Gestion de Trafic : G.T
2- Le service Facturation : FR
3- Le service Production de la DSI : PR
4- Le service Systmes Commerciales de la DSI : S.C
5- Lditeur sous-traitant : Docuprint
b.4 : Outils
1- SIRIO : Systme qui prend en charge la facturation. La tarification et la
valorisation des consommations sont effectues sur SIRIO.
2- CFT : Mode de transfert de donnes utilis pour transmettre les fichiers
de facturation lditeur.
32
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
3- Messagerie (Lotus Notes): Support de communication et dchange de
donnes entre les diffrents acteurs du
processus. Elle offre aussi des
possibilits de gestion du travail en groupe (agenda partage) et de partage de
base de donnes (Workflow sur Notes).
3.2 : Flux informationnels du processus Facturation
Lobjet du diagnostic que nous avons opr est de formaliser les processus
et leurs activits, ce qui nous sera utile par la suite pour dgager les activits
critiques mettre sous contrle ; cependant, il faut prciser que notre optique
nest pas une optique reengineering des process, mais une optique
informationnelle . Car notre objectif est bien de dgager les flux
informationnels. Cest linformation, matire premire des tableaux de bord, qui
nous intresse en premier lieu.
Nous avons opt pour une prsentation en grille des flux informationnels.
Flux informationnel
Intervenants18
Support
Nouveaux concepts tarifis
G.T
FR
Workflow Notes
Grille des critres dchantillonnage FR
PR
Messagerie
Fichiers chantillons
PR
FR
Messagerie
Incident de facturation
FR
S.C
Workflow Notes
Validation
FR
PR
Messagerie
Fichier print de la facturation
FR
Editeur CD
3.3- Reporting du processus Facturation :
Les systmes informatiques supports au processus Facturation permettent
de gnrer de multiples reporting (CA factur par concepts de tarification, par
plan tarifaire, par client,). De plus, grce au Data Warehouse 19 et son
18
Pour les abrviations des intervenants voir la rubrique b.3 Acteurs de la page prcdente.
Le sens de la flche schmatise le sens du flux, ainsi une flche double quivaut un aller retour.
19
Cest lEntrept de donnes qui stocke des informations provenant de tous les systmes informatiques de
gestion de lentreprise. Mdi Telecom gre son Data Warehouse avec le systme Business Objects.
33
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
interface unique, il est possible de faire des analyses croises des informations
de gestion provenant de sources diffrentes.
Au niveau du processus de facturation, Les reporting produits sont :
- Rapport Publiphonie : CA Publiphonie par distributeur, par destination des
appels, par concept. Ce rapport est destin la BU Direction Publiphonie.
- Rapport Entreprise et Particuliers : Dclinaison du montant factur par plan
tarifaire, concept, rgion. Ce rapport est envoy au service Recouvrement.
-
Rapport Systme dencaissement : Montant et nombre des factures par
mode paiement. Ce rapport est destin au service Contrle et Process, cest le
rfrent.
3.4 : Conclusion diagnostic :
Comme nous lavons signal au dpart, Mdi Telecom est bien outille en
systmes informatiques offrant dnormes possibilits de reporting.
Cette disponibilit latente de linformation, on pourras la gnrer
quon veut, fait que linformation nest pas utilise comme outil de suivi de la
performance ou de lactivit ; mais plutt comme moyen de justification des
ralisations. Ceci est bien un constat gnral en relation avec lutilisation que
font les tableaux de bord de linformation.
Concernant le processus Facturation, nos remarques sont les suivantes :
Pas dindicateurs de dlai de production de la facturation : La
performance du processus de facturation est uniquement apprhende en termes
derreurs de facturation (indicateur de performance de la facturation), alors que
le dlai est un lment trs important dautant plus que la production de la
facture dclenche dautres processus.
Pas de suivi du cots de la facturation : Le cot de la facturation nest
pas suivi, alors que toute la production de la facture physique est sous-trait.
Une mise sous contrle des cots de cette sous-traitance (Edition, mise sous pli
34
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
et affranchissement) pourrait rvler des niches de performance, des sources de
surcots et aidera une plus grande matrise du processus.
Pas de prsentation comparative de linformation : Les informations
prsentes au niveau des diffrents reporting du processus ne sont pas
compares un historique. On ne fait pas recours au cumul annuel ou trimestriel,
pas de moyenne mobile. Alors que ce type de prsentation permettrait
dapprcier la performance et son volution dans le temps.
Section 4 : Diagnostic du Processus Recouvrement
En adoptant la mme dmarche que celle dveloppe lors de la section
prcdente, nous allons cartographier le processus Recouvrement en le
dlimitant puis en dcrivant ses diffrentes composantes.
Le processus Recouvrement est, relativement, trs tendue (le cycle de
recouvrement peut durer jusqu 60 jours) et trs complexe (des activits de
gestion des rglements factures et de relance des impays). Aussi, nous avons
dcid de le scinder en deux le processus Recouvrement : processus Gestion des
encaissements et processus de Relance des factures impayes.
A: Processus Recouvrement-Encaissement :
A.1 : Cartographie du Processus Gestion des encaissements :
a) Dlimiter le processus Gestion des encaissements
Finalit : Grer les diffrents modes de rglement (Prlvement bancaire,
chque, espces) et assurer le chargement des encaissements sur le systme.
Client : Le client Mditel postpay metteur du rglement dont la facture
devra tre rapproch au paiement quil a effectu.
Enjeux : Contrler lenvoi aux banques des factures payables par
prlvement pour viter le non rglement ou le prlvement tort. Contrler le
35
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
chargement des encaissements, leur rapprochement aux factures dues et traiter
les paiements non identifis (PNI) afin quaucun client ne soit relanc tort.
Rsultat final : La facture du client est rapproche au paiement quil a
effectu.
b) Dcrire le processus Gestion des encaissements
b.1 : Workflow du processus
36
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Service Systmes
Commerciales (DSI)
Service Contrle Process & Banking
(DGC)
Chargement de la
facturation sur SAP
Contrle de lexactitude
du chargement sur SAP
Service Recouvrement Particuliers,
Entreprises (DGC)
Banque (Externe)
Gnration fichier des
factures rgler par PB
Excution du fichier des
prlvements bancaires
Chargement du fichier
retour sur SAP
Gnration et envoi du
fichier retour
Tlchargement des
fichiers dencaissements
Encaissement des
rglements clients et
saisie sur lapplication
des paiements Mditel
Chargement des
rglements clients sur
Rapprochement des
encaissements sur SAP
Gnration liste des
PNI
Confirmation des
PNI
Traitement PNI
Identifier le N de GSM
relatif au PNI
37
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
38
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
b.2 Activits :
1- Chargement de la facturation sur SAP : Le service Systmes
Commerciales, aprs la fin du processus de facturation, procde au chargement
des factures du mois sur SAP. Cest le point de dpart du processus gestion des
encaissements.
2- Contrle du chargement : Le service Contrle et Process contrle sur
SAP les factures charges en les confrontant aux donnes du service Facturation.
3- Gnration du fichier des factures rgler par PB : Une fois le
chargement sur SAP est valid, le service Contrle et Process gnre par banque
les fichiers des factures rgler par prlvement bancaire. Et envoi chaque
banque le fichier des clients conjoints prlever.
4- Excution du fichier des prlvements bancaires et envoi du fichier
retour : La banque procde lexcution du fichier reu c--d au prlvement
des factures. Par la suite, un fichier avec le sort (paye, rejete) de toutes les
factures est retourn Mdi Telecom. Le dlai dexcution ainsi que le format
des fichiers sont rgis par une convention de prlvement conclue avec la
banque.
5- Chargement du fichier retour sur SAP : Le fichier du sort des factures
est charg sur SAP par le service Contrle et Process, ainsi apparat ,sur SAP,
ltat (paye, impaye) des factures de prlvement bancaire.
6- Encaissement des rglements clients : Les clients qui ne paient pas
prlvement bancaire rglent leurs factures auprs des guichets des banques
partenaires (BMCE). Le guichetier de la banque encaisse le montant du
rglement et enregistre sur lapplication, de gestion des paiements Mditel, les
donnes relatives au rglement (Montant, N de GSM du client,).
7- Chargement des fichiers dencaissements guichet : Quotidiennement, le
service Contrle et Process tlcharge du serveur de la banque le fichier des
encaissements guichet de la veille. Ce fichier est charg sur SAP.
39
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
8- Rapprochement des encaissements : Le service Contrle et Process
lance sur SAP le process automatique de rapprochement des encaissements
chargs. Ainsi, chaque rglement client est rapproch la facture y affrente.
9- Traitement paiements non identifis : Les paiements non identifis
sont les rglements dont lidentifiant ( le N de GSM du client ) est incomplet ou
erron. Le service Recouvrement gnre quotidiennement
une liste des
paiements non identifis, quil va essayer dans un premier temps didentifier en
se basant sur les montants des rglements ou encore sur les promesses de
rglement reues des clients. Les paiements non identifis restants sont trasmis
au Contrle et Process qui en tant quinterface avec les banques va les
transmettre la banque pour identification.
b.3 Acteurs :
1-
Le service Contrle et Process : C.P
2-
Le service Recouvrement Particuliers et Entreprises : RC
3-
Le service Systmes Commerciales (DSI) : S.C
4-
La BMCE : Elle prend en charge au niveau de ses agences les
rglements espces et chques des factures Mditel.
5-
Banques conventionnes : Les banques ayant sign une convention
de prlvement bancaire avec Mdi Telecom, et qui en consquence prlvent
les factures Mditel de leurs clients conjoints.
b.4 Outils :
1-
SAP : Le ERP de Mdi Telecoms, toute la comptabilit client est
prise en charge par SAP.
2-
ETEBAC : Application permettant de tlcharger quotidiennement
les fichiers des encaissements.
3-
Application gestion des encaissements Mditel : Application chez
les agences de la BMCE, elle permet de saisir les rglements des factures
Mditel.
40
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
4- Messagerie (Lotus Notes): Support de communication et dchange de
donnes entre les diffrents acteurs du
processus. Elle offre aussi des
possibilits de gestion du travail en groupe (agenda partage) et de partage de
base de donnes (Workflow sur Notes).
A.2 : Flux informationnels du Processus Gestion des encaissements:
Ci-dessous, on trouve les flux informationnels gnrs par le processus
Gestion des encaissements :
Flux informationnel
Intervenants20
Rapport facturation globale par systme FR
Support
C.P
Messagerie
S.C
C.P
Messagerie
Validation chargement de la facturation C.P
S.C
Messagerie
Fichiers prlvement bancaire
C.P
Banque CD/ CFT
Fichiers encaissements guichet
Banque
Liste des PNI identifier
C.P
dencaissement
Rapport chargement de la facturation
sur SAP
C.P ETEBAC
Banque Messagerie
A.3 : Reporting du processus Gestion des encaissements :
Le reporting produit au niveau de ce processus se limite au :
- Rapport priodique des encaissements : Le prsentation du
montant encaiss global et du montant factur global et par groupement de
catgorie (Entreprises/Particuliers).
A.4 : Conclusion diagnostic :
Au niveau du processus Gestion des encaissements, on peut mettre les
remarques suivantes :
Suivi mensuel des encaissements : Les encaissements sont suivis
mensuellement dans le cadre du rapport des encaissements gnr de SAP. Ce
20
Pour les abrviations des intervenants voir la rubrique b.3 Acteurs de la page prcdente.
41
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
rapport mets en relation les encaissements avec les chances relatives. Alors
quun suivi des encaissements effectus durant le mois permettrait de connatre
leur distribution sur le mois et dgager ainsi des lois dencaissement et de
connatre limpact des actions de relance entreprises.
Pas de suivi encaissements par moyen de paiement : Les encaissements,
toujours par rapport leurs chances respectives, sont suivis par mode de
paiement (Prlvement, Guichet), mais pas par moyen de paiement (Espces,
Chque, GAB). Ce suivi permettrait dapprcier la part relative de chaque
moyen de paiement.
Pas de suivi des rejets bancaires par motif : Les rejets bancaires des
factures nest pas suivi par motif de rejet, sachant que ces motif de rejet sont
standardiss pour toutes les banques. Un suivi des rejets bancaires par motif peut
rvler des niches de performance, des champs daction et damlioration. De
plus, un suivi des rejets par motif dune banque en particulier permet de
contrler son excution du fichier des clients Mditel et de dtecter ainsi des
dfaillances ventuelles ce niveau.
B. :Processus Recouvrement-Relance :
B.1 : Cartographie du Processus Relance des factures impayes :
a) Dlimiter le processus :
Finalit : Relancer les factures impayes et initier la relance pr
contentieuse pour les crances en souffrance.
Client : Le client dbiteur dont on relance les factures impayes. En
interne le client est la Direction des Affaires Juridiques pour laquelle on prpare
le dossier contentieux.
Enjeux : Relancer dans les dlais toutes les factures impayes. Ne pas
relancer des clients tort. Rcuprer le maximum de crance par les modes de
relance amiable et pr contentieuse. Prparer un dossier contentieux complet.
42
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Rsultat : Recouvrire les factures impayes des clients Mditel. Prparer
un dossier contentieux complet.
b) Dcrire le processus :
b.1 : Workflow du processus
43
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Relance des factures impayes (1/2)
Service Contrle Process &
Banking (DGC)
Service Pr-contentieux
(DGC)
Service Production
(DSI)
Docuprint (Externe)
Client
Chargement du fichier
retour PB sur SAP
Rception SMS de
notification du rejet de
la facture
Envoi SMS aux clients
dont le PB est rejet
Excution 1 niveau de
relance : gnration fichier
clients restreindre
Excution du fichier
des clients restreindre
Contrle de la
restriction
Gnration rapport
dexcution de la restriction
Excution 2 niveau de
relance : gnration fichier
clients suspendre
Excution du fichier
des clients suspendre
Contrle de la
suspension
Gnration rapport
dexcution de la suspension
Excution 3 niveau de
relance : Gnration fichier
Lettre de mise en demeure
Envoi du fichier print
lditeur
Gnration fichier des clients
dbiteurs et son envoi aux
socits de recouvrement
Restriction de la ligne :
impossibilit dmettre
des appels
Suspension de la ligne :
impossibilit de recevoir
des appels
Edition, mise sous pli et
envoi lettre de mise en
demeure
Rception de la lettre
de mise en demeure
45
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Relance des factures impayes (2/2)
Service Contrle Process &
Banking (DGC)
Service Pr-contentieux
(DGC)
Service Production
(DSI)
Docuprint (Externe)
Client
A
Excution 4 niveau de
relance : gnration fichier
clients rsilier
Excution du fichier
des clients rsilier
Contrle de la
Gnration rapport
dexcution de la
rsiliation
rsiliation
Rsiliation de la
ligne
Prparation du dossier
contentieux et son envoi
la Direction des Affaires
juridiques
46
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
b.2 Activits :
1- Chargement des fichiers retours du prlvement bancaire : Cette tape
(voir p37) est le dclencheur du processus de relance
2- Envoi SMS de notification : Le service Contrle et Process, partir du
fichier des clients dont le prlvement a t rejet, procde lenvoi dun SMS
de notification aux clients dbiteurs.
3- Excution relance 1 niveau : Aprs un dlai de paiement accord au
client, en fonction du planning de relance 21 , le service Contrle et Process
procde la relance 1 niveau sur SAP des factures impayes. Un fichier des
clients restreindre est gnr et transmit au service Production de la DSI.
4- Excution de la restriction : Le service Production excute le fichier
quil a reu sur le systme. Ainsi, les lignes des clients dbiteurs seront
restreintes. Cest dire que les clients en question en pourront plus mettre des
appels, ils nont que la possibilit de rception.
5- Gnration du rapport dexcution de la restriction : Le service
Production gnre un rapport rcapitulant les clients dont la ligne a t restreinte.
Ce rapport est transmit au service Contrle et Process.
6- Contrle de la restriction : Le service Contrle et Process procde la
confrontation du rapport dexcution avec le fichier des clients restreindre,
pour vrifier si tous les clients dbiteurs ont t restreints.
7- Excution relance 2 niveau 22: Le service Contrle et Process excute
le 2 niveau relance sur SAP et gnre le fichier des clients suspendre. Ce
fichier est excut par le service Production et les clients dbiteurs seront dans
limpossibilit de recevoir des appels.
8- Excution relance 3 niveau : Ce niveau de relance, excut toujours
par le Contrle et Process sur SAP, comporte lenvoi de la lettre de mise en
21
Un planning de relance dtermine les diffrents dlais observs entre les tapes de relance. Pour des raisons de
confidentialit professionnelle nous ne pourrons pas le dvelopper ici.
22
Le cycle gnration fichiers clients, excution sur le systme, gnration rapport et contrle rapport quon a
dvelopp pour la restriction (1 niveau de relance) est identique pour la suspension et la rsiliation ( 2 et 4
niveaux de relance). Aussi pour ne pas alourdire la prsentation on ne va pas les reprendre en dtail par la suite.
47
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
demeure. Aussi, un fichier print (fichier dimpression) est gnr lissue de
cette relance, ce fichier est contrl puis transmis lditeur. Ce dernier dite les
lettres de mise en demeure, les met sous pli, les affranchi et les envoi aux clients
dbiteurs.
9- Envoi du fichier des clients dbiteurs aux socits de recouvrement :
Aprs lenvoi de la lettre de mise en demeure, le service Pr-contentieux gnre
de SAP un fichier des clients ayant des factures impayes au 3 niveau de
relance. Ce fichier serait envoy pour relance aux socits de recouvrement.
10- Excution relance 4 niveau : Le service Contrle et Process excute
sur SAP le 4 niveau de relance et gnre un fichier des clients rsilier. Ce
fichier est excut par le service Production et la ligne des clients dbiteurs est
rsilie.
11- Prparation du dossier contentieux : Aprs puisement de tous les
modes de relance amiable, un dossier juridique est prpar par le service PrContentieux et transmis la Direction des Affaires Juridiques pour entamer la
procdure judiciaire lencontre des clients concerns.
b.3 Acteurs :
1- Le service Contrle et Process : C.P
2- Le service Pr-Contentieux : P.C
3- Le service Production : PR
4- La Direction des Affaires Juridiques : D.A.J
5- Les socits de Recouvrement : Ste.Rec
6- Lditeur sous-traitant : Docuprint
b.4 Outils :
1- SAP : Toutes les relances sont excutes sur SAP et les fichiers de
relance sont gnrs de SAP.
48
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
2- SIRIO : La restriction, suspension et rsiliation de ligne sont
excutes sur SIRIO.
3- CFT : Le fichier dimpression de la lettre de mise en demeure est
achemin lditeur par CFT.
4- Messagerie (Lotus
Notes):
Support
de
communication
et
dchange de donnes entre les diffrents acteurs du processus. Elle offre aussi
des possibilits de gestion du travail en groupe (agenda partage) et de partage
de base de donnes (Workflow sur Notes).
B.2 : Flux informationnels du Processus Relance des factures impayes:
Ci-dessous, on prsente les flux informationnels gnrs par le processus
Relance des factures impayes :
Flux informationnel
Intervenants23
Support
Fichier clients restreindre
C.P
PR
Messagerie
Rapport dexcution de la restriction
PR
C.P
Messagerie
Fichier clients suspendre
C.P
PR
Messagerie
Rapport dexcution de la suspension
PR
C.P
Messagerie
Fichier dimpression LMD
PR
Editeur
CFT
Fichier clients dbiteurs 3 niveau
P.C
Ste.Rec Messagerie
Fichier clients rsilier
C.P
PR
Messagerie
Rapport dexcution de la rsiliation
PR
C.P
Messagerie
Dossiers contentieux
P.C
Ste.Rec Messagerie
B.3 : Reporting du Processus Relance des factures impayes:
Le processus Relance des factures impayes produits les reporting
suivants :
- Impay final : Le montant des impays mensuels 60 jours de
lchance.
23
Pour les abrviations des intervenants voir la rubrique b.3 Acteurs de la page prcdente.
49
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
- Rapport dirrcouvrabilit : Rapport tablis par les socits de
recouvrement pour chaque fichier de clients relancer quelles
reoivent.
- Rapport mensuel des rcuprations des clients contentieux :
Rapport tablis par la Direction des Affaires Juridiques.
B.4 : Conclusion diagnostic :
Pour le processus Relance des factures impayes, on peut mettre les
remarques suivantes :
Pas de suivi des rcuprations par niveau de relance : Il ny pas de suivi
des rcuprations de crance ralises aprs lexcution de chaque niveau de
relance. Ce suivi permettrait dapprcier limpact de chacune des actions de
relance, notamment la restriction, la suspension et lenvoi de la lettre de mise en
demeure.
Pas de suivi dynamique des impays : Dans le cadre du rapport dimpay
final, on privilgie le rsultat final du processus de relance, puisquon ne
prsente que le taux dimpay 60 jours de lchance. Cette prsentation ne
permet pas de suivre lvolution de la rcupration dune chance. A 60 jours
de lchance, il se peut quil soit trop tard pour lancer des campagnes cibles de
relance. Alors quun suivi hebdomadaire dune chance tout au long de son
cycle de relance offrirait plus de possibilit daction.
Pas de prsentation de la population relance : Les rapports dexcution
des relances ne sont pas exploits en dehors du contrle des excution (voir
Activits). Ces rapports pourraient tre utiliss pour tablir des situations
mensuelles qui aideront apprcier leffort de relance dploy durant le mois.
De plus, il permettrait dapprhender les caractristiques des populations
relances chaque niveau ce qui pourrait conduire des analyses utiles pour la
matrise des impays.
50
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Section 5 : Conclusion du Chapitre II
Dans le cadre de ce chapitre nous avons dlimit et dcrit les processus et
formalis les activits. Cependant, il faut prciser que Mdi Telecom a t le
premier oprateur certifi ISO 9001 (version 2000) et ce depuis 2003. La
dmarche qualit apparat dailleurs au niveau des processus qui sont bien
dtermins, comportant plusieurs points de contrle permettant dassurer le bon
droulement des activits. Cependant, par rapport lobjet de notre travail :
Linformation de gestion. Plusieurs remarques se dgagent.
En effet, ct des remarques relatives chaque processus en particulier,
dveloppes auparavant, il y a des remarques gnrales, tous les processus
tudis, quon a choisit de dvelopper ici.
Malgr toutes les possibilits offertes par les diffrents outils de reporting
des systmes informatiques et par Business Objects. Linformation de gestion
nest pas produite sous une forme synthtique couvrant toutes les activits du
dpartement 24 . Comme on la vu travers le reporting des processus,
linformation produite couvre des axes particuliers et elle vient souvent en
rponse des demandes externes (Ex : Rapport Publiphonie) ou encore cest
une conformit la dmarche qualit qui impose des indicateurs de performance
des processus (Erreur de facturation et Impay final sinscrivent dans ce cadre).
Linformation de gestion produite devrait, ct de cet aspect reporting vers
lextrieur, tre suivie en tant que dterminant de la performance globale du
dpartement. Les axes suivre et les informations prsenter devront rpondre
une rflexion interne, une recherche interne de la performance.
Les reporting produits noffrent pas de possibilit de comparaison parce
quil ne sont pas accompagns dhistorique. En effet, on ne compare par les
ralisation dune priode aux ralisations de la mme priode de lanne
24
Le rapport annuel du dpartement fait exception cette rgle, dans la mesure o il prsente des informations
synthtiques couvrant la totalit des activits, mais de part sa priodicit annuelle, il ne remplir une fonction de
suivi de performance.
51
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
prcdente, pas de cumul annuel ou trimestriel, pas de moyenne mobile. Une
prsentation comparative a lavantage de relativiser les ralisations et
dapprhender la performance dans le temps.
Les reporting des processus Facturation Recouvrement ne sont pas
standardiss et formaliss. En effet, il ny a pas des fiches dindicateurs ni de
procdure ou dinstruction de travail qui formalisent les responsables de
production de linformation, la source et la priodicit de gnration.
En conclusion, on peut dire que le dpartement Facturation Recouvrement
ncessite une nouvelle approche de linformation de gestion. Une approche
manant dune rflexion interne, permettant tout en matrisant les activits de
suivre la performance globale et ses dterminants. Cest lapport du Tableau de
Bord de gestion.
Aussi, ce travail aura pour ambition de doter le dpartement Facturation
Recouvrement, en se basant sur une dmarche structure, dun Tableau de Bord
de gestion ax sur le suivi de la performance.
Aussi, la deuxime partie serait consacre la prsentation de la mise en
place du Tableau de Bord de gestion de la Facturation Recouvrement.
52
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Mise en place du Tableau de
Bord de gestion de la
Facturation Recouvrement
53
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Partie II : Mise en place du Tableau de Bord de
gestion de la Facturation Recouvrement
Comme nous lavons annonc auparavant, la dmarche adopte pour la
mise en place du Tableau de Bord de gestion de la Facturation Recouvrement est
inspir de la mthode JANUS25.
Concernant les deux premires tapes de la mthode JANUS. La premire
tape : Les orientations du projet de mise en place, le chef du dpartement tant
le donneur dordre du projet ses besoins constituent les principales orientations
du projet, par consquent ils vont tre dvelopps lors de lanalyse des besoins
des utilisateurs. Dun autre ct, le diagnostic opr en premire partie a fourni
une finalit notre projet de mise en place.
Pour la deuxime tape de la mthode : La formalisation des processus,
elle a t aborde au deuxime chapitre de la premire partie.
Dans cette partie, on va drouler les tapes suivantes conduisant la mise
en place dun Tableau de Bord de gestion.
Chapitre 1 : Analyse des besoins des utilisateurs
Dans le cadre de ce chapitre nous allons analyser les besoins des
diffrents utilisateurs au niveau du dpartement Facturation Recouvrement.
Pour analyser les besoins des utilisateurs nous avons eu recours des
runions de travail avec les utilisateurs.
La premire runion a t rserve lexplication du projet sa porte et
son objectif. Nous avons essay dinsister sur le fait que lobjet du Tableau de
Bord mettre en place est de doter les diffrents services dun outil de matrise
de la gestion et de la performance et non pas dtablir un contrle des
25
Voir p.18
54
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
ralisations. Les avantages du Tableau de Bord en tant que outil de
communication ont t aussi mis en valeur.
La deuxime runion a t rserve au diagnostic du systme actuel, ainsi
nous avons essay dimpliquer les intervenants la rflexion sur les limites du
systme actuel.
Les runions suivantes ont t des sances de travail o grce une fiche
de besoins, nous avons
tent dinventorier et danalyser les besoins des
diffrents utilisateurs et des voies possibles pour apprhender la performance au
niveau des processus.
Section 1 : Dpartement Facturation Recouvrement
Pour le chef du dpartement Facturation Recouvrement les principaux
besoins taient :
- Suivre priodicit fixe les activits critiques ;
- Disposer dune information synthtique et globale couvrant
toutes les activits du dpartement ;
- Documenter les indicateurs ;
- Matriser le circuit de production de linformation.
Ces besoins constituent les orientations de notre projet de mise en place.
Section 2 : Processus Facturation :
La fiche des besoins des utilisateurs du processus de Facturation est la suivante :
Processus : Facturation
Missions/Activits
Points cls
Echantillonnage
Nouveaux concepts de
des donnes de la
facturation, clients
facturation.
facturables, plan tarifaires.
Contrle
dchantillon.
Indicateurs
Nombre des plan
tarifaires, des nouveaux
concepts de facturation et
des clients facturables, dlai
Dtecter des erreurs de
Nombre danomalies
facturation ou des anomalies derreur de facturation,
et tablir des fiches
nombre factures concernes,
dincident.
nombre dincident de
facturation et dlai de
55
ISCAE Mastre CG 2004-05
Supervision de la
production de la
facture physique.
Qualit de la
facturation et de la
facture.
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Edition, mise sous pli,
affranchissement et envoi.
Erreur de facturation,
rception effective de la
facture par le client.
rsolution.
Cot et dlai de chacune
des tapes.
Nombre de rclamations
client concernant la
facturation, Erreur
facturation et Retour
courrier.
Section 3 : Processus Gestion des encaissements :
La fiche des besoins du processus Gestion des encaissements est la suivante :
Processus : Gestion des encaissements
Missions/Activits
Points cls
Contrle du
Toutes les factures clients
chargement de la
sont charges sur SAP avec
facturation sur SAP. le bon mode de paiement.
Gnration fichier Toute facture payable par
prlvement
PB a t envoye la
bancaire.
banque. Pas de Prlvement
tort.
Excution fichier Tous les prlvements sont
PB.
excuts. Pas de rejet pour
des motifs techniques.
Chargement fichier Les comptes des clients en
retour sur SAP.
PB sont correctement mis
jour. Pas de relance tort
Chargement sur
Les comptes des clients en
SAP des fichiers
Guichet sont correctement
dencaissement.
mis jour. Pas de relance
tort.
Traitement PNI
Mise jour des comptes
clients. Pas de relance tort
Qualit du
processus
Encaissement client non
pris en considration
Indicateurs
Nombre, montant des
factures par mode de
paiement.
Montant et nombre facture
par banque
Retour bancaire en
nombre et montant par motif
de rejet. Dlai dexcution.
Taux de rejet des factures
PB.
Le nombre et montant des
encaissements quotidiens
par moyen de paiement
guichet.
Nombre et Montant des
PNI, part relative des PNI,
dlai de confirmation par la
banque.
Nombre rclamations
encaissement, classement
par dlai de rsolution.
56
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Section 4 : Processus de Relance des factures impays
La fiche des besoins du processus Relance des factures impayes est la suivante :
Processus : Relance des factures impayes
Missions/Activits
Points cls
Chargement fichier Pas de relance tort. Les
retour sur SAP.
comptes des clients en PB
sont correctement mis jour.
Excution relance Pas de relance tort. Tous
les clients au 1 niveau sont
1 niveau.
restreints.
Indicateurs
Nombre des impays PB.
Taux de rejet PB.
Le nombre et montant des
factures au 1 niveau de
relance. Nombre des clients
restreints.
Excution relance Pas de relance tort. Tous Nombre et Montant des
2 niveau.
les clients au 2 niveau sont factures au 2 niveau.
suspendus.
Nombre des clients
suspendus.
Excution relance Pas de relance tort. Tous Nombre et Montant des
3 niveau.
les clients au 3 niveau ont factures au 3 niveau.
reu leur lettre de mise en
Nombre des LMD. Cot
demeure.
envoi LMD.
Pas de relance tort. Tous Rapport dirrcouvrabilit.
Envoi fichier
clients dbiteurs aux les clients sont relancs par Commission Sts de Rec.
les Sts de Rec.
Sts de Rec.
Excution relance Pas de relance tort. Tous Nombre et Montant des
les clients au 4 niveau sont factures au 4 niveau.
4 niveau.
rsilis.
Nombre des clients rsilis.
Prparation dossier Dossier incomplet. Compte Nombre et montant dossier
contentieux.
client contentieux non arrt. contentieux par anciennet
de la crance.
Rcupration de limpay. Taux dimpay. Nombre et
Qualit du
processus
Relance tort.
montant des impays
rcuprs par niveau de
relance. Rclamations
relance.
Chapitre 2 : Activits critiques contrler
A partir des besoins des utilisateurs et de la formalisation des activits et
dans un souci de recherche de performance, nous avons choisit de mettre sous
contrle certaines activits critiques que nous prsentant par processus. La
57
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
qualit de lcout client a t aussi une de nos proccupations majeures, aussi
nous avons considr la rponse aux rclamations clients comme activit
critique au niveau de tous les processus.
Section 1 : Processus de facturation
Les activits critiques suivre au niveau de ce processus sont :
Activits critiques
Indicateurs de suivi
Contrle facturation :
chantillonnage, validation
Production de la facture physique :
dition, mise sous pli et envoi
Nombre dincident de facturation.
Erreur de facturation
Dlai de production de la facture
Nombre factures dites
Cot de production par phase
Nombre des rclamations facturation
classes par dlai de rponse
Rponse aux rclamations clients
Section 2 : Processus de Gestion des encaissement
Les activits critiques suivre au niveau de ce processus sont :
Activits critiques
Indicateurs de suivi
Chargement de la facturation
Nombre et montant de la facturation
par mode de paiement.
Nombre et montant des factures
envoyes pour PB.
Rejets des banques par motif de rejet
Dlai dexcution et commission par
banque
Taux de rejet par banque
Prlvement bancaire des factures
Chargement des encaissements
guichet
Traitement PNI
Rponse aux rclamations clients
Nombre et montant des
encaissements quotidiens par moyen de
paiement
Nombre et montant des PNI et leur
part relative
Nombre des rclamations
encaissement classes par dlai de
rponse
58
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Section 3 : Processus de Relance des factures impayes
Les activits critiques suivre au niveau de ce processus sont :
Activits critiques
Indicateurs de suivi
Excution relance
Nombre et montant des factures
relances
Nombre des clients relancs
Rcupration aprs relance
Nombre et montant des factures
envoyes au Sts de Rec.
Rcupration (Nombre et montant)
Commission des Sts de Rec.
Nombre et montant des dossiers
contentieux.
Nombre des rclamations relance
classes par dlai de rponse
Recouvrement pr-contentieux :
Socits de recouvrement
Recouvrement contentieux
Rponse aux rclamations clients
Chapitre 3 : Dtermination des indicateurs
Lors des deux chapitres prcdents on a dj dgag des indicateurs. En
effet, les utilisateurs nous ont propos des indicateurs pour le suivi des missions
de leurs processus. Et aussi lors de la mise en relief des activits critiques, on a
propos des indicateurs de suivi de ces activits. Ces indicateurs sont des
indicateurs axs suivi et matrise de lactivit.
Par contre, les indicateurs que nous allons dvelopper dans le cadre de ce
chapitre, sont plutt des indicateurs de performance et de pilotage. Cest des
indicateurs qui permettrait aux utilisateurs dapprcier la performance de leurs
processus.
Les indicateurs dtermins dans le cadre de ce chapitre sont de trois
natures : Performance, Pilotage et Eclairage.
59
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Les indicateurs de performance sont proches de lactivit (ils peuvent
mme comporter des indicateurs de suivi). Ils en mesurent la performance
travers les axes de :
o Rsultat : Loutput du processus/activit ;
o Dlai : Dlai de production du rsultat ;
o Cot : Les cot supports par le processus, notamment
externes ;
o Feed-Back : Le feed-back du client du processus.
Les indicateurs de pilotage sont des indicateurs plus synthtique, leurs
rsultat est imputable plusieurs activits. Ils donnent une apprciation de la
performance globale du processus.
Les indicateurs dclairage sont des indicateurs concernant des activits
externes mais qui permettent dclairer les rsultats atteints par nos processus.
Enfin, il faut prciser que par souci de pertinence, lune des
caractristiques des tableaux de bord 26 , il nous a fallut faire un tri entre les
diffrents indicateurs disponibles et en choisir les plus pertinents.
Section 1 : Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance vont tre prsents par processus.
1.1 :Processus Facturation
Selon les axes dvelopps ci-dessus les indicateurs de performance du
processus Facturation sont :
Rsultat : Nombre et Montant des factures
Taux derreur de facturation
Taux de retour courrier facturation
Dlai : Dlai de validation de la facturation
Dlai de production de la facture
26
Voir, Section 2 du 1 chapitre, p.13
60
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Cot : Cot de production de la facture par tape.
Feed-Back : Nombre rclamations facturation
1.2 :Processus Gestion des encaissements :
Les indicateurs de performance du processus Gestion des encaissements
sont :
Rsultat : Encaissements par moyen de paiement
Retour PB par motif
Dlai :
Dlai dexcution des PB par banque
Cot :
Commissions bancaires sur les PB
Feed-Back : Nombre des rclamations encaissements
1.3 :Processus Relance des factures impayes :
Les indicateurs de performance du processus Gestion des encaissements
sont :
Rsultat : Impay fin du mois par chance
Rcupration par niveau de relance
Dlai :
Dlai moyen de retard
Cot :
Commissions Sts de Rec.
Frais lettre de mise en demeure.
Feed-Back : Nombre des rclamations relance.
Section 2 : Indicateurs de pilotage :
Comme nous lavons prcis les indicateurs de performance sont des
indicateurs synthtiques permettant de mesurer la performance globale. Ces
indicateurs sont destins au chef du dpartement. Nous avons dtermin quatre
indicateurs de pilotage de la Facturation Recouvrement.
Balance ge : Cest une prsentation des impays par anciennet de la
crance. Ainsi, les impays arrts une date donne sont dclins par tranche
61
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
dge : 0-30 jours, 30-60 jours, 60-90 jours, 90-180 jours, 180-360 jours et Plus
dun an. Limportance des impayes des tranches anciennes permet dapprcier
leffort de relance. La balance ge permet aussi de cibler les actions de
recouvrement.
DSO : Days of Sales Outstanding ou encore Dlai moyen de paiement.
DSO= Impays/ CA par jour
Cest le rapport entre les impays et le CA journalier permettant ainsi de traduire
les impays en jours. Le DSO, en mettant en rapport le CA journalier et les
impays, permet dapprcier le dlai moyen de paiement que reprsente nos
impays27.
Cot financier des impays : Les impays reprsentent un manque de
trsorerie quon peut tre amen combler en faisant appel des sources de
financement externes. Aussi, le cot financier des impays mesure le cot
ventuel de financement des impays.
Cot Financier des impays= Impays*Taux de financement des besoins de
trsorerie
Le taux de financement des besoins de trsorerie pourras nous tre communiqu
par la Direction Financire ou dfaut on peut prendre le cot minimal (une
sorte de cot dopportunit) qui serait le taux des Dons de Trsor.
Dlai de rsolution rclamations clients : Dans un souci de satisfaction
client, une attention particulire est accorde au sein de Mdi Telecom au
traitement des rclamations clients et surtout leur rsolution en moins de 24
heures. Aussi, le dpartement Facturation Recouvrement est tenu de suivre de
prs le dlai de rsolution des rclamations le concernant.
27
A ct de cette mthode de calcul bas sur le CA moyen par jour, qui souffre des limites dun calcul moyen ne
tenant pas compte deffet de saisonnalit, mais offrant lavantage dune formule de calcul simple prsenter. Il y
a dautres mthodes de calcul de DSO qui permettent de tenir compte de la saisonnalit, notamment la mthode
dpuisement par les CA mensuels prsente dans la fiche indicateur DSO, voir annexe n2
62
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Section 3 : Indicateurs dclairage :
Les indicateurs dclairage sont des indicateurs relevant dactivits
externes la Facturation Recouvrement mais qui impactent sur notre
performance. Ces indicateurs sont destins au chef du dpartement. Nous avons
dgag trois indicateurs dclairage.
Nouveaux concepts facturation : Le nombre des nouveaux concepts
facturer durant le prochain cycle de facturation 28 . Cet indicateur permettra
dapprcier la charge de travail au niveau du contrle de la facturation.
Risque nouveaux clients : Cest le nombre des clients activs le mois
prcdent par catgorie client. Sachant que la catgorie client est dtermine par
un scoring risque, qui prend en considration la solvabilit du client. Cet
indicateur nous claireras sur le comportement de nos futurs payeurs.
Taux de rcupration au contentieux : La Direction des Affaires
Juridiques nous transmet le rapport mensuel des rcuprations des clients au
contentieux, do on pourrait dgager le taux de rcupration des crances
contentieuses. Le niveau de rcupration au contentieux impacte le niveau total
des impays.
Chapitre 4 : Structure du Tableau de Bord de gestion
Dans le cadre de ce chapitre nous allons traiter de la structure du Tableau
de Bord de gestion de la Facturation Recouvrement. Dans un premier temps on
va dvelopper la structure logique du tableau de bord : sa composition et ses
rgles de gestion, par la suite nous allons dvelopper sa structure physique : sa
prsentation physique.
Section 1 : Structure logique du Tableau de Bord de gestion
La structure logique du Tableau de Bord de gestion correspond son
architecture et ses rgles de gestion.
28
Mdi Telecom a un cycle de facturation diffrent du mois calendaire. Il stend du 18 (m-1) au 17 (m). Ce qui
faciliterait lutilisation de cet indicateur
63
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Notre Tableau de Bord de gestion est compos de trois parties :
- Indicateurs dclairage, au nombre de 3.
- Indicateurs de pilotage, au nombre de 4.
- Indicateurs de performance, au nombre de 18.
Pour les indicateurs de suivi de lactivit, dgags lors de la dtermination
des activits critiques et dont on retrouve certains parmi les indicateurs de
performance, ils sont rservs aux services. Ainsi, chaque service les mettras en
uvre pour matriser son activit, et partir aussi de ses indicateurs de suivi il
fournira linformation ncessaire llaboration du Tableau de Bord de gestion
du dpartement.
Nous allons prsenter la structure logique de notre Tableau de Bord
laide dune grille, rcapitulant les axes suivants :
Indicateur : Le nom de lindicateur
Calcul : Dfinition et/ou formule de calcul de lindicateur
Priodicit : Priodicit de gnration de lindicateur
Dlai : Dlai de gnration de lindicateur
Source : Systme source de linformation, ou lentit qui le gnre
dans le cas o cette dernire est externe au dpartement.
Responsable : Lentit responsable de la mise jour de lindicateur
Code : Code de lindicateur
Codification : Pour la codification nous avons essayer dadopter un code
qui renseigne sur la nature de lindicateur (PLT : Indicateur de pilotage, ECR :
Indicateur dclairage, PRF : Indicateur de performance) et sur le processus
objet de lindicateur pour les indicateurs de performance (PRF_FR : Indicateur
Facturation, PRF_GE :Indicateur Gestion des encaissements, PRF_RF :
Indicateur Relance des factures impays). La codification des indicateurs en plus
du fait quelle faciliterait laccs aux indicateurs, faciliterait aussi larchivage
des donnes ; ainsi, la consultation de lhistorique serait plus aise.
64
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Dlai de gnration : Pour le dlai de production du Tableau de Bord de
gestion, il ne devra en aucun cas dpasser la fin de deuxime semaine du mois
(m+15 au plus tard). Dans le cas o certaines informations manquent on devrait
recourir lestimation en se rfrant aux donnes historiques.
65
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Indicateur
Calcul
Nouveaux concepts facturation
Nombre des nouveaux concepts de facturation
Risque nouveaux clients
Cot financier des impays
Dlai de rsolution rclamations
clients
Nombre et montant des factures
Taux d'erreur de facturation
Taux retour courrier facturation
Dlai de validation de la facturation
Dlai de production de la facture
Cot de production de la facture
Nombre rclamations facturation
Encaissements par moyen de
paiement
Mensuelle
m+10
Mensuelle
m+10
Mensuelle
m+10
Mensuelle
m+10
Mensuelle
m+10
Nombre des nouveaux clients ventils par catgorie risque
Taux de rcupration au contentieux TRAC= Montant des crances contentieuses
rcupres/Montant envoy
Classement par anciennet des impays arrts fin m.
Balance ge
DSO
Priodicit Dlai
DSO=Impays fin m/ CA TTC moyen par jour
CFI= Impays fin m*Taux de financement des besoins de
trsorerie
Mensuelle
Nombre les rclamations client concernant la Facturation
Recouvrement classes par dlai de rsolution
Mensuelle
Nombre et montant des factures de l'chance m
Mensuelle
Nombre des factures errones/Nombre total des factures
Mensuelle
Nombre factures retournes/Nombre total des factures
Mensuelle
Dlai courant de la fin du cycle de la facturation jusqu' son
chargement sur SAP
Mensuelle
Dlai courant de l'envoi du fichier print de la facturation
jusqu' l'expdition des factures aux clients
Mensuelle
Cot de production facturation=Cot dition+Cot mise
sous pli+Cot affranchissement
Mensuelle
Nombre des rclamations mises par les clients concernant
la facturation
Mensuelle
Nombre et montant des encaissements guichets ventils
par moyen de paiement
Mensuelle
m+10
m+10
m+10
m+10
m+10
m+10
m+10
m+10
m+10
m+10
Source
Workflow Notes
Sce Risque
DAJ
SAP
SAP+ PRF_FR1
SAP+ Sce
Trsorerie
Dpartement
Call Center
SIRIO
Rclamations
clients
Retours
physiques
FR et CP
FR et diteur
Editeur
Dpartement
Call Center
SAP
Responsable Code
FR
ECR 1
CP
ECR 2
PC
ECR 3
CP
PLT 1
CP
PLT 2
CP
PLT 3
RC
PLT 4
FR
PRF_FR 1
FR
PRF_FR 2
FR
PRF_FR 3
FR
PRF_FR 4
FR
PRF_FR 5
FR
PRF_FR 6
FR
PRF_FR 7
CP
PRF_GE 1
66
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Nombre et montant des retours PB par banque, par motif de
rejet
Mensuelle
Dlai courant de l'envoi du fichier PB jusqu' sa la rception
Dlai d'excution des PB
du retour par le service CP
Mensuelle
Nombre factures envoyes pour PB*Commission
Commission bancaires sur les PB
Mensuelle
Nombre rclamations encaissement Nombre des rclamations mises par les clients concernant
les encaissements
Mensuelle
Montant des impays fin m classs par chance
Impay fin du mois par chance
Mensuelle
Rcupration par niveau de relance Montant des encaissements relatives l'chance effectus
aprs entre deux niveaux de relance
Mensuelle
La pondration des dlais de retard moyens par chance.
Dlai moyen de retard
DMR= [Impay*(jours retard chance/2)]/ (total jours retard
chance/2)
Mensuelle
CSR=Montant des factures rcupres*Commission St de
Commissions Sts de Rec
Rec
Mensuelle
Cot de la LMD=Cot dition+Cot mise sous pli+Cot
Frais lettre de mise en demeure
affranchissement
Mensuelle
Nombre rclamations encaissement Nombre des rclamations mises par les clients concernant
la relance
Mensuelle
Retour PB par motif
m+10
m+10
m+10
m+10
m+10
m+10
Fichiers retours
CP
PRF_GE 2
CP
PRF_GE 3
CP
PRF_GE 4
RC
PRF_GE 5
CP
PRF_RF 1
CP
PRF_RF 2
CP
SAP+ Rapport
d'irrcouvrabilit PC
PRF_RF 3
Fichiers retours
Convention
bancaire
Dpartement
Call Center
SAP
SAP
PLT 1
m+10
m+10
m+10
m+10
Editeur
Dpartement
Call Center
PRF_RF 4
CP
PRF_RF 5
RC
PRF_RF 6
67
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Un autre outil de structuration logique et de standardisation de
l'information est la fiche dindicateur. Cest un document spcifiant les
caractristiques dun indicateur et offrant ainsi une base de comprhension et de
lecture de lindicateur. En annexe, on prsente deux fiches dindicateurs de
pilotage (Balance ge et DSO) et deux fiches dindicateurs de performance
(Taux derreur de facturation et Rejets par motif).
Section 2 : Structure physique du Tableau de Bord de gestion
La prsentation du tableau de bord est un lment crucial. En effet, au
del du contenu, la prsentation peut dterminer le degr de recours au tableau
de bord et donc dterminer son acceptation par les utilisateurs et sa russite.
Pour le Tableau de Bord de gestion de la Facturation Recouvrement nous
avons choisit de le gnrer sur Excel. Aussi, la premire page du tableau de bord
contiendra les indicateurs dclairage et de pilotage, quant aux pages suivantes
chacune sera rserve aux indicateurs de performance dun processus.
Pour chaque indicateur on adoptera la prsentation suivante :
Code indicateur: "Nom indicateur"
Couleur
Objectif
Ecart/Objectif Ecart/Rel(m-1)
Rel
Rel (m-1)
Couleur
Les carts par rapport aux objectifs (cette colonne ne sera pas renseigne
pour les indicateurs dclairage), ainsi que par rapport lhistorique sera
exprim en pourcentage. Cette faon dexprimer lcart plus judicieuse et se
prte mieux aux comparaisons.
Chaque cellule de calcul dcart (sur objectif ou sur rel m-1) sera remplie
par une des couleurs suivantes selon le sens dvolution de lcart :
Rouge pour un cart ngatif
Vert pour un cart positif
68
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Cris pour un cart neutre
Cette prsentation en couleur des carts permettra une lecture visuelle rapide du
tableau de bord. Cest lune des rgles de prsentation importante pour laquelle
on a insist car elle parat futile, mais en ralit elle trs utile pour la lecture et
lexploitation de notre Tableau de Bord de gestion.
Les premires pages du modle de Tableau de bord de gestion sont
prsentes en annexe (voir annexe 5 et annexe 6).
La deuxime partie de ce travail a t loccasion dexposer notre
dmarche de mise en place et den expliciter les diffrentes tapes. Cette
dmarche peut tre tendue tous les processus de lentreprise afin de construire
un systme global de tableaux de bord qui permettrait de dcliner le suivi de la
performance tous les niveaux de lentreprise et den impliquer aussi tous les
acteurs dans la recherche de la performance globale.
69
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Conclusion gnrale :
En partant dun besoin de matrise de la production de linformation de
gestion, dict par un changement organisationnel, on sest confront une
ralit : Lutilisation de linformation de gestion est cantonne sa fonction de
justification des ralisations. Ce constat nous a ouvert un champ dinvestigation
plus large et notre problmatique a acquis une nouvelle dimension : Comment
augmenter la valeur
ajoute de linformation de gestion ? Comment faire
voluer lutilisation de linformation de gestion dun moyen de justification des
ralisations un outil de suivi et de pilotage de la performance ?
Les enseignements thoriques du Master de Contrle de Gestion, nous ont
fait dcouvrire le concept des Tableaux de Bord de Gestion. Cet outil de
Contrle de Gestion qui constitue un systme dinformation lger, rapide,
synthtique et en phase avec le dcoupage organisationnel de lentreprise, nous a
paru porteur dlments de rponse notre problmatique.
Aussi, on nous basant sur une dmarche structure, nous nous sommes
adonner la tche ardue de mise en place dun Tableau de Bord de Gestion au
sein du dpartement Facturation Recouvrement de Mdi Telecom.
Cet exercice a t trs instructif plusieurs gards. La
recherche
thorique nous a permis dapprofondir nos connaissances concernant les
Tableaux de Bord et leur utilisation. Le diagnostic des processus et la
formalisation des activits nous a permis de dpasser certaines prsomptions et
nous a dvoil un autre aspect de notre vcu professionnel. Enfin, la mise en
uvre du Tableau de Bord de Gestion a t loccasion de sadonner lexercice
enrichissant de rflexion collective sur les leviers et les dterminants de la
performance.
La dmarche quon propose dans le cadre de ce travail est parfaitement
applicable tous les processus de lentreprise, qui en pourra tirer un grand profit
du fait quelle fait appel une rflexion collective, donc une implication
70
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
collective. De plus, les vertus des Tableaux de Bord, quon a longuement
dveloppes en premire partie, sont immenses et dpassent de loin les cots
ventuels de mise en place. Une entreprise dote dun systme de Tableaux de
Bord sassurera une plus grande ractivit tous les niveaux hirarchiques ; et
aussi une plus grande implication et cohsion travers une dclinaison des
objectifs axe sur des indicateurs dactivit et de performance, dont tous les
acteurs ont particip llaboration.
Toutefois, force est de constater que les Tableaux de Bord restent des
outils, tout comme linformation dailleurs, dont la valeur dpend uniquement de
lutilisation quon en fait.
71
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Bibliographie et sources :
Ouvrages :
C. SELMER, Concevoir le tableau de bord, Ed Dunod, 2003, 2 dition.
A. FERNANDEZ, Les nouveaux tableaux de bord pour piloter lentreprise, Ed
dOrganisation, 1999.
M. LEROY, Le tableau de bord au service de lentreprise, Ed dOrganisation,
1991.
M. GERVAIS, Contrle de Gestion, Ed Economica, 2000
C. GRENIER & C. MOINE, Construire le systme dinformation de lentreprise,
Ed Foucher, 2003
D. NANCI & B. ESPINASSE, Ingnierie des systmes dinformation, Ed Sybex,
1996
J-L. ROSET & D. VOYENNE, Le Credit Management en pratique, Ed
dOrganisation, 1997
Mmoires :
A. AGUELLID, Evaluation et proposition de refonte dun systme de tableaux
de bord, MSCG, ISCAE, AU : 2002-03.
B. SAFAA, Mise en place dun contrle budgtaire proactif au niveau de la
Direction Centrale Commerciale de Mdi Telecom, MSCG, ISCAE, AU : 200203.
N. BENAMER, Tableaux de bord prospectifs : Centrale Laitire, MSCG,
ISCAE, AU :2002-03
Cours du MSCG :
Support cours Mr. M.K. BEN OTMANE sur les tableaux de bord, Mai 2005.
Support cours Mr. J. CHARROIN sur les tableaux de bord, ISCAE, Juin 2005.
72
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Ressources WEB :
Site institutionnel Agence Nationale de Rglementation des
Tlcommunications (ANRT) : www.anrt.net.ma
Site institutionnel Mdi Telecom : www.meditelecom.ma
Intranet Mdi Telecom
73
ISCAE Mastre CG 2004-05
REFONTE DU TB DE GESTION DE LA FACT-RECOUVREMENT
Liste des annexes :
Annexe 1 : Fiche indicateur Balance ge
Annexe 2 : Fiche indicateur DSO
Annexe 3 : Fiche indicateur Taux derreur de facturation
Annexe 4 : Fiche indicateur Rejets PB par motif
Annexe 5 : Page Indicateurs synthtiques du modle Tableau de bord
Annexe 6 : Page Indicateurs de performance Facturation
74
Vous aimerez peut-être aussi
- TEF Format NewDocument94 pagesTEF Format NewSwapna Vasudevan Anand80% (5)
- Ceramiques PDFDocument6 pagesCeramiques PDFilhem antabli50% (2)
- 02-Propriétés de Base Du Sol Et de La Phase Liquide PDFDocument29 pages02-Propriétés de Base Du Sol Et de La Phase Liquide PDFAbdou HababaPas encore d'évaluation
- Usage Des FeuxDocument4 pagesUsage Des Feuxbenjamin duletPas encore d'évaluation
- EXP-MN-SE060-FR-R0 - La Génération D'électricitée PDFDocument127 pagesEXP-MN-SE060-FR-R0 - La Génération D'électricitée PDFanis louam100% (1)
- Arthur AronDocument2 pagesArthur ArontchekedadayaPas encore d'évaluation
- Etude Et Conception Dune Serre Agricole AutonomeDocument54 pagesEtude Et Conception Dune Serre Agricole AutonomeFati RetPas encore d'évaluation
- Exercices Mas PDFDocument6 pagesExercices Mas PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- TP N 4 - Réseaux Sans FilsDocument6 pagesTP N 4 - Réseaux Sans FilsFadhilaCelinePas encore d'évaluation
- Course V1oniris159001session03 - Semaine1 Biologie Des AbeillesDocument26 pagesCourse V1oniris159001session03 - Semaine1 Biologie Des AbeillesMeadanPas encore d'évaluation
- L 5S: S, S, S, S, S: ES Eiri Eiton Eiso Eiketsu HitsukeDocument2 pagesL 5S: S, S, S, S, S: ES Eiri Eiton Eiso Eiketsu HitsukeRaed ThebtiPas encore d'évaluation
- Rc3a9vision Dynamique Des Solides Indc3a9formablesDocument68 pagesRc3a9vision Dynamique Des Solides Indc3a9formablesyassinedabboussi42Pas encore d'évaluation
- PROCEDURE CAS en Milieu Professionnel Extra Milieu de Soins Version Validée ConvertiDocument5 pagesPROCEDURE CAS en Milieu Professionnel Extra Milieu de Soins Version Validée ConvertiFhimi JdidiPas encore d'évaluation
- Cours EntierDocument58 pagesCours Entiermohamed laghribPas encore d'évaluation
- Tp16 Concent Solute Effective Eleves A Distance CorrectionDocument4 pagesTp16 Concent Solute Effective Eleves A Distance CorrectionAthenais ManguelePas encore d'évaluation
- Fcts Trigo RecDocument4 pagesFcts Trigo RecWalid TliliPas encore d'évaluation
- 137Document2 pages137Oecox Cah DjadoelPas encore d'évaluation
- Préinscription À La Faculté Des Sciences Aïn Chock NDocument2 pagesPréinscription À La Faculté Des Sciences Aïn Chock Nphysiquesmp33Pas encore d'évaluation
- FICHE Eleve ParureDocument2 pagesFICHE Eleve ParureSoudosuPas encore d'évaluation
- Bassirou Ibo NourouDocument114 pagesBassirou Ibo NourouFatima Ezzahra KtaibPas encore d'évaluation
- Sommaire RdE 01032018Document44 pagesSommaire RdE 01032018trevisani-andreaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Objectifs Et Cadre de La CAEDocument4 pagesChapitre 1 - Objectifs Et Cadre de La CAEthibaut darmagnacPas encore d'évaluation
- Ecn-2060 A18 91298Document11 pagesEcn-2060 A18 91298Chris FloricPas encore d'évaluation
- Nouvelle-Calédonie: Militaire D'activeDocument6 pagesNouvelle-Calédonie: Militaire D'activeThomas Kirov AlbertPas encore d'évaluation
- Plaquette Primo Declarant V2Document4 pagesPlaquette Primo Declarant V2Tlahuizcalpantecuhtli SvobodaPas encore d'évaluation
- Poser Des MouluresDocument20 pagesPoser Des MouluresedysonePas encore d'évaluation
- SF2H Recommandations Hygiene Des Mains 2009Document102 pagesSF2H Recommandations Hygiene Des Mains 2009zeugma2010Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Eléments de Physique NucléaireDocument69 pagesChapitre 1 - Eléments de Physique NucléaireMohamed El Hadi Redjaimia100% (1)
- Dimentionnement D'une Installa - El Azzouzy Chaymae - 2389Document43 pagesDimentionnement D'une Installa - El Azzouzy Chaymae - 2389maria100% (1)
- Office de La Formation Professionnelle Et de La Promotion Du TravailDocument5 pagesOffice de La Formation Professionnelle Et de La Promotion Du TravailMohamed ChrifPas encore d'évaluation